Histoire socialiste/La Législative/La guerre ou la paix
La Législative (1791-1792) (1901-1908)
LA GUERRE OU LA PAIX
La Législative était une assemblée assez inconsistante et hésitante. Presque tous les nouveaux élus avaient une certaine expérience révolutionnaire. Au moins dix-neuf d’entre eux sur vingt, étaient des fonctionnaires électifs de la Révolution : maires, juges de paix, administrateurs du département ou du district, procureurs syndics, membres du directoire du département. Ils avaient vu de près et surveillé les grandes opérations révolutionnaires, la vente des biens nationaux. Ils avaient vu de près aussi les menées contre-révolutionnaires, les intrigues des nobles, les révoltes des prêtres insermentés. Ils étaient donc dévoués de tout cœur à l’ordre nouveau et avertis de ses périls
Mais ils n’avaient aucune politique bien nette. Beaucoup d’entre eux avaient été élus sous l’impression des événements de juin 1791. Ils avaient vu la Constituante se rallier désespérément à la royauté et il leur semblait impossible de tenter un autre chemin. La sanglante journée du Champ-de-Mars, dont la responsabilité fut attribuée aux démocrates, pesa aussi sur les élections.
À Paris, les modérés l’emportèrent. Danton fut battu, et c’est à grand’peine que Brissot fut élu après une dizaine de scrutins qui lui furent défavorables. Pourtant, Paris, qui dans les élections pour la Législative inclina vers les Feuillants, donna la majorité aux Jacobins et même aux Cordeliers dans les élections municipales. Pétion fut élu maire de Paris contre Lafayette, et Danton fut élu substitut du procureur de la Commune. Il y avait incertitude et flottement. Et il semble, qu’on pouvait dire de la Législative ce que Desmoulins disait, le 21 octobre 1792, de la Constitution elle-même : « Placée entre l’état populaire et l’état despotique, comme la roue d’Ixion entre deux pentes rapides, de manière que la moindre inclinaison devait la précipiter d’un côté ou de l’autre. »
La Législative allait-elle renforcer l’autorité royale ? Allait-elle développer au contraire la démocratie ? Tout d’abord, elle parut animée à l’égard de la royauté d’une sorte d’esprit ombrageux, et même, si on peut dire, de susceptibilité provinciale. Les journaux de la Cour raillaient les nouveaux législateurs venus « en galoches et en parapluies ». Ils signifiaient à l’Assemblée nouvelle que l’absence de toute aristocratie la rendait presque ridicule. La Législative eut la faiblesse de s’émouvoir de ces pointes et elle chercha à se donner, comme le disent tous ses orateurs, une « attitude imposante », un « caractère imposant ».
Mais, au lieu de chercher ce « caractère imposant » dans la fermeté de ses lois, dans la vigueur et la suite de ses décrets, elle s’attacha d’abord à des questions d’étiquette assez puériles. Réunie le 1er octobre, elle détruisit, en une de ses premières séances, le cérémonial réglé par la Constituante pour les rapports de l’Assemblée et du roi. Elle décida qu’on ne l’appellerait plus « Votre Majesté », attendu qu’il n’y avait que deux majestés : la majesté du peuple et la majesté de Dieu. Elle décida que le roi ne serait point assis dans un fauteuil doré et plus haut que celui du président, mais dans un fauteuil tout pareil.
Mais, comme le lendemain de ces décrets assez enfantins, il y eut une émotion assez vive dans la bourgeoisie parisienne, comme les anciens députés de la Constituante se scandalisèrent et gémirent, comme les actions à la Bourse baissèrent subitement sous la menace d’un conflit entre la Législative et le Roi, l’Assemblée, assez effarée, revint sur son vote. Les impétueux députés de la Gironde, qui avaient d’abord entraîné la Législative à ces manifestations un peu puériles, durent battre en retraite.
L’Assemblée choisit comme président un modéré, Pastoret, qui reçut le roi avec un discours fleuri où s’épanouissait « Sa Majesté », et qui alla jusqu’à lui dire : « Nous avons besoin d’aimer notre roi. » Tour à tour guindée et attendrie, la Législative ne prenait pas du tout, en ces premiers jours, le caractère « imposant » qu’elle avait recherché. Elle imagina aussi de donner au serment de fidélité que devaient prêter tous les législateurs, un apparat théâtral. Elle décréta qu’une députation irait chercher aux Archives l’exemplaire de la Constitution.
Ce furent les plus âgés des députés qui allèrent chercher le dépôt sacré. Quand ils rentrèrent dans l’Assemblée, elle se leva comme en une manifestation religieuse. C’était l’arche sainte qui passait. Des fervents proposèrent que pendant que la Constitution séjournerait ainsi dans l’Assemblée, aucun député ne fût admis à parler, de même qu’on ne parlait point quand le roi était présent. Devant le Saint-Sacrement de la Révolution le silence convenait.
L’Assemblée n’alla pas jusqu’à cette mysticité un peu ridicule. Mais les
propositions les plus étranges abondèrent : En jurant, les députés devaient
tenir tout le temps la main sur le livre de la Constitution. Interrompre une
seconde le contact eût été supprimer la vertu du serment.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
D’autres proposèrent que la formule du serment de fidélité à la Constitution, à la nation, à la loi, au roi, fût écrite en gros caractères sur une enseigne, et que cette enseigne dominât la tribune.
L’Assemblée voulait ainsi se donner je ne sais quoi de solennel, et les modérés essayaient de faire de la Constitution de 1791, si largement monarchique, une sorte de livre sacré.
Mais bientôt des difficultés pressantes et graves obligèrent la Législative à renoncer à ces cérémonies puériles et à faire face au péril. D’abord deux nouvelles sinistres lui parviennent, l’une d’Avignon, l’autre de Saint-Domingue.
À Avignon, un secrétaire de la mairie patriote, Lescuyer, est assassiné dans une église par la populace catholique fanatisée. Les patriotes crièrent vengeance, mais ils commirent la faute de laisser un bandit, Jourdan coupe-tête, prendre la direction. Celui-ci, aidé par des hommes ivres de colère et de sang, consomma les effroyables massacres de la Glacière.
À Saint-Domingue, les mulâtres et les noirs, exaspérés par la politique décevante de la Constituante, venaient de se soulever, et en une nuit, avaient incendié, pillé, massacré.
Mais quelque violents et douloureux que fussent ces événements, ils n’étaient point, pour ainsi dire, au cœur même de la Révolution. La révolte des colonies était lointaine ; le comtat venaissin était à peine annexé de la veille. Ce qui était plus inquiétant, sinon plus triste, c’est que partout la contre-révolution s’agitait, se ranimait à l’espérance. C’est que les émigrés, rassemblés en un petit corps de troupe sur nos frontières, multipliaient les excitations et les défis : c’est qu’en France même les prêtres réfractaires animaient les esprits, et qu’en Vendée notamment, les premiers feux de la guerre civile s’allumaient.
Mais s’il y avait partout des difficultés ou même des périls, la force de la Révolution restait immense, et il aurait suffi à la Législative d’une politique de fermeté et de sang-froid pour assurer le fonctionnement de l’ordre révolutionnaire. Mais c’est précisément le sang-froid qui faisait défaut à cette assemblée inexpérimentée et inconsistante. Tout contribuait à la déconcerter. D’abord, la disparition de la Constituante, de la grande assemblée, qui, si souvent, au 20 juin, au 14 juillet, puis au 21 juin 1792, avait sauvé la Révolution, encourageait les espérances factieuses.
Il semblait aux ennemis de la liberté que l’immense force révolutionnaire, qui les avait vaincus, n’était plus là, et que les destins allaient changer.
L’impuissance de la Constituante elle-même, après Varennes, sa soumission, en quelque sorte superstitieuse, à la royauté provocatrice et traîtresse, avait suggéré l’idée que la monarchie était intangible, qu’elle était la seule force durable et inviolable et qu’on ne risquait rien à se rallier autour d’elle.
Les persécutions, dirigées, à la suite des événements du Champ-de-Mars, contre les patriotes les plus ardents, poursuivis comme Danton jusque dans les assemblées électorales, exaltaient encore la confiance, l’esprit de sarcasme et de provocation des réacteurs.
L’heure semblait venue où la Révolution, lassée et comme effrayée de son propre mouvement, cessait de frapper ses ennemis et se frappait elle-même.
Avec de la prudence et de l’esprit de suite, la Législative aurait permis à l’énergie révolutionnaire de se reformer. Mais la Législative, sans passé, sans prestige, n’avait pas confiance en elle-même : et d’emblée elle crut qu’elle devait crier très fort, prodiguer les gestes de menace, pour se faire craindre. Les orateurs, jeunes, brillants, passionnés, qui abondaient en elle, les Grangeneuve, les Isnard, les Guadet, même Vergniaud, se plaisant à des émotions oratoires, lui communiquaient une ardeur désordonnée, fiévreuse, un peu factice et une sorte de fanatisme superficiel.
Entre les motions éblouissantes des Girondins et les conseils de modération débile et sournoise des Feuillants, l’Assemblée oscillait sans cesse et elle n’avait ni la suite dans la modération, ni la suite dans la vigueur.
Toute l’Assemblée avait je ne sais quoi de superficiel et d’artificiel. Elle ne portait point en elle la forte, saine et droite pensée du peuple, écarté du scrutin par la loi des citoyens passifs. Et d’autre part, la bourgeoisie dirigeante, très déconcertée et divisée au lendemain de Varennes, ne lui avait donné qu’un mandat trouble et incohérent. Elle était donc comme suspendue dans le vide et à la merci des souffles errants, des motions improvisées ou des intrigues savantes. Et la tentation devait venir naturellement aux habiles, à ceux qui se croyaient « des hommes d’État » de mépriser un peu cette Assemblée imprévoyante, et de la conduire par des raisons incomplètes vers des buts qu’on ne lui révélait qu’à demi.
C’est ainsi que soudain, en une séance, en un discours, Brissot fit surgir la question de la guerre. Or, c’était en partie, une question factice et qui masquait des desseins inavoués.
Pour nous, aujourd’hui, il n’y a pas de plus troublant problème. Il peut sans doute paraître puéril de refaire l’histoire après coup et de se demander ce qu’il fût advenu de la Révolution, de la France, de l’Europe, de l’univers, si la France révolutionnaire avait pu éviter la guerre.
Mais d’autre part, cette grande aventure de la guerre a fait tant de mal à notre pays et à la liberté, elle a si violemment déchaîné, dans la France de la philosophie et des droits de l’homme, les instincts brutaux, elle a si bien préparé la banqueroute de la Révolution en césarisme, que nous sommes obligés de nous demander avec angoisse : Cette guerre de la France contre l’Europe était-elle vraiment nécessaire ? Était-elle vraiment commandée par les dispositions des puissances étrangères et par l’état de notre propre pays ? Enfin, pour dire toute notre pensée, il nous répugnerait beaucoup de dégrader ou de méconnaître le patriotisme fervent, l’enthousiasme sacré qui se mêla à la grande aventure guerrière ; mais si à l’origine même de cette aventure héroïque nous démêlons une part d’intrigues, de roueries, de mensonges, c’est notre devoir d’avertir les générations nouvelles.
Je crois pouvoir dire, après avoir bien étudié les documents, que, pour une bonne part, la guerre a été machinée. La Gironde y a conduit la France par tant d’artifices, qu’on n’a pas le droit de dire que la guerre était vraiment inévitable.
C’est le 21 octobre 1791, à propos du débat sur les émigrants, que Brissot monta à la tribune. Avant qu’il eût parlé, il fut salué par les plus vifs applaudissements. Évidemment les initiés savaient quel coup il allait porter, quel horizon « plein d’éclairs » il allait ouvrir ; et avant même que le machiniste fît jouer le décor, ils exaltaient le sentiment de l’Assemblée.
Il commença par déclarer qu’il serait à la fois injuste et inutile de frapper la foule obscure des émigrants : Ce sont les chefs de l’émigration, les fonctionnaires publics ayant déserté leur poste ; ce sont les princes, les frères du roi qui doivent être sommés de rentrer, et s’ils désobéissent, déchus de leurs titres et droits.
Par là Brissot se flatte d’arrêter l’émigration, de frapper à la tête la contre-révolution.
Prétention étrange ! Car les princes français, décidés à la guerre à mort contre la Révolution, méprisaient tous les décrets de déchéance et de confiscation : que leur importaient les décrets des « rebelles » ? Et quant à leurs biens, ils les avaient déjà réalisés en partie, et, vainqueurs, ils les retrouveraient sans peine.
Brissot s’exalte pourtant, comme s’il y avait là une vue audacieuse et un moyen décisif de salut :
« Vous devez vous élever, Messieurs, à la hauteur de la Révolution. Vous devez faire respecter la Constitution par les rebelles, et surtout par leurs chefs, ou elle tombera par le mépris. Le néant est là : il attend ou la noblesse ou la Constitution : choisissez. (Vifs applaudissements.) Ce décret va vous juger. Ils vous croient timides, effrayés par l’idée de frapper sur des individus que la précédente Assemblée a épargnés. Qu’ils apprennent enfin que vous avez le secret de votre force…
« Craindriez-vous d’être imprudents en frappant ce coup ? C’est la prudence même qui vous l’ordonne. Tous vos maux, toutes les calamités qui désolent la France, l’anarchie que sèment sans cesse des mécontents, la disparition de votre numéraire, la continuité des émigrations, tout part du foyer de rébellion établi dans le Brabant, et dirigé par les princes français. Éteignez ce foyer en poursuivant ceux qui le fomentent, en vous attachant opiniâtrement à eux, à eux seuls, et les calamités disparaîtront. »
Quel enfantillage ou quelle manœuvre de prétendre que toute l’agitation contre-révolutionnaire tient au rassemblement de quelques milliers d’émigrés ! Quel enfantillage ou quelle manœuvre de prétendre que, pour arrêter toute cette agitation, il suffira de proférer contre les princes, chefs de l’émigration, des menaces que les législateurs ne pouvaient mettre à exécution !
Mais, soudain, avouant lui-même la futilité de ces mesures, Brissot met la France de la Révolution, non plus en face d’une misérable troupe d’émigrés, mais en face de l’Europe monarchique et féodale :
« Je vous l’ai déjà fait pressentir : toutes vos lois et contre les émigrants et contre les rebelles et contre leurs chefs seraient inutiles, si vous n’y joignez pas une mesure essentielle, seule propre à en assurer le succès, et cette mesure concerne la conduite que vous avez à tenir à l’égard des puissances étrangères qui maintiennent et encouragent ces émigrations et ces révoltes.
« Je vous ai démontré que cette émigration prodigieuse n’avait lieu que parce que vous aviez épargné les chefs de la rébellion, que parce que vous avez toléré le foyer de contre-révolution qu’ils ont établi dans les pays étrangers ; et ce fait n’existe que parce qu’on a négligé ou craint jusqu’à ce jour de prendre des mesures convenables et dignes de la nation française, pour forcer les puissances étrangères, d’abandonner les rebelles. »
« Tout présente ici, Messieurs, cet enchaînement de fraudes et de séductions. Les puissances étrangères trompent les princes, ceux-ci trompent les rebelles, les rebelles trompent les émigrants. Parlons enfin le langage d’hommes libres aux puissances étrangères et ce système de révolte, qui tient à un anneau factice, tombera bien vite ; et non seulement les émigrations cesseront, mais elles reflueront vers la France ; car les malheureux qu’on enlève ainsi à leur patrie désertent dans la ferme persuasion que des armées innombrables vont fondre sur la France et y rétablir la noblesse. Il est temps enfin de faire cesser ces espérances chimériques qui égarent des fanatiques ou des ignorants ; il est temps de montrer à l’univers ce que vous êtes, hommes libres et Français. » (Applaudissements prolongés.)
Hélas ! quelle mystification, et avec quelle facilité l’Assemblée se laisse prendre à des raisonnements aussi dangereux qu’enfantins ! Car s’il est vrai que les puissances étrangères trompent les émigrants, s’il est vrai qu’elles ne sont nullement disposées à mettre à leur service des soldats, la vérité ne tardera pas à éclater à tous les yeux : la déception ramènera bientôt les émigrants, et tout ce prestige s’évanouira sans que la France ait couru le risque d’indisposer les puissances étrangères par des fanfaronnades et des menaces. Si les puissances sont foncièrement pacifiques, pourquoi s’exposer à susciter en elles des sentiments belliqueux ?
Mais soudain, comme s’il avait senti la frivolité de sa thèse, Brissot jette le trouble dans l’esprit de l’Assemblée par la plus détestable exaltation et par les contradictions les plus étranges. Il fait appel au sentiment de la gloire, à l’amour-propre blessé. Il montre le peu de cas que les puissances font de la France révolutionnaire, de sa Constitution nouvelle. Partout, en tous pays, à Naples, en Russie, en Suisse, à Liège, nos ambassadeurs ne trouvent point les égards auxquels ils ont droit. Et Brissot, en un tableau effrayant et sommaire, nous montre un instant toute l’Europe conjurée contre nous :
« Est-il vrai que dans cette fameuse entrevue de Pilnitz, on ait conjuré la ruine de la Constitution française ? Est-il vrai qu’on y ait arrêté cette déclaration devenue publique, par laquelle les princes s’engagent à maintenir le repos de l’Europe et à tourner leurs armes contre la France, si elle ne donne pas satisfaction aux princes allemands ? Est-il vrai que le roi de Prusse, comme Électeur de Brandebourg, ait fait la même déclaration à la Diète de Ratisbonne ? Est-il vrai que l’Impératrice de Russie ait écrit cette lettre à l’Empereur, dans laquelle elle déclare qu’elle se croit obligée, par bien des considérations et pour le repos de l’Europe, à regarder comme sa propre cause la cause du roi des Français ? Est-il vrai qu’elle ait actuellement donné des sommes d’argent considérables aux chefs des rebelles, qu’elle leur ait envoyé, pour se concerter avec eux, un personnage distingué dans ses États ?…
« Est-il vrai que tous les princes aient arrêté de tenir un congrès à Aix-la-Chapelle pour modifier notre Constitution et rétablir la noblesse ? Est-il vrai que cet évident projet de congrès doive s’exécuter, malgré la déclaration faite par le roi qu’il accepte la Constitution ? »
Mais, si tout cela est vrai, il y a une conjuration universelle des souverains de l’Europe contre la France de la Révolution, et la guerre va éclater. Nous savons, nous, que cela n’est point vrai ; que Brissot, dans ces interrogations menaçantes, supprime toutes les nuances, ne tient aucun compte des difficultés sans nombre qui paralysaient les puissances, des réserves qui neutralisaient leurs déclarations. Nous savons déjà, notamment, qu’à Pilnitz l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse n’ont pris que des engagements incertains, subordonnés au concours des autres puissances qui, comme l’Angleterre, se dérobent. Mais enfin, si cela est vrai, il n’y a plus en effet à hésiter. Il faut révéler à la France toute l’étendue du péril et sonner dans tout le pays la guerre sainte pour la liberté.
Mais voici que soudain Brissot nous découvre qu’au fond les puissances veulent la paix, ou sont incapables de faire la guerre, et que tout cela n’est que fantasmagorie :
« Considérez, Messieurs, quelles puissances on veut vous faire redouter, et vous verrez si vous ne devez pas déployer toute votre énergie, soit à leur égard, soit à l’égard des rebelles qu’elles favorisent.
« Le peuple anglais aime notre Révolution, si son gouvernement la hait, et pour juger des forces de ce gouvernement, il faut ouvrir le registre des intérêts qu’il paye, entendre les volontaires de Dublin, parcourir les déserts de l’Écosse et suivre le lord Cornwallis à Seringapataam.
« C’est à Tippou, vainqueur ou vaincu, que nous devons la modération du gouvernement anglais ; il ne sera jamais à redouter tant qu’il aura à combattre ou à régir le vaste Hindoustan. Non que je veuille ici déprécier un peuple libre, avec lequel la nature des choses nous commande les liaisons les plus étroites, un peuple appelé à être notre allié, notre frère ; mais je veux, je dois calmer de vaines terreurs.
« Telles sont encore celles qu’inspire l’Autriche-Hongrie. Son chef aime la paix, veut la paix, a besoin de la paix. (Applaudissements.) Ses pertes immenses en hommes et en argent dans la dernière guerre, la modicité de ses revenus, le caractère inquiet et remuant des peuples qu’il commande, les mécontentements du Brabant que les prédications des Vonckistes, que les querelles des États avec le Conseil ne cessent d’allumer, la disposition des troupes qui ont pressenti la liberté, qui ont déjà donné des exemples funestes pour la discipline, encouragées par une condescendance inouïe dans les troupes autrichiennes, tout fait une loi à Léopold de recourir aux négociations et non aux armes.
« Les habitudes, les goûts et l’intérêt y porteront également l’héritier du grand Frédéric, qui ne peut en politique excuser sa coalition avec son ennemi, s’il veut être de bonne foi jusqu’au bout ; car la Révolution française ôte à l’Autriche une partie de son poids dans la balance germanique.
« Quant à cette princesse (Catherine de Russie), dont l’ambition ne connaît point de bornes, tout est uni contre elle : ses trésors épuisés, ses guerres ruineuses, les éléments, les distances. On a peine à subjuguer des esclaves à mille lieues ; on ne triomphe point d’hommes libres à cette distance. » (Applaudissements.)
Mais quoi ! et que veut donc Brissot ? Si malgré leurs manifestations contre-révolutionnaires les puissances ou désirent la paix, ou sont incapables de faire la guerre, si leur démonstration contre la liberté nouvelle de la France est une parade, elles y renonceront d’elles-mêmes quand elles verront que cette parade est vaine, que la France ne s’émeut pas. Il n’y a donc qu’une politique sensée : sauvegarder le sang-froid de la France et pratiquer la Constitution libre, sans souci de l’étranger. Par sa seule durée, la liberté révolutionnaire déjouera les manœuvres de l’étranger, et triomphera de tous ces simulacres d’hostilité.
Mais provoquer les puissances, leur tenir un langage menaçant, et s’exposer ainsi à convertir en résolutions réellement belliqueuses leurs parades grossières ou leurs velléités incertaines, c’est un crime contre la Révolution, livrée ainsi à tous les hasards. Ce crime s’aggrave quand, pour décider la France à ces démarches imprudentes, on exagère à plaisir la faiblesse et les embarras de l’étranger, dont les difficultés intérieures ne dépassaient certainement pas celles de la France elle-même. Et pourtant, après avoir égaré par ces sophismes une assemblée sans information et sans réflexion, Brissot la grise de paroles fanfaronnes :
« La France a le droit de dire aux gouvernements voisins : nous respectons votre pays, mais respectez le nôtre ; ne donnez plus d’asile aux mécontents, ne vous associez plus à leurs projets sanguinaires ; déclarez-nous que vous ne vous y associerez pas ; ou si vous préférez à l’amitié d’une grande nation vos rapports avec quelques brigands, attendez-vous à des vengeances ; la vengeance d’un peuple libre est lente, mais elle frappe sûrement. » (Applaudissements.)
Ô détestable griserie d’ignorance et d’orgueil. Même le Ça ira avait retenti dans le discours de Brissot « ce chant célèbre qui propagera jusque dans les derniers temps l’histoire de la Révolution. » Brissot donna lecture d’un projet de décret qui se terminait ainsi :
« Quant aux puissances étrangères qui favorisent les émigrants et les rebelles, l’Assemblée nationale réserve à cet égard de prendre les mesures convenables, après le rapport du ministre des Affaires étrangères ajourné au 1er novembre. »
C’était menaçant et vague : c’était la nuée perfide portant la guerre dans ses flancs. Quand Brissot descendit de la tribune d’où il avait laissé tomber tant de paroles contradictoires, aveuglantes et funestes, « une grande partie de l’Assemblée et des tribunes applaudit à plusieurs reprises. — Les applaudissements accompagnent M. Brissot jusqu’à sa place, et quelques minutes se passent dans l’agitation. » Ce fut une journée fatale.
Aucun orateur n’osa répondre nettement à Brissot qu’il compromettait témérairement la paix, et que la Révolution ne devait pas se risquer en cette grande aventure sans une connaissance certaine de l’état de l’Europe et sans une nécessité absolue. Les uns déclarèrent modestement et presque humblement qu’ils n’avaient que « quelques étincelles à ajouter aux grands éclairs de Brissot » ; d’autres se bornèrent à dire qu’il avait « transformé tout le champ de la discussion » et à demander un ajournement du débat.
Les journaux démocratiques furent un moment déconcertés. Le journal de Prudhomme, les Révolutions de Paris, qui tout à l’heure, va ouvrir contre la politique de guerre une si belle et si vigoureuse campagne, se tait tout d’abord. C’est à peine s’il mentionne le grand discours de Brissot et il ne le commente pas. Ce silence ou ce quasi-silence sur un discours aussi sensationnel est déjà significatif : c’est un blâme secret, qui n’ose s’exprimer encore. Marat lui-même est embarrassé ; lui, qui bientôt, se déchaînera contre Brissot avec tant de violence, il se réserve ; pourtant, avec sa clairvoyance aiguë, il a bien démêlé les sophismes et les contradictions du discours, mais on dirait qu’il n’ose prendre ouvertement à son compte les critiques qu’il suggère, et sa conclusion est bien vague. Dans son numéro du 25 octobre, il écrit : « Je ne suivrai point M. Brissot dans ses considérations sur nos rapports politiques avec les nations étrangères, que nous devons regarder comme ennemies, d’après les outrages qu’en éprouvent les Français, amis de la liberté.
« Il pense, qu’au lieu de nous attaquer de vive force, elles formeront entre elles, une médiation armée, pour reconnaître la noblesse, et nous donner le gouvernement anglais. Mais à quoi bon, dira peut-être quelque raisonneur, insister si fort sur la nécessité de les faire expliquer incessamment, sans attendre qu’elles nous attaquent à improviste puisque les plus redoutables sont peu faites pour nous intimider, tandis que les autres ne méritent que du mépris ? Et puisque nous n’avons rien à craindre de ces puissances, pourquoi s’inquiéter si fort des émigrants qui réclament leur appui ? Pourquoi les poursuivre à outrance sans distinguer les citoyens effrayés des lâches déserteurs et des traîtres perfides ?

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
« Ce sont les atteintes cruelles que ces puissances liguées avec les conjurés du dedans et du dehors peuvent porter à la liberté ; et les coups mortels qu’elles s’apprêtent de porter à la patrie, qui doivent enfin nous faire ouvrir les yeux sur les dangers qui nous menacent, et nous faire recourir à des mesures efficaces pour faire rentrer dans nos murs les fugitifs conspirateurs. »
Évidemment, les objections que Marat met dans la bouche du raisonneur, ont frappé Marat lui-même, et devant le discours de Brissot il ressent du malaise. Mais il n’est pas encore décidé à l’offensive.
Ainsi, dès son premier éclat, la politique belliqueuse semblait tout dominer. Et pourtant, jamais les dispositions des puissances ne furent plus incertaines. Jamais il ne parut plus facile, à une politique avisée, de conjurer toute agression et d’empêcher le concert des souverains. J’ai déjà cité la lettre du roi d’Angleterre qui refusait tout concours au roi de Suède et par son ferme propos de neutralité, réduisait à néant la convention de Pilnitz. J’ai cité aussi ce que Fersen écrit des dispositions tout à fait négatives de l’empereur Léopold. Il est certain qu’en octobre, au moment même où Brissot pousse la France à une démarche décisive, le désarroi et l’hésitation sont très grands à la Cour et chez les puissances.
La trahison royale continue. Ni Louis XVI, ni Marie-Antoinette n’acceptent la Révolution et la Constitution. Mais ils sont frappés de terreur, ils ont peur qu’une imprudence des émigrés expose leur liberté et leur vie même aux plus grands périls. Ils s’efforcent à paralyser l’émigration : et ils demandent aux souverains étrangers de former un Congrès. Ce Congrès essaiera d’imposer à la France une constitution nouvelle, plus respectueuse de la monarchie. C’est la trahison, mais la trahison mêlée de peur. Car Louis XVI et Marie-Antoinette craignent que si le Congrès des souverains procède d’emblée par la force, il ne provoque un soulèvement terrible de toute la France. Il faudrait qu’il pût agir par une sorte de pression. Mais cette pression ne sera efficace que si les puissances sont absolument unanimes.
Or, cette unanimité absolue est, à cette date, une chimère. Des puissances se réservent et elles tirent argument de l’acceptation de la Constitution par Louis XVI. Les princes, les émigrés, désavoués par le roi, redoutés par la reine, importuns aux puissances, s’exaspèrent tous les jours, mais d’une rage impuissante.
Le 20 octobre, le jour même où Brissot sonne la première fanfare de guerre, le comte de Fersen écrit au roi de Suède : « Sire, je suis assuré que l’intention de l’empereur est de regarder la sanction du roi de France comme bonne, et de ne rien faire en ce moment, sous prétexte qu’on ne peut pas lui donner un démenti. Mais la seule chose qu’on pourrait obtenir, serait l’annonce immédiate d’un Congrès, la fixation du lieu et la nomination des membres qui devraient le composer. Le prétexte de ce Congrès serait la prise de possession que l’Assemblée a faite d’Avignon. Il faudrait engager le pape à réclamer l’intervention de toutes les puissances de l’Europe contre une telle usurpation. La Cour d’Espagne pourrait indiquer cette démarche à Sa Sainteté. Je doute cependant encore de l’activité que l’empereur mettrait à cette démarche s’il n’y était poussé par les autres Cours. »
Marie-Antoinette écrit le 19 octobre à Fersen : « J’écris à M. de Mercy pour presser le Congrès. Je lui mande vous communiquer ma lettre ; aussi je n’entre pas en détail sur cela avec vous. J’ai vu M. du Montier qui désire fort aussi ce Congrès. Il m’a donné même des idées pour les premières bases, que je trouve raisonnables. Il refuse le ministère et je l’y ai même engagé. C’est un homme à conserver pour un meilleur temps, et il serait perdu. »
Et elle continue sa lettre par des paroles découragées, presque désespérées : elle ne sait si elle redoute davantage les Français du dehors, les émigrés, ou les Français du dedans, les révolutionnaires. « Tout est assez tranquille pour le moment, en apparence, mais cette tranquillité ne tient qu’à un fil et le peuple est toujours comme il était, prêt à faire des horreurs ; on nous dit qu’il est pour nous, je n’en crois rien, au moins pour moi. Je sais le prix qu’il faut mettre à tout cela ; la plupart du temps cela est payé, et il ne nous aime qu’autant que nous faisons ce qu’il veut. Il est impossible d’aller longtemps comme cela ; il n’y a pas plus de sûreté dans Paris qu’auparavant, et peut-être encore moins, car on s’accoutume à nous voir avilis… les Français sont atroces de tous les côtés : il faut bien prendre garde que si ceux d’ici (les révolutionnaires) ont l’avantage et qu’il faille vivre avec eux, ils ne puissent nous rien reprocher ; mais il faut penser aussi, que si ceux du dehors redevenaient maîtres, il faut qu’on puisse ne pas leur déplaire… »
C’est l’extrême frayeur : elle ne sait plus quel est le parti qui l’emportera et elle veut se ménager avec tous. Ce n’est plus la reine superbe et outragée qui calcule des moyens de revanche. C’est la créature humaine aux abois qui ne veut pas périr, et quelle tristesse pour elle de constater le néant de ces applaudissements « populaires », payés par la liste civile !
Le 21 octobre le baron de Taube écrit de Stockholm à Fersen : « Quant aux affaires de France voici ce que les princes disent dans leur lettre à l’impératrice (de Russie) : L’esprit de lenteur qui conduit les cabinets de Vienne et de Madrid, la mauvaise volonté de ce dernier, que nous avons de fortes raisons de croire vendu à nos ennemis ; les intrigues enfin du baron de Breteuil, car il est temps de le nommer à Votre Majesté, qui aime mieux de tout renverser que de voir réussir des projets qu’il n’a pas conçus lui-même, etc., etc. »
Ainsi, colère et déception chez les émigrés, terreur et duplicité chez la reine, indécision et paralysie des puissances : je ne sais quel effort stérile et informe de trahison et de guerre qui n’aboutit pas.
Le 31 octobre, Marie-Antoinette écrit à Fersen : « La lettre de Monsieur (comte de Provence et frère du roi) au baron (de Breteuil) nous a étonnés et révoltés ; mais il faut avoir patience et dans ce moment, pas trop montrer sa colère ; je vais pourtant la copier pour la montrer à ma sœur (Madame Élisabeth sœur de Louis XVI, qui tenait pour les princes). Je suis anxieuse de savoir comment elle la justifiera au milieu de tout ce qui se passe. C’est un enfer que notre intérieur ; il n’y a pas moyen d’y rien dire avec les meilleures intentions du monde. Ma sœur est tellement indiscrète, entourée d’intrigants, et surtout dominée par son frère au dehors, qu’il n’y a pas moyen de se parler, ou il faudrait quereller tout le jour. Je vois que l’ambition des gens qui entourent Monsieur, le perdra entièrement ; il a cru dans le premier moment qu’il était tout, et il aura beau faire, jamais il ne jouera ce rôle ; son frère (Louis XVI), aura toujours la confiance et l’avantage sur lui dans tous les partis, par la constance et l’invariabilité de sa conduite. Il est bien malheureux que Monsieur ne soit pas revenu tout de suite, quand nous avons été arrêtés, il aurait suivi alors toujours la marche qu’il avait annoncée : de ne vouloir jamais nous quitter, et il nous aurait épargné beaucoup de peines et de malheurs, qui vont peut-être résulter des sommations que nous allons être forcés de lui faire pour sa rentrée, à laquelle nous sentons bien, que surtout de cette manière, il ne pourra pas consentir.
« Nous gémissons depuis longtemps du nombre des émigrants ; nous en sentons l’inconvénient tant pour l’intérieur du royaume que pour les princes mêmes. Ce qui est affreux, c’est la manière dont on trompe et a trompé tous ces honnêtes gens, à qui il ne restera bientôt que la ressource de la rage et du désespoir.
« Ceux qui ont eu assez de confiance en nous pour nous consulter, ont été arrêtés, ou au moins s’ils ont cru de leur honneur de partir, nous leur avons dit la vérité. Mais que voulez-vous ? Le ton et la manie est, pour ne pas faire nos volontés, de dire que nous ne sommes pas libres (ce qui est bien vrai) ; mais que par conséquent nous ne pouvons pas dire ce que nous pensons et qu’il faut agir à l’inverse… Comme il est pourtant possible qu’ils fassent dans ce moment-ci, des sottises qui perdraient tout, je crois qu’il faut à tout prix les arrêter (les princes) ; et comme j’espère, d’après ce que vos papiers annoncent et la lettre de M. de Mercy, que le Congrès pourra avoir lieu, je crois qu’il faudrait leur envoyer d’ici quelqu’un de sûr qui pût leur montrer le danger et l’extravagance de leur projet : leur montrer en même temps notre véritable position et nos désirs, en leur prouvant que la seule marche à suivre pour nous, est, dans ce moment-ci, de gagner ici la confiance du peuple, que cela est nécessaire, utile même, pour tout projet quelconque ; qu’il faut que pour cela tout marche ensemble et que les puissances ne pouvant pas venir au secours de la France avec de grandes forces pendant l’hiver, il n’y a qu’un Congrès qui puisse rallier et réunir les moyens possibles pour le printemps.
«…L’Espagne avait encore une autre idée : mais que je crois détestable : c’est de laisser entrer les princes avec tous les Français, soutenus seulement par le roi de Suède comme notre allié, et déclarer par un manifeste qu’ils ne viennent pas faire la guerre, mais pour rallier tous les Français à leur parti et se déclarer protecteurs de la vraie liberté française.
« Les grandes puissances fourniraient tout l’argent nécessaire pour cette opération et resteraient, elles, au dehors, avec un nombre de troupes assez considérable, pour en imposer, mais ne rien faire, pour qu’on ne puisse prendre prétexte d’une invasion et crainte de démembrement. Mais tout cela n’est pas praticable comme cela, et je crois que si l’empereur se dépêche d’annoncer le Congrès, c’est la seule manière convenable et utile de finir tout ceci. Je n’entends point pourquoi vous désirez qu’on relève de suite les ministres et ambassadeurs (accrédités à Paris par les puissances), il me semble que ce Congrès étant censé, au moins dans le premier moment, d’être réuni tant pour les affaires qui intéressent toutes les puissances de l’Europe que pour celles de la France, il n’y a pas de raison à cette prompte retraite, et puis est-on sûr que toutes les puissances en agiront de même et croit-on que l’Angleterre, la Hollande, conduite par elle, et la Prusse même, pour déjouer les autres, ne laisseront pas peut-être leurs ministres ? Alors, il y aurait une désunion dans les opinions de l’Europe qui ne pourrait que nuire à nos affaires. Je peux me tromper ; mais je crois qu’il n’y a qu’un grand accord, au moins en apparence, qui puisse en imposer ici. »
Il est visible qu’il n’y avait point péril immédiat pour la Révolution, qu’elle avait le temps de s’organiser, de se fortifier à l’intérieur, de déjouer les intrigues et les trahisons et peut-être de s’imposer à l’Europe et aux rois par le prestige de sa force, sans se jeter au hasard des guerres.
Quelle imprudence à Brissot et à ses amis, d’animer et de coaliser par leurs défis, par leurs sommations, des souverains aussi incertains et aussi divisés !
Le 4 novembre encore, Fersen écrit de Bruxelles au roi de Suède : « Tout me confirme dans l’opinion que l’intention du cabinet de Vienne est de ne rien faire. Déjà il a, par ses discours, forcé le roi à sanctionner, mis les puissances du Nord, dont il craint l’entente, dans l’impossibilité d’agir. L’empereur vient de recevoir l’ambassadeur de France et les nouvelles lettres de créance qu’il lui a présentées ; il témoigne hautement, à Vienne, le contentement sur la sanction du roi de France, et après m’avoir dit que le seul moyen de venir au secours du roi serait une acceptation de la Constitution, sans y faire aucun changement, il présente cette même acceptation comme une raison pour ne pas s’en mêler. Je sais, en outre, que les arrangements qui avaient été pris pour la marche des troupes viennent d’être annulés, et le comte de Mercy s’explique froidement sur la convocation d’un Congrès. »
« Le prince de Kaunitz n’aime pas la France et verra avec plaisir l’abaissement de cette puissance. L’empereur est faible et se laisse mener par ses ministres, il est d’ailleurs personnellement anglais. L’empressement du roi de Prusse à soutenir le roi les effraye ; ils y voient le projet qu’il a sans doute de s’allier avec la France ; le leur est sans doute de se lier avec l’Angleterre, et quelques passages d’une conversation que le comte de Mercy a eue avec quelqu’un et dont j’ai eu le détail me confirment dans cette opinion. » Et ce qui ajoute au désarroi, c’est que la Cour de Russie blâme hautement comme une faiblesse, comme une désertion de la cause des souverains, l’acceptation même simulée de la Constitution par Louis XVI : c’est donc exactement le contraire de la tactique recommandée par l’empereur Léopold.
Le baron de Steding, ambassadeur de Suède à Saint-Pétersbourg, écrit au comte de Fersen le 25 octobre (5 novembre) : « Tout ce qui se fait aux Tuileries depuis un mois déroute tout le monde. Les Cours mal intentionnées et indécises en prennent occasion pour excuser leur inaction. Les ennemis de la monarchie applaudissent et les bons sujets du roi sont consternés.
« J’imagine quelquefois que l’intention de la reine est de s’attacher le peuple pour relever l’autorité royale par les mêmes mains qui l’ont détruite… Ce que je vous écris n’est pas uniquement mon sentiment à moi, c’est celui de S. M. l’impératrice (Catherine de Russie) qui a une bonne tête et le jugement très juste. »
Le comte Esterhazy écrit à Fersen de Saint-Pétersbourg le 28 octobre (6 novembre) :
« Nous ne nous étions pas trompés sur le ministère de l’empereur (Léopold). Il a fait du pis qu’il a pu pour nos affaires, et on a mandé ici même, du 15 octobre que le marquis de Noailles (ambassadeur constitutionnel de la France) avait déjà jour pour ses audiences. La conduite de cette Cour-ci (de Russie) est un peu différente. Elle parle hautement, mais n’agit pas encore, et la saison est un bon prétexte puisqu’on a tant retardé. La Suède professe les mêmes sentiments, mais peut-être un désir plus vif d’agir, mais pour que le succès soit sûr, les deux Cours désirent avec ardeur que l’union s’établisse entre les Tuileries et les princes…
« Expliquez-nous le peut-être du roi (Louis XVI). S’il est de bonne foi (en acceptant la Constitution), il se voue à l’avilissement aux yeux de son siècle et de la postérité, et s’il trompe, il en fait trop pour pouvoir être justifié par la nécessité ou par le danger. Je voudrais du moins qu’il prouvât, par une apparence de résistance, qu’il est forcé de tenter les démarches humiliantes que l’on exige de lui. Cela donnerait des armes à ceux qui veulent le servir, même malgré lui, et n’autoriserait pas l’inaction des faibles qui ne demandent qu’un prétexte.
« Je conviens que les bases de la présente Constitution sont si fausses qu’elle ne peut pas aller, mais tant qu’une force majeure ne dictera pas des lois sans égard à tout ce qui a été fait, on en gardera un peu, on détruira une partie, on en changera une autre, et de cet état inerte et incertain il résultera des désordres d’un autre genre qui produiront toujours l’anarchie et les maux qui en sont la conséquence.
« Vous, mon ami, dont, ainsi que moi, le seul désir est le bien de la famille royale, employez tous vos moyens pour prouver que sans accord on ne peut rien faire que du mal. Avant de savoir qui gouvernera la France, mettons la France en état d’être gouvernée ; et attendons, pour discuter à qui sera le ministère, qu’il y ait un roi. Tout retardement à cet égard est un mal si grand que pour peu qu’il se prolonge il sera sans remède. Est-il vrai que l’archiduchesse dit hautement que l’empereur ne donnera ni hommes ni argent et, puisque le roi est content de la Constitution, qu’on serait fou de courir des risques pour la changer ? Gare à elle ! En établissant ce principe-là, elle pourra bien se faire chasser encore une fois des Pays-Bas et croyez que la contagion gagnera vite partout où les souverains n’auront pas assez de caractère pour couper dans le vif dès que la gangrène les gagnera. »
Ainsi, tandis que l’empereur d’Autriche ne se décide nullement et cherche toute sorte de raisons pour ne pas intervenir en France, tandis que l’Angleterre proclame sa neutralité absolue, les Cours du Nord, Suède et Russie, parlent assez haut mais agissent peu, et surtout, mettent pour condition à leur action un changement impossible dans le système de Louis XVI. Elles lui demandent de préparer le rétablissement de l’absolutisme qui lui apparaît à lui-même impraticable. Elles lui demandent enfin, de se découvrir aux yeux des Français et de marquer si bien que son acceptation de la Constitution est forcée, qu’aucun Français ne pourra un instant avoir confiance en lui. C’est dans ce sens que le roi de Suède écrit à Fersen le 11 novembre : « La conduite équivoque de ce prince (l’empereur d’Autriche) et ses tergiversations continuelles nous présageaient le parti qu’il avait pris depuis longtemps, et tout ce qu’il faisait n’était que pour empêcher les autres puissances d’agir, en leur faisant perdre du temps ; mais il est vrai que la conduite honteuse du roi de France a favorisé merveilleusement ses projets, et, quoique nous devions nous attendre à des démarches faibles, la conduite de la Cour de France a sûrement passé en lâcheté et en ignominie tout ce qu’on pouvait en présumer et que le passé pouvait indiquer ; mais ce qui est bien plus fâcheux, c’est qu’après avoir autant dégradé sa dignité il travaille encore à mettre des entraves aux efforts que ses frères et les puissances qui s’intéressent au sort de ce prince et au bien de la France peuvent faire pour le secourir ; et si la reine préfère la sujétion et le danger où elle vit à la dépendance des princes ses frères (ses beaux-frères) qu’elle paraît plus redouter, quoique bien à tort, je dois vous dire que l’impératrice (de Russie) est très mécontente de cette conduite. »
Et le roi de Suède va jusqu’à traiter Marie-Antoinette en suspecte qui doit donner par écrit des gages de sa haine contre la Révolution : « Vous devez donc fortement représenter à la reine, la nécessité pour elle de donner des assurances par écrit qui prouvent la violence qu’on lui fait et a faite depuis qu’elle a reparu sous une apparente liberté, pour que cet écrit soit une arme contre les prétextes dont se servira l’empereur et forcer ce prince à prendre seulement sur lui la honte de sa conduite qu’il tâche maintenant de rejeter sur la sienne. »
Ainsi, parmi les ennemis de la Révolution, discordance, méfiance, paralysie. Et cette impuissance devient si aiguë que le 26 novembre 1791, Fersen, dans un mémoire à Marie-Antoinette où il résume tout l’état des choses lui demande formellement de ne plus compter sur l’empereur d’Autriche et de se passer de son concours : « s’il est vrai, comme je le crois, que vous ne puissiez plus compter sur l’empereur, il faut absolument tourner vos espérances d’un autre côté, et ce côté ne peut être que le Nord et l’Espagne, qui doit décider la Prusse et entraîner l’empereur. »
Mais ce plan est puéril. Que serait un Congrès des souverains se proposant de rétablir l’autorité de Louis XVI et où le frère de Marie-Antoinette, l’empereur d’Autriche, ne viendrait pas ou ne viendrait que par force ? D’ailleurs, Fersen lui-même ne pouvait penser que le roi de Prusse commît l’imprudence de s’engager dans une politique qui pouvait mener à la guerre sans y engager en même temps l’empereur d’Autriche. Dans le mémoire du 29 novembre il écrit : « On me mande de Berlin : « L’impératrice de Russie a écrit au roi de Prusse pour l’inviter de la manière la plus pressante d’entrer avec elle dans des mesures rigoureuses, pour faire rendre au roi de France sa liberté et les prérogatives de son trône. S. M. Prussienne a répondu qu’elle était prête et qu’elle persistait dans les sentiments déclarés à Pilnitz, pourvu que toutes les autres puissances, mais surtout l’empereur, voulussent coopérer au même but. On a fait dire également aux princes qu’ils n’ont qu’à se régler ici strictement d’après ce que fera la Cour de Vienne et que si celle-ci reste inactive le roi de Prusse ne fera rien de son côté. »
Il n’y a donc que l’impératrice de Russie qui semble décidée. Et elle joue trop visiblement un jeu égoïste. Elle sait bien que, à raison même de la distance, elle ne sera tenue d’engager contre la France révolutionnaire qu’une part infime de ses forces ; nul ne put prévoir alors le formidable duel de Napoléon et de la Russie. Catherine, précipitera donc toute l’Europe dans une guerre contre la France ; cette guerre sera d’autant plus violente, d’autant plus longue, elle absorbera d’autant plus les forces de l’Autriche et de la Prusse que l’on prétendra imposer à la France de la Révolution un régime plus despotique et des conditions plus dures. Et pendant ce temps, l’influence de la Russie sera souveraine en Pologne, en Turquie, sur les rives du Danube. La seule puissance qui parle haut cherche donc à pousser les autres dans un piège, et son empressement même ajoute à la méfiance et à l’incertitude générale.
Louis XVI et Marie-Antoinette ne se laissent pas entraîner, malgré tout, vers la politique des émigrés. Et ils s’obstinent à espérer de l’Empereur la réunion d’un Congrès. Le 19 octobre, Marie-Antoinette écrit au comte de Mercy-Argenteau : « Je vous ai mandé mon idée sur un Congrès. Tous les jours cette mesure devient plus pressante ; les frères du Roi sont eux-mêmes dans une position, par le nombre des personnes qui les ont rejoints, à n’être plus maîtres de contenir ceux qu’ils voudraient, et peut-être seront-ils forcés de marcher sous peu. Jugez de l’horreur de leur position et de la nôtre. D’un côté nous sommes obligés de marcher contre eux, et cela ne se peut pas autrement, et de l’autre, nous serons encore soupçonnés ici, d’être de mauvaise foi et d’accord avec eux…

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
« On ne peut voir sans frémir les suites d’un tel événement et à quoi nous serions exposés ici. Il faut donc à tout prix le prévenir, et ce n’est que l’Empereur qui le puisse, en commençant le Congrès, en indiquant de suite le lieu et quelques-uns des membres qui le composeront. »
On pourrait croire par un billet de Mercy à Marie-Antoinette, du 26 octobre, que l’Empereur se rallie en effet à l’idée d’un Congrès : « On avait réglé d’avance tout ce qu’indique la note du 19 sur l’utilité d’un Congrès, il est plus que probable que les puissances s’y rallieront. On y est très décidé à Vienne, où cette même note du 19 sera envoyée sans retard. Les princes se plaignent maintenant de l’Empereur et lui attribuent tous les délais et obstacles à leurs projets. Le monarque est très dégoûté de pareils procédés ; il emploie tous les moyens qui sont en son pouvoir pour arrêter les projets actifs des princes. »
Mais dès le 21 novembre, Mercy-Argenteau apprend à Marie-Antoinette qu’elle ne doit pas compter sur le Congrès. L’Empereur estime que le Roi doit faire l’essai de la Constitution. Il doit tout au moins tenter de ramener à lui les esprits et c’est seulement « s’il arrivait le contraire » de ce qu’on peut se promettre de cette politique, que les puissances interviendraient. « Partant de ce plan, on croit un Congrès inutile, même impossible. On ne peut traiter avec les usurpateurs de l’autorité souveraine ; le roi ne peut se charger de leur mandat, et s’il s’en chargeait, que pourrait-on lui demander qui ne fût en contraste avec les engagements qu’il vient de prendre puisque tout ce qui serait demandé ne pourrait l’être qu’au nom et pour le roi ? ce monarque se chargeant de traiter, aurait à soutenir le pour et le contre. Si, sur un refus on se détermine à faire la guerre, à qui la fera-t-on ? puisqu’après l’acceptation on ne peut plus séparer le roi de l’Assemblée nationale. »
L’empereur d’Autriche ne se borne donc pas à refuser toute intervention diplomatique comme toute intervention armée, il essaie de persuader à Louis XVI et à Marie-Antoinette que liés par leur acceptation de la Constitution ils sont condamnés à l’incohérence et à l’impuissance s’ils n’agissent pas dans le sens de la Constitution.
Louis XVI insiste encore par un mémoire du 25 novembre à l’adresse du baron de Breteuil : « Toute la politique doit se réduire à écarter les idées d’invasion que les émigrés pourraient tenter par eux-mêmes : ce serait le malheur de la France si les émigrés étaient en première ligne, et s’ils n’avaient des secours que de quelques puissances.
« Qui dit que d’autres, comme l’Angleterre, ne fourniraient pas au moins en secret des secours à l’autre parti, et ne tireraient pas avantage de la fâcheuse situation de la France se déchirant elle-même ?
« Il faut persuader aux émigrés qu’il ne feront rien de bien d’ici au printemps ; que leur intérêt ainsi que le nôtre demande qu’ils cessent de donner des inquiétudes. On sent bien que s’ils se croyaient abandonnés, ils se porteraient à des excès qu’il faut éviter ; il faut porter l’espérance des uns au printemps et pourvoir aux besoins des autres. Un Congrès atteindrait le but désiré, il pourrait contenir les émigrés et effrayer les factieux.
« Les puissances conviendraient ensemble du langage à tenir à tous les partis. Une démarche combinée entre elles ne peut qu’en imposer sans nuire aux intérêts du roi ; outre leurs intérêts particuliers, il se trouvera peut-être des occasions où ces interventions seraient nécessaires : si, par exemple, on voulait établir la république sur les débris de la monarchie. Il n’est pas possible non plus qu’elles voient sans inquiétude, Monsieur et Monsieur le comte d’Artois ne revenant pas, le duc d’Orléans le plus près du trône ; que de sujets de réflexions !
« Le langage ferme et uniforme de toutes les puissances de l’Europe, appuyées d’une armée formidable, aurait les conséquences les plus heureuses ; il tempérerait l’ardeur des émigrés, dont le rôle ne serait plus que secondaire. Les factieux seraient déconcertés et le courage renaîtrait parmi les bons citoyens amis de l’ordre et de la monarchie. Ces idées sont pour l’avenir et pour le présent… Le roi ne peut ni ne doit par lui-même revenir sur ce qui a été fait ; il faut que la majorité de la nation le désire ou qu’il y soit forcé par les circonstances, et dans ce cas il faut qu’il acquière confiance et popularité en agissant dans le sens de la Constitution ; en la faisant exécuter littéralement, on en connaîtra plus tôt les vices, surtout en écartant les inquiétudes que donnent les émigrés. S’ils font une irruption sans des forces majeures, ils perdront la France et le roi. »
Mais même cette combinaison d’un Congrès européen, sur laquelle le maître fourbe comptait pour arracher à la France, sans péril pour lui-même, la Constitution libre à laquelle il avait juré fidélité, échappait décidément au roi et s’effondrait. Le 30 novembre Mercy renouvelle avec une sorte d’impatience et d’irritation, le refus de l’Empereur. Il écrit à Marie-Antoinette. « On a rendu compte des raisons qui s’opposent à un Congrès, — bien d’autres considérations politiques rendaient ce Congrès plus nuisible qu’utile à la France, et on en a des indices plus que vraisemblables. Il s’est formé un plan par lequel on voudrait conduire l’Empereur à se charger de tous les hasards, de tous les risques réels, tandis que l’on se tiendrait à couvert des uns et des autres. »
Entre le baron de Breteuil et le comte de Mercy avait eu lieu une explication très vive que raconte Fersen dans le mémoire du 26 novembre ;
« Le refus que fait l’Empereur du Congrès est une nouvelle preuve combien peu vous pouvez compter sur ses secours et combien il est intéressant que vous vous adressiez ailleurs. Le baron a eu à ce sujet une conversation très vive avec M. de Mercy, et il lui a exprimé toute sa sensibilité sur le peu d’intérêt que l’Empereur prenait à votre situation, et où il lui a articulé qu’il prévoyait que l’impératrice de Russie aurait le plaisir d’avoir fait ce que l’Empereur n’avait pas voulu tenter ; que ce serait à elle et au roi de Suède que le Roi aurait des obligations qu’il lui aurait été plus doux d’avoir à l’Empereur ; que dans ce cas l’Empereur devait au moins le dispenser de la reconnaissance et ne pas être étonné de celle qu’il témoignerait à ceux qui lui auraient rendu un aussi grand service. M. de Mercy s’est fort mal défendu ; il a allégué qu’un Congrès ne serait d’aucune utilité et qu’il n’aurait rien d’imposant, que faute d’objets à traiter il resterait inactif…, etc. » Faute d’objets à traiter : l’Empereur d’Autriche s’interdisait donc de peser sur la politique intérieure de la France.
Donc dans l’automne de 1791, dans les deux premiers mois de la Législative, en octobre et novembre, deux grands faits sont certains : le premier c’est que la trahison du roi continue. Elle est plus prudente, et comme resserrée par la peur. Elle est aussi coupable.
Le roi veut détourner de lui les entreprises compromettantes des émigrés, mais il persiste, en fait, à appeler l’invasion des étrangers, car ce Congrès, « appuyé d’armées formidables », est le prélude de l’invasion : si la France, en effet, n’accepte pas la Constitution plus qu’à demi-despotique que le Congrès lui proposera, c’est par la force des armes que celui-ci tentera de l’imposer. Donc le roi trahit toujours, quoique d’une main tremblante. Voilà le premier fait incontestable ; et le second, c’est l’hésitation de l’Europe monarchique ou son impuissance à intervenir.
Ces deux faits auraient dû commander toute la politique de la Législative. Elle devait surveiller étroitement les menées du roi, lui imposer des ministres patriotes, amis de la Révolution, se tenir prête à soulever contre lui l’opinion et le peuple, le jour où une démarche coupable aurait révélé sa trahison secrète et s’appliquer avec un soin infini à ne pas provoquer l’Europe, à éviter toutes les chances de guerre.
Tout au contraire, sous l’impulsion de Brissot, la Législative, dans cette période d’octobre 1791 à avril 1792, ménage le roi qui trahissait et provoque l’étranger qui ne voulait point attaquer. Comment expliquer cet immense et funeste malentendu ? Je sais bien que Brissot était un esprit remuant et brouillon. Il avait une haute idée de lui-même, un souci constant de sa personnalité. Il raconte dans ses mémoires qu’enfant, quand il lisait des nouvelles sur les jeux et l’éducation du fils du roi, il se disait à lui-même : « Pourquoi lui, et pourquoi pas moi ? « Il avait fait beaucoup de lectures superficielles et hâtives et il se croyait en état de parler de tout. Il avait séjourné à Londres : il connaissait l’étranger un peu mieux que ses collègues de la Législative et de la presse révolutionnaire, et il affectait de parler toujours des États-Unis, de l’Angleterre, des affaires du monde. Quelle gloire si, par lui, la Révolution emplissait l’horizon universel ! Il rêvait un vaste embrasement de liberté dont la France aurait été le foyer, et sans calculer les périls et les forces il méditait des coups de théâtre. La Constituante s’était enfermée étroitement dans la politique intérieure : elle avait répudié tout esprit de conquête, toute propagande systématique au dehors : elle avait même résisté longtemps à accepter la libre adhésion du Comtat Venaissin pour ne pas éveiller la défiance de l’étranger. Aux hommes nouveaux la politique intérieure ne semblait offrir ni des émotions fortes, ni des promesses de gloire. La Constitution était fixée ou le semblait, et si incomplète, si imparfaite qu’elle fût aux yeux des démocrates, ils ne pouvaient la renouveler par un coup d’éclat. Il ne leur restait donc au dedans que la tâche ingrate d’éteindre l’insurrection cléricale, d’assurer les finances, de veiller au fonctionnement d’un mécanisme que d’autres avaient construit. Dans cette besogne nécessaire et admirable mais modeste, l’impatience vaniteuse et affairée de Brissot était mal à l’aise. Aussi se tournait-il vers le dehors, vers le monde. Là, des complications infinies pouvaient donner aux habiles, aux « hommes d’État », matière d’action, matière de renommée. Mais comment jeter la France dans la vaste mêlée du monde ? Comment lier le mouvement révolutionnaire si nettement clos jusque-là, au mouvement universel ?
Brissot ne voulait pas attendre que l’exemple de la France libre et heureuse agît tout naturellement sur les autres peuples. Il voulait échauffer les événements. Et il agrandit soudain cette pauvre petite question des émigrés, pour ouvrir tout à coup devant la France je ne sais quelle perspective troublante et enivrante d’action infinie. Par cette pauvre lucarne soudain élargie, Brissot commence à jeter au monde un regard de défi.
Mais comment une grande partie de l’Assemblée et de l’opinion le suit-elle ? Comment la France, qui semblait si résolument pacifique sous la Constituante, prend-elle une attitude belliqueuse ? Elle parle encore de paix : mais il est visible qu’elle ne désire pas passionnément éviter la guerre, qu’elle n’en prévoit pas tous les périls et qu’au fond de son âme je ne sais quoi d’inquiet, d’ardent et d’aventureux l’appelle. Est-ce que l’Assemblée ne connaissait pas la situation exacte ? Est-ce qu’elle s’exagérait le parti-pris de guerre des souverains étrangers ? Mais nous avons vu que même dans le discours si contradictoire et si dangereux de Brissot il reconnaissait que l’Europe voulait la paix.
Et nous verrons bientôt, par les paroles mêmes de ceux qui après Brissot poussèrent à la guerre, notamment par les paroles de Rühl et de Daverhoult qu’ils connaissaient exactement l’état des choses et la pensée des puissances. Les Girondins, d’autre part, pouvaient-ils avoir une absolue confiance dans le roi ? pouvaient-ils avoir oublié la fuite de Varennes et la violation de tant de serments ? D’où vient donc, à ce moment, cette subite étourderie guerrière de la Révolution ? D’où vient cette imprudence provocatrice à l’égard de l’étranger, et cette apparente confiance au roi ?
Une sorte d’énervement semblait gagner les esprits. La résistance des nobles, des prêtres se prolongeait au delà du terme prévu, et les jeunes orateurs de la Législative témoignaient leur colère en paroles véhémentes, qui ôtaient aux esprits le sang-froid ; ils portaient peu à peu dans les questions étrangères, où tant de prudence eût été nécessaire à ce moment, les mêmes habitudes de déclamation passionnée. Isnard s’écriait le 31 octobre, à propos des émigrés :
« Quoique nous ayons détruit la noblesse et les députés, ces vains fantômes épouvantent encore les âmes pusillanimes. Je vous dirai qu’il est temps que ce grand niveau de l’égalité que l’on a placé sur la France libre, prenne enfin son aplomb. Je vous demanderai si c’est en laissant quelques têtes au-dessus des lois que vous persuaderez aux citoyens que vous les avez rendus égaux ; si c’est en pardonnant à tous ceux qui veulent nous enchaîner de nouveau que nous prétendons continuer de vivre libres ; je vous dirai à vous, législateurs, que la foule des citoyens français qui se voit, chaque jour, punie pour avoir commis les moindres fautes, demande enfin à voir expier les grands crimes ; je vous dirai que ce n’est que quand vous aurez fait exécuter cette mesure que l’on croira à l’égalité et que l’anarchie se dissipera. Car ne vous y trompez pas : c’est la longue impunité des criminels qui a fait le peuple bourreau. (Applaudissements.) Oui, la colère du peuple comme celle de Dieu n’est trop souvent que le supplément terrible du silence des lois. (Vifs applaudissements.) Je vous dirai : Si nous voulons vivre libres, il faut que la loi, la loi seule nous gouverne, que sa voix foudroyante retentisse dans le palais du grand comme dans la chaumière du pauvre, et qu’aussi inexorable que la mort, lorsqu’elle tombe sur sa proie, elle ne distingue ni les rangs, ni les titres. »
Paroles enflammées où Marat reconnaissait avec joie son propre langage : discours « rayonnant de sagesse et brûlant de civisme », dit-il du discours d’Isnard.
Mais aussitôt, c’est du même ton échauffé qu’il parle de l’Europe : « Un orateur vous a dit que l’indulgence est le devoir de la force, que la Russie et la Suède désarment, que l’Angleterre pardonne à notre gloire, que Léopold a devant lui la postérité ; et moi, je crains, Messieurs, je crains qu’un volcan de conspirations ne soit près d’éclater et qu’on ne cherche à nous endormir dans une sécurité funeste. Et moi, je vous dirai que le despotisme et l’aristocratie n’ont ni mort ni sommeil ; et que si la nation s’endormait un instant, elle se réveillerait enchaînée. » (Applaudissements.)
Ce fut un malheur immense pour la Législative et pour le pays qu’il ne se soit trouvé à cette heure, à la Législative même, aucun homme d’un grand sens révolutionnaire qui, tout en animant l’ardeur sacrée de la nation pour la liberté, la mit en garde contre tous les entraînements belliqueux. Ah ! si Mirabeau avait vécu, et vécu libre de toute attache secrète avec la Cour, c’est son génie à la fois révolutionnaire et lucide, véhément et sage qui aurait peut-être sauvé la liberté et la patrie.
Mais, ni les prétentions inquiètes de Brissot, ni les entraînements oratoires et la rhétorique guerrière d’Isnard ne suffisent à expliquer ce grand fait si étrange : Comment, dans l’automne de 1791, la Révolution se découvre-t-elle subitement une âme guerrière ? Voici je crois, l’explication décisive. Il y avait dans les consciences révolutionnaires à la fin de 1791 et en 1792, un immense malaise, un commencement de doute, et la guerre apparaissait obscurément comme un moyen détourné de trancher des problèmes que directement la Révolution ne pouvait résoudre. Elle se débattait dans une difficulté terrible.
Son point d’appui était la Constitution : en la brisant, elle craignait de tout livrer aux ennemis de la liberté. Mais, cette Constitution donnait au roi de tels pouvoirs par la liste civile, par le choix des ministres, par le veto suspensif étendu à deux législatures, que le roi, s’il était de mauvaise foi, pouvait légalement, constitutionnellement, fausser la Révolution, la remettre désarmée à l’ennemi. Or le roi, pouvait-on vraiment avoir confiance en lui ? On l’avait mis hors de cause après Varennes et il avait accepté la Constitution : il semblait même, extérieurement, s’y conformer ; mais que de raisons de douter de lui ! Ne pouvait-il négocier secrètement avec l’étranger ? Quelle garantie avait la nation ? Et, devant la figure énigmatique, devant l’âme incertaine et si souvent traîtresse du roi, la nation révolutionnaire avait un malaise. Qui déchiffrerait cette énigme ? Quel feu éprouverait ce métal équivoque et mêlé ? Ah ! s’il y avait une grande guerre, si le roi était obligé de marcher contre les souverains étrangers armés en apparence pour sa cause, il serait bien obligé de se découvrir, de se révéler enfin ! ou il mènerait loyalement la guerre, et la Révolution, sûre de lui, serait enfin débarrassée du soupçon qui la hantait et l’énervait, ou il trahirait, et cette trahison du roi envers la nation donnerait à la nation la force d’exécuter le roi. Qu’on se figure l’état d’un peuple qui se demande tout bas chaque jour ce que fait son chef, s’il est fidèle ou félon, ou s’il ne combine pas en des proportions inconnues et variables, fidélité et félonie.
Il y a là pour lui une énigme à la fois menaçante et irritante, une de ces obsessions maladives dont il faut se débarrasser à tout prix. Mais quoi ? Ne vaut-il pas mieux faire appel à l’énergie révolutionnaire du peuple et jeter bas le roi suspect que de demander à une guerre peut-être funeste je ne sais quelle épreuve de l’équivoque loyauté du roi ? Oui, mais à la fin de 1791, les révolutionnaires démocrates ne croyaient plus au ressort révolutionnaire du peuple. Et à vrai dire, la Révolution elle-même l’avait si souvent comprimé, elle avait si souvent contrarié les mouvements populaires en leurs efforts décisifs qui semblait naturel de ne plus compter sur un élan tant de fois refoulé.
Le peuple au 17 juillet avait pétitionné pour la République ; la Révolution même avait noyé sa pétition dans le sang. Le peuple se taisait maintenant, et sans doute nulle autre brûlure que celle des guerres extérieures ne pourrait l’arracher à son engourdissement. Ainsi ce n’est pas, comme l’ont répété tant d’historiens, l’enthousiasme débordant de la liberté qui a suscité la guerre.
Ce n’est pas de l’exaltation révolutionnaire, c’est au contraire d’une défaillance de la Révolution qu’elle est sortie. Les témoignages abondent sur cet affaissement, sur ce découragement des démocrates, des révolutionnaires dans la période même où flambaient les discours guerriers. Marat a, à cette époque, une crise de désespoir.
Dans le numéro du 21 septembre, il proclame que la Révolution est perdue, et il trace un tableau admirable des forces conservatrices qui se sont développées en elle et qui semblent la maîtriser. « Nous avions conquis la liberté par la plus étonnante des révolutions, mais à peine en avons-nous joui un jour, nous l’avons laissé perdre par notre stupidité, par notre lâcheté et nous en sommes plus loin aujourd’hui qu’avant la prise de la Bastille. On veut que nous ayons des lois qui établissent nos droits ; j’ai démontré cent fois que ces lois sont dérisoires ; mais quand elles ne seraient pas oppressives elles-mêmes, ceux qui sont chargés de leur exécution sont les plus implacables ennemis de la patrie ; ils les font taire ou parler à leur gré ; tour à tour ils les interprètent en faveur des ennemis et contre les amis de la liberté, et toujours les défenseurs des droits du peuple sont immolés avec le glaive de la justice. »
« Ceux qui font honneur de la Révolution à notre courage attribuent la perte de la Révolution à notre défaut actuel d’énergie ; ils se plaignent de ce qu’elle a toujours été en s’affaiblissant et ils disent qu’il nous en reste à peine aujourd’hui quelque étincelle. Mais, nous sommes exactement aujourd’hui ce que nous étions il y a trois ans : c’est une poignée d’infortunés qui ont fait tomber les murs de la Bastille ! qu’on les mette à l’œuvre, ils se montreront comme le premier jour ; ils ne demanderont pas mieux que de combattre contre leurs tyrans ; mais alors ils étaient libres d’agir, et maintenant ils sont enchaînés. »
« Quand on suit d’un œil attentif la chaîne des événements qui préparèrent et amenèrent la suite du 14 juillet, on sent que rien n’était si facile que la révolution ; elle tenait uniquement au mécontentement des peuples, aigris par les vexations du gouvernement, et à la défection des soldats indignés de la tyrannie de leurs chefs.
« Mais quand on vient à considérer le caractère des Français, l’esprit qui anime les différentes classes du peuple, les intérêts opposés des différents ordres de citoyens, les ressources de la Cour et la ligue non moins naturelle que formidable des ennemis de l’égalité, on sent trop que la révolution ne pouvait être qu’une crise passagère, et qu’il était impossible que la révolution se soutînt par les causes qui l’avaient amenée. »

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Et Marat ne se borne pas à proclamer la faillite définitive de la liberté. Il prétend qu’en fait il n’y a jamais eu un mouvement de liberté sincère et vrai ; que, quand toute la France, dans les jours qui précédèrent et suivirent le 14 juillet, a pris les armes, ce n’était point pour conquérir la liberté, mais par peur des pauvres, « des brigands », et que si la bourgeoisie révolutionnaire utilisa aussitôt cette grande levée d’armes, ce fut pour intimider la Cour et pour se servir du pouvoir au profit d’une oligarchie nouvelle.
Ainsi c’est la peur utilisée par l’égoïsme de caste qui a été, selon Marat, le grand et premier ressort de la Révolution.
À cette heure sombre où l’avénement de la démocratie et d’un régime vraiment populaire lui paraît définitivement impossible et où la Révolution lui semble manquée, il en déshonore, pour ainsi dire, les racines.
« À tort prétend-on que la prise d’armes du 14 juillet fut une insurrection générale contre le despotisme ; puisqu’alors les suppôts du despote se trouvaient mêlés à ses esclaves ; mais c’était une simple précaution des citoyens qui avaient quelque chose à perdre contre les entreprises des indigents qui venaient de faire tomber les barrières.
« Cette précaution, qu’avait dictée la crainte dans la capitale, s’étendit comme une traînée de poudre dans tout le royaume par la seule force de l’exemple ; et ce ne fut que lorsque les petits ambitieux qui menaient les plébéiens des États-généraux se furent prévalus des circonstances, pour se faire acheter, que ce déploiement de la force nationale parut se diriger contre le despotisme.
« Dans ce soulèvement universel, le despote, entouré de sa famille, de ses ministres et de quelques courtisans, paraissait abandonné de la nation entière : mais il n’en conservait pas moins la légion innombrable de ses suppôts et de ses satellites, à la troupe de ligne près, dont le cœur venait de se donner à la patrie ; armés en apparence contre leur maître, ils ne l’étaient en effet que pour sa défense, pour le maintien de son empire, pour la conservation de leurs privilèges et de leurs dignités.
« On voyait alors les favoris insolents de la Cour, sous le masque du patriotisme, ne parler que de la souveraineté du peuple, des droits de l’homme, de l’égalité des citoyens, et mendier humblement, sous l’habit des soldats de la patrie (la garde nationale), les places de chefs, ou les acheter adroitement sous le voile de la bénéficence. Ceux qui ne purent pas s’emparer du commandement des forces nationales s’emparèrent de l’autorité des assemblées populaires, des places de fonctionnaires publics ; et l’on vit, pour la première fois, de grands magistrats en moustaches à la tête d’un bataillon ; des conseillers d’État en perruque à queue, humblement inclinés sur un bureau de district à côté de leurs tailleurs ou de leurs notaires ; des ducs superbes en habits bourgeois siégeant à un comité de police avec leurs procureurs ou leurs huissiers, et des prélats pacifiques gardiens d’un arsenal et distributeurs d’instruments de mort aux enfants de Mars.
« Autour de ces intrigants ambitieux, viles créatures de la Cour, se rallièrent bientôt ses suppôts et ses satellites ; la noblesse, le clergé, le corps des officiers de l’armée, la magistrature, les gens de robe et de loi, les financiers, les agioteurs, les sangsues publiques, les marchands de paroles, les agents de la chicane, la vermine du Palais, en un mot, tous ceux qui fondent leur grandeur, leur fortune, leurs espérances sur les abus du gouvernement, qui subsistent de ses vices, de ses attentats, de ses dilapidations et qui s’efforçaient de maintenir ces désordres pour profiter du malheur public. Peu à peu se rangèrent autour d’eux les faiseurs d’affaires, les usuriers, les ouvriers de luxe, les gens de lettres, les savants, les artistes, qui tous s’enrichissent aux dépens des heureux du siècle ou des fils de famille dérangés. Ensuite vinrent les négocians, les capitalistes, les citoyens aisés, pour qui la liberté n’est que le privilège d’acquérir sans obstacle, de posséder en assurance et de jouir en paix. Puis arrivent les trembleurs qui redoutent moins l’esclavage que les orages politiques ; les pères de famille qui craignent jusqu’à l’ombre d’un changement qui pourrait leur faire perdre leur place ou leur état. »
Oui, le tableau est merveilleux de couleur et de force. Si Marat avait eu une philosophie sociale plus étendue, il aurait trouvé inévitable que la classe bourgeoise, armée de science et de richesse, s’emparât de l’ordre nouveau et le fît d’abord tourner à son profit. Mais il aurait compris aussi que ce mouvement, que cet ébranlement étaient favorables au peuple lui-même et que l’avenir était à la démocratie. Ce n’est plus, cette fois, un cri aigu de colère et de haine : c’est un cri profond de désespoir, et lui-même s’avoue vaincu :
« Pour échapper au fer des assassins, je me suis condamné à une vie souterraine, relancé de temps à autre par des bataillons d’alguazils, obligé de fuir, errant dans les rues au milieu de la nuit, et ne sachant quelquefois où trouver un asile, plaidant au milieu des fers la cause de la liberté, défendant les opprimés, la tête sur le billot, et n’en devenant que plus redoutable encore aux oppresseurs et aux fripons publics.
« Ce genre de vie, dont le simple récit glace les cœurs les plus aguerris, je l’ai mené dix-huit mois entiers, sans me plaindre un instant, sans regretter ni repos ni plaisirs, sans tenir aucun compte de la perte de mon état, de ma santé, et sans jamais pâlir à la vue du glaive toujours levé sur mon sein. Que dis-je ? je l’ai préféré à tous les avantages de la corruption, à tous les délices de la fortune, à tout l’éclat d’une couronne. J’aurais été protégé, caressé et fêté, si j’avais simplement voulu garder le silence ; et que d’or ne m’aurait-on par prodigué, si j’avais voulu déshonorer ma plume ! J’ai repoussé le métal corrupteur, j’ai vécu dans la pauvreté, j’ai conservé mon cœur pur. Je serais millionnaire aujourd’hui, si j’avais été moins délicat et si, je ne m’étais pas toujours oublié.
« Au lieu de richesses que je n’ai pas, j’ai quelques dettes que m’ont endossées les infidèles manipulateurs auxquels j’avais d’abord confié l’impression et le débit de ma feuille. Je vais abandonner à ces créanciers les débris du peu qui me reste, et je cours, sans pécule, sans secours, sans ressources, végéter dans le seul coin de la terre où il me soit encore permis de respirer en paix, devancé par les clameurs de la calomnie, diffamé par les fripons publics que j’ai démasqués, chargé de la malédiction de tous les ennemis de la patrie… peut-être ne tarderai-je pas à être oublié du peuple au salut duquel je me suis immolé. »
La main de Marat ne laissera point aussitôt tomber la plume : mais quelle crise profonde de découragement, et comme il sentait bien que le peuple amorti ne vibrait plus à ses appels passionnés !
Le pessimisme de Camille Desmoulins est aussi profond. Lui, qui si souvent a raillé l’humeur noire de Marat, il parle et pense exactement, à cette date, comme Marat lui-même, et le long discours qu’il prononça, le 21 octobre, à la tribune des Jacobins, est, lui aussi, une déclaration de faillite de la Révolution.
Desmoulins, avec une verve admirable, signale les contradictions de la Constitution. Il a fallu d’abord pour entraîner le peuple lui présenter tous ses droits primitifs, « les rassembler sous un verre étroit et en offrir à ses regards l’enivrante perspective ».
Ce fut la déclaration des Droits : mais cette Déclaration des Droits, elle a été ensuite comme retirée en détail par d’innombrables dispositions rétrogrades ; on n’a pas osé pourtant en effacer tous les traits. « À ce reste de vergogne qui a retenu parfois les ministériels, ajoutez les explosions du patriotisme dans les tribunes et sur la terrasse, qui ont donné quelques convictions à la majorité corrompue de la Législature, et l’ont forcée de dériver un peu au cours de l’opinion. De tout cela il est résulté une Constitution destructive il est vrai de sa préface, mais qui n’a pas laissé d’emprunter de cette préface tant de choses destructives d’elles-mêmes que, en même temps que comme citoyen, j’adhère à cette Constitution, comme citoyen libre de manifester mon opinion, et qui n’ai point renoncé à l’usage du sens commun, à la faculté de comparer les objets, je dis que cette Constitution est inconstitutionnelle et je me moque du secrétaire Cérutti, ce législateur Pangloss qui propose de la déclarer par arrêt ou par un décret la meilleure Constitution possible ; enfin, comme politique, je ne crains pas d’en assigner le terme prochain. Je pense qu’elle est composée d’éléments si destructeurs l’un de l’autre qu’on peut la comparer à une montagne de glace qui serait assise sur le cratère d’un volcan. C’est une nécessité que le brasier fasse fondre et dissiper en fumée les glaces, ou que les glaces éteignent le brasier. »
Or Camille Desmoulins ne cachait point ses craintes que la glace éteignît le brasier. Selon lui, « le démon de l’aristocratie » avait eu, depuis deux ans, une habileté infernale. Renonçant à la lutte corps à corps contre la Révolution, il l’avait paralysée et stupéfiée. Il avait glissé l’inégalité dans toute la constitution ; il avait réservé le droit de vote, le droit de porter les armes, à des privilégiés ; et le peuple s’était laissé dépouiller sans mot dire : « Je les ai appelés citoyens passifs et ils se sont crus morts. »
« Mais c’est Paris qui a fait la Révolution, c’est à Paris qu’il est réservé de la défaire ; tandis qu’à mesure que l’espérance des patriotes s’éloigne et qu’ils en connaissent la chimère, leur première ardeur se refroidit et leur

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.).
parti s’affaiblit tous les jours la seule douleur dont le temps ne console point et qu’il ne fait qu’aigrir, la douleur de la perte des biens, accroît sans cesse le ressentiment de tous les soutiens de l’ancien régime. Je fortifie leur parti de la cupidité de tous les boutiquiers, de tous les marchands qui soupirent après leur créanciers ou leurs acheteurs émigrés, je le fortifie des craintes de tous les rentiers dont la peur de la banqueroute a si puissamment aidé la Révolution et qui ne voyant que du papier et point de comptes au
dedans, et au dehors des préparatifs de guerre, s’effrayent d’une banqueroute. Je le fortifie surtout, ce parti, de la lassitude des gardes nationales parisiennes. Depuis deux ans, j’ai soin de tapoter le tambour du matin au soir, de les tenir autant que possible, hors de leur comptoir, de leur cheminée et de leur lit.
« Au milieu de la plus profonde paix, la face de la capitale est aussi hérissée de baïonnettes depuis deux ans que si Paris était occupé par deux cent mille Autrichiens. Le Parisien, arraché sans cesse de chez lui pour des patrouilles, pour des revues, pour des exercices, lassé d’être transformé en Prussien, commence à préférer son chevet ou son comptoir au corps de garde ; il croit bonnement (pour adoucir le mot) que l’Assemblée nationale n’aurait pu faire ses décrets sans les soixante bataillons, que c’est seulement après la Révolution que finira l’achèvement de sa campagne, plus fatigante que la guerre de sept ans. Quand finira cette Révolution ? Quand commencera la Constitution ? Nous étions moins las dans l’ancien régime. »
Las, lassés, le parti de la lassitude : Desmoulins semble croire que la Révolution n’est plus capable d’effort, et son exposé parut si sombre, si décourageant, que plusieurs Jacobins le blâmèrent : mais nul ne le contredit. Évidemment en cette fin d’année 1791, il y avait un sentiment profond de fatigue et les démocrates se demandaient, Desmoulins comme Marat, si l’énergie révolutionnaire n’était pas épuisée. La même note, défiante et triste, est donnée par le journal de Prudhomme, les Révolutions de Paris. Au moment où se réunissait la Législative, dans le numéro du 1er au 8 octobre, il publie une sorte d’article manifeste :
« Représentants d’un peuple qui n’est point libre encore mais qui n’a pas perdu tout espoir de le devenir, souffrez qu’il vous rappelle vos obligations ; elles sont plus grandes que vous ne pensez. Votre tâche, moins brillante, est plus difficile que celle de vos prédécesseurs, ils n’ont pas tout fait puisqu’ils vous laissent tant de choses à faire. Les dangers qu’ils ont courus étaient moindres que ceux qui vont vous assaillir.
« De leur temps, le despotisme se montrait à découvert. Vos prédécesseurs n’avaient qu’un ennemi à combattre ; bientôt peut-être vous en aurez deux. LE DESPOTISME ET LE PEUPLE.
« Remarquez-vous que déjà la Cour cherche à se coaliser avec le peuple, qui fit toute la force de la première assemblée et qui peut-être servira d’instrument aveugle contre la seconde ? La nation est fatiguée, si vous n’y prenez garde, elle est prête à retourner à ses anciennes habitudes.
« Les esclaves ont plus de bon temps que les hommes libres ; et les rois qui savent leur métier, s’arrangent de manière qu’on se croie plus heureux à l’ombre de la couronne que sous le bonnet de la liberté. C’est à vous à rappeler ces premiers moments d’énergie dont le souvenir seul fait pâlir la Cour. »
Le journal essaie d’animer les nouveaux députés par les menaces les plus terribles et les prophéties les plus sombres : « Si après trois années de gêne et d’appréhensions, de troubles et de misères, le peuple, qui vient de vous remettre en mains ses plus chers intérêts, apprenait que vous faites secrètement cause commune avec le château des Tuileries, s’il venait à s’apercevoir que vous n’êtes aucunement en mesure pour déjouer les coalitions ministérielles et autres, et que vous n’avez servi qu’à donner le temps à nos ennemis d’ourdir tout à leur aise leurs trames sinistres, alors les voies de la justice ordinaire seraient rejetées ou suspendues ; un grand mouvement dont la liberté ne peut plus se passer sera très incessamment imprimé à toute la France. Également, indignement trompé par tous les pouvoirs ensemble, auxquels il avait donné d’abord toute sa confiance, alors le peuple fera main basse sur tous les pouvoirs à la fois, et laissera aux races futures une leçon déplorable mais nécessaire. Toutes ces armées qui s’avancent à pas lents et qui troublent en ce moment notre sommeil, ne causeront alors aucun effroi à plusieurs millions d’hommes combattant chacun pour sa liberté individuelle. Un grand spectacle se prépare pour la fin de l’hiver qui approche.
« Épuisée d’argent, de grains et de munitions, trahie par ses chefs, s’il faut que la nation le soit encore par ses mandataires, vous qui l’aurez trahie ou mal représentée, attendez-vous à être les premières victimes de son désespoir.
« Un phénomène politique doit nécessairement éclater dans peu ; patriotes du Corps législatif, tenez-vous prêts à une catastrophe bien autrement importante que celle qui a fait de vos devanciers des héros d’un jour. Tout nous annonce un événement tel que la Révolution de 1789 n’en aura été que le prélude ; ménagez vos forces pour en soutenir le choc et concourir au dénouement de ce drame sublime mais terrible et qui plongera l’Europe dans la stupeur. »
Étranges et énigmatiques paroles où l’on croirait voir, d’avance, comme en un sombre miroir magique, le 20 juin, le 10 août, le procès et la mort du Roi, la chute des Girondins eux-mêmes, et la Terreur !
Comment le même journaliste, qui constate que la nation est fatiguée peut-il en même temps prédire ces prochains soulèvements révolutionnaires ? Et d’où vient la précision singulière de ces prophéties ? Évidemment quand il annonce un grand spectacle pour la fin de l’hiver, c’est-à-dire pour le moment où la saison permet l’entrée en campagne des armées, c’est à la guerre que pense le journaliste. Bientôt le journal de Prudhomme s’apercevra des périls que fait courir à la liberté, à la Révolution, l’aventureuse politique guerrière de la Gironde, et il la combattra vigoureusement. Mais à cette date il n’a pas encore pris parti, et il se fait l’écho des mystérieux projets du parti girondin : susciter par la guerre contre l’étranger une nouvelle action révolutionnaire.
C’est là le grand secret que dès la réunion de la Législative et avant même les premiers discours de Brissot se chuchotaient les initiés, et je considère cet article comme un des plus importants indices du sourd travail que faisait dès les premiers jours la Gironde. Toute sa pensée est là : constater la fatigue de la nation et, pour la pousser plus avant dans la voie révolutionnaire où elle semblait hésiter, recourir à l’aiguillon de la guerre.
Cette lassitude, cette sorte de rémission de l’esprit révolutionnaire, le journal de Prudhomme les signale encore dans le numéro du 15 au 22 octobre : « Parisiens, c’est avec douleur que nous vous le disons, il nous semble que l’esprit public n’a fait aucun progrès parmi vous. On vous a dit tant de fois que la crise est passée, qu’il ne s’agit plus que de vivre tranquilles et d’avoir confiance dans vos chefs. Depuis le premier fonctionnaire public jusqu’au dernier de vos officiers municipaux, tous les gens en place vous ont tant prêché la paix et l’ordre que vous êtes devenus immobiles au milieu même des agitations de toute espèce qui se font sentir autour de vous !
« La Constitution n’est-elle pas terminée ? vous disent-ils ? N’est-elle pas acceptée ? Que désirez-vous encore ? — Mais on émigre ? — Tant mieux, c’est la patrie qui se purge. — Mais Louis XVI s’entend avec les émigrés ? — Cela n’est pas possible ; lisez ses proclamations, ses lettres. — Mais les ministres ne sont pas de bonne foi ? — Cela se peut, aussi les mande-t-on à la barre chaque semaine. — Mais le numéraire a disparu ? — Le papier national vous reste. — Mais tous ces billets de confiance qui circulent ? — À qui s’en prendre ? À ceux qui veulent bien les recevoir. — Mais tous ces coupe-gorge ouverts aux joueurs ? — À qui la faute ? À ceux qui jouent. — Mais à chaque marché, le pain, cette première nourriture du pauvre, augmente de prix ? — Cela est tout naturel, quand l’argent est rare. Patience et paix, ordre et soumission et tout ira au mieux. Amour au roi, qui fait tout ce que vous voulez. Obéissance aux magistrats, qui ne marchent qu’avec la loi ; confiance dans la Législative dont chaque séance est marquée d’un acte de sagesse, et ça ira. »
« Voilà ce que les modérés, les ministériels, les royalistes, les aristocrates casaniers, plus fiers ou mieux aguerris que leurs camarades de Worms, ne cessent de vous insinuer dans leurs journaux, sur leurs placards, dans les cafés, dans les groupes, et vous croyez tout cela parce que cela favorise votre indolence, et vous dormez sur la foi de tous ces propos teintés adroitement. Le commerce, d’ailleurs, a paru reprendre un peu de son activité. Il ne vous en a pas fallu davantage pour traiter de terreur panique et d’exagérations ce que les journaux patriotes vous annoncent sur l’état déplorable de nos frontières, sur les intentions du cabinet des Tuileries et sur le grand nombre de membres gangrenés déjà de l’Assemblée nationale. »

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
En même temps que les démocrates, la reine Marie-Antoinette constate cette sorte indifférence et d’apathie du peuple à ce moment de la Révolution. Elle dit à Fersen dans une lettre du 31 octobre, en parlant des Parisiens :
« Il n’y a que la cherté du pain qui les occupe et les décrets. Les journaux, ils n’y regardent seulement pas ; il y a sur cela un changement bien visible dans Paris, et la grande majorité, sans savoir si elle veut ce régime-ci ou un autre, est lasse des troubles et veut la tranquillité. Je ne parle que de Paris, car je crois les villes de province bien plus mauvaises dans ce moment-ci que celle-ci. »
Il fallait que les révolutionnaires, les démocrates redoutassent bien cet affaissement et même cet entraînement réactionnaire du peuple, pour que Marat voulût imposer silence aux tribunes qui, jusque-là, avaient toujours manifesté dans le sens de la Révolution. Il écrit le 15 octobre :
« Dans un pays vraiment libre, jaloux de conserver sa liberté, il importe que les représentants du peuple soient sans cesse sous les yeux de témoins qui les rappellent au devoir en leur donnant des signes d’improbation lorsqu’ils s’en écartent, et qui les encouragent au bien, en les applaudissant lorsqu’ils s’en acquittent avec fidélité. Ainsi, les battements de mains et les sifflets sont un droit de tout citoyen éclairé, dont il importe cependant d’user avec beaucoup de retenue et dans les grandes occasions seulement, pour ne pas user ce précieux ressort. Peut-être chez aucune nation du monde, le public n’est-il assez bien composé pour qu’il soit prudent de lui laisser l’exercice de ce droit ; mais à coup sûr il est de la sagesse de l’ôter à un public ignare, frivole et inconséquent, qui ne sait rien apprécier, qui se passionne pour des mois, qui s’engoue pour des charlatans adroits qui le leurrent, qui gâte la meilleure cause en se livrant à la fougue d’un moment, et qui fait des affaires les plus sérieuses de la vie une comédie, une farce ridicule. Tel est le public de Paris : peu disposé à siffler, mais prêt à applaudir. La triste expérience que nous avons faite de cette manie serait bien propre à nous y faire renoncer, si nous savions profiter de nos défauts, si nous n’étions pas incorrigibles.
« Je ne parle point ici de ces essaims de valets, de fainéants et de mouchards dont les fripons des comités remplissaient les tribunes, quand ils avaient quelques grands coups à frapper, mais de ces citadins aveugles, dont ils arrachaient les applaudissements par le préambule imposteur qu’ils donnaient à tous leurs projets de décrets funestes. Chez les Français, il est donc de la sagesse de faire observer le plus rigoureux silence dans le Sénat de la nation, dans les assemblées administratives et dans les tribunaux ; mais telle est la force de notre penchant pour tout ce qui flatte la vanité, et telle est notre légèreté, qu’à peine une loi positive nous aura-t-elle fait un devoir du silence dans les assemblées publiques, les membres ou législateurs seront eux-mêmes les premiers à la violer.
« Mes lecteurs m’accuseront peut-être d’avoir changé de doctrine : ce n’est pas ma faute s’ils ne savent pas lire. Dans un temps où les patriotes éclairés remplissaient les tribunes de l’Assemblée nationale et formaient l’audience des tribunaux, je les ai souvent invités à rappeler au devoir par des signes d’improbation les députés, les agents du peuple : et j’avais raison. Aujourd’hui que les patriotes n’osent plus se montrer et que les ennemis de la liberté remplissent les tribunes du Sénat, et se trouvent partout, je demande qu’on les empêche d’applaudir en les forçant au silence ; c’est une arme dangereuse que je cherche à faire tomber de leurs mains. »
Ainsi, en cette fin de 1791, l’état de l’esprit public était inquiétant pour les hommes de la Révolution : il était presque désespérant pour ceux qui auraient voulu vraiment installer la démocratie, donner à tous les citoyens le droit politique, et obliger le pouvoir exécutif à s’inspirer des volontés de la nation.
La cour, dont on devinait, mais dont on ne pouvait démontrer les intrigues au dehors, affectait au dedans un zèle minutieux pour la Constitution.
Et, à vrai dire, celle-ci avait encore fait la part si belle à la royauté, quelle pouvait être très puissante tout en restant constitutionnelle. Le roi avait décidé, pour préparer plus sûrement le renversement de la Constitution, de paraître la respecter. Et le parti des Lameth et de Barnave qui ne siégeait plus à l’Assemblée, mais qui essayait de prolonger par des moyens occultes son influence, semblait accepté par le roi comme conseiller, comme guide. Jusqu’où allèrent les rapports des Lameth et de Barnave avec le roi et la reine ? Il est malaisé de le dire. Il semble qu’il n’y ait eu, après l’acceptation de la Constitution, qu’une entrevue de Barnave et de Marie-Antoinette ; mais, quoique Barnave n’ait pas tardé à s’éloigner de Paris, il est certain qu’il donnait fréquemment des avis.
Ces communications de la cour avec quelques révolutionnaires modérés inquiétaient les amis intransigeants de la royauté ; Marie-Antoinette est obligée d’écrire à Fersen le 19 octobre : « Rassurez-vous, je ne me laisse pas aller aux enragés, et si j’en vois ou que j’ai des relations avec quelques-uns d’entre eux, ce n’est que pour m’en servir, et ils me font tous trop horreur pour jamais me laisser aller à eux. »
Mais ils avaient beau lui faire horreur, par le seul fait qu’elle correspondait avec eux, elle était obligée de les ménager, de tenir compte de leur politique. Or, elle se résumait en deux traits : pratiquer la Constitution au dedans, de façon à faire tomber peu à peu l’effervescence révolutionnaire et à restaurer par le seul jeu de la Constitution elle-même la force du pouvoir exécutif ; au dehors, maintenir la paix pour éviter le contre-coup d’une intervention étrangère sur l’esprit de la France. Il paraît donc infiniment probable et même à peu près certain que la cour laissait ignorer aux Lameth, à Duport, à Barnave, sa négociation secrète avec l’étranger en vue d’un congrès.
Le journal de Fersen contient pourtant quelques lignes terribles pour la mémoire des Lameth et de Duport. Il note dans son journal, à la date du 14 février : « La reine me dit qu’ils voyaient Alexandre Lameth et Duport, qu’ils lui disaient sans cesse qu’il n’y avait de remède que des troupes étrangères, sans cela tout était perdu ; que ceci ne pouvait durer, qu’eux avaient été plus loin qu’ils ne voulaient, et que c’étaient les sottises des aristocrates qui avaient fait leur succès, et la conduite de la cour qui les aurait arrêtés, si elle s’était jointe à eux. Ils parlent comme des aristocrates, mais elle croit que c’est l’effet de la haine contre l’Assemblée actuelle, où ils ne sont rien et n’ont aucune influence, et la peur, voyant que tout ceci doit changer, et voulant se faire d’avance un mérite. »
Il serait coupable de décréter des hommes de trahison sur un témoignage aussi isolé et aussi incertain. Marie-Antoinette avait-elle saisi exactement le sens d’un propos amer de Lameth et de Duport ? l’avait-elle exactement rapporté ? Fersen lui-même l’avait-il bien saisi ? Cet appel aux armées étrangères était en contradiction absolue avec toute la politique passée de Barnave : la guerre livrait les modérés soit aux révolutionnaires de gauche, soit aux aristocrates, et ils n’en voulaient point ou ils voulaient la limiter le plus possible. En février, quand la politique de la Gironde parut décidément l’emporter, l’un d’eux laissa-t-il échapper ces propos imprudents ?
Ce passage étrange de Fersen est d’ailleurs en contradiction avec un autre passage du journal du même, à la date du dimanche 8 janvier : « Mémoire de la reine Marie Antoinette à l’empereur : détestable, fait par Barnave, Lameth et Duport ; veut effrayer l’empereur, lui prouver que son intérêt est de ne pas faire la guerre, mais de maintenir la Constitution, de peur que les Français ne propagent leur doctrine et ne débauchent ses soldats. On voit cependant qu’ils ont peur. »
Je suis très tenté de penser que c’est pour s’excuser auprès de l’intransigeant Fersen d’accepter ainsi le concours de Lameth, Barnave et Duport, que la reine, quelques jours après, lui a dit : « Mais vous ne connaissez pas le fond de leur pensée : ils croient, comme vous, qu’il n’y a de salut que par les armées étrangères. »
Enfin je crois pouvoir démontrer (et je le ferai un peu plus loin) que le mémoire très important de Marie-Antoinette, publié par le comte d’Arnete, est bien en effet pour la plus grande part, écrit par Barnave. Or, c’est un mémoire pacifique : c’est celui même contre lequel s’élève Fersen.
En tout cas, il est certain qu’en octobre et novembre 1791, c’est une politique toute constitutionnelle et pacifique qu’ils conseillaient à la cour. Barnave, dans le livre si remarquable dont j’ai cité déjà bien des parties, a très nettement marqué son point de vue. Il affirme d’abord que les puissances voulaient la paix :
« Quiconque, dit-il, aux considérations générales, joint quelques connaissances des affaires dans ce temps et particulièrement ceux qui ont vu les dépêches diplomatiques, ne peuvent avoir aucun doute en ce point. Lorsque les affaires intérieures parurent pacifiées, les puissances se regardèrent comme déchargées d’un poids immense, n’ayant plus à soutenir à leur péril la cause d’un roi arrêté, emprisonné et détrôné ; les conventions qui parurent subsister entre elles, et particulièrement ce qui nous concernait dans le fameux traité de Pilnitz, n’avaient pour objet que le retour éventuel des mêmes événements ; à la vérité, la situation des choses et l’ordre nouveau ne leur paraissaient pas assez bien établis pour qu’elles se prononçassent à cet égard, mais toutes leurs vues hostiles étaient arrêtées, et elles attendaient de connaître la marche que prendraient nos affaires intérieures pour fixer définitivement leurs résolutions à notre égard. Quoique les émigrés défigurassent étrangement et la situation du royaume quant à l’ordre public, et les moyens de défense, leurs cris ne produisaient qu’un effet médiocre sur les cabinets qui, tout à fait indifférents aux intérêts de ces proscrits, ne mesuraient leur conduite que sur leur propre politique. »
Et Barnave, sous le titre : « Marche qu’il fallait suivre », précise la politique qu’évidemment il conseillait à la cour : « C’était donc la marche de nos affaires intérieures qui devait décider les résolutions des puissances et faire notre sort en tous sens. Il ne fallait pas une profonde politique pour concevoir ce que cette marche devait être ; elle était si claire que déjà elle se présentait à tous les esprits, si bientôt diverses causes ne se fussent réunies pour tromper et corrompre l’opinion publique.
« Il fallait donc :
« 1o Achever de rétablir l’ordre et de comprimer l’anarchie ; une législature qui l’aurait voulu fortement et qui eût su se faire respecter, l’eût effectué dans trois mois.
« 2o Fortifier les autorités nouvelles contre l’anarchie populaire, et établir entre elles la subordination et les rapports constitutionnels, qui seuls pouvaient leur donner une marche régulière ; cinq à six décrets d’une forte sévérité suffiraient pour cela.
« 3o Presser le recouvrement des impôts, afin de pourvoir aux besoins publics. La circulation des assignats, comme je l’ai dit, favorisait puissamment l’établissement du nouveau système d’impôts, et l’excellent ministre qui était alors à la tête de cette partie, l’eût mise promptement dans le meilleur état, pour peu qu’il eût été soutenu et favorisé.
4o Mettre la défense militaire sur un pied respectable sans être ruineux, et s’attacher surtout à rétablir la subordination qui depuis quelques mois avait fait de grands progrès dans l’armée ;
5o S’attacher à maintenir l’harmonie entre les deux premiers pouvoirs constitutionnels ;
6o Se mettre en état constitué, faire des lois, régler l’éducation publique, etc., etc. ;
7o Ne s’occuper des affaires étrangères que pour terminer par négociation les difficultés relatives aux princes possessionnés en Alsace, seul chef sérieux de querelle entre les étrangers et nous, mais qui, perpétuant les débats, pouvait sans cesse aigrir les esprits. Ne songer d’ailleurs aucunement aux émigrés et aux puissances ; montrer à leur égard la tranquillité de la force ; ne donner aux étrangers aucun signe de crainte ; et en même temps aucun sujet d’offense, et marquer par toute sa conduite que, déterminé à ne jamais reconnaître leur influence dans nos affaires intérieures, on l’était également à les laisser faire tranquillement les leurs, et à laisser en paix leur système de gouvernement comme on voulait qu’ils y laissassent le nôtre.
« Si l’on eût suivi cette marche, il n’est pas douteux que tous les obstacles n’eussent bientôt disparu.
« Bientôt aussi les puissances cessant de nous craindre comme un corps contagieux, et commençant à nous considérer comme une puissance organisée, auraient commence à spéculer à notre égard, suivant les vues ordinaires de la politique : chacune eût recherché notre alliance et redouté notre inimitié ; nous serions rentrés dans le système général de l’Europe où nous aurions été les maîtres d’adopter les vues que notre nouvelle manière d’exister nous eût fait paraître avantageuse. »
Voilà les conseils que donnait, voilà les perspectives qu’ouvrait Barnave à Marie-Antoinette et à Louis XVI et il y ajoutait à coup sûr, reprenant la pensée de Mirabeau, que par là le roi s’assurerait d’abord tranquillité et sécurité, puis, dans des conditions nouvelles, un pouvoir plus grand qu’autrefois, à la tête d’un peuple libre et plus fort. Sans doute la Cour feignait d’entrer dans ces vues, mais elle dupait Barnave, car, tandis qu’il voulait que la royauté fit un usage vigoureux, conservateur et monarchique, mais loyal, de la Constitution, elle n’en simulait le respect que pour en mieux ménager la révision forcée sous la menace de l’étranger. Malgré tout, par ses relations mêmes avec des révolutionnaires constituants, elle accréditait l’idée qu’elle acceptait enfin la Constitution, et cachant ainsi son jeu, elle ne donnait presque pas prise à ses adversaires. En tout cas, sa conduite apparente était assez correcte, assez légale pour endormir un peuple déjà fatigué et surmené.
Trompée par ces apparences, l’Assemblée législative pouvait facilement aussi incliner au modérantisme et glisser peu à peu sous le pouvoir et l’intrigue du roi. On a vu avec quelle rapidité elle avait retiré ses premières mesures agressives : elle paraissait peu faite pour la bataille continue, vigoureuse, contre l’autorité royale.
Préoccupée de dresser les comptes des finances publiques, préoccupée aussi de raffermir l’administration pour assurer partout la libre circulation des grains, elle pouvait fort bien, croyant ne consolider que l’ordre public, renforcer à l’excès le pouvoir de Louis XVI, au moment où celui-ci négociait avec l’étranger pour imposer à la France tout au moins une Constitution aristocratique avec une Chambre haute où la puissance héréditaire de la noblesse aurait soutenu la puissance héréditaire du roi.
La reine, dans une lettre du 7 décembre, confie à Fersen qu’elle se prend à espérer dans la Législative : « Notre position est un peu meilleure et il semble que tout ce qui s’appelle constitutionnel se rallie pour faire une grande force contre les républicains et les Jacobins : ils ont rangé une grande partie de la garde pour eux, surtout la garde soldée, qui sera organisée et enrégimentée sous peu de jours. Ils sont dans les meilleures dispositions et brûlent de faire un massacre des Jacobins. Ceux-ci font toutes les atrocités dont ils sont capables, mais ils n’ont dans ce moment que les brigands et les scélérats pour eux ; je dis dans ce moment, car d’un jour à l’autre tout change dans ce pays-ci et on ne s’y reconnaît plus. »
Brissot, qui avait déjà senti la force presque écrasante des modérés dans l’assemblée électorale de Paris où il n’avait été élu qu’à grand’peine, ne se faisait pas d’illusion sur la Législative. Il savait bien qu’il serait besoin d’une terrible secousse pour la hausser de nouveau à l’énergie révolutionnaire. Seule une éruption violente de lave pouvait soulever l’énorme amas d’intérêts mélangés, intérêts anciens et intérêts nouveaux, qui obstruait le cratère de la Révolution : et quelle autre flamme que celle du patriotisme surchauffé par la guerre pourrait faire jaillir de nouveau la force populaire, attiédie et comme figée ? Quelle autre force que la terreur de ce spectacle effrayant et grandiose pourrait mater les modérés ?
Quant aux ministres, ils n’étaient, au moment où commençaient les débats de la Législative, ni une garantie pour la Révolution ni une force pour le roi. On se souvient que la plupart d’entre eux étaient entrés en fonctions depuis un an, après le départ de Necker. Le ministère était formé d’éléments assez variés, mais également médiocres. Les plus honnêtes d’entre eux, comme le garde des sceaux Duport-Dutertre, s’étaient laissé surprendre par les événements de Varennes. Il est à peine croyable qu’aucun indice ne leur ait révélé tout le plan de conspiration et de fuite de la famille royale. Il n’y eut probablement pas trahison, mais faiblesse, incapacité, je ne sais quelle habitude paresseuse de sentir autour de soi une intrigue de cour et de ne point faire effort pour la démêler.
Le ministre des affaires étrangères, Montmorin, avait un rôle particulièrement ambigu. Il avait ménagé la gauche de l’Assemblée constituante, et il était en fonction depuis la fin de 1789. Il était le seul du ministère Necker qui fût resté à son poste, après la disgrâce du grand homme. Il servait d’intermédiaire officieux entre la Constituante et la Cour.
Quand M. de Mercy, qui correspondait avec Mirabeau par l’intermédiaire de Lamarck, quitta Paris en août 1790, il fut convenu que le ministre Montmorin serait mis dans la confidence des rapports de Mirabeau et de la Cour. Mais débile, de volonté faible, d’esprit fuyant et de petite santé, Montmorin ne s’engagea jamais bien avant en aucun sens. D’une part, il ne sut pas conquérir sur le roi et la reine assez d’autorité pour les maintenir dans la voie de la Révolution. D’autre part, bien qu’il semble impossible qu’il n’ait pas deviné les préparatifs de fuite, il ne fut jamais le confident du roi et de la reine.
Fersen déclare expressément que Bouillé et lui, en France, étaient les seules personnes dans le secret : et comment la Cour l’eût-elle confié à Montmorin puisqu’elle voulait le cacher à Mirabeau ? Montmorin semble avoir évité d’approfondir les intrigues qu’il soupçonnait, de peur d’être obligé de prendre un parti et d’assumer des responsabilités.
Quand s’ouvre la Législative les événements le pressent et il va être obligé d’adopter une conduite un peu ferme et nette. D’abord, l’acceptation de la Constitution par le roi rétablit les relations officielles entre la royauté constitutionnelle et les puissances étrangères. En même temps la diplomatie occulte de la Cour continue : quel jeu jouera Montmorin ? La situation devient difficile et même périlleuse, d’autant plus que l’irritation croissante de l’Assemblée contre les émigrés, les discours de Brissot et d’Isnard, les premiers décrets contre les princes, les menaces grondantes contre l’Autriche, tout annonçait une période d’orages, de difficultés et de dangers. Montmorin se déroba.
Je ne puis m’expliquer qu’ainsi sa retraite. C’est le 31 octobre 1791, onze jours après le discours de Brissot, qu’il annonça sa démission à l’Assemblée : « Dès le mois d’avril dernier, j’avais donné ma démission à Sa Majesté, mais la distance qui me séparait de celui qu’elle m’avait destiné pour successeur me força de continuer mon travail jusqu’à la réception de sa réponse qui fut un refus. Depuis, je ne trouvai plus où placer ma démission, et l’espérance d’être encore de quelque utilité à la chose publique et au roi, put seule me consoler de la nécessité de rester dans le Ministère, au milieu des circonstances qui en rendaient les fonctions si périlleuses pour moi. Aujourd’hui Sa Majesté a daigné agréer ma démission. »
Sybel commet donc une légère erreur matérielle lorsqu’il dit que c’est le décret du 29 novembre contre les prêtres et les émigrés qui détermina la retraite de Montmorin : elle était décidée et annoncée dès la fin d’octobre. Mais c’est bien la difficulté croissante des choses qui décida Montmorin au départ. Sybel paraît croire que c’est parce que Montmorin ne put faire adopter par la Cour une politique vigoureuse contre la Révolution qu’il se retira. Et le témoignage de Mallet-du-Pan auquel Sybel se réfère est en effet très précis.
Mallet écrit dans ses notes en novembre 1791 :

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
« M. de Montmorin était l’homme fort du Ministère au moment de sa retraite. Malouet et moi l’avions décidé à présenter au roi un plan de conduite et à se servir des circonstances légalement. Spécialement d’aller à l’Assemblée nationale et de leur dire que les puissances étrangères (dont il leur remettrait les dépêches) ne le croyant
pas libre, il fallait constater cette liberté ; qu’en conséquence il demandait d’aller à Fontainebleau ou à Compiègne, de choisir un nouveau Ministère qui n’eût coopéré en rien à la Constitution et à son acceptation, et d’y aller avec sa garde propre. Ou l’Assemblée nationale eût refusé, et elle constituait la servitude du roi, ou elle eût accepté, et le roi se délivrait des chaînes de son Conseil, il s’en faisait un vigoureux des royalistes affectionnés. M. de Montmorin a insisté à trois reprises ; il s’est jeté aux genoux de la reine ; tout a été inutile, on s’est effrayé des conséquences et de la crainte d’une insurrection. »
Je ne crois pas un mot de ce récit, en ce qui touche Montmorin. Il trompait tout le monde : il ne fut point fâché de persuader à Malouet et à Mallet-du-Pan, qui l’avaient chargé d’un message vigoureux et d’un plan redoutable, qu’il s’était heurté à l’inflexible résistance du roi et de la reine, et que de désespoir il se retirait. S’il était parti par dégoût de voir ses conseils énergiques repoussés, il n’aurait pas demandé (d’ailleurs en vain), à rester au Conseil avec 50.000 livres de rente, sans portefeuille ministériel. Et nous ne le retrouverions pas mêlé à la politique occulte de Louis XVI.
Il cherchait simplement à éluder les responsabilités officielles, apparentes, qui pouvaient subitement devenir lourdes. Le roi, ne sachant quel fond faire sur ses services ni quel jugement porter sur son caractère, ne le retint pas. En cette période étrange, les ressorts sont partout détendus, l’énergie populaire sommeille et le courage des ministres fléchit.
Quant à la Cour, elle est tellement à la dérive que, pour remplacer Montmorin et pourvoir au ministère le plus important à cette heure, celui des affaires étrangères, elle n’a aucun plan. Elle semble même redouter d’y avoir un homme à elle, de peur qu’il se perde et la perdre. Elle ne s’occupe pas non plus d’y mettre un homme connu pour son dévouement à la Révolution et qui puisse apaiser les esprits en les rassurant. La reine écrit le 19 octobre, quand Montmorin avait déjà remis sa démission au roi :
« J’ai vu M. du Montier, qui désire fort aussi ce Congrès (des puissances). Il m’a même donné des idées pour les premières bases, que je trouve raisonnables. Il refuse le ministère et je l’y ai même engagé. C’est un homme à conserver pour un meilleur temps et il serait perdu. »
D’autre part, elle écrit à Mercy le 1er novembre : « Le malheur est que nous n’avons pas un homme ici auquel nous fier… M. de Ségur refuse les affaires étrangères : elles sont vacantes et la publicité de tous ces refus rend le choix presque impossible. »
Mercy insiste par une lettre du 6 novembre : « Il faut un ministère éclairé et fidèle, et, s’il n’est pas possible de l’établir ici, il conviendrait d’y suppléer quoique très imparfaitement, par un conseil secret, composé de quelques personnes d’une habileté reconnue, d’un attachement à toute épreuve et capables de suggérer la marche journalière à tenir. Rien n’annonce encore que l’on se soit occupé à former ce ministère convenable. Le choix de M. de Ségur a d’abord indiqué le contraire. Depuis son refus on annonce que M. de Sainte-Croix lui sera substitué. Ce dernier passe généralement pour le plus déterminé démagogue. Tous les cabinets répugneront à cette disposition, et elle donnera lieu à des conjectures fâcheuses. Si ce choix porte sur ce système que le ministère actuel ne tiendra pas, et que ceux dont on le compose sont voués d’avance à une chute prochaine, on en conclura dans les Cours étrangères que celle de France s’abandonne au hasard des révolutions. »
La reine lui répond le 25 novembre : « C’est M. de Lessart (passé de l’intérieur aux affaires étrangères) qui garde le ministère des affaires étrangères. On a parlé un moment de M. de Sainte-Croix, mais jamais je ne l’aurais souffert. Pour ce que vous dites d’un conseil secret, je crois que sous bien des rapports cela serait bon, mais il y a bien des choses aussi qui le rendent impossible. »
Et en M. de Lessart la reine témoigne un peu après, qu’elle n’a aucune confiance. Ainsi tout est à l’abandon : ni ministère décidément constitutionnel, ni conseil secret ; aucune politique assurée. Au moment même où la Révolution semble n’avoir pas confiance en la Révolution, la royauté n’a pas confiance en la royauté : il y a partout je ne sais quelle acceptation atone et inquiète du provisoire ; si on n’entre pas à fond dans ce secret des esprits par l’analyse minutieuse des choses, comment pourrait-on comprendre l’extraordinaire ascendant que donna en quelques jours à la Gironde son audace, mêlée d’inconscience et de légèreté ? Elle osait et elle était la seule à oser.
Du ministre de la guerre Duportail et du ministre de la marine Bertrand de Moleville je dirai peu de chose. Duportail avait à vaincre de grandes difficultés ; les institutions militaires créées par la Constituante étaient très composites. Par exemple, c’était le ministre de la guerre qui devait recevoir et diriger sur la frontière les gardes nationaux ; mais c’étaient les directoires des départements qui étaient chargés de les recruter, de les équiper, de les armer. De là, des complications quotidiennes et même des dégoûts incessants que n’aurait pu vaincre qu’un dévouement héroïque à l’ordre nouveau. Or Duportail le supportait, mais ne l’aimait pas, et les moindres critiques de l’Assemblée législative le mettaient hors de lui. Ses qualités d’administrateur étaient ainsi frappées d’impuissance.
Bertrand de Moleville était entré au ministère de la marine le 1er octobre, le jour même où l’Assemblée législative entrait en fonction. C’était un contre-révolutionnaire, un menteur et un fourbe. Ses mémoires sont pleins d’affirmations absurdes et de calomnies atroces contre les hommes de la Révolution, et même des royalistes comme Mallet-du-Pan ne purent obtenir de lui le redressement d’assertions absolument fausses. Il se croyait très habile parce que dans l’administration de ce grand service de la marine, où les éléments contre-révolutionnaires abondaient, il affectait de respecter littéralement la Constitution tout en en paralysant le succès par une sorte de trahison sourde et de déloyauté continue. Il répète sans cesse qu’il fallait qu’on touchât le tuf de la Constitution, et il fait l’aveu impudent de sa méthode de désorganisation sournoise. Par exemple, au moment où les hauts officiers semblent faire grève et refuser le commandement du port de Brest, dont les marins s’étaient plusieurs fois soulevés, un ancien chef d’escadre, M. de Peynier, se montra disposé à accepter.
« Depuis longtemps il habitait un château qu’il avait dans les montagnes de Bigorre, où il n’était en relation avec personne. J’imaginai un moyen de tirer parti de cette circonstance, de manière à augmenter ma popularité au conseil et à rendre à M. de Peynier le service de lui faire apercevoir les conséquences de son acceptation. Je lus sa lettre le même jour au conseil, et après lui avoir donné tous les éloges qu’il méritait, je proposai au roi, que j’avais mis dans le secret, de témoigner sa satisfaction à M. de Peynier, par une lettre dont je lus le projet, et de le nommer sur-le-champ commandant de la marine à Brest, au lieu de M. de la Grandière, qui venait de refuser cette place.
« Ces deux propositions furent adoptées et fort applaudies par tous les ministres, qui étaient d’avis que j’expédiasse un courrier à M. de Peynier pour lui porter la lettre du Roi ; mais j’observai qu’il la recevrait presque aussitôt par la poste qui partait le lendemain, et qu’il était d’autant plus inutile de faire la dépense d’un courrier extraordinaire que rien ne périclitait à Brest où M. Bernard de Marigny, excellent officier, commandait par intérim.
« Le véritable motif qui m’empêchait d’y mettre plus de diligence était l’importance que j’attachais à ne pas faire parvenir la lettre du roi à M. de Peynier avant celles que je m’attendais bien que ses amis lui écriraient, pour lui faire connaître l’état actuel de la marine et le mettre à portée de prendre un parti définitif avec connaissance de cause ; il en résulta que M. de Peynier dans sa réponse à la lettre du roi, refusa le commandement de la marine de Brest et rétracta son acceptation du nouveau grade dont il avait été pourvu. J’avoue que malgré mon serment à la Constitution, le rétablissement de la subordination dans les ports et sur les vaisseaux me paraissait impossible sous le nouveau régime, je croyais pouvoir désirer en conscience que tous les officiers distingués du corps de la marine abandonnassent, au moins pendant quelque temps, un service qu’ils ne pouvaient plus continuer avec honneur, et sans s’exposer à être assassinés. »
Quel fourbe ! Mais ce système de trahison sournoise contre la Révolution n’avait rien de décidé, et la politique royale semblait impuissante comme la Révolution elle-même.
Dans ce désarroi général et dans cette sorte de paralysie momentanée des partis et des forces, Brissot, avec une audace extraordinaire, vit dans la guerre le seul moyen de déterminer un mouvement nouveau, d’aiguillonner l’énergie révolutionnaire, de mettre à l’épreuve le roi et de le soumettre enfin à la Révolution ou de le renverser.
La guerre agrandissait le théâtre de l’action, de la liberté et de la gloire. Elle obligeait les traîtres à se découvrir, et les intrigues obscures étaient abolies comme une fourmilière noyée par l’ouragan.
La guerre permettait aux partis du mouvement d’entraîner les modérés, de les violenter au besoin ; car leur tiédeur pour la Révolution serait dénoncée comme une trahison envers la patrie elle-même.
La guerre enfin, par l’émotion de l’inconnu et du danger, par la surexcitation de la fierté nationale, ravivait l’énergie du peuple. Il n’était plus possible de le conduire directement par les seules voies de la politique intérieure à l’assaut du pouvoir royal. Une sorte de cauchemar d’impuissance semblait peser sur la Révolution. Quoi ! Ni au 14 juillet, ni au 6 octobre, ni même après Varennes, nous n’avons pu ou renverser ou subordonner le roi ! Bien mieux, à chacun des combats qu’elle soutient, à chacune même des fautes qu’elle commet, la royauté semble grandir en force ; et à l’heure où c’est le roi qui devrait être châtié, il n’y a que les démocrates qui soient poursuivis ! Pour rompre ce charme séculaire de la royauté, il faut qu’elle s’abandonne enfin à la Révolution ou que par la trahison flagrante contre la patrie, elle suscite contre elle la colère des citoyens déjà enfiévrés par la lutte contre l’étranger.
Ainsi la Gironde voulait faire de la guerre une formidable manœuvre de politique intérieure. Terrible responsabilité ! Quand nous pensons aux épreuves inouïes que la France va subir, quand nous songeons que cette surexcitation d’un moment sera payée par vingt années de césarisme sanglant et qu’ensuite de 1815 à 1848, on peut dire de 1815 à 1870, la France aura moins de liberté qu’elle n’en avait sous la Constitution de 1791, quand on songe que la propagande armée des principes révolutionnaires a surexcité contre nous le sentiment national des peuples et créé le formidable état militaire sous lequel plient les nations, on se demande si la Gironde avait le droit de jouer cette extraordinaire partie de dés.
La guerre n’était pas voulue par les souverains étrangers, et il semble que si le parti démocratique avait été uni, vigilant, prudent, s’il avait lutté contre les ministres suspects, s’il avait peu à peu imposé au roi des ministres patriotes, s’il avait travaillé sans relâche à propager les idées de la démocratie, s’il avait au besoin déclaré ouvertement la guerre à la royauté, il aurait pu consommer la Révolution sans la jeter dans les aventures extérieures. Mais ce qui faisait la force de la politique girondine, c’est qu’en 1791 et 1792 elle apparaissait comme le seul moyen d’action ; la fatigue intérieure de la nation obligeait les partis du mouvement à chercher des ressorts nouveaux. Michelet a dit, à propos de la guerre, que l’Océan de la Révolution débordait et que les Girondins venaient, portés sur la crête de ses vagues. Non, l’Océan de la Révolution ne débordait pas ; il s’était affaissé au contraire, et c’est de peur que la Révolution immobilisée sur une mer plate fût à la merci de l’ennemi que la Gironde déchaînait la guerre comme un vent de tempête. Avec quelle étourderie ! Avec quelle imprévoyance et quelle infatuation ! Quand on compte, pour réaliser un bilan de politique intérieure, sur les sentiments qu’excitera dans le peuple l’émotion de la guerre, quand on compte sur la colère que provoquera en lui la trahison, il faut s’attendre à toutes les fureurs et à tous les aveuglements ; il faut avoir fait d’avance le sacrifice entier de soi-même ; il faut prévoir que le soupçon de trahison n’enveloppera pas seulement les traîtres, mais peut-être aussi les bons citoyens ; il faut être prêt à pardonner au peuple qu’on aura ainsi soulevé, toutes les erreurs, toutes les violences.
Or les Girondins se flattaient de gouverner à leur aise ces sombres flots. Ils se flattaient de marquer aux colères patriotiques et populaires leur limite et leur chemin. Ils se croyaient les guides infaillibles et à jamais souverains, les maîtres du noir Océan, et ils s’imaginaient que sous leur conduite la barque de la Révolution repasserait aisément le Styx de la guerre, après avoir porté aux enfers la royauté morte.
La politique de la Gironde va donc se préciser ainsi. Elle ménagera le roi, pour ne pas découvrir trop brutalement son jeu. Elle harcèlera et attaquera les ministres jusqu’à ce qu’elle les ait obligés à prendre à l’égard de l’étranger une altitude provocatrice. Elle grossira les futiles incidents de frontière créés par la présence de quelques milliers d’émigrés à Coblentz ou à Worms. Au lieu de calmer les susceptibilités nationales, elle les excitera sans cesse ; et elle entraînera l’Assemblée, d’ultimatum en ultimatum, à déclarer la guerre. Elle se tiendra prête soit à gouverner au nom du roi, s’il se remet en ses mains, soit à le renverser dans la grande crise de la guerre et à proclamer la République. Et par un jeu d’une duplicité incroyable elle excitera tout ensemble et rassurera le pays, elle préparera la guerre en disant que les puissances ne la veulent pas, ne peuvent pas la vouloir.
Tout d’abord l’Assemblée, après le premier éblouissement du discours de Brissot, parut sentir le danger, et des conseils de prudence furent donnés. Koch, député du Haut-Rhin, démontra dans la séance du 12 octobre que les rassemblements d’émigrés ne pouvaient en aucune manière constituer un danger.
Vergniaud reprit, le 25, la thèse de Brissot et affirma que pour la France de la Révolution la sécurité serait dans l’offensive : « Certes je n’ai point l’intention d’étaler ici de vaines alarmes dont je suis bien éloigné d’être frappé moi-même. Non, ils ne sont pas redoutables ces factieux aussi ridicules qu’insolents, qui décorent leur rassemblement criminel du nom bizarre de France extérieure ; chaque jour leurs ressources s’épuisent. L’augmentation de leur nombre ne fait que les pousser plus rapidement vers la pénurie la plus absolue de tous moyens d’existence. Les roubles de la fière Catherine et les millions de la Hollande se consument en voyages, en négociations, en préparatifs désordonnés et ne suffisent pas d’ailleurs au faste des chefs de la rébellion. Bientôt on verra ces superbes mendiants qui n’ont pu s’acclimater à la terre de l’égalité, expier dans la honte et dans la misère les crimes de leur orgueil et tourner des yeux trempés de larmes vers la patrie qu’ils ont abandonnée ; et quand leur rage, plus forte que leur repentir, les précipiterait les armes à la main sur son territoire, s’ils n’ont pas de soutien chez les puissances étrangères, s’ils sont livrés à leurs propres forces, que seraient-ils si ce n’est de misérables pygmées qui, dans un accès de délire, se hasarderaient à parodier l’entreprise des Titans contre le Ciel ? (Applaudissements.)
« Quant aux Empires dont ils implorent les secours, ils sont trop éloignés et trop fatigués par la guerre du Nord pour que nous ayons de grandes craintes à concevoir de leurs projets. D’ailleurs l’acceptation de l’acte constitutionnel par le roi paraît avoir dérangé toutes les combinaisons hostiles. Les dernières nouvelles annoncent que la Russie et la Suède désarment, que dans les Pays-Bas les émigrés ne reçoivent d’autres secours que ceux de l’hospitalité.
« Croyez surtout, Messieurs, que les rois ne sont pas sans inquiétude. Ils savent qu’il n’y a pas de Pyrénées pour l’esprit philosophique qui vous a rendu la liberté ; ils frémiraient d’envoyer leurs soldats sur une terre encore brûlante de ce feu sacré ; ils trembleraient qu’un jour de bataille ne fît de deux armées ennemies un peuple de frères (Applaudissements) ; mais si enfin il fallait mesurer ses forces et son courage, nous nous souviendrions que quelques milliers de Grecs combattant pour la liberté triomphèrent d’un million de Perses ; et combattant pour la même cause avec le même courage, nous aurions l’espérance d’obtenir le même triomphe.
« Mais quelque rassuré que je sois sur les événements que nous cache l’avenir, je n’en sens pas moins la nécessité de nous faire un rempart de toutes les précautions qu’indique la prudence. Le ciel est encore assez orageux pour qu’il n’y ait pas une grande légèreté à se croire entièrement à l’abri de la tempête ; aucun voile ne nous cache la malveillance des puissances étrangères, elle est authentiquement prouvée par la chaîne des faits que M. Brissot a si énergiquement développés dans son discours. Les outrages faits aux couleurs nationales et l’entrevue de Pilnitz sont un avertissement que leur haine nous a donné, et dont la sagesse nous fait un devoir de profiter. Leur inaction actuelle cache peut-être une dissimulation profonde. On a tâché de nous diviser. Qui sait si on ne veut pas nous inspirer une dangereuse sécurité ? »
Et après avoir ainsi excité l’alarme, après avoir grossi le danger que les émigrés pouvaient indirectement, faire courir à la France, Vergniaud ajoute :
« Ici j’entends une voix qui s’écrie : Où sont les preuves légales des faits que vous avancez ? Quand vous les produirez, il sera temps de punir les coupables. Ô vous qui tenez ce langage, que n’étiez-vous dans le Sénat de Rome lorsque Cicéron dénonça la conspiration de Catilina ! vous lui auriez demandé aussi la preuve légale !… Des preuves légales ! Attendez une invasion que votre courage repoussera sans doute, mais qui livrera au pillage et à la mort vos départements frontières et leurs infortunés habitants. Des preuves légales ! Vous comptez donc pour rien le sang qu’elles vous coûteraient. Ah ! prévenons plutôt les désordres qui pourraient nous les procurer.
« Prenons enfin des mesures rigoureuses ; ne souffrons plus que des factieux qualifient notre générosité de faiblesse ; imposons à l’Europe par la fierté de notre contenance ; dissipons le fantôme de contre-révolution autour duquel vont se rallier les insensés qui la désirent ; débarrassons la nation de ce bourdonnement d’insectes avides de son sang qui l’inquiètent et la fatiguent, et rendons le calme au peuple. » (Applaudissements.)
Et Vergniaud concluait à des mesures sévères contre tous les émigrés, mais particulièrement contre les frères du roi, en un couplet sentimental et ému sur le roi lui-même :
« On parle de la douleur profonde dont sera pénétré le roi. Brutus immola des enfants criminels à sa patrie. Le cœur de Louis XVI ne sera pas mis à une si rude épreuve ; mais il est digne du roi d’un peuple libre de se montrer assez grand pour acquérir la gloire de Brutus… Si les princes se montraient insensibles aux accents de la tendresse en même temps qu’ils résisteraient à ses ordres, ne serait-ce pas une preuve aux yeux de la France, et de l’Europe que, mauvais frères et mauvais citoyens, ils sont aussi jaloux d’usurper par une contre-révolution l’autorité dont la Constitution investit le roi que de renverser la Constitution elle-même ? » (Vifs applaudissements.)
« Dans cette grande occasion, leur conduite lui dévoilera le fond de leur cœur et s’il a le chagrin de n’y pas trouver les sentiments d’amour et d’obéissance qu’ils lui doivent, qu’ardent défenseur de la Constitution et de la liberté il s’adresse aux cœurs des Français : il y trouvera de quoi se dédommager de ses pertes. » (Vifs applaudissements.)
L’Assemblée, le 31 octobre, rendit le décret suivant :
« L’Assemblée nationale considérant que l’héritier présomptif de la Couronne est mineur et que Louis-Stanislas-Xavier, prince français, parent majeur, premier appelé à la régence, est absent du royaume, en exécution de l’article 2, de la section III de la Constitution française, déclare que Louis-Stanislas-Xavier, prince français, est requis de rentrer dans le royaume sous le délai de deux mois, à compter du jour où la proclamation du Corps législatif aura été publiée dans la Ville de Paris, lieu actuel de ses séances.
« Dans le cas où Louis-Stanislas-Xavier, prince français, ne serait pas rentré dans le royaume à l’expiration du délai ci-dessus fixé, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence conformément à l’article 2 de l’acte constitutionnel.
« L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution du décret du 30 de ce mois, la proclamation dont suit la teneur sera imprimée, affichée et publiée sous trois jours dans la ville de Paris, et que le pouvoir exécutif fera rendre compte à l’Assemblée nationale, dans les trois jours suivants, des mesures qu’il aura prises pour l’exécution du présent décret.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
« Louis-Stanislas-Xavier, prince français, l’Assemblée nationale vous requiert, en vertu de la Constitution française, titre III, chapitre 2, section III, article 2, de rentrer dans le royaume dans le délai de deux mois, à compter de ce jour, faute de quoi, et après l’expiration dudit délai, vous serez censé avoir abdiqué votre droit éventuel à la régence. »
C’était une manifestation assez vaine, car on savait bien que Monsieur ne rentrerait pas ; et que lui importait d’être dépouillé de la régence par une assemblée révolutionnaire qu’il se promettait de briser ? Mais la Législative voulait paraître agir.
Le 8 novembre, un modéré, Ducastel, proposa au nom du Comité un projet de décret contre tous les émigrés :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation civile et criminelle, considérant que l’intérêt sacré de la patrie rappelle tous les Français fugitifs ; que la loi leur assure une protection entière ; que néanmoins la plupart se rassemblent sous des chefs, ennemis de la Constitution ; qu’ils sont suspects de conspiration contre l’Empire et que la générosité nationale peut leur accorder encore le temps de se repentir ; mais que s’ils ne se divisent pas dans ce délai, ils décèleront leurs criminels projets en demeurant rassemblés ; qu’alors ils seront des conjurés manifestes ; qu’ils devront être poursuivis et punis comme tels, et que déjà la tranquillité publique exige des mesures rigoureuses, décrète ce qui suit :
« ARTICLE PREMIER : Les Français rassemblés au delà des frontières du royaume sont, dès ce moment, déclarés suspects de conjuration contre la patrie. »
Cet article fut décrété à l’unanimité : le difficile en effet n’était pas de faire une déclaration générale et vague, le difficile était d’organiser des sanctions efficaces, et les incertitudes se manifestèrent dès l’article 2 :
« Si, au 1er janvier 1792, ils sont encore en ce moment en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration et ils seront poursuivis comme tels et punis de mort. »
La phrase était terrible. Mais comment démontrer d’une façon juridique et certaine qu’il y avait en effet « rassemblement » et que tel individu déterminé participait au rassemblement ? Couthon signale la difficulté avec brièveté et avec force :
« Le rassemblement est un crime, point de doute à cet égard ; mais, Messieurs, le grand embarras c’est d’établir le fait qui constitue le rassemblement. Pouvez-vous le faire par la voie ordinaire de l’information ? Vous n’aurez d’autres témoins que les Français en fuite eux-mêmes, et vous savez quel cas on pourrait faire de leur témoignage. » (Murmures.)
Couthon propose donc de substituer à la preuve proprement dite une présomption légale et il soumet à l’Assemblée le projet suivant ;
« Seront réputés en état de rassemblement jusqu’à la preuve du contraire et seront poursuivis et punis comme conspirateurs ceux des Français qui, sans cause légitime justifiée, resteraient hors du royaume et n’y rentreraient pas avant le 1er janvier 1792. »
Une partie de l’Assemblée murmura. Mais, dès lors la doctrine du salut public commence à s’affirmer avec force. Le député Gorguereau déclara :
« Je pense que lorsque vous avez une conviction intime que toute la France, toute l’Europe partage avec vous ; lorsque vous avez une conviction qui sera celle de la postérité, je crois, messieurs, que ces preuves morales doivent suffire à l’homme d’État. Il faut sauver l’État et vous ne le sauverez pas, si vous voulez faire juger les conspirateurs comme des perturbateurs ordinaires de la tranquillité… La transition de l’Assemblée constituante à la législation actuelle doit être l’entière et absolue solution de continuité entre l’ancien régime et le nouveau. Sous l’ancien régime, tous les gens puissants échappaient à la loi ; aujourd’hui la loi doit les atteindre par tous les moyens qui sont possibles et praticables. Je ne balance point à dire que vous devez renoncer à la Haute-Cour nationale et aux tribunaux et aux formes judiciaires, parce que votre premier devoir est de sauver l’Empire qui est confié à votre sollicitude. » (Applaudissements.)
Couthon réduisit son amendement aux princes et aux fonctionnaires publics :
« Seront réputés prévenus d’attentat et de complot contre la sûreté générale et contre la Constitution et seront mis, en conséquence, en état d’accusation, ceux des princes français et des fonctionnaires publics qui resteraient hors du royaume et n’y rentreraient pas d’ici au premier janvier prochain. »
Sous cette forme nouvelle, l’amendement de Couthon fut adopté à la presque unanimité en addition à l’article 2 du Comité, adopté également. La suite fut adoptée presque sans débat :
« Article 3. — Dans les quinze premiers jours du même mois, la Haute-Cour nationale sera convoquée s’il y a lieu.
« Article 4. — Les revenus des émigrés condamnés par contumace seront, pendant leur vie, perçus au profil de la nation, sans préjudice des droits des femmes, enfants et des créanciers, dont la légitimité aura été reconnue antérieurement au présent décret.
« Article 5. — Dès à présent, tous les revenus des princes français absents du royaume seront séquestrés. Nul payement de traitement, pension ou revenus quelconques ne pourra être fait directement ou indirectement auxdits princes, leurs mandataires ou délégués, jusqu’à ce qu’il ait été autrement décidé par l’Assemblée nationale, sous peine de responsabilité et de deux années de gêne contre les ordonnateurs et payeurs. La même disposition est applicable, en ce qui touche leurs traitements et pensions, à tous les fonctionnaires publics, civils ou militaires et aux pensionnés de l’État.
« Article 6. — Toutes les diligences nécessaires pour la perception et le séquestre décrétés par les deux articles précédents, seront faites à la requête des procureurs-syndics des départements, sur la poursuite des procureurs-syndics de chaque district où seront les dits revenus, et les deniers en provenant seront versés dans les caisses des receveurs de district, qui en demeureront comptables. Les procureurs-syndics feront parvenir tous les mois au ministère de l’intérieur, qui en rendra compte aussi à l’Assemblée chaque mois, l’état des diligences qui auront été faites pour l’exécution de l’article ci-dessus.
« ARTICLE 7. — Tous fonctionnaires publics absents du royaume sans cause légitime avant l’amnistie prononcée par la loi du 15 septembre 1791, et qui n’étaient pas rentrés en France, sont privés de leurs places et de tout traitement.
« ARTICLE 8. — Tous fonctionnaires publics absents du royaume sans cause légitime depuis l’amnistie sont aussi déchus de leurs places et traitements et, en outre, de leurs droits de citoyens actifs.
« ARTICLE 9. — Aucun fonctionnaire public ne pourra sortir du royaume sans un congé du ministre dans le département duquel il sera, sous les peines portées ci-dessus.
« ARTICLE 10. — Tout officier militaire, de quelque grade qu’il soit, qui abandonnera ses fonctions sans congé ou démission acceptée, sera réputé coupable de désertion et puni comme le soldat déserteur. (Vifs applaudissements.)
« ARTICLE 11. — Aux termes de la loi, il sera formé une cour martiale dans chaque division de l’armée pour juger les délits militaires commis depuis l’amnistie ; des accusateurs publics poursuivront en outre, comme coupables de vol, les personnes qui ont enlevé des effets ou des deniers appartenant aux régiments français.
« ARTICLE 12. — Tout Français qui, hors du royaume, embauchera et enrôlera des individus pour qu’ils se rendent aux rassemblements énoncés dans les articles 1 et 2 du présent décret sera puni de mort. La même peine aura lieu contre toute personne qui commettra le même crime en France.
« ARTICLE 13. —Il sera sursis à la sortie hors du royaume de toute espèce d’armes, chevaux, munitions. »
Et enfin voici l’article 14 qui amorçait les hostilités :
« L’Assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui proposer les mesures que le roi sera prié de prendre, au nom de la nation, à l’égard des puissances étrangères limitrophes qui souffrent, sur leur territoire, les rassemblements des Français fugitifs. »
La séance fut levée à six heures au milieu des applaudissements et des acclamations des tribunes.
La politique de la Gironde triomphait. Les modérés, après une faible tentative de résistance, avaient dû consentir aux lois contre les émigrés ; ils n’auraient pu s’obstiner sans être accusés de couvrir de leur indulgence une conjuration armée contre la patrie. Puis, si le roi sanctionnait les décrets, il était pris dans l’engrenage ; les mesures contre les émigrés resteraient vaines si les puissances étrangères ne dispersaient pas les rassemblements ; de là évidemment des complications diplomatiques d’où la guerre pouvait sortir, et la guerre donnerait un nouvel élan à la Révolution. Si, au contraire, le roi refusait sa sanction aux décrets, il devenait évident à tous que seule une grande crise, à la fois extérieure et intérieure, pourrait remettre en mouvement la Révolution. Enfin, la vanité même des lois promulguées contre les émigrants qui étaient hors d’atteinte, suggérerait naturellement au pays l’idée d’une action plus décisive. Brissot pouvait attendre avec confiance les événements. Son plan commençait à se développer dans les faits.
En quelques démocrates, pourtant, la défiance s’éveille. Robespierre est encore absent de Paris, il prend à Arras quelques semaines de repos et, sans doute, il commence à s’inquiéter, puisque quinze jours après il rentre. Le journal de Prudhomme exprime de vagues inquiétudes ; il ne paraît pas se douter encore que la marche adoptée conduit à la guerre. Mais il se demande si on ne trompe pas la nation :
« Ce que tout le monde se demande et ce que personne ne sait, ce sont les suites qu’aura le décret. D’abord il paraît bien singulier que le projet en ait été présenté par M. Ducastel, qui avait annoncé des vues toutes contraires dans le courant de la discussion, et plus étonnant encore que ce même décret n’ait pas essuyé d’opposition marquée de la part des ministériels… Le serpent est sous l’herbe. Prenons bien garde que ce ne soit un piège ou tout au moins un jeu. Il ne suffit pas que l’Assemblée nationale ait prononcé, il faut que le roi sanctionne, et sanctionnera-t-il ? Signera-t-il l’arrêt de mort de ses frères ? S’il ne le fait pas, quel parti prendre ? S’il le fait, comment croire à sa bonne foi ? Et supposé que le roi ait sanctionné, supposé qu’il ne contrarie pas l’exécution du décret, les émigrants attroupés se diviseront-ils ? Rentreront-ils en France ? Auront-ils le courage d’être repentants ? Tous les indices tendent à faire croire que non ; ces misérables se laisseront aller à un faux sentiment de gloire ; ils ne se sépareront pas ; ils attaqueront leur patrie ; s’il en est ainsi, plus de pitié, que la loi soit inflexible pour les condamnations judiciaires, comme le sera l’épée des braves gardes nationales des frontières ; il faut que les conjurés trouvent la mort civile au dedans ; il faut qu’ils tombent sous le fer des tyrannicides au dehors ; mais que l’Assemblée nationale prenne garde aux ministres, qu’elle prenne garde au roi ; qu’elle prenne garde à tout ce qui approche de lui ; si elle n’avait rendu le décret que pour tromper le peuple, si elle n’en surveille exactement l’exécution… la hache est levée, il faut qu’elle frappe de grands coups. »
Il n’y a évidemment, dans l’esprit des révolutionnaires du journal de Prudhomme que perplexité et obscurité. Ils n’avertissent pas le peuple qu’il ne faut pas grossir artificiellement la question des émigrés, car, ainsi exagérée, elle n’aura d’autre solution que la guerre. Ils font de grands gestes de menace et servent, sans s’en douter, la politique belliqueuse de la Gironde. Marat aussi tâtonne encore. Il paraît croire à une agression imminente des puissances étrangères, et il écrit le 4 novembre :
« En dépit des assurances pacifiques de Montmorin, et de son propre aveu, nous avons donc toujours contre nous les puissances dont nous avions à craindre des projets hostiles ; après un pareil aveu, était-ce bien la peine d’entreprendre de nous bercer encore ? Mais que dis-je ? sa retraite soudaine est le plus sûr indice que nous sommes sur le point d’être attaqués par ces puissances si pacifiques. Aujourd’hui qu’une explosion terrible va mettre le sceau de l’évidence à ses impostures et à ses machinations, il tremble que chaque instant ne vienne à découvrir toute la noirceur des manœuvres criminelles qu’il a employées pour nous les mettre sur les bras, et il se joue de la loi de responsabilité en échappant, par la fuite, à sa trop juste punition. »
Mais si Marat se trompe sur les dispositions des puissances en ce moment du moins évite-t-il loin ce qui peut créer des chances de guerre. Il ramène à leur vraie valeur les mesures de l’Assemblée contre les émigrants. Il montre qu’elles seront vaines, que l’essentiel est de combattre, en France même, le pouvoir royal. »
Il écrit le 12 novembre :
« Le lecteur irréfléchi aura sans doute été scandalisé de mon jugement sur le décret contre les émigrés contre-révolutionnaires ; et cela doit être, il faut des lumières que le commun des hommes n’a pas pour en apercevoir les vices à travers des apparences de sévérité, bien propres à en imposer à la multitude qui ne pense pas. Faites retentir aux oreilles du peuple les grands mots d’amour de la patrie, de monarchie, de liberté, de défense des droits de l’homme, de souveraineté de la nation ; peu en peine si les fripons qui les ont dans la bouche s’en servent pour l’enchaîner, il les applaudit à tout rompre… Que sera-ce si vous paraissez sévir contre des hommes qu’il est habitué à regarder comme ses ennemis, comme des traîtres et des conspirateurs ? À l’ouïe de la confiscation des biens de ceux qui seraient condamnés, il a poussé des cris d’allégresse, sans s’embarrasser s’il le seront jamais. À l’ouïe de la peine de mort portée contre les chefs des conjurés, il a fait éclater ses transports sans songer si cette peine pourra jamais les atteindre…
Que faire, me disait un patriote un peu revenu de sa joie, à l’ouïe de mon commentaire sur le décret qu’il me remit ? — Nous préparer à la guerre civile, qui est enfin inévitable, l’attendre et commencer par écraser nos ennemis du dedans, qui occupent toutes les places d’autorité et de confiance ; ce n’est qu’après les avoir exterminés que nous pourrons agir avec efficacité contre nos ennemis du dehors, quelque nombreux qu’ils soient. Avant cela, tout ce que nous entreprendrons sera complètement inutile ; car à supposer le législateur enfin déterminé à sauver la France et à faire triompher la liberté (ce que je suis bien loin de croire), quel fonctionnaire public chargera-t-il de l’exécution de ses décrets qui ne soit vendu ou prêt à se vendre au prince ? Or le prince lui-même est le chef des conspirateurs contre la patrie. Tant qu’il aura les clefs du trésor public, soyez sûr qu’il sera l’âme de toutes les affaires. »
Ainsi, ce que veut Marat, c’est que la Révolution s’achève au dedans directement et non par le funeste détour de la guerre ; c’est que la Révolution mette dans tous les postes d’autorité des agents fidèles, et qu’elle finisse par donner l’assaut aux Tuileries ; c’est un 10 août, sans déclaration préalable de guerre aux puissances, que conseille Marat ; et si tous les révolutionnaires démocrates s’étaient entendus pour calmer l’effervescence du peuple contre le péril factice des émigrés et concentrer sur l’ennemi du dedans l’énergie populaire, là était le salut de la Révolution. Il n’est pas démontré que les puissances auraient osé prendre l’offensive contre la Révolution victorieuse au dedans de ses ennemis. En tout cas, il fallait tenter cette chance de la Révolution avec la paix au lieu d’attiser les conflits extérieurs pour réchauffer à la flamme de la guerre la Révolution. On devine que Marat, qui ne fait encore que manifester une sorte de malaise, ne tardera pas à prendre position contre la politique girondine.
Le roi fit savoir à l’Assemblée, le 12 novembre, par le garde des sceaux Duport-Dutertre, qu’il donnait sa sanction au décret contre son frère. Quant au décret d’ensemble contre les émigrés, il faisait dire qu’il examinerait : c’était la formule officielle du refus de sanction. L’Assemblée accueillit cette communication dans un profond silence. Mais le garde des sceaux Duport-Dutertre ayant voulu expliquer pourquoi le roi avait refusé la sanction, des murmures s’élevèrent et l’Assemblée déclara qu’elle n’avait pas à entendre des explications.
Le choc immédiat entre l’Assemblée et le roi fut beaucoup moins rude qu’on ne l’aurait imaginé. Cambon alla même jusqu’à dire : « Nos ennemis ont en ce moment la preuve la plus imposante que le roi est libre au milieu de ses peuples, même de résister au vœu général ; il vient de mettre son veto sur un décret très important. (Applaudissements.) Je m’applaudis de cet acte de représentant qu’il vient d’exercer ; c’est la plus grande marque d’attachement qu’il ait pu donner à la Constitution. » (Applaudissements.)
Il n’est pas aisé de comprendre pourquoi Louis XVI a refusé sa sanction à ce décret. En fait, il n’était pas très dangereux pour les émigrés. C’est contre les fonctionnaires publics seuls que la peine de la confiscation était portée ; contre les autres émigrés, la preuve légale de la participation au rassemblement restait difficile à faire, et il semble que puisque Louis XVI avait à ce moment pour tactique de gagner la confiance du peuple, il aurait pu sanctionner le décret.
Sans doute il craignit de surexciter encore les émigrés et de les pousser à des démarches imprudentes en paraissant les abandonner. Ne perdrait-il pas le peu d’autorité qu’il avait encore sur eux s’ils pouvaient l’accuser de les avoir livrés à la Révolution ? Pour amortir auprès de l’Assemblée et du pays l’effet de son refus de sanction, le roi fit connaître à l’Assemblée, le 16 novembre, une proclamation aux émigrants et une lettre à ses frères. Il pressait les émigrants de rentrer, de renoncer à tout projet de violence. « Revenez, c’est le vœu de chacun de vos concitoyens ; c’est la volonté de votre roi. » Il pressait aussi ses frères de le rejoindre. « Je vais prouver par un acte bien solennel et dans une circonstance qui vous intéresse, que je puis agir librement. Prouvez-moi que vous êtes mon frère et Français en cédant à mes instances. Votre véritable place est auprès de moi. Votre intérêt, vos sentiments vous conseillent également de venir la reprendre et je vous y invite et, s’il le faut, je vous l’ordonne. »
Vains appels et dont Louis XVI connaissait bien l’inanité. Mais ces documents suffirent à empêcher tout mouvement d’opinion un peu vif contre le refus de sanction. Le pays aimait à se persuader que le roi, tout en prouvant sa liberté par ce refus même, essayait loyalement de mettre un terme aux agitations des émigrés et aux intrigues des princes, et le conflit entre la royauté et la Révolution ne se précisait pas.
Le 15 novembre, à la Législative, c’est le chef des modérés Viénot-Vaublanc qui succède à Vergniaud au fauteuil de la présidence.
Mais une autre question brûlante est jetée dans l’Assemblée : il devenait urgent de réprimer les manœuvres factieuses des prêtres réfractaires. Le 12 novembre, au nom du Comité de Législation, le rapporteur Velrieu faisait une peinture très inquiétante de l’agitation cléricale. « Il n’est pas de moyens que les prêtres perturbateurs n’emploient pour renverser s’il est possible la Constitution que nous avons juré de défendre, pour l’anéantir dans les horreurs d’une guerre civile. Insinuations perfides, mesures sinistres, propos séditieux, écrits incendiaires, calomnies contre la loi qui nous a arrachés à la servitude, désordres domestiques, insultes envers les autorités constituées, refus des sacrements par les curés non remplacés, envers ceux qui ont acquis des biens nationaux ; coalition de ces prêtres avec les ci-devant nobles ; rébellions ouvertes à l’installation des curés amis de la pureté de l’Évangile ; outrages sanglants faits à ceux-ci au pied même des autels ; rassemblements formés devant les églises pour troubler le service divin ; hordes de femmes égarées et séditieuses ; curés chassés, poursuivis, assassinés ; enfin, citoyens aigris, formés par une haine fanatique et prêts à s’entrégorger, voilà, Messieurs, l’idée rapide et générale des maux qui désolent une partie de l’Empire français. »
Mais le Comité où dominaient des influences modérées, se bornait à proposer, le 14 novembre, un projet de décret exigeant des prêtres le serment civique et privant de leurs pensions et traitements ceux qui ne le prêteraient point.
Isnard fit de nouveau gronder ses foudres : « Je soutiens, Messieurs, qu’il n’est qu’une loi vraiment appropriée à ce genre de délit : c’est celle d’exiler hors du royaume le prêtre perturbateur. (Applaudissements dans les tribunes.) C’est là le moyen qui fut employé contre les jésuites, et les jésuites furent oubliés ; ce n’est que par l’exil que vous pourrez faire cesser l’influence contagieuse du coupable ; il faut le séparer de ses prosélytes ; car

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
si en le punissant de toute autre manière, vous lui laissez la faculté de prêcher, de messer (Rires) et de confesser (et vous ne pourriez pas la lui ôter s’il
reste dans le royaume) ; il vous fera plus de mal puni, qu’absous. Je regarde les prêtres perturbateurs comme des pestiférés qu’il faut renvoyer dans les lazarets d’Espagne et d’Italie… (Applaudissements, murmures et approbations.) Il faut punir le prêtre coupable. Toute voie de pacification est désormais inutile, et je demande, en effet, ce qu’ont produit jusqu’ici tant de pardons réitérés. Notre indulgence a augmenté l’audace de nos ennemis ; il faut donc changer de système et employer enfin des moyens de rigueur. Hé ! qu’on ne me dise pas qu’en voulant réduire le fanatisme on redoublera sa force, ce monstre n’est plus ce qu’il était ; il ne peut vivre longtemps dans l’atmosphère de la liberté ; déjà blessé par la philosophie, il n’opposera qu’une faible résistance ; abrégeons sa dangereuse et convulsive agonie, en l’immolant avec le glaive de la loi. L’univers applaudira à cette grande exécution, car de tous les temps et chez tous les peuples les prêtres fanatiques ont été les fléaux des sociétés, les assassins de l’espèce humaine ; toutes les pages de l’histoire sont tachées de leurs crimes ; partout ils aveuglent un peuple crédule, ils tourmentent l’innocence par la crainte et trop souvent ils vendent au crime ce ciel que Dieu n’accorde qu’à la vertu. » (Applaudissements répétés.)
Ainsi, la lutte se précisait, nette et violente, entre la Révolution et l’Église. Mais Isnard, girondin fougueux, témoigne une vaste impatience de combat qui semble menacer tout l’univers. Le vent de sa parole sème au loin des germes ardents de guerre.
« Et vous croiriez, s’écrie-t-il avec un singulier mélange d’inspiration et d’emphase, vous croiriez que la Révolution française, la plus étonnante qu’ait éclairée le soleil, révolution qui tout à coup arrache au despotisme son sceptre de fer, à l’aristocratie ses verges, à la théocratie ses mines d’or ; qui déracine le chêne féodal, foudroie le cyprès parlementaire, désarme l’intolérance, déchire le froc, renverse le piédestal de la noblesse, brise le talisman de la superstition, étouffe la chicane ; détruit les fiscalités ; révolution qui sans doute va émouvoir tous les peuples, forcer la couronne à fléchir devant les lois, placer les ministres entre le devoir et le supplice et verser le bonheur dans le monde entier, s’opérera paisiblement, sans que l’on puisse tenter de nouveau de la faire avorter ? Non, il faut un dénouement à la Révolution française. »
C’est cette hâte, cette fièvre d’en finir avec tous les ennemis du dedans et du dehors qui anime en ce moment la Gironde. Dès qu’elle parle et à propos de toutes les questions, c’est l’horizon universel qui s’enflamme. Cet enthousiasme belliqueux est plein de grandeur, mais aussi, pour la liberté, plein de péril. L’Assemblée fut un peu effrayée du discours d’Isnard. Un membre cria : « Je demande que ce discours soit renvoyé à Marat. » Et malgré l’insistance de la gauche, l’Assemblée refusa d’en voter l’impression. Entre les lois trop conciliantes du comité et les lois d’exil proposées par Isnard, elle cherchait un moyen terme. Et elle demanda un nouveau rapport et un nouveau projet au Comité.
Le projet présenté par François de Neufchâteau fut adopté presque en son entier. Il y eut discussion assez vive sur l’article 7, où Isnard renouvela sans succès la proposition de déporter les prêtres factieux. Elle fut repoussée, mais le rapporteur, François de Neufchâteau, se borna à objecter qu’elle était « prématurée ». Et il ajouta : « Elle est une des mesures générales qui vous sont réservées après avoir entendu les comptes que vous demandez aux directoires des départements. »
La Révolution se ménageait ainsi cette arme redoutable. Il y eut débat aussi sur un article additionnel d’Albitte. Celui-ci craignait évidemment d’exaspérer une partie des populations catholiques en leur refusant tout moyen de culte si elles ne se ralliaient pas au prêtre constitutionnel. Il proposa ceci : « Les églises ou édifices nationaux ne pourront être employés à l’usage gratuit d’aucun autre culte que celui qui est entretenu aux frais de la nation. Pourra néanmoins toute association religieuse acheter celles desdites églises non employées audit culte, pour y exercer publiquement le sien, sous la surveillance des autorités constituées, en se conformant aux lois de police et d’ordre public. « Cela paraissait très libéral, mais c’était la destruction de la loi, à moins que ce ne fût une disposition tout à fait vaine. Si les catholiques, qui ne reconnaissaient point le prêtre constitutionnel, pouvaient acheter les édifices non consacrés au culte légal dans les paroisses où celui-ci serait nul, les édifices religieux appartiendraient bientôt aux prêtres réfractaires. Mais ceux-ci, allait-on exiger d’eux le serment ? Si on le leur demandait, l’amendement Albitte n’avait plus d’objet. S’ils en étaient dispensés, toute la loi tombait, et des prêtres, ayant refusé le serment, étaient autorisés à dire publiquement la messe dans les édifices mêmes, qui, la veille, servaient au culte, sous la seule condition que les fidèles groupés autour d’eux les eussent acquis de leurs deniers.
Vergniaud, Guadet, désirant sans doute ne pas pousser jusqu’au bout la guerre religieuse, semblèrent un moment sympathiques à la motion Albitte. Mais quelle inconséquence dans la Gironde ! ils craignaient de surexciter au dedans le fanatisme catholique ; ils voulaient autant que possible amortir le conflit entre le culte constitutionnel et les habitudes anciennes, et en même temps, ils toléraient et ils encourageaient les manœuvres de Brissot qui, du fond du Comité diplomatique comme à la tribune de l’Assemblée, poussait à la guerre contre l’Europe. Comme si le conflit tragique de la Révolution avec l’étranger n’allait pas aggraver d’un coefficient formidable tous les conflits intérieurs ! La trompette guerrière du girondin Isnard déchirait les oreilles et exaspérait les nerfs, au moment même où ses amis essayaient d’adoucir un peu le choc des préjugés catholiques et de la Révolution. François de Neufchâteau démontra aisément, au nom du Comité, que la disposition d’Albitte, qui rouvrait les temples aux prêtres réfractaires, était en contradiction avec toute la loi qui les frappait, et pour obtenir le vote définitif de l’ensemble, il résuma en quelques formules brèves et fortes la doctrine laïque de la Révolution :
« Je demande si l’on peut invoquer la tolérance pour des opinions qui ne sont pas des opinions théologiques, mais bien évidemment des principes de troubles, des motifs de sédition, des germes de discorde et de guerre intestine. Je demande s’il y a de la dureté, s’il y a de la persécution de la part du législateur à vouloir prévenir ces troubles, en obligeant des prêtres suspects de tenir à un système aussi contraire à l’ordre social, à la prestation d’un serment civique. Je demande si l’on peut accorder à ceux qui refusent de s’y soumettre la faculté d’exercer un prétendu culte particulier, qui ne diffère véritablement du culte salarié par l’État, qu’en ce que les ministres de ce dernier ont eu le mérite de se montrer citoyens et de coopérer par leur patriotisme à la Révolution qui nous a rendu la liberté et l’égalité des droits.
« Messieurs, je me résume.
« L’Église est dans l’État et l’État n’est pas dans l’Église. Vous ne commettrez point la faute d’admettre un empire dans un empire ; vous ne subordonnerez point la société générale, la grande famille, le peuple souverain, dont les intérêts vous sont confiés, à l’ambition et à la cupidité de quelques individus. Vous direz à ces individus que, s’ils sont de bonne foi, ils ne doivent pas se refuser à en donner la preuve, que si leur Église veut être reçue dans l’État, il faut qu’elle se soumette aux lois de l’État ; qu’il faut que ses ministres prêtent serment d’obéissance et de fidélité à l’État. » (Applaudissements répétés.)
Comme on voit, la Législative est plus éloignée encore, s’il est possible, que la Constituante, de toute idée de séparer l’Église de l’État. Au contraire, l’Église doit être liée par la loi de l’État, par la loi de la Révolution. Et nous-mêmes, le jour où la République aura supprimé le budget des cultes et dénoncé le Concordat, nous ne devrons pas oublier la forte pensée révolutionnaire ; et l’organisation ecclésiastique, ne devra pas former « un empire dans un empire ».
Sous l’impression des vigoureuses paroles de Neufchâteau, la Législative vota le 29 novembre 1791 toute une loi de police religieuse, autour de laquelle vont se livrer de grandes batailles et qu’il importe de faire connaître en entier dans son texte même.
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires civils envoyés dans le département de la Vendée, les pétitions d’un grand nombre de citoyens et le rapport du Comité de législation civile et criminelle sur les troubles excités dans plusieurs départements du royaume, par les ennemis du bien public, sous prétexte de religion ;
« Considérant que le contrat social doit lier comme il doit également protéger tous les membres de l’État ;
« Qu’il importe de définir sans équivoque les termes de cet engagement, afin qu’une confusion dans les mots n’en puisse opérer une dans les idées ; que le serment purement civique est la caution que tout citoyen doit donner de sa fidélité à la loi, et de son attachement à la société, et que la différence des opinions religieuses ne peut être un empêchement de prêter serment, puisque la Constitution assure à tout citoyen la liberté entière de ses opinions en matière de religion, pourvu « que leur manifestation ne trouble pas l’ordre » ou « ne porte pas à des actes nuisibles à la sûreté publique ».
« Que le ministre d’un culte, en refusant de reconnaître l’acte constitutionnel qui l’autorise à professer ses opinions religieuses, sans lui imposer d’autre obligation que le respect pour « l’ordre établi par la loi » et pour la « sûreté publique », annoncerait par ce refus même que son intention n’est pas de les respecter : Qu’en ne voulant pas reconnaître la loi il abdiquerait volontairement les avantages que celle-là seule peut lui garantir ;
« Que l’Assemblée nationale pressée de se livrer aux grands objets qui appellent son attention pour l’affermissement du crédit et le système des finances, s’est vue, avec regret, obligée de tourner ses premiers regards sur des désordres qui tendent à compromettre toutes les parties du service public, en empêchant l’assiette prompte et le recouvrement paisible des contributions ;
« Qu’en remontant à la source de ces désordres, elle a entendu la voix de tous les citoyens éclairés proclamer dans l’Empire cette grande vérité que la religion n’est pour les ennemis de la Constitution, qu’un prétexte dont ils abusent, et un instrument dont ils osent se servir pour troubler la terre au nom du ciel ;
« Que leurs délits mystérieux échappent aisément aux mesures ordinaires, qui n’ont point de prise sur les cérémonies clandestines, dans lesquelles leurs trames sont enveloppées, et par lesquelles ils exercent sur les consciences un empire invisible ;
« Qu’il est temps enfin de percer ces ténèbres, afin qu’on puisse discerner le citoyen paisible et de bonne foi, du prêtre turbulent et machinateur qui regrette les anciens abus, et ne peut pardonner à la Révolution de les avoir détruits ;
« Que ces motifs exigent impérieusement que le Corps législatif prenne de grandes mesures politiques pour réprimer les factieux, qui couvrent leur complot d’un voile sacré ;
« Que l’efficacité de ces nouvelles mesures dépend en grande partie du patriotisme, de la prudence et de la fermeté des corps municipaux et administratifs, et de l’énergie que leur impulsion peut communiquer à toutes les autres autorités constituées ;
« Que les administrations de département surtout, peuvent dans ces circonstances, rendre le plus grand service à la nation et se couvrir de gloire en s’empressant de répondre à la confiance de l’Assemblée Nationale, qui se plaira toujours à distinguer leurs services, mais qui, en même temps, réprimera sévèrement les fonctionnaires publics dont la tiédeur dans l’exécution de la loi ressemblerait à une connivence tacite avec les ennemis de la Constitution ;
« Qu’enfin, c’est toujours au progrès de la saine raison et à l’opinion publique bien dirigée qu’il est réservé d’achever le triomphe de la loi, d’ouvrir les yeux des habitants des campagnes sur la perfidie intéressée de ceux qui veulent leur faire croire que les législateurs constituants ont touché à la religion de leurs pères et de prévenir, pour l’honneur des Français, dans ce siècle de lumière le renouvellement des scènes horribles dont la superstition n’a malheureusement que trop souillé leur histoire dans les siècles où l’ignorance des peuples était un des ressorts du gouvernement. »
« L’Assemblée nationale décrète préalablement l’urgence et décrète définitivement ce qui suit. »
Ce beau préambule qui faisait appel tout ensemble à la force de la loi et la force de l’opinion éclairée, pouvait légitimer des mesures plus rigoureuses encore que celles qu’allait prendre à ce moment la Législative ; car en réalité, il constatait que le clergé réfractaire, refusant le nouveau pacte, le « Contrat social » se mettait lui-même hors la loi, hors la nation. C’est dès maintenant la justification théorique des lois d’exil et de déportation contre les prêtres insoumis que la Révolution ne portera que quelques mois plus tard.
Dès le 29 novembre, elle décide à une immense majorité :
ARTICLE PREMIER. — Dans la huitaine à compter de la publication du présent décret tous les ecclésiastiques autres que ceux qui se sont conformés au décret du 27 novembre dernier, seront tenus de se présenter par devant la municipalité du lieu de leur domicile, d’y prêter le serment civique dans les termes de l’article 5 du titre 2 de la Constitution et de signer le procès-verbal qui en sera dressé sans frais.
ART. 2. — À l’expiration du délai ci-dessus, chaque municipalité fera parvenir au directoire du département, par la voie du district, un tableau des ecclésiastiques domiciliés dans sa section, en distinguant ceux qui auront prêté le serment civique et ceux qui l’auront refusé. Ces tableaux serviront à former les listes dont il sera parlé ci-après.
ART. 3. — Ceux des ministres du culte catholique qui ont donné l’exemple de la soumission aux lois et de l’attachement à leur patrie en prêtant le serment civique suivant la formule prescrite par le décret du 27 novembre 1790, et qui ne l’ont pas rétracté, sont dispensés de toute formalité nouvelle. Ils sont invariablement maintenus dans tous les droits qui leur ont été attribués par les décrets précédents.
ART. 4. — Quant aux autres ecclésiastiques, aucun d’eux ne pourra désormais toucher, réclamer ou obtenir de pension ou de traitement sur le Trésor public qu’en représentant la preuve de la prestation du serment civique, conformément à l’article 1er ci-dessus. Les trésoriers receveurs ou payeurs, qui auront fait des payements contre la teneur du présent décret, seront condamnés à en restituer le montant et privés de leur état.
ART. 5. — Il sera composé tous les ans une masse des pensions dont les ecclésiastiques auront été privés par leur refus ou leur rétractation du serment. Cette masse sera répartie entre les 83 départements pour être employée, par les conseils généraux des communes, soit en travaux de charité pour les indigents valides, soit en secours pour les indigents invalides.
ART. 6. — Outre la déchéance de tout traitement et pension, les ecclésiastiques qui auront refusé de prêter le serment civique ou qui le rétracteront après l’avoir prêté, seront par ce refus ou cette rétractation même, réputés suspects de révolte contre la loi, et de mauvaises intentions contre la patrie et comme tels plus particulièrement soumis et recommandés à la surveillance des autorités constituées.
ART. 7. — En conséquence, tout ecclésiastique ayant refusé de prêter le serment civique ou qui le rétractera après l’avoir prêté, qui se trouvera dans une commune où il surviendra des troubles dont les opinions religieuses seront la cause ou le prétexte, pourra, en vertu d’un arrêté du directoire du département sur l’avis de celui du district, être éloigné premièrement du lieu de son domicile ordinaire sans préjudice de la dénonciation aux tribunaux, suivant la gravité des circonstances.
ART. 8. — En cas de désobéissance à l’arrêté du directoire du département, les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux et punis de l’emprisonnement dans le chef-lieu du département : le terme de cet emprisonnement ne pourra excéder une année.
ART. 9. — Tout ecclésiastique qui sera convaincu d’avoir provoqué la désobéissance à la loi et aux autorités constituées sera puni de deux années de détention.
ART. 10. — Si à l’occasion des troubles religieux, il s’élève dans une commune des séditions qui nécessitent le déplacement de la force armée, les frais avancés par le Trésor public pour cet objet seront supportés par les citoyens domiciliés dans la commune sauf leur recours contre les chefs, instigateurs, et complices des émeutes.
ART. 11. — Si des corps ou des individus chargés des fonctions publiques négligent ou refusent d’employer les moyens que la loi leur confie pour prévenir ou réprimer ces émeutes, ils en seront personnellement responsables, ils seront poursuivis, jugés et punis conformément à la loi du 3 août 1791.
ART. 12. — Les églises et édifices employés au culte dont les frais sont payés par l’État ne pourront servir à aucun autre culte. Les églises et oratoires nationaux que les corps administratifs auront déclarés n’être pas nécessaires pour l’exercice du culte dont les frais seront payés par la Nation pourront être achetés ou affermés par les citoyens attachés à un autre culte quelconque, pour y exercer publiquement ce culte sous la surveillance de la police et de l’administration, mais cette faculté ne pourra s’étendre aux ecclésiastiques qui se seront refusés au serment civique exigé par l’article 1er du présent décret (ou qui l’aurait rétracté) et qui, par ce refus ou cette rétractation sont déclarés, suivant l’article 6, suspects de révolte contre la loi, et de mauvaises intentions contre la patrie. »
Suivaient des dispositions d’ordre réglementaire. La loi était rigoureuse. Le serment civique, le serment de fidélité à toute la Constitution (y compris la Constitution civile du clergé) était exigé de tous les prêtres ; s’ils s’y refusaient, non seulement ils perdaient tout traitement, toute pension, mais ils étaient déclarés suspects, placés sous la surveillance des autorités administratives, et au moindre trouble de leur commune, éloignés de leur domicile ; c’était pour ainsi dire l’exil à l’intérieur et, en cas de délit, la prison.
De plus, une responsabilité pécuniaire collective, avec recours contre les auteurs et complices des troubles, était imposée aux communes dont le mouvement factieux nécessiterait l’intervention de la force publique. La Révolution était enfin résolue à se défendre contre la funeste agitation cléricale. Il y avait un intérêt immense à ce que la loi fût sanctionnée et appliquée, car l’intrigue de l’Église exploitant contre la Révolution le fanatisme imbécile des populations accoutumées au joug depuis des siècles, était infiniment plus dangereuse pour la liberté naissante que tous les rassemblements d’émigrés hors des frontières. C’est sur ce point que devait porter tout l’effort, ou au moins le principal effort de la Révolution. Et pour le roi lui-même, s’il avait été capable d’une pensée libre et un peu étendue, il y avait un intérêt très grand à mettre fin à l’agitation des prêtres ; car l’autorité royale telle que la Constitution la définissait, ne pouvait s’affermir et fonctionner à l’aise que lorsque le pays révolutionnaire serait rassuré contre tout retour offensif du régime passé.
Or l’opposition de l’Église éveillait toutes les défiances, toutes les colères de la Révolution. La bigoterie du roi, son étroitesse de pensée, son impuissance même à pratiquer jusqu’au bout le système de simulation et d’hypocrisie constitutionnelle qu’il avait adopté, l’empêchèrent de s’associer à la Révolution dans sa lutte contre l’Église. Mais les modérés, par quelle aberration conseillèrent-ils au roi de repousser ces lois de défense de la Révolution ? Ils savaient bien pourtant que l’Église serait encouragée par le refus de la sanction et que le fanatisme catholique se développant par son impunité même, acculerait bientôt la Révolution à des mesures plus rigoureuses encore.
Et puis, en ce mois de novembre et décembre 1791 les modérés ne voulaient pas la guerre. Ils n’étaient pas entrés encore dans les plans aventureux et louches de trahison.
Ils pressentaient ce qu’un conflit armé avec l’Europe déchaînerait en France de passions brûlantes, et ils avaient peur de ce redoutable inconnu. Par quelle folie firent-ils donc le jeu de Brissot qui comptait précisément pour rendre inévitable une grande diversion au dehors, sur l’échec de toute la politique révolutionnaire au dedans ?

(D’après une estampe de la Bibliothèque nationale.)
Comment se fait-il que Lameth, Duport, Barnave surtout, dont les vues pourtant sont d’habitude si nettes, n’aient pas senti le danger ? Barnave dans ses études sur la Révolution marque avec beaucoup de force et de clarté les périls que recelait, pour la monarchie constitutionnelle et pour le parti modéré, la politique guerrière de la Gironde. Et dans le plan de politique apaisée, avisée et prudente, qu’il trace, il ne dit pas un mot de la question religieuse. Elle ne pouvait lui échapper pourtant, et il n’en ignorait pas la gravité ; car c’est lui précisément qui avait demandé et obtenu à la Constituante le premier décret imposant aux prêtres le serment, ce même décret du 27 novembre 1790 qu’invoque un an plus tard la Législative.
Je ne puis m’expliquer ce silence étrange, cette lacune surprenante dans la pensée et dans l’action de Barnave que par son désir de jouer auprès du roi et de la reine un rôle secret. Il craignait sans doute en rappelant la part qu’il avait prise à la lutte contre l’Église et en demandant au roi de s’associer aux mesures nouvelles de la Révolution, de blesser la conscience de Louis XVI au point le plus douloureux et de compromettre à jamais son autorité de conseiller, son crédit de ministre occulte.
À la Législative même, le mouvement révolutionnaire en faveur de la loi avait été si vif que la résistance des modérés avait été très incertaine. Tous les orateurs constatent que c’est à une immense majorité que les articles les plus sévères sont adoptés. Mais voici qu’à peine la loi votée, les Feuillants commencent une campagne contre elle ; et les membres du Directoire du département de Paris, s’engagent à fond par la démarche la plus grave, la plus dangereuse. Une loi de la Constituante, comme nous l’avons vu, interdisait les pétitions collectives des corps constitués. Les membres du directoire tournèrent la difficulté en signant à titre individuel mais ils ajoutaient à leur nom leur qualité de membres du directoire.
C’est le 8 décembre que Germain, Garnier, Brousse, Talleyrand-Périgord, Beaumes, La Rochefoucauld, Desmeunier, Blondel, Thion de la Chaume, Anson et Davais firent paraître leur adresse au roi. Ils le suppliaient de ne pas sanctionner une loi, suivant eux inquisitoriale et intolérante, qui obligerait les administrateurs à forcer le secret des consciences de tous les prêtres ; qui, en interdisant certaines formes de culte, surexciterait les passions religieuses et qui ramènerait en pleine Révolution le despotisme et l’arbitraire :
« Vainement on dira que le prêtre non assermenté est suspect ; et sous le règne de Louis XIV les protestants n’étaient-ils pas suspects aux yeux du gouvernement lorsqu’ils ne voulaient pas se soumettre à la religion dominante ? et les catholiques n’ont-ils pas été longtemps suspects en Angleterre ?
« Que l’on surveille les prêtres non assermentés, qu’on les frappe sans pitié au nom de la loi, s’ils l’enfreignent, mais que jusqu’à ce moment on respecte leur culte comme tout autre culte… »
Les modérés n’oubliaient qu’une chose : c’est qu’il y avait à ce moment même, dans plusieurs régions de la France, un commencement de guerre civile. Ils prétendaient que Paris devait à la politique tolérante de ses administrateurs la paix religieuse dont ils jouissaient ; ils oubliaient qu’à Paris l’ignorance et le fanatisme étaient moindres qu’en Vendée. Sans doute le Directoire de Paris fut inspiré par les Feuillants qui voyaient avec crainte la Révolution, qu’ils avaient cru immobiliser, reprendre sa marche. Une fois engagée dans la lutte religieuse, c’est aux partis de gauche, aux partis de vigueur et de combat qu’elle se livrerait. Le Directoire de Paris, mécontent du glissement de la Législative, voulait d’emblée arrêter le mouvement. Mais en même temps que les modérés considéraient comme négligeable le péril catholique, ils appelaient l’attention du roi sur les périls de l’émigration. Quel inexplicable renversement des proportions ! À côté de l’Église fanatisant les masses et essayant de paralyser le cœur même de la Révolution, les rassemblements d’émigrés n’étaient qu’une fumée vaine, irritante peut-être, mais sans danger. Et comment ces modérés, ces prétendus sages, ne voient-ils pas que les mesures décisives qu’ils demandent contre les émigrés peuvent conduire rapidement à la guerre contre l’Europe et que cette guerre est la mort de la monarchie constitutionnelle et des partis tempérés ?
Les Feuillants font ici le jeu de la belliqueuse Gironde avec une inconscience inouïe, et l’on se demande nécessairement si, de ce côté aussi, il n’y a pas une intrigue. Qui sait si aux modérés la guerre, que dirigerait le roi, n’apparaît pas, dès ce moment, comme une diversion utile, comme un moyen d’affermir l’autorité royale tandis que pour les Girondins c’est un moyen de la supprimer ? En tout cas, il faut noter comme un inquiétant symptôme ces phrases de l’adresse du département de Paris :
« Au nom sacré de la liberté, de la Constitution et du bien public nous vous prions. Sire, de refuser votre sanction au décret des 29 novembre et jours précédents sur les troubles religieux ; mais en même temps, nous vous conjurons de seconder de tout votre pouvoir le vœu que l’Assemblée nationale vient de vous exposer avec tant de force et de raison contre les rebelles qui conspirent sur les frontières du royaume. Nous vous conjurons de prendre, sans perdre un seul instant, des mesures fermes, énergiques et entièrement décisives, contre les insensés qui osent menacer le peuple français avec tant d’audace. »
La démarche du directoire de Paris produisit une émotion extraordinaire. Les démocrates y virent tout un plan du roi cherchant à provoquer une manifestation d’ensemble des directoires de département, presque tous modérés, et à opposer cette force d’opinion au mouvement encore incertain de l’Assemblée. Un grand nombre de sections de Paris envoyèrent des délégués à la barre de l’Assemblée pour protester contre le directoire de Paris. Ils le firent avec une violence extrême et ne ménagèrent ni le veto ni le roi. Camille Desmoulins, le 11 décembre, au nom de 300 signataires présenta à l’Assemblée une pétition éblouissante d’esprit et pleine de menaces révolutionnaires.
« Dignes représentants, les applaudissements sont la liste civile du peuple, ne repoussez donc point la juste récompense qui vous est décernée par le peuple. Entendez des louanges courtes, comme vous avez entendu plus d’une fois une longue satire. Recueillir les éloges des bons citoyens et les injures des mauvais, c’est avoir réuni tous les suffrages. » (Applaudissements.)
Il perça de ses ironies Louis XVI :
« Prenant exemple de Dieu même, dont les commandements ne sont point impossibles, nous n’exigerons jamais du ci-devant souverain un amour impossible de la souveraineté nationale, et nous ne trouvons point mauvais qu’il oppose son veto précisément aux meilleurs décrets. »
Il accusa le directoire de Paris d’avoir violé la loi sur les pétitions collectives. Il s’écria, comme pour associer la Législative à un plan de Révolution :
« Continuez, fidèles mandataires, et si on s’obstine à ne pas vous permettre de sauver la nation, eh bien, la nation se sauvera elle-même, comme elle a déjà fait (Applaudissements), car enfin la puissance du veto royal a un terme Et on n’empêche point avec un veto la prise de la Bastille. » (Applaudissements.)
C’était comme une annonce du 20 juin et du 10 août. Desmoulins termina par ces mots :
« Ne doutez plus de toute la puissance d’un peuple libre, mais si la tête sommeille, comment le bras agira-t-il ? Ne levez plus ce bras, ne levez plus la massue nationale pour écraser des insectes… Ce sont les chefs qu’il faut poursuivre. Frappez à la tête ; servez-vous de la foudre contre les princes conspirateurs, de la verge contre un directoire insolent, et exorcisez le démon du fanatisme par le jeûne. »
Desmoulins fut acclamé par la gauche, et il y a loin du ton agressif de ce discours à la longue élégie du 21 octobre. Visiblement, l’énergie révolutionnaire que les démocrates avaient cru un moment abattue se réveillait. Et il semble que dès lors le devoir des révolutionnaires était clair : provoquer contre le veto et contre le modérantisme une agitation populaire, insister pour l’application des décrets contre les prêtres factieux, faire sentir aux ministres qu’ils seraient responsables, sur leur tête, de toute politique de défaillance, de ruse ou de trahison, et si la royauté s’obstinait ou trichait, concentrer sur elle l’effort et emporter enfin la monarchie comme on avait emporté la Bastille ; pendant ce temps, armer le peuple aussi bien contre les ennemis du dedans que contre tous les périls possibles du dehors, mais se bien garder de déplacer l’action révolutionnaire en la portant au dehors, s’abstenir de toute provocation inutile qui déchaînerait la guerre.
Était-il donc impossible de porter plus haut l’animation révolutionnaire du peuple et d’aller à la République sans passer par les chemins de la guerre et par les dangereux détours imaginés par la Gironde ? Mais déjà le discours de Brissot du 21 octobre avait porté. Déjà une fièvre belliqueuse commençait à agiter le peuple imprudent, qui ne pouvait, à travers la fumée des batailles dont les cerveaux déjà s’enveloppaient, entrevoir les abîmes prochains de servitude militaire. Et, dans les discours des sections qui, en décembre se succédaient à la barre de l’Assemblée, les cris de guerre retentissaient.
Comment avait grandi ce mouvement ? C’est le 22 novembre, qu’en exécution de la motion de Brissot et de Vergniaud, votée le 8, le Comité diplomatique fit son rapport à l’Assemblée sur « les mesures à prendre relativement aux puissances étrangères limitrophes qui souffrent sur leur territoire les rassemblements des Français fugitifs ».

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Le rapporteur Koch tint un langage très modéré ; il annonça la paix :
« Déjà, Messieurs, les principales puissances de l’Europe repoussent loin d’elles ces projets insensés de contre-révolution, que la rage impuissante des ennemis de la Constitution cherche en vain à nous faire redouter. » Le projet de décret soumis par lui était à la fois mesuré et vague :
« L’Assemblée nationale, après avoir entendu son Comité diplomatique, considérant que les rassemblements, les attroupements et les enrôlements des fugitifs français, que favorisent les princes d’Empire, dans les cercles du Haut et du Bas-Rhin, de même que les violences exercées en différents temps contre des citoyens français sur le territoire de l’évêché de Strasbourg, au delà du Rhin, soit des attentats contre le droit des gens et des contraventions manifestes aux lois publiques de l’Empire, qu’ils ne sauraient non plus se concilier avec l’amitié et le bon voisinage que la nation française désirerait d’entretenir avec tout le corps germanique, décrète que le pouvoir exécutif sera invité de prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces vis-à-vis des puissances étrangères pour faire cesser ces désordres, rétablir la tranquillité sur la frontière et obtenir des réparations convenables des outrages dont les citoyens de Strasbourg ont été plus particulièrement les victimes. »
Modéré, ai-je dit, et d’intention pacifique, dangereux pourtant, car c’était la voie ouverte à tous les hasards. Il n’y avait à ce moment-là qu’une chance de paix, c’était de dire : « Négligeons, dédaignons les intrigues des émigrés, ne nous engageons pas pour les atteindre dans des négociations qui peuvent conduire à la guerre ; préparons-nous seulement à nous défendre, et donnons à la Révolution une grande force au dedans : l’écume de l’émigration se brisera contre ce roc. » Voilà le langage de la paix ; tout le reste, même sous les formes les plus modérées, était, qu’on le voulût ou non, amorce de guerre, germe de guerre. Mais le 6 novembre il n’y avait pas encore, chez les démocrates, un parti de la paix.
L’absence de Robespierre, le silence de Marat sur les choses du dehors duraient toujours. C’est pourtant à ces débuts incertains de la politique belliqueuse qu’il aurait fallu s’opposer d’emblée : la modération même des premières formules et des premières démarches ne servait qu’à aggraver le péril en le déguisant. Déjà le 27 novembre, Rühl et Daverhoult haussent le ton, et c’est l’amour-propre de la nation qu’ils s’appliquent à aiguillonner. De plus, tandis que Brissot tenait encore compte, dans son discours du 21 octobre, de l’état complexe des choses et des esprits, ne peignait qu’une Europe à demi belliqueuse, Rühl et Daverhoult, tout en raillant les émigrés, dénoncent les desseins guerriers des souverains et surexcitent les alarmes par des affirmations que nous savons aujourd’hui plus qu’à moitié fausses. Rühl dit à l’Assemblée :
« Il n’y a donc, Messieurs, dans toute la vaste étendue de la Germanie que trois prêtres, qui se préparent à lancer la foudre contre vous et à convertir la France entière en un monceau de cendres, et après avoir exterminé la race des mécréants dont la surface est couverte. Son Altesse Éminentissime Monseigneur le baron d’Erthal, archevêque-électeur de Mayence qui, de son chef, peut mettre 4.000 hommes sur pied, si les Mayençais, ses sujets, sont assez sots pour en vouloir faire la dépense ; Son Altesse Sérénissime Monseigneur l’évêque de Trêves, qui peut fournir une armée de 7.000 hommes (Rires.) en y comprenant les troupes auxiliaires de Monseigneur le prince de Neuwied, son voisin ; Son Altesse Sérénissime et Éminentissime Monseigneur Louis-René-Edouard, cardinal de Rohan, qui, abstraction faite de 600 ou 700 brigands qu’il a l’honneur de commander en chef (Rires et applaudissements.) peut mettre sur pied une armée de 50 hommes, tous gens d’élite (Rires) ; car c’est à 50 hommes que se réduit tout au plus le contingent que les lois de l’Empire lui accordent.
« Ce ne sera donc pas, Messieurs, à des hordes barbares, mais à des soldats de l’Église teutonique, tous amplement munis de chapelets et de bénédictions, fort doux, au reste, et gens de très bonne composition que vous aurez à faire, quand Louis-Joseph de Bourbon, à la tête de tous ses chevaliers errants, viendra fondre sur vous et fera marcher devant lui la mort et le carnage. Mais, quoique j’aie lieu de supposer. Messieurs, que vous ne sauriez être fort effrayés de l’orage dont vous êtes menacés et que vous ne croyez pas assez fort pour obscurcir la sérénité du beau ciel qui vous éclaire, il n’en est pas moins vrai qu’il serait indigne de la majorité d’une grande nation comme la nôtre de souffrir plus longtemps ce feu d’opéra dont la fumée nous incommode (Applaudissements) et de nous laisser impunément injurier par d’affreux baladins, dont l’insolence mérite le fouet. Un simple particulier peut opposer le mépris aux forfanteries d’un spadassin, mais une grande nation doit être jalouse de sa gloire, doit punir sévèrement les téméraires qui osent lui manquer de respect, doit anéantir dans son principe le moindre germe d’opposition à sa volonté suprême, dès que cette volonté a été solennellement dénoncée à la face de l’univers, dès qu’elle a été légitimement manifestée à tous les individus qui la composent.
« Ne vous méprenez pas, Messieurs, au sommeil apparent des despotes qui vous entourent : c’est le sommeil du lion qui guette sa proie et qui s’élance sur elle dès qu’il croit qu’elle ne pourra plus échapper à ses griffes, ni à sa dent carnassière. Ce Léopold qu’on vous a peint si pacifique, dont les ordres ostensibles sont si contraires aux applaudissements de nos émigrés, mais dont les ordres secrets vous sont inconnus, ce Léopold ne vous pardonnera jamais d’avoir mis en pratique le principe que les rois sont faits pour les peuples et que les peuples ne sont pas la propriété des rois. » (Applaudissements).
Avec quelle légèreté, avec quelle témérité Rühl suppose ici à l’Empereur l’Autriche un plan secret d’agression ! Par les correspondances non plus seulement ostensibles, mais secrètes, que j’ai citées, nous savons au contraire qu’il était haï des émigrés, qu’il ne voulait pas s’engager dans la lutte et qu’il réduisait sa sœur Marie-Antoinette au désespoir. Ce sont ces suppositions étourdies et inexactes qui allumaient peu à peu dans les esprits le feu de la guerre. Daverhoult poussa aussi à la guerre, dans un discours où abondent les contradictions. Sa thèse peut se résumer ainsi : Les émigrés ne sont encore ni très nombreux, ni très dangereux ; mais leur parti peut se grossir, et ils peuvent devenir un péril, s’ils dirigent une attaque imprévue contre la France, en un moment où celle-ci serait déchirée intérieurement par les factions. Les puissances étrangères sont divisées notamment par la question de Pologne, mais le jour où l’impunité des émigrés les aurait persuadés de notre faiblesse, le jour où la France déchirée par des luttes intestines semblerait une proie facile, elles se réconcilieraient pour nous attaquer. Conclusion : il faut prendre l’offensive.
« Les émigrés comptent sur les troubles intérieurs qu’ils excitent et entretiennent par toute sorte de moyens, ainsi que sur les relations secrètes qu’ils peuvent avoir conservées dans quelques-unes des places frontières. Soutenus par l’or étranger, en mesure pour profiter des événements et à portée d’en saisir l’occasion favorable plutôt qu’en force pour les faire naître, ils inquiètent, menacent, intriguent pour augmenter en nombre et temporisent afin de saisir le moment qui leur sera propice ; voilà leur situation militaire et leur système politique. Il suffit de l’annoncer pour prouver que le nôtre doit être formé en sens inverse.
« Tout délai de notre part entretient l’inquiétude des bons citoyens, refroidit leur zèle, augmente l’espoir des ennemis secrets, occasionne des séditions et prépare à ceux d’Outre-Rhin, cet instant favorable qu’ils guettent. »
Ne nous laissons point éblouir ; nos forces ne seront respectables qu’autant qu’elles seront bien dirigées ; mais si nos ennemis exécutaient leur plan tandis qu’elles seraient en partie employées à réprimer des séditions ; si une quantité considérable de mécontents qui se trouvent dans l’intérieur se joignaient à l’armée ennemie ; si les alarmes et le désordre paralysaient une partie de nos moyens ; si l’incertitude des points d’attaque avait fait prendre le change à nos généraux, si la marche rapide de l’armée ennemie avait produit de la consternation dans les âmes faibles et rendu les patriotes de circonstance à leur premier caractère ; si dans cet instant il existait de la mésintelligence entre les deux pouvoirs ; si dans Paris même, à l’approche de l’armée ennemie, il se trouvait des traîtres soudoyés par l’étranger, quelle serait notre position ?
« Permettez, Messieurs, que je cite un exemple récent. Proscrit en Hollande et sur le point d’y périr sur l’échafaud pour la cause de la liberté, j’ai vu cette cause sublime perdue en temporisations. C’est pour avoir employé des demi-moyens ; c’est pour n’avoir pas écrasé ses adversaires, lorsqu’il en était temps, c’est pour s’être attachée aux effets sans s’attaquer aux causes ; c’est pour avoir attendu jusqu’à ce que ses ennemis furent soutenus par une des puissances de premier ordre, que la Hollande est dans les chaînes. « Ne croyez pas que placés sur un théâtre plus vaste et pouvant disposer de moyens plus considérables, vous puissiez impunément mépriser l’exemple que la Hollande asservie donne aux nations. »
J’ai dit qu’en ce discours les contradictions abondaient. D’abord, si les émigrés ne doivent être dangereux qu’à raison des déchirements intérieurs de la France, c’est à une politique vigoureuse d’action révolutionnaire au dedans qu’il faut se livrer avant de soulever la tempête du dehors. Si la France ne doit pas attendre que ses ennemis cherchent leur heure, si elle doit les devancer, ce n’est pas seulement contre les émigrés, contre les petits princes d’Empire qui leur donnent asile qu’elle doit ouvrir les hostilités ; c’est contre tous les souverains ennemis ou suspects de l’Europe. Et ainsi, sous prétexte qu’il ne faut pas attendre l’heure où les émigrés seront soutenus par une des grandes puissances, il faut susciter contre la France de la Révolution la coalition des grandes puissances.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Enfin, Daverhoult redoute que les puissances étrangères nous attaquent Juste à l’heure où il y aura des soulèvements intérieurs dans le royaume, juste à l’heure où il y aura mésintelligence entre les deux pouvoirs, c’est-à-dire entre l’Assemblée et le roi. Mais comment peut-il avoir l’assurance qu’en prenant l’offensive la France échappera à ces terribles éventualités ? Est-ce qu’il espère que la lutte sera finie d’un coup ? Et si elle se prolonge au contraire à travers des alternatives de revers et de succès, toutes les crises intérieures, toutes les anarchies peuvent se développer précisément quand l’ennemi redoublera d’efforts. En fait, tous les périls que Daverhoult veut éviter en prenant l’offensive se sont précisément déchaînés sur la France de la Révolution quand elle eut pris l’offensive : la révolte de la Vendée, le duel à mort entre la Révolution et le roi, les massacres de septembre où périrent ceux que le peuple, affolé par l’invasion, considéra comme « des traîtres soudoyés par l’étranger », tous les traits les plus sombres du terrible tableau tracé par Daverhoult se retrouvent précisément dans l’histoire de la Révolution belliqueuse. Par quelle illusion extraordinaire les hommes de 92 ont-ils pu croire qu’ils éviteraient tous les périls entrevus par eux en déchaînant les chances incalculables et formidables d’une guerre européenne ? Daverhoult termina son discours par une motion beaucoup plus ferme, beaucoup plus nettement aggressive que celle du rapporteur Kock.
« L’Assemblée nationale décrète qu’une députation de vingt-quatre de ses membres se rendra près du roi, pour lui communiquer au nom de l’Assemblée sa sollicitude sur les dangers qui menacent la patrie, par la combinaison perfide des Français armés et attroupés au dehors du royaume, et de ceux qui trament des complots au dedans, ou excitent les citoyens à la révolte contre la loi ; et pour déclarer au roi que la nation verra avec satisfaction toutes les mesures sages que le roi pourra prendre, afin de requérir les électeurs de Trêves, Mayence, et l’évêque de Spire, qu’en conséquence du droit des gens ils dispersent, dans un délai de trois semaines, lesdits attroupements formés par des Français émigrés ; que ce sera avec la même confiance dans la sagesse de ses mesures que la nation verra rassembler les forces nécessaires pour contraindre par la voie des armes ces princes à respecter le droit des gens, au cas qu’après ce délai expiré, les attroupements continuent d’exister.
« Et enfin que l’Assemblée nationale a cru devoir faire cette déclaration solennelle, pour que le roi fût à même de prouver dans les communications officielles de cette démarche imposante à la Diète de Ratisbonne et à toutes les cours de l’Europe que ses intentions et celles de la nation française ne font qu’un. » (Applaudissements.)
Et si les princes refusent d’obéir à cette sommation ? s’ils demandent le secours de la Diète, et celui de Léopold, chef de l’Empire ? Et encore si le roi, tout en se résignant à ces démarches, prépare par une trahison sourde la défaite de la France ? Il y a, dans la dernière phrase de la motion de Daverhoult, une ambiguïté terrible : cette preuve du loyalisme du roi, on ne sait si l’Assemblée veut lui fournir l’occasion de la donner à l’Europe ou à la France. La guerre conçue comme une sorte d’épreuve du feu pour éprouver la sincérité révolutionnaire du roi, quel sinistre détour ! et quelle défaillance de la Révolution elle-même, n’osant pas d’emblée démasquer le traître royal et le frapper directement au visage ! C’est à peine si quelques députés purent obtenir que la motion de Daverhoult ne fût pas votée d’enthousiasme.
Il y a en ce moment dans la conscience révolutionnaire je ne sais quel mélange admirable et trouble d’exaltation héroïque et d’énervement. La France de la Révolution était prête à jeter un défi au monde pour défendre sa liberté ; elle était prête, suivant les paroles mêmes de Rühl, « à s’ensevelir sous les ruines du temple » plutôt que de livrer son droit. Elle voulait lutter, oser, « dussent même toutes les puissances de l’enfer s’armer contre elle, pour la replonger dans le gouffre affreux de l’esclavage ». Mais il lui manquait une forme suprême du courage : l’héroïsme tranquille, qui attend l’évidence du danger et qui ne se hâte pas vers le péril par une sorte de fascination maladive et de fiévreuse impatience.
Il y avait comme une hâte d’en finir qui suppose un admirable élan des forces morales, mais aussi un commencement de trouble. Ah ! quel service incomparable aurait rendu à la France l’homme ou le parti qui aurait su lui maintenir cette animation héroïque, mais en lui donnant plus de patience et de clairvoyance !
Mais il était peut-être au-dessus de l’humanité que toute une nation eût cette admirable sagesse dans cette admirable ferveur et cette parfaite possession de soi-même jusque dans l’ardeur sublime de se donner.
Le 29 novembre, deux jours après le discours de Daverhoult, le Comité diplomatique, entraîné par l’animation croissante des esprits, se rallia à la motion Daverhoult.
Il en sentait pourtant le danger et il essayait de l’atténuer un peu : Il demanda qu’on ne sommât point les électeurs du Rhin d’avoir à disperser les rassemblements dans le court délai de trois semaines.
« Il n’a pas paru sage à votre comité de recourir, dès à présent, à des voies menaçantes et offensantes avant d’avoir épuisé celles d’honnêteté que l’usage a consacrées entre les nations.
« Un pareil procédé serait d’autant moins juste que nous croyons pouvoir annoncer avec certitude qu’un grand nombre de princes et d’États de l’Empire ne demanderaient pas mieux que d’être débarrassés de ces fugitifs qui les molestent, et qu’ils sont eux-mêmes à soupirer après le moment où le calme renaîtra sur nos frontières. »
C’était la vérité même, mais que signifiait alors tout cet appareil de menace et de drame ?
Étrange tentation de solliciter la nuée dormante jusqu’à ce que l’éclair de la guerre ait jailli. Et que pouvaient ces timides réserves à l’heure où les esprits semblaient se charger d’électricité ?
Isnard, une fois de plus, s’abandonna à son enthousiasme guerrier, et jamais il ne fut plus éloquent, jamais aussi il ne fut plus dangereux. Déjà ce qui va se mêler bientôt d’orgueil brutal, de nationalisme guerrier à la Révolution française éclate dans sa parole : on dirait, à l’entendre, que la Révolution a hérité de la superbe de Louis XIV : il parle d’affranchir le monde avec un accent de conquête et un air de supériorité : ce n’est plus la seule liberté, c’est la puissance et la gloire qui exaltent les âmes, et les premières fumées de la grande ivresse napoléonienne commencent à obscurcir les cerveaux. Écoutez Isnard : il commence par démontrer rapidement que la vigueur des démarches projetées aura pour effet de consolider la paix en effrayant les puissances ; mais il se hâte d’ajouter :
« La mesure proposée est commandée par ce que nous devons à la dignité de la nation.
« LE FRANÇAIS EST DEVENU LE PEUPLE LE PLUS MARQUANT DE L’UNIVERS, il faut que sa conduite réponde à sa nouvelle destinée. Esclave, il fut intrépide et grand ; libre, serait-il faible et timide ? (Applaudissements.) Sous Louis XIV, le plus fier des despotes, il lutta avec avantage contre une partie de l’Europe : aujourd’hui que ses bras sont déchaînés, craindrait-il l’Europe entière ? »
« Traiter tous les peuples en frères, respecter leur repos, mais exiger d’eux les mêmes égards ; ne faire aucune insulte, mais n’en souffrir aucune ; ne tirer le glaive qu’à la voix de la patrie, mais ne la renfermer qu’au chant de la victoire (Applaudissements) ; renoncer à toute conquête, mais vaincre quiconque voudrait la conquérir ; fidèle dans ses engagements, mais forçant les autres à remplir les leurs ; généreux, magnanime dans toutes ses actions, mais terrible dans ses justes vengeances ; enfin, toujours prêt à combattre, à mourir, à disparaître même tout entier du globe plutôt que de se remettre aux fers ; voilà je crois, quel doit être le caractère du Français devenu libre. (Applaudissements répétés.)
« Ce peuple se couvrirait d’une honte ineffaçable, si son premier pas dans la brillante carrière que je vois s’ouvrir devant lui était marqué par la lâcheté : je voudrais que ce pas fût tel qu’il étonnât les nations, leur donnât la plus sublime idée de l’énergie de notre caractère, leur imprimât un long souvenir, consolidât à jamais la Révolution et fît époque dans l’histoire. (Applaudissements.)
« Et ne croyez pas, Messieurs, que notre position du moment s’oppose à ce que la France puisse, au besoin, frapper les plus grands coups. « On se trompe, dit Montesquieu, si l’on croit qu’un peuple qui est en état de révolution pour la liberté est disposé à être conquis ; il est prêt au contraire à conquérir les autres. » Et cela est très vrai, parce que l’étendard de la liberté est celui de la victoire, et que les temps de la révolution sont ceux de l’oubli des affaires domestiques en faveur de la chose publique, du sacrifice des fortunes, des dévouements généreux, de l’amour de la patrie, de l’enthousiasme guerrier. Ne craignez donc pas, Messieurs, que l’énergie du peuple ne réponde pas à la vôtre ; craignez, au contraire, qu’il ne se plaigne que vos décrets ne répondent pas à tout son courage. (Applaudissements.)
«…Non, nous ne tromperons pas ainsi la confiance du peuple. Levons-nous, dans cette circonstance, à toute la hauteur de notre mission. Parlons à nos ministres, à notre roi, à l’Europe, le langage qui convient aux représentants de la France. Disons aux ministres que jusqu’ici la nation n’a pas été très satisfaite de leur conduite… (Applaudissements.) que désormais ils n’ont à choisir qu’entre la reconnaissance publique ou la vengeance des lois ; que ce n’est pas en vain qu’ils oseraient se jouer d’un grand peuple et que par le mot « responsabilité » nous entendons la « mort ». (Nouveaux applaudissements dans la salle et dans les tribunes.)
« Disons au roi qu’il est de son intérêt, de son très grand intérêt de défendre de bonne foi la Constitution ; que sa couronne tient à la conservation de ce palladium ; disons-lui qu’il n’oublie jamais que ce n’est que par le peuple et pour le peuple qu’il est roi ; que la nation est son souverain et qu’il est sujet de la loi. (Applaudissements.)
« Disons à l’Europe que les Français voudraient la paix, mais que si on les force à tirer l’épée, ils en jetteront le fourreau bien loin et n’iront le chercher que couronnés des lauriers de la victoire ; et que quand même ils seraient vaincus, leurs ennemis ne jouiraient pas du triomphe, parce qu’ils ne régneraient que sur des cadavres. (Applaudissements.)
« Disons à l’Europe que nous respecterons toutes les constitutions des divers Empires, mais que si les cabinets des cours étrangères tentent de susciter une guerre des rois contre la France, nous leur susciterons une guerre des peuples contre les rois. (Applaudissements.)
« Disons-lui que dix millions de Français, embrasés du feu de la liberté, armés du glaive, de la raison, de l’éloquence, pourraient, si on les irrite, changer la face du monde et faire trembler tous les tyrans sur leurs trônes.
« Enfin, disons bien que tous les combats que se livrent les peuples par ordre des despotes… (Applaudissements.)
« N’applaudissez pas, Messieurs, n’applaudissez pas : respectez mon enthousiasme, c’est celui de la liberté.
« Disons-lui que tous les combats que se livrent les peuples par ordre des despotes ressemblent aux coups que deux amis, excités par une instigation perfide, se portent dans l’obscurité ; le jour vient-il à paraître, ils jettent leurs armes, s’embrassent et se vengent de celui qui les trompait. (Bruit et applaudissements.) De même si, au moment que les armées ennemies lutteront avec les nôtres, le génie de la philosophie frappe leurs yeux, les peuples s’embrasseront à la face des tyrans détrônés, de la terre consolée et du ciel satisfait. (Applaudissements.)
« Je conclus par demander que l’Assemblée adopte à l’unanimité le projet de décret proposé : je dis à l’unanimité, parce que ce n’est que par cet accord parfait des représentants de la nation que nous parviendrons à inspirer aux Français une entière confiance, à les réunir tous dans un même esprit, à en imposer sérieusement à tous nos ennemis et à prouver que lorsque la patrie est en danger, il n’existe qu’une volonté dans l’assemblée nationale. » (Vifs applaudissements prolongés dans la salle et dans les tribunes.)
Il y a, en ce discours d’Isnard, un étonnant mélange d’héroïsme et de rodomontades, d’enthousiasme sacré pour la liberté et de griserie militaire, d’amour de l’humanité et de forfanterie nationale. Ce n’est pas encore la guerre systématique de propagande : on annonce qu’on respectera les « constitutions des autres Empires » ; mais Isnard s’anime si fort en parlant de la guerre des peuples contre les rois, qu’il est visible qu’il la désire. Et il ne songe pas un moment à se demander si la liberté ainsi portée au monde non par la puissance de l’exemple, mais par la brutalité des armes, ne se changera pas bientôt, pour la France et pour le monde, en une immense servitude militaire.
Il célèbre déjà « les lauriers de la victoire » qui couronneront les héros de la liberté ; il n’entrevoit pas le front de César qui, un jour, s’ombragera seul de ces lauriers.
Et puis, quelle disproportion entre la véhémence de ce langage et l’état réel des choses en Europe ! Il semble, à entendre Isnard, que le sol déjà soit envahi ; et pourtant il n’est pas certain, à cette heure, qu’avec une grande vigueur de politique intérieure et une grande habileté diplomatique, la France ne réussisse pas à éviter la guerre, à sauver tout ensemble la liberté et la paix.
Mais les esprits perdaient toute mesure : Brissot pouvait se féliciter de son œuvre. Un de ses adversaires a dit de lui qu’il excellait « à allumer la paille ».
L’imagination un peu vaine d’Isnard, l’ardente paille de Provence, s’était allumée en effet, et cette « paille allumée », emportée au loin en un tourbillon de paroles, d’enthousiasme, d’héroïsme et de vanité, va mettre le feu à l’univers et dévorer bientôt la liberté elle-même.
L’Assemblée adopte à l’unanimité le projet de décret nouveau apporté par le comité ; et à l’unanimité aussi, elle charge son président modéré, Vienot-Vaublanc de lire au roi une vigoureuse adresse qu’il avait rédigée. Tous les partis semblaient marcher à la fois vers la guerre.
Pourtant, les démocrates commencent à entrevoir le péril. Robespierre, rentré d’Arras, prend la parole, le 28 novembre, aux Jacobins. Il se sent tout à coup enveloppé d’une atmosphère surchauffée, et n’ose pas combattre directement la politique de guerre.
Peut-être même, surpris par la violence du mouvement soudain qui, pendant son absence et en quelques semaines, s’était déchaîné, il n’a pas encore pris parti.
Mais il est visible qu’en tout cas il a démêlé d’emblée ce qu’il y avait dans la politique de Brissot d’incohérence et d’hypocrisie. Incohérence, s’il s’imagine qu’il suffira, pour dissiper les inquiétudes et rasséréner l’horizon, d’attaquer les petits princes des bords du Rhin. Hypocrisie, s’il prévoit que cette première escarmouche conduira à une grande guerre contre l’Autriche, mais la dissimule au pays pour l’entraîner plus aisément.
Et il semble tout d’abord que c’est une rupture immédiate et franche que conseille Robespierre.
« Il faut dire à Léopold : vous violez le droit des gens en souffrant les rassemblements de quelques rebelles que nous sommes loin de craindre, mais qui sont insultants pour la nation. Nous vous sommons de les dissiper dans tel délai, ou nous vous déclarons la guerre au nom de la nation française et au nom de toutes les nations ennemies des tyrans… Il faut imiter ce Romain qui, chargé au nom du Sénat de demander la décision d’un ennemi de la République, ne lui laissa aucun délai. Il faut tracer autour de Léopold le cercle que Popilius traça autour de Mithridate. Voilà le décret qui convient à la nation française et à ses représentants. »
Ainsi Robespierre semble d’abord ne combattre la politique belliqueuse de la Gironde que par une surenchère. Est-ce chez lui entraînement ? ou tactique ? Voulait-il diminuer les chances de guerre en ouvrant devant le pays la perspective d’une grande guerre redoutable et coûteuse ? Ou bien cherche-t-il d’abord à ménager sa popularité, à éviter le choc trop violent de l’opinion déjà entraînée ? Ce n’est pas, en tout cas, par des discours équivoques, comme celui du 28, où la pensée de la paix se cachait sous une affectation ultra-belliqueuse, qu’il pouvait ramener les esprits, et ce discours du 28 a quelque chose de faux et de pénible. Cette première période guerrière n’est pas une période de sincérité. Tous les partis, à travers un semblant d’exaltation, équivoquent et rusent.
Marat, comme si en cette question de la guerre son entendement était stupéfié, avait gardé le silence après la séance du 27, après celle du 29, après la motion Daverhoult, après la démarche de l’Assemblée au roi. Cherchait-il sa voie ? Était-il assourdi par l’éloquence guerrière d’Isnard et se demandait-il si lui-même n’allait pas souffler d’un souffle furieux dans la trompette ? Mais tout à coup, dans son numéro du 1er décembre, il se réveille comme en sursaut, se reproche son trop long silence, dénonce la politique de guerre et commence une vigoureuse campagne contre la Gironde. Je me demande si quelque avis ne lui était point venu de Robespierre, en qui il eut toujours pleine confiance. Après avoir analysé le discours de Rühl, prononcé quatre jours avant, Marat dit :
« Voilà à coup sûr le discours d’un fripon payé pour engager l’Assemblée dans la démarche impolitique et désastreuse de provoquer une rupture avec quelques petits princes de l’Empire et d’avoir bientôt sur les bras tous leurs alliés. Quand ce conseil funeste ne serait pas suspect par les suites cruelles qu’il aurait infailliblement s’il était adopté, peut-on douter qu’il ne soit parti du cabinet des Tuileries puisque l’émissaire ministériel qui en était porteur n’est rien moins que persuadé lui-même de sa nécessité ? C’est pour éteindre UN FEU D’OPÉRA (c’est Marat lui-même qui imprime en gros caractères ce mot de Rühl) qu’il conseille d’allumer le flambeau de la guerre, pour le rare avantage de n’être pas incommodé par la fumée. »
Et Marat, comprenant que déjà peut-être le flambeau est allumé, s’accuse de négligence :
« Je regrette beaucoup de n’avoir pu m’occuper plus tôt de cet objet pour éventer le piège ; je crains fort que les patriotes n’y soient pris, et je tremble que l’Assemblée, hâtée par les jongleurs prostitués à la Cour, ne se prête elle-même à entraîner la nation dans l’abîme. »
Ainsi, contre la tactique de la Gironde, cherchant la guerre ou pour abattre le roi ou pour le mettre sous la tutelle girondine, commence à s’affirmer la tactique des démocrates disant que la guerre est un piège, qu’elle est voulue par la Cour.
En même temps que Marat, et comme s’il y avait eu un mot d’ordre général donné au parti d’avant-garde, le journal de Prudhomme, dans le numéro qui va jusqu’au 3 décembre, se met à combattre la politique de Brissot. Et son argument est celui-ci :
« Soyez d’abord libres au dedans ; débarrassez-vous de la tyrannie intérieure qui est un péril immédiat au lieu de vous précipiter au dehors contre des périls incertains. « L’intention de l’Assemblée nationale est de dire aux princes d’Allemagne : Nous ne sommes pas contents des rassemblements que vous permettez chez vous ; nous vous sommons de les faire cesser ou bien nous devons déclarons la guerre. Représentants, cette mesure serait bonne si vous représentiez un peuple entièrement libre. »
Et il demande que le veto royal soit supprimé :
« Pourquoi ne pas substituer la volonté nationale au veto royal ?… Si l’Assemblée nationale était grande, elle aborderait fièrement la question, discuterait ce veto pendant plusieurs séances (le veto sur le décret contre les émigrés), elle en démontrerait la nullité, la perfidie du roi, et elle finirait par une adresse aux départements. »
Ainsi le journal de Prudhomme voudrait que sur la question du veto l’Assemblée provoquât une agitation dans tout le pays et le prît pour juge entre le roi et elle. C’est un premier effort, un peu tardif, pour ramener dans le sens d’une révolution démocratique le torrent, maintenant gonflé à nouveau, des énergies populaires que la Gironde rêvait de répandre sur le monde ;
« Si l’Assemblée nationale prenait le parti que nous venons d’indiquer, si ce parti était sanctionné par la majorité des départements, si la nation et l’Assemblée nationale cessaient de s’occuper, non pas du complot, mais des conspirateurs (les émigrés), si elles les abandonnaient au mépris qu’ils méritent, nous les verrions se disperser d’eux-mêmes, et bientôt nous rougirions de les avoir redoutés quelques moments. »
Haute sagesse, mais déjà un peu tardive, et contre laquelle l’instinct de lutte et d’aventure éveillé dans le peuple prévaudra sans doute.

que fit l’annonce de la guerre par le Ministre Linote à la suite de son grand
tour qu’il venait de faire.
(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Les pétitionnaires des sections qui se succédaient à la barre de l’Assemblée pour protester contre le directoire du département de Paris, poussaient presque tous des cris belliqueux. L’adresse des citoyens de Calais disait : « C’est la volonté de la nation : La guerre ! La guerre ! » Et les tribunes, l’Assemblée applaudissaient. Legendre, orateur de la députation du Théâtre-Français, s’écriait, le 11 décembre :
« Représentants du peuple, ordonnez : l’aigle de la victoire et la renommée des siècles planent sur vos têtes et sur les nôtres. Si le canon de nos ennemis se fait entendre, la foudre de la liberté ébranlera la terre, éclairera l’univers, frappera les tyrans… Faites forger des milliers de piques semblables à celles des héros romains, et armez-en tous les bras. »
L’aigle de la victoire. Ô imprudents ! qui ne savez pas qu’un jour cette aigle romaine, devenue une aigle impériale, emportera dans ses serres la Révolution meurtrie !
Pendant que sur la question de la guerre les révolutionnaires commençaient à se diviser et qu’un peu de réflexion contrariait l’entraînement aveugle des premiers jours, que faisait la Cour ? Il y avait à ce moment-là un changement de ministère. Nous avons déjà vu que Montmorin, effrayé par les responsabilités croissantes de son rôle ambigu, avait annoncé sa démission. Le 29 novembre, le jour même où l’assemblée décidait la démarche auprès du roi, Louis XVI annonçait à la Législative qu’il avait remplacé aux affaires étrangères Montmorin par Delessart, auparavant ministre de l’intérieur, et qu’il avait appelé au ministère de l’intérieur Cahier de Gerville. Le ministre de la guerre Duportail, effrayé aussi, annonçait sa démission le 2 décembre, et était remplacé le 7 décembre par M. de Narbonne.
Nous savons déjà que la Cour n’avait pas pu ou n’avait pas osé mettre dans le ministère, et notamment dans celui des affaires étrangères, des hommes à elle, dévoués à sa politique occulte. Cahier de Gerville, qui était appelé à l’intérieur, était un révolutionnaire constitutionnel modéré, mais assez ferme. Le mouvement de la Révolution se communiquait nécessairement aux choix ministériels faits par le roi ; et voulant ruser avec le peuple révolutionnaire, il évitait de prendre des ministres dont le nom fût un défi. Mais il n’y eut que le choix du nouveau ministre de la guerre, de Narbonne, qui eut quelque influence sur les événements.
C’était une sorte d’intrigant et d’aventurier d’ancien régime jeté à demi dans la Révolution : une sorte de Dumouriez sans l’éclair du génie ou de la fortune. La Cour ne l’aimait pas et même le méprisait ; il était ou avait été l’amant de la jeune Mme de Staël, fille de Necker, qui dépensait avec les hommes politiques le feu de son esprit, et avec les hommes d’épée le feu de son tempérament. Elle pédantisait avec éloquence sur la Constitution, et Marie-Antoinette avait contre elle une double haine de reine et de femme. Elle écrit à Fersen, le 7 décembre :
« Le comte Louis de Narbonne est enfin ministre de la guerre d’hier ; quelle gloire pour Mme de Staël et quel plaisir pour elle d’avoir toute l’armée… à elle ! »
Mais elle ajoute :
« Il pourra être utile, s’il veut, ayant assez d’esprit pour rallier les constitutionnels et bien le ton qu’il faut pour parler à l’armée actuelle… Mais comprenez-vous ma position et le rôle que je suis obligée de jouer toute la journée ? quelquefois je ne m’entends pas moi-même, et je suis obligée de réfléchir pour voir si c’est bien moi qui parle ; mais que voulez-vous ? Tout cela est nécessaire, et croyez que nous serions encore bien plus bas que nous ne sommes, si je n’avais pas pris ce parti tout de suite ; au moins gagnons-nous du temps par là, et c’est tout ce qu’il faut. Quel bonheur, si je puis un jour redevenir assez forte pour prouver à tous ces gueux que je ne suis pas leur dupe ! »
Ainsi l’intrigue de trahison et de mensonge se compliquait à cette heure prodigieusement. La Cour, en effet, va pousser la simulation révolutionnaire jusqu’à accepter la guerre. Et même, elle va faire de la guerre sa politique. Elle se prend à espérer que le roi pourra ainsi se mettre à la tête des troupes et bientôt contenir la Révolution.
C’est le nouveau ministre, Narbonne, qui fait adopter à la Cour cette tactique qui séduisait son ambition d’aventurier. Il aurait ainsi gloire et popularité, puisqu’on marchant contre les émigrés il flattait la passion des patriotes, et bientôt, profitant de ce prestige pour établir en France une sorte de monarchie tempérée à la mode anglaise, il apparaissait comme le restaurateur de l’autorité royale et le modérateur de la liberté. Rêve insensé, car après avoir déchaîné la guerre et surexcité la passion révolutionnaire, comment l’aventurier aurait-il pu maîtriser les événements ?
L’esprit du roi et de la reine était si désemparé qu’ils cédèrent pourtant à ces illusions et à ce conseil, et dès le milieu de décembre, la politique de la guerre subit une révolution : ce n’est plus la guerre de la Gironde qui s’annonce, c’est la guerre du roi et de la Cour. Sur les intentions et les conceptions de Narbonne, le doute n’est pas possible. Bien des années après, en des propos que M. Villemain a recueillis, il disait :
« L’armée, une fois formée, pouvait être pour Louis XVI un appui libérateur, un refuge d’où il aurait soutenu la majorité saine et intimidé les clubs, comme l’essaya et le voulut M. de Lafayette, mais trop tard et trop isolément. »
Il semble bien que c’est entre le 7 décembre, jour de son entrée en fonctions, et le 11 décembre, que Narbonne éblouit et entraîna dans le sens de la guerre le roi et la reine. Louis Blanc cite, à la date du 6 décembre, une lettre de Marie-Antoinette à Mercy où tout le plan belliqueux de la cour est exposé. C’est le texte, aux trois quarts faussé, d’une lettre du 10 décembre, Louis Blanc a été induit en erreur par une publication inexacte et même frauduleuse.
Dès l’entrée de Narbonne au ministère, Marie-Antoinette mettait vaguement en lui quelque espérance ; elle pensait surtout qu’il pourrait servir de lien entre les constitutionnels et la Cour ; mais il ne paraît pas qu’il eût encore entraîné le roi et la reine dans la tactique de la guerre. Et même, lorsque le 7 décembre Narbonne parut pour la première fois à l’Assemblée, Marie-Antoinette en parle avec défaveur : « M. de Narbonne, écrit-elle à Fersen, a fait à son entrée à l’Assemblée un discours d’une platitude peu croyable pour un homme d’esprit. »
Mais le 14 décembre, c’est une toute autre allure. Le roi se rend à l’Assemblée pour répondre au message du 30 novembre. Tous les ministres l’accompagnent, « M. de Narbonne à la tête », comme nous l’apprend une lettre du 19 décembre de l’abbé Salamon. M. de Narbonne faisait, si je puis employer une expression toute moderne, figure de président du Conseil. Il apparaissait comme le chef du ministère. Le roi debout et découvert lut à l’Assemblée une déclaration…
« Vous m’avez fait entendre qu’un mouvement général entraînait la nation et que le cri de tous les Français était : « Plutôt la guerre qu’une « patience ruineuse et avilissante. » Messieurs, j’ai pensé longtemps que les circonstances exigeaient une grande circonspection dans les mesures ; qu’à peine sortis des agitations et des orages d’une révolution et au milieu des premiers essais d’une Constitution naissante, il ne fallait négliger aucun des moyens qui pouvaient préserver la France des maux incalculables de la guerre. Ces moyens je les ai tous employés… L’empereur a rempli ce qu’on devait attendre d’un allié fidèle en défendant et dispersant tout rassemblement dans ses États. Mes démarches n’ont pas eu le même succès auprès de quelques autres princes : des réponses peu mesurées ont été faites à nos réquisitions. Ces injustes refus provoquent des déterminations d’un autre genre. La nation a manifesté son vœu : vous l’avez recueilli, vous en avez pesé les conséquences ; vous me l’avez exprimé par votre message ; Messieurs, vous ne m’avez pas prévenu ; représentant du peuple, j’ai senti son injure, et je vais vous faire connaître la résolution que j’ai prise pour en poursuivre la réparation.
« Je fais déclarer à l’électeur de Trêves, que si avant le 15 de janvier, il ne fait pas cesser dans ses États tout attroupement et toute disposition hostile de la part des Français qui s’y sont réfugiés, je ne verrai plus en lui qu’un ennemi de la France. (Vifs applaudissements et cris de : Vive le roi.) Je ferai faire une semblable déclaration à tous ceux qui favoriseraient de même des rassemblements contraires à la tranquillité du royaume et en garantissant aux étrangers toute la protection qu’ils doivent attendre de nos lois, j’aurai bien le droit de demander que les outrages que les Français peuvent avoir reçus soient promptement et complètement réparés. (Applaudissements.)
« J’écris à l’Empereur pour l’engager à continuer ses bons offices, et, s’il le faut, à déployer son autorité comme chef de l’Empire pour éloigner les malheurs que ne manquerait pas d’entraîner une plus longue obstination de quelques membres du Corps germanique. Sans doute on peut beaucoup attendre de son intervention ; mais je prends en même temps les mesures les plus propres à faire respecter ces déclarations. (Applaudissements.)
« Mais en nous abandonnant courageusement à cette résolution, hâtons-nous d’employer les moyens qui seuls peuvent en assurer le succès. Portez votre attention, Messieurs, sur l’état des finances ; affermissez le crédit national ; veillez sur la fortune publique ; que vos délibérations toujours soumises aux principes constitutionnels prennent une marche grave, fière, imposante, la seule qui convienne aux législateurs d’un grand Empire. (Vifs applaudissements dans une partie de l’Assemblée et dans les tribunes.) Que les pouvoirs constitués se respectent pour se rendre respectables et qu’ils se prêtent un secours mutuel au lieu de se donner des entraves ; et qu’enfin on reconnaisse qu’ils sont distincts et non ennemis. Il est temps de montrer aux nations étrangères que le peuple français, ses représentants et son roi ne font qu’un. » (Vifs applaudissements.)
Et il termina par ces paroles à la fois ambiguës et flatteuses : « Pour moi, Messieurs, c’est vainement qu’on chercherait à environner de dégoût l’exercice de l’autorité qui m’est confiée. Je le déclare devant la France entière : rien ne pourra lasser ma persévérance, ni ralentir mes efforts. Il ne tiendra pas à moi que la loi ne devienne l’appui des citoyens et l’effroi des perturbateurs. (Vives acclamations.) Je conserverai fidèlement le dépôt de la Constitution et aucune considération ne pourra me déterminer à souffrir qu’il y soit porté atteinte ; et si des hommes qui ne veulent que le désordre et le trouble prennent occasion de cette fermeté pour calomnier mes intentions, je ne m’abaisserai pas à repousser par des paroles les injurieuses défiances qu’ils se plairaient à répandre. Ceux qui observent la marche du gouvernement avec un œil attentif mais sans malveillance, doivent reconnaître que jamais je ne m’écarte de la ligue constitutionnelle et que je sens profondément qu’il est beau d’être le roi d’un peuple libre. « Les applaudissements se prolongent pendant plusieurs minutes. Plusieurs membres font entendre dans l’Assemblée le cri de : Vive le roi des Français ! Ce cri est répété par les tribunes et par un grand nombre de citoyens qui s’étaient introduits dans la salle à la suite du roi, et qui s’étaient placés dans l’extrémité de la partie droite. Les tribunes des deux extrémités de la salle et les membres de l’Assemblée placés à l’extrême gauche ont gardé le plus profond silence.)
En vérité, c’était bien joué et le sémillant aventurier qui avait soufflé ce discours au roi avait fait largement les choses. Le langage royal était assez populaire et décidé dans le sens de la Constitution, pour que l’importun souvenir de Varennes parût se dissiper. Et la tactique nouvelle était bien définie : conquérir décidément la popularité en paraissant suivre, ou même devancer le mouvement belliqueux des esprits ; limiter étroitement la guerre ; mettre hors de cause l’Empereur d’Autriche et affirmer ses bonnes intentions : réserver l’ultimatum aux petits princes du Rhin et avoir ainsi une guerre bénigne, mais qui tromperait l’appétit de mouvement de la nation et qui permettrait au roi de prendre le commandement des troupes. Jusque-là le roi et Narbonne marchaient d’accord. Au delà, leur pensée secrète bifurquait ; le ministre croyait qu’il suffirait du prestige ainsi conquis, pour reviser la Constitution ; le roi s’obstinait à penser que le concours des puissances, réunies en Congrès, y serait nécessaire, et il espérait que la guerre ferait surgir des incidents qui nécessiteraient la tenue de ce Congrès.
En attendant, le roi affirmait sa volonté constitutionnelle ; et quand il parlait des dégoûts dont on « environnait l’exercice de son autorité », on ne sut s’il parlait des émigrés ou des révolutionnaires. L’Assemblée ne chercha point à préciser, et c’est avec des transports d’enthousiasme qu’elle allait vers l’abîme. Car quel pire désastre pour la Révolution, que la guerre ainsi accaparée par la Cour et conduite avec tant d’arrière-pensées traîtresses ! Mais les esprits étaient si échauffés et la Gironde les avait si étourdiment passionnés du feu de la guerre que toute clairvoyance semblait perdue. Pourtant l’extrême-gauche dans l’Assemblée et dans les tribunes garda le silence. Robespierre et Marat avaient réussi à éveiller un commencement de défiance.
Les conseillers secrets de la Cour depuis Varennes, les Lameth, Duport, Barnave, avaient-ils poussé le roi dans la voie aventureuse ouverte par Narbonne ? Les contemporains l’ont pensé ; l’abbé de Salamon chargé de renseigner la cour de Rome, écrivait le 19 décembre au cardinal Zelada :
« Les Constituants, ne sachant de quel moyen se servir pour écraser les Jacobins et pour faire aller la Constitution, ont pensé qu’il fallait prendre les dits Jacobins au mot et déclarer la guerre, parce qu’il en arriverait une explosion quelconque qui pourrait amener le but désiré, c’est-à-dire la Constitution un peu mitigée. Louis de Narbonne, vif, ayant de l’esprit et de l’ambition, voulant se soutenir dans une place hérissée des écueils les plus scabreux, persuadé qu’un ministre de la guerre ne peut être vraiment en activité que pendant la guerre, non seulement a goûté ce projet des constituants ses amis, mais on assure que c’est lui qui l’a proposé dans le Conseil et l’a fait voir au roi comme le seul moyen de déjouer l’Assemblée et les Jacobins, et l’a fait adopter. C’est d’après cette résolution que nous avons vu sortir de la presse le pitoyable discours qu’on a mis dans la bouche du roi. »
Il paraît bien que Barnave, du moins, n’encouragea pas cette politique ; il aurait voulu le maintien absolu de la paix, mais d’autres « constituants » semblent avoir conseillé l’aventure. Barnave, sous le titre : Fautes de la nouvelle Assemblée, écrit ceci :
« La conduite du gouvernement et du parti constitutionnel eût été de s’opposer décidément à la guerre et en général de résister fortement sur toutes les choses décisives, mais hors de là d’éviter toutes les secousses… Si les ministres ayant arrêté entre eux ces mesures, en ont envoyé le résumé au roi, et ont cru qu’elles auraient plus de poids auprès de lui, appuyées de l’opinion de deux anciens députés qui, quelques mois auparavant, avaient contribué à conserver son trône et sa personne, c’est ce que j’ignore absolument, mais c’est ce qui pourrait être vrai. »
« Le gouvernement n’a jamais eu de marche suivie et a presque toujours donné dans les pièges que ses adversaires ont voulu lui tendre ; à peine ceux-ci osaient-ils parler ouvertement de guerre qu’on fit prononcer au roi, dans le mois de décembre, un discours où il semblait l’annoncer à la nation, et vouloir pousser la nation dans ce sens ; c’est alors que la guerre a paru vraisemblable ; le parti dit modéré, qui jusque-là l’avait en horreur, voyant le gouvernement à la tête de cette opinion, a commencé à l’adopter, et le peu d’hommes prévoyants qui voulurent résister à cette frénésie ont passé pour des endormeurs. »
Ainsi, en décembre, au moment où Narbonne entraîne le roi à la politique de guerre limitée, Barnave est résolument opposé à toute guerre : mais il est visible qu’autour de lui les révolutionnaires modérés et monarchistes se laissent gagner aussi à la tactique du ministre aventureux. Sans doute les Lameth et Duport résistèrent moins que Barnave. C’est peut-être son impuissance à faire agréer ses conseils et le dépit de voir l’influence secrète qu’il avait su se ménager auprès du roi et de la reine, abolie en un jour par la brillante étourderie de Narbonne, qui décida Barnave à quitter Paris. Sans doute aussi le terrible enchevêtrement des choses intérieures et des choses extérieures lui fit-il peur. Il quitta Paris, c’est lui-même qui nous l’apprend, dans les premiers jours de janvier 1792, pour revenir dans ses foyers.
Narbonne ne cacha point d’ailleurs à l’Assemblée que c’était lui qui avait suggéré au roi cette politique.
Il affecta dans la séance même du 14 et aussitôt après le roi, de parler en grand ministre dirigeant, et il signifia nettement que, par lui, c’est le parti modéré, le parti constitutionnel qui allait prendre la direction de la guerre, lui donner son caractère et ses limites : « C’est la même nation, c’est la même puissance qui combattit sous Louis XIV ; voudrions-nous laisser penser que notre gloire dépendait d’un seul homme, et qu’un siècle ne rappelle qu’un nom ? Non Messieurs, je ne l’ai pas cru lorsque j’ai désiré le parti que le roi vient de prendre. Je sais qu’on a déjà voulu, qu’on voudra peut-être encore calomnier ce parti, que parmi les hommes qui l’avaient ardemment réclamé, il en est qui se sont préparés à le combattre dès que le gouvernement a paru l’adopter ; mais vous déconcerterez de tels systèmes, et l’on persuadera difficilement à une nation courageuse que de vains discours suffisent à la défense de sa liberté. »
Après ce coup aux Jacobins, et même sans doute à la Gironde, Narbonne précise bien, par le choix même des chefs, que ce sont les révolutionnaires nettement monarchistes et modérés qui auront la conduite des opérations. « Trois armées ont paru nécessaires, M. de Rochambeau, M. de Lückner, M. de Lafayette. » (Triple salve d’applaudissements.)
Enfin, découvrant hardiment son jeu, c’est aux forces d’ordre et de conservation qu’il fait appel et il démontre que la guerre doit être l’occasion de renforcer le pouvoir exécutif, c’est-à-dire royal. « Nous aurons le soin de prouver à l’Europe que les malheurs intérieurs dont nous avons d’autant plus à gémir que nous nous sommes quelquefois peut-être refusés à les réprimer, naissaient de l’ardeur inquiète de la liberté, et qu’au moment où sa cause appellerait une défense ouverte, la vie et les propriétés seraient en sûreté parfaite dans l’intérieur du royaume. Nous ne reconnaîtrons d’ennemis que ceux que nous aurons à combattre, et tout homme sans défense sera devenu sacré. Ainsi nous vengerons l’honneur de notre caractère, que de longs troubles auraient pu apprendre à méconnaître. Si le funeste cri de guerre se fait entendre, il sera du moins pour nous le signal tant désiré de l’ordre et de la justice ; nous sentirons combien l’exact payement des impôts auquel tiennent le crédit et le sort des créanciers de l’État, la protection des colonies, dont les richesses commerciales dépendent, l’exécution des lois, force de toutes les autorités, la confiance accordée au gouvernement pour lui donner les moyens nécessaires d’assurer la fortune publique et les propriétés particulières, le respect pour les puissances qui garderaient la neutralité ; nous sentirons, dis-je, combien de tels devoirs nous sont impérieusement commandés par l’honneur de la nation et la cause de la liberté. »
Et Narbonne annonçait qu’il partait immédiatement pour faire une tournée d’inspection sur la frontière : il demandait un premier crédit de vingt-cinq millions.
La Gironde fut à la fois réjouie et inquiétée par ce discours. Réjouie : car elle voyait bien que de cette première guerre limitée sortirait bientôt nécessairement la guerre générale, la grande épreuve de la royauté ; inquiétée : car Narbonne semblait, au moins pour un temps, prendre à la Gironde sa guerre, faire de la guerre de la Révolution la guerre du roi. Moment étrange où pour tous les partis la guerre est une manœuvre de politique intérieure : manœuvre du roi qui espère réaliser par là son rêve d’un Congrès des souverains : manœuvre des constitutionnels qui veulent rétablir le pouvoir exécutif et mater les influences jacobines : manœuvre de la Gironde qui veut jeter la royauté en pleine mer, en pleine tempête pour prendre enfin le gouvernail du vieux navire pavoisé aux couleurs nouvelles, ou pour le couler à fond. Et pour jouer ce jeu, pour accepter d’abord la direction de la cour dans une guerre destinée à combattre la cour, pour s’exposer sans peur aux intrigues et trahisons royales et à l’hostilité générale des souverains de l’Europe incessamment provoqués, il fallait aux révolutionnaires de la Gironde une telle foi dans la Révolution et dans la France nouvelle, dans la force rayonnante de la liberté et dans l’héroïsme du peuple, qu’on ne sait si l’on doit détester leur étourderie guerrière ou admirer leur enthousiasme.
Qui sait après tout si la coalition des rois ne se fût pas formée enfin malgré toute la prudence et toute la réserve des partis révolutionnaires ? Qui sait si cette coalition aidée par la lente et sourde trahison royale n’aurait pas peu à peu enserré, enveloppé la France pacifique et s’il n’y avait point sagesse à prendre l’offensive, à jeter au monde l’épée de la Révolution ? La raison hésite et se trouble devant ce formidable problème, et résignée, elle se laisse porter par le destin.

Brissot, dès la séance du 14, répondant au ministre de la guerre, marqua sa mauvaise humeur du langage qui venait d’être tenu par Narbonne. « Je suis bien loin, dit-il, de m’opposer à l’impression du compte que vient de rendre le ministre de la guerre ; ce compte mérite la plus sérieuse attention ; mais j’aurais désiré qu’aux nombreuses vérités qu’il contient on n’y eût point mêlé d’injustes préventions plus propres… (Murmures, rires et exclamations ; applaudissements dans les tribunes.) Je demande que la discussion de ce compte important ne commence qu’après l’impression, et qu’elle soit ajournée à samedi prochain, et l’on verra si les patriotes méritent les préventions dont on les accable. » (Applaudissements dans les tribunes.)
Ainsi, Brissot ne retourne pas en arrière. Il ne déclare pas qu’effrayé par l’intrigue de modérantisme, qui pourrait maintenant fausser la guerre, il renonce à conseiller celle-ci. Il proteste au contraire que les « patriotes », les démocrates continuent à la désirer.
À partir de ce jour, la Gironde joue à l’égard de Narbonne un jeu très compliqué. Elle le ménage, parce qu’en disposant le gouvernement à la guerre il sert inconsciemment la Révolution ou du moins la politique girondine. Mais en même temps, elle s’applique à entraîner la guerre hors des voies que Narbonne et le roi ont tracées. Il s’agit d’abord de redoubler de violence contre les émigrés et contre les princes, pour aggraver la lutte de la Révolution et de la cour. Il s’agit ensuite d’étendre à l’empereur le conflit que le roi voudrait limiter aux petits princes du Rhin.
Dès le 29 décembre, Brissot recommence la bataille. À propos du vote des 20 millions demandés par le ministre de la guerre, il expose à nouveau dans un très long discours toute la politique extérieure et intérieure. Il répète sur les dispositions de l’Europe ce qu’il avait dit le 20 octobre. Une agression de la plupart des souverains n’est pas à craindre. D’ailleurs, les peuples sont amis de la France révolutionnaire. « Il ne faut pas se borner à examiner maintenant les petites passions, les petits calculs et des rois et de leurs ministres.
« La Révolution française a bouleversé toute la diplomatie. Quoique les nations ne soient pas encore libres, toutes pèsent maintenant dans la balance politique ; les rois sont forcés de compter leurs vœux pour quelque chose… Le sentiment de la nation anglaise sur la Révolution n’est plus douteux ; elle l’aime… En Hongrie, le serf lutte contre l’aristocratie, et l’aristocratie contre le trône… Nous ne sommes pas cette poignée de bourgeois bataves, qui voulaient conquérir la liberté sur le stathouder, sans partager avec la classe indigente…
« En vain les cabinets politiques multiplieront les négociations secrètes ; en vain ils s’agiteront, ils agiteront toute l’Europe pour attaquer la France, tous leurs efforts échoueront, parce qu’en définitive il faut de l’or pour payer les soldats, des soldats pour combattre et un grand concert pour avoir beaucoup de soldats. Or, les peuples ne sont plus disposés à se laisser épuiser pour une guerre de rois, de nobles et surtout pour une guerre immorale, impie. »
Ainsi, Brissot croit que la guerre aura nécessairement un caractère démocratique et populaire. Et il semble penser que déjà les souverains de l’Europe sont tellement menacés ou paralysés par leurs peuples qu’une Révolution européenne sera la conséquence presque immédiate d’une guerre sans péril. Déjà, dans son journal le 15 décembre, avec plus de netteté qu’il n’ose le faire à la tribune, c’est sous la forme d’une propagande révolutionnaire armée qu’il entrevoit la guerre. « La guerre ! la guerre ! écrit-il, tel est le cri de tous les patriotes, tel est le vœu de tous les amis de la liberté répandus sur la surface de l’Europe, qui n’attendent plus que cette heureuse diversion pour attaquer et renverser leurs tyrans. »
« C’est à cette guerre expiatoire, qui va renouveler la face du monde et planter l’étendard de la liberté sur les palais des rois, sur les sérails des sultans, sur les châteaux des petits tyrans féodaux, sur les temples des papes et des muphtis, c’est à cette guerre sainte qu’Anacharsis Clootz est venu inviter l’Assemblée nationale, au nom du genre humain dont il n’a jamais mieux mérité d’être appelé l’ami. »
Quel abîme entre cette guerre de Révolution universelle et la guerre de conservation monarchique voulue maintenant par la Cour ! Et quelle intrépidité il fallait à la Gironde pour aller à l’une en passant par l’autre ! Mais elle s’ingénie à déborder la Cour de toutes parts. C’est avec tout le vieux monde que Brissot veut mettre la Révolution aux prises : « Le tableau que je viens de faire des puissances serait-il trompeur ? Quoique tout leur commande la paix, les princes voudraient-ils la guerre ? Je veux le croire un instant et je dis que nous devrions nous hâter de les prévenir. Qui prévient son ennemi l’a vaincu à moitié. (Applaudissements.) C’était la tactique de Frédéric et Frédéric était maître en cet art. »
« Je veux donc croire que l’empereur et la Prusse, que la Suède et la Russie soient sincères et de bonne foi dans les traités qu’ils viennent de conclure ; je veux croire qu’ils se soient engagés à détruire par la force, la Constitution française, ou à la modifier, à y amalgamer une Chambre haute, une noblesse ; je veux croire que pour effectuer cet étrange amalgame, ils aient besoin de convoquer un Congrès général des puissances de l’Europe ; je veux croire qu’ils y citent la nation française, qu’ils la menacent si elle ne se soumet pas. Je vous le demande, je le demande à la France entière : quel est le lâche qui, pour sauver sa vie, accepterait une capitulation ignominieuse ? » (Applaudissements.)
« La guerre est nécessaire à la France sous tous les points de vue. Il la faut pour son honneur ; car elle serait à jamais déshonorée si quelques milliers de brigands pouvaient impunément braver 25 millions d’hommes libres. Il la faut pour sa sûreté extérieure, car elle serait bien plus compromise si nous attendions tranquillement dans nos foyers le feu et la flamme dont on nous menace, que si, prévenant ces desseins hostiles, nous voulons les porter nous-mêmes dans les cavernes des brigands qui osent nous braver.
« Il la faut pour assurer la tranquillité intérieure, car les mécontents ne s’appuient que sur Coblentz, n’invoquent que Coblentz, ne sont insolents que parce que Coblentz existe. (Applaudissements.) C’est le centre où aboutissent toutes les relations des fanatiques et des privilégiés ; c’est donc à Coblentz qu’il faut voler, si l’on veut détruire et la noblesse et le fanatisme. »
Comme on voit, c’est le même thème que dans le discours du 20 octobre ; c’est le même parti pris de guerre. Si l’hostilité des souverains contre la Révolution est sérieuse, qu’on les attaque pour prévenir le danger ; si elle est simulée, qu’on les attaque encore pour mettre fin à cette parade. C’est la même contradiction étrange : le monde entier s’ouvrant à la propagande de la Révolution, et puis soudain, cet horizon immense et tout empli de lumière ardente se resserrant à la pauvre question des émigrés. Mais l’audace de Brissot avait grandi dans l’intervalle comme la passion guerrière du pays, et cette fois il ne craint pas d’exiger du roi, contre plusieurs des grandes puissances, des démarches violentes. La Russie n’a pas reconnu nos agents ; l’Espagne témoigne du mauvais vouloir ; la Suède s’agite ; l’empereur équivoque ; qu’à tous des explications soient demandées ; que les ministres du roi soient tenus de communiquer à l’Assemblée le résultat de ces démarches.
Ainsi le filet de guerre, qui semblait d’abord ne devoir capturer que les petits princes du Rhin et les émigrés, s’élargit soudain sur toute l’Europe. Ainsi les ministres sont enveloppés d’un réseau mortel ; car si leurs démarches sont agressives, si elles provoquent des répliques du même ton, et s’ils communiquent ces réponses à l’Assemblée, ils étendent malgré eux, la guerre à toute l’Europe. S’ils ne font que des démarches incertaines, s’ils atténuent les réponses hostiles qu’ils reçoivent, s’ils ne laissent parvenir à l’Assemblée qu’une partie de la vérité, ils seront accusés de trahison et c’est la Gironde qui prendra, au nom de la France révolutionnaire, la suite des opérations. Brissot et Narbonne sont à ce moment comme deux pêcheurs montés dans la même barque. Mais Narbonne malgré le large geste de fanfaronnade qui semble menacer toute l’étendue des eaux ne veut pêcher que le menu fretin des princes. Brissot ne veut pas laisser échapper le gros poisson, et Narbonne, en ce jeu frivole d’imitation menteuse, sera contraint de travailler pour son rival, d’amorcer le gros poisson que l’autre prendra. Qu’on me pardonne cette image : c’est ce qui se mêle de manœuvres et d’intrigues à la première préparation de la guerre qui me l’a suggérée. Mais déjà, en sa croissante effervescence, la Nation allait plus haut que tous ces calculs, et, croyant la guerre inévitable elle s’apprêtait à combattre d’un cœur héroïque ; elle s’efforçait aussi de retenir dans l’orage de fer et de feu qui allait éclater, sa sérénité humaine, sa grande tendresse pour les nations.
Hérault de Séchelles, en cette même séance du 29 décembre, découvre « une vaste conspiration contre la liberté de la France et la liberté future du genre humain », donnant ainsi à la Révolution toute son ampleur d’humanité. Condorcet se résigne à la guerre comme à une nécessité de salut pour la liberté menacée ; mais cette guerre même, il s’applique pour ainsi dire à la pénétrer de paix ; et il propose une adresse à la Nation, où à travers toutes les tristes fumées des batailles, c’est encore la paix lumineuse qui transparaît. C’est comme un sublime et douloureux effort pour concilier la philosophie du xviiie siècle, la philosophie de la raison, de la paix, de la tolérance avec la guerre inévitable ; c’est la promesse fraternelle jusque dans le déploiement de la force, le rameau d’olivier bruissant au vent d’orage.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
« La Nation française ne cessera pas de voir un peuple ami dans les habitants des pays occupés par les rebelles et gouvernés par les principes qui les protègent. Les citoyens paisibles dont ses armées couvriront le territoire, ne seront point des ennemis pour elle ; ils ne seront même pas des sujets. La force publique dont elle deviendra momentanément dépositaire, ne sera employée que pour assurer leur tranquillité et maintenir leurs lois. Fière d’avoir reconquis les droits de la nation, elle ne les outragera point dans les autres hommes. Jalouse de son indépendance, résolue à s’ensevelir sous ses ruines plutôt que de souffrir qu’on osât lui dicter des lois, ou même garantir les siennes, elle ne portera point atteinte à l’indépendance des autres nations. Ses soldats se conduiront sur une terre étrangère comme ils se conduiraient sur celle de leur patrie s’ils étaient forcés d’y combattre, les maux involontaires que ses troupes auraient fait éprouver aux citoyens seront réparés… La France présentera au monde le spectacle nouveau d’une nation vraiment libre, soumise aux règles de la justice, au milieu des orages de la guerre et respectant partout, en tout temps, à l’égard de tous les hommes, les droits qui sont les mêmes pour tous. » (Applaudissements.)
Évidemment Condorcet répugne à la guerre. Il en reconnaît ou paraît en reconnaître la nécessité : mais on dirait que renonçant à contrarier directement le mouvement belliqueux il essaie une sorte de diversion en rappelant la Révolution à son idéal pacifique. Surtout il semble redouter « la guerre de propagande ». Il comprend que libérer les autres peuples par la force ce serait encore les asservir. Quelques jours avant, l’orateur populaire Louvet s’était écrié à l’Assemblée, avec un lyrisme extraordinaire : « La guerre ! et qu’à l’instant la France se lève en armes. Se pourrait-il que la coalition des tyrans fût complète ? Ah ! tant mieux pour l’univers ! Qu’aussitôt, prompts comme l’éclair, les milliers de citoyens soldats se précipitent sur tous les domaines de la féodalité ! Qu’ils ne s’arrêtent qu’où finira la servitude ; que les palais soient entourés de baïonnettes ; qu’on dépose la Déclaration des Droits dans les chaumières ; que l’homme, en tous lieux instruit et délivré, reprenne le sentiment de sa dignité première ! Que le genre humain se relève et respire !Que les nations n’en fassent plus qu’une ; et que cette incommensurable famille de frères envoie ses plénipotentiaires sacrés, jurer sur l’autel de l’égalité du droit, de la liberté des cultes, de l’éternelle philosophie, de la souveraineté populaire, jurer la paix universelle ! »
Cet enthousiasme démesuré inquiétait Condorcet : il prévoyait qu’à vouloir réaliser par les armes la fraternité universelle et l’universelle paix la France de la Révolution risquerait d’accroître les conflits et les haines ; que d’ailleurs aucune négociation séparée avec divers États ne restait possible dans ce système. Et il demandait que les lois des autres peuples et leurs préjugés mêmes fussent respectés.
Mais, n’était-ce point ôter à l’esprit de guerre un de ses aliments ? Condorcet, en mathématicien qui calcule les forces, semblait renoncer à refouler l’extraordinaire mouvement guerrier déchaîné depuis des mois : mais il s’appliquait à le contenir.
Le journal de Prudhomme et Robespierre luttent directement : ils essaient de briser le courant de guerre plus violent tous les jours. Dans le numéro du 17 au 24 décembre, les Révolutions de Paris publient un vigoureux article sur les dangers d’une guerre offensive. « Que le roi, que les ministres et la Cour veuillent la guerre, que les aristocrates veuillent la guerre ; que les fanatiques veuillent la guerre ; que tous les ennemis de la liberté veuillent la guerre, cela n’est point étonnant ; la guerre ne peut que servir leurs projets homicides ; mais que nombre de patriotes veuillent aussi la guerre ; que l’opinion des patriotes puisse être partagée sur la guerre, c’est ce que l’on ne comprend pas et pourtant c’est une vérité dont nous sommes les témoins…
« L’honneur français est blessé ! Et ce sont de prétendus patriotes qui tiennent ce langage ! Louis XVI aussi, Narbonne aussi, les Feuillants et les ministériels aussi parlent à la nation le langage de l’honneur. Encore une fois, les hommes libres n’ont su jamais ce qu’était l’honneur. L’honneur est l’apanage des esclaves ; l’honneur est le talisman perfide avec lequel on a vu les despotes fouler aux pieds la sainte humanité. »
« Depuis le 14 juillet, nous n’entendions plus parler d’honneur. Pourquoi tout à coup reproduire ce mot et le substituer à celui de vertu ? Qu’un peuple soit vertueux, qu’il soit fort, c’est tout pour lui, mais l’honneur… L’honneur est à Coblentz, et qu’importe à la nation française l’opinion de quelques tyrans, de quelques esclaves qui ont fui à l’aurore de la liberté ?… C’est pourtant au nom de cet honneur que Brissot a demandé la guerre. »
Et quelques jours après, commentant une adresse de Vergniaud qui contenait ces mots : la gloire nous attend, le courageux journal s’écriait : « La gloire, nous n’en voulons pas, nous ne voulons que le bonheur. » Et il ajoutait ces graves et belles paroles : « Espérons du moins que l’Assemblée n’autorisera pas les peuples étrangers à suivre ses préceptes, ceux de la résistance à l’oppression. »
Les discours que Robespierre prononça contre la guerre aux Jacobins le 2 janvier et le 11 janvier 1792 étaient admirables de courage, de pénétration et de puissance ; et je regrette bien vivement de ne pouvoir les citer en entier. Il nous plaît que ce soit le parti le plus nettement démocratique, celui qui voulait faire de la souveraineté du peuple une vérité, qui ait le plus énergiquement résisté à la guerre ; plus tard, quand la guerre sera déchaînée, quand la France de la Révolution devra défendre sa liberté contre l’univers conjuré, les révolutionnaires démocrates la soutiendront avec une énergie implacable ; mais tant que la paix leur a paru possible, ils ont lutté, même contre la passion du peuple, pour maintenir la paix.
Est-ce à dire qu’il n’y avait ni erreur, ni lacune, ni insuffisance, dans la thèse de Robespierre ? Pour détourner les révolutionnaires de la voie guerrière où ils étaient déjà engagés, il avait besoin d’exciter leur défiance. Et il insistait au delà du vrai sur la part prise par la Cour au mouvement de guerre. Robespierre voyait dans la guerre une machination du roi : il se trompait. Longtemps le roi et la reine avaient redouté la guerre. C’est seulement quand ils virent le mouvement presque irrésistible des esprits que, conseillés par Narbonne, ils songèrent à l’utiliser, à prendre la direction des opérations. Mais au moment où parlait Robespierre, il était bien vrai que la guerre serait, en tout cas, conduite par la Cour et rattachée par elle à son plan de contre-révolution.
« Si des traits ingénieux, si la peinture brillante et prophétique des succès d’une guerre terminée par les embrassements fraternels de tous les peuples de l’Europe sont des raisons suffisantes pour décider une question aussi sérieuse, je conviendrai que M. Brissot l’a parfaitement résolue ; mais son discours m’a paru présenter un vice qui n’est rien dans un discours académique, et qui est de quelque importance dans la plus grande de toutes les discussions politiques ; c’est qu’il a sans cesse évité le point fondamental de la question pour élever à côté tout son système sur une base absolument ruineuse.
« Certes, j’aime tout autant que M. Brissot une guerre entreprise pour étendre le règne de la liberté, et je pourrais me livrer aussi au plaisir d’en raconter d’avance toutes les merveilles. Si j’étais maître des destinées de la France, si je pouvais, à mon gré, diriger ses forces et ses ressources, j’aurais envoyé dès longtemps une armée en Brabant, j’aurais secouru les Liégeois et brisé les fers des Bataves ; ces expéditions sont fort de mon goût ; je n’aurais point, il est vrai, déclaré la guerre à des sujets rebelles ; je leur aurais ôté jusqu’à la volonté de se rassembler ; je n’aurais pas permis à des ennemis plus formidables et plus près de nous (la Cour) de les protéger et de nous susciter au dedans des dangers plus sérieux. Mais dans les circonstances où se trouve mon pays, je jette un regard inquiet autour de moi, et je me demande si la guerre que l’on fera sera celle que l’enthousiasme nous promet : je me demande qui la propose, comment, dans quelles circonstances et pourquoi ?
« C’est là, c’est dans notre situation toute extraordinaire que réside toute la question. Vous en avez sans cesse détourné vos regards ; mais j’ai prouvé ce qui était clair pour tout le monde, que la proposition de la guerre actuelle était le résultat d’un projet formé dès longtemps par les ennemis intérieurs de notre liberté ; je vous en ai montré le but ; je vous ai indiqué les moyens d’exécution ; d’autres vous ont prouvé qu’elle n’était qu’un piège visible ; il n’est personne qui n’ait aperçu ce piège en songeant que c’était après avoir constamment protégé les émigrations et les émigrants rebelles, qu’on proposait de déclarer la guerre à leurs protecteurs, en même temps qu’on défendait encore les ennemis du dedans, confédérés avec eux.
« Vous êtes convenu vous-même que la guerre convenait aux émigrés, qu’elle plaisait au ministère, aux intrigants de la Cour, à cette faction nombreuse dont les chefs trop connus dirigent depuis longtemps toutes les démarches du pouvoir exécutif. Toutes les trompettes de l’aristocratie et du gouvernement en donnent à la fois le signal ; enfin, quiconque pourrait croire que la conduite de la Cour depuis le commencement de cette révolution n’a pas toujours été en opposition avec les principes de l’égalité et le respect pour les droits du peuple serait regardé comme un insensé, s’il était de bonne foi ; quiconque pourrait dire que la Cour propose une mesure aussi décisive que la guerre sans la rapporter à son plan ne donnerait pas une idée plus avantageuse de son jugement ; or, pouvez-vous dire qu’il est indifférent au bien de l’État, que l’entreprise de la guerre soit dirigée par l’amour de la liberté, ou par l’esprit de despotisme, par la fidélité ou par la perfidie ? Cependant qu’avez-vous répondu à tous ces faits décisifs ? Qu’avez-vous dit pour dissiper tant de justes soupçons ?

(D’après une estampe de la Bibliothèque nationale.)
« La défiance, avez-vous dit dans votre premier discours, la défiance est un état affreux : elle empêche les deux pouvoirs d’agir de concert ; elle empêche le peuple de croire aux démonstrations du pouvoir exécutif ; attiédit son attachement, relâche sa soumission. »
« La défiance est un état affreux ! Est-ce là le langage d’un homme libre qui croit que la liberté ne peut être achetée à trop haut prix ? Elle empêche les deux pouvoirs d’agir de concert ! Est-ce encore vous qui parlez ainsi ? Quoi ! c’est la défiance du peuple qui empêche le pouvoir exécutif de marcher et ce n’est pas sa volonté propre ? »
Sur ce point, Robespierre presse impitoyablement Brissot. Il semble, en effet, que là, Robespierre avait un avantage marqué ; car si la guerre était déclarée, c’était d’abord la guerre de la cour. Et Brissot était obligé de dire avec certitude : Le roi ne trahira pas, ou de dire avec audace : Si nous sommes trahis, tant mieux, car sous le coup de la trahison, la guerre échappera à la direction de la Cour.
Brissot disait à la fois les deux choses. Tantôt il se plaignait, en effet, de l’excès de défiance et semblait faire crédit « à l’esprit merveilleux » de Narbonne. Tantôt il proclamait que le salut serait précisément dans la trahison. Aux Jacobins même, il avait dit, dans le discours auquel répondait Robespierre : « Connaissez-vous un peuple, s’écrie-t-on, qui ait conquis sa liberté en soutenant une guerre étrangère, civile et religieuse, sous les auspices du despotisme qui le trompait ?
« Mais que nous importe l’existence ou la non-existence d’un pareil fait ? Existe-t-il donc dans l’histoire ancienne une révolution semblable à la nôtre ? Montrez-nous un peuple qui après douze siècles d’esclavage a repris sa liberté ! Nous créerons ce qui n’a pas existé.
« Oui, ou nous vaincrons et les émigrés et les prêtres et les Électeurs, et alors nous établirons notre crédit public et notre prospérité, ou nous serons battus et trahis…, et les traîtres seront enfin convaincus et ils seront punis, et nous pourrons faire disparaître enfin ce qui s’oppose à la grandeur de la nation française. Je l’avouerai, messieurs, je n’ai qu’une crainte, c’est que nous ne soyons pas trahis. NOUS AVONS BESOIN DE GRANDES TRAHISONS : NOTRE SALUT EST LÀ ; car il existe encore de fortes doses de poison dans le sein de la France, et il faut de fortes explosions pour l’expulser : le corps est bon, il n’y a rien à craindre. »
Je crois que c’est une des paroles les plus audacieuses qui aient été dites par des hommes à la veille de grands événements. Mais observez bien que Brissot, malgré tout, ne fait ici que des hypothèses : il prévoit la possibilité de la trahison ; il ne la redoute pas : il la désire, au contraire, parce qu’elle purgera la France et la Révolution du poison secret qui les paralyse. Mais Brissot n’ose pas dire d’une façon directe et positive : « L’état des esprits est tel à la Cour, la logique du despotisme royal est telle que nous serons d’abord nécessairement trahis, et c’est à travers le feu de la trahison que nous parviendrons à la grande guerre révolutionnaire, républicaine et libératrice. »
Non, Brissot manœuvre et équivoque. De même qu’il désire et prépare la guerre avec les grandes puissances de l’Europe, mais rassure la nation en lui persuadant qu’elles veulent la paix ; de même, il se prépare à compléter la Révolution grâce à la trahison royale manifestée dans la guerre, mais il se garde bien d’annoncer comme inévitable cette trahison. Ainsi, il flotte ou paraît flotter d’une conception à une autre, de la guerre avec la Cour à la guerre contre la Cour.
Il ne veut pas ou n’ose pas choisir, et Robespierre profite de cette incertitude, de cet embarras, pour le transformer en un allié, en un complaisant de la Cour. La tactique était habile, mais elle ne répondait pas à la grandeur du problème et à la grandeur du péril. Robespierre se trompait et rapetissait le débat quand il disait que la guerre avait été voulue, préparée, machinée, par la famille royale.
C’est, au contraire, d’une partie de la nation que venaient les impulsions belliqueuses, et la Cour entrait dans le mouvement une fois créé, pour le conduire, le fausser et l’exploiter. Robespierre aurait été bien plus fort s’il avait dit toute la vérité. Mais, peut-être ne la voyait-il pas. Il n’avait pas le sens de ces vastes mouvements confus, de ces impatiences instinctives, de ce besoin d’action brutale et immédiate qui saisissent parfois une nation énervée par l’attente, l’incertitude et le péril. S’il avait vu clair, si la petite intrigue de la Cour ne lui avait pas caché l’effervescence nationale, il aurait dit à Brissot : « Oui, la nation commence à perdre patience et elle va vers la guerre pour déployer sa force, pour en prendre conscience, pour acculer tous ses ennemis masqués à jeter leur masque. Mais il reste à la Cour assez de puissance pour égarer le mouvement. Oui, il se peut, même si la Cour trahit, que la force révolutionnaire puisse traverser cette période de trahison ; mais au prix de quelles épreuves ! et que signifie surtout cette diversion ? Concevez-vous vraiment la guerre comme un purgatif nécessaire pour la Révolution ? et si vraiment elle ne peut trouver dans sa sagesse, dans son amour de la liberté, la force nécessaire pour éliminer la contre-révolution, n’y a-t-il pas danger à jeter dans les aventures guerrières une nation aussi peu assurée de sa propre conscience ? »
Là était le véritable problème. La guerre est-elle vraiment nécessaire à la Révolution ? La guerre est-elle vraiment commandée par notre politique intérieure ?
Et j’ose dire que, dans leurs conclusions opposées, Brissot et Robespierre commirent tous deux la même faute. Tous deux, ils manquèrent de foi en la Révolution.
Oui, malgré ses apparences d’audace, malgré ses téméraires paradoxes sur la trahison, Brissot n’avait pas une suffisante confiance en la Révolution, puisqu’il pensait que la guerre était une convulsion nécessaire, disons le mot, un « vomitif nécessaire », pour que l’organisme de la Révolution rejetât les éléments malades qu’il contenait. Et Robespierre aussi n’avait pas assez de foi en la Révolution, puisqu’il n’affirmait pas la possibilité d’une action révolutionnaire intérieure capable d’expulser immédiatement tous ces éléments mauvais.
À ceux qui s’enfiévraient et voulaient marcher sur Coblentz, il fallait dire : « Non, marchons sur les Tuileries. » Or, Robespierre disait bien ou laissait bien entendre que le véritable péril était non à Coblentz mais aux Tuileries : il ne proposait pas, il ne laissait pas espérer une action révolutionnaire prochaine. L’horizon, de plus en plus chargé et troublé, devait être dégagé par un coup de foudre : coup de foudre de la guerre, ou coup de foudre d’une Révolution populaire et républicaine. Robespierre ne promettait, ne désirait ni l’un ni l’autre. Il était tout ensemble pour la paix avec le dehors et pour la légalité au dedans : c’était trop demander à un peuple dont les nerfs ou excités ou affaiblis vibraient de nouveau après quelques mois d’atonie.
Aussi, son action contre la guerre, si elle fut grande et noble, ne fut pas efficace. Mais quel sens merveilleux de la réalité, surtout quel sens des difficultés, des obstacles chez cet homme que d’habitude on qualifie d’idéologue, de théoricien abstrait ! Et comme il dissipe les rêves vains de ceux qui croyaient, comme le dit le journal de Prudhomme, « en portant au peuple la Déclaration des Droits de l’Homme à la pointe des baïonnettes », établir sans effort la liberté universelle ! « N’importe, dit-il à Brissot avec une ironie puissante, vous vous chargez vous-même de la conquête de l’Allemagne, d’abord ; vous promenez notre armée triomphante chez tous les peuples voisins ; vous établissez partout des municipalités, des directoires, des assemblées nationales, et vous vous écriez vous-même que cette pensée est sublime, comme si le destin des empires se réglait par des figures de rhétorique. Nos généraux conduits par vous ne sont plus que les missionnaires de la Constitution ; notre camp, qu’une école de droit public ; les satellites des monarques étrangers, loin de mettre aucun obstacle à l’exécution de ce projet, volent au-devant de nous, mais pour nous écouter. »
« Il est fâcheux que la vérité et le bon sens démentent ces magnifiques prédictions ; il est dans la nature des choses que la marche de la raison soit lentement progressive. Le gouvernement le plus vicieux trouve un puissant appui dans les habitudes, dans les préjugés, dans l’éducation des peuples. Le despotisme même déprave l’esprit des hommes jusqu’à s’en faire adorer, et jusqu’à rendre la liberté suspecte et effrayante au premier abord. La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d’un politique est de croire qu’il suffise à un peuple d’entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n’aime les missionnaires armés, et le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c’est de les repousser comme des ennemis. J’ai dit qu’une telle invasion pourrait réveiller l’idée de l’embrasement du Palatinat et des dernières guerres, plus facilement qu’elle ne ferait germer des idées constitutionnelles, parce que la masse du peuple dans ces contrées, connaît mieux ces faits que notre constitution. Les récits des hommes éclairés qui les connaissent, démentent tout ce qu’on nous raconte de l’ardeur avec laquelle elles soupirent après notre constitution et nos armées. Avant que les effets de notre Révolution se fassent sentir chez les nations étrangères, il faut qu’elle soit consolidée. Vouloir leur donner la liberté avant de l’avoir nous-mêmes conquise, c’est assurer à la fois notre servitude et celle du monde entier ; c’est se former des choses une idée exagérée et absurde, de penser que, dès le moment où un peuple se donne une constitution, tous les autres répondent au même instant à ce signal. »
« L’exemple de l’Amérique, que vous avez cité, aurait-il suffi pour briser nos fers, si le temps et le concours des plus heureuses circonstances n’avaient amené insensiblement cette révolution ? La Déclaration des Droits n’est point la lumière du soleil qui éclaire au même instant tous les hommes ; ce n’est point la foudre qui frappe en même temps tous les trônes. Il est plus facile de l’écrire sur le papier ou de la graver sur l’airain que de rétablir dans le cœur des hommes les sacrés caractères effacés par l’ignorance, par les passions et par le despotisme. Que dis-je ? N’est-elle pas tous les jours méconnue, foulée aux pieds, ignorée même parmi vous qui l’avez promulguée ? L’égalité des droits est-elle ailleurs que dans les principes de notre charte constitutionnelle ? »
Le despotisme, l’aristocratie ressuscitée sous des formes nouvelles, ne relève-t-elle pas sa tête hideuse ? N’opprime-t-elle pas encore la faiblesse, la vertu, l’innocence, au nom des lois et de la liberté même ? La Constitution que l’on dit fille de la Déclaration des Droits, ressemble-t-elle de fait à sa mère ?… Comment donc pouvez-vous croire qu’elle opérera, dans le moment même que nos ennemis intérieurs auront marqué pour la guerre les prodiges qu’elle n’a pu accomplir encore ? »
La suite des événements a montré que Robespierre avait raison d’annoncer la résistance des peuples à la Révolution armée. Certes, les grandes guerres de la Révolution ont ébranlé en bien des pays le régime ancien, mais elles ne l’y ont point abattu, et il y a plus d’une nation à qui il a fallu plus d’un siècle pour conquérir une partie seulement des libertés que possédait la France en 1792. Qui peut dire que la seule propagande de l’exemple aurait agi avec plus de lenteur ? Mais les guerres de la Révolution suscitèrent partout un nationalisme belliqueux et âpre, et l’on ne peut songer sans un regret poignant à ce que seraient les rapports des peuples et la civilisation générale si la paix avait pu être maintenue par la Révolution.
Robespierre, pour détruire les illusions propagées par la Gironde, atteint à une profondeur d’analyse sociale, et, si l’on me passe le mot, de réalisme révolutionnaire qu’on ne peut pas ne pas admirer. Lui qui dit parfois, en paroles vagues, que c’est « le peuple » qui a fait la Révolution, il reconnaît qu’il a fallu d’abord un ébranlement des classes privilégiées elles-mêmes et, en tout cas, des classes riches.
« Voulez-vous, dit-il, un contre-poison sûr à toutes les illusions que l’on vous présente ? Réfléchissez seulement sur la marche naturelle des révolutions. Dans des États constitués comme presque tous les pays de l’Europe, il y a trois puissances : le monarque, les aristocrates et le peuple, ou plutôt le peuple est nul. S’il arrive une révolution dans ces pays, elle ne peut être que graduelle, elle commence par les nobles, par le clergé, par les riches, et le peuple les soutient lorsque son intérêt s’accorde avec le leur pour résister à la puissance dominante, qui est celle du monarque. C’est ainsi que parmi vous ce sont les parlements, les nobles, le clergé, les riches, qui ont donné le branle à la Révolution ; ensuite le peuple est venu. Ils s’en sont repentis ou, du moins, ils ont voulu arrêter la Révolution lorsqu’ils ont vu que le peuple pouvait recouvrer sa souveraineté ; mais ce sont eux qui l’ont commencée ; et, sans leur résistance et leurs faux calculs, la nation serait encore sous le joug du despotisme. D’après cette vérité historique et morale, vous pouvez juger à quel point vous devez compter sur les nations de l’Europe en général, car, chez elles, loin de donner le signal de l’insurrection, les aristocrates, avertis par notre exemple même, sont aussi ennemis du peuple et de l’égalité que les nôtres, se sont ligués comme eux avec le gouvernement pour retenir le peuple dans l’ignorance et dans les fers. »
Aussi, il est chimérique, selon Robespierre, d’espérer une rapide expansion universelle de la Révolution, et c’est sur les forces contre-révolutionnaires de France qu’il faut concentrer son effort : « Mais, que dis-je ? Avons-nous des ennemis au dedans ? Vous n’en connaissez pas : vous ne connaissez que Coblentz. N’avez-vous pas dit que le siège du mal est à Coblentz ? Il n’est donc pas à Paris ? Il n’y a donc aucune relation entre Coblentz et un autre lieu qui n’est pas loin de nous ?… Apprenez donc qu’au jugement de tous les Français éclairés le véritable Coblentz est en France… Je décourage la nation, dites-vous : non, je l’éclaire ; éclairer des hommes libres c’est réveiller leur courage, c’est empêcher que leur courage même ne devienne l’écueil de leur liberté ; et, n’eussé-je fait autre chose que de dévoiler tant de pièges, que de réfuter tant de fausses idées et de mauvais principes, que d’arrêter les élans d’un enthousiasme dangereux, j’aurais avancé l’esprit public et servi la patrie ! »
Oui, mais ce qui manquait au discours de Robespierre, c’était le souffle révolutionnaire : il semblait ne pas plus espérer le succès d’un mouvement populaire au dedans que le succès de la guerre. « Lorsque le peuple s’éveille et déploie sa force et sa majesté, ce qui arrive une fois dans des siècles, tout plie devant lui, le despotisme se prosterne contre terre et contrefait le mort comme un animal lâche et féroce à l’aspect du lion ; mais bientôt il se relève, il se rapproche du peuple d’un air caressant ; il substitue la ruse à la force ; on le croit converti ; on a entendu sortir de sa bouche le mot de liberté ; le peuple s’abandonne à la joie, à l’enthousiasme ; on accumule en ses mains des trésors immenses que lui livre la fortune publique ; on lui donne une puissance colossale ; il peut offrir des appâts irrésistibles à l’ambition et à la cupidité de ses partisans, quand le peuple ne peut payer ses serviteurs que de son estime… Le moment arrive où la division règne partout, où tous les pièges des tyrans sont tendus, où la ligue de tous les ennemis de la liberté est entièrement formée, où les dépositaires de l’autorité publique en sont les chefs, où la portion des citoyens qui a le plus d’influence par ses lumières et par sa fortune est prête à se ranger de leur parti. Voilà la nation placée entre la servitude et la guerre civile. Il est impossible que toutes les parties d’un empire ainsi divisé se soulèvent à la fois, et toute insurrection partielle est regardée comme un acte de révolte… »
Mais, qui ne voit que par ce pessimisme, Robespierre faisait le jeu de la Gironde et de la guerre ? Si la Révolution est à ce point enlisée, et si elle ne peut se sauver ni par un soulèvement général ni par une insurrection partielle, essayons du moins la grande diversion girondine. Robespierre n’a pas entrevu le 20 juin : il n’a pas cru à la possibilité du 10 août, et sa critique toute négative ne pouvait arrêter l’élan des passions étourdies et ardentes soulevées par la Gironde.
Il fallait à ce moment un parti de l’action qui ne fût pas un parti de la guerre. Robespierre n’a pas su le susciter, et la guerre restait la seule issue. Mais pendant tous ces débats, entre Robespierre et Brissot grandissaient les haines : c’est là que commence le conflit de la Gironde et de la Montagne. Les Girondins, au moment où ils croyaient pouvoir réaliser un plan qui leur donnait le pouvoir, qui mettait la royauté à leur merci et qui faisait éclater la Révolution sur le monde, se heurtaient soudain à l’opposition inflexible d’un patriote, d’un démocrate dont l’autorité morale était immense. Ils sentaient leur échapper une partie de l’opinion, une partie de la force révolutionnaire, à l’heure même où ils avaient espéré éblouir tous les esprits, entraîner toutes les forces. Et Robespierre, méticuleux, ombrageux, personnel, souffrait dans son orgueil aussi bien que dans sa prudence de l’audace brillante et fanfaronne de la Gironde.
Les adversaires paraissaient d’abord se ménager ; mais bientôt ils se portèrent des coups très rudes. Les Girondins étaient des calomniateurs étourdis. Robespierre était un calomniateur profond. Brissot, avec beaucoup de légèreté et de mauvaise foi, représenta comme un outrage au peuple les paroles de circonspection prononcées par Robespierre. Et celui-ci insinua tous les jours plus perfidement que Brissot et ses amis faisaient le jeu de la Cour. En fait, parce qu’ils voulaient la guerre et qu’ils la voulaient tout de suite, avec n’importe quels instruments, les Girondins assumaient des responsabilités redoutables. Le jeu savant et cruel de Robespierre sera de les solidariser avec le frivole Narbonne, avec Lafayette, couvert du sang du peuple au Champ de Mars, et bientôt avec Dumouriez. Robespierre, qui n’agissait pas, qui ne s’engageait pas à fond, était beaucoup plus difficile à atteindre.
À travers ces disputes, la Révolution penchait de plus en plus vers la guerre, et l’effet des provocations systématiques de la Gironde commençait à se faire sentir. Le 31 décembre 1791, le ministre des affaires étrangères, Delessart, communiquait à l’Assemblée une note que le ministre autrichien, le prince de Kaunitz, avait remise le 21 à l’ambassadeur de France :
« Le chancelier de cour et d’État a l’honneur de lui communiquer de son côté : que Monseigneur l’électeur de Trêves vient également de faire part à l’Empereur de la note que le ministre de Vienne à Coblentz avait été chargé de présenter ; que ce prince a fait connaître en même temps à Sa Majesté impériale qu’il avait adopté à l’égard des rassemblements armés des émigrés et réfugiés français, et à l’égard des fournitures d’armes et des munitions de guerre les mêmes principes et règlements qui ont été adoptés dans les Pays-Bas autrichiens, mais que se répandant de vives inquiétudes parmi ses sujets et dans les environs, que la tranquillité des frontières et États pouvait être troublée par des incursions et violences, nonobstant cette sage mesure, Monseigneur a réclamé l’assistance de l’Empereur pour le cas que l’événement réalisât ses inquiétudes :
« Que l’Empereur est parfaitement tranquille sur les intentions justes et modérées du roi très chrétien, et non moins convaincu du très grand intérêt qu’a le gouvernement français à ne point provoquer tous les princes souverains étrangers, par des voies de fait contre l’un d’eux, mais que l’expérience journalière ne rassurait point assez sur la stabilité et la prépondérance du principe modéré en France, et sur la subordination des pouvoirs et surtout des provinces et des municipalités pour ne point devoir appréhender que les voies de fait ne soient exercées malgré les intentions du roi et malgré les dangers des conséquences, Sa Majesté impériale se voit nécessitée, tant par suite de son amitié pour l’électeur de Trêves que par les considérations qu’elle doit à l’intérêt général de l’Allemagne comme co-État, à ses propres intérêts comme voisin, d’enjoindre au maréchal de Bender, commandant général de ses troupes aux Pays-Bas, de porter aux États de S. A. S. E. (l’électeur de Trêves) les secours les plus prompts et les plus efficaces au cas qu’ils fussent violés par des incursions hostiles ou imminemment menacés d’icelles.
« L’Empereur est trop sincèrement attaché à Sa Majesté très chrétienne et prend trop de part au bien-être de la France et au repos général pour ne pas vivement désirer d’éloigner cette extrémité et les suites infaillibles qu’elle entraînerait tant de la part du chef et des États de l’Empire germanique que de la part des autres souverains réunis en concert pour le maintien de la tranquillité publique, et pour la sûreté et l’honneur des couronnes, et c’est par un effet de ce désir, que le chancelier de cour et d’État est chargé de s’en ouvrir, sans rien dissimuler vis-à-vis de M. l’ambassadeur de France. »

Délivrez-nous Seigneur.
(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Ce n’était pas encore la guerre, mais c’était un grand pas vers la guerre, et Brissot en tressaillait de joie. D’abord, en exprimant ses vues sur la marche des partis en France, l’Empereur blessait la fierté nationale et révolutionnaire, si excitée déjà. Ensuite il parlait d’un concert des souverains, et quoiqu’il lui assignât un rôle purement défensif, il suggérait par là l’idée que le Congrès contre-révolutionnaire n’était pas abandonné. Enfin et surtout, comme Brissot l’avait espéré, ce n’était plus la rencontre de la Révolution et des émigrés, c’était la mise en contact direct de la Révolution et de l’Empereur, c’était donc la possibilité de la grande guerre, de celle que la Cour ne voulait pas et que voulait la Gironde. Le roi dissimula sa frayeur et il envoya à l’Assemblée la déclaration suivante :
« Dans la réponse que je fais à l’Empereur, je lui répète que je n’ai rien demandé que de juste à l’électeur de Trêves, rien dont l’Empereur n’eût lui-même donné l’exemple. Je lui rappelle le soin que la nation française a pris de prévenir sur-le-champ les rassemblements de Brabançons, qui paraissaient vouloir se former dans le voisinage des Pays-Bas autrichiens. Enfin je lui renouvelle le vœu de la France pour la conservation de la paix, mais en même temps je lui déclare que si, à l’époque que j’ai fixée, l’électeur de Trêves n’a pas effectivement et réellement dissipé les rassemblements qui existent dans ses États, rien ne m’empêchera de proposer à l’Assemblée nationale, comme je l’ai annoncé, d’employer la force des armes pour l’y contraindre. (Applaudissements.)
« Si cette déclaration ne produit pas l’effet que je dois espérer, si la destinée de la France est d’avoir à combattre ses enfants et ses alliés, je ferai connaître à l’Europe la justice de notre cause ; le peuple français la soutiendra par son courage, et la nation verra que je n’ai point d’autres intérêts que les siens, et que je regarderai toujours le maintien de sa dignité et de sa sûreté comme le plus essentiel de mes devoirs. » (Vifs applaudissements.)
Pendant que le roi, lié par ses premières démarches, entraîné d’ailleurs par Narbonne, parle ainsi à l’Assemblée et à la France et semble résigné à la guerre, même contre l’Autriche, la Cour fait des efforts ambigus et incohérents pour empêcher la guerre, tout au moins avec l’Empereur. La reine, en cette crise, eut recours aux lumières de ses conseillers constitutionnels, des Lameth, de Duport, de Barnave.
Il ne semble pas qu’ils eussent été d’accord sur la tactique conseillée par Narbonne. Il est permis de conjecturer que Lameth et Duport ne l’avaient point blâmée. Barnave y était nettement opposé, au contraire ; mais tous se retrouvaient unis pour prévenir toute extension de la guerre, tout conflit entre le roi et l’empereur. C’est à ce moment, quelques jours avant que Barnave quittât décidément Paris, qu’ils rédigèrent ensemble le mémoire envoyé par la reine à l’empereur. Je rappelle le témoignage de Fersen qui est très net à cet égard :
« Mémoire de la reine à l’Empereur, détestable, fait par Barnave, Lameth et Duport ; veut effrayer l’Empereur, lui prouver que son intérêt est de ne pas faire la guerre (8 janvier 1792). »
C’est évidemment le mémoire dont parle Marie-Antoinette dans sa lettre de janvier à son frère Léopold II :
« J’ai une occasion bien sûre d’ici à Bruxelles, et j’en profite, mon cher frère, pour vous dire un mot. Vous recevrez avec celle-ci un mémoire que je suis obligée de vous envoyer, de même que la lettre que j’ai été forcée de vous écrire au mois de juillet. Il y avait aussi une lettre, mais comme elle dit la même chose que le mémoire, je me suis dispensée de l’écrire. Il est bien essentiel que vous me fassiez une réponse que je puisse montrer et où vous ayez l’air de croire que je pense tout ce qui est dans ces deux pièces, précisément comme vous m’avez répondu cet été. »
Pourquoi donc Marie-Antoinette est-elle obligée de transcrire et d’envoyer à l’Empereur les mémoire et lettre rédigés par Barnave, Lameth et Duport ? Elle a intérêt évidemment à ménager les constitutionnels ; mais si sur la question de la guerre ils ne traduisaient pas, au moins à quelque degré, la pensée de la Cour, elle saurait bien en avertir avec précision son frère. Elle décline seulement la responsabilité des vues que contient le mémoire sur la politique intérieure de la France. Ce mémoire n’est pas tout de Barnave, puisqu’il est consacré en partie à justifier la politique de Narbonne, que Barnave n’approuvait pas, mais il est certain qu’il y a collaboré. En dehors du témoignage précis de Fersen, le style même de certains morceaux équivaut à la signature pour ceux qui ont quelque habitude de la manière de Barnave.
« Pour juger sainement des affaires françaises, non seulement il ne faut prêter l’oreille à aucun parti, puisqu’ils sont tous également aveuglés par leur intérêt ou leurs passions ; il ne faut pas mieux espérer que l’on connaîtra l’état des choses par les opinions que l’on entend énoncer. Les opinions en ce moment ne sont ni assez universelles ni assez profondes pour servir d’indications sûres aux hommes qui veulent raisonner en politique. Il faut compter pour beaucoup le caractère français, et cette propriété qu’il a de s’oublier pour des idées générales et abstraites de liberté, patriotisme, gloire, monarchie, etc., en tout, d’obéir à des impulsions soudaines et rapides. Il en résulte qu’il est plus facile de le guider au milieu des événements en disposant avec art les objets de sa haine ou de son affection que de soumettre sa conduite au calcul. »
Et les auteurs du mémoire, après avoir analysé les esprits, tentent de persuader à l’Empereur qu’entre une minorité républicaine et une minorité contre-révolutionnaire il y a une grande majorité de citoyens modérés et paisibles qui reprendront la direction des affaires si la paix est maintenue. Ils manifestent donc l’inquiétude très vive que leur donne l’office de l’Empereur du 21 décembre.
« L’ordre donné au maréchal de Bender de secourir l’électeur de Trêves en cas d’attaque ou d’hostilités imminentes a produit ici le plus fâcheux effet, l’obscurité des motifs allégués pour cette démarche y a beaucoup contribué : on a cru voir que l’empereur renonçait au système de modération et de justice qu’il avait suivi jusqu’à ce moment pour adopter des vues contraires au bonheur et la tranquillité de la France. Personne n’a pensé qu’un prince aussi éclairé pût partager les absurdes craintes de l’électeur de Trêves de se voir attaqué par des municipalités ou des provinces sans l’ordre du roi. On en a généralement conclu que l’Empereur avait saisi ce prétexte pour soutenir les princes et faire approcher ses troupes du territoire français. Un cri général de guerre s’est fait entendre et on ne doute plus ici qu’elle n’ait lieu.
« Mais avant que de s’engager de manière à ne plus pouvoir reculer, il faudrait fixer ses regards sur les malheurs de tout genre et sur les suites de la guerre.
« On conçoit facilement tout le mal qui en résulterait pour la France ; si l’on devait à ce prix voir renaître l’ordre et la prospérité, on pourrait consentir à faire ce terrible sacrifice, mais ce serait cruellement s’abuser que de le penser. Si la guerre a lieu, elle sera terrible ; elle se fera d’après les principes les plus atroces ; les hommes exaspérés, incendiaires, auront le dessus ; leurs conseils prédomineront dans l’opinion. Le roi, dans la nécessité de combattre son beau-frère et son allié, sera environné de défiances, et, pour ne pas les augmenter, il sera obligé de forcer les mesures, d’exagérer ses intentions. Il ne pourra plus employer ni modération ni prudence sans paraître d’accord avec l’empereur et donner ainsi des armes très fortes à ses ennemis, et même à cette partie des honnêtes gens qu’il est toujours si facile de séduire. Les émigrés, comptant sur le secours de l’empereur, deviendront plus obstinés, plus difficiles à réduire, et la querelle s’établissant ainsi entre deux partis extrêmes, les partis modérés, raisonnables et l’intérêt véritable seront aussi oubliés que les principes de l’humanité. »
C’est l’appel désespéré à la paix, c’est le cri d’agonie des constitutionnels, des modérés, qui se sentent définitivement perdus par l’approche de la grande guerre. En quelle mesure la reine s’associait-elle aux pensées qu’elle transcrivait et transmettait ? Il est malaisé de le dire, car le fond de son cœur devait être singulièrement trouble et mêlé. Elle devait redouter la crise de la grande guerre qui allait, si je puis dire, surexciter toutes les passions et tous les périls. Mais elle commençait à sentir aussi que toutes les voies moyennes n’aboutissaient pas, et elle pouvait espérer d’une grande commotion le salut définitif. Ses amis les plus passionnés, comme Fersen, désiraient la guerre. Elle recopiait donc le mémoire de Barnave et de Lameth d’une main à demi machinale, d’une âme à demi consentante, se remettant surtout au hasard des choses. Barnave devina toutes ces fragilités, et il partit pour le Dauphiné, laissant dans les papiers des Tuileries des traces qui lui furent mortelles.
Est-ce ce départ de Barnave qui a donné l’idée qu’entre la Cour et les constitutionnels tout était rompu ? Le journal de Brissot écrit à la date du 10 janvier :
« Le règne des Barnave et des Lameth à la Cour est passé. Ils ont été disgraciés samedi. On assure que le roi a dit : « Ces gens-là, avec leurs conseils, me feraient perdre dix royaumes. »
Ce qui est probable, c’est qu’à mesure que croissaient les chances de guerre et que la politique moyenne des Barnave et des Lameth devenait plus impraticable, la Cour était plus tentée de se séparer d’eux, et la transmission du mémoire à l’Empereur fut le dernier effet de leur influence.

(D’après une estampe de la Bibliothèque nationale.)
Ce n’est pas que dès ce moment la guerre fût certaine. L’Empereur n’était toujours pas décidé à la provoquer, mais elle lui apparaissait comme de plus en plus probable, et malgré ses défiances contre la Prusse, il signait avec elle, le 4 janvier, un traité défensif. Mercy écrivait à la reine le 2 janvier :
« L’électeur de Trêves, intimidé par les menaces de guerre, s’est adressé à l’Empereur pour être secouru. Le monarque a fait remettre une note à l’ambassadeur de France, où il est dit qu’on n’attribue pas au roi le dessein d’attaquer l’Allemagne, que si les factions forçaient la volonté du roi, en ce cas l’Empereur serait obligé de soutenir ses co-États, et que par précaution l’ordre est donné au maréchal de Bender de faire marcher un corps de troupes au secours de l’électeur s’il était attaqué. Tout cela ne change point essentiellement l’état des choses. L’électeur a dit qu’il ne permettrait point de rassemblements chez lui ; on ne lui a pas demandé plus, donc il n’y a pas de motif d’attaquer, mais les princes français voudraient profiter de l’occasion pour entamer la querelle, et en cela ils suivent un faux système, au lieu de laisser à l’Assemblée tout le tort et le blâme dont elle se couvrira en faisant une agression injuste, faute qu’il est clair qu’elle commettra et qui lui attirera le ressentiment de toute l’Europe. Il est donc de bonne politique de tout ramener à ce plan ; cela posé, on croit que l’on ne peut faire mieux que de garder la même contenance et le même maintien jusqu’à ce que ceci prenne un développement décidé. Les nouvelles de Vienne, où sans doute on aura envoyé, traceront une marche certaine. Il est moralement impossible que l’on finisse sans guerre civile ou étrangère ; il est même probable que l’une et l’autre auront lieu en même temps. Quelque critique que soit une pareille chance, elle peut relever le trône plus promptement, plus sûrement que toute autre, et si on ne fait point de fautes, si on s’attire et conserve l’opinion, on se verra en meilleur terrain que l’on n’a jamais été ci-devant. »
Puisque la guerre commençait à paraître inévitable, les conseils de Barnave n’étaient plus pour la Cour qu’un fardeau. Elle le secoua.
On devine que l’office de l’Empereur, communiqué à l’Assemblée le 31 décembre, fournit à Brissot une occasion nouvelle de presser les hostilités, d’engager la Révolution dans la guerre.
Le 17 janvier, dans le débat sur le rapport de Gensonné, il s’écria : « Le masque est enfin tombé, votre ennemi véritable est connu ; l’ordre donné au général Bender vous apprend son nom ; c’est l’Empereur. Les électeurs n’étaient que des prête-noms, les émigrants n’étaient qu’un instrument dans sa main. C’est à la Haute-Cour à venger la nation de la révolte de ces princes mendiants. (Applaudissements dans les tribunes.)
« Cromwell força la France et la Hollande à chasser Charles. Une pareille persécution honorerait trop les princes : saisissez leurs biens et abandonnez-les à leur néant. (Applaudissements.)
« Les électeurs ne sont pas plus dignes de votre colère : la peur les fait prosterner à vos pieds. (Applaudissements.)
« Cependant leur soumission peut n’être qu’un jeu ; mais qu’importe à une grande nation cette hypocrisie de petits princes ? L’épée est toujours dans vos mains et cette épée doit nous répondre de leur bonne conduite pour l’avenir.
« Votre ennemi véritable c’est l’Empereur ; c’est à lui, à lui seul, que vous devez vous attacher ; c’est lui que vous devez combattre. Vous devez le forcer à rompre la ligue qu’il a formée contre vous ou vous devez le vaincre. Il n’y a pas de milieu, car l’ignominie n’est pas un milieu pour un peuple libre. » (Applaudissements.)
Vraiment, à l’heure où nous commençons à pressentir que la guerre est inévitable, que la France y est entraînée par les passions des hommes ou par la force des choses, par l’énervement des esprits et par les manœuvres des partis, à la veille de cette grande et tragique lutte où la Révolution sera aux prises avec tout l’ancien régime et se débattra contre toutes les trahisons, nous voudrions jeter un voile sur les fautes de ses amis, sur les intrigues de ses défenseurs. Mais il est bien difficile de ne pas témoigner quelque impatience à ce langage de Brissot.
Pour attiser les passions guerrières, pour surexciter l’orgueil et la colère, tous les moyens lui sont bons et les contradictions les plus impudentes ne l’effraient pas. Ce qu’il dit, en cette séance du 17 janvier, est exactement le contraire de ce qu’il disait en octobre, en décembre et même au commencement de janvier. Alors, pour rassurer la France, pour la prendre doucement dans l’engrenage, il disait : « Nous avons affaire aux électeurs, aux émigrés : l’Empereur veut la paix : il a besoin de la paix. »
Maintenant que les électeurs dispersent les émigrés, Brissot s’écrie : « Que vous importent les électeurs, que vous importent les émigrés ? C’est l’Empereur qui est votre ennemi, c’est l’Empereur qu’il faut combattre. » C’est le parti pris presque cynique de la guerre, c’est la guerre à tout prix. Je serais presque tenté de dire que la seule excuse de la Gironde est précisément dans la grossièreté de ses artifices. Pour qu’ils aient réussi, il faut que la nation éprouvât je ne sais quel besoin profond de dissiper par une action décisive toutes les inquiétudes et tous les cauchemars. Mais dans cette impatience nerveuse qui livre la France aux sophismes presque outrageants, aux contradictions presque méprisantes de Brissot, je trouve, à cette date, plus de débilité que de grandeur.
Vergniaud couvrit d’un beau langage, et d’une sorte de noble passion oratoire, les roueries politiciennes et belliqueuses de Brissot.
« Je ne vous parlerai pas de l’inquiétude vague qui tourmente les esprits, de l’anxiété qui fatigue les cœurs, du découragement qui peut naître dans les âmes faibles des longues angoisses de la Révolution. Je ne vous dirai point qu’on emploiera tous les moyens de séduction pour faire dévier les citoyens de la route du patriotisme.
« De toute part, vous marchez sur une lave brûlante, et je veux croire que vous n’avez pas d’éruptions violentes à redouter. Mais je dirai : on a juré de maintenir la Constitution parce qu’on s’est flatté qu’on serait heureux par elle. Si vous laissez les citoyens livrés sans cesse à des inquiétudes déchirantes, à des convulsions continuelles, si vous permettez que leurs ennemis les rendent trop longtemps malheureux ; si vous laissez établir l’opinion que ces malheurs ont leur source dans la Révolution, n’aurez-vous pas à redouter, alors, que chaque jour n’éclaire une nouvelle défection de la cause des peuples ?…
« Or, cet état d’incertitude et d’alarmes, ces présages cruels sont, ce me semble, mille fois plus effrayants, plus terribles que l’état de guerre. Sans doute, la guerre traîne après elle de grandes calamités ; elle peut même conduire à des fautes désastreuses ; mais enfin pour un peuple qui ne veut pas de l’existence sans la liberté, elle peut aussi conduire à la victoire, et, par elle, assurer une paix tranquille et durable. Au contraire, l’état dans lequel on voudrait vous faire rester est un véritable état de destruction qui ne peut vous conduire qu’à l’opprobre et à la mort. (Vifs applaudissements.)
« Aux armes donc, aux armes ; c’est le salut de la patrie et l’honneur qui le commandent ; aux armes donc, aux armes ; ou bien, victimes d’une indolente sécurité, d’une confiance déplorable, vous retomberez insensiblement et par lassitude sous le joug de vos tyrans ; vous périrez sans gloire, vous ensevelirez avec votre liberté l’espoir de la liberté du monde ; et, devenus par là coupables envers le genre humain, vous n’aurez même pas la consolation d’obtenir sa pitié dans vos malheurs. » (Vifs applaudissements.)
C’est bien, en effet, une sorte d’angoisse, la peur de s’enliser qui fit faire à la Révolution un grand bond vers la guerre.
Vergniaud demande la rupture définitive du traité d’alliance conclu avec l’Autriche et sur lequel reposait, depuis 1756, toute la politique de la royauté. « L’Europe, dans ce moment, a les yeux fixés sur nous. Apprenons-lui enfin ce qu’est l’Assemblée nationale de France. (Bravo ! Bravo ! Vifs applaudissements.) Si vous vous conduisez avec l’énergie qui convient à un grand peuple, vous obtiendrez ses applaudissements, son estime, et les alliances viendront d’elles-mêmes s’offrir à vous. Si au contraire vous cédez à des considérations pusillanimes, à des ménagements honteux ; si vous négligez l’occasion que la providence semble vous offrir pour rompre des liens avilissants ; si, lorsque la nation a secoué le joug de ses despotes intérieurs, vous consentez, vous, ses représentants, à la tenir dans l’asservissement d’un despote étranger, j’oserai vous le dire, redoutez la haine de la France et de l’Europe, le mépris de votre siècle et de la postérité. » (Bravo ! Bravo ! Vifs Applaudissements.)
Oui, mais où était, dans les faits, l’action de ce despotisme extérieur ? et était-ce là vraiment l’obstacle où se heurtait la Révolution ?
«…Démosthènes, tonnant contre Philippe, disait aux Athéniens : Vous vous conduisez à l’égard du roi de Macédoine comme les barbares se conduisent dans nos jeux. Les frappez-vous au bras, ils portent la main au bras, les frappez-vous à la tête, ils portent la main à la tête. Ils ne songent à se défendre que lorsqu’ils sont blessés ; jamais leur prévoyance ne va jusqu’à parer le coup ; ainsi, vous, Athéniens, si l’on vous dit que Philippe arme, vous armez, qu’il désarme, vous désarmez ; qu’il menace un de vos alliés ; vous envoyez une armée pour défendre cet allié ; qu’il menace une de vos villes, vous envoyez une armée au secours de cette ville ; en sorte que vous êtes aux ordres de Philippe, c’est votre ennemi qui est votre général.

Après avoir longtemps gouverné les Gallères
Maintenant il voudrait gouverner les affaires.
Image contre-révolutionnaire.
(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
« Et moi aussi, s’il était possible que vous vous livrassiez à une dangereuse sécurité, parce qu’on vous annonce que les émigrés s’éloignent de l’électorat de Trêves ; si vous vous laissez séduire par des nouvelles insidieuses ou des faits qui ne prouvent rien, ou des promesses insignifiantes ; et moi aussi, je vous dirai : vous apprend-on qu’il se rassemble des émigrés à Worms et à Coblentz, vous envoyez une armée sur les bords du Rhin ; vous dit-on qu’ils se réunissent dans les Pays-Bas, vous envoyez une armée en Flandre ; vous dit-on qu’ils s’enfoncent dans le sein de l’Allemagne, vous rappelez vos soldats dans vos foyers.
« Publie-t-on des lettres, des offices dans lesquels on vous insulte ? Alors votre indignation s’excite et vous voulez combattre. Vous adoucit-on par des paroles flatteuses, vous leurre-t-on de fausses espérances, alors votre courroux, docile aux insinuations, se calme : vous songez à la paix. Ainsi, Messieurs, ce sont les émigrés et Léopold qui sont vos chefs. Ce sont eux qui règlent tous vos mouvements. Ce sont eux qui disposent de vos citoyens, de vos trésors, ils sont les arbitres de votre repos, ceux de votre destinée. » (Bravo ! Bravo ! Applaudissements réitérés.)
J’ai presque honte de paraître, commentateur attardé, épiloguer sur ces paroles passionnées, d’où sont sortis des événements passionnés. À quoi sert-il que je coure auprès de ce char de feu en répétant : Prenez garde ! Quel démon d’aventure vous emporte ? Le char éblouissant et terrible, char de la liberté et de la guerre, de la lumière et de la foudre, suit son chemin. Si bientôt le dieu, à force de manier le glaive, devient César et si les peuples éblouis, hébétés par tous les éclairs de la guerre, ne sont plus qu’une immense foule d’esclaves aveugles, cela empêchera-t-il que la Gironde ait bien parlé ? Pourtant s’il reste encore en ces heures ardentes quelque droit à l’esprit critique et à la raison, comment Vergniaud se scandalise-t-il que les précautions que prend un peuple libre soient adaptées aux mouvements mêmes de la réalité ?
Il paraît que se prémunir contre un péril incertain et variable, c’est être l’esclave de ce péril. Il paraît que, pour se délivrer de cet esclavage, il faut aller tout droit au péril lui-même, éveiller la guerre endormie pour n’avoir pas à en surveiller le sommeil.
« Messieurs, dit en terminant l’abondant et noble orateur, une grande pensée s’échappe en ce moment de mon cœur, et c’est par elle que je finirai. Il me semble que les mânes des générations qui dorment dans le tombeau se pressent dans ce temple ; qu’ils vous adjurent par les maux que leur fit souffrir l’esclavage d’en préserver par votre énergie les générations futures ; exaucez ce vœu de l’humanité si longtemps opprimée. Soyez pour l’avenir une providence généreuse. Osez vous associer à la justice éternelle ; sauvez la liberté des efforts des tyrans ; vous serez tout à la fois les bienfaiteurs de votre patrie et ceux du genre humain. »
Il est singulier qu’il ne se soit élevé aucune voix à la Législative, pas même celle de Couthon, pour soutenir la thèse de Robespierre, pour protester contre la guerre au nom de la démocratie et de la Révolution. Seuls des modérés résistèrent. Mathieu Dumas déclara avec force qu’il n’y avait point de raison solide de faire la guerre, que « c’était empoisonner l’avenir que prendre pour une rupture formelle le dernier office de l’empereur ». Il attaque les amis de Brissot qui « paraissent redouter que des démarches satisfaisantes, que des actes sincères, qu’une paix solide ne leur enlèvent leur chimère ».
« Il ne faut pas, ajoute-t-il, que le peuple abusé voie dans ce vœu terrible une mesure de patriotisme ; son courage n’a pas besoin d’être excité ; vouloir ou ne vouloir pas la guerre, sont deux choses également absurdes ; il faut la faire si pour le maintien de la Constitution elle est inévitable ; mais il ne faut pas la rendre inévitable pour la faire. »
Mais que pouvait ce calme langage ? Daverhoult, qui avait poussé, comme nous l’avons vu, aux premières démarches vigoureuses contre les émigrés et les électeurs et qui avait ainsi ouvert les voies de la guerre générale, s’effraie maintenant des vastes plans belliqueux de la Gironde et il les dénonce avec force et précision.
« Si donc j’ai prouvé que cette ligue des princes n’est que défensive, qu’il dépend de nous seuls de déjouer par nos opérations intérieures les desseins de ceux qui voudraient modifier notre constitution dans un congrès, s’il n’est pas moins prouvé que tous les princes ont besoin de la paix, et déjà ils vous en ont donné la preuve en dispersant les attroupements qui portaient atteinte à votre tranquillité intérieure, que deviennent alors les phrases de ceux qui voudraient vous exciter à faire une guerre injuste ?
« Ce n’est pas devant vous, et dans une discussion où il s’agit du salut de la chose publique que je sais composer avec la vérité.
« L’on vous induit en erreur lorsque, bâtissant sur des hypothèses et en vous circonvenant de vaines terreurs, l’on veut vous engager à attaquer l’Empereur pour forcer cette ligue de princes à prendre le caractère offensif ; car, la déclaration que le traité de 1756 est rompu et la satisfaction qu’on demande équivalent à une déclaration de guerre. C’est donc par une misérable équivoque qu’on a opposé, dans cette tribune, la dignité de la nation française à celle d’un seul homme couronné. Tant que les nations nos voisines n’auront pas changé leur gouvernement, l’homme qui est à leur tête est leur représentant de fait, et sa dignité devient la dignité nationale.
« Je ne vous répéterai pas que le traité avec l’Autriche vous est onéreux, toute la France le sait : il est inutile d’en donner des preuves, et ce n’est pas ici qu’on doit débiter des lieux communs ; mais ce qui est digne de votre attention, c’est d’examiner si c’est dans l’instant où vous n’avez aucun autre allié, où toutes les liaisons entre les différentes cours sont formées, que vous devez, non seulement rompre ce traité, mais forcer Léopold à la guerre, sur l’espoir douteux que d’autres puissances formeront des traités avec vous.
« Est-ce d’après des données aussi incertaines que nous devons agir, messieurs, lorsqu’il s’agit du salut public ? et, s’il m’est permis de me servir d’une phrase aussi triviale, est-ce en bâtissant des châteaux en Espagne que nous défendrons la liberté et la constitution française ?
« Ne vous le dissimulez pas, l’Empereur et la Prusse qui, seuls, ont cinq cent mille bayonnettes à leurs ordres resteront unis et seront forts de l’alliance de toutes les autres puissances quand la guerre sera injuste de votre part et qu’elle ne sera pas nécessitée aux yeux de tous les peuples par la conduite de ces mêmes puissances.
« L’on vous a donné l’exemple de l’Angleterre, mais l’on ne vous a pas dit que, supérieure sur mer à toutes les autres puissances, elle n’avait rien à craindre pour elle-même par sa position. L’on vous a cité Charles XII, mais l’on vous a passé Pultawa sous silence.
« Messieurs, soyons vrais ; les amis de la liberté voudraient venir au secours de la philosophie outragée par la ligue des princes, ils voudraient appeler tous les peuples à cette liberté, et propager une sainte insurrection ; voilà le véritable motif des démarches inconsidérées qu’on vous propose. Mais devez-vous laisser à la philosophie elle-même le soin d’éclairer l’univers, pour fonder, par des progrès plus lents mais plus sûrs, le bonheur du genre humain et l’alliance fraternelle de tous les peuples ? ou bien devez-vous, pour hâter ces effets, risquer la perte de votre liberté et celle du genre humain, en proclamant les droits de l’homme au milieu du carnage et de la destruction ?
« Cette entreprise ne sera noble, grande, digne de vous, que lorsque, provoqués à une guerre devenue juste et nécessaire, l’attaque sera le seul moyen de défense, lorsqu’en vous constituant en état de guerre effective, vous pourrez prouver à l’univers entier, qui vous contemple, et à la France, qui vous a confié ses plus chers intérêts, que c’est pour maintenir sa Constitution, dont vous êtes les gardiens, que vous allez confier son sort et le sang de vos frères au hasard des combats.
« Laissons donc à la philosophie le soin d’éclairer l’univers et si l’aveuglement de cette ligue des princes devance l’heure qui a été marquée de toute éternité pour fonder le seul empire durable, celui de la raison, plaignons le sort de l’humanité souffrante, qui alors ne verrait luire ces beaux jours qu’après un orage aussi terrible. »
Le discours de Daverhoult porta, et Brissot se crut obligé de lui répondre par une note du Patriote Français (26 janvier).
« M. Daverhoult a rejeté mon projet, parce que, dit-il, il porte sur une fausse hypothèse de ligue entre diverses puissances contre la France. Je réponds : 1o que ce n’est point une hypothèse, que la ligue est prouvée par les différents actes que j’ai rapportés.
« 2o Je dis que mon système roule sur ce dilemme : ou l’Empereur veut nous attaquer ou il ne veut que nous effrayer : dans le premier cas il faut le prévenir ; dans le second, le forcer à reculer.
« Ni M. Daverhoult ni les orateurs qui m’ont attaqué n’ont répondu à ce dilemme. »
La réplique de Brissot était pitoyable. D’abord il n’avait pas démontré du tout l’existence d’une ligue offensive. Et puis, cette prétention d’enfermer dans un dilemme la réalité mouvante et multiple du monde était odieusement ridicule. La vérité est que l’Empereur était pris entre des forces très divergentes et des exigences très opposées. Il souffrait des périls de sa sœur, mais il ne voulait pas déclarer la guerre à l’aventure. Ses sentiments fraternels, le point d’honneur monarchique lui conseillaient d’intervenir, mais son intérêt politique lui conseillait l’abstention. Et il manœuvrait pour concilier ces nécessités contraires. Il pouvait donc dépendre de la France elle-même et de l’Assemblée que l’esprit de Léopold inclinât enfin d’un côté plutôt que de l’autre ; et la rouerie pédantesque et plate de Brissot enfermant dans les branches grêles d’un dilemme la formidable question de la paix ou de la guerre et l’avenir même de l’humanité libre apparaît, dans cette note, d’une façon bien déplaisante.
En fait, dans tout le débat, une seule parole vraie et profonde avait été dite, c’est celle de Vergniaud, signalant l’état d’anxiété, d’angoisse qui poussait le pays à brusquer une décision, il fallait obliger la maladie « à se déclarer ». Mais nul, dans l’Assemblée, n’avait eu le courage de dire : Cette angoisse, d’où nous vient-elle ? Est-ce du dehors ou du dedans ?
En fait, ce sont les rapports de la Révolution et de la Royauté traîtresse, sournoise, paralysante, qui auraient dû être abordés.
La Législative a fui le problème terrible : elle s’est réfugiée dans la guerre immense, comme un homme obsédé se réfugie dans la tempête pour étourdir un souci qu’il ne peut chasser, pour calmer l’énervement d’un doute insoluble. Et le médiocre Méphistophélès de la Gironde a guetté cette heure de lassitude intime de la Révolution pour lui faire conclure un pacte de guerre.
Au moment où j’écris le monde entier est encore lié par ce pacte. Quand donc l’humanité socialiste le brisera-t-elle ?
Il est tellement fort et il a si étroitement lié, depuis plus d’un siècle, les consciences et les esprits, que même les plus hauts penseurs, même ceux qui ont un grand cœur pacifique et fraternel ne semblent pas concevoir que la Révolution ait pu être séparée de la guerre.
En cette même séance du 17 janvier, Condorcet, n’essayant même pas d’appuyer Daverhoult et de s’opposer aux démarches irréparables, s’ingénie seulement à épurer la guerre de toute pensée trop grossière de conquête, et à la restreindre. Il croit qu’une diplomatie franchement révolutionnaire pourrait aisément nouer des alliances, surtout avec l’Angleterre, et il demande que le pouvoir exécutif renouvelle tout son personnel de représentants au dehors.
Plus tard, le noble et doux communiste Cabet, écrivant, en 1832, un chapitre sur la Révolution française, ne se pose même pas le problème. Il ne semble pas soupçonner qu’une autre politique fût possible que celle des Feuillants, royaliste et pacifique, ou celle des Girondins, révolutionnaire et belliqueuse.
« Cependant les patriotes, qui reçoivent chaque jour des avertissements et que mille apparences inquiètent et effraient, se demandent sans cesse : Mais le roi ne nous trahit-il pas ? L’étranger n’a-t-il pas résolu la guerre ?
« Les constituants et les modérés, réunis dans le club des Feuillants (doctrinaires et juste-milieu d’alors), voulant concentrer tout le pouvoir dans la bourgeoisie, redoutant le peuple proprement dit, croient ou feignent de croire à la sincérité de Louis XVI, ou du moins se flattent que la douceur et les concessions vaincront enfin ses répugnance pour la Révolution ; ils prétendent que les rois craignent la France bien plus qu’elle ne doit les craindre elle-même ; que c’est pour mieux surtout que la paix est un besoin impérieux ; que leurs menaces ne sont que des fanfaronnades ; que leurs préparatifs sont purement défensifs ; qu’il faut éviter toutes les mesures qui pourraient les inquiéter ; et qu’on évitera la guerre si la Révolution est sage. Leur devise est légalité, constitution, confiance, modération et paix.
« Louis XVI choisit ses ministres parmi eux, mais il conspire avec ceux qui veulent se rendre ses complices et trompe les autres ; il leur cache ses correspondances particulières, les résolutions hostiles des étrangers, leurs préparatifs d’attaque et même leur marche vers nos frontières.
« D’un autre côté, il invoque sans cesse une constitution qui lui donne assez de pouvoir pour qu’il puisse trouver moyen de la renverser…
« Les autres, en beaucoup plus grand nombre, parmi lesquels se trouvent les fameux Girondins, le duc d’Orléans et son fils, réunis dans le club des Jacobins, sont convaincus que Louis XVI ne se résignera jamais à la diminution de son ancienne autorité ; qu’il conspire contre la Constitution ; qu’il s’entend avec l’émigration et avec l’étranger ; que l’intérêt des rois est d’étouffer la Révolution ; qu’ils veulent non seulement rétablir le pouvoir absolu, mais surtout démembrer le royaume ; que leurs préparatifs sont hostiles ; que la guerre est inévitable ; que le danger est imminent et pressant ; enfin, que le salut public exige qu’on se prépare à la guerre, et qu’on fasse expliquer catégoriquement les gouvernements étrangers sur leurs intentions et leurs projets. »
Ce tableau tracé par Cabet serait admirable en sa brièveté si, à propos de la question de la guerre, il n’y avait, quelques traits inexacts et brouillés, et aussi une singulière lacune. Ce ne sont pas les modérés tout d’abord, ce ne sont pas les Feuillants qui ont voulu persuader au pays que les souverains étrangers veulent la paix, et ont peur de la France. C’est la Gironde, c’est Brissot. Et c’est Brissot aussi qui combat la « défiance ».
Il n’est pas vrai non plus que les modérés se soient tous et systématiquement opposés à la guerre, à toute guerre. Sous l’inspiration de Narbonne, de madame de Staël et même de quelques-uns des anciens constituants, ils ont voulu tenter l’aventure.
Enfin, Cabet oublie complètement et semble même ignorer l’immense effort de Robespierre, du journal de Prudhomme, d’une très notable partie des Jacobins pour ne se livrer ni à la Cour ni à la Gironde, ni au modérantisme ni à la guerre, et pour diriger vers la démocratie et la paix le torrent des forces révolutionnaires.
Dans la tradition révolutionnaire, dans l’image un peu déformée que se transmettent les générations, la guerre et la Révolution sont liées. Et c’est, si je puis dire, cette superposition d’image qui, plus d’une fois, permit aux républicains et aux bonapartistes de marcher d’accord contre les menaces et les retours offensifs de l’ancien régime.
Chose curieuse. L’ardent robespierriste Laponneraye, qui connaissait à fond la vie de Robespierre, dont il a édité les œuvres, dans les leçons populaires qu’il faisait, en 1831, sur l’histoire de la Révolution, n’a pas même signalé les grands efforts de Robespierre pour maintenir la paix. Il signale pourtant, avec une clairvoyance aiguisée par la haine, la duplicité des Girondins dans la préparation de la guerre. « Il ne manquait plus au triomphe des Girondins que de compromettre le roi avec l’Europe, et de le mettre dans la nécessité de faire la guerre aux despotes conjurés pour le rétablir dans ses anciennes prérogatives : ils l’entreprirent et le succès couronna leurs efforts… Cependant il était encore possible au ministère de Louis XVI (en avril) de prévenir les hostilités sans déshonneur ; il aima mieux les entreprendre…
« Le gant est jeté, la lice est ouverte, les partis vont se précipiter l’un contre l’autre. Une lutte sanglante va s’engager pour vingt-cinq ans ; pendant un quart de siècle l’Europe roulera contre la France, la France roulera contre l’Europe, débordera sur l’Europe, et ce duel d’un peuple contre vingt peuples, d’une nation contre un monde entier, se terminera par une invasion honteuse que l’un des plus grands capitaines de l’époque aura value à notre malheureuse patrie.
« D’abord défensive, la guerre deviendra offensive, car il n’est pas dans notre caractère d’attendre l’ennemi derrière des retranchements ; c’est au pas de charge et la bayonnette en avant que les Français se battent. Juste, légitime et toute de propagande, tant qu’elle soutiendra les intérêts de la Révolution, cette guerre, quelques années plus tard, deviendra inique, conquérante, spoliatrice, quand un soldat ennemi de la liberté s’en sera emparé pour la faire servir à ses projets ambitieux. »
Voilà comment, en 1831, un robespierriste exalté, qui adorait son héros comme un saint, résumait le grand drame de révolution et de guerre dont nous cherchons en ce moment les origines. Il n’est point dupe de la manœuvre girondine, et il ne croit pas que la guerre fût inévitable ; mais comme cette indication est discrète et timide ! comme il néglige, de peur sans doute de scandaliser les ouvriers qui l’écoutaient, de signaler la lutte, si glorieuse pourtant, que soutint Robespierre contre les entraînements belliqueux ! Et il semble accepter cette « guerre de propagande » à laquelle Robespierre opposait de si fortes objections.
Ainsi, le torrent éblouissant et trouble où la Gironde a mêlé les flots de la Révolution et les flots de la guerre s’est creusé un lit jusque dans la conscience de roc des montagnards et de leurs héritiers.
C’est peut-être parce que la paix, l’harmonie internationale, nous apparaît à nous comme une condition absolue de l’avènement prolétarien et de la révolution sociale que nous portons jusque dans le passé, jusque dans la révolution de la démocratie bourgeoise ce parti pris de paix.
Ce serait fausser le sens de l’histoire que de substituer notre sensibilité à celle des hommes de 92, mais en signalant ce qu’il y eut dès lors, dans la politique belliqueuse, d’intrigues, de sophismes et d’obscur énervement, nous préserverons peut-être les générations nouvelles des déclamations héroïques et vaines qui ne propagent plus que les haines ineptes ou basses et l’esprit de réaction.
Comme conclusion à tous ces débats de janvier, l’Assemblée rendit dans la séance du 25, un décret qui ressemblait vraiment à une déclaration de guerre :
I. — « Le roi sera invité, par un message, à déclarer à l’empereur qu’il ne peut désormais traiter avec aucune puissance qu’au nom de la nation française, et en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la Constitution.
II. — « Le roi sera invité à demander à l’empereur si, comme chef de la maison d’Autriche, il entend vivre en paix et en bonne intelligence avec la nation française, et s’il renonce à tout traité et convention dirigés contre la souveraineté, l’indépendance et la sûreté de la nation.
« III. — Le roi sera invité à déclarer à l’empereur qu’à défaut par lui de donner à la nation avant le 1er mars prochain, pleine et entière satisfaction sur les points ci-dessus rapportés, son silence, ainsi que toute réponse évasive et dilatoire, seront regardés comme une déclaration de guerre.
« IV. — Le roi sera invité à continuer de prendre les mesures les plus promptes pour que les troupes françaises soient en état d’entrer en campagne au premier ordre qui leur en sera donné.
« L’Assemblée nationale charge son comité diplomatique de lui faire incessamment son rapport sur le traité du 17 mai 1756. »
Comme pour souligner le sens guerrier de ce décret, le maréchal de Rochambeau, commandant d’un des trois corps, prit séance ce même jour à l’Assemblée. Il lui demanda diverses mesures d’ordre militaire, et il termina par ces mots chaleureusement applaudis : « J’espère, messieurs, que par le fruit de vos déclarations, vous voudrez bien aider et soutenir le zèle qui anime, pour le service de l’État, une vieillesse plus que sexagénaire, et l’âme encore brûlante d’un corps épuisé. » Le souffle héroïque et chaud de la Révolution rajeunissait les corps et les âmes.

Image contre-révolutionnaire.
(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Quel effet produisit ce décret de l’Assemblée sur la Cour de France, sur l’empereur d’Autriche, sur les ministres de Louis XVI ? Il est clair que la guerre apparut à tous infiniment plus probable et plus proche. Mais rien de décisif ne jaillit encore. Mercy, averti par les débats de l’Assemblée, commence à prévoir la guerre, et il organise, d’accord avec la reine, un service d’espionnage. « Ce qui s’est passé à l’Assemblée, écrit-il à la reine le 24 janvier, justifie l’opinion que l’on a eue à Vienne de l’inutilité et même des inconvénients d’un Congrès. Il paraît que le moment approche où les Cours s’expliqueront entre elles d’une manière précise ; on doit en être informé incessamment. Si la guerre éclate, il sera bien important que l’on sache, aux Tuileries, les mouvements de chaque jour et les intrigues de tous les partis. Il faudrait, à cet effet, des observateurs bien intelligents et actifs. On croit avoir des preuves que… y serait très propre. Par son canal, on établirait un concert de notions et de mesures ; sans cet accord, bien des choses essentielles échapperont. On supplie de faire attention à cette remarque. » C’est la trahison royale qui se précise.
Mais, malgré l’attitude tous les jours plus agressive de l’Assemblée, malgré même le décret, l’empereur hésite encore. Il est vivement préoccupé de ses grands desseins en Pologne. Depuis des années, il manœuvrait pour soustraire la Pologne à l’influence russe et prussienne, pour la sauver de l’anarchie et pour y installer une monarchie héréditaire, alliée à l’Autriche et sur laquelle celle-ci aurait une grande autorité morale. Le 3 mai 1791, une révolution dans ce sens s’était opérée en Pologne, sous la conduite du roi Stanislas, enfin acquis aux vues de Léopold II. Le droit de veto, c’est-à-dire le droit reconnu à tout noble d’arrêter, par sa seule opposition, toute décision de la Diète, fut aboli.
Des garanties furent données aux paysans, des droits politiques furent accordés à la bourgeoisie, et un système de deux Chambres fut institué. Le ministère devait gouverner au nom d’une monarchie héréditaire. Et c’est dans la maison de l’Électeur de Saxe, alliée à la maison d’Autriche, que la couronne de Pologne devait être fixée. Ainsi, la Pologne et la Saxe réunies, associées, constituaient en Allemagne, contre la Prusse et la Russie, une force de premier ordre, et l’influence de l’Autriche dans le monde était singulièrement accrue : la Prusse ne pouvait plus lui arracher l’Allemagne. La Russie ne pouvait plus contrarier ses progrès en Turquie. On devine qu’il était cruel à Léopold II de renoncer à ce plan magnifique pour entreprendre une guerre onéreuse et périlleuse contre la Révolution.
Il lui était cruel de négocier avec la Prusse une entente contre la France, et de se condamner par là même à abandonner ses desseins en Pologne que la Prusse ne pouvait tolérer. Aussi, s’efforçait-il encore d’ajourner tout au moins la rupture avec la France, et le mémoire qu’il adressa à Marie-Antoinette le 31 janvier, répond certainement à ses pensées. Bien que la reine lui eût écrit d’envoyer une réponse « qu’on pût montrer », il est clair que c’est bien la politique de l’empereur lui-même qui s’exprime dans ce mémoire : « 31 janvier 1792. Très chère sœur, je crois ne pouvoir mieux témoigner ma tendre amitié pour vous et pour le roi, en ces moments critiques, qu’en vous ouvrant mes sentiments sans la moindre réserve. Je m’en acquitte avec la plus entière cordialité par ce mémoire que je vous envoie pour servir de réponse à celui que vous m’avez fait parvenir par le canal du comte de Mercy. Charmé de voir que nos idées et nos vues se rencontrent dans les points les plus essentiels, je ne puis que bien augurer de l’issue ; elle sera à la fois tranquille et heureuse si elle répond aux vœux que me dicte l’attachement vif et éternel avec lequel je vous embrasse. »
Léopold II expose d’abord le plan de révision constitutionnelle qui, selon lui, devrait être appliqué : « Les imperfections de la nouvelle Constitution française rendent indispensable d’y acheminer des modifications pour lui assurer une existence solide et tranquille. L’empereur applaudit à cet égard à la sagesse des bornes que Leurs Majestés Très Chrétiennes mettent à leurs désirs et à leurs vues. »
« Le rétablissement de l’ancien régime est une chose impossible à exécuter, inconciliable avec la prospérité de la France. Le renversement des bases essentielles de la Constitution serait incompatible avec l’esprit actuel de la nation et exposerait aux derniers malheurs. Lier cette Constitution avec les principes fondamentaux de la monarchie est le seul but auquel on peut raisonnablement viser. »
« Les objets compris dans ce but sont tracés avec la précision la plus satisfaisante dans le mémoire envoyé par la reine. Conserver au trône sa dignité et la convenance nécessaire pour obtenir le respect et l’obéissance aux lois ; assurer tous les droits, accorder tous les intérêts ; et, regardant comme objets accessoires les formes du régime ecclésiastique, judiciaire et féodal, rendre toutefois, dans la Constitution, à la noblesse un élément politique qui lui manque, comme partie intégrante de toute monarchie. Ces points d’amendement renferment tout ce qu’il est nécessaire de vouloir… »
« Il y a quatre mois que l’empereur partageait l’espoir que le temps, aidé de la raison et de l’expérience, suffirait seul pour réaliser les amendements. Les communications secrètes ci-jointes prouveront la bonne foi avec laquelle il seconda, sur cet espoir, la détermination du roi et de la reine et qu’il ne tint point à ses soins que les mêmes vues n’aient été adoptées par toutes les Cours (elles l’ont toutefois été par la plupart, et même par toutes, eu égard à l’effet), ainsi que par les frères du roi et par les émigrés.
« Ce n’est pas que l’empereur ne persiste encore à croire que le but devra et pourra être rempli sans troubles et sans guerre, car il est intimement convaincu que rien de solide ne pourra être effectué qu’en se conciliant la volonté et l’appui de la classe la plus nombreuse de la nation, composée de ceux qui voulant la paix, l’ordre et la liberté sont aussi fortement attachés à la monarchie ; mais parce qu’ils ne sont pas tous parfaitement d’accord, parce qu’ils sont lents à se mouvoir et à se déterminer, parce que leur attachement à la Constitution est plus obstiné qu’éclairé, tout porte l’empereur à craindre que cette même classe de gens, abandonnée à elle-même, ou se laissera toujours maîtriser, ou que ses bonnes intentions seront prévenues et rendues infructueuses par le parti républicain, dont le fanatisme dans les uns et la perversité des autres supplée au nombre par une énergie d’activité, d’intrigues et de mesures fermes et concertées, qui doit nécessairement l’emporter sur le découragement, la désunion ou l’indifférence des premiers. Plus les chefs (si bien caractérisés dans le mémoire) qui dirigent ce parti sentent que le temps et le calme anéantiront leur crédit, plus ils se livrent à des mesures désespérées et violentes, et cherchent d’entraîner la nation à des extrémités irrémédiables pour subvenir, par un fanatisme universel, à la détresse des ressources et à l’insuffisance des moyens constitutionnels. »
« Telle est la vraie source de la crise actuelle. C’est par un dessein prémédité de réchauffer le zèle révolutionnaire de la nation que les rassemblements des émigrés, qui n’arrivaient pas en somme totale à quatre mille hommes et qu’il était facile de contenir par des mesures analogues à l’insignifiance du danger, ont servi de prétexte à un armement de cent cinquante mille hommes rassemblés en trois armées sur les frontières de l’empire germanique. Au lieu des ménagements dus à la conduite modérée de l’empereur qui venait d’y mettre le comble par le désarmement des émigrés aux Pays-Bas, au lieu de se réconcilier des princes de l’empire qu’on a dépouillés au fond contre la teneur des traités, on force l’empereur et l’empire, par des déclarations impérieuses et menaçantes et par des armements excessifs, à pourvoir de leur côté à la sûreté de leur frontière et à la tranquillité de leur État…
« Les vœux des pervers qui ont amené ces extrémités seraient comblés si l’empereur, ulcéré par une telle conduite et désespérant absolument du succès des moyens conciliants, se laissait entraîner à des projets de rupture, épousant hautement la cause des émigrés, et se réunissant avec ceux qui désirent une contre-révolution parfaite. Ils attendent sans doute avec impatience ce moment pour accabler le parti modéré, et pour précipiter la nation, par des mesures violentes, dans ce nouvel état de choses pire que l’état actuel et accompagné de maux sans nombre qu’il n’y aura plus moyen d’empêcher ni de changer.
« L’empereur préservera, s’il est possible, la France et l’Europe entière d’un tel dénouement. Il augmentera d’abord ses forces de l’Autriche antérieure d’environ six mille hommes, puisque ce moyen est indispensable, quand on ne considérerait que l’esprit d’insurrection qui germe déjà dans les contrées de l’Allemagne qui bordent le Rhin. Il concourra à des armements plus considérables encore et proportionnés à ceux de la France, puisque ces derniers compromettent immédiatement la sûreté et l’honneur de l’empire germanique et le repos des Pays-Bas. Mais, renfermant le but de ces mesures dans les motifs de défensive et de précaution qui en rendent l’emploi nécessaire, bien loin d’abandonner et contredire les principes sages et salutaires dont il partage la conviction avec le roi et la reine, il tournera tous ses soins à les combiner avec les mesures dont il s’agit, et à les faire adopter également par toutes les Cours qui prendront part au nouveau concert, en proposant pour bases essentielles de celui-ci, et pour condition sine qua non de son concours :
« Que la cause et les prétentions des émigrés ne seront point soutenues ; qu’on ne s’ingérera dans les affaires internes de la France par aucune mesure active, hors le cas que la sûreté du roi et de sa famille soit compromise par de nouveaux dangers évidents, et qu’on ne visera enfin dans aucun cas à un renversement de la Constitution, mais se bornera à en favoriser l’amendement d’après les principes ci-dessus et par des voies douces et conciliantes. »
Ainsi, à la fin de janvier encore, l’empereur d’Autriche désirait la paix et s’obstinait à l’espérer. Il est vrai que le plan de Constitution semi-aristocratique qu’il prévoit est absolument chimérique et rétrograde. Mais, comme il ne veut point intervenir pour l’imposer, qu’importe à la France ? qu’importe à la Révolution ?
Il est vrai encore qu’il annonce qu’il interviendra si la « sûreté » de Louis XVI et de Marie-Antoinette est évidemment en péril. Mais il lui était vraiment malaisé de tenir à sa sœur un autre langage. Et non seulement il ne veut point de la guerre mais, selon les vues des constitutionnels, il tente de persuader au roi et à la reine de France que la guerre les perdrait.
Mais qu’est-ce à dire ? Est-ce que nous admettons un instant que la Révolution devait tolérer une intervention quelconque, même pacifique, même conciliante, de l’étranger dans ses affaires intérieures ? Non, non ; qu’il n’y ait pas de malentendus : le premier devoir de la Révolution, la condition du salut et de la vie même, c’était d’affirmer qu’elle voulait se développer librement, évoluer à son gré, et que ni menace ni conseil ne la détourneraient de sa voie. Mais la Gironde jetait la Révolution sur l’étranger, sur l’empereur, au moment même où celui-ci se refusait précisément à toute intervention.
Qu’est-ce à dire encore ? Prétendons-nous que par plus de sagesse, la guerre aurait été certainement évitée ? Non, non ; il ne peut y avoir ici une certitude. Peut-être, malgré tout, le choc de la démocratie révolutionnaire et de l’Europe absolutiste et féodale se serait produit. Il est probable même que le jour où la Révolution, rompant avec l’équivoque, et châtiant la trahison, le mensonge et le parjure, aurait porté la main sur la royauté et le roi, l’étranger se serait ému.
Ce ne sont pas les menaces de Léopold ou ses outrages au parti républicain qui devaient arrêter la Révolution dans sa marche logique et nécessaire vers la République. Mais ce que je dis, c’est que la Gironde, au moment où elle a déclaré la guerre, ne pouvait pas croire et ne croyait pas en effet que la guerre fût inévitable, c’est qu’elle a tout fait pour la déchaîner. C’est qu’elle a oublié que si la France avait attendu le choc de Europe et si elle avait commencé par se débarrasser au dedans de la trahison royale avant de provoquer l’étranger, elle aurait été beaucoup mieux armée pour soutenir la lutte. Ce que je dis, c’est que compter sur la guerre pour fanatiser la Révolution, c’était compter sur l’alcool pour surexciter les forces et les courages. Oui, la Gironde a cru que la Révolution défaillait à demi, qu’elle ne saurait pas sans ce stimulant factice, dompter la contre-révolution, abattre la royauté et elle lui a fait avaler presque traîtreusement l’alcool de la guerre, un alcool d’orgueil, de soupçon et de fureur, qui bientôt livrera la liberté déprimée au césarisme et à la réaction.
Mais qu’est-ce à dire enfin ? C’est que même si nous ne nous trompons pas, même s’il est vrai que l’étourderie ambitieuse et vaniteuse de la Gironde a jeté la Révolution dans des chemins d’aventures, nous devons de cette erreur des hommes tirer une leçon pour l’avenir, non un argument contre la Révolution elle-même.
Elle reste, dans le monde, le droit, l’espoir de la liberté, et tout notre cœur sera avec elle dans la formidable bataille que témérairement peut-être et nerveusement elle engagea avant l’heure contre les puissances d’oppression, de ténèbres, de médiocrité, qui guettaient toutes ses imprudences, surveillaient tous ses mouvements et mesuraient à leur courte pensée l’essor de son rêve.
Dans la paix, s’il est possible, à travers la guerre s’il le faut, nous suivrons le grand peuple de la Bastille devenu le grand peuple de Valmy ; mais que dans la coupe de la Révolution les générations nouvelles boivent l’héroïsme pur de la liberté, non le résidu fermenté des passions guerrières.
L’empereur, à cette date, est si incertain encore que la reine Marie-Antoinette se croit obligée de l’aiguillonner. Elle qui avait jusqu’ici évité de s’engager avec l’impératrice Catherine de Russie, suspecte à ses yeux de trop de complaisance pour les émigrés, elle recourt à elle maintenant, et c’est Simolin, le chargé d’affaires de la Russie à Paris, que la reine envoie à Vienne pour presser son frère. Elle a pris son parti : comme la Gironde, elle veut en finir, et elle préfère décidément la guerre avec tous ses périls, à l’état d’inquiétude et de tension nerveuse où elle vivait depuis si longtemps. Ainsi, c’est à peu près à la même date que la Révolution et la royauté se décidèrent à la grande épreuve.
La reine écrit, dans les premiers jours de février, au comte de Mercy : « M. de S… (Simolin) qui va vous joindre. Monsieur, veut bien se charger de mes commissions… L’ignorance totale où je suis des dispositions du cabinet de Vienne rend tous les jours ma position plus affligeante et plus critique. Je ne sais quelle contenance faire, ni quel ton prendre ; tout le monde m’accuse de dissimulation et de fausseté, et personne ne peut croire (avec raison) qu’un frère s’intéresse assez peu à l’affreuse position de sa sœur pour l’exposer sans cesse sans lui rien dire. Oui, il m’expose et mille fois plus que s’il agissait ; la haine, la méfiance, l’insolense sont les trois mobiles qui font agir dans ce moment ce pays-ci.
« Ils sont insolents par excès de peur, et parce qu’en même temps ils croient qu’on ne fera rien du dehors. Cela est clair, il n’y a qu’à voir les moments où ils ont cru que réellement les puissances allaient prendre le ton qui leur convient, notamment à l’office du 21 décembre de l’empereur, personne n’a osé parler ni remuer jusqu’à ce qu’ils fussent rassurés.
« Que l’empereur donc sente une fois ses propres injures ; qu’il se montre à la tête des autres puissances avec une force, mais une force imposante, et je vous assure que tout tremblera ici. Il n’y a plus à s’inquiéter pour notre sûreté, c’est ce pays-ci qui provoque à la guerre ; c’est l’Assemblée qui la veut. »
« La marche constitutionnelle que le roi a prise le met à l’abri un côté, et de l’autre son existence et celle de son fils sont si nécessaires à tous les scélérats qui nous entourent, que cela fait notre sûreté ; et je le dis, il n’y a rien de pis que de rester comme nous sommes, et il n’y a plus aucun secours à attendre du temps ni de l’intérieur.
« Le premier moment sera difficile à passer ici, mais il faudra une grande prudence et circonspection. Je pense comme vous qu’il faudrait des gens habiles et sûrs, mais où les trouver ? »
Que de ténèbres descendent à cette heure sur la terre de France ! Pendant que la Révolution s’énerve et pendant que les Girondins lui persuadent que l’empereur qui cherche à éluder le combat, est l’ennemi qu’il faut abattre, voilà la reine qui prend pour de la peur les inévitables délais que se ménagent les Girondins pour entraîner le pays à l’idée de la guerre. Surmenée d’incertitudes, la reine se précipite aussi comme les Girondins sur le chemin où elle doit périr, et où ils périront. La voilà maintenant qui provoque son frère hésitant à envahir la France.
Elle promet de trahir autant que le lui permettront les médiocres instruments dont elle dispose. Et tout cela parce que la royauté ne s’est pas résignée une minute sincèrement à accepter une Constitution qui modernisait, renouvelait peut-être pour des siècles, la force de la royauté ! Ô aveuglement ! petitesse des égoïsmes ! tyrannie des habitudes ! étourderie des ambitions ! Que la force décide et que la foudre prononce, puisque dans cette obscurité universelle la seule lumière possible est celle de l’éclair, éclair de la guerre ! éclair de la mort ! et que le destin de chacun s’accomplisse.
Fersen, qui était à Bruxelles, note dans son journal, à la date du 9 février, le passage de Simolin : « Simolin arrivé à onze heures sans aucun obstacle ; dîné avec lui chez le baron de Breteuil. Il va à Vienne de la part de la reine instruire l’empereur de leur position, de l’état de la France et de leur désir positif d’être secourus. Il les a vus secrètement ; la reine lui a dit : « Dites à l’empereur que la nation a trop besoin du roi et de son fils pour qu’ils aient rien à craindre, c’est eux qu’il est intéressant de sauver ; quant à moi, je ne crains rien, et j’aime mieux courir tous les dangers possibles que de vivre plus longtemps dans l’état d’avilissement et de malheur où je suis.
« Simolin a été touché aux larmes de sa conversation. Il m’a parlé de lettres charmantes de la reine à l’empereur, à l’impératrice et au prince de Kaunitz. M. de Mercy, qu’il a vu, lui a tenu le même langage que de coutume. Simolin lui a reproché la conduite que l’empereur avait tenue, si différente de celle indiquée dans ses déclarations de Padoue, et qu’il avait trompé les puissances ; il a été forcé d’en convenir. »
Ainsi la reine compte que le roi et son fils paraîtront si nécessaires à la nation que celle-ci les épargnera même au cours d’une guerre entreprise en leur nom et pour eux. Et il ne lui vient pas un instant à la pensée qu’il est abominable de trahir un peuple qui est attaché encore à son roi par de tels liens ! Au moment même où elle croit que l’ascendant du roi dominera la nation même dans l’effroyable crise d’une guerre déclarée pour le roi, elle ne songe pas qu’à être le serviteur fidèle de la Constitution et du peuple il aurait sans péril une autorité immense et douce !
Mais ici encore, notez que Mercy tient à Simolin « son langage habituel », c’est-à-dire qu’il s’efforce autant que possible d’amoindrir les chances de guerre, de rabattre les fumées d’orgueil et d’étourderie. Lui-même d’ailleurs l’écrit à Marie-Antoinette, le 11 février :
« Je ne saurai assez répéter qu’il serait injuste de rejeter sur l’empereur des hésitations et des retards ; qui ne dépendent point de lui. Il est évidemment démontré que ce monarque, qui se trouve le premier à la brèche, n’est dans le fait secondé efficacement par personne. On lui excite mille tracasseries, on lui cause mille embarras ; l’Angleterre contrarie toutes les mesures, et les princes français les déjouent d’une autre manière. J’ai recueilli le peu de forces qui me restent pour avoir avec M. Simolin un entretien bien substantiel sur l’état des choses. Je lui ai dit, et le langage qu’il convenait de tenir à Vienne, et la manière la plus utile d’y montrer les objets tels qu’ils sont. Je crois qu’il s’acquittera bien de la commission… L’explosion ne peut manquer d’être très prochaine, mais l’essentiel est qu’elle soit générale, et on a recommandé particulièrement de surveiller l’Espagne… »
Encore des tactiques d’ajournement. Léopold trouve que les émigrés demandent trop, et que l’Angleterre ne fait pas assez, et il lie si bien son action à une action universelle de l’Europe, en ce moment impossible, qu’en réalité il se dérobe. Mercy avait comme alourdi Simolin, à son passage à Bruxelles, de ces décourageantes pensées. Amortir toutes les passions et gagner du temps était la seule pensée de l’empereur, de Kaunitz et de son confident Mercy.
Cependant la décision de la reine était bien prise, car elle venait d’appeler Fersen auprès d’elle. Celui-ci jouant sa tête, partait déguisé de Bruxelles, le samedi 11 février à neuf heures et demie. La reine savait que Fersen était pour la guerre, et si elle le priait de venir, c’était pour confirmer en elle cette résolution dangereuse ; elle avait besoin, à la veille de cette crise formidable, d’avoir à côté d’elle un cœur qui sentait comme le sien. Jamais sa solitude n’avait été plus profonde. Les conseils des constitutionnels, de Lameth, de Duport, lui étaient cruellement importuns, puisqu’elle voulait la guerre et qu’ils ne la voulaient pas.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Le ministre des affaires étrangères, Delessart, que la Gironde accusera tout à l’heure de complicité criminelle avec la Cour, travaillait contre la guerre, c’est-à-dire à la fois contre la Cour et contre la Gironde. Entre lui et la reine, il n’y avait aucune communication. C’est tout à fait en secret qu’elle avait reçu Simolin, et il était chargé d’un message que le ministre ignorait. Et au moment où elle se décidait à la guerre, la reine se sentait plus éloignée que jamais des sœurs de Louis XVI, car c’est dans une toute autre pensée qu’elle s’y décidait ; elle gardait toujours au cœur sa haine contre les émigrés et contre les princes frères du roi. Le roi lui-même était indécis et pesant. Avec un seul homme maintenant elle pouvait parler en confiance, avec celui qui pour préparer la fuite de Varennes, avait affronté tous les périls ; un mutuel amour, mélancolique et combattu, liait Fersen et la reine, et cet amour s’était exalté chez l’un jusqu’au sacrifice, chez l’autre jusqu’à l’acceptation du sacrifice. Il est vrai que le voyage était aussi dangereux pour la reine que pour Fersen. Reconnu, l’ancien cocher du départ pour Varennes, était perdu, mais la reine, suspectée ou accusée d’avoir machiné un nouveau projet de fuite, pouvait être compromise aussi. Leur émotion dut être grande quand, dans le mystère toujours menacé des Tuileries, ils s’entretinrent de ce triste voyage de Varennes, quand la reine en conta quelques détails à Fersen qui les a notés dans son journal.
Mais ce poignant retour du passé ne pouvait être que d’une heure. C’est l’avenir qu’il fallait régler. Fersen essaie de nouveau de décider le roi à fuir, ou tout au moins à combiner la fuite avec la guerre. Fersen se fait auprès du roi le représentant des tendances absolutistes. Il lui semble que si Louis XVI, après la déclaration de guerre, reste au milieu de la Révolution, et avec le rôle de médiateur que prévoit pour lui l’empereur d’Autriche, Louis XVI fera trop de concessions aux idées nouvelles. Qu’il s’évade, au contraire, qu’il consente à être enlevé par les envahisseurs, ce n’est plus comme négociateur entre la Révolution et la contre-révolution qu’il interviendra, mais comme chef des forces contre-révolutionnaires.
« Le 14 (février), mardi : Très beau et très doux. Vu le roi à six heures du soir. Il ne veut pas partir, et il ne peut pas à cause de l’extrême surveillance ; mais, dans le vrai, il s’en fait un scrupule, ayant si souvent promis de rester, car c’est un honnête homme. Il a cependant consenti, lorsque les armées seront arrivées, à aller avec des contrebandiers, toujours par les bois, et se faire rencontrer par un détachement de troupes légères. Il veut que le congrès ne s’occupe d’abord que de ses réclamations, et si on les accordait, insister alors pour qu’il sorte de Paris dans un lieu fixé pour la ratification. Si on refuse, il consent que les puissances agissent, et se soumet à tous les dangers. Il croit ne rien risquer, car les rebelles en ont besoin pour obtenir une capitulation. Il (le roi) portait le cordon rouge. Il voit qu’il n’y a de ressource que la force, mais, par une suite de sa faiblesse, il croit impossible de reprendre toute son autorité. Je lui prouvai le contraire, dis que c’était par la force et que les puissances le désirent ainsi. Il en convint. Cependant, à moins d’être toujours encouragé, je ne suis pas sûr qu’il ne soit tenté de négocier avec les rebelles. Ensuite il me dit : « Ah ! ça, nous sommes entre nous et nous pouvons parler. Je sais qu’on me taxe de faiblesse et d’irrésolution, mais personne ne s’est jamais trouvé dans ma position. Je sais que j’ai manqué le moment, c’était le 14 juillet ; il fallait s’en aller, et je le voulais ; mais comment faire quand Monsieur lui-même me priait de ne pas partir, et que le maréchal de Broglie, qui commandait, me répondait : — Oui, nous pouvons aller à Metz, mais que ferons-nous quand nous y serons ? — J’ai manqué le moment, et depuis je ne l’ai pas retrouvé. J’ai été abandonné de tout le monde. » Il me pria de prévenir les puissances qu’elles ne devaient pas être étonnées de tout ce qu’il était obligé de faire, qu’il y était obligé et que c’était l’effet de la contrainte. « Il faut, dit-il, qu’on me mette « tout à fait de côté et qu’on me laisse faire. »
Quel désarroi ! quelle chute ! Je ne parle pas de ce projet puéril d’aller à travers bois à la rencontre de l’avant-garde étrangère pour se faire enlever. Mais comment ce roi, qui reconnaît lui-même qu’il ne peut pas recouvrer toute son autorité ancienne, et que par conséquent la Révolution était inévitable, comment s’obstine-t-il à la combattre encore ? Et surtout comment le roi des Français a-t-il assez perdu le sens de la France pour croire qu’elle aura peur à la première démarche de l’ennemi, et que, tremblante, elle se réfugiera auprès de lui ? Quoi, ce peuple, qui si souvent dans son histoire tourmentée se redressa du fond des abîmes par un magnifique courage, va se prosterner maintenant aux pieds de l’envahisseur ? Voilà la véritable abdication du roi. Voilà la véritable déchéance. Il ne sait plus ce qu’est la nation dont il est le chef. Fersen repartit pour Bruxelles le 23 février.
Cependant l’empereur finissait par arrêter un plan de concert avec la Prusse, mais combien incertain encore ! Il semble bien qu’il s’était décidé à une intervention dans les affaires intérieures de la France, c’est-à-dire à la guerre. Car, selon les conventions fixées entre l’Autriche et la Prusse, Mercy écrit à la reine, le 16 février :
« 1o Les puissances étrangères, en s’abstenant de rien prescrire sur le mode (de l’autorité royale) n’en sont pas moins autorisées à exiger qu’il en existe un convenable.
« 2o Que la France fasse cesser ses démonstrations hostiles contre l’Allemagne en écartant les trois armées de cinquante mille hommes chacune, ouvertement annoncées pour agir brutalement.
« 3o Que les princes possessionnés en Alsace, et aussi injustement que violemment dépouillés de ce que leur garantissent les traités les plus solennels soient rétablis dans l’intégrité de leurs droits et possessions.
« 4o Qu’Avignon et le comtat Venaissin soient restitués au pape. « 5o Que le gouvernement français reconnaisse la validité des traités qui subsistent entre lui et les autres puissances de l’Europe. »
Rien qu’à formuler ces conditions, l’empereur aurait soulevé la France. Mais il veut éviter encore ce qui peut amener une explosion.
« La nation française, écrit Mercy, est divisée en différents partis. Il est précieux d’entretenir cette division ; elle seule peut opérer sans de violentes secousses la ruine de la Constitution. Si cette dernière est ouvertement attaquée par le dehors, alors tous les partis se réuniront pour la défendre, et la nation entière, cédant au prestige de sa prétendue liberté et égalité, croira devoir lui faire le sacrifice de ses dissensions intérieures. »
Et même en ce qui concerne les conditions précises et, semble-t-il, provocatrices, énumérées plus haut, Mercy ajoute, dans la même lettre du 16 février :
« Pour donner à ces propositions et déclarations le poids nécessaire à les faire valoir, l’empereur offre indépendamment de son armée déjà existante aux Pays-Bas, de faire marcher quarante mille hommes, pourvu que le roi de Prusse convienne d’employer une force égale au succès du plan proposé ; ces forces ne doivent pas débuter par être actives, et ne peuvent même le devenir qu’autant que la nation française, par quelque acte de violence et une réticence invincible, n’amenât par son propre fait les choses à un terme extrême. »
Toute cette politique de l’Autriche est encore ambiguë, suspendue, et ce n’est vraiment pas un torrent de guerre que la Révolution avait à refouler ou à détourner. Il semble bien que si elle l’eût voulu, elle aurait eu quelques chances de sauver la paix sans abdication, sans concession aucune. Marie-Antoinette vit très bien qu’il y avait encore là des moyens dilatoires, et le 2 mars elle répond à Mercy :
« La nation est en effet divisée en différents partis, mais il n’y en a qu’un seul dominant tous les autres. Soit lâcheté, indolence ou division même intérieure dans leurs opinions, aucun n’ose se montrer, il n’y a qu’une force extérieure, et quand ils seront sûrs d’être soutenus, qu’ils auront le courage de se prononcer pour leur vrai intérêt et ceux du roi. Les idées de l’empereur sont bonnes, et les articles de la déclaration me paraissent bien, mais tout cela aurait été mieux il y a six mois. Cela fera perdre encore du temps, et on n’en perd pas ici contre nous. Chaque jour amène sa calamité et aggrave le mal. La perte de toutes les fortunes particulières, la banqueroute, la cherté des grains, l’impossibilité de les transporter d’un endroit à un autre, le manque total du numéraire et le peu de confiance que l’on a dans le papier, et enfin la manière dont on avilit tous les jours davantage la puissance du roi, soit dans des écrits et paroles, soit en tout ce qu’on l’oblige de dire, d’écrire et de faire, tout annonce une crise prochaine, et s’il n’y a pas un soutien extérieur, comment pourra-t-il faire tourner cette crise à son avantage ? »
Voilà ce qu’écrit la reine le 2 mars. Or c’était la veille, 1er mars, que le ministre des affaires étrangères, Delessart, avait communiqué à l’Assemblée législative la réponse de l’empereur à la demande d’explication qui lui avait été faite par ordre de l’Assemblée. Et cette réponse même de l’empereur paraît à la reine ambiguë et peu intelligible.
« Je me dispense de parler de la dernière dépêche qui a été lue hier à l’Assemblée. La politique peut l’avoir dictée ; je ne la comprends pas assez pour la juger. Les suites et l’effet pourront seuls fixer mes idées sur elle. »
Le ministre des affaires étrangères, Delessart, se trouvait depuis deux mois dans une situation bien difficile et même périlleuse. Personnellement il voulait le maintien de la paix, il croyait que le parti modéré serait perdu par la guerre, et il cherchait résolument à l’écarter. C’est dire qu’il ne collaborait pas avec la Cour qui, comme nous venons de le démontrer, appelait impatiemment la guerre à la fin de janvier et en février. La Cour cachait soigneusement à Delessart ses intentions belliqueuses. Bien mieux, Delessart avait de l’éloignement pour le ministre de la guerre, Narbonne, dont les fantaisies et les combinaisons lui semblaient très imprudentes. Delessart pensait que si on commençait à déchaîner la guerre on ne pourrait plus la contenir, et qu’ayant commencé par la guerre de parade de Narbonne on finirait nécessairement par la vaste guerre de propagande de Brissot ; déjà la logique même de la politique belliqueuse faisait peu à peu dériver Narbonne vers la Gironde, qui le ménageait et parfois même dans ses journaux, le louait à demi aux dépens de ses collègues. Narbonne sentait bien qu’il s’userait en vaines démonstrations et manifestations, en revues et en mots brillants, s’il ne mettait pas la main sur la politique extérieure et il cherchait à remplacer Delessart. Celui-ci, craignant à tout instant d’être entraîné hors de la ligne qu’il s’était tracée par une étourderie de Narbonne, cherchait à l’éliminer. Il y avait donc entre les deux ministres un conflit aigu. La reine note ce conflit dans une lettre du commencement de février à Mercy : « Il y a guerre ouverte dans ce moment-ci entre les ministres Delessart et Narbonne. Ce dernier sent bien que sa place est dangereuse et il veut avoir celle de l’autre ; pour cela ils se font attaquer tous les deux de tous côtés ; c’est pitoyable. Le meilleur des deux ne vaut rien du tout. »
Mais c’est surtout à l’égard de l’Assemblée que Delessart se trouvait dans une situation fausse et dangereuse. Il était chargé auprès de l’Empereur d’une mission tout à fait délicate. Il devait le sommer de s’expliquer sur ses sentiments intimes, lui arracher le secret de ses pensées, de ses desseins sur la Révolution. Faite sur un ton comminatoire ou même très pressant, cette demande entraînait immédiatement la guerre avec l’Autriche, et cette guerre, Delessart ne voulait pas en assumer la responsabilité, non par connivence avec la Cour, qui lui cachait ses démarches de trahison et qui le détestait, mais par prudence, par scrupule et aussi par attachement au parti constitutionnel et modéré qui avait ou croyait avoir besoin de la paix.
Faite au contraire sur un ton réservé, cette demande laissait les choses en l’état. Elle prolongeait la paix et les Girondins voulaient la guerre. Elle prolongeait aussi l’incertitude, et l’échange d’observations diplomatiques qui allait se produire ne décidait rien. L’attente de ceux qui voulaient en finir soit par la guerre, soit par la certitude de la paix était trompée, et le ministre allait porter le poids des déceptions et des colères. C’est le 1er mars que Delessart donna communication à l’Assemblée de la note qu’il avait adressée au cabinet de Vienne par l’intermédiaire de notre ambassadeur et des réponses qu’il avait reçues.
La lettre de Delessart était incolore et tiède. Il affirmait parfois avec une certaine force que la France ne permettrait pas que l’on touchât à sa Constitution ; mais parfois aussi il semblait plaider les circonstances atténuantes pour la Révolution. « Ce serait vainement qu’on entreprendrait de changer par la force des armes notre nouvelle Constitution ; elle est devenue, pour la grande majorité de la nation, une espèce de religion qu’elle a embrassée avec enthousiasme, et qu’elle défendrait avec l’énergie qui appartient aux sentiments les plus exaltés. » (Applaudissements réitérés.)
…Et il ajoutait : « Vous m’avez mandé plusieurs fois, Monsieur, qu’on était extrêmement frappé à Vienne, du désordre apparent de notre administration, de l’insubordination des pouvoirs, du peu de respect qu’on témoignait parfois pour le roi. Il faut considérer que nous sortons à peine d’une des plus grandes Révolutions qui se soient jamais opérées ; que cette Révolution, dans ce qui la caractérise essentiellement, s’étant d’abord faite avec une extrême rapidité, s’est ensuite prolongée par les divisions qui sont nées dans les différents partis, et par la lutte qui s’est établie entre les passions et les intérêts divers.
« Il était impossible que tant d’opposition et tant d’efforts, tant d’innovations et tant de secousses violentes ne laissassent pas après elles de longues agitations ; et l’on a lieu de s’attendre que le retour de l’ordre ne pourrait être que le fruit du temps. »
Delessart déclarait que c’étaient les menaces des émigrés qui surexcitaient les esprits : « Qu’on cesse de nous inquiéter, de nous menacer, de fournir des prétextes à ceux qui ne veulent que le désordre, et bientôt l’ordre renaîtra. (Applaudissements.)
« Au reste, ce déluge de libelles dont nous avons été si complètement inondés est considérablement diminué et diminue encore tous les jours. L’indifférence et le mépris sont les armes avec lesquelles il convient de combattre cette espèce de fléau. L’Europe pouvait-elle s’agiter et s’en prendre à la nation française parce qu’elle recèle dans son sein quelques déclamateurs et quelques folliculaires ; et voudrait-on leur faire l’honneur de leur répondre à coups de canon ? » (Rires et quelques applaudissements.)
Puis, il essayait de détourner l’Empereur de toute pensée d’agression en lui représentant les périls qu’aurait pour lui-même la victoire ; et cette hypothèse qui semblait vouer la Révolution à la défaite, indisposa l’Assemblée. « Je reviens à l’objet essentiel, à la guerre. Est-il de l’intérêt de l’Empereur de se laisser entraîner à cette fatale mesure ? Je supposerai si l’on veut, tout ce qu’il y a de plus favorable pour ses armes : Eh bien ! qu’en résultera-t-il ? Que l’Empereur finira par être plus embarrassé de ses succès qu’il ne l’eût été de ses revers et que le seul fruit qu’il réalisera de cette guerre sera le triste avantage d’avoir détruit son allié et d’avoir augmenté la puissance de ses ennemis et de ses rivaux. » (Murmures.)
Le ministre concluait sur un ton très modéré, très conciliant et un peu humble. « Vous devez chercher, Monsieur, à vous procurer des explications sur trois points : 1o Sur l’office du 21 décembre ; 2o Sur l’intervention de l’Empereur dans nos affaires intérieures ; 3o Sur ce que Sa Majesté impériale entend par les Souverains réunis en concert pour l’honneur et la sûreté des couronnes. Chacune de ces explications demandée à sa justice peut être donnée avec la dignité qui convient à sa personne et à sa puissance…
« Je me résume, Messieurs, et je vais vous exprimer en un mot le vœu du Roi ; celui de son conseil et je ne crains pas de le dire, celui de la partie saine de la nation : c’est la paix que nous voulons. Nous demandons à faire cesser cet état dispendieux de guerre dans lequel la fatalité des circonstances nous a entraînés ; nous demandons à revenir à l’état de paix. Mais on nous a donné de trop justes sujets d’inquiétude pour que nous n’ayons pas besoin d’être pleinement rassurés. »
Le vice essentiel de ce document, c’est d’accepter, pour ainsi dire, la discussion avec l’Empereur, avec l’étranger, sur nos affaires intérieures. C’est de s’efforcer d’obtenir la paix pour la Révolution en promettant qu’elle sera bien sage, en laissant espérer que si on ne l’inquiète point, elle ne dépassera pas une certaine ligne. Ce n’était donc qu’une reconnaissance conditionnelle de la Révolution que paraissait demander le ministre. Mais en vérité, comment aurait-il pu poser autrement la question ? En exigeant de l’Empereur, frère de Marie-Antoinette, la reconnaissance publique et inconditionnelle de la Révolution, en le sommant de déclarer qu’il n’attaquera en aucun cas, même si la France renverse la royauté, même si à l’exemple de l’Angleterre de 1648, elle décapite le roi, la Gironde acculait l’Empereur ou à une déclaration qu’il ne pouvait faire, ou à la guerre. C’est seulement dans le silence que pouvaient s’accorder la liberté de la Révolution et les calculs pacifiques de Léopold.
Or, ce silence, la Gironde voulait avant tout qu’il fût rompu et le ministre des affaires étrangères, ne pouvant pas se taire et ne voulant pas prononcer d’irréparables paroles, était condamné à ce langage inerte et faible où ne vibraient certes pas la fierté de la Révolution et l’orgueil de la France. C’est la Gironde qui, par ce que j’appellerai son audace sournoise, acculait peu à peu la France et l’Europe à la guerre, qu’elle n’osait pourtant proclamer d’emblée.
On comprend que la réponse de l’Empereur ait paru peu intelligible à Marie-Antoinette. Il est visible qu’il a cherché seulement, cette fois encore, à gagner du temps, sans rompre avec la France et sans s’humilier devant la Révolution. Mais le ministre Kaunitz exécuta cette opération avec une lourdeur, une ignorance des susceptibilités françaises et des passions révolutionnaires qui ne font pas grand honneur à la diplomatie autrichienne. Il s’abstint de formuler aucune des conditions, aucune des exigences : retour du comtat à la Papauté, rétablissement du pouvoir politique de la noblesse, qui servaient de base, à ce moment même, aux négociations incertaines de l’Autriche et de la Prusse.
Mais il parla des agitations de la France grossièrement et pesamment. Il avoua qu’à Pilnitz une convention avait été signée pour protéger le roi de France contre les progrès « de l’anarchie ». Il ajouta qu’après l’acceptation de la Constitution par le roi cette convention n’avait plus qu’une valeur toute « éventuelle ».
Et il accusa violemment les partis de gauche. « Tant que l’état intérieur de la France, au lieu d’inviter à partager l’augure favorable de M. Delessart sur la renaissance de l’ordre, l’autorité du gouvernement et l’exercice des lois, manifestera au contraire des symptômes journellement croissants d’inconsistance et de fermentation, les puissances amies de la France auront les plus justes sujets de craindre, pour le roi et la famille royale, le retour des mêmes extrémités qu’ils ont éprouvées plus d’une fois, et pour la France de la voir replongée dans le plus grand des maux dont un grand État puisse être attaqué, l’anarchie populaire. »
« Mais c’est aussi des maux le plus contagieux pour les autres peuples ; et tandis que plus d’un État étranger a déjà fourni les plus funestes exemples de ses progrès, il faudrait pouvoir contester aux autres puissances le même droit de maintenir leurs constitutions que la France réclame pour la sienne, pour ne pas convenir que jamais il n’a existé de motif d’alarme et de concert général plus légitime, plus, urgent et plus essentiel à la tranquillité de l’Europe. »
« Il faudrait pareillement pouvoir récuser le témoignage des événements journaliers les plus authentiques, pour attribuer la principale cause de cette fermentation intérieure de la France à la consistance qu’ont prise les émigrés à ou leurs projets… Les armements des émigrés sont dissous, ceux de la France continuent. L’empereur, bien loin d’appuyer leurs projets ou leurs prétentions, insiste sur leur tranquillité ; les princes de l’Empire suivent son exemple…
« Non, la vraie cause de cette fermentation et de toutes les conséquences qui en dérivent, n’est que trop manifeste aux yeux de la France et de l’Europe entière. C’est l’influence et la violence du parti républicain (Violents murmures), condamné par les principes de la nouvelle Constitution, proscrit par l’Assemblée constituante, mais dont l’ascendant sur la législature présente est vu avec douleur et effroi par tous ceux qui ont le salut de la France sincèrement à cœur. »
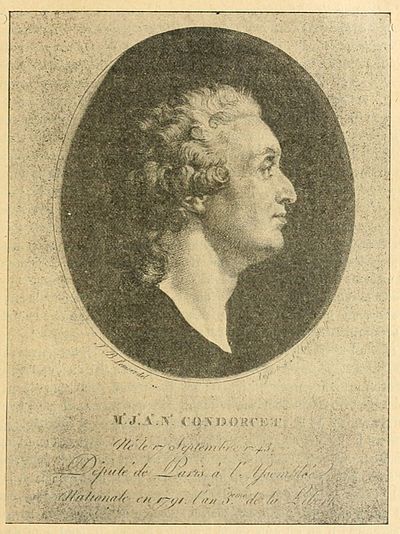
(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
Il avait très bien démêlé le plan de la Gironde, républicaniser la France au moyen de la guerre. « Ce sont les moteurs de ce parti qui, depuis que la nouvelle Constitution a prononcé l’inviolabilité du gouvernement monarchique, cherchent sans relâche d’en renverser ou saper les fondements, soit par des motions et des attaques immédiates, soit par un plan suivi de l’anéantir dans le fait, en entraînant l’Assemblée législative à s’attribuer les fonctions essentielles du pouvoir exécutif ou en forçant le roi à céder à leurs désirs par les explosions qu’ils excitent et par les soupçons et les reproches que leurs manœuvres font retomber sur le roi. »
« Comme ils ont été convaincus que la majeure partie de la nation répugne à l’adoption de leur système de république, ou pour mieux dire d’anarchie, et comme ils désespèrent de réussir à l’y entraîner, si le calme se rétablit à l’intérieur et que la paix se maintienne au dehors, ils dirigent tous leurs efforts à l’entretien des troubles et à susciter une guerre étrangère. »
«…Voilà pourquoi, au lieu d’apaiser les secrètes inquiétudes que les puissances étrangères ont conçues depuis longtemps sur leurs menées sourdes mais constatées, pour séduire d’autres peuples à l’insubordination et à la révolte, ils les trament aujourd’hui avec une publicité d’aveu et de mesures sans exemple dans l’histoire d’aucun gouvernement policé de la terre. Ils comptaient bien que les souverains devraient enfin cesser d’opposer l’indifférence et le mépris à leurs déclarations outrageantes et calomnieuses, lorsqu’ils verraient que l’Assemblée nationale non seulement les tolère dans son sein mais les accueille et en ordonne l’impression (Murmures prolongés)…Malgré des procédés aussi provocants, l’empereur donnera à la France la preuve la plus évidente de la constante sincérité de son attachement, en conservant de son côté le calme et la modération que son intérêt amical pour la situation de ce royaume lui inspire. » Et, en terminant, il se borne à dire qu’il défendrait les princes de l’Empire s’ils étaient attaqués.
Quel est le vrai sens de ce document-ci ? À des paroles agressives et blessantes se mêle le souci visible d’éviter la rupture. J’ai dit que l’empereur voulait avant tout gagner du temps ; mais ce n’était point pour mieux préparer la guerre, c’était pour laisser se produire des chances de paix. Évidemment, l’exemple de la France révolutionnaire, la sourde et inévitable propagande de la liberté l’inquiètent et l’irritent. Il ne déclare pas pourtant à la Révolution une guerre de principe, puisqu’il s’abrite derrière la Constituante, derrière la grande Assemblée qui proclama les Droits de l’Homme et la souveraineté des nations. Pourquoi, dès lors, voulant la paix, l’espérant encore, a-t-il prodigué à une partie notable et influente de l’Assemblée, les paroles outrageantes ? Il en est sans doute plusieurs raisons. D’abord, tout en désirant la paix, l’empereur est résigné à la guerre et commence à la croire inévitable : il désire surtout, si elle se produit, que la France ait la responsabilité de l’agression. Aussi n’évite-t-il pas très exactement d’irriter les esprits. Puis, il s’imaginait peut-être que la brutalité de ce langage ferait impression, et que les partis de gauche, aussi directement dénoncés, reculeraient. Étrange méconnaissance de la force d’élan de la Révolution. J’imagine encore qu’en signalant tout haut le plan de la Gironde, de ce qu’il appelle le parti républicain, c’est-à-dire le dessein formé de surexciter la politique intérieure par la guerre extérieure, l’empereur voulait avertir le roi et la reine qu’ils avaient bien tort de jouer avec le feu. Et il justifiait ainsi devant le monde, ses propres lenteurs, les hésitations et la prudence qui lui étaient si violemment reprochées par les intransigeants de l’émigration et de la monarchie.
La paix restait donc possible, mais à une condition : c’est que la France révolutionnaire eût à ce moment l’esprit assez lucide et assez ferme pour bien voir toute la vérité. Il aurait fallu qu’un ministre des affaires étrangères pût donner à l’Assemblée, à son comité diplomatique, la preuve qu’en effet l’empereur voulait la paix et résistait à la Cour. Il aurait fallu que le comité diplomatique et l’Assemblée puissent avoir confiance en ce ministre. Or, tout était trouble, faux, débile, dans cette triste incubation de la guerre ; tout était mensonge, trahison, duplicité, habileté basse, calcul sournois dans les partis. Le roi et la reine trahissaient. Ils trahissaient cyniquement, mais sans esprit de suite ; tantôt ils redoutaient la guerre, tantôt ils la souhaitaient, mais pour se sauver plus sûrement par l’appui de l’étranger. Les anciens constituants qui voulaient la Constitution et la paix étaient engagés dans de louches négociations avec la Cour : ils acceptaient de faire passer à l’empereur leur mémoire diplomatique par les mains de la reine, dont il est impossible que la loyauté ne leur fût pas suspecte. Les Girondins intriguaient et cherchaient à susciter la guerre par surprise.
Ils tournaient autour de la Royauté d’un cœur hésitant et fourbe, rêvant parfois de la renverser dans une grande crise extérieure, mais se réservant aussi de s’installer en elle, comme des vainqueurs dans une antique maison, et de couvrir leur puissance ministérielle du prestige de la vieille monarchie. Robespierre enfin, qui n’aurait pu détourner les esprits de la fascination extérieure que par un grand effort de révolution intérieure, se bornait à montrer les Tuileries d’un geste vague et timide. La France de la Révolution était admirable, hier, quand elle proclamait les Droits de l’Homme, sa foi sublime dans la raison, la liberté et la paix. Elle sera admirable, demain, quand elle défendra la Révolution menacée, l’avenir du monde contre l’infernale conspiration de toutes les tyrannies. Mais, dans cette période de préparation obscure et sournoise de la guerre, tout serait triste et bas si on ne sentait parfois du cœur profond du peuple monter la sublime espérance de l’universelle libération des hommes et un héroïque défi à toutes les puissances de la mort.
L’Assemblée entendit avec malaise toutes ces communications. Un moment, elle se laissa aller à applaudir Delessart : mais le mécontentement éclata vite.
De suite, à la séance du soir, Rouyer dénonça ce qu’il croyait être la connivence de l’empereur et du ministre : « Je pourrais vous dire, s’écria-t-il, que le comité diplomatique lui-même, lorsque le ministre Delessart lui communiqua ces réponses insidieuses, lui a ri au nez en lui disant : « N’avez-vous pas honte de pareilles pièces qui ne seront regardées dans l’Assemblée que comme votre propre ouvrage ! » (Bravo ! bravo ! Applaudissements réitérés dans les tribunes.)…Mais, est-il payé pour témoigner les craintes de la nation à l’Empire, pour mentir aux puissances étrangères ? Un peuple libre n’a rien à craindre, il se joue des efforts qu’on peut diriger contre lui. Il ne veut et ne peut voir que des vaincus dans les despotes qui voudraient l’attaquer. Mais, tant que nous serons exposés à des mains mercenaires telles que les siennes, on nous fera tenir ce langage. Je dénonce donc le ministre des affaires étrangères, et dussé-je périr victime de mon patriotisme, je ne cesserai de le poursuivre jusqu’à ce que la loi ait prononcé entre l’accusateur et l’accusé. » (Bravo ! bravo ! Applaudissements réitérés.)
Voilà l’acte d’accusation lancé. Mercenaire ? Delessart ne l’était pas. Il ne trahissait pas la Révolution au profit de la Cour qui le détestait. Mais y avait-il connivence entre lui et l’empereur ? Il y avait seulement concordance de vues. Il y a eu un moment où les modérés constitutionnels dont Delessart était l’organe, et l’empereur ont eu les mêmes vues, les mêmes espérances. Delessart et l’empereur voulaient également la paix et, voulant la paix, ils espéraient l’un et l’autre que la conduite de la Révolution ne passerait pas aux mains du parti de la Gironde, du parti de la guerre. Quand Rouyer et les ennemis du ministre disaient qu’il avait dicté et rédigé la réponse de l’empereur, ils n’étaient point tout à fait hors du vrai. Car, d’une part, la lettre envoyée par M. Delessart à notre ambassadeur à Vienne, ressemblait beaucoup au mémoire que Barnave, Lameth et Duport avaient fait tenir à l’empereur dans les premiers jours de janvier par l’intermédiaire de la reine, et, d’autre part, la réponse publique que fait M. de Kaunitz ressemble trait pour trait au mémoire que l’empereur fit parvenir à la reine en réponse au sien. C’est bien l’état d’esprit feuillant qui sert de lien entre les Tuileries et la cour de Vienne. Ce sont les formules des Feuillants que l’empereur emploie. Ce sont les Feuillants notamment qui ont tracé dans leur mémoire le portrait de ce qu’ils appellent « le parti républicain », en termes presque identiques à ceux qu’emploie Kaunitz dans le document lu à l’Assemblée.
Mais, je le répète, l’empereur ayant besoin de la paix, mais pressé par les appels de sa sœur, Marie-Antoinette, se flattait de l’espoir que les événements ne l’obligeraient pas à intervenir, et il entrait ainsi tout naturellement dans le système des constitutionnels, sans qu’aucune trahison fût imputable à ceux-ci.
C’est à souligner cet accord des Feuillants et de l’empereur, que Brissot s’applique d’abord : « Nous nous dispenserons, écrit-il dans le Patriote français du 2 mars, de donner une longue analyse de cette réponse qui n’est qu’une paraphrase tudesque des morceaux les plus saillants de nos papiers ministériels… On ne s’attendait guère à voir l’empereur s’ériger en avocat de la Constitution ; mais, c’est ce qu’il a encore de commun avec les Feuillants

2. Mon Prince, la Mort est sans doute Aveugle comme la Fortune.
1. Mon cher nous perdons gros aujourd’huy.
et, tout ce qui nous étonne, c’est qu’il n’ait pas cité la devise célèbre : la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. »
Puis, Brissot rappelle avec ironie les attaques de l’empereur contre les sociétés populaires : « Il ne dissimule pas que s’il conserve une armée en état d’observation passive, c’est pour empêcher cette terrible puissance des Jacobins de renverser la monarchie libre de la France, pour laquelle il se sent un si tendre intérêt, tel est encore le but du concert qu’il a formé avec diverses puissances : ce n’est pas trop d’une pareille ligue contre cette secte formidable. On pense bien que ces terreurs et ces menaces ont été accueillies des plus vifs éclats de rire : les ministériels semblaient rougir eux-mêmes de ces déclamations. On eût bien voulu quelques tirades contre les Républicains et les Jacobins ; mais en faire une puissance ! c’était couvrir de boue et les souffleurs et l’écolier. »
« Une note de l’ambassadeur de Prusse, qui déclare que son maître adhère aux conclusions de l’empereur et qu’il est obligé de s’opposer à toute espèce d’invasion sur le territoire de l’Empire, et un message du roi ont terminé cette comédie diplomatique. »
« Le roi déclare à l’empereur qu’il croit au-dessous de la dignité et de l’indépendance d’une grande nation, de discuter ces divers articles qui concernent la situation intérieure du royaume ; qu’il aurait désiré une réponse plus catégorique et plus précise, relativement à ce concert formé entre les puissances, et que ce concert n’a aucun objet, qu’il en demande la cessation pour mettre fin à des inquiétudes où la nation ne veut ni ne peut rester. Il offre de désarmer si l’empereur retire une partie de ses troupes. »
« La simplicité et la clarté de cette réponse qui contrastait d’une manière frappante avec l’entortillage germanique des dépêches du cabinet de Vienne ont obtenu les applaudissements de l’Assemblée… Louis XIV, quoiqu’il ne fût pas roi d’une nation libre aurait été moins patient ; mais, une nation libre aime à épuiser les bons procédés. »
« Quelle que soit l’issue de cette réponse, les amis du peuple doivent se féliciter de cette journée.
« Elle a marqué l’ascendant de cette nation livrée à l’anarchie populaire. L’empereur a obéi au vœu national en écrivant avant l’époque qui lui a été fixée. »
« Il a été forcé de se justifier devant un peuple qu’on foulait aux pieds. »
« Il a révélé le grand secret de l’intrigue qui unit les deux cabinets de Vienne et des Tuileries ; le même esprit les dirige, le pauvre esprit de quelques intrigants, qui, pour se venger des hommes et des sociétés qui les ont démasqués, empruntent des plumes royales et ministérielles, assez faibles pour se prêter à leurs plates manœuvres. »
« Enfin, cette journée a tué et la diplomatie et la réputation de profondeur des cabinets politiques. Y a-t-il rien de plus pitoyable que ces dépêches ? On voit maintenant pourquoi les ministres aiment tant à s’envelopper de mystère : la faiblesse et l’ignorance en ont tant besoin. Et voilà le fruit d’une expérience de soixante ans ! Kaunitz, dupe de jeunes ambitieux, bien ignorants et bien impudents ! Kaunitz se battre contre les républicains et les Jacobins ! Quelle école à quatre-vingts ans ! Ces fautes ne s’effacent guère : il a donné sa mesure et celle de son maître, et avec cette mesure on ne subjugue point une grande nation qui veut sa liberté. »
Brissot triomphe et se grise ; il plane au-dessus de l’Europe. Mais un moment sa vanité semble contrarier son dessein. Il est si fier d’avoir obtenu une réponse de l’Empereur aux sommations dictées par lui qu’il oublie un moment d’attiser la guerre. Car, si déjà, comme le dit Brissot, l’Empereur est humilié, quel besoin est-il de le poursuivre davantage et d’exiger de plus formelles déclarations ? S’il a consenti à cette humiliation plutôt que de rompre, pourquoi la Révolution ne s’applique-t-elle pas à ménager les chances de paix qui se manifestent ?
Si l’Empereur est le jouet des Feuillants, si Barnave, les Lameth, Duport le manœuvrent à leur gré, n’est-il point visible que l’Empereur espère, en modérant par eux les événements intérieurs de France, se dispenser d’une intervention qui l’effraie ? Pourquoi, dès lors, ne pas marcher d’un pas rapide et ferme dans les voies révolutionnaires sans être obsédé par le fantôme extérieur, sans chercher dans la guerre une diversion funeste ? Si la réponse de Louis XVI est simple et franche, si elle mérite les applaudissements de toute l’assemblée, comment pourra-t-on attaquer la royauté ? Comment pourra-t-on attaquer aussi le ministre des affaires étrangères qui a rédigé au nom du roi cette réponse et qui a obtenu de l’Empereur une communication hâtive, humiliante pour celui-ci ? Cet article de Brissot était la meilleure défense du ministre que dix jours après Brissot fera décréter de trahison. Il était le meilleur plaidoyer pour la paix que la Gironde s’obstinera passionnément à rompre.
Et que signifient ces coquetteries avec Louis XVI qui, vraiment, à cette date, était traître à la nation ? Mais qu’importaient à Brissot toutes ces contradictions ? Son cœur s’était gonflé un moment de vanité ; il s’était dit avec complaisance qu’il avait plus de fierté que Louis XIV. Avoir obligé un empereur à répondre le faisait tressaillir d’aise. Ô pauvre parvenu qui n’avait pas la fierté de la Révolution et qui semblait avoir besoin pour elle des approbations impériales !
Que signifie encore cette sorte de rabaissement de son propre parti, des républicains et des Jacobins ? Ils étaient en effet la force organisée de la Révolution. L’Empereur ne se trompait pas en constatant leur puissance. Les Jacobins relevèrent d’ailleurs le défi avec un juste orgueil. Mais Brissot, platement rapetissa ses amis pour pouvoir railler l’Empereur. Vanité sans dignité et intrigue sans grandeur.
Mais Brissot, en qui une fumée de puéril orgueil a un moment suspendu et obscurci la pensée politique, ne tarde pas à comprendre que de la journée du 1er mars il peut tirer un double parti. Il peut aigrir les susceptibilités nationales et exaspérer les nerfs du peuple en disant que l’Empereur a voulu se mêler de nos affaires et que sa réponse ambiguë laisse subsister les incertitudes épuisantes. Il peut aussi, en frappant Delessart, désorganiser le ministère, terroriser la Cour et la mettre enfin sous la tutelle de la Gironde.
Il écrit, le samedi, 3 mars, à propos de la séance du soir du 1er, de celle où Rouyer parla :
« On avait eu le temps de réfléchir sur la farce diplomatique jouée le matin, et l’on avait cru s’apercevoir qu’un des principaux acteurs en était maintenant le souffleur : c’était M. Lessart, et il a été formellement dénoncé par M. Rouyer. M. Charlier a appuyé la dénonciation, et il a pensé qu’il y avait lieu à déclarer que le ministre avait perdu la confiance de la nation. Le Comité diplomatique a été chargé d’examiner la note confidentielle de M. Lessart à notre ambassadeur à Vienne, note qu’on peut regarder comme le nœud de cette intrigue épistolaire. Au reste, la pièce va être imprimée, et l’on sera à portée de juger par la comparaison si les lettres et les réponses ne sortent pas de la même plume. »
Brissot va se recueillir pendant quelques jours et préparer le réquisitoire qui, en frappant Delessart, disloquera le ministère modéré et ouvrira à la Gironde le pouvoir ministériel. Devant cette tactique, l’intérêt évident du roi était de maintenir son ministère uni, de défendre Delessart, de garder Narbonne et de dire que l’un des deux ministres représentait la politique de paix, l’autre la vigilance guerrière. Mais le ministère était disloqué du dedans par le conflit sourd de Delessart et de Narbonne, surtout par le conflit aigu de Narbonne et du réactionnaire Bertrand. Celui-ci, très attaqué dans l’Assemblée, était exaspéré des manœuvres de popularité de Narbonne. Narbonne affectait une grande prévenance pour les comités de la Législative que Bertrand dédaignait. Le ministre de la marine se plaignait que Narbonne le fit attaquer dans les journaux jacobins. Et il est vrai que si le journal de Brissot, dans les premières journées de mars attaque assez souvent Narbonne, c’est toujours avec un extrême ménagement, et la Chronique de Condorcet le loue souvent.
Mais le roi n’avait confiance qu’en Bertrand, et celui-ci s’insinuait tous les jours plus avant dans la confiance de Louis XVI et lui rendait même des services privés, en lui procurant de la monnaie d’or, que le roi préférait aux assignats, par un prélèvement frauduleux sur la caisse de la marine.
Narbonne se sentit menacé. Il demanda aux généraux qu’il avait nommés : Rochambeau, Lückner, Lafayette, de le soutenir. Ceux-ci intervinrent par des lettres publiques qui irritèrent le roi, et il donna congé à Narbonne.
Brissot, le 9 mars, écrit : « Le roi a retiré ce matin le portefeuille de la guerre à M. Narbonne. On assure qu’il est remplacé par M. Degrave. Les motifs du renvoi ne sont pas bien certains. Les uns l’attribuent à l’intrigue du ministre Bertrand et de ses confrères qui le soutiennent ; d’autres croient que la Cour haïssait M. Narbonne, parce que, dans son opinion, il devenait trop populaire ; d’autres, enfin, donnent pour prétexte les lettres des généraux à M. Narbonne imprimées dans les journaux. »
Mme Roland.
(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
« Dans ces lettres les généraux Rochambeau et Lafayette prient le ministre de ne pas quitter sa place dans un moment où il peut rendre de si grands services, et ils assurent que sa démission serait une calamité publique. On ne pouvait pas trouver de meilleur moyen pour perdre M. Narbonne. »
« M. Narbonne a un tort à se reprocher. Il dit dans sa réponse qu’il avait voulu se retirer parce qu’il n’était pas d’accord avec un de ses collègues (M. Bertrand) dont il estime le caractère personnel, mais dont il n’approuve pas également la conduite ministérielle.
« Comment M. Narbonne estime-t-il le caractère d’un homme qui a menti à la face de l’Europe, qui a donné un démenti au roi dont il est le ministre, qui n’a cessé de montrer la mauvaise foi la plus effrontée ? »
Comment le roi n’hésitait-il point à se séparer ainsi de Narbonne ? S’être engagé, sur ses conseils, dans la politique de guerre limitée et le congédier juste à l’heure où le semblant de popularité qu’il avait acquis pouvait protéger la Cour, c’était une faute qui prouvait ou l’entière impuissance, ou l’entière incohérence de la royauté. Cette décision du roi perdait Delessart. N’osant pas blâmer ouvertement une décision du roi relative aux ministres, l’Assemblée va prendre sa revanche en décrétant un des ministres de trahison. Je ne m’arrêterai pas à analyser longuement l’acte d’accusation porté le 10 mars à la tribune.
Au fond, tous les arguments peuvent se ramener à un seul : « Delessart est criminel de n’avoir pas tout fait pour amener la guerre. » Brissot lui reproche comme une félonie jusqu’à la prudence du langage diplomatique. Il lui reproche comme une félonie des paroles, des attitudes qui, hier encore, étaient celles de Brissot lui-même. Il semblait, dit-il, que M. Delessart voulût dérober la connaissance (du concert des souverains), ou ne la donner que le plus tard possible ; il semblait se réserver cette matière nouvelle à des explications et à des négociations, pour tempérer l’ardeur de la nation française qui brillait d’attaquer et de se venger des insultes qu’elle avait reçues. »
« Un ministre habile et patriote aurait vu dans ce concert le foyer de tous les orages qui pouvaient menacer la France, il se fût attaché opiniâtrement à le dissiper. M. Delessart respectait au contraire ce foyer et ne s’attachait qu’à quelques ramifications ou rassemblements des émigrés, aux princes possessionnés. »
Or, nous savons qu’en fait ce concert offensif n’existait pas. Nous savons que Léopold avait toujours cherché des moyens dilatoires. Et nous nous rappelons que Brissot disait il y a peu de temps : « C’est à Coblentz qu’est le foyer du mal. » Il assurait que l’empereur voulait la paix, avait besoin de la paix.
Il pèse tous les mots de la lettre de Delessart : « Avec quelle faiblesse le ministre parle de ce concert, dont l’existence était si bien démontrée, dont l’objet était si contraire aux intérêts de la France. « On a été, dit-il, extrêmement frappé « de ces expressions : les souverains réunis en concert ; on a cru y « voir l’indice « d’une ligue formée à l’insu de la France et peut-être contre « elle ». L’indice ! comment une expression aussi lâche, aussi criminelle est-elle échappée au ministre ?
Ainsi Brissot va envoyer le ministre devant la Haute-Cour d’Orléans parce que l’expression indice, dans une correspondance diplomatique, ne lui paraît pas assez forte.
Et encore. « L’affectation de M. Delessart à prêcher la paix n’était-elle pas encore plus propre à nous attirer la guerre ou au moins des réponses humiliantes ? Lisez la fin de sa lettre : C’est la paix que nous voulons… Qui ne sait ici, Messieurs, que le ministre autrichien ne devait voir dans ces cris pour la paix que les fureurs de l’impuissance et de la pusillanimité ?… »
C’est sur des raisons de cette force que Brissot fonde une demande de mise en accusation. Il y a treize griefs. Delessart était coupable « en ayant demandé bassement la paix. » C’est le grief no 7. Il l’est encore, « en ayant communiqué au ministère autrichien des détails sur l’intérieur de la France qui pouvaient donner une fâcheuse opinion sur sa situation et provoquer des déterminations funestes pour elle », comme si Delessart en faisant allusion aux agitations, aux conflits qui suivaient naturellement en France le grand ébranlement révolutionnaire avait appris quoi que ce soit à l’étranger.
Et dans ce réquisitoire sophistiqué contre le ministre, pas un mot sur le roi, pas un mot sur la Cour. C’est toujours le même système d’hypocrisie et de mensonge. Depuis des mois, les habiles et les peureux faussent la conscience de la Révolution. Il est entendu que l’on ménagera le roi. Il est entendu qu’on surexcitera la passion nationale pour ranimer la passion révolutionnaire que l’on croit affaiblie. Avec ce parti pris de n’aborder la royauté que par ces détours, de ne l’attaquer qu’obliquement, on s’est condamné à mentir, à tricher ; et n’osant pas dire au peuple la vérité rude et forte, qu’il faut décidément abattre la royauté et le roi, on affole le pays par des soupçons, par des romans de trahison. Sur Delessart, qui s’est borné à traduire honnêtement la politique pacifique des modérés, Brissot épuise ses ressources de plate dialectique, et contre le roi, qui trahit lui, qui livre la patrie, mais qui distribue encore les portefeuilles ministériels, Brissot n’a pas un mot de menace. Et pourtant si le roi ne trahit pas, au profit de qui trahit Delessart ?
C’est un soulagement, après toutes ces roueries de sophiste et de pédant, d’entendre, en cette même séance du 10 mars, le grand cri de colère et d’éloquence de Vergniaud contre les Tuileries :
« Permettez-moi, messieurs, une réflexion. Lorsqu’on proposa à l’Assemblée constituante de décréter le despotisme de la religion chrétienne, Mirabeau prononça ces paroles mémorables : De cette tribune où je vous parle on aperçoit la fenêtre d’où la main d’un monarque français armé contre ses sujets par d’exécrables factieux, qui mêlaient des intérêts personnels aux intérêts sacrés de la religion, tira l’arquebuse qui fut le signal de la Saint-Barthélémy.
« Eh ! bien, messieurs, dans ce moment de crise où la patrie est en danger, où tant de conspirations s’ourdissent contre la liberté, moi aussi je m’écrie : Je vois de cette tribune les fenêtres d’un palais où des conseillers pervers égarent et trompent le roi que la Constitution nous a donné, forgent les fers dont ils veulent nous enchaîner, et préparent les manœuvres qui doivent nous livrer à la maison d’Autriche. Je vois les fenêtres du palais où l’on trame la contre-révolution, où l’on combine le moyen de nous replonger dans les horreurs de l’esclavage, après nous avoir fait passer par tous les désordres de l’anarchie et par toutes les fureurs de la guerre civile. (La salle retentit d’applaudissements.)
« Le jour est arrivé, messieurs, où vous pouvez mettre un terme à tant d’audace, à tant d’insolence, et confondre enfin les conspirateurs. L’épouvante et la terreur sont souvent sorties, dans les temps antiques et au nom du despotisme, de ce palais fameux. Qu’elles y rentrent aujourd’hui au nom de la loi. (Applaudissements réitérés.) Qu’elles y pénètrent tous les cœurs. Que tous ceux qui l’habitent sachent que notre Constitution n’accorde l’inviolabilité qu’au roi. Qu’ils sachent que la loi y atteindra sans distinction tous les coupables, et qu’il n’y aura pas une seule tête convaincue d’être criminelle qui puisse échapper à son glaive. Je demande qu’on mette aux voix le décret d’accusation. » (L’orateur descend de la tribune au milieu des applaudissements réitérés de l’Assemblée et du public.)
Enfin, une main hardie déchirait le voile : la trahison royale était directement dénoncée. La Révolution retrouvait son accent de franchise et de puissance. La menace à la reine était terrible. L’acte d’accusation contre Delessart fut voté. Les amis de Marie-Antoinette furent pris de peur pour elle.
Fersen note ceci dans son journal, le 23 mars : « Trouvé Goguelat chez moi en rentrant. Il avait passé par Calais, Douvres et Ostende. Il était parti depuis huit jours. Leur situation (du roi et de la reine) fait horreur. On a entendu des députés dire : « Lessart s’en tirera, mais la reine ne s’en tirera pas. » Deux autres, sur la terrasse des Feuillants, disaient, en parlant du départ du roi : « Ces bougres-là ne partiront pas ; vous le verrez. »
Il écrit encore le 18 : « Le chevalier de Coigny avait mandé le projet des Jacobins de mettre la reine dans un couvent ou de la mener à Orléans pour la confronter avec Delessart. »
Vraiment l’épouvante et la terreur étaient entrées dans le palais au nom de la Révolution.
Et presque au même moment, comme pour achever l’accablement de la Cour, la nouvelle de la mort de l’empereur Léopold arrivait. Le journal de Brissot dit, le 11 mars : « La mort de l’Empereur n’est plus douteuse ; elle a été officiellement annoncée. Cette mort change tout le système politique de l’Allemagne. Cette nouvelle et celle du décret d’accusation contre M. Lessart ont répandu la consternation dans le château. »
À vrai dire, Brissot s’exagérait la confiance de la Cour en l’Empereur. Les amis intransigeants de Marie-Antoinette, les absolutistes ne s’affligèrent pas outre mesure de la mort du temporisateur qui ajournait sans cesse la guerre et qui voulait réconcilier la royauté française et la Révolution.
Fersen écrit, le jeudi 8 mars, à Bruxelles : « Le vicomte de Vérac, l’évêque et beaucoup de gens croyaient que cela allait tout changer et tout retarder, occasionner des longueurs. Je ne fus pas de cet avis, je le leur prouvais, et je sais que le baron de Breteuil avait été de mon avis. Je pris alors mon parti d’écrire à la reine mon opinion là-dessus. »
Et le lendemain : « Les généraux ne témoignaient pas le moindre chagrin, mais presque le contraire. Thugut dit au baron qu’il en était bien aise. Dans la ville cela ne faisait aucune sensation : les officiers en étaient même contents. »
Mais, quoique la reine, pour ses desseins de contre-révolution armée, n’eût pas à se louer de son frère, sa disparition subite aggravait encore, si je puis dire, l’inconnu.
En tout cas, le système des Feuillants, qui combinaient avec Léopold un régime de modération et de paix, s’effondrait au dehors par la mort de l’Empereur, comme il s’effondrait au dedans par l’acte d’accusation contre de Lessart.
Acculés, frappés de terreur, Louis XVI et Marie-Antoinette n’avaient plus qu’une ressource : appeler un ministère girondin. Ils s’y résignèrent, et le mois de mars 1792 vit l’avènement gouvernemental de la Gironde. C’était un pas immense de la Révolution.
Quelles que fussent l’étourderie et l’ambition des Girondins, ils représentaient l’esprit révolutionnaire, prêt à dompter au dedans tous les factieux de la noblesse et du clergé, prêt à défier et à vaincre au dehors tous les tyrans conjurés, tous ceux qui menacent la liberté nouvelle, tous ceux aussi qui prétendent la limiter.
Pendant que la royauté traîtresse s’affole et se livre, les volontaires vont par milliers vers la frontière ; ils font, au passage, hommage de leur vie à l’Assemblée, qui suspend un moment ses tumultes et ses querelles pour les acclamer, et, purs de toute intrigue, ignorants de ce qui se mêlait de factice aux cris belliqueux de la Gironde, convaincus de la nécessité et de la sainteté de la guerre révolutionnaire, ils vont combattre, vaincre ou mourir, et en se libérant, libérer le monde.
