L’Homme et la Terre/II/08
Les historiens placent l’arrivée des Pélasges en Grèce à une époque distante de nous de quarante siècles environ.
Aucune des dates que l’on cite pour les différentes civilisations préhelléniques (Cécrops — 1580, Cadmos — 1314, Minos — 1300) et pour la période héroïque de la Grèce (Hercule de — 1262 à — 1216, voyage des Argonautes — 1226, prise de Troie — 1184, retour des Héraclides — 1104, etc.) n’a de valeur historique. Les noms des personnages eux-mêmes doivent s’entendre au sens mythique.
La chronologie se précise peu à peu : les archontes remplacent les rois à Athènes vers — 1045, dit-on, mais l’époque à laquelle Lygurgue donne des lois à Sparte (ire moitié du IXe siècle avant J.-C.) est bien incertaine ; ce n’est qu’à partir de l’établissement des Olympiades ( — 776) qu’on peut accorder quelque degré de confiance aux dates de l’histoire grecque.
Nous nous bornons à rappeler ici, en années de l’ère chrétienne et en années du cycle olympique, les événements et les hommes auxquels le texte fait allusion ; mais il faut remarquer que dans le passage de l’un à l’autre millésime, il peut se produire une erreur d’un an, les jeux qui marquaient le début de l’Olympiade de quatre ans ayant lieu au mois de juillet.
| Ere chrétienne — |
Ere olympique — | ||
Lois de Dracon (Athènes) |
— 624 | 152 | |
Solon — |
— 595 | 181 | |
Pisistrate, tyran d’Athènes en |
— 561 | 215 | |
Hippias, son fils, chassé en |
— 510 | 266 | |
Expédition de Darius en Scythie |
— 508 | 268 |
Révolte de l’Ionie (Aristagoras) |
— 501 | 275 | |||
Bataille de Marathon (Miltiade) |
— 490 | 286 | |||
— des Thermopyles (Léonidas) |
— 480 | 296 | |||
— de Salamine (Thésmistocle) |
|||||
— de Platées (Pausanias et Aristide) |
— 479 | 297 | |||
— de Mycale (Xantippe) |
— 479 | 297 | |||
— de l’Eurymedon (Cimon) |
— 466 | 310 | |||
Début de la guerre du Péloponèse |
— 431 | 345 | |||
Prise d’Athènes par Lysandre |
— 404 | 372 | |||
Expédition des Dix mille (Xénophon) |
— 400 | 376 | |||
Epaminondas bat les Spartiates à Leuctres |
— 371 | 405 | |||
— — à Mantinée |
— 362 | 414 | |||
Philippe bat les Athéniens et Thébains à Chéroné |
— 338 | 438 | |||
Destruction de Thèbes par Alexandre |
— 334 | 442 | et 443 | ||
Batailles du Granique et d’Issus |
— 334 | et | — 333 | 443 | |
Le Consul Flamininus à Corinthe (année 556 de Rome) |
— 197 | 579 | |||
Prise de Corinthe par Mummius (année 607 de Rome) |
— 146 | 630 | |||
Hésiode (Ascra) |
vécut vers | — 800 | |||
Phidon (Argos) |
— 750 | ||||
Mimnerme (Colophon, Asie Mineure) |
— 600 | ||||
| Périandre (Corinthe) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · vécut de | — 670 | ? à | — 585 | né | en 106 |
Pythagore (Samos) |
— 572 | ? | — 472 | 204 | |
Eschyle (Eleusis) |
— 525 | — 456 | 251 | ||
Cynégire son frère, tué à Salamine |
— 480 | ||||
Pindare (Cynoscéphales, près de Thèbes) |
— 522 | — 442 | 254 | ||
Phidias (Athènes) |
— 500 | — 431 | 276 | ||
Sophocle (Colone, près d’Athènes) |
— 495 | — 405 | 281 | ||
Périclès (Athènes) |
— 494 | — 429 | 282 | ||
Démocrite (Abdère, Thrace) |
— 490 | ? | — 380 | ? | 286 |
Hérodote (Halicarnasse) |
— 484 | — 406 | 292 | ||
Euripide (Salamine) |
— 480 | — 405 | 296 | ||
Thucydide (Athènes) |
— 471 | — 401 | 305 | ||
Myron (Eleuthères) |
— 470 | ? | 306 | ||
Socrate (Athènes) |
— 469 | — 399 | 307 | ||
Hippocrate (Cos) |
— 460 | — 380 | ? | 316 | |
Xénophon (Athènes) |
— 445 | — 353 | 331 | ||
Platon (Egine) |
— 429 | — 347 | 347 | ||
Scopas (Paros) |
— 420 | ? | — 350 | 356 | |
Diogène (Athènes) |
— 413 | — 323 | 363 | ||
Phocion — |
— 402 | — 307 | 374 | ||
Démosthènes — |
— 385 | — 322 | 391 | ||
Aristote (Stagire, Macédoine) |
— 384 | — 322 | 392 | ||
Pythéas (Marseille) |
— 380 | ? | 396 | ||
Praxitèle (Athènes) |
— 360 | — 280 | 416 | ||
Epicure (Samos) |
— 341 | — 270 | 435 | ||
Aristarque (Samos) |
— 320 | ? | 456 | ||
Apollonios (Rhodes) |
— 280 | ? | 496 | ||
Philopœmen (Megalopolis) |
— 233 | — 183 | 543 | ||
Polybe — |
— 204 | — 122 | 572 | ||
de la pensés qui caractérise la Grèce
doit être cherchée dans la faible
influence de l’élément religieux.
PREMIÈRES IMMIGRATIONS. — ÉPOQUE HÉROÏQUE. — INVASION DORIENNE
SPARTE ET ATHÈNES. — GRECS ET PERSES. — CITOYENS ET ESCLAVES
ALEXANDRE. — GRECS ET ROMAINS. — ART, SCIENCES, RELIGION
Les Egyptiens sont strictement cantonnés dans un pays aux limites bien déterminées, l’étroit fossé dans lequel se perdent les eaux du Nil, de la première cataracte aux bouches du delta ; quelle que soit leur origine première par les éléments de race, ils sont bien, comme nation civilisée, issus du limon nilotique. Les Grecs, au contraire, nous apparaissent dans l’histoire avec une certaine indépendance du tracé géographique. Le domaine de cette nation n’a point de contours précis, et se développe au loin comme une draperie flottante autour du Péloponèse et de sa pléiade d’îles et de péninsules. Jusqu’où la Grèce s’étend-elle vers le Nord ? Ne comprend-elle pas l’Acarnanie et l’Epire et le Pinde ? N’embrasse-t-elle pas la Chalcidique et les vallées qui descendent des monts de la Thrace et de la Macédoine ? Elle contient assurément les îles du littoral d’Asie, et certaines régions de la côte à l’orient de la mer Egée furent même parmi les foyers les plus intenses de la vie hellénique.

Les grandes îles, la Crète, et Cypre, projetée très à l’est dans les parages sémitiques, appartiennent également à la Grèce, qui, par ses corsaires, ses marchands et ses fils de race croisée, s’empara aussi de maint rivage sur les côtes de la Syrie. Et vers l’Occident, colonie s’ajoute à colonie ; des Grèces nouvelles, plus vastes que la première, apparaissent successivement au milieu des eaux ; et jusque dans la lointaine Libye, la Cyrénaïque, limitée au sud par la mer des sables, surgit et, pendant quelques siècles, se présente comme une Hellade africaine.
En réalité, la culture grecque semble, comme Aphrodite, être née de l’écume des flots. Quelle origine qu’aient eue leurs migrations par terre, de vallée en vallée et de rivage en rivage, c’est grâce à la mobilité des eaux, cause de la mobilité de leurs riverains, que les Grecs ont pu si facilement échanger d’Europe en Asie leurs produits et leurs idées et naître peu à peu à la conscience d’une civilisation commune.

La mer les unissait beaucoup plus qu’elle ne les séparait, et le nom même qu’ils donnèrent à la Méditerranée et à ses bassins latéraux permet de croire qu’ils le comprirent bien ainsi : dès les temps les plus reculés de l’histoire, ils avaient vu dans les eaux marines plutôt un chemin naturel qu’un obstacle. Les mots pontos, pontus ont le sens primitif de « Grande Route » et proviennent du même radical que le vocable latin pons, indiquant un passage artificiel pratiqué au-dessus des eaux. Sans doute, les matelots ont toujours à redouter que leur esquif ou leur nef se perde sur le chemin des mers ; les aventuriers grecs eurent à le craindre surtout dans le bassin maritime qui a gardé le nom de « Pont » par excellence, la mer Noire ; mais la navigation se faisant presqu’uniquement à proximité des cotes, en vue des havres ou plages de refuge qui se succèdent entre les promontoires, ils pouvaient, en s’exposant aux vents redoutés du large, garder toujours devant leurs yeux l’idée de la route à suivre : ils s’arrêtaient de temps en temps, mais rien ne les détournait de leur but. Les conditions étaient différentes pour les peuples occidentaux qui se trouvaient devant de grandes étendues maritimes ou océaniques souvent bouleversées par les tempêtes : en face de ces eaux sauvages, s’acharnant contre les falaises, ils éprouvaient surtout un sentiment de terreur, et cette impression même leur dicta ces noms de mar, mare, mer, meer, muir, qui impliquent l’idée de violence et de destruction[1].
Entre les deux Grèces, l’européenne et l’asiatique, la mer se présente plus hospitalière aux marins que dans toute autre partie de la Méditerranée : on ne retrouve, au voisinage des continents, des eaux aussi bienveillantes pour l’homme que dans les archipels de la Sonde. Si l’on étudie sur la carte de la mer Egée la distribution des îles qui jalonnent les distances entre les deux rives continentales, on constate l’existence de plusieurs « ponts », véritables alignements de piles insulaires, toutes assez rapprochées les unes des autres pour que les embarcations restent toujours en vue de la terre ferme.
Que l’on parte de l’entrée du golfe Pagasétique, aujourd’hui de Volo, entre la Thessalie et l’Eubée, pour se diriger vers les Dardanelles : dès qu’on a doublé le dernier cap de la péninsule Magnésienne, on se trouve à l’abri d’une longue avenue d’îles, d’îlots, de rochers s’élevant de l’eau profonde, puis au sortir de cette allée triomphale, on n’a qu’à franchir une soixantaine de kilomètres pour se trouver dans les eaux asiatiques, soit dans un port de la Chalcidique, soit à l’abri de la petite île Strati (Halonesos) ; il suffit alors de cingler vers la grande île de Lemnos, la porte des Dardanelles s’ouvre devant le navigateur entre les terres gardiennes, Imbros et Tenedos. Pour se rendre directement en Asie quand on a quitté ces mêmes parages thessaliens, les marins ont un plus long trajet à fournir dans la mer libre que rase le vent du large, mais s’ils passent devant l’île de Skyros, ils n’ont plus, jusqu’à l’île de Psara, première terre de l’Asie, qu’un espace de 80 kilomètres à parcourir ; c’est un voyage de quatre heures par un vent favorable.

Au delà, ils glissent sur les eaux de Chios et des presqu’îles qui abritent Clazomènes et Smyrne. Au sud de ce bassin relativement désert d’îles qui forme la cuve centrale de la mer Egée, les alignements réguliers se profilent de nouveau entre les deux continents. Les îles et les péninsules de la côte d’Europe, l’Eubée, l’Attique, l’Argolide, se continuent suivant le même axe, dans la direction du nord-ouest au sud-est, et forment à travers la mer Egée, dans plus de la moitié de la largeur, de longs détroits, bordés de hautes îles que l’on peut comparer aux propylées d’un temple.

Des ports de la Grèce européenne, les barques cheminent ainsi jusqu’en Asie par les voies abritées qui se ramifient et s’entrecroisent au milieu de toutes ces îles fameuses aux noms si beaux : Andros, Tenos, Mykonos, Keos, Kythnos, Delos, Paros et Antiparos, Melos et Antimelos, Naxos, Amorgos et Ios, Thera, Anaphe, Astypalæa. Des embranchements latéraux rattachent Mykonos aux côtes d’Ephèse par Icaria et Samos, Naxos ou Amorgos à Milet par Patmos ou Kalymnos, tandis que le littoral, merveilleusement découpé, qui darde ses pointes à l’angle sud-occidental de l’Asie Mineure, est masqué par une longue chaîne d’îles formant un parvis maritime asiatique développé parallèlement aux alignements des îles européennes.

Enfin, un arc de cercle presque géométriquement tracé qui comprend Rhodes, Carpathos, Casos, la Crète, Cythère se déploie d’un continent à l’autre comme un rempart semi-circulaire ; la mer grecque par excellence où s’ébattirent les éléments primitifs de la nation se trouve ainsi nettement limitée du côté du large : c’est un vaste berceau préparé pour une civilisation naissante.
Ce n’est pas que la mer Egée soit toujours douce aux matelots et que son flot se déroule toujours harmonieusement sur les plages. Elle s’irrite aussi parfois, et son nom même, dû à ses vagues qui se redressent en « chèvres » bondissantes, nous montre que nos ancêtres grecs la voyaient surtout sous son aspect redoutable. De nombreux récits et, avant l’histoire, les légendes homériques nous disent avec quelle émotion les navigateurs se hasardaient sur les eaux irritées et combien fréquents y furent les naufrages. Le vent le plus mauvais est celui qui souffle du Nord et du Nord-Est, descendant des montagnes de la Macédoine ou même provenant des grandes plaines méridionales de la Russie et se glissant en tempête dans les détroits sinueux. Mais ce vent s’égalise souvent en brise régulière, qui souffle pendant le jour, surtout durant l’été, et qui se calme pendant la nuit. Une alternance s’établit en certains parages avec un rythme si parfait que les marins s’y abandonnent avec toute confiance : la terre, puis la mer « respirent » chacune à son tour, poussant les navires, d’abord dans la direction du large, puis les ramenant dans l’intérieur des golfes. Les dangers qui menaçaient les navigateurs de la mer Egée étaient donc de ceux que des hommes intelligents pouvaient souvent prévoir : ils s’y préparaient, se promettant de doubler tel promontoire avant l’arrivée du grain ou le changement de brise et gardant toujours en vue la lumière lointaine d’une escale ou du port souhaité.
Les plus anciens habitants du monde grec dont les archéologues aient retrouvé la trace ne vivaient point à des âges aussi reculés que les riverains de l’Euphrate et du Nil dont les travaux ont subsisté jusqu’à nous. On fait remonter l’existence de ces Hellènes ou pré-Hellènes à une cinquantaine de siècles environ, bien antérieurement à la venue des Phéniciens dans les eaux de la mer Egée ; et c’est dans les îles que les plus antiques vestiges humains ont été retrouvés, d’où le nom d’ « égéenne » donné à cette première période de la société humaine en ces parages. Les restes exhumés dans la Grèce continentale, à Mycènes (Mukênai), à Tyrinthe, à Vaphio près de Sparte, à Spatha en Attique, sont postérieurs, de 1 000 ans peut-être, à ceux fournis par les fouilles de Crête, de Troade ou de Thera.
Dans cette île, la moderne Santorin, c’est au-dessous de cendres volcaniques que des débris de civilisation ont été découverts[2]. Il ressort de leur examen que les indigènes possédaient encore des instruments de pierre et connaissaient cependant l’usage du cuivre pur. Ils fabriquaient de grands vases fort grossiers en terre blanchâtre et se bâtissaient des maisons de laves, couvertes avec des poutres d’olivier sauvage. 
Cl. Monatsbefte, Berlin.
cnosse (knossos), un magasin à amphores
A terre, les ouvertures d’où on les a extraites.Peuple pastoral et agricole, ils savaient se faire aider du chien, employaient le lait de leurs troupeaux à préparer des fromages, et récoltaient l’orge, l’épeautre, le pois chiche. D’autre part, ils obtenaient par le commerce maritime quelques produits étrangers, entr’autres des vases d’argile[3].
Après la formidable éruption qui projeta en l’air le volcan de Thera, n’en laissant que les piliers en croissant, l’île se repeupla bientôt par des gens de même race que les premiers habitants, car les débris des couches postérieures à l’explosion sont identiques à ceux qu’on retrouve au-dessous. C’est au milieu de cette seconde population que s’établirent les Phéniciens, dont on retrouve quelques tombeaux.
À l’époque où la cendre incandescente se déposait sur les plus anciennes constructions connues élevées par des Grecs, la domination des mers helléniques appartenait aux insulaires de Crète, cette longue île placée en travers de l’Archipel et si favorablement située pour servir d’entrepôt aux marchandises venues de l’Egypte et de la Syrie à destination du monde des îles et des péninsules grecques. Aristote signalait déjà cette fonction naturelle d’intermédiaire revenant à la grande île. Les anciennes traditions s’accordent, en effet, à représenter les Crétois comme les « thalassocrates » par exellence, c’est-à-dire comme les « maîtres de la mer », aux temps qui précédèrent l’histoire. Alors, les Cyclades étaient les « îles de Minos », le roi légendaire de la

Cl. Monatshefte, Berlin.
cnosse (knossos)
inscription funéraire en caractères crétois
1/2 nature.Crète, et des colonies crétoises s’étaient répandues sur les littoraux insulaires et continentaux des alentours, jusqu’en Palestine, où leur nom — Kreti — avait fini par devenir celui des populations du littoral méditerranéen.
Les récentes fouilles d’Evans ont démontré que, dès les premiers âges, il y a plus de cinq mille ans peut-être, les objets de l’industrie égyptienne avaient été importés dans la grande île. Le palais immense du labyrinthe de Minos, le monument le mieux conservé de la civilisation préhellénique, a été retrouvé, avec ses sculptures, ses peintures à fresque, ses inscriptions à caractères préphéniciens ; puis les palais de Phaestos et de Hagia Triada ont été dégagés du sol et ont fourni à leur tour de précieux documents. L’écriture crétoise, alphabétique ou syllabaire, est tout à fait différente des hiéroglyphes égyptiens et des cunéiformes babyloniens, elle se rapprocherait plutôt du système de transcription cypriote ; du reste ces deux écritures auraient pénétré dans le Péloponèse et dans la Grèce continentale aussi loin que la civilisation mycénienne[4].

Le nom d’Aspronisi s’applique à la petite île sur la paroi sous-marine entre Therasia et la pointe sud-occidentale de Thera, les îles du centre sont toutes des Kaïmeni (Brûlées) ; de l’Est à l’Ouest, on a Mikra-Kaïmeni, Nea-Kaïmeni et Palœa-Kaïmeni.
Si la position de la grande île explique le rôle d’importance majeure qu’elle eut certainement à une époque ancienne, sa forme fait comprendre pourquoi la puissance crétoise n’eut pas la force nécessaire pour maintenir à la domination maritime une certaine unité. Non seulement l’île est très allongée, ce qui facilite la segmentation des habitants en groupes distincts sans cohésion forcée, mais les massifs de montagnes sont disposés de telle sorte, au centre et aux deux extrémités, que l’île se trouve réellement divisée en trois domaines naturels sans rapports les uns avec les autres.
Ce fut toujours par l’emploi de la violence, contrairement aux affinités spontanées, que la domination ayant son siège au milieu de la 
Cl. Monatshefte, Berlin.
hagia triada, peintures à fresque,
plantes et animauxCrète, dans les campagnes que domine le mont Ida, berceau de Jupiter, put s’étendre sur les montagnards de l’est et de l’ouest. Par la distribution normale des habitants en groupes disposés linéairement en des vallées de difficile accès, la Crète devait naturellement se diviser en de nombreuses petites républiques, assez fortes pour se défendre chacune contre sa voisine, trop faibles pour résister à une grande invasion. L’île ne présente point d’unité ; se composant de nombreuses individualités ethniques en lutte les unes avec les autres, elle devint une proie facile pour des envahisseurs étrangers ; sa liberté date des temps du mythe et de la tradition, mais pendant les temps historiques, elle fut toujours asservie.
Les Phéniciens furent au nombre de ses dominateurs : ils s’emparèrent de la Crète comme de Santorin et de tant d’autres îles de la Méditerranée. La preuve en est dans le culte du Minotaure, que l’on doit identifier avec le Moloch phénicien, le monstre à tête de bœuf, dont les bras se resserraient sur des victimes humaines. Ce culte dura longtemps, puisqu’il se maintint jusqu’aux temps où les immigrants grecs eurent introduit tous les dieux de leur Olympe[5]. Rhodes, Melos, Syros restèrent aussi pendant plusieurs générations sous la domination des Phéniciens, mais l’île de Cythère, dont le nom même paraît être d’origine sémitique, fut, en dehors de l’Hellade continentale, la station de commerce, d’industrie et d’attaque guerrière la plus importante que les marchands de Tyr aient acquise.

Phaestos se trouve à l’ouest de Gortyne, à six kilomètres de la mer, sur la rive gauche du fleuve ; Hagia Triada est tout près de Phaestos.
Sentinelle placée à l’angle du Péloponèse, au détour de deux mers, elle possédait un port suffisamment vaste et bien abrité où les navires pouvaient attendre à l’aise les vents favorables pour cingler vers la Sicile, les côtes de la Grande Grèce ou de l’Illyrie. En outre, Cythère, très riche en coquillages de pourpre, aidait les industriels phéniciens à développer leur travail de teintures précieuses. Cette île mérita pendant une certaine période de son histoire le nom de Porphyrusa, « île de la Pourpre », et l’on retrouva encore d’énormes amas de coquillages utilisés près de Gythion, au fond du golfe Laconique. Ainsi que l’a établi de Saulcy, les deux espèces de mollusques d’où l’on retirait la matière tinctoriale n’étaient pas les mêmes à Tyr et en Grèce : le murex phénicien était le tranculus, et celui de Cythère le brandaris[6].
Les Phéniciens colonisèrent aussi des îles et des péninsules du nord de la mer Egée : ils s’établirent à Thasos, l’île riche en mines, de même que sur les pentes du mont Pangée qui se dresse sur le continent au nord-ouest de cette île. Peut-être, au bord d’une autre mer, en Elide, exercèrent-ils également une part d’influence. On peut leur attribuer aussi, avec Schliemann, le peuplement d’Ithaque, dont le nom, à peine différent de celui d’Utique, la ville africaine, a le sens de « colonie ». Ainsi le type du voyageur artificieux, le prudent Ulysse, très grec à certains égards, serait-il néanmoins pour une part le représentant du marin de Phénicie ; ce fait que, même de nos jours, tant de Thiakiotes (Ithakiotes) s’adonnent à la navigation et au transport des blés dans la mer Noire s’expliquerait largement par atavisme.
On n’est encore qu’au début d’investigations qui dégagent des traces de civilisations préhelléniques : la sagacité des chercheurs a pourtant fourni déjà maintes belles découvertes. Victor Bérard a montré que des navigateurs s’étaient installés en plus d’un promontoire rocheux rattaché à la côte par une langue de terre ; une demi-douzaine de sites semblables, dispersés de Rhodes à l’Attique, furent nommés par eux Astypalée, en l’honneur de quelque divinité, et devinrent pour les Grecs des Astypalaia ou Ville-Vieille[7]. Si les Phéniciens ne s’étaient guère établis à demeure loin du rivage, s’ils ne pénétraient dans les vallées distantes d’Arcadie qu’en brocanteurs ou en pirates, ils gardaient néanmoins les isthmes et y établissaient des forteresses : Tyrinthe, Mycènes, Korinthos, « dont aucune étymologie grecque ne parvient à expliquer le nom », jalonnent une route dont la possession permet d’éviter les dangereux abords des caps du Péloponèse. Thèbes commande, à égale distance des deux mers, un chemin de traverse entre les golfes de Chalcis et de Corinthe. Ilion, éloignée du rivage, mais à cheval sur une route qui contourne l’entrée de l’Hellespont aux vents hostiles, occupe une position de même ordre[8]. Aux mains des résidants du pays, ces villes leur permettaient de prélever un impôt sur le commerce ; mais trafiquants et habitants étaient trop utiles les uns aux autres pour qu’une coutume ne se soit pas établie, supérieure à la haine de l’étranger : la traversée des isthmes est une des plus antiques opérations qui ait mis les peuples en contact.

L’origine sémitique, phénicienne ou cananéenne de la colonie que dirigea le légendaire Cadmus dans les plaines de la Béotie ne saurait être mise en doute. Qadem est « l’Orient » dans les idiomes sémitiques, et Qadmon ou Qadmoni est « l’Oriental »[9]. C’est le nom que la Bible donne aux Arabes, et probablement celui que prirent les nouveaux débarqués dans leur patrie béotique. La terreur superstitieuse qui s’attache à leur souvenir doit être tenue pour un indice de provenance étrangère. Quoique les Cadméens aient été les instituteurs des Grecs en leur apportant l’alphabet, le plus précieux des biens, ils apparaissent dans le drame comme tout particulièrement maudits par le destin. Ils furent à la fois les messagers et les victimes des mythes de l’Asie : la famille d’Œdipe dut accomplir et subir tous les crimes, autant de rites sacrés préparatoires à l’extinction de leur race, car les Grecs que la légende nous représente sous le nom des « Sept chefs » réussirent à reprendre Thèbes et à la purifier complètement du sang étranger. La colonie phénicienne, non renforcée par de nouveau-venus, devait nécessairement périr, absorbée par les éléments autochtones, et la famille dominatrice était condamnée d’avance, soit à disparaître, soit à s’accommoder au nouveau milieu, en se reniant elle-même.
Peut-être aussi cette famille n’était-elle pas d’origine commerçante et différait-elle à cet égard des autres groupes phéniciens établis dans les ports de la Méditerranée. Peut-être appartenait-elle à un groupe d’émigrants issus des populations agricoles qui vivaient à l’intérieur du pays cananéen, dans les vallées et sur les terrasses des monts. Lorsque les Hébreux eurent occupé partie du pays de Canaan, ils refoulèrent ces agriculteurs vers le littoral, et c’est à la suite de ces migrations forcées que des essaims de colons, cherchant de nouvelles terres, durent émigrer vers les pays lointains pour y trouver, non des entrepôts mais des campagnes de culture analogues à celles qu’ils avaient laissées. La fuite dans une contrée s’était répercutée en invasion dans une autre contrée[10]. C’est ainsi que, après la Réforme, les huguenots persécutés fondèrent tant de communautés nouvelles en Suisse, en Allemagne, en Hollande et en Grande Bretagne.
L’influence que l’Egypte put avoir sur le développement de la civilisation grecque est difficile à déterminer, vu le manque absolu de documents historiques, et l’on ne sait quelle part de réalité il faut attribuer aux légendes fabuleuses des Inachos, des Cecrops, Danaos et autres prétendus fondateurs de colonies égyptiennes sur le sol hellénique. Nous commençons à être renseignés sur les rapports qu’eurent entre elles les populations égéennes et nilotiques : mais c’est à une époque appartenant déjà pleinement à l’histoire grecque, sous la dynastie saïte, il y a vingt-cinq siècles, qu’eurent lieu les emprunts directs de peuple à peuple dont témoignent les découvertes de Flinders Petrie à Naukratis et autres lieux, et que se fit sentir l’influence égyptienne sur la statuaire grecque à ses débuts. Sans doute, il y avait eu précédemment des relations entre les deux continents par l’intermédiaire de la Crète ou d’autres îles, mais une longue période d’isolement sépare les deux âges.

| A. | Rhodes (Redos), colonie | phénicienne. | B. | Karpathos (Scarpanto), colonie | phénicienne. |
| G. | Crète (Candia, Kirid), | » | D. | Thera (Santorin), | » |
| E. | Melos (Milo), | » | F. | Paros (Paro), | » |
| G. | Syros (Syra), | » | H. | Cythère (Kythera, Cerigo), | » |
| I. | Gythion (Marathonesi), | » | J. | Ithaque (Thiaki), | » |
| K. | Lemnos (Limni), | » | L. | Thasos (Thasso), | » |
| M. | Mont Pangée[Bunar dagh), | » | O. | Lampsacus (Lamsaki), | » |
| N. | Abdère — devrait être placée à l’ouest de l’indentation marine, | » | |||
Pendant des siècles la politique absolument exclusive des Pharaons avait enfermé le peuple égyptien dans la fosse nilolique.
Les éléments ethniques qui ont constitué le peuple grec sont sans aucun doute venus de deux côtés parfaitement contrastés, le Nord et l’Est, ici par les voies de la mer, là par les chemins de la montagne. Un courant d’immigration descendit des hautes régions froides du Pinde et des monts balkaniques, l’autre provint des rivages plus tempérés de l’Asie Mineure, de la Syrie ou des îles.
Les gens du Nord, accoutumés à un âpre climat de froidure, de vent et de neige, étaient des cultivateurs besogneux qui n’avaient pas le loisir nécessaire pour s’instruire dans les arts et les sciences ; à demi barbares, ils ne pouvaient échapper à leurs hautes vallées sans conquérir violemment leur chemin à travers des tribus ennemies ; ils se faisaient pillards et guerriers. Refoulés vers le Sud par d’autres émigrants qui venaient de la vallée du Danube, ou de plus loin encore, des plaines de la Sarmatie, ils repoussaient d’autres peuplades devant eux : une trace de sang les suivait, un même ondoiement rouge sur la route qu’ils avaient à se frayer. Pendant leur dur voyage d’émigration qui, d’étape en étape, pouvait durer des années ou des siècles, ils prenaient des mœurs de plus en plus farouches, et, arrivant enfin dans les péninsules rétrécies que limite la mer du Sud, ils se présentaient en conquérants sans pitié.
Les Orientaux, que la vague souple avait amenés dans leurs esquifs rapides, furent aussi en grande partie des pirates et des hommes de guerre, mais ils comprenaient également des essaims de colons venus de pays dont la culture intellectuelle était assez avancée, et qui, s’établissant sur les cotes de la Grèce, apportèrent avec eux leurs industries et leur civilisation supérieure. On peut dire d’une manière générale que l’immigration venue des contrées montagneuses du Nord a surtout fourni la matière humaine, les hommes à l’état brut, et que les navigateurs de l’Est ont fourni les idées, les conceptions nouvelles, les éléments de transformation intellectuelle et morale.
Quoi qu’il en soit, la position même de la Grèce, au point de convergence de tant de voies historiques continentales et maritimes, ne permet pas de croire à une pureté d’origine ethnique pour les populations hellènes. Les historiens sont fréquemment les dupes de vanités nationales. Toutes les aristocraties prétendent naturellement à la descendance de dieux ou de héros sans tache ; toutes les cités, ambitionnant un nom glorieux, cherchent, en leur naïve inconscience, à se donner d’illustres fondateurs unissant dans leur histoire particulière tous les hauts faits accomplis durant le cycle dans lequel ils vécurent. Mais les aristocraties, les cités oubliaient, et les historiens oublient avec elles 
Musée du Louvre.
statue funéraire, défunt divinisé,
influence égyptienneque la plupart des groupes urbains avaient commencé, soit par l’arrivée d’étrangers qui s’unissaient à des femmes du pays, soit par l’établissement de captifs que des conquérants dressaient au travail, soit par une proclamation d’amnistie et de franchise adressée aux brigands et aux désespérés de toute race. La légende ne dit-elle pas que Cadmos fonda ainsi la ville de Thèbes, et que Thésée construisit Athènes autour d’un asile des malheureux[11] ? « Peuples, venez tous ici », telle fut la formule de l’appel que lança le héros lorsqu’il voulut faire de sa ville le rendez-vous de tous. Est-ce la raison pour laquelle Homère, dans son Catalogue des Vaisseaux (Iliade, 547), donne aux seuls Athéniens le nom de peuple[12] ? « Ne cherchez pas la tribu », disait un proverbe, pour indiquer le manque absolu de certitude que présentaient les prétendues généalogies nobiliaires.
Le fond primitif, auquel vinrent s’unir les divers éléments qui donnèrent naissance aux Grecs de l’histoire, fut la nation dite des Pélasges, que la légende et les traditions nous montrent établie surtout en Epire, en Thessalie, en Arcadie, dans les vallées des monts, en certaines îles de l’Archipel : ils se disaient eux-mêmes fils du Lycée, le « mont des Loups », qui se dresse au centre du Péloponèse ; ils se nommaient les « Hommes de la Terre Noire » et les « Enfants des Chênes ». Rudes et fiers, ils étaient beaucoup plus agriculteurs résidants et constructeurs de cités que marins et trafiquants ; cependant ils commerçaient aussi par mer avec leurs voisins des îles et de l’Asie Mineure. Ce sont les Pélasges que la fable symbolisa sous le nom d’Hercule, car c’est à eux que la Grèce dut les grands travaux d’appropriation du sol, le dessèchement des marais pestilentiels, le refoulement des bêtes féroces, la régularisation des cours d’eau, le déboisement des plaines fertiles, la construction des murailles de défense et des acropoles. La postérité les divinisa presque comme des géants, des êtres surhumains, de prodigieux bâtisseurs que leurs descendants, plus débiles, n’eussent pu imiter ; on s’imagina qu’une force supérieure les avait animés quand ils construisirent ces murs qui se dressent encore, çà et là, en mainte partie de la Grèce. Nombre de familles anciennes, principalement dans l’Attique, se vantaient de descendre de ces « autochtones », et cette prétention dut être justifiée en bien des cas, grâce aux mœurs conservatrices des populations agricoles. De même, la langue et la religion se continuèrent à travers les âges, ainsi qu’en témoignent les anciens noms de lieux et de divinités. Les Pélasges avaient déjà leur Zeus, qu’ils adoraient en regardant le ciel bleu, et le dévot Pausanias nous parle des pierres brutes qu’avaient autrefois vénérées les Pélasges et devant lesquelles se prosternaient encore les Grecs, sous la domination romaine.
C’est parmi les Pélasges qu’il faut probablement chercher, nous dit Aristote, les tribus qui donnèrent leur nom de « Grecs » à l’illustre nation qui se forma dans les péninsules et les îles de l’Europe sudorientale. Les Graïkoï ou Graïques, — c’est-à-dire les « Montagnards » ou les « Vieux », les « Antiques », d’après des étymologies diverses, — étaient les rudes habitants des hautes vallées forestières de l’Epire, et près d’eux résidaient les Selles ou Helles, ancêtres des Hellènes, dont le nom rappelle celui de Séléné, la déesse lunaire, celui d’Hélène, la femme de beauté parfaite qui se montre à nous à l’aurore de l’histoire, entre deux peuples s’entr’égorgeant pour elle[13].

Il est intéressant de constater que les dénominations originaires de la nation grecque
lui viennent d’une province montagneuse, l’Epire, qui fut presque toujours considérée comme en dehors de la Grèce proprement dite, à cause du caractère barbare de ses habitants.
La Thessalie, autre pays des origines, où se dresse l’Olympe, le mont sacré par excellence, où coule le Pénée de Tempé entre les bosquets de lauriers, fut aussi fréquemment tenue pour un pays étranger, c’était le territoire dont les premiers habitants jouèrent, sous le nom de centaures, c’est-à-dire pique-taureau, bouviers à cheval, un rôle si important dans la mythologie grecque : là pourtant se trouvait la petite ville de Hellas, qui portait le nom de la race[14], et sur les sommets du pourtour siégeaient les anciens dieux, les Titans, et les dieux nouveaux, le Zeus Panhellénien.

À ces époques préhistoriques, bien plus encore que pendant les âges de la grande prospérité grecque, la Grèce était forcément divisée en plusieurs petits groupes à vie politique autonome, portant chacun sa dénomination particulière. Alors les communications par mer n’étaient pas aussi fréquentes et faciles qu’elles le devinrent plus tard, et les populations d’agriculteurs résidants restaient presque enfermées dans leur domaine étroit. Du nord au sud, on voit se succéder sur la carte ces petits bassins indépendants les uns des autres, bien séparés par un amphithéâtre de montagnes.

Chacune de ces républiques de paysans avait son petit cours d’eau bordé d’arbres, sa plaine asséchée pour les cultures, des forêts sur les pentes, un promontoire ou un roc isolé pour son acropole ou ses temples ; plusieurs avaient aussi leur porte de sortie vers un golfe du littoral. Ainsi tous les éléments nécessaires à une petite société autonome se rencontraient en ces espaces que le regard embrasse dans leur ensemble et qui pourtant forment autant de mondes complets. Chaque île de la mer Egée constituait aussi un univers à faibles dimensions, avec ses vallons et ses ruisselets, ses rochers et ses criques. Il est inutile d’énumérer toutes ces individualités géographiques : elles apparaissent chacune à son tour dans le grand drame de l’histoire.
De tous ces petits mondes distincts se suffisant à eux-mêmes, il en est un qui parait avoir été tout particulièrement remarquable par ses richesses, ses progrès dans la civilisation et la pratique des arts. C’est la nation des Minyens, qui occupait surtout la riche plaine du Kephissos, entre le Kallidromos, l’Oeta et le Parnasse, et dont la capitale était Orkhomenos, près de l’endroit où s’étendaient naguère les eaux du lac Copaïs. Possesseurs de ce magnifique bassin agricole, très bien arrosé, les Minyens disposaient aussi d’un magnifique port naturel, rade immense où leurs flottilles pouvaient attendre le vent favorable pour aller prendre leur vol vers Lemnos, Thasos ou l’Hellespont, contournant l’Eubée soit par le nord, soit par le sud[15]. Il paraît que les Minyens avaient eu la science nécessaire pour régler l’écoulement du lac Copaïs : des galeries souterraines le faisaient communiquer avec le golfe d’Atalante par une des criques du littoral. Ils avaient donc réussi à augmenter la superficie de leur territoire en prairies et en champs de culture et à purifier le sol de ses eaux marécageuses, l’air de ses germes vénéneux. Après eux, les peuples qui se succédèrent pendant trois mille années ayant cessé d’aménager leur domaine, la fièvre, la pestilence, la misère en firent une contrée triste et dangereuse, au sol perfide, à l’air épais. Il a fallu toutes les ressources de l’industrie moderne pour restaurer l’oeuvre des Minyens.
La péninsule de l’Argolide, si élégamment découpée à l’angle nord-oriental du Péloponèse, entre deux golfes profonds et dans la proximité d’un troisième, celui de Corinthe, fut également habitée par des tribus policées qui, aux origines de l’histoire, nous apparaissent comme un peuple initiateur des autres Grecs. C’est à lui qu’appartenait l’hégémonie de tous les « Achéens » à l’époque légendaire de la guerre de Troie ; Agamemnon, le pasteur des peuples, était roi d’Argos. Cette presqu’île, si facilement abordable de toutes parts, devait recevoir, beaucoup mieux que la plaine fermée des Minyens, toutes les influences venues par mer, même de lointains rivages ; on y retrouve des éléments de culture provenant des îles de l’Archipel, de Cypre et de la péninsule d’Asie Mineure. Le caractère essentiellement asiatique présenté par la civilisation d’Argos aux premiers temps de l’histoire est même frappant.

Il y a plusieurs fleuves du même nom en Grèce. Les plus importants sont le Céphise de Béotie que mentionne le texte, et le Céphise qui traverse Athènes. C’est ce dernier que Phidias a représenté.
Les indigènes, non encore assez habiles pour se construire de belles enceintes fortifiées et dédaignant d’entasser grossièrement des pierres brutes comme les Pélasges de l’intérieur, avaient fait appel à des « Cyclopes » de Lycie, terre anatolienne, pour élever leurs remparts. Ce sont des ouvriers originaires de l’Asie Mineure, alors dans l’aire d’influence des Hittites, qui bâtirent les murailles de Tyrinthe, de Mycènes[16], et qui dressèrent à l’entrée de la fameuse acropole des rois ce bas-relief des lions, qui témoigne d’un art primitif encore inaccessible aux Grecs.
Les relations de toute nature qui s’étaient établies entre les diverses communautés politiques des rivages opposés de la mer Egée, en Europe et en Asie, avaient pris une telle fréquence à ces époques lointaines que la mer Noire ou Pont-Euxin était entrée déjà dans le cercle d’attraction de la Grèce : Jason, personnage qui symbolise la force d’expansion des Minyens, Argiens et autres Hellènes, s’associe des héros de toutes les races de la Grèce, triomphe des sortilèges qui défendaient l’entrée de la mer inconnue et, de miracle en miracle, finit par conquérir la « toison d’or ». Des Grecs s’établissent donc en un monde tout à fait différent de leur patrie, à cent mille stades des vallées ou des plages natales, sur les torrents qui charrient l’or du Caucase.

Cette industrie, ce commerce sont devenus assez importants pour que des Hellènes venus de tous les rivages de l’Archipel y prennent part, — c’est là ce dont témoignent les détails du mythe des Argonautes. Si le navire lui-même a pris le nom d’Argos, l’état le plus puissant de la Grèce méridionale, Jason, le chef de l’expédition, est d’origine thessalienne, et c’est du port d’Iolkos, au pied du Pélion, que partent les rameurs. Une pièce de bois, taillée dans un chêne de Dodone, en Epire, prononce des oracles comme la forêt dont elle est issue ; c’est Pallas, dont le nom s’identifia plus tard avec celui d’Athènes, qui donne les plans pour la construction du navire : Hercule, fils de la terre comme les Pélasges, se tient à l’avant du navire pour veiller au danger, tandis qu’Orphée, le Thrace, encourage les rameurs par ses chants et les accords de sa lyre. C’est la Grèce entière, ce sont aussi les terres des aïeux qui s’avancent en masse vers
les régions du Caucase.

Toutefois, il faut bien comprendre que la légende primitive n’était pas un mythe commercial ; suivant les milieux et les âges, tout se transforme et prend un sens nouveau. Il est certain que la plus ancienne forme du récit n’avait aucun rapport avec les mines d’or de la Colchilde : des vers de Mimnerme, qui paraissent dater d’environ vingt-cinq siècles et qui se trouvent intercalés dans la Géographie de Strabon, nous parlent des « rayons du Soleil à la course rapide » qui « reposent étendus sur un lit d’or »[17]. Evidemment, le mythe est purement solaire, et ce lit de rayons d’or, que l’on pourrait d’ailleurs chercher aussi bien à l’Occident qu’à l’Orient, n’est autre que le carquois de flèches déposé par le dieu quand il a fini de parcourir le ciel. Au crépuscule, il les place sur des amas de nuages empourprés ; à l’aurore, il les retrouve sur des écharpes de nuelles roses et reprend sa marche triomphante. Mais où se trouvent elles, ces armes solaires ? Au loin, toujours plus loin, par delà l’horizon des soirs, par delà l’horizon des matins, et il fallut que naquissent des âges utilitaires pour que les esprits étroits, comme celui de Strabon, vissent des lingots d’or en ces rayons du Soleil et une toison de brebis constellée de pépites dans le trésor conquis par Jason[18].
Au point de vue des connaissances géographiques de l’époque, il est également très fructueux d’étudier les versions données sur le voyage de retour des Argonautes d’après les différents auteurs, lyriques, dramaturges ou autres. Tous ces chantres ou historiens d’une longue période épique s’efforcent d’embrasser dans leurs récits l’ensemble des contrées de la terre qui leur étaient connues. Hésiode nous dit que l’Argo remonta le Phase, puis, arrivé dans le grand fleuve océan, se fit porter par lui autour du monde jusqu’au sud de la Libye, d’où il fut convoyé à travers le désert jusqu’à l’un des golfes de la Méditerranée. Un autre itinéraire part de la bouche du Tanaïs pour entrer par un circuit analogue à travers les portes d’Hercule. Mais le tracé qui finit par prévaloir est celui que propose Apollonius de Rhodes : il fait pénétrer l’Argo dans l’Ister ou Danube, d’où, par une série de diramations fluviales, il gagne l’Eridân ou Padus (Pô), puis le Rhodanus (Rhône); il le mène dans le pays des Ligures et des Celtes, lui fait parcourir la mer Adriatique et la mer Tyrrhénienne, visiter l’île d’Elbe, échapper, près du golfe de Naples ou ailleurs, au redoutable chant des Sirènes, puis aux dangers du détroit de Messine et pousser, dans le continent libyen, jusqu’au lac Triton, que cherchent les archéologues actuels sur les côtes de Tunisie.

| A. Ulysse s’embarque à Troie et dirige une excursion de piraterie sur les côtes de Thrace. | |
| B. Pays des Lotophages, île Djerba. | C. Chez les Kyklopes, Champs Phlégréens. |
| D. Chez Eole, Stromboli. | E. Pays des Lestrygons. |
F. Chez Circé (mont Circeo, près Terracina), puis visite au pays des morts (Averne) ; après une nouvelle visite chez Circé, le voyage se dirige vers Messine en traversant la mer des Sirènes (entre Capri et la côte).
| |
| G. Charybde et Scilla (Skylla, détroit de Messine) et île du Soleil (Taormina). | |
| H. Chez Kalypso, l’île Peregil de nos jours, au pied du Mont aux Singes, à l’ouest de Ceuta. | |
| I. Chez Alkinoos et Nausikaa, Corcyre. | J. Retour à Ithaque, après dix années de voyage. |
| a. Iolkos. | b. Ile d’Elbe. |
Le mythe des Argonautes résume toutes les connaissances géographiques des Grecs à l’époque où commence pour nous l’histoire écrite du monde méditerranéen. C’est un document historique de premier ordre auquel s’ajoute le récit des aventures d’Ulysse, et qui correspond au tableau des peuples connus que nous a conservé la Genèse ; seulement, le résumé ethnographique transmis par les Sémites présente un caractère plus étroit. Les Hébreux tenaient surtout à se remémorer leur propre généalogie et à déterminer leurs relations, de parenté ou de haine héréditaire, avec les peuples qui les entouraient ; ils n’étudiaient le monde qu’à leur point de vue tout égoïste de nation choisie, tandis que les Grecs, plus curieux, sollicités par la pittoresque variété des rivages qui se déroulaient devant eux, comprenaient les étendues environnantes à un point de vue plus objectif : ils cherchaient, non à se glorifier, mais à savoir. Ce contraste est naturel entre deux races dont l’une habitait un étroit domaine entouré par le désert, dont l’autre, mobilisée par son milieu, se déplaçait volontiers de-ci de-là, sur les flots changeants de la Méditerranée.
Les conflits d’intérêts, les ambitions rivales qui devaient se produire entre les peuples, des deux côtés de la mer Egée, finirent par amener une violente rupture d’équilibre : ce fut la guerre de Troie, dans laquelle on vit la plupart des Grecs occidentaux, guidés par les Achéens, porter la guerre sur les côtes de l’Asie Mineure et s’y heurter pendant de longues années contre les populations dardaniennes de la contrée, apparentées aux Thraces de l’Hœmus, aux Phrygiens de l’Anatolie intérieure. On ne sait qu’à une couple de siècles près l’époque où eurent lieu ces terribles conflits dont la mémoire se maintiendra toujours parmi les hommes, grâce aux chants d’Homère et des rhapsodes ; on ne peut être sûr non plus que la Troie autour de laquelle le cruel vainqueur traîna le cadavre d’Hector soit une des villes exhumées par Schliemann sur la colline d’Hissarlyk : aucune inscription ne rendant authentique la découverte du « trésor de Priam », on ne peut encore préciser la place d’Ilion dans le temps et sur le sol. Ce qui est certain, c’est que le choc eut lieu et qu’il mit en mouvement, comme un orage, les populations de l’Hellade et de l’Asie Mineure ; on ne saurait également douter que les étroits bassins du Simoïs et du Scamandre, qui viennent aboutir à l’entrée même de l’Hellespont, n’aient été les lieux de rencontre entre les combattants ; les ruines, les tertres funéraires, les débris de villes calcinées témoignent de l’importance des événements qui s’accomplirent autrefois à cet angle nord-occidental de l’Asie Mineure. Peut-être pourrait-on concilier les affirmations contradictoires des savants à propos des temps et des lieux, en admettant qu’il y eut plusieurs « guerres de Troie » ; l’épopée d’Homère symboliserait alors toute une longue époque pendant laquelle les corsaires grecs faisaient des incursions guerrières dans ces beaux et riches territoires de la Dardanie. Tantôt vainqueurs, tantôt vaincus, ils finirent par s’emparer des forteresses ennemies, et les Troyens survivants eurent à chercher un asile en terres étrangères. C’est ainsi que procèdent les nations pour résumer en une épopée ou même en un simple mythe toutes les vicissitudes d’un cycle de l’histoire.

Si l’on s’en tenait strictement au récit de l’lliade, il faudrait croire à une parenté très rapprochée entre les envahisseurs grecs et les Troyens. Les mœurs, les coutumes sont représentées comme étant les mêmes de part et d’autre ; des côtés opposés du rempart, les combattants se provoquent dans la même langue ; les dieux auxquels on adresse des objurgations ou des actions de grâce diffèrent les uns des autres, mais ils siègent sur le même Olympe. Des historiens ont ainsi pu prétendre avec une grande apparence déraison, en s’appuyant sur le texte précis des anciens chants, qu’il n’y avait aucune différence essentielle de race ou d’origine entre les armées qui se disputaient Ilion. Mais une épopée n’est point un mémoire historique. Elle transforme les événements qu’elle met en scène ; comme le théâtre, elle leur donne la même langue, elle les place en un même milieu[19] : les conditions de l’intérêt populaire sont à ce prix ; on n’eût pu tolérer l’intervention d’un interprète entre deux héros qui s’entre-heurtent, animés par des passions furieuses. De même que dans les romans de chevalerie, Croisés et Sarrasins s’interpellent comme s’ils avaient un langage commun, de même, dans le recul des temps lointains, le poète ne se gêne point pour faire converser comme autant de Grecs les guerriers de Troie et leurs alliés venus des profondeurs de l’Asie. Il se peut qu’en réalité le contraste des idiomes, des pensers et des mœurs ait été considérable entre les peuples en lutte ; il se peut que, dans une certaine mesure, la guerre de Troie symbolise un conflit entre l’Europe et l’Asie, analogue à celui qui se produisit pendant les guerres médiques. Qu’on se rappelle le début des Histoires d’Hérodote ! Dès ses premières paroles le grand voyageur, remontant aux origines, établit une différence ethnique entre les Européens et les Asiatiques et rend les Perses solidaires des Troyens : la cause de l’inimitié héréditaire serait bien, d’après lui, la ruine d’Ilion par les Grecs.
Quoi qu’il en soit, le cycle de la civilisation était certainement le même pour tous les riverains de la mer Egée, orientaux et occidentaux. Les uns et les autres avaient depuis longtemps dépassé l’âge de la pierre ; ils étaient encore en plein dans l’âge du bronze, bien que déjà les armes de fer fussent probablement en usage. Un beau vers que trois mille années n’ont pu vieillir revient deux fois dans l’Odyssée (XVI, 394 ; XIX, 13) : « De lui-même le fer entraîne l’homme ». Cette parole, que la répétition même indique comme ayant été un proverbe, ne peut avoir pris ce caractère de dicton que dans un siècle où, pour se battre, les guerriers employaient le fer, le métal dont les bourreaux et les soldats se servent encore pour trancher les chairs, couper les membres et les têtes[20]. Le témoignage des Grecs eux-mêmes est unanime à faire remonter aux Asiates le mérite de la découverte de la fabrication du fer. De toute antiquité les mineurs chalybes, qui vivaient sur les rives méridionales du Pont-Euxin, vers les bouches de FIris, étaient fameux comme fabricants d’armes, et même ils apprirent à durcir le fer, à le changer en acier : d’où le nom de chalybs que prit le nouveau produit.

La difficulté de tourner la pointe de Kum-Kalessi conduisit les marins à établir une route de terre entre la baie de Bechik (Besika Bay) et la première anse du détroit des Dardanelles. C’est cet isthme que surveillait Ilion.
La guerre, fatale aux Troyens, qui furent exterminés ou vendus comme esclaves sur les marchés lointains, fut aussi funeste aux Grecs : elle ne porta que malheurs avec elle. Tandis que les peuples civilisés des petits États de la Grèce méridionale envoyaient leurs hommes les plus vaillants et dépensaient toutes leurs ressources à la conquête d’un empire, les Doriens, barbares du Nord, profitaient de l’affaiblissement de leurs voisins et parents pour envahir les contrées du Sud, appauvries, privées de leurs défenseurs : une nouvelle migration de Grecs eut lieu. La disposition triangulaire de la péninsule des Balkans devait avoir pour conséquence de comprimer les peuples dans la direction du Sud ; chaque grand mouvement se propageant des plaines du Nord aidait aux migrations qui se faisaient des vallées de l’Hæmus et du Pinde vers la Thessalie et l’Epire, et de ces contrées elles-mêmes vers les bords du golfe de Corinthe et le Péloponèse. C’est ainsi que les Pélasges s’étaient répandus dans les contrées du Sud, ainsi que les Argiens du Nord, groupés au pied de l’Olympe, avaient émigré vers la péninsule du Midi qui devint l’Argolide.
Homère mentionne à peine les Doriens ; ceux-ci, pauvres clans de montagnards, ne comptaient guère à son époque parmi les peuples de la Grèce proprement dite. Pourtant les dissensions des Hellènes policés et l’affaiblissement des États méridionaux leur fournirent l’occasion de prendre un ascendant qui dura pendant des siècles. Guidés par des princes achéens qui se prétendaient « fils d’Hercule » et qui voulaient retourner en conquérants dans leur patrie, les Doriens quittèrent leurs âpres régions pour aller gaiement au pillage de contrées plus ensoleillées. De rudes agriculteurs et de pâtres qu’ils étaient, ils se firent, nous l’avons dit, hommes de carnage et de butin, ce à quoi leur milieu sauvage les prédisposait déjà. Ils apprirent à vivre, « non du soc de la charrue mais du fer de la lance » : terres, esclaves, richesses, ils demandèrent tout à cette pointe acérée qu’ils tenaient devant eux. Il semble d’ailleurs que ce mode de combattre leur facilita la victoire : contre les Achéens qui se précipitaient en désordre, à la façon des héros d’Homère, en commençant par se braver et s’injurier mutuellement, les Doriens s’avançaient en silence, pressés les uns contre les autres, comme un rempart mouvant[21] : c’était presque la phalange macédonienne, plusieurs siècles avant Philippe.
Les invasions doriennes se succédèrent probablement pendant de nombreuses générations d’hommes, et tous les indices s’accordent pour faire de cet exode la simple continuation de mouvements antérieurs qui avaient amené les « Hellènes » proprement dits, ou plutôt les rois conquérants et chefs de guerre, parmi les autochtones de race pélasgique. Les aristocrates aux grands yeux bleus, à la chevelure flottante et dorée, au crâne allongé, au nez droit sans dépression à la racine, ces beaux hommes souples et forts qu’aiment à représenter nos poètes et les sculpteurs, auraient été des « Hyperboréens », des immigrants du Nord, frères des Germains et des Scandinaves.
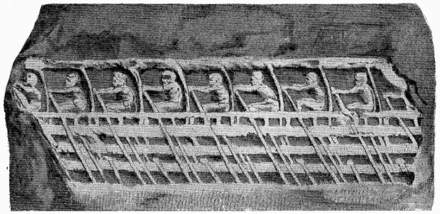
bas-relief de l’acropole d’athènes
Venus à différentes époques, mais toujours en maîtres, ils se considéraient volontiers comme les Grecs par excellence, quoiqu’ils fussent peu nombreux en proportion des habitants originaires, et qu’ils fussent nécessairement condamnés à perdre leur type, si ce n’est en Albanie peut-être, pour ressembler aux hommes bruns qui constituaient le fond national. Du moins avaient-ils conservé leur langage, appartenant à la souche aryenne comme celui des populations du nord de l’Iran.
Après le grand ébranlement dû aux invasions doriennes, dites le « retour des Héraclides », l’équilibre de la Grèce continentale et du Péloponèse se trouvait complètement changé. Une « Doris » ou population dorienne pure occupait la haute partie du cirque de montagnes où naît le Céphise béotien, entre le Kallidrome et le Parnasse : c’est là, ou plus près de l’ancienne patrie thessalienne, que s’étaient établis les clans doriens qui gardèrent le mieux les mœurs originaires, cultivant eux-mêmes le sol des âpres et pauvres vallées qu’ils avaient conquises. Mais le gros de l’armée envahissante avait poussé plus avant, s’était emparé de la Phocide jusqu’au golfe de Corinthe, puis, contournant l’Attique, vaillamment défendue, avait forcé les portes du Péloponèse, à Mégare, à Corinthe et, refoulant, massacrant, asservissent les populations résidantes, avait fait, par le droit de la lance, une terre dorienne des anciens royaumes et communautés pastorales de l’orient et du centre de la péninsule.
L’Argolide et la Lacouie surtout devinrent les centres de la domination dorienne, sans que, d’ailleurs, la race des conquérants s’y conservât pure : plus tard, les rois de Sparte eux-mêmes se vantèrent de leur origine achéenne[22]. Les régions du Péloponèse qui, en tout ou en partie, échappèrent aux Doriens furent les terres montagneuses du nord et du centre. Les Achéens, repoussés dans les vallées du Cyllène et de l’Erymanthe, se pressèrent les uns contre les autres en vue des eaux du golfe de Corinthe ; les pasteurs Arcadiens, cantonnés dans leur forteresse, au milieu du Péloponèse, gardèrent en maints endroits la jouissance de leurs forêts et de leurs prairies, et si les Messéniens durent à la fin recevoir la loi de l’atroce vainqueur, du moins fut-ce après avoir résisté héroïquement. Quant à l’Elide, aux belles campagnes arrosées par des eaux abondantes, elle était absolument ouverte aux invasions doriennes, et fut en effet soumise à des rois de la race conquérante, mais en vertu d’un accord avec des cités confédérées. Bien avant que les jeux olympiques devinssent la fête de la Grèce par excellence, l’Elide était un pays vénéré de tous, grâce à un sanctuaire fondé par le mythique Pélops et aux jeux publics qui ajoutaient à la sainteté et à la renommée du temple. Aussi la contrée fut-elle relativement épargnée par les féroces Doriens et, plus tard, échappa-t-elle longtemps aux incursions et aux pillages, malgré les énormes richesses qu’y apportaient les fidèles et les gymnastes. De même, de l’autre côté du golfe de Corinthe, le petit État sacerdotal de Delphes dut à la majesté de ses oracles le maintien de son indépendance et l’acquisition de ses trésors[23].
Même par delà les détroits et la mer, les peuples eurent à se déplacer par suite de la grande migration dorienne, qui, après la prise de possession des ports du Péloponèse, se poursuivit aussi sur les eaux. Ainsi les Ioniens, trop comprimés dans l’Attique, terre trop étroite pour eux, durent par contre-coup essaimer vers les côtes de l’Asie Mineure pour y chercher des patries nouvelles ; de belles cités naquirent au bord des golfes abrités, sur des promontoires faciles à défendre, et 
D’après Pouqueville.
types de héros grecsquelques-unes d’entre elles, devenues de grands entrepôts de commerce, des lieux d’étude et de savoir, prirent dans l’histoire de la pensée humaine une place à peine moins grande que celle de l’Athènes d’Europe[24]. Dans cette partie du monde ancien se produisit donc un mouvement historique très puissant, orienté de l’Ouest à l’Est, précisément en sens inverse de la marche prétendue normale de la civilisation, décrivant sa trajectoire dans la direction de l’Occident. La riche floraison de culture qui s’accomplit dans les péninsules de l’Asie Mineure eut certainement parmi ses causes majeures ce fait considérable que les exilés volontaires de la Grèce européenne comprenaient surtout des hommes exceptionnels d’initiative et d’intelligence. Quelles que soient d’ailleurs les heureuses conditions du milieu nouveau, les colonies fondées par des hommes que de fortes convictions ou des passions énergiques soutenaient dans leur désastre se sont toujours illustrées parmi les communautés politiques. Mais combien ces vaillants hommes furent-ils en cette circonstance aidés par la nature !
Les presqu’îles frangées de l’Asie Mineure, les vallées fertiles qui découpent le littoral, les îles qui forment comme un deuxième rivage au-devant du premier et lui donnent une succession de rades et de ports naturels, tout cet ensemble qui diffère tellement par son aspect et sa nature du haut plateau anatolien, âpre, monotone, aride et se développant en bassins fermés autour de baies salines, constitue en réalité un monde tout à fait à part : c’est, en géographie comme il le fut en histoire, une véritable Grèce asiatique[25] ; mais cette autre Hellade se distinguait de la première par des proportions plus grandes. Les terres de l’Asie grecque ont de larges campagnes d’une tout autre ampleur et d’une plus grande richesse en alluvions généreuses que les petits bassins étroits du Péloponèse et de la Béotie. Des fleuves abondants les parcourent, fournissant en suffisance l’eau nécessaire à l’irrigation, ouvrant des chemins de communication faciles avec les plateaux de l’intérieur et les populations lointaines du Taurus[26].
De toutes les villes de cette Hellade d’Asie, Milet fut celle qui développa le plus d’initiative et d’intelligence pour l’extension de son commerce et de sa gloire. D’ailleurs, elle disposait d’avantages naturels de premier ordre : située vers le milieu des parages de navigation qui s’étendent de l’entrée de l’Hellespont à l’île de Crète, elle occupait l’issue de la vallée la plus large, la plus fertile et la plus longue de toute l’Asie Mineure occidentale, elle se trouvait donc au lieu le plus favorable pour l’échange entre les terres de la mer Egée et les contrées de l’intérieur, Phrygie et Cappadoce. Aussi les marins de toute race qui s’étaient succédé comme « thalassocrates » dans la Méditerranée orientale, les Phéniciens, les Cretois, les Cariens, puis les Ioniens, avaient les uns après les autres occupé le port de Milet, lui donnant, par le mélange de leurs civilisations diverses, un caractère essentiellement cosmopolite et une remarquable intelligence commerciale. Et les Milésiens, prudents acquéreurs de richesses, s’étaient bien gardés de se lancer dans une politique de conquêtes, qui peut-être n’eût pas été difficile : évitant les routes du plateau qui s’ouvrait à eux par la vallée du Méandre, ils se bornaient de ce côté au rôle d’intermédiaires du trafic et profitaient surtout des chemins de la mer pour aller chercher des matières premières à leur industrie chez les peuples lointains.

Ils s’assurèrent néanmoins d’une route terrestre qui permît d’éviter le couloir des Dardanelles, souvent fermé par des vents contraires ; ils se fixèrent à Skepsis, à l’étape médiane entre le golfe abrité par Lesbos du côté de l’Archipel et la baie de Kizique sur la Propontide[27]. La mer Noire finit par devenir le domaine presque exclusif des Milésiens. De l’Hellespont à la Khersonèse Taurique et au pied du Caucase, ils fondèrent environ quatre-vingts comptoirs, dont beaucoup si bien choisis qu’ils devinrent des cités considérables et se sont maintenus jusqu’à nos jours malgré les vicissitudes de
l’histoire[28]. Quant à la cité mère, la glorieuse Milet, les avantages exceptionnels que lui avait donnés la nature ne devaient durer qu’un temps ; elle était condamnée par les éléments à disparaître un jour ou du moins à se déplacer ; car les alluvions du Méandre, ne cessant de gagner sur les eaux du golfe Latmique, enfermèrent graduellement la cité d’une ceinture de marais ; ses ruines sont perdues maintenant au loin dans l’intérieur des terres.
Combien d’autres cités ioniennes, éoliennes, doriennes se fondèrent, comme Milet, sur ces rivages heureux de l’Asie Mineure et dans les îles de la côte. A l’angle sud-occidental de la péninsule anatolienne naquit Halicarnasse, le « Fort de la mer » ; Diane vit son temple se dresser dans Ephèse, ville qui se fit conquérante et s’acquit de vastes territoires en terre ferme, tandis que Milet songeait à établir des comptoirs sur les rivages des mers seulement. Samos, Smyrne, Chios, Phocée, Cumes (Cyme) portent des noms à peine moins glorieux que celui de Milet, et chacune de ces mères eut aussi de nombreuses filles parmi les cités riveraines de la Méditerranée. Les colonies de l’Orient hellénique possédaient un lieu de ralliement dans l’île de Delos où se célébraient de grandes fêtes religieuses depuis des temps immémoriaux, et où les Grecs occidentaux, Athéniens et gens de Chalcis, venaient se rencontrer avec leurs frères des tribus émigrées[29].
Dans leurs exodes, les Grecs, toujours très imaginatifs, aimaient à donner pour raison de leur déplacement un oracle de l’Apollon delphien, tandis qu’en réalité les causes diverses étaient toujours d’ordre économique, social ou politique. Des haines de classes, des rivalités entre familles ambitieuses, l’insuffisance des champs de culture, la perte ou l’amoindrissement du territoire, ainsi que ce fut le cas lors des invasions doriennes, telles furent les vraies raisons déterminantes de ces migrations.

La plus fameuse de toutes est celle qui donna naissance aux « douze cités ioniennes » de l’Asie Mineure, mais combien d’autres essaims se portèrent vers des rivages éloignés, de la Thrace à la Sicile, et de la Sicile aux portes de l’Océan ! L’esprit d’imitation, le
goût des aventures contribuèrent également pour une forte part à ce mouvement d’expansion des Grecs : les jeunes gens se décidaient assez facilement à l’expatriation, tant la mer paraissait propice aux voyages, tant l’espoir d’un destin favorable entrait aisément dans l’âme hardie de l’Hellène. L’oracle consulté répondait naturellement suivant les vœux de ceux qui s’adressaient à lui, et bientôt les barques fuyaient vers des contrées que l’on ne connaissait guère que par des récits fabuleux, mais où l’on retrouvait des sites analogues à ceux de la patrie. Les îlots de Massilia ne ressemblaient-ils pas à ceux de Phocée, et la fontaine d’Aréthuse qui jaillit dans l’île syracusaine d’Ortygie n’est-elle pas la résurgence du fleuve Alphée ? Partout on pouvait reconstituer une image du lieu natal, avec son acropole, ses temples et ses autels bocagers.

C’est sur le versant sud du Mykale (Mycale, aujourd’hui Samsun), entre la montagne, la rivière et Priène, qu’eut lieu, en l’an 479 avant le début de l’ère chrétienne, la bataille navale et terrestre où les Grecs, sous Xantippe, défirent les Perses.
Milet, Samos, Myus (Myonthe) et Priène, villes mentionnées sur la carte, firent partie des « douze cités ioniennes ». Les autres étaient Ephèse, Lebedos, Clazomènes, Erythrée, Kolophon, Phocée, Teos et Chios. Leur centre religieux était le sanctuaire de Poséidon à Priène. La confédération, dissoute par Cyrus, se reforma après la conquête d’Alexandre et persista plusieurs siècles ; on retrouve encore son nom sur une monnaie de l’époque de Valérien (iiie siècle).
Le grand mouvement des migrations qui fut la conséquence des invasions doriennes eut donc à maints égards des résultats heureux dans l’histoire de la civilisation grecque, puisqu’il étendit de beaucoup le domaine de la race et de la langue : toute la moitié du bassin de la Méditerranée se trouva ainsi conquise à l’influence partie de la petite péninsule hellénique. Que de cités d’origine barbare se vantèrent d’avoir eu pour origine des colonies grecques : jusqu’aux Irlandais de nos jours qui, par fierté nationale, se donnent sérieusement le nom de Milésiens ! À l’étranger, loin des villes conquises, des champs ravagés, les diverses sous-races entre lesquelles se divisait la nation grecque. Doriens, Ioniens, Achéens, Eoliens, apprenaient à se détester moins, à se sentir davantage les fils de la même mère Hellade, et des mélanges nombreux eurent lieu entre les descendants des frères ennemis. Ainsi, les Doriens qui continuèrent leur migration par delà les mers, en Crète, à Rhodes, dans les presqu’îles de l’Asie Mineure, jusque dans la Cyrénaïque, cessèrent bientôt de ressembler aux hommes de leur race qui en représentent le mieux l’âpre génie, les durs guerriers Spartiates : ils changèrent avec le milieu. On peut en juger par le plus célèbre des Doriens, Hérodote, le glorieux fils d’Halicarnasse. C’est dans le doux dialecte ionien qu’il écrivit ses Histoires, c’est vers Athènes, comme vers la patrie de sa pensée, qu’il revenait après ses longs voyages dans les diverses parties du monde connu, et lorsqu’il mourut, il s’occupait à fonder une colonie athénienne dans la Grèce de l’Italie, sur l’emplacement de l’ancienne Sybaris, démolie par les Crotoniates.
Mais si l’expansion de la race hellénique fut un des heureux résultats indirects de l’invasion dorienne, les conséquences directes dans les pays immédiatement frappés en furent terribles et firent brusquement reculer la culture chez les populations conquises à la pointe de la lance et que la haine de l’oppresseur réduisait à la servitude. Les Doriens, envahisseurs barbares, ont trouvé naturellement des historiens, adorateurs de la force, qui se sont rangés du côté des vainqueurs, précisément parce qu’ils ont vaincu et qu’il est profitable d’aduler les puissants, même ceux qui sont morts depuis des milliers d’années. Il est certain que le régime imposé par les Spartiates fut atroce et que le peuple des Hilotes, de libre et policé qu’il était avant la conquête, devint un lamentable ramassis d’esclaves : jamais il ne put se relever de son abjection et jamais ses maîtres ne purent atteindre à l’idée de la liberté civique ; bien que Grecs, ils restèrent vraiment « barbares ». Comme un corps étranger introduit dans un organisme sain, ils développèrent dans le monde grec des maladies redoutables. On peut dire que de toutes les causes de mort déposées dans la civilisation hellénique, c’est leur action qui fut la plus funeste.
Le régrès de l’Hellade se manifesta surtout de la manière la plus évidente dans les contrées du nord, Epire et Thessalie, que les Doriens avaient traversées en entier dans leur invasion triomphante. Ces régions, qui tenaient une si grande place dans la mémoire et dans la religion des Grecs et où se maintenait dans leur pensée le siège de leurs dieux, cessèrent d’être considérées comme appartenant au monde hellénique.

La force des populations du nord pour toute initiative supérieure ou pour tout exemple à suivre se trouva définitivement épuisée : pendant les trente siècles de l’histoire connue, cette poétique Thessalie, qui donna tant d’éléments précieux à notre avoir légendaire et mythique, n’a pris aucune part appréciable à l’action de l’humanité. Même dans les contrées du sud, qui maintinrent quand même le nom de la Grèce, l’invasion dorienne fit d’abord reculer en tous lieux la culture hellénique, ainsi qu’en témoignent nettement les manifestations d’art. Comme tous les gens de guerre, les Doriens étaient pleins d’un arrogant mépris pour les inventions, les métiers, les œuvres, les idées des nations dont ils envahissaient le territoire, ils n’avaient que faire des beaux vases, des figures sculptées, des bijoux patiemment gravés. Il y a régression incontestable dans le travail et la richesse, dans l’art et l’industrie, après la période que l’on peut désigner comme « achéenne » ou « mycénienne », et un siècle ou deux durent s’écouler avant que le progrès eût repris son cours normal[31].
D’ailleurs, une grande partie du monde grec était encore dans la phase purement agricole de son développement, et, chose curieuse, ceux qui s’occupaient d’un autre labeur que celui de la culture, pour lequel la force et la santé sont indispensables, étaient régulièrement choisis parmi les infirmes : l’agriculteur hellène, de même qu’en nombre de districts le paysan français décidant que tel fils malvenu sera prêtre ou maître d’école, avait grand souci de remettre sa terre à des héritiers vigoureux et de solide membrure ; les boiteux se faisaient d’ordinaire forgerons, et c’est pour cela que ceux-ci attribuèrent la même infirmité à Hephaïstos, leur divin patron ; les aveugles, comme le plus illustre d’entre eux, Homère le rhapsode, se faisaient chanteurs, danseurs, improvisateurs et récitateurs de vers. Incapables de tirer leur propre nourriture du sol et de vivre d’une manière indépendante, les artisans et les chanteurs étaient obligés de travailler pour la communauté : ils devenaient « démiurges », c’est-à-dire les « travailleurs du peuple », et n’étaient pas absolument considérés comme des hommes libres[32].
Aux temps d’Homère, les Grecs sont loin d’être les premiers dans les arts, et ils ne font aucune difficulté pour le reconnaître : ce sont des produits d’origine étrangère qu’ils célèbrent comme étant les plus beaux : épées de la Thrace, ivoires de la Libye, bronzes de Cypre et de la Phénicie. On a trouvé des bijoux dans les tombes athéniennes de cette époque, mais pour la qualité du métal, aussi bien que pour l’originalité de la décoration, ils sont très inférieurs à ceux que l’on a retirés des tombes mycéniennes. Les métaux précieux étaient devenus moins abondants et d’un emploi plus rare. En outre, le style a changé : l’artiste ne prend plus ses modèles dans les mille formes de la vie, plantes et animaux ; à l’exception de l’oiseau des marais, et plus tard du cheval et de l’homme, il ne représente plus de formes animées. Il n’avive plus les courbes, et ses motifs sont empruntés à des figures géométriques, sans doute élégantes et variées, mais toujours rectilignes.

Ce système d’ornementation, qui coïncide avec l’invasion dorienne, a dû très probablement être apporté par elle des régions de l’Europe centrale et se rattache au style qui a prévalu chez les populations septentrionales, sur les rives de la Baltique. Il remplaça un art beaucoup plus riche et plus avancé qu’avaient connu des populations plus riches et plus civilisées. Mais ce ne sont point les Doriens porteurs du style nouveau qui en furent les meilleurs interprètes : c’est dans l’Attique, destinée à devenir plus tard le pas par excellence de la sculpture, que les poteries à dessins géométriques arrivèrent à leur perfection. La finesse de l’argile recueillie

Cl. Giraudon.
lécythe blanc a figures noiresdans le sous-sol de la plaine du Céphise d’Attique fut pour une grande part dans cette excellence des produits athéniens, mais le goût naturel des céramistes annonce déjà la race qui devait élever les monuments de l’Acropole.
En jetant les yeux sur une carte de la Grèce, l’observateur, sans connaissance préalable de l’histoire, tombé, supposons-le, d’une planète voisine, remarquera d’abord quelques points vitaux, où, devra-t-il lui sembler, se concentrera le cours des événements. Tout d’abord il sera frappé par la position géographique de Corinthe, située près de la partie la moins large et la moins accidentée de l’Isthme, au pied d’un rocher facile à transformer en citadelle. Ses plages et les criques voisines, d’un côté sur le golfe de
Corinthe, de l’autre sur le golfe Saronique, sont autant de ports naturels, et les eaux mêmes de ces golfes, entourées de montagnes ou d’îles élevées, servent de rades aux navires. En ce lieu devait naître un entrepôt de trafic, d’abord entre les rivages des deux petites mers qui séparent le Péloponèse de la Grèce continentale, puis entre la
mer Egée, l’Adriatique et tous les rivages de l’Occident. Lorsque l’histoire commence, Corinthe nous apparait comme une ville illustre entre les villes, et les divinités de la
mer, apportées par les Phéniciens, trônent dans ses temples. La fable nous dit que, déjà bien avant les envahisseurs doriens, Sisyphe y roula les puissants rochers de la forteresse, ce qui donna sans doute occasion à ses ennemis d’imaginer le tourment auquel il fut condamné dans le Tartare, celui de remonter sur une pente un roc qui dévalait avant 
Cl. Giraudon.
amphore chalcidienne, les bœufs de geryon
d’atteindre le sommet. A l’époque de sa prospérité, Corinthe devint la cité de la Grèce qui renferma le plus grand nombre d’habitants se pressant dans une seule enceinte : trois cent mille personnes s’y trouvaient réunies. L’échange des marchandises ne suffisant pas à son activité, elle s’improvisa grand centre de fabrication pour les poteries, les métaux, les œuvres de luxe et d’art. Quelques-unes de ses colonies furent parmi les plus célèbres du monde hellénique, notamment Corfou et Syracuse, celle-ci la plus grande et la plus peuplée de toutes les cités coloniales. Telle était la gloire de Corinthe que son nom s’identifia souvent à celui de la Grèce entière : le jour de sa destruction par les Romains, il y a vingt siècles et demi, fut considéré par tous comme la fin même de la nation.
Autre lieu que l’examen sommaire révèle aussitôt comme vital pour la rencontre des hommes et l’échange des marchandises : Chalcis. Cet endroit privilégié possède à la fois les avantage d’une ville continentale et ceux d’un port maritime. La cité se trouve au loin dans l’intérieur des terres, et cependant au point de rencontre de deux golfes ; elle commande à la fois les chemins maritimes du Nord et du Sud, et par un simple pont, facile à défendre en cas d’attaque, se rattache à la péninsule de l’Attique et à l’ensemble de l’Europe. En outre, elle avait une source locale de richesses, fournie par ses mines de cuivre, et de toutes parts accouraient les marchands. Devenue centre de commerce et de puissance, elle fonda de nombreux comptoirs sur les rives lointaines et finit même par devenir la métropole de trente-deux villes, bâties par elle dans la triple péninsule projetée comme une main au sud de la Thrace et connue encore de nos jours sous le nom de « Chalcidique ». Combien grand eût pu devenir le rôle de Chalcis, comme celui de Corinthe, si les avantages de sa position avaient été complétés par un domaine environnant d’une grande étendue, présentant un caractère d’unité géographique ! Mais Chalcis et Corinthe n’étaient que des points, pour ainsi dire, et, malgré leurs avantages locaux extraordinaires, elles furent distancées historiquement par des cités moins favorisées quant au site, mais ayant de plus vastes territoires pour dépendances naturelles.
Dans la concurrence vitale qui se produisit entre les nombreuses cités de la Grèce, avec leurs divers avantages locaux pour la production agricole, industrielle ou minière, les facilités du commerce, et la puissance de résistance ou d’attaque, un certain équilibre finit par s’établir entre les petits États de la Grèce continentale et ceux du Péloponèse, mais c’était un équilibre peu stable, comme celui qui se produit dans les phénomènes éternellement changeants de la vie. Les deux contrées qui s’affrontaient de chaque côté de l’isthme de Corinthe étaient à peu près égales en étendue, car les parties montueuses de la Grèce du Nord, que le haut Parnasse et les autres grands massifs de montagnes, jusqu’aux arêtes maîtresses du Pinde, séparent de la Boétie et de l’Attique, restaient à demi en dehors de la Grèce, à cause de l’âpreté du sol et de la sauvagerie des populations. Dans l’ensemble, le Péloponèse présentait plus de force compacte, plus de solidité, non seulement pour la défense, mais aussi pour l’offensive. L’avantage revenait à la Grèce du Nord quand elle ajoutait à sa puissance celle des îles voisines jusqu’à la côte d’Asie. D’ailleurs, les frontières oscillaient constamment entre les deux Grèces, différentes par leur tension naturelle, par leur génie propre, par leur manière de vivre et de comprendre la vie. Les rivalités de commerce, les jalousies, les rancunes et les brouilles, les alliances et les guerres modifiaient d’année en année les forces respectives.

Sparte et Athènes symbolisèrent et représentèrent matériellement les génies des deux contrées, des deux groupes ethniques, car le Péloponèse fut surtout la terre des Doriens, et l’Attique devint le centre des Ioniens. Tout d’abord le contraste se révèle par ce qu’on appelle les « lois » et ne fut en réalité que la vie sociale et politique des peuples de la Grèce. La nature seule, le simple milieu du sol et du climat n’expliquent point cette opposition, il faut tenir compte aussi du milieu moral que créait aux Spartiates leur caractère d’étrangers s’installant de force en un pays nouveau pour eux, où ils se trouvaient toujours en danger. En effet, l’ambiance de la contrée dans laquelle se déroulait leur existence n’a rien de tragique en elle-même. La plaine est fertile, une des étymologies proposées pour le nom de Sparte a le sens de « sol fécond ». L’Iri, l’ancien Eurotas, se déroule dans une large campagne qui fut jadis un lac et qui laissa d’épaisses couches d’alluvions, puis, au delà d’âpres défilés, se déverse dans le golfe de Laconie à côté d’un « fleuve royal » (Vasili Potamo) qui vient de s’élancer en source du fond de galeries calcaires. Un bel amphithéâtre de montagnes, que commande à l’ouest le superbe Taygète ou Pentedactylon (aux cinq doigts), entoure la plaine de Sparte et lui fait un cercle d’escarpements blanchâtres alternant avec des fonds d’ombre et de verdure.
Les résidants originaires de cette belle contrée, les Laconiens, se disaient fils des Pélasges autochtones, « nés du sol », et vivaient en paix avec les habitants des vallées et des hautes combes voisines ; la conquête dorienne en fit des asservis : ce sont eux qui, sous le nom de Periœques ou « Gens des Alentours », « Bordiers », « Clients », continuèrent de se livrer aux travaux de la campagne et aux industries héréditaires. Ces occupations diverses les avaient enrichis aux temps anciens, alors que des colonies phéniciennes peuplaient Cythère et les comptoirs d’échange et de pêcheries de coquillages à pourpre sur le pourtour du golfe. Pendant toute la période de l’histoire grecque proprement dite, au contraire, les Laconiens, soumis à une domination très dure et menant une existence précaire, ne travaillèrent que pour le profit de leurs âpres patrons, les Spartiates. C’est à eux pourtant que les peuples de la Grèce venaient acheter des meubles, des instruments en bois et en fer, des vêtements, des chaussures. Constituant surtout un prolétariat ouvrier, ils enrichirent leurs maîtres qui, sans eux, n’eussent jamais pu maintenir leur pouvoir. Sans les laborieux Lacédémoniens, la domination des Spartiates eût été impossible ; mais l’histoire oublia ces humbles pour concentrer toute son attention sur les hommes de guerre campés à Sparte. Elle négligea surtout les Hilotes, anciens habitants de la plaine rapprochée de la mer : ceux-ci, qui avaient longtemps résisté, furent punis du plus dur esclavage ; ayant à peine gardé le nom d’hommes, ils restèrent complètement ignorés des autres Grecs, quoique par le nombre ils fussent les premiers dans le territoire lacédémonien.
Ainsi les Spartiates avaient dû se créer un milieu artificiel, parfaitement à part, en dehors du milieu naturel, qui avait été celui des Laconiens et des Hilotes. Etablis dans le pays la lance à la main, après un exode guerrier qui, des régions du Pinde jusqu’au centre du Péloponèse, avait usé des générations entières, ils n’avaient plus d’autre métier que la guerre. Leur cerveau s’était fait à la lutte incessante et ne pouvait plus s’accommoder à la préparation des travaux pacifiques. Ils eurent à subjuguer d’abord les populations résidantes, puis celles des monts environnants. Leurs voisins de l’ouest, les vaillants Messéniens, qui possédaient de très fécondes vallées, plus riches encore et plus étendues que celles de la Laconie, soutinrent longtemps la fureur guerrière des Spartiates. Ceux-ci, devenus les maîtres incontestés du Péloponèse, eurent tout le monde grec pour champ de conquête et de pillage. Ils devaient avoir, en outre, le souci constant de se garder, et ils le firent avec une logique, une méthode dont on ne trouve peut-être d’autres exemples que chez les Peaux-Rouges du Nouveau Monde, tenus également à une vigilance continue par un danger de tous les instants. Leur ville était un camp, d’autant mieux surveillé qu’ils avaient eu la fierté de ne pas l’entourer de murailles et qu’ils formaient un rempart vivant autour de leur Apollon dorien, brandissant la lance comme lui : leur divinité, leur idéal ne pouvait être que la force. Groupés en une petite armée au milieu de populations éparses qu’ils terrorisaient par de fréquents massacres, ils compensaient par la solidité de leur position stratégique et par la pratique incessante de la violence guerrière la faiblesse relative de leur nombre — environ un contre dix.
On connaît la dure sévérité des lois, attribuées au personnage légendaire de Lycurgue, mais issues en réalité de l’inéluctable nécessité dans laquelle le péril continu avait placé les Spartiates. Ces lois n’étaient pas inspirées par le génie dorien, comme le dit Otfried Müller, car les tribus de même race vivant en des conditions différentes ne connaissaient point cette organisation sociale et politique : elle était dictée par le milieu historique, résultat de tous les milieux antérieurs, naturels et artificiels[33].

Le Spartiate, livré dès l’âge de sept ans à l’Etat, c’est-à-dire à l’assemblée des guerriers, était aussitôt dressé, façonné de manière à devenir un guerrier de plus : on l’entraînait à la force et à l’adresse ; on en faisait un animal de combat, on l’exerçait à la lutte sanguinaire, même contre ses camarades ; on lui livrait dans les jours de fête la racaille méprisée du populaire, pour qu’il l’insultât et la battît : on l’excitait même à la rapine, comme il convient à un bon soldat, et l’on se gardait bien de lui apprendre à lire, de peur que l’étude lui ouvrît une perspective sur un monde inconnu, différent de celui auquel on le destinait. A peine devait-il savoir parler : son langage, interprétant une idée fixe de guerre et de domination, se bornait à l’expression précise de la volonté, sans éloquence ni poésie. On n’exaltait en lui qu’une seule vertu, celle de l’endurance, de la force, du courage, et cette vertu même devait lui servir à priver les autres de leur vie ou de leur liberté.

Le travail restait interdit à ces parasites, quoiqu’ils eussent commencé par se distribuer des terres, incessibles et inaliénables. Mais c’est à d’autres, aux Laconiens, aux Hilotes, qu’il incombait de se fatiguer pour eux, de leur construire des demeures, de leur porter du pain et des fruits, de leur tisser des étoffes et de leur forger des glaives.
En échange de leur labeur, les Hilotes asservis n’avaient aucun droit et pouvaient s’estimer heureux d’être parmi ceux auxquels on laissait la vie. C’était fête de les enivrer, de les montrer ignobles et vomissants afin que les enfants, fiers de leur plus noble sang, apprissent à mépriser ces esclaves. Mais il fallait les haïr quand il y avait danger. On tuait les plus forts et les plus beaux, pour qu’ils n’eussent pas l’audacieuse pensée de se comparer avec leurs maîtres ; dans la guerre du Péloponèse, lorsque les Spartiates purent craindre un soulèvement de la foule asservie, ne mit-on pas au concours la dignité de citoyens, afin qu’il se fit ainsi une sélection des plus vaillants, puis, quand deux mille d’entre ces ambitieux de liberté se furent présentés, ne s’empressa-t-on pas, nous dit Thucydide, de les faire disparaître en quelque ténébreuse embûche ?
Ainsi tenus par leur propre destin, prisonniers de leur propre crime de guerre et d’oppression, qui les obligeait à guerroyer, à opprimer sans cesse, les « héros » Spartiates devaient, chez leurs voisins, invariablement choisir pour alliés les familles aristocratiques, ambitieuses comme eux de réduire le peuple à la soumission ou même à la servitude ; ils étaient condamnés au mal aussi bien qu’à l’ignorance. Dans le grand péril commun, lorsqu’on vit s’ébranler l’immense armée des Perses et des Mèdes pour venir écraser la petite Grèce, les Spartiates se firent plus d’une fois les alliés du despote étranger, et quand la domination de Lacédémone fut enfin brisée, ceux d’entre ses citoyens qui restaient s’adonnèrent surtout — digne fin de leur carrière — à la profession de guerriers à gages dans les bandes de quelque tyran.
D’ailleurs, leur sang non renouvelé par les croisements avait subi la décadence qui frappe inévitablement toutes les aristocraties : leur nombre, énuméré à diverses époques, témoignait d’un amoindrissement graduel, causé bien plus encore par le déclin de la race que par les pertes d’hommes dans les batailles. A la fin, ils n’étaient plus assez pour se risquer à combattre seuls ; ils ne pouvaient entrer en campagne qu’appuyés sur des alliés et des mercenaires. Ce n’en est pas moins un fait historique des plus curieux que celui de la durée plus de cinq fois séculaire d’une puissance militaire, maintenue avec si peu de changements et une si lente évolution intérieure, dans cette Grèce si mobile, si prompte à se renouveler. Hommes de bronze, que ne troublait point le travail de la pensée, les Spartiates pouvaient, de génération en génération, rester à peu près les mêmes en apparence, au milieu d’un monde rapidement transformé.

C’est là ce qu’exprimait la légende de Lycurgue, se retirant à Delphes et s’y laissant mourir de faim, après avoir fait jurer l’observation de ses lois : il mettait ainsi son peuple sous la protection solennelle des dieux qui vengent la violation du serment.
Au point de vue de la nature ambiante, les avantages d’Athènes sur sa rivale du Péloponèse ne sont pas tels qu’ils frappent aussitôt la pensée, et même, à certains égards, Sparte se trouvait réellement privilégiée. D’abord la petite vallée de l’Eurotas, avec ses dépendance et ses annexes, est un territoire plus riche que le pays d’Athènes, pauvrement arrosé, manquant souvent de pluie, entouré d’âpres rochers. Sauf sa très heureuse situation stratégique, à la base d’un rocher de défense facile, dominant une vallée très ouverte, unie et fertile, qui s’incline doucement vers la mer, Athènes n’a rien dans son ambiance immédiate qui lui donne une prééminence naturelle sur les autres cités de la Grèce ; même ce merveilleux tableau que présentent les bosquets d’oliviers, les rivages sinueux, les îles et les promontoires, les montagnes aux arêtes blanches burinées sur le ciel bleu, cet ensemble harmonieux se retrouve sous mille formes, non moins pur et non moins beau, sur tout le pourtour de l’Hellade et d’autres terres méditerranéennes : à ces multiples paysages il manque seulement le souvenir auguste du passé, toujours présent dans le respect et la mémoire des hommes.
Les grands avantages matériels d’Athènes sont de ceux qu’elle eut à se créer par son industrie, telles ses carrières qui lui donnèrent de beaux matériaux pour la construction de ses maisons, de ses forteresses et de ses temples, tandis que les riches mines d’argent du Laurium lui fournirent en abondance des ressources pour l’entretien de son commerce. Les découpures du littoral lui facilitèrent singulièrement les relations avec les pays étrangers ; la communauté politique abritée par la forteresse naturelle de l’Acropole se trouvait à une très faible distance — deux petites heures de marche, à peine — de trois ports : Phalère, Munichia avec ses deux bassins, enfin le Pirée, absolument protégé contre tous les vents du large et auquel s’ajoute une admirable rade, sous le vent de l’île de Salamine. De plus, la péninsule de l’Attique est, de toute la Grèce continentale, la contrée la plus rapprochée de l’Asie Mineure qui, sous la même latitude, projette au-devant de l’Europe deux presqu’îles et deux traînées insulaires : en ces parages, on ne compte guère par un bon vent qu’une journée de navigation entre l’Europe et l’Asie, et les barques peuvent faire escale en route sur des îles nombreuses. Ainsi, dès les premiers temps de son évolution historique, l’Attique, dont le nom même — Aktiké ou la « Pointe », la « Péninsule » — rappelle la situation relativement à la mer, était devenue une puissance maritime. Son activité rayonnait au loin, tandis que Sparte, royaume continental au milieu de sa presqu’île, cherchait à se renfermer étroitement en son ancien bassin lacustre presque fermé. Athènes contemplait la mer du haut de son Acropole, et de ses trois ports les navires cinglaient librement vers les îles de l’Archipel, les péninsules de la Grèce asiatique et les havres de la Grande-Grèce, pendant que sa rivale laconienne, se détournant de la perspective naturelle qui lui montrait au sud la mer déserte, à l’ouest de Cythère et de la Crète, regardait surtout au nord pour accroître son domaine de conquêtes par delà les remparts successifs de la grande citadelle du Péloponèse.

La ville de Chalcis du texte (pages 305-306) est ici désignée par Khalcis. On trouvera aussi les orthographes Chalcidique, Chios, puis Cythère, Mycènes, etc. à côté de Orkhomenos, Khersonèse et de Kimolos, Kythnos, etc. La règle qu’on eût désiré suivre était de représenter par Kh le X grec et par K, devant i et e, le K grec, à moins que le mot français écrit avec Ch ou C n’ait pris une physionomie usuelle.
Oropos était le port où débarquaient les blés d’Eubée à destination d’Athènes, Dekeleia commandait la route de l’isthme d’Attique (V. Bérard).
Le contraste géographique entre les deux cités était donc considérable ; mais le contraste historique, provenant de tous les milieux successifs survenus pendant les âges, était bien plus grand encore. Les Spartiates, entourés d’ennemis déclarés ou d’esclaves cachant sous les dehors de la flatterie rampante une haine immortelle, ne vivaient que pour la guerre, avec la continuelle appréhension de la révolte, avec l’appétit constant des massacres et des butins. Les Athéniens, descendants des antiques Pélasges aborigènes, auxquels s’étaient associés de nombreux immigrants refoulés chez eux par les invasions doriennes, les Athéniens furent dans l’histoire ceux qui représentent le mieux ce type héroïque de la cité dont l’individualité changeante se distingue si bien dans l’unité supérieure de la Grèce.
En se remémorant Athènes, on voit en même temps apparaître cent autres villes grecques aux maisonnettes blanches s’étageant sur les pentes d’une colline rocheuse, sous la verdure pâle des oliviers. La patrie, tout le groupe de familles alliées, contenu en cet étroit espace, formait un tout complet, un véritable organisme. Du haut de son acropole, le citoyen suivait du regard les limites du domaine collectif, ici le long de la mer indiquée par le liséré blanc des vagues, plus loin à travers la forêt bleuâtre qui recouvre le penchant des collines, puis, au delà des ravins et des gorges, sur la crête des rochers. Le « fils du sol » pouvait donner un nom à tous les ruisselets, à tous les bouquets d’arbres, à toutes les demeures qu’il apercevait dans l’étendue. Il connaissait les familles qu’abritaient ces toits de chaume, il savait où les héros de la nation avaient accompli leurs exploits, où les dieux avaient lancé leur foudre. De leur côté, les gens de campagne regardaient vers la cité comme vers leur chose par excellence. Ils en connaissaient bien les sentiers, qui s’étaient graduellement transformés en rues : telle place, telle voie magistrale portait encore le nom des arbres qui s’y élevaient autrefois ; ils se rappelaient leurs jeux autour des fontaines, où se miraient maintenant les statues des nymphes ; là-haut, sur le roc protecteur, se dressait le temple portant l’effigie du dieu que l’on invoquait dans les dangers publics, et c’est derrière ses remparts que se réfugiaient les enfants et les femmes lorsque l’ennemi, trop nombreux, envahissait la plaine. Nulle part, si ce 
Musée du Louvre.Cl. Giraudon.
tête archaïque (vie siècle av. j.-c.).n’est dans les clans des tribus primitives, le patriotisme ne se produisit avec une pareille intensité, la vie, le bien-être de chacun se confondant avec le bonheur de tous. L’ensemble politique du corps social était aussi simple, aussi un et bien délimité que celui de l’individu lui-même. C’est dans ce sens qu’il faut considérer avec Aristote ζῶον πολιτιϰὀν, l’ « animal urbain », le part-prenant à la cité organique[34] — et non pas seulement l’ « animal politique », ainsi qu’on le traduit d’ordinaire —, comme l’homme par excellence, et dans l’histoire cet homme n’est-il pas surtout l’Athénien ?
Certes, la vie d’une cité, avec tous ses éléments diversement entremêlés, est une évolution trop complexe pour que dans son ensemble, et de son origine à sa fin, elle puisse représenter un principe, une idée, dans sa pureté symbolique : Athènes eut aussi ses périodes critiques pendant lesquelles on put l’assimiler à la cruelle Sparte. Elle eut ses familles nobles qui tentèrent de monopoliser à leur profit toutes les forces de la nation ; elle eut ses guerres féroces, qui pèsent lourdement sur sa mémoire ; elle eut également de cruels législateurs, représentants de despotes, que le danger d’être renversés rendait impitoyables. C’est ainsi que dans le lointain de l’histoire à demi légendaire, il y a plus de vingt-cinq siècles, apparaît l’archonte Dracon, dont le nom symbolise encore de nos jours les lois féroces promulguées par les pouvoirs apeurés. Ce chef du parti des « meilleurs » n’édictait qu’une seule peine pour tous crimes et délits, la mort : c’est que, dans un état d’équilibre instable, le moindre accident peut entraîner des conséquences décisives[35].
Mais cette législation « draconienne » ne pouvait durer dans le conflit des éléments en lutte, et celle qui lui succéda, beaucoup plus humaine, dut tenir compte des conditions du milieu et tenter d’établir des rapports équitables entre les classes : c’est à elle que se rattache le nom de Solon, personnage que l’on croit avoir réellement vécu, mais qu’il faut considérer surtout comme l’interprète du peuple athénien et de la civilisation hellénique dans son ensemble. La première réforme, d’intérêt capital, fut de soustraire le pauvre à l’esclavage dont il était menacé par le riche. Le prêt cessa d’être hypothéqué sur la liberté de l’emprunteur, et celui-ci ne courut plus le risque, d’être éloigné de sa famille, vendu sur les marchés étrangers, condamné à vivre parmi des barbares peut-être et à ne plus entendre le parler maternel. Le citoyen d’Athènes, si pauvre qu’il fût, acquit des droits inaliénables ; même l’eupatride, le descendant des dieux, eut à respecter le prolétaire, à lui demander en votation publique la confirmation de ses fonctions et prérogatives. Il est vrai que l’existence même de classes inégales dans la république devait causer des luttes intestines ; aussi était-il nécessaire de trouver un dérivatif a la vindicte populaire, et c’est dans l’activité commerciale qu’on le chercha. La postérité, qui met volontiers sous un seul nom propre de longues évolutions auxquelles participe tout un peuple, attribue à Solon l’ouverture de ces chemins de la mer convergeant vers Athènes et la prise de possession de Salamine, l’île qui commande le port du Pirée. Un trait de la légende oppose très ingénieusement le législateur d’Athènes à celui de Sparte. Le premier ne fit point, comme Lycurgue, jurer les citoyens d’observer ses lois à toujours, il ne leur demanda qu’une fidélité de dix années. Déjà l’instinct populaire prévoyait les changements inévitables qu’apporterait l’avenir.
Dans l’ensemble de son développement, Athènes se montra surtout 
Bibliothèque Nationale.Cl. Giraudon.
camée grec, tête de pallas athéné.commerçante et pacifique. Elle guerroya fort peu avec les cités ses voisines et n’eut à repousser que de rares incursions de pirates, les Cyclades lui formant à l’est un double rempart protecteur. Loin de promulguer des lois contre l’étranger et de le déclarer ennemi en vertu de sa naissance, ainsi qu’on faisait à Sparte, Athènes accueillait l’exilé ; de partout les fugitifs venaient lui demander un asile, et parmi ces hôtes, les plus chers, ceux dont la lignée donna le plus d’hommes illustres à l’Attique, furent précisément les Messéniens et autres Grecs du Péloponèse dont les Spartiates avaient réduit les frères en esclavage. Un euxène, le « guide des étrangers », était chargé spécialement par la cité de les bien accueillir, de les introduire dans les temples, de leur faciliter l’établissement sur la terre que protégeait Pallas. C’était une loi de l’opinion à Athènes qu’il ne fallait « refuser à personne l’usage de l’eau vive, ni la permission d’allumer son feu au foyer du voisin ». Ne pas montrer la route à celui qui s’égare était un crime que les Athéniens flétrissaient par l’exécration publique[36]. Certes, c’est en grande partie au bon accueil fait aux exilés étrangers qu’Athènes doit son étonnante pléiade d’hommes grands par la pensée et par l’action. Dans l’énumération des Athéniens illustres, on constate l’existence de très nombreux descendants d’exilés, entr’autres Solon, le législateur même, Périclès, Miltiade, Thucydide, Platon[37]. C’est ainsi, dans une proportion bien autrement puissante, que, plus de vingt siècles après, les réfugiés protestants de France et d’Italie donnèrent une âme à la petite et insignifiante ville de Genève, pour en faire une citadelle contre Rome, et que plus tard, les philosophes persécutés trouvèrent un asile dans la minuscule république des Provinces-Unies et contribuèrent à l’animer de cette virilité qui lui permit de contrebalancer la puissance du « Grand Roi ». Et l’essor de Berlin ne date-t-il pas en grande partie de l’activité intelligente qu’y déployèrent les immigrés huguenots ?
Grâce à ces pratiques de bon accueil envers les étrangers, Athènes se trouva facilement en relations suivies d’amitié avec nombre de cités helléniques, différentes par la race, le dialecte et les traditions ; ces alliances s’accrurent naturellement des liens qui l’unissaient à toutes ses « filles », les colonies éparses sur les rivages de la mer Egée et sur les côtes plus lointaines ; c’étaient autant d’Athènes nouvelles confédérées à la mère-patrie par l’origine, le langage, les oracles et les dieux. Quant aux Spartiates, ils ne cherchaient guère d’alliés, mais surtout des sujets ou des mercenaires, et même, quand ils étaient accompagnés dans leurs invasions par d’autres Doriens appartenant à la même souche originaire, ils ne les guidaient point aux batailles comme frères, mais comme chefs.
Etudiées dans leur ensemble, les deux cités contrastaient donc, moins par les conditions géographiques du milieu que par l’ambiance artificielle créée à l’une des deux communautés. Sparte était une ville de guerre et ne pouvait devenir autre chose ; Athènes s’était développée surtout en une ville de paix, d’industrie, de commerce, de
science et d’art. Même les institutions qui, dans les deux Etats, portaient le même nom, différaient d’une manière essentielle. Dans l’Attique, l’esclavage n’était point ce qu’il était en Laconie, quoiqu’il impliquât aussi cette chose atroce, la possession d’un homme par un autre homme. Les gens de la campagne, d’origine grecque, étaient en réalité de simples métayers, dont la vie différait peu de celle que menaient naguère la plupart des paysans français. Les esclaves de la maison, pour la plupart gens de la Thrace ou de l’Asie Mineure, achetés

Bibliothèque Nationale.Cl. Giraudon.
monnaies grecquesaux navigateurs, étaient plus asservis, d’abord à cause du contact immédiat avec leurs maîtres, puis en vertu de leur origine étrangère ; cependant, l’histoire d’Athènes nous montre qu’ils étaient très libres en paroles et qu’ils se géraient souvent en égaux des citoyens, bien différents par leur attitude de ces malheureux Hilotes, qui devaient s’avilir par ordre, jouets des enfants brutaux de la race noble. Quant aux esclaves appartenant à la cité d’Athènes, c’étaient de véritables fonctionnaires, jouissant de privilèges matériels qu’auraient pu leur envier les citoyens pauvres. Enfin, nombre d’esclaves athéniens se rachetaient par leur travail ou recevaient la liberté en présent de leurs maîtres ; parfois, notamment dans les batailles, quand ils avaient mérité l’admiration de tous, ils entraient directement au rang de citoyens. La forme ordinaire de l’émancipation d’un esclave consistait à le vouer à un dieu : dès lors, il devenait sacré, libre par conséquent. Ainsi que le fait remarquer Laurent dans son Histoire de l’Humanité, l’hellénisme l’emporte de beaucoup à cet égard sur le christianisme. Les serfs voués à l’Eglise n’en restaient pas moins esclaves, et l’on sait qu’en France les derniers affranchis furent des prisonniers de la glèbe appartenant aux moines de Saint-Claude.
L’histoire écrite commença pour la Grèce lorsque s’était déjà constitué cet antagonisme des deux Grèce, aristocratique et démocratique, représentées l’une par Sparte, l’autre par Athènes. Un premier personnage, bien identifié et fixé dans son cadre historique, Phidon, apparaît en Argolide et frappe des monnaies à son effigie pour le commerce avec l’Asie Mineure et la Phénicie ; on croit pouvoir reconnaître encore sur des médailles primitives de la Grèce une image copiée de l’Astarté tyrienne, qui rappellerait l’époque de Phidon, de vingt-six à vingt-sept siècles avant nous[38]. Puis, dans Athènes, nous voyons en plein relief le « tyran » Pisistrate qui, grâce aux dissensions des grandes familles et non sans l’aide de mercenaires étrangers, réussit à s’emparer du gouvernement et cherche aussitôt, suivant la constante politique des maîtres intelligents et perfides, à faire dévier les passions du peuple vers un autre but que la liberté. C’est Pisistrate : peut-on dire, qui fut le véritable fondateur du « panhellénisme » : détournant les ambitions des Athéniens, il leur persuada de lutter pour la constitution d’une grande Grèce au lieu de rêver à leur propre indépendance. Le premier, il fit recueillir les textes connus des chants homériques et les fit colliger en un tout qui devint l’Iliade, le plus précieux des livres grecs, et donna aux Grecs de toutes origines et de tous dialectes la conscience de leur unité de civilisation en face de l’Asie persane. Joignant l’exemple au précepte, il rattacha très étroitement au gouvernement d’Athènes l’île de Delos, le grand lieu de pèlerinage des insulaires de la mer Egée ; il prit même pied sur la terre d’Asie au cap Sigée (Kum-Kalessi ou Ienicheri) à la porte de l’Hellespont et s’empara du sol sacré qui recueillit les cendres de Patrocle et d’Achille. C’était un défi adressé directement au « Roi des rois » qui ne devait pas tarder à répondre. Autre événement très grave, Pisistrate tourna l’esprit des Athéniens vers la furieuse acquisition des richesses en s’emparant des mines de Thrace, très productives en or et en argent.
Arrivés à la pleine conscience de leur valeur, les Hellènes se trouvèrent donc face à face avec les Asiates. Poussés par la force des choses, par le besoin de sauvegarder leur commerce, leur industrie, leurs mines, leurs possessions et leurs alliés, n’ayant pas le moindre doute sur la 
Munich.Cl. Giraudon.
archer, fronton du temple d’égine
Sculpture datant d’environ 470 avant J.-C.supériorité de leur race, les Grecs, et notamment les Athéniens, se préparèrent au conflit, et réellement ce sont eux qui portèrent les premiers coups. Athènes s’empara de vive force des deux îles de Lemnos et d’Imbros, qui se trouvent dans les mers d’Asie et que le roi des Perses et des Mèdes considérait comme appartenant à son empire[39].
D’autre part, l’action hellénique se faisait sentir d’une manière indirecte, mais très vive, par l’influence de civilisation exercée dans toutes les contrées circonvoisines. La Thrace, la Macédoine, les pays d’où les aïeux étaient venus et que le recul causé par les invasions doriennes avait replongés dans la barbarie revenaient graduellement au monde grec. L’empire de Lydie s’était aussi à demi grécisé, et son roi le plus fameux, Crésus, fut précisément le tributaire le plus dévot de Delphes, dont il paya par de prodigieux trésors les oracles énigmatiques. Enfin, l’Egypte avait accueilli les Grecs, Doriens, Eoliens, Ioniens, tous ensemble, et leur avait donné des villes où se fondaient des temples consacrés aux dieux et aux arts de la patrie ; bien plus, elle avait conquis l’île de Cypre, dont elle éloigna les marchands phéniciens pour appeler à leur place les marins et les traitants hellènes. Grâce à ces comptoirs et à ces colonies, tout le bassin de la Méditerranée tendait à devenir rapidement une « très grande » Grèce, embrassant toutes les autres, celle de l’Hellade proprement dite, et la « Grande », l’Italie méridionale.
Du côté de la Perse, le mouvement de reflux contre l’hellénisme se produisit aussi indirectement : avant de s’attaquer au foyer même de la civilisation grecque, il s’agissait d’en déblayer les abords, de la cerner graduellement : on pouvait tenter de l’étouffer avant de procéder à son extermination, et il est curieux de constater avec quelle suite les représentants successifs de l’autocratie absolue persistèrent dans leur politique à l’égard de la nation libre, et aussi combien la division des Grecs en classes hostiles aida les rois asiates dans leur tentative.
Déjà Cyrus s’était emparé de Sardes, repoussant les Grecs sur le littoral et dans les îles. Son fils Cambyse pénétra dans l’Egypte et jusque dans la Cyrénaïque, ruina les comptoirs de Grecs et leur enleva la fructueuse exploitation de Cypre. Les armées de Darius franchirent ensuite le Bosphore et s’établirent solidement dans la Macédoine et la Thrace, et ce furent des mains grecques qui lui facilitèrent cette invasion en construisant le pont de bateaux sur lequel passèrent les multitudes conduites par le roi des Perses. Les mêmes alliés hellènes l’aidèrent à passer le Danube et à pénétrer dans les plaines de la Scythie, où il se promettait de châtier les hordes nomades qui, un peu plus de cent ans auparavant, avaient ravagé la Médie. Peut-être le « Roi des rois » avait-il conçu le gigantesque projet de traverser avec son armée tout le pays des Scythes et de revenir dans ses royaumes en suivant le littoral du Pont-Euxin, ou bien en faisant le grand tour par le nord du Caucase, le long de la mer Caspienne, chemin que lui avaient frayé les ennemis eux-mêmes dans leur invasion récente. Si tel n’avait pas été son plan de campagne, on ne comprendrait pas qu’en laissant ses troupes ioniennes a la garde du pont de l’Ister, il les eût autorisées à rentrer dans leur patrie s’il n’était pas revenu après deux mois révolus. Mais il ne rencontra devant lui que des bandes fuyantes et insaisissables, ne trouva ni villes à détruire, ni plantations à dévaster, et en fin de compte dut laisser honteusement ses malades derrière lui et revenir sur ses pas.

Cyrus le Jeune, satrape de Lydie, tenta de renverser son frère, le roi de Perse Artaxerxès Mnemon. Il engagea des mercenaire grecs, pénétra en Mésopotamie, mais fut vaincu et tué à Cunaxa — (400). Le contingent grec battit en retraite vers le Nord, puis, atteignant la mer Euxine, rentra en Grèce, en longeant le littoral. Xénophon qui fut un des capitaines de l’expédition en écrivit le récit, parvenu jusqu’à nous. Pendant son absence, les Grecs avaient délibéré : s’en tiendraient-ils strictement à leur promesse et s’en retourneraient-ils dans leurs terres d’Ionie en laissant le « Grand Roi » aux prises avec les Scythes et la faim et l’hiver, ou bien sauveraient-ils l’armée des Perses, au risque de la retrouver un jour maîtresse de la Grèce ? Le dernier avis prévalut, presque tous les chefs ioniens ayant opiné que leurs intérêts personnels étaient absolument solidaires de ceux du roi leur allié et maître. En qualité de « tyrans » de leurs villes, ne tenaient-ils pas leur pouvoir de Darius, et celui-ci renversé, ne seraient-ils pas renversés à leur tour ? Le parti aristocratique ne serait-il pas obligé de céder les places et les honneurs au parti populaire ? Ainsi les dissensions des cités se continuaient dans les camps, et cette fois, elles eurent pour conséquence d’augmenter singulièrement la force d’attaque de la Perse contre les Grecs.
Cette campagne de Scythie, qui aurait pu facilement entraîner pour Darius un désastre irréparable, se termina donc de manière à resserrer le blocus que le roi de Perse et les tyrans alliés avaient établi autour des cités où le peuple jouissait d’une part dans le gouvernement. Le choc se préparait et la signification profonde des intérêts en jeu était si bien comprise que lorsque la guerre éclata, amenée par le ressentiment d’Aristagoras, le tyran de Milet, celui-ci commença par déposer le pouvoir devant le peuple assemblé et fit proclamer de nouveau l’isonomie ou égalité des droits entre citoyens, puis il livra à leurs villes affranchies divers tyrans qu’il avait faits prisonniers[40]. Mais il lui fallait de plus puissants alliés que les insulaires des Cyclades et que les Ioniens de l’Asie Mineure restés encore indépendants ; il partit donc pour la Grèce proprement dite, porteur de la première carte géographique mentionnée par l’histoire, la table d’airain sur laquelle Hécatée de Milet avait tracé la forme du monde connu. Muni de ce document stratégique, Aristagoras essaya de démontrer aux « pasteurs des peuples » que le temps était venu d’abandonner les petites guerres intestines, les expéditions de rancune et de pillage entre cités, et qu’il fallait s’en prendre au grand ennemi, au roi des Mèdes et des Perses, l’attaquer au besoin dans sa capitale, la distante Suse. Les Spartiates, plus aristocrates que patriotes, refusèrent leur appui, tandis que le peuple d’Athènes, spécialement menacé d’avoir à subir la vengeance du vieil Hippias, le Pisistratide, exilé chez les Perses, accueillit les ouvertures d’Aristagoras. Mais trop mollement, sans l’énergie que l’on doit avoir dans les dangers suprêmes.

fouilles de delphes
Le flot perse se déversa sur l’Asie grecque : cité après cité, île après île furent conquises par les satrapes. Athènes restait presque seule et Darius, nous dit la légende, avait lancé la flèche de son arc de guerre dans les nuages du ciel pour prendre Ormuzd à témoin de son serment de vengeance. Et pourtant sa puissante armée vint se briser contre les Athéniens dans les plaines de Marathon. Pendant dix années de préparatifs, de prodigieuses forces d’attaque, telles que n’en avaient jamais vues les rives de la mer Egée, s’amassèrent contre la petite Grèce ; la terre était couverte de soldats, un million, deux millions d’hommes, dit-on ; la mer était couverte de navires ; les peuples atterrés se prosternaient au passage. Il fallut abandonner Athènes, laisser les barbares raser les demeures et démolir les temples, et Xerxès triomphant avait fait dresser son trône sur le rivage pour contempler à l’aise la destruction de la flotte où s’étaient réfugiés les rebelles. Mais ceux-ci avait gardé pour eux la confiance en eux-mêmes, la certitude d’être les plus sagaces et les plus intelligents, ils le prouvèrent dans le détroit de Salamine. Partout, sur terre et sur mer, à Platées, à Mycale, les envahisseurs perses furent refoulés ou mis en fuite. Les peuples crurent fermement que les dieux, que le Destin avait établi entre l’Asie et l’Europe des limites naturelles, et de part et d’autre on redouta longtemps de les franchir. Se conformant à cette appréciation des choses, les envoyés athéniens, inspirés par Cimon, stipulèrent avec le successeur de Xerxès que désormais ils s’engageaient à ne point attaquer l’empire des Perses, si le roi promettait de ne pas faire entrer ses navires dans la mer Egée et de tenir ses armées de terre au moins à trois journées de la côte[41].
Mais les événements qui se succédaient ne devaient pas faire oublier les journées où l’on vit la déroute des Asiatiques dans les eaux de Salamine et les campagnes de Platées. Par une singulière illusion d’optique, il nous semble, à nous Occidentaux, que Marathon et les autres rencontres furent des faits décisifs où le génie libre de l’Europe triompha définitivement des mœurs serviles qui prévalaient chez les esclaves du « Grand Roi » et qui n’eussent pas manqué de contaminer les vaincus. Toutefois ces mémorables luttes ne furent que de simples épisodes d’un conflit séculaire ou millénaire, comme l’avait été autrefois la guerre mythique de Troie. Plus tard, la lutte devait continuer, mais non plus pour assurer le triomphe de la liberté, puisque le Macédonien, vainqueur des Orientaux, se fit Oriental lui-même, par le faste, le caprice et l’asservissement abject qu’il imposa aux peuples subjugués.

Smyrne pourra peut-être éviter le sort de Milet. La déviation de l’embouchure du Hermos, dont les alluvions menaçaient d’obstruer les abords de la grande ville, est une œuvre toute récente.
Néanmoins il faut considérer les victoires grecques comme des événements de la signification la plus haute et la plus heureuse, puisqu’en ces batailles la force resta aux mains de ceux qui représentaient la volonté libre, l’initiative personnelle contre des masses humaines sans penser ni vouloir. Emplis à bon droit de la joie du triomphe, les Grecs prirent conscience de leur individualité nationale, de leur fraternité de langue, de mœurs et de génie ; mais Athènes eut le tort de s’attribuer une trop forte part de la gloire commune : elle voulut presque avoir triomphé seule, oubliant les Eginètes de Salamine et les Spartiates de Platées. Pendant des siècles elle ne parla plus que de Marathon, même lorsqu’elle fut avilie par la conquête : ainsi que le fait remarquer Beulé, des rhéteurs athéniens osaient, devant le Romain Sylla, se réclamer de Miltiade et de Cynégire.
Du moins la conscience fière de la victoire remportée en des conditions si difficiles et contre un ennemi si puissant donna-t-elle aux Grecs et surtout à leurs représentants par excellence, les Athéniens, une prodigieuse intensité de vie. Chaque soldat de Marathon ou de Salamine comprit sa dignité d’homme, et, rentré dans sa ville, prétendit désormais au respect de tous. Les descendants des grandes familles eurent à compter avec les petites gens de généalogie modeste qui avaient combattu à côté d’eux. Une plus grande égalité s’établit entre les citoyens même au point de vue matériel, car les propriétaires aristocrates avaient perdu leurs récoltes par suite du va-et-vient des guerres, tandis que les combattants des classes inférieures avaient gagné en bien-être, grâce à leur part de butin. Même les plus hauts personnages, tel Aristide, durent céder à cette poussée du peuple d’en bas et réduire singulièrement les prérogatives traditionnelles des grands. Sur sa proposition, les clauses qui excluaient la majorité des citoyens de la participation aux emplois supérieurs furent supprimées : tous les électeurs devinrent éligibles : la forme gouvernementale perdit complètement son caractère aristocratique pour devenir démocratique.
Ce fut la grande époque de la Grèce. Enrichie par le commerce et les tributs, Athènes devint la cité merveilleuse des temples, des théâtres, des statues. Alors se dressa le Parthénon, s’élevèrent les Propylées ; alors Phidias et tant d’autres illustres sculpteurs ciselèrent dans le beau marbre de l’Attique et des îles ces admirables formes humaines et animales qui sont restées pour nous les types mêmes de la beauté. L’artiste, dégagé des préjugés hiératiques, pleinement conscient du superbe équilibre de son corps, heureux de le reproduire dans toute la grâce et la force d’une noble nudité, était arrivé désormais à la parfaite libération de son génie : les images n’avaient plus l’aspect rigide et froid des premières effigies taillées dans le bois. Les vêtements ne descendaient plus en longs plis massifs attachés au corps ; la chevelure ne se développait plus, également raide, en ondulations parallèles, mais flottait soulevée par l’air ; les lèvres ne s’entr’ouvraient plus en un sourire béat, la vie animait les visages ; l’expression, toujours noble, rayonnait des traits et des attitudes. Le 
Cl. Girandon.
sphinx des naxiens et chapiteau ionique
fouilles de delphes, vie siècle av. j.-c.Grec, comme artiste évocateur, était arrivé à la compréhension parfaite de sa propre nature, divinisée en Zeus et en Athéné, et savait lui donner une forme définitive d’incorruptible beauté. En même temps, la pensée se manifestait en une langue des plus riches et des plus sonores : jamais littérature ne se produisit avec plus d’abondance, de splendeur et d’éclat. Eschyle avait été l’un des combattants de la grande guerre et Pindare l’avait chantée ; Sophocle adolescent menait le chœur qui se portait au-devant des vainqueurs de Salamine et, pendant la génération qui suivit, Hérodote raconta la mémorable histoire. Et combien d’autres poètes, historiens et dramaturges, dans toutes les parties du monde grec, succédèrent à ces grands hommes en une merveilleuse lignée !
Toutefois la période de glorieuse hégémonie ne dura pas longtemps pour Athènes. Les dissensions intérieures, suspendues 
Musée du Louvre.Cl. Giraudon.
ares grec, connu sous le nom de mars borghèse
Belle époque de la statuaire grecque.partiellement à cause du commun danger, reprirent de nouveau quand les Perses ne furent plus à craindre. D’ailleurs, les citoyens d’Athènes n’avaient plus rien à faire qu’à discuter et la plupart du temps à discuter à vide, à se disputer. En effet, les richesses produites par le commerce et par les cotisations des alliés, perçues sous forme d’impôts, affluaient en une telle abondance que fatalement la nation tout entière en devint parasite. Aristide, qui était alors l’homme le plus influent, conseilla aux Athéniens de s’ériger collectivement en assemblée dirigeante de la Grèce ionienne et de vivre aux frais de la confédération. Il invita les campagnards à venir habiter la ville où il y aurait de quoi les entretenir en tout bien-être, ainsi que les soldats, les fonctionnaires, les employés de toute sorte. Le peuple ne se laissa persuader que trop facilement, et, d’après ce que rapporte Aristote dans sa République athénienne, la majorité de la nation — plus de vingt mille citoyens, sans compter les esclaves —, vécut du budget national. Ce parasitisme, pratiqué toujours par les vainqueurs aux dépens des vaincus, mais qui n’avait jamais pris ce caractère normal et législatif, devait amener un très grand mécontentement chez les alliés, devenus tributaires et privés de leurs constitutions propres : seuls, les insulaires de Lesbos, de Chios et de Samos, voisins de l’Asie et 
Musée du Louvre.Cl. Giraudon.
apollon sauroctone (tueur de lézards)
Statue de Praxitèle.chargés de veiller en sentinelles contre les Perses, gardèrent leurs libertés locales. On doit presque s’étonner qu’une nation ainsi transformée en une immense assemblée de fonctionnaires et de politiciens ait eu assez de ressources morales en elle-même pour ne pas commettre plus de fautes à l’intérieur et plus d’attentats contre ses voisins ; mais ses méfaits suffirent à faire éclater des révolutions et des guerres sur tous les points de la Grèce vassale. Certes, les Athéniens auraient eu raison mille fois d’ostraciser Aristide s’ils l’avaient fait, non pas par lassitude et désir du nouveau, mais pour le punir d’avoir entraîné le peuple à échanger les efforts journaliers du gagne-pain pour les rentes gratuites et les vanités de la faconde politique.
Un autre fait très grave consistait dans le développement de la grande industrie, phénomène que l’on peut comparer à celui qui s’est produit aux temps modernes dans le monde civilisé en des proportions beaucoup plus vastes. La fabrique avait pour conséquence un développement rapide de l’esclavage, non de cet esclavage de famille tel qu’il avait existé pendant la période spécialement agricole de l’histoire grecque, mais d’un asservissement qui ne tient aucun compte des intérêts de l’individu et qui le subordonne entièrement aux convenances du patron. C’est par achat que les fabricants recrutent les hommes dont ils ont besoin et de grands marchés d’esclaves s’établissent aux lieux bien situés pour le commerce. L’île de Chios, disent les anciens, est la première communauté hellène qui se donna pour spécialité le trafic des hommes, et les villes qui en reçurent le plus, Corinthe, Athènes, Egine, Syracuse, furent également les grands centres industriels de l’époque. En vain quelques citoyens, tel Périandre à Corinthe, essayèrent de s’opposer à l’importation des esclaves : contre eux, la ligue des intérêts industriels fut trop puissante[42].
Bientôt, la lutte recommence entre Sparte et l’Allique, puis la peste, apportée par les navires de l’Egypte, décime les populations de la Grèce du nord. Les « métabolies », ou transformations, qui se succèdent dans l’histoire intérieure d’Athènes[43], guerres, révolutions et contre-révolutions, expéditions désastreuses, tyrannies et révoltes, exécutions et massacres, continuent de dévaster les territoires des cités grecques, jusque dans l’Asie Mineure et en Sicile, tandis qu’au Nord grandit la monarchie de Macédoine, se préparant sournoisement à la conquête des républiques affaiblies. Pourtant, de très nobles tentatives se faisaient dans l’intervalle en vue de la réconciliation finale des Hellènes par le maintien et même le rétablissement de toutes les républiques, petites et grandes, unies désormais en une vaste fédération. Ce fut la gloire des Béotiens, plus tard venus que les Athéniens et les Spartiates au plein épanouissement de leur génie, d’avoir tenté cette œuvre de justice à laquelle s’attache le nom d’Epaminondas. Par le respect de tous les peuples représentant le panhellénisme et par leurs campagnes heureuses dans le cœur du Péloponèse, ils restituèrent l’autonomie des Arcacliens et des Messéniens, si longtemps asservis. Mais la Grèce, appauvrie par tant de guerres, intestines, n’était plus de force à repousser une nouvelle invasion des peuples du Nord.
Un siècle et demi après les guerres médiques, Philippe de Macédoine, que les Athéniens tenaient presque en mépris comme un roi barbare, mais qui était l’égal des Hellènes par l’intelligence, leur supérieur par la tactique militaire, se sentit assez sûr de lui-même pour franchir le défilé des Thermopyles : il s’aventura dans les plaines fatales à Darius et triompha, grâce à sa phalange solide, des troupes moins disciplinées de Thèbes et d’Athènes.

viie siècle avant l’ère vulgaire
Sous un autre nom, ce fut la revanche des Perses, et l’on dirait qu’il y eut une sorte d’ironie dans la proposition de Philippe qui, pour les consoler de leur défaite, convia les Hellènes à l’aider en un retour offensif de l’Europe contre l’Asie. Mais ils répondirent à son appel de si mauvais gré, préférant être citoyens libres que soldats d’un conquérant, qu’Alexandre eut à recommencer la guerre : la destruction de Thèbes, le massacre et la mise à l’encan de ses défenseurs, tel fut son cadeau de joyeux avènement.
Les campagnes d’Alexandre dans l’immense empire des Perses, qui comprenait alors presque tout le monde connu, tiennent du prodige et seraient inexplicables si la multitude des nations qui obéissaient au « Grand Roi » avait constitué un véritable ensemble ; mais l’immense domaine subjugué par les rois de Perse était habité par les peuples les plus distincts de langages, de traditions, de mœurs et d’intérêts, tous trop faibles, trop avilis par la servitude pour revendiquer leur liberté propre, trop indifférents à la destinée de leur maître présent pour le défendre contre un étranger. Ainsi, les Macédoniens purent entrer facilement sur le territoire de l’empire, n’ayant à rencontrer que des armées, mais sans se heurter à des peuples. Les Perses avaient l’avantage du nombre, et les soldats d’Alexandre la grande supériorité des méthodes militaires ; bien que grécisés, on ne peut pourtant dire que les vainqueurs représentassent l’hellénisme, car c’est par la crainte et la force que les Grecs, réunis à Corinthe, avaient déclaré la guerre à la Perse et choisi le roi de Macédoine pour leur généralissime. Même Alexandre rencontra devant lui, à la bataille du Granique, plus de Grecs parmi ses adversaires qu’il n’avait amené d’alliés : des milliers d’hommes parlant la langue des soldats de Marathon servaient dans l’armée asiatique, non comme mercenaires mais par esprit de vengeance contre l’oppresseur de leur patrie.
De son côté, Alexandre ne se trouvait point satisfait d’être le premier des Grecs. Conscient malgré tout d’appartenir encore à demi au monde des barbares, poussé en outre par la vanité naturelle aux parvenus, il se glorifia, ivre de jactance, d’être le successeur des Akhemenides et, se mettant à leur place, devint à son tour le « Roi des rois », fit suivre son nom de tous les titres dont s’était enorgueilli Darius, prit les mêmes résidences, Babylone et Suse, pour ses capitales, et voulut faire la conquête des contrées qui avaient obéi au roi des Mèdes et des Perses : il lui fallut la Phénicie, l’Egypte et les oasis, l’Iranie, la Bactriane et la Sogdiane, l’Arachosie, la Gédrosie et l’Inde. Mais, dans le bassin des Sept Rivières, il dut s’arrêter où s’étaient arrêtés les envahisseurs iraniens, et revenir sur ses pas.

| A. Apollonia, en Pisidie. | B. Alexandrie d’Égypte. |
| C. Alexandrie, non identifiée. | D. Alexandrie d’Arie, Herat. |
| E. Prophtasia, non identifiée. | F. Alexandrie d’Arachosie, Kandahar. |
| G. Alexandrie du Paropamise, Kherinan, à 15 kil. à l’ouest de Kabul. | |
| H. Alexandrie de l’Oxus, Satiroraï ou Karchi, suivant les auteurs. | |
| I. Alexandrie la plus lointaine, Khodjend, Maghinan d’après quelques auteurs. | |
| J. Nikaia ou Nicée (la Victoire), village voisin de Kabul. | |
| K. Bukephalaia, au bord de l’Hydaspes (Djilum), du nom du cheval d’Alexandre, qui y fut | |
| tué. Sur la rive opposée se trouve : | L. Nikaea, probablement Udinagur. |
| M. Alexandrie de l’Inde, non identifiée. | N. Alexandrie, Veh ou Milhan. |
| O. Alexandrie des Soriens, près Kastinur. | P. Alexandrie, Rhambakia. |
| Q. Alexandrie de l’Estuaire, Sangada. | R. Alexandrie, de Susiane, Charax. |
| S. Alexandrie de Troas qui fut aussi appelée Antigonea, aujourd’hui Eski-Stambul. | |
T. Alexandrie, près d’Issus, sur le site de la colonie phénicienne Myriandos, aujourd’hui Iskanderum, ou Alexandrette.
| |
C’est comme souverain d’Asie, non comme l’Achille grec auquel il avait aimé se comparer dans sa jeunesse, qu’il commanda aux peuples de toute langue et de toute race qui lui furent asservis. Bien plus, en se faisant élever de son vivant au rang des dieux, ce n’est pas au sommet de l’Olympe grec qu’il s’était assis : il se déifia suivant des rites étrangers et barbares. Il se vantait d’être le fils, non du roi Philippe — qu’il avait peut-être aidé à faire périr — mais d’un serpent, dieu de la Terre[44], et se fit reconnaître solennellement en Égypte comme issu d’Ammon aux Deux Cornes. Il le crut si bien, et le fit si bien croire aux peuples éblouis par sa fulgurante destinée, que, jusqu’à nos jours, il est connu en Asie sous le nom de « Sikandar le Bicornu ».
Quoiqu’Alexandre eût été le violenteur de la Grèce et qu’il n’ait pas représenté le génie des Hellènes dans sa vertigineuse conquête du monde connu, il était toutefois accompagné de trop d’hommes à l’esprit lucide et les contrées orientales s’ouvrirent trop largement à tout ce qui venait des petites républiques de l’Hellade pour que leur influence ne se fît pas fortement sentir dans toute cette partie de l’Asie, qui leur était autrefois presque fermée, et ne s’y rencontrât pas avec les idées et les conceptions des Iraniens et des Hindous pour se mélanger diversement avec elles. Les conquêtes d’Alexandre furent ainsi l’occasion de l’une des plus importantes évolutions de l’histoire mondiale. L’univers conscient des hommes se trouva en peu d’années très amplement agrandi, plus que doublé : même, de proche en proche, par les rumeurs lointaines, les divergences de courant et les remous, le contact se produisit au milieu de l’Asie entre les représentants des peuples méditerranéens et ceux de l’Extrême Orient. On comprend donc que cette époque d’ébranlement ait été l’une des grandes ères de l’humanité. Dans les légendes asiatiques, les noms d’Alexandre, de Rustem, de Zoroastre s’entremêlent bizarrement à ceux de Salomon, de Mahomet et de personnages plus modernes.
Le conquérant macédonien dressait des colonnes aux lieux où il avait remporté des victoires ; il fondait aussi des villes aux endroits désignés par leur importance commerciale et stratégique, au point de convergence des voies maîtresses, terrestres et maritimes. Dans le choix de quelques-uns de ces emplacements on a voulu voir un effet de son génie, comme si le concours des nations vers telle ou telle « Alexandrie » ne provenait pas de la force même des choses, de la nécessité de l’évolution historique. Nombre d’Alexandries disparurent, parce qu’elles ne s’étaient pas élevées en l’un de ces lieux indiqués d’avance ; celle de l’Inde n’existe plus et l’on en cherche inutilement la trace, tandis que la superbe Alexandrie d’Egypte devint l’une des capitales de l’univers, fut même pendant un temps le foyer le plus actif des sciences et de la pensée et, jusqu’à nos jours, est restée une cité considérable. Mais aussi sa position naturelle était de celles que le grand commerce ne pouvait négliger : déjà aux temps protohistoriques, Homère reprenait les dictons des marins pour mentionner le mouillage abrité par l’îlot de Pharos.

En cet endroit se rencontre l’un des premiers havres naturels, à l’extrémité occidentale de la longue courbe de plages incertaines qui se développe au-devant du Nil et du désert jusqu’aux côtes de Syrie. Et ce port, que les ingénieurs de la suite d’Alexandre, mais surtout ceux des Ptolémées, les successeurs du Macédonien, purent aménager sans peine par des môles et des quais, se trouvait à proximité de la
branche canopique du Nil : pratiquement, la cité nouvelle possédait les avantages réunis d’un lieu de commerce à la fois maritime et fluvial. Elle paraît avoir été fondée d’après les conseils des Grecs de Naukratis, qui tenaient à posséder le grand port maritime dans le voisinage du bras du Nil sur lequel s’était bâtie leur ville. D’ailleurs, Alexandrie surgissant plus à l’Est, près de l’excellente rade d’Aboukir,
eût présenté exactement les mêmes avantages pour le commerce et la navigation[45].
Après la mort d’Alexandre, les fragments détachés de l’immense domaine conquis eurent, de même que les villes fondées par lui, les destinées les plus diverses, et la Grèce proprement dite fut entraînée dans le tourbillon des révolutions et des guerres qui remuait les royaumes de formation nouvelle, essayant de se refaire suivant les anciennes affinités de traditions, de cultes, de races et de langues. La situation devint d’autant plus grave que l’éblouissement causé par la conquête du monde connu et l’apparition soudaine de l’Inde affola tous les ambitieux, exalta tous les aventuriers, suscita dans chaque cité des imitateurs d’Alexandre.
Un autre grand danger provenait du déluge d’argent qui s’était déversé sur la Grèce et qui avait eu pour conséquence fatale l’inégalité des fortunes : accaparement de grandes richesses en quelques mains et appauvrissement correspondant des foules. Les maux qui
avaient suivi l’enrichissement d’Athènes à l’époque de Périclès s’aggravèrent
singulièrement. Démosthènes avait pu dire que « des enrichis achetaient toutes les terres, tandis qu’à côté d’eux le plus grand nombre des citoyens n’avait plus même la vie du lendemain assurée »[46] ; mais un plus grand désastre pour la Grèce fut la prise de possession par Alexandre des prodigieux trésors amassés par les rois de Perse : une masse de lingots correspondant à près de deux milliards fut monnayée par les Grecs ; elle s’accumula dans les mains des riches et corrompit la nation[47]. Ce fut une révolution économique comparable à celle à celle qui se produisit, dix-huit siècles plus tard, lorsque les rois

athènes, colonne corinthienne dit temple de zeus panhellénien, IIe siècle de l’ère vulgaired’Espagne virent affluer dans leurs ports les galions chargés des dépouilles du Nouveau Monde. C’était la fin nécessaire d’une évolution économique dont le mot d’ordre proverbial était : Χρἠματʹ ἀνἠρ, « c’est l’argent qui fait l’homme ».
La pauvreté de la grande masse, comparée à la richesse de quelques-uns, et le dégoût d’une vie sans liberté amenèrent un découragement général, que Polybe nous dit s’être manifesté par le célibat et la diminution volontaire du nombre des enfants. Le pays se dépeupla, même pendant les périodes où ne régnaient ni guerres ni épidémies. « Les hommes, non les dieux étaient les seuls coupables, puisqu’ils refusaient de se marier, et quand ils se mariaient, ne s’occupaient plus d’élever leurs enfants, sinon un ou deux, qui devaient, après la mort des parents, hériter de la fortune entière ». Toute décadence se manifeste par les mêmes symptômes. Néanmoins, la puissante vitalité qui avait fait naître la civilisation grecque était encore loin d’être épuisée et même, à certains égards, donna-t-elle ses meilleurs fruits ayant que la main de Rome vînt brutalement supprimer la Grèce : il arrive souvent qu’en des organismes physiquement affaiblis la pensée prend une plus grande acuité, une force de pénétration plus profonde. Des ligues se formèrent entre petites républiques avec la volonté sincère de respecter les libertés locales, de n’assurer de privilège à aucun État aux dépens des autres. Jamais les Grecs ne s’étaient aussi rapprochés d’une véritable fédération que durant l’existence de la ligue achéenne. Fondée dans le Péloponèse, surtout par les descendants de ceux des Grecs qui, mille ans auparavant, antérieurement à Sparte et Athènes, avaient exercé l’hégémonie pendant la guerre de Troie, cette ligue ramenait le centre de gravité de l’Hellade vers le point qu’il avait occupé jadis avant les grandes invasions doriennes : la vieillesse renouvelait le cycle de l’enfance. Les derniers des Grecs furent ceux qui en avaient été les premiers. « La fin de la Grèce rappela ses commencements ; Philopœmen était un arcadien, — un Pélasge »[48].
Mais la belle ligue achéenne, qui devait embrasser tout le monde grec, réaliser l’idée du panhellénisme, avait contre elle tous les tyrans des cités, toutes les vieilles aristocraties qui ne pouvaient espérer de maintenir leur pouvoir que par l’alliance avec les Macédoniens ou d’autres conquérants. Aux anciens ennemis vinrent bientôt s’en joindre de plus redoutables ; le monde s’était élargi et au fur et à mesure que la Grèce développait sa pensée d’indépendance, les dangers du dehors devenaient plus pressants dans une proportion plus rapide : Athènes, ayant pris conscience d’elle-même par le renversement des tyrans et les victoires sur les Mèdes, se gouverne en démocratie, mais, s’attribuant l’hégémonie, elle est renversée par Sparte. La ville du Parthénon redevient libre et prospère, plus respectueuse des autres cités : le Macédonien la subjugue. Une fédération libre, véritable organisation populaire, se forme avec la ligue achéenne : les Romains font leur apparition dans la péninsule illyrique.
Le territoire primitif de la ligne achéenne, vers 280 av. J.-C, était le versant nord-occidental de l’Erymanthe ; l’Arcadie s’y joignit ensuite, et plus tard l’Elide avec le reste du Péloponèse.
Contre ce danger nouveau il eût fallu des forces nouvelles, mais précisément les envahisseurs surent utiliser les Grecs contre les Grecs, pousser la ligue étolienne contre la ligue achéenne. Or les Etoliens, qui entraient désormais en violent contact avec les autres Hellènes, avaient jusqu’alors vécu presque en dehors du groupe des peuples de même origine : pasteurs et bandits, ils s’étaient pour la plupart divisés en petits États obéissant à des chefs de guerre, et, dans l’ensemble, représentaient une période de civilisation très inférieure à celle des Grecs, tournés vers la mer Orientale.

Une coutume singulière s’était établie chez les Etoliens avec la force d’une loi. Deux peuples se déclaraient-ils la guerre, les Etoliens campaient dans le voisinage des combattants pour tomber sur le vaincu et arracher aux vainqueurs la plus grande part du butin : c’est ce qu’ils disaient « piller le pillage ». Polybe raconte de Dicéarque, le pirate étolien, que, dans « l’excès de son délire», il voulait consterner les dieux et les hommes. Partout où il abordait, il élevait deux autels[49], l’un à l’Impiété, l’autre à l’Injustice, il transformait en religion son mépris des cultes grecs et de
tout ce qui leur était cher. Les Romains s’adressaient donc bien en prenant les Etoliens pour alliés dans leurs entreprises de conquête, ce qui ne les empêcha pas ensuite de se retourner contre eux et de les écraser, de les réduire à une impuissance absolue.

Mais avant que le drame de la fin ne s’accomplit en sa terrible brutalité, l’ironie du sort devait se produire aux dépens de la pauvre nation condamnée. En l’an 196, trois siècles après Marathon, devant la foule accourue pour les jeux isthmiques, au pied de l’Acrocorinthe, un héraut proclame la pleine liberté de tous les Grecs, la ligue fraternelle des cités sous la protection des légions romaines, vouées désormais au soutien du bon droit. Avec cette furie de bassesse et d’abjection qui précipite les multitudes sous les pas des vainqueurs, tout ce peuple assemblé, heureux de recevoir le simulacre des biens qu’il était trop lâche pour conquérir lui-même, poussa de tels cris d’acclamation vers le ciel que « les oiseaux en tombèrent », dit la légende ; mais le demi-siècle ne s’était pas écoulé qu’au même endroit le consul Mummius venait sans phrases porter la ruine et la mort. La Grèce n’était plus qu’une province romaine, il lui restait un nom, chèrement gagné par ses dernières luttes, « Achaïe », et l’immortelle influence qu’elle avait acquise dans les sciences, les arts et tout le mouvement de la pensée. Thucydide, qui assista aux terribles événements de la guerre du Péloponèse et put reconnaître en partie les causes de la future décadence hellénique, avait tenu le langage fier qui convenait à un Athénien : « S’il faut que nous dégénérions un jour, car tout est destiné à décroître, il en restera du moins un éternel souvenir ». Il eût pu ajouter « un éternel exemple ».
L’œuvre de la Grèce dans l’histoire du monde a été surtout de concentrer en soi et d’élaborer tous les éléments de progrès convergeant de l’Egypte et du monde oriental, du Paripamisos au Caucase. En cet espace insulaire et péninsulaire étroit, se sont successivement déversés, comme en un creuset pour s’y refondre à nouveau, les mythes et les idées, les industries, les sciences et les arts nés, pendant le cours des âges, dans un pourtour immense de terres habitées par des populations de races différentes et du génie le plus divers, Hamites et Sémites, Aryens et Touraniens. Les petites tribus
ancestrales des Hellènes étaient encore dans leur barbarie primitive lorsque l’Egypte, la Chaldée sculptaient déjà des statues, gravaient des écritures sacrées et dressaient des temples ; mais, en se propageant vers l’Ouest, ces deux grandes civilisations locales devaient sa rencontrer sur les côtes de la Phénicie, et les flottes du peuple commerçant, portant ce que l’homme a jamais trouvé de plus précieux, le trésor par excellence, le livre, avaient nécessairement pour première étape, dans le voyage sur la longue Méditerranée, les îles et les presqu’îles du monde grec. Là, ces navigateurs de l’Orient trouvaient des colons venus d’autres pays, des rivages de l’Asie Mineure et des bords de la mer Noire : de proche en proche, par les récits et les légendes qui se portaient de peuplade en peuplade sur les routes du lent trafic, La Grèce reçut et mit en œuvre tout l’avoir intellectuel acquis déjà par les peuples assis en amphithéâtre dans le monde environnant, des Ethiopiens du Haut Nil aux Scythes du Borysthène. L’évolution comporte toujours un certain recul en même temps que des progrès, et la Grèce n’échappa point à cette loi. Il est certain que les Hellènes, comme industriels proprement dits, restèrent inférieurs aux 
Musée du Louvre.Cl. Giraudon.
miroir et flacon à parfumEgyptiens ; de l’autre côté du monde, les Chinois les dépassèrent de beaucoup dans leur développement autonome ; rien chez les
Grecs ne peut être mis en parallèle avec les objets d’albâtre fabriqués par les Egyptiens dès la sixième dynastie[50]. Le milieu et le génie qui en dérivait porta les premiers dans une direction autre, vers les applications de la science au travail de l’homme. La fabrication d’instruments relatifs à la connaissance de la Terre fut un des grands triomphes de l’intelligence humaine, et c’est aux Grecs de Milet qu’est due l’admirable réalisation des premiers globes célestes et terrestres. Pareille industrie témoignait d’ailleurs, sinon d’une connaissance approfondie de la Terre et des Cieux, du moins de la découverte du fait primordial, la rondeur terrestre. La translation du globe autour du soleil était admise par quelques-uns également, notamment par Aristarque de Samos, suivant en cela renseignement de Pythagore et de
son école : on dit même qu’il fut menacé d’un procès en impiété, sous l’imputation
de vouloir « déplacer le foyer intime du monde »[51]. Bien plus, les lois de la gravitation étaient déjà pressenties puisque, d’après certaines hypothèses, la lune ne tombe point, « grâce à sa marche même et à la rapidité de sa révolution. Ainsi les projectiles placés sur une fronde se trouvent retenus par le mouvement circulaire qui leur est imprimé ». Enfin, les savants parlaient de l’absurdité de tout système donnant la Terre pour centre à l’univers. « Le monde étant infini, disaient-ils, la Terre ne peut en occuper le milieu »[52].
Dans leurs œuvres matérielles, la gloire toujours grandissante des Grecs vint surtout du merveilleux sens de la mesure et de la forme, dans lequel ils n’ont pas encore été surpassés. Aucune de leurs peintures n’a été conservée et nous ne pouvons nous en faire une idée indirecte que par les décorations — romaines et égyptiennes, mais évidemment nées sous l’influence de l’art grec — dont on a retrouvé les restes dans les cendres de Pompei et dans les fouilles de Hawara. Des chefs-d’œuvre de sculpture dus à Myron, Phidias, Scopas, Praxitèle sont encore l’orgueil de nos musées, et l’on sent en présence de ces dieux qu’ils représentent vraiment un idéal de l’homme, tel que les Grecs l’avaient conçu dans le parfait équilibre de sa force et de sa grâce, de sa noblesse et de sa beauté : aussi, cette perfection même, où les artistes avaient su admirablement fondre l’idée première de la majesté, jadis grossièrement symbolisée par les règles hiératiques, et la science de la réalité vivante, cette perfection eut-elle pour conséquence d’arrêter pendant de longs siècles le libre développement de l’art, en laissant le sentiment de leur impuissance aux hommes qui suivirent : longtemps, les meilleurs, désespérant d’atteindre aux sommets inaccessibles, s’épuisèrent déplorablement en de vaines imitations, au lieu de tenter virilement des voies nouvelles correspondant à des pensers nouveaux. De même que les monuments de la grande statuaire, les charmantes figurines de Tanagra, les aiguières, les amphores, les vases retrouvés dans les temples et les tombeaux restèrent des types qui, dans l’admiration des modeleurs et ciseleurs, furent presque considérés comme inégalables.
Les divers ordres d’architecture classique furent aussi, par respect

Musée de Chantilly.Cl. Giraudon.
statuette en terre cuite de tanagrapour le génie hellénique, reproduits sans originalité sur tous les sols et dans tous les climats, et souvent sans choix raisonné entre les deux styles transmis par les Athéniens aux peuples leurs successeurs : le corinthien avec son chapiteau en corbeille de feuilles d’acanthe date réellement de l’époque romaine ; la cariatide, bien qu’appartenant à la conception hellénique, n’eut jamais qu’un emploi restreint. L’ « ordre dorique », forme d’art dont on retrouve surtout les origines dans le style mycénien, reçut ce nom parce que les Doriens étaient les dominateurs des contrées du Péloponèse où surgirent le plus anciennement des temples de ce type architectural[53], on peut le considérer comme hellénique, national par excellence. Directement, il ne doit rien à l’Egypte ; avant que les Grecs se répandissent dans la vallée du Nil, la forme du temple dorique était parfaitement arrêtée dans ses grandes lignes. L’ouverture de l’Egypte aux marins hellènes ne put avoir sur les progrès de l’architecture de la Grèce et des îles que des effets très indirects et très généraux, par l’étonnement que produisit la vue des énormes édifices riverains du Nil et par l’esprit d’émulation qu’il fit naître chez les artistes grecs[54]. Le temple dorique n’est autre chose que la « maison royale » des temps homériques, entourée d’une colonnade pour en accroître la majesté divine. Ce mode architectural n’emprunta rien aux pratiques de l’étranger : il est bien le fils aîné du génie de la Grèce.
Quant à l’art ionique, né dans la Grèce de l’Asie, son nom est bien justifié au point de vue de l’histoire, puisque ce furent des Ioniens d’Asie qui grécisèrent les formes locales de la construction. Eoliens et surtout Ioniens du littoral s’étaient rencontrés avec Phéniciens et Cypriotes ; par la Cappadoce et autres pays de l’intérieur, ils s’étaient même trouvés en rapports avec l’Assyrie et la Perse. Parmi les formes architecturales qui appartenaient déjà au monde de l’Asie Antérieure bien avant la naissance du mode ionique, la volute était un ornement très répandu, que les bâtisseurs ioniens empruntèrent certainement à leurs prédécesseurs en civilisation. De même, la colonne ionique ressemble à celle de l’Asie par sa plus grande légèreté relativement à la colonne dorique : bien que les palais connus de la Perse soient très postérieurs aux plus anciens monuments de l’Ionie, on a des raisons de penser que leurs colonnes, si élancées en comparaison de celles de tous les ordres grecs, continuent les traditions iraniennes et reproduisent les formes d’une architecture antérieure, comme celle du Mazanderan, où des troncs d’arbres, et non de lourds piliers de pierre, supportaient les toitures. A ces influences de la construction des Perses, la colonne ionique doit sa forme élégante de même que le profil de sa base et les cannelures nombreuses de son pourtour ; mais ce fut des Athéniens triomphants après les guerres médiques qu’elle reçut son caractère universel : il en fut de même pour l’ordre dorique, jadis réservé aux édicules élevés par des gens du Péloponèse à Thèbes et autres lieux de pèlerinage. Quand, à Athènes devenue la vraie métropole de tous les Grecs, affluèrent tant de savants architectes venus de toutes les parties de l’Europe et de l’Asie hellénique, ses arts conquirent droit de cité dans la Grèce antique, dans la Sicile et l’Italie, puis l’héritage s’en propagea de peuple en peuple et de siècle en siècle.

A. Acropole.
B. Aréopage, Siège du Tribunal.
C. Pnyx, Assemblée du Peuple.
D. Colline des Muses.
E. Quartier de Céramique.
F. Ville de l’époque romaine.
1. Bassin de Munichia.
2. Bassin de Zéa.
3. Port militaire, Kantharos.
4. Port de commerce, Emporion,
5. Aphrodision.
6. Port muet.
La promenade du Lycée rappelle l’enseignement d’Aristote, et les bosquets d’Academos celui de Platon.
La ville actuelle d’Athènes se développe surtout vers le nord.
D’ailleurs, la fin apparente de la Grèce n’était pas une vraie fin, et l’asservissement des républiques mères, l’expatriation des meilleurs et des vaillants qui se réfugiaient ou allaient chercher fortune dans toutes les colonies helléniques ou dans tous les royaumes « barbares » du pourtour de la Méditerranée eurent pour conséquence une énorme extension de la véritable Grèce et de ses idées. Le foyer de vie se déplaça, mais la vie continua de brûler avec la même ardeur. De même qu’Athènes avait reçu le feu sacré porté par les Milésiens et tant d’autres fugitifs de l’Asie Mineure, de même Pergame, Alexandrie, Cyrène, Syracuse, Marseille devinrent autant d’Athènes continuant l’oeuvre de leur devancière et la continuant surtout par l’activité de la pensée et l’amour désintéressé de la science. Ne vit-on pas le Massiliote Pythéas explorer les passages du Grand Nord Atlantique, uniquement pour la joie de savoir ? Les édifices construits, notamment le Parthénon, montraient d’une façon définitive, éblouissante, comment les artistes grecs avaient compris la réalisation de leur idéal en architecture, mais dans la philosophie, dans la morale, dans la conception de la vie personnelle et collective, ils n’achevèrent leur œuvre que longtemps après : c’est en exil, peut-on dire, que la Grèce rédigea le testament des siècles vécus par elle et sa méthode d’enseignement pour les peuples à venir.
La cause première de cet admirable développement de la pensée qui caractérise la Grèce doit être cherchée dans la faible influence de l’élément religieux. Les prêtres ne gouvernèrent point les Hellènes. Certainement, le sacerdoce tenta de se constituer dans les républiques éoliennes, ioniennes et doriennes, comme il l’avait fait aussi dans tous les autres pays du monde, mais il ne réussit que faiblement en son entreprise. Les mythes apportés de l’Egypte, de la Phénicie, de la Perse ne furent pas accompagnés de leurs redoutables interprètes, les magiciens dispensateurs du salut. Dans chaque vallon de montagne, en chaque famille de clan primitif, le Grec était son propre prêtre, et, quand la tribu prit une plus grande extension, les représentants politiques des citoyens présidaient un culte général. La mythologie grecque, si riche et si variée, se renouvelait incessamment au gré de l’imagination populaire qui, de vallée en vallée, de péninsule en péninsule, aussi bien que de siècle en siècle, modifiait rapidement ses dieux. Le sens primitif des fables inventées par le symbolisme — première tentative de résumé synthétique — était encore resté clair à la plupart dès fidèles : ils savaient parfaitement que Zeus était le « Grand Jour », et, en même temps, le souverain de l’Olympe : Poséidon était le dieu de la mer, mais surtout la mer elle-même ; Hephaïstos forgeait les armes des dieux au foyer souterrain des laves, mais il se montrait en personne sous l’apparence des flammes. Ainsi de toutes les divinités : Demeter, la « Bonne mère », qui protégeait les moissons, était la moisson même que fait onduler le vent. Cette transparence des mythes permettait aux Grecs de se passer d’intermédiaire pour les comprendre, et, d’ailleurs, la cité restait trop petite, trop agitée aussi pour qu’il pût s’y former un sacerdoce aux dehors immuables.
Certainement, la beauté du ciel clair, la pureté de profil qu’offraient les rochers et les collines de l’horizon, la lumière éparse sur la mer avaient contribué à donner du charme et de la gaieté à l’ensemble de la mythologie grecque. L’effroi de la mort, la peur de l’inconnu qui se devine au delà du tombeau, régnait moins sur les Hellènes que sur les populations des contrées où la nature est plus sombre, où ses phénomènes sont plus redoutables. Ce fut l’une des raisons pour lesquelles ils évitèrent l’intervention constante du magicien qui conjure le sort par des gestes, des contorsions et des cris ; ils se tenaient à l’écart de leurs parents et alliés de l’Asie Mineure, qui, dans le Pont, la Cappadoce, la Cilicie, aimaient à se jeter en des transes extatiques, comme le font encore de nos jours le chamane touranien, l’exorciste catholique et le piagé des Mundurucù.
Pendant la belle période de la Grèce, le redoutable destin, qui planait au dessus des dieux eux-mêmes et dont les grands tragiques nous décrivent la domination terrible, parait avoir été, pour le peuple d’Athènes, un sujet d’instruction dramatique beaucoup plus qu’une cause réelle d’épouvantement. Les oracles de Delphes, ceux des autres dieux que l’on venait consulter de tous pays grecs et grécisés, ont un caractère spécial : tandis que les divinités des autres nations menacent, commandent, terrorisent, Delphes semble s’ingénier à exercer la sagacité des Grecs : elle leur donne des énigmes à résoudre, des jeux d’esprit à deviner. Le Sinaï fulminait ses lois au peuple prosterné dans la poussière du désert, Delphes conversait, pour ainsi dire, avec des hommes de goût, et fréquemment les citoyens d’une ville discutèrent ses oracles. Même les Cuméens, dans l’Asie Mineure, désobéirent de propos délibéré à un ordre des Branchides[55] leur enjoignant de livrer leur hôte au roi de Perse. Ils préférèrent leur propre conception du bien.
Mais, si peu qu’il existât, le sacerdoce devait, par son esprit de caste, devenir hostile au libre génie des Grecs, tendre même à la trahison. Dans la période du péril suprême, le peuple voulait se défendre et, par le fait même de son énergique volonté, il s’imagina volontiers que les dieux avaient combattu pour lui ; toutefois, les « oracles étaient restés neutres ou équivoques » : il fallut toute la subtilité de Thémistocle pour interpréter dans le sens héroïque une réponse ambiguë de la Pythie. Ne pas se compromettre avec le vainqueur, tel avait été le dernier mot de la sagesse sacerdotale[56].
Sans doute, la perte de l’indépendance des Grecs accrut proportionnellement l’influence du prêtre. Des rites mystérieux comme ceux d’Eleusis attiraient vers eux les désœuvrés et décadents de l’époque, gens vaniteux ou inquiets qui voulaient se faire initier à une prétendue science interdite aux profanes, et sur les collines se pourchassaient, déchaînés dans la fureur des sens, les troupeaux des Bacchantes et des Ménades.
Plus heureux que les Sémites et les peuples de l’Orient lointain, et grâce à la variété, à la rapidité d’allures, aux changements successifs et profonds de leur polythéisme, les Hellènes purent aussi échapper à la tyrannie de livres comme le Zend-Avesta, les Veda et le Chu King, comme la Bible et le Coran. Ce qui, chez les Grecs, se rapprocha le plus des « livres sacrés » par l’autorité sur les esprits, ce furent les poèmes et les drames des grands rhapsodes et tragédiens ; mais il était difficile de trouver dans ces œuvres une règle de pensée, une ligne de conduite pour la nation ; tout au plus, un individu comme Strabon, lui-même Sémite hellénisé[57], donnait-il une sorte de vertu sacrée aux vers de l’Iliade, s’ingéniant à ramener les faits de la géographie aux descriptions d’Homère, mais les conceptions du poète ne pouvaient en rien arrêter le développement normal de la société dans son ensemble, elles ne servaient pas de frein, comme les injonctions de la Bible ou du Coran, pour retarder indéfiniment l’évolution intellectuelle et morale des croyants.
Le polythéisme, tel qu’il se développa dans la Grèce antique, a pour principe l’autonomie de tous les êtres et reconnaît implicitement que toute chose est vivante[58]. Ainsi la religion des Grecs affirmait déjà ce que la science moderne a reconnu : l’indissolubilité de la vie sous tous ses aspects, matière et pensée ; mais, si par ses hautes conceptions elle se projette au loin dans le monde de la science, elle tient aussi par ses origines à l’animisme primitif qui peuple de génies les terres, l’air et les eaux, qui voit les esprits innombrables frémir dans le feuillage des chênes.

fin du ve siècle avant l’ère vulgaire
Les bergers de l’Arcadie sur leurs plateaux herbeux continuèrent le plus longtemps de pratiquer cette vieille religion naturelle : leur principale divinité, champêtre comme eux, faite à leur image, aimait les beaux horizons lumineux, les féconds pâturages, les antres frais où l’on s’abrite du soleil[59]. Pan, qui avait valu à toute la contrée le nom de Panie[60], céda le premier rang à Zeus, le dieu jaloux ; et les Arcadiens durent se subordonner à de puissants voisins ; mais, quoique fort modeste et se retirant discrètement dans les cavernes, Pan n’abdiqua

Musée de Vienne.
aristote
Attribution contestée.point, il resta le dieu des pauvres qui lui dressaient de simples autels, non des temples, et lui apportaient non des bêtes grasses mais de rustiques offrandes. Il vécut ainsi, bien plus durable que Zeus et autres jeunes dieux, et par une étrange fortune il dut à la ressemblance fortuite de son nom avec le mot « πᾶν », pris dans le sens de « tout », d’être assimilé à l’immensité même des choses vivantes, avec le grand univers panthéiste. C’est ainsi que dans le Satyre de Hugo, Pan, infiniment grandi, sans bornes comme le monde, abrite les hommes et les dieux dans son immensité.
Les mystères religieux de la Grèce conservèrent aussi, pendant de longs siècles, le culte direct des astres, soleil, lune, étoiles, lors même que les représentants symboliques de la nature, les dieux, eurent pris la place des éléments : le fétichisme panthéiste se maintenait sous le polythéisme, de même que, plus tard, le paganisme se continua sous le catholicisme. Les temples grecs, aussi bien que ceux de l’Egypte, furent construits de manière à s’orienter exactement vers le lever des étoiles ou des groupes stellaires les plus remarquables, tels qu’Arcturus, Spica, les Pléiades, et c’est à l’époque où ces astres surgissaient de l’horizon, en vue du sanctuaire, que se célébraient les grandes fêtes de la divinité, associée à l’astre lointain dans l’adoration des fidèles. Mais puisque, de période en période, la position apparente des étoiles change 
Musée d’Aix en Provence.
platonpar suite de la précession des équinoxes, les prêtres, debout à côté de l’autel, devaient faire déplacer l’ouverture des portes pour suivre le faisceau des rayons stellaires. Bien plus, lorsque plusieurs siècles avaient déjà passé sur le temple, il ne suffisait plus de percer de nouvelles portes ; c’était l’édifice même qu’il s’agissait de reconstruire en le faisant tourner sur son axe, pour ainsi dire ; le temple marchait comme une aiguille sur le cadran des cieux. Aux endroits où les constructions s’élevèrent successivement sur la même place, l’angle d’écart, observé par les architectes, leur suffit pour révéler les époques d’érection première et de restauration. De cette manière, on a pu fixer à plus de 34 siècles avant nous (exactement à l’année — 1530) la fondation du temple archaïque d’Athéné, sur l’Acropole, et à 230 ans plus tard celle du temple d’Eleusis, qui regardait vers Sirius, comme tant de monuments contemporains d’Egypte, et qui donna peut-être asile à des magiciens venus de la même contrée[61].
Ainsi, le polythéisme hellénique comprend, dans l’ensemble de son développement, toutes les formes religieuses primitives qui se sont succédé parmi les hommes ; il devait aboutir également aux formes religieuses les plus élevées, puis nier son principe, pour retrouver, au delà des cultes, la morale humaine en son essence. Des forêts de Dodone, où l’on écoutait avec frayeur les grands chênes frémissants, aux jardins d’Academos, où se promenaient les philosophes en discourant de la sagesse, les chercheurs hellènes ont parcouru la route immense qui mené de l’instinct originaire à l’étude consciente des grands problèmes de la vie. Certainement, la religion monothéiste, concentrant tout l’idéal humain en une seule personne auguste, se manifeste dans la pensée grecque aussi noblement que dans celle des Sémites : « Le Jupiter de Pindare et de Sophocle n’était-il pas l’ennemi de la tyrannie, le protecteur des opprimés, le gardien du foyer, le vengeur de la justice, le refuge des malheureux ? »[62] Et dès que les différents peuples ont perdu les dieux spéciaux qui les distinguent, le grand Dieu lui-même ne s’évanouit-il pas au profit du bien et du beau qu’il représente ? De cité à cité, les Hellènes s’étaient reconnus comme fils d’ancêtres communs, cohéritiers d’une même langue et d’une même civilisation, créateurs d’un même type social. La notion patriotique, d’abord absolument étroite, confinée dans la même cité, s’étendit graduellement à tous les habitants de l’Hellade et des pays helléniens, puis, chez les philosophes, elle embrassa le monde entier. Jamais le principe de la grande fraternité humaine ne fut proclamé avec plus de netteté, d’énergie et d’éloquence que par des penseurs grecs : après avoir donné les plus beaux exemples de l’étroite solidarité civique, les Hellènes affirmèrent le plus hautement le principe de ce qui deux mille ans après eux s’appela « l’Internationale ».
L’atavisme qui, dans toute civilisation vieillie, plus ou moins faisandée de conventions et de mensonges, ramène toujours un certain nombre d’hommes vers l’amour de la nature primitive, cet atavisme dut se manifester aussi dans la société grecque, mais accompagné de toutes les conquêtes de la culture intellectuelle. On vit alors des philosophes, parfaitement armés pour la dialectique par la connaissance des choses et le mépris de tout préjugé, revendiquer en toute simplicité, mais avec une force invincible de conviction, leur affranchis. sèment de tout despotisme, aussi bien celui que d’autres hommes faisaient peser sur eux que celui des prétendues convenances et de l’habitude. On vit des stoïciens esclaves marcher si noblement dans leur dignité qu’on les respecta plus que des hommes libres ; on vit des 
British Museum.Cl. Mansell.
diogène« cyniques », mot jadis respecté mais employé actuellement en mauvaise part, prendre la même liberté de gîte et d’action que les animaux des champs, tout en s’élevant par l’étude et l’enseignement à la même hauteur de pensée que les sages les plus renommés de leur temps. N’ayant d’autre demeure qu’une jarre ou qu’un tonneau, presque sans besoins, ignorant même la faim puisqu’une olive, puisqu’une gousse d’ail leur suffisait, ils croyaient à l’égalité et la pratiquaient ; effaçant par leur propre vie toute différence entre riches et pauvres, ils revenaient à la parfaite réconciliation entre les classes. Du coup, toutes les distinctions sociales se trouvaient abolies, et, devant Diogène, « Citoyen de la Terre », Alexandre, le meurtrier de son père, l’exterminateur de Thèbes, ne se sentait plus le maître omnipotent qu’il était en face de ses soldats et de ses peuples asservis. Et cependant, ces philosophes, si hauts par la pensée qu’ils pouvaient ignorer comme si elle n’existait pas la société des puissants et des riches, continuaient de vivre dans les cités, d’agir directement sur leurs concitoyens par l’exemple et la noblesse de leur vie ; ils ne se réfugiaient pas en dehors de l’humanité, comme le firent plus tard les anachorètes et les cénobites, égoïstes pusillanimes, ne cherchant que leur propre salut.
Cette haute compréhension des choses n’entrait, il est vrai, que dans un petit nombre de cerveaux ; mais elle devait se propager de siècle en siècle et de peuple en peuple jusqu’aux extrémités de cet univers que, sans le connaître encore, on embrassait d’avance en une vaste république d’égaux, l’idéal de notre temps et des temps à venir.

- ↑ Zénaïde A. Ragozin, Vedic India, p. 72.
- ↑ Fouqué, Mission scientifique à l’île de Santorin. Archives des Missions, 2e série, t. IV, 1867.
- ↑ Fr. Lenormant, La Légende de Cadmus, Les premières Civilisations, vol. II, pp. 344 et 345.
- ↑ Arthur Evans, A Mycenean System of Writing in Crete and the Peloponnesus.
- ↑ André Lefèvre, Les Origines helléniques.
- ↑ Movers ; Fr. Lenormant ; de Saulcy, passim.
- ↑ Victor Bérard, Les Phéniciens et l’Odyssée.
- ↑ V. Bérard, ouvrage cité.
- ↑ Movers, Die Phoenizier, t. I, p. 517.
- ↑ Fr. Lenormant, Les premières Civilisations, vol. II, p. 422.
- ↑ Giambattista Vico, Science nouvelle, édition française, p. 202.
- ↑ Aristote, République athénienne, éd. Th. Reinach, pp. 2, 3.
- ↑ André Lefèvre, Les Origines helléniques.
- ↑ Bursian, Géographie von Griechenland.
- ↑ Otfried Müller, Orchomenos und die Minyen.
- ↑ Fr. Lenormant, Les premières Civilisations, vol. II, p. 410.
- ↑ Strabon, livre I, chap. II, 40, Éd. Am. Tardieu.
- ↑ E.-H. Bunbury, History of ancien Geography, vol. I, p. 20.
- ↑ L. von Ranke, Weltgesckiçhte, I, 1, pp. 160, 161.
- ↑ G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l’Art dans l’Antiquité, t. VII, p. 230.
- ↑ L. von Ranke, Weltgeschichte, t. I, 1, p. 169.
- ↑ Hérodote, Histoires, Livre V, 72.
- ↑ G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l’Art dans l’Antiquité, tome VII, p. 8.
- ↑ Fr. Lenormant,Les premières Civilisations, vol. II, p. 423.
- ↑ Ernst Curtius, Die Ionier vor der griechischen Wanderung, p. 9.
- ↑ G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l’Art dans l’antiquité, t. VII, pp. 304, 305.
- ↑ Victor Bérard, Les Phéniciens et l’Odyssée, t. I, p. 74.
- ↑ G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l’Art dans l’Antiquité, t. VII, pp. 307, 308.
- ↑ L. von Ranke, Weltgeschichte, I, 1, p. 173.
- ↑ G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l’Art dans l’Antiquité, t. VII, pp. 293 et suiv.
- ↑ G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l’Art dans l’Antiquité; tome VII, p. 277 et suiv.
- ↑ Ed. Meyer, Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums, p. 16, 17.
- ↑ George Grote, History of Greece.
- ↑ Ibn-Khaldoun, Prolégomènes ; cité par Ernest Nys, Société nouvelle, juillet 1896, p. 123.
- ↑ L. von Ranke, Weltgeschichte, I, I, p. 185.
- ↑ F. Laurent, Histoire de l’Humanité.
- ↑ Daily, De la Sélection ethnique, Revue d’Anthropologie.
- ↑ L. von Ranke, Weltgeschichte, t. I, 1, p. 171.
- ↑ G. Grote, History of Greece, IV, p. 37.
- ↑ Hérodote, Histoires, v. 37, 38.
- ↑ L. von Ranke, Weltgeschichte, I, 1, p. 254 et suiv.
- ↑ Ed. Meyer, Die Sklaverei im Altertum.
- ↑ Aristote, La République Athénienne, édit. Th. Reinach, chap. XVI, § 41.
- ↑ Michelet, La Bible de l’Humanité.
- ↑ J.-P. Mahaffy, The Empire of the Ptolemies, p. 11.
- ↑ Troisième Olynthienne, § 24 et suiv.
- ↑ Louis Theureau, Revue scientifique, 1897, II, p. 520.
- ↑ Michelet, Histoire Romaine, pp. 60, 61.
- ↑ Bazin, Archives des Missions scientifiques et littéraires, 2e série, t. I, p. 258.
- ↑ Ernest Renan, Mélanges d’Histoire et de Voyages, p. 67.
- ↑ Plutarque, Du Visage qui se voit dans le Disque de la Lune, 6.
- ↑ Même ouvrage.
- ↑ G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l’Art dans l’Antiquité, t. VII, pp. 348, 349.
- ↑ Même ouvrage, t. VII, pp. 654 à 667.
- ↑ Hérodote, Histoires, I. p. 158 et suiv.
- ↑ Edgar Quinet, Vie et Mort du Génie grec, pp. 33, 34.
- ↑ Jules Baissac, Société nouvelle, mars 1896, p. 316.
- ↑ Louis Ménard, Polythéisme grec.
- ↑ Victor Bérard, De l’Origine des Cultes des Arcadiens.
- ↑ Plutarque, Dénomination des Fleuves et des Montagnes ; G. Clemenceau, Le grand Pan.
- ↑ F.-C. Penrose (and N. Lockyer) Philosophical Transactions, 1884, p. 805 et suiv. ; — Nissen, Rheinisches Museum fur Philologie, 1885, 1887.
- ↑ Michel Bréal.

