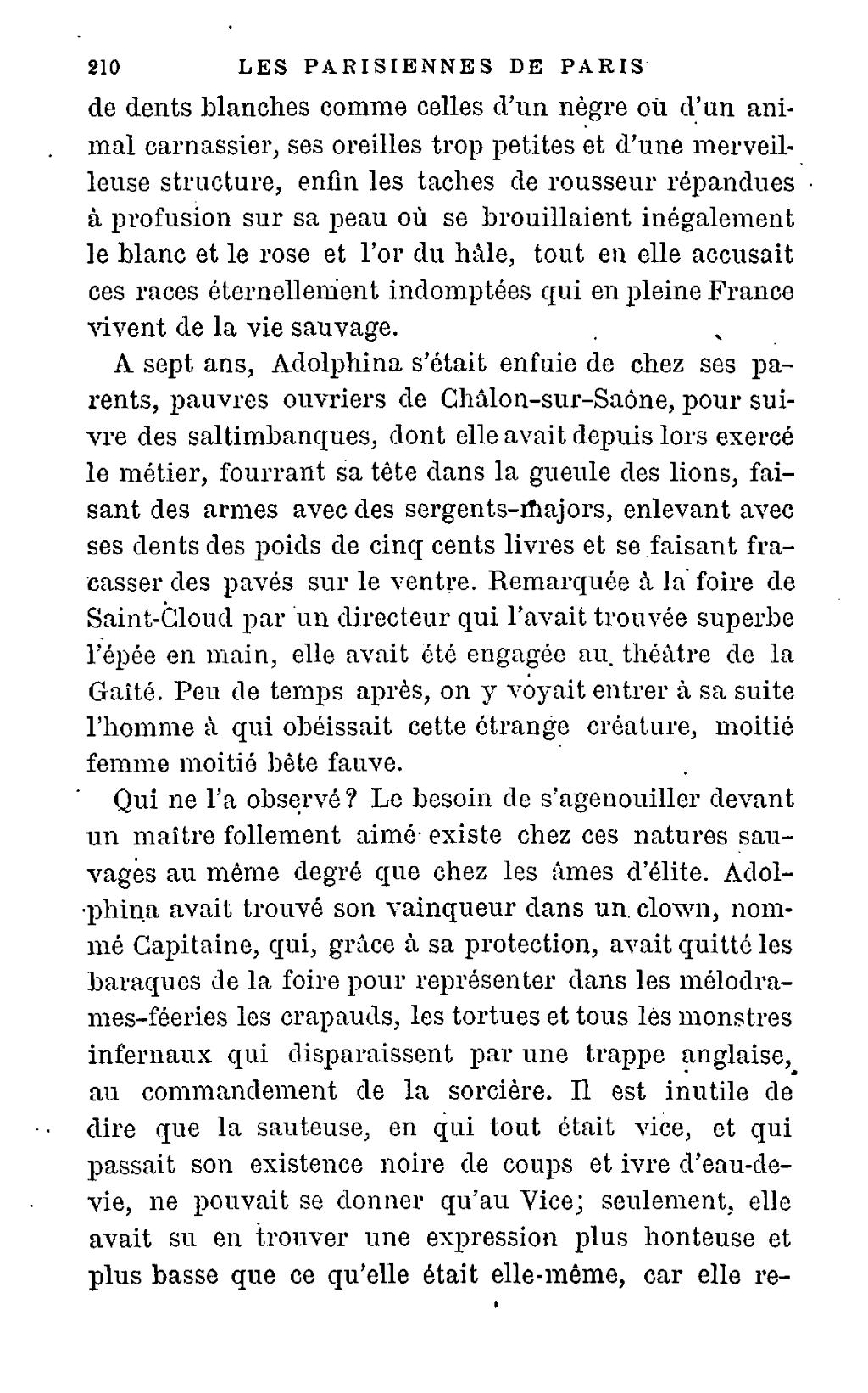de dents blanches comme celles d’un nègre ou d’un animal carnassier, ses oreilles trop petites et d’une merveilleuse structure, enfin les taches de rousseur répandues à profusion sur sa peau où se brouillaient inégalement le blanc et le rose et l’or du hâle, tout en elle accusait ces races éternellement indomptées qui en pleine France vivent de la vie sauvage.
À sept ans, Adolphina s’était enfuie de chez ses parents, pauvres ouvriers de Châlon-sur-Saône, pour suivre des saltimbanques, dont elle avait depuis lors exercé le métier, fourrant sa tête dans la gueule des lions, faisant des armes avec des sergents-majors, enlevant avec ses dents des poids de cinq cents livres et se faisant fracasser des pavés sur le ventre. Remarquée à la foire de Saint-Cloud par un directeur qui l’avait trouvée superbe l’épée en main, elle avait été engagée au théâtre de la Gaîté. Peu de temps après, on y voyait entrer à sa suite l’homme à qui obéissait cette étrange créature, moitié femme moitié bête fauve.
Qui ne l’a observé ? Le besoin de s’agenouiller devant un maître follement aimé existe chez ces natures sauvages au même degré que chez les âmes d’élite. Adolphina avait trouvé son vainqueur dans un clown, nommé Capitaine, qui, grâce à sa protection, avait quitté les baraques de la foire pour représenter dans les mélodrames-féeries les crapauds, les tortues et tous les monstres infernaux qui disparaissent par une trappe anglaise, au commandement de la sorcière. Il est inutile de dire que la sauteuse, en qui tout était vice, et qui passait son existence noire de coups et ivre d’eau-de-vie, ne pouvait se donner qu’au Vice ; seulement, elle avait su en trouver une expression plus honteuse et plus basse que ce qu’elle était elle-même, car elle re-