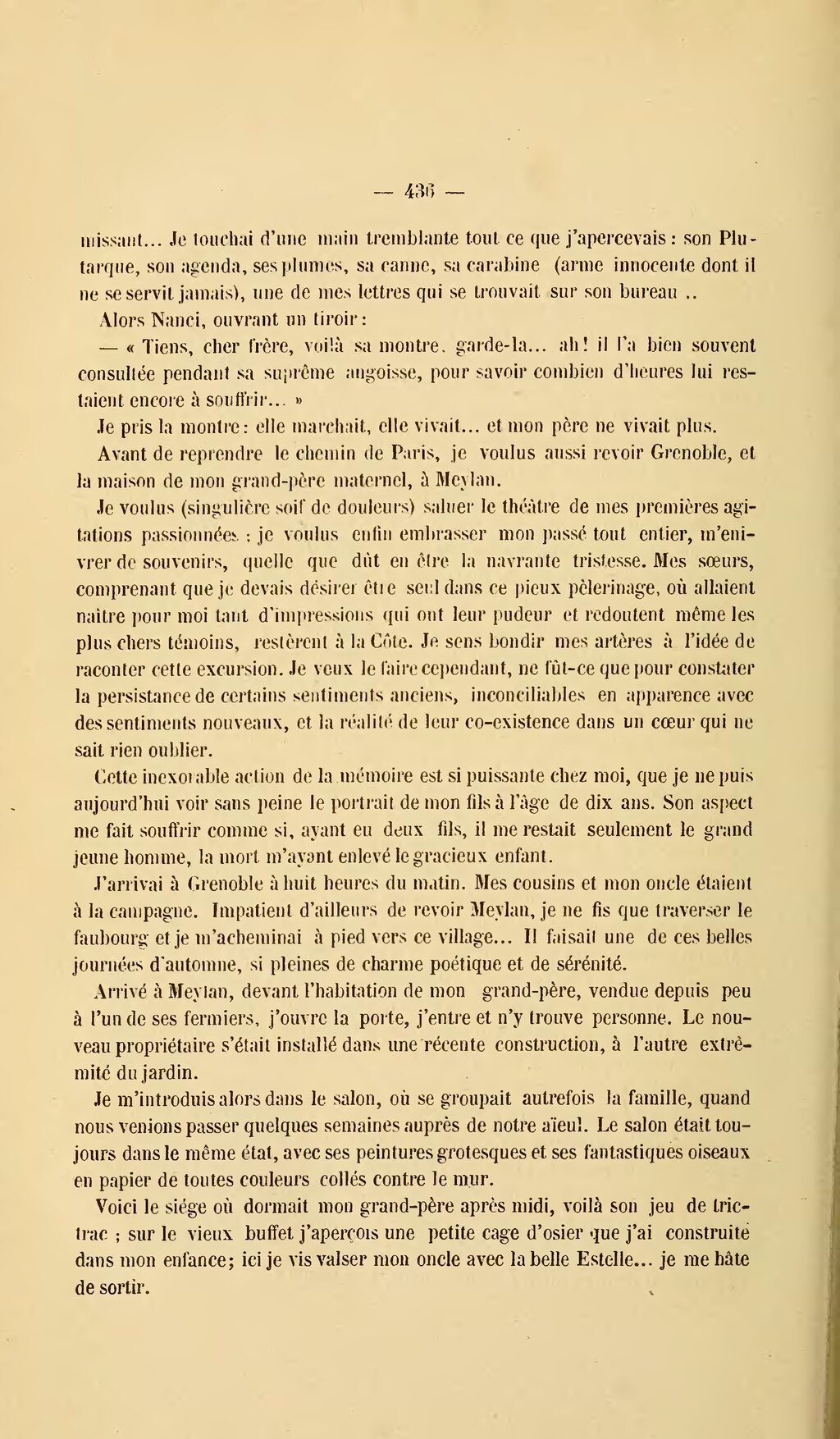Je touchai d’une main tremblante tout ce que j’apercevais : son Plutarque, son agenda, ses plumes, sa canne, sa carabine (arme innocente dont il ne se servit jamais), une de mes lettres qui se trouvait sur son bureau...
Alors Nanci, ouvrant un tiroir :
— «Tiens, cher frère, voilà sa montre, garde-la... ah ! il l’a bien souvent consultée pendant sa suprême angoisse, pour savoir combien d’heures lui restaient encore à souffrir...»
Je pris la montre : elle marchait, elle vivait... et mon père ne vivait plus.
Avant de reprendre le chemin de Paris, je voulus aussi revoir Grenoble, et la maison de mon grand-père maternel, à Meylan.
Je voulus (singulière soif de douleurs) saluer le théâtre de mes premières agitations passionnées ; je voulus enfin embrasser mon passé tout entier, m’enivrer de souvenirs, quelle que dût en être la navrante tristesse. Mes sœurs, comprenant que je devais désirer être seul dans ce pieux pèlerinage, où allaient naître pour moi tant d’impressions qui ont leur pudeur et redoutent même les plus chers témoins, restèrent à la Côte. Je sens bondir mes artères à l’idée de raconter cette excursion. Je veux le faire cependant, ne fût-ce que pour constater la persistance de certains sentiments anciens, inconciliables en apparence avec des sentiments nouveaux, et la réalité de leur coexistence dans un cœur qui ne sait rien oublier.
Cette inexorable action de la mémoire est si puissante chez moi, que je ne puis aujourd’hui voir sans peine le portrait de mon fils à l’âge de dix ans. Son aspect me fait souffrir comme si, ayant eu deux fils, il me restait seulement le grand jeune homme, la mort m’ayant enlevé le gracieux enfant.
J’arrivai à Grenoble à huit heures du matin. Mes cousins et mon oncle étaient à la campagne. Impatient d’ailleurs de revoir Meylan, je ne fis que traverser le faubourg et je m’acheminai à pied vers ce village... Il faisait une de ces belles journées d’automne, si pleines de charme poétique et de sérénité.
Arrivé à Meylan, devant l’habitation de mon grand-père, vendue depuis peu à l’un de ses fermiers, j’ouvre la porte, j’entre et n’y trouve personne. Le nouveau propriétaire s’était installé dans une récente construction, à l’autre extrémité du jardin.
Je m’introduis alors dans le salon, où se groupait autrefois la famille, quand nous venions passer quelques semaines auprès de notre aïeul. Le salon était toujours dans le même état, avec ses peintures grotesques et ses fantastiques oiseaux en papier de toutes couleurs collés contre le mur.
Voici le siège où dormait mon grand-père après midi, voilà son jeu de trictrac ; sur le vieux buffet j’aperçois une petite cage d’osier que j’ai construite dans mon enfance ; ici je vis valser mon oncle avec la belle Estelle... je me hâte de sortir.