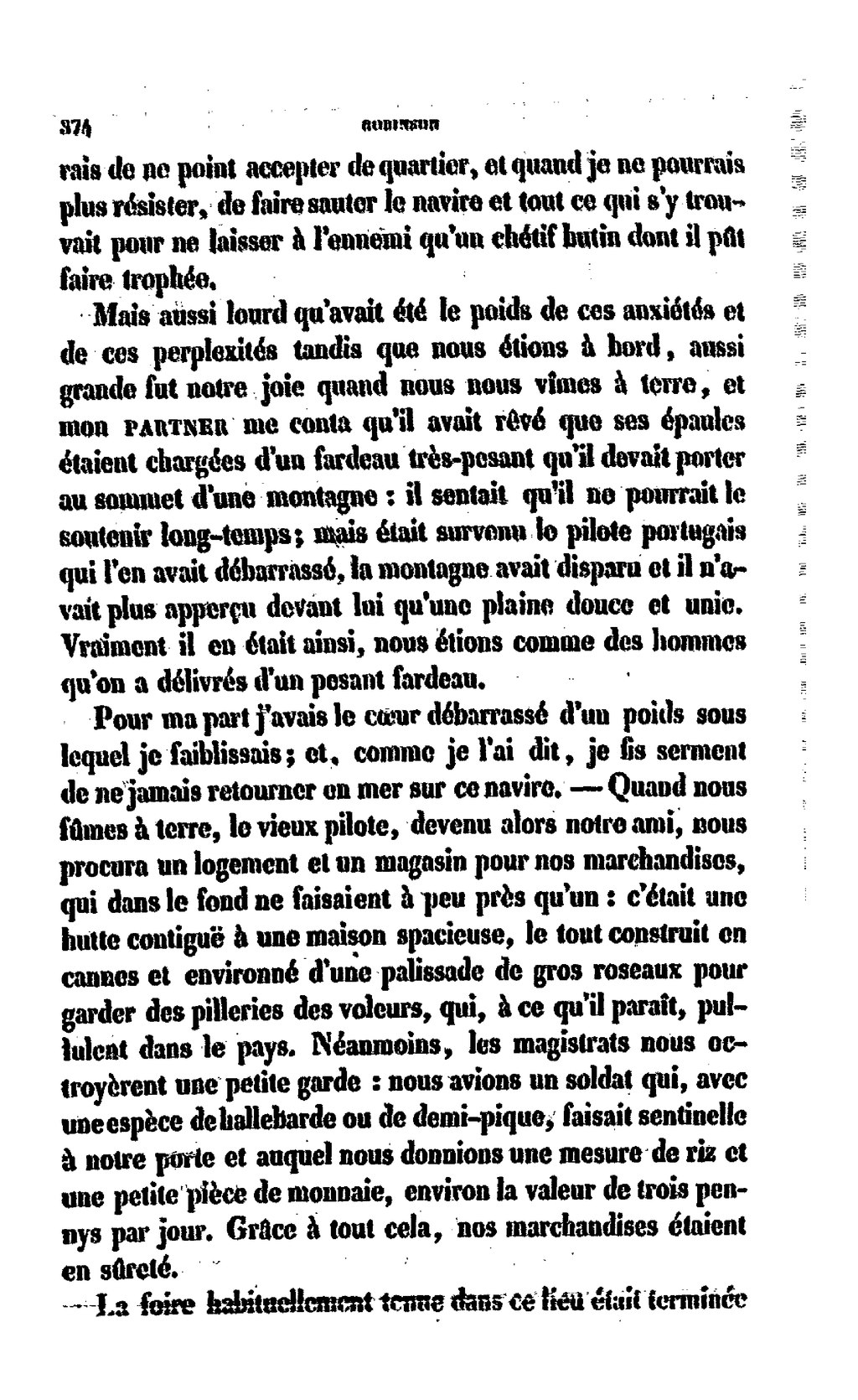rais de ne point accepter de quartier, et quand je ne pourrais plus résister, de faire sauter le navire et tout ce qui s’y trouvait pour ne laisser à l’ennemi qu’un chétif butin dont il pût faire trophée.
Mais aussi lourd qu’avait été le poids de ces anxiétés et de ces perplexités tandis que nous étions à bord, aussi grande fut notre joie quand nous nous vîmes à terre, et mon partner me conta qu’il avait rêvé que ses épaules étaient chargées d’un fardeau très-pesant qu’il devait porter au sommet d’une montagne : il sentait qu’il ne pourrait le soutenir long-temps ; mais était survenu le pilote portugais qui l’en avait débarrassé, la montagne avait disparu et il n’avait plus apperçu devant lui qu’une plaine douce et unie. Vraiment il en était ainsi, nous étions comme des hommes qu’on a délivrés d’un pesant fardeau.
Pour ma part j’avais le cœur débarrassé d’un poids sous lequel je faiblissais ; et, comme je l’ai dit, je fis serment de ne jamais retourner en mer sur ce navire. — Quand nous fûmes à terre, le vieux pilote, devenu alors notre ami, nous procura un logement et un magasin pour nos marchandises, qui dans le fond ne faisaient à peu près qu’un : c’était une hutte contiguë à une maison spacieuse, le tout construit en cannes et environné d’une palissade de gros roseaux pour garder des pilleries des voleurs, qui, à ce qu’il paraît, pullulent dans le pays. Néanmoins, les magistrats nous octroyèrent une petite garde : nous avions un soldat qui, avec une espèce de hallebarde ou de demi-pique, faisait sentinelle à notre porte et auquel nous donnions une mesure de riz et une petite pièce de monnaie, environ la valeur de trois pennys par jour. Grâce à tout cela, nos marchandises étaient en sûreté.
La foire habituellement tenue dans ce lieu était terminée