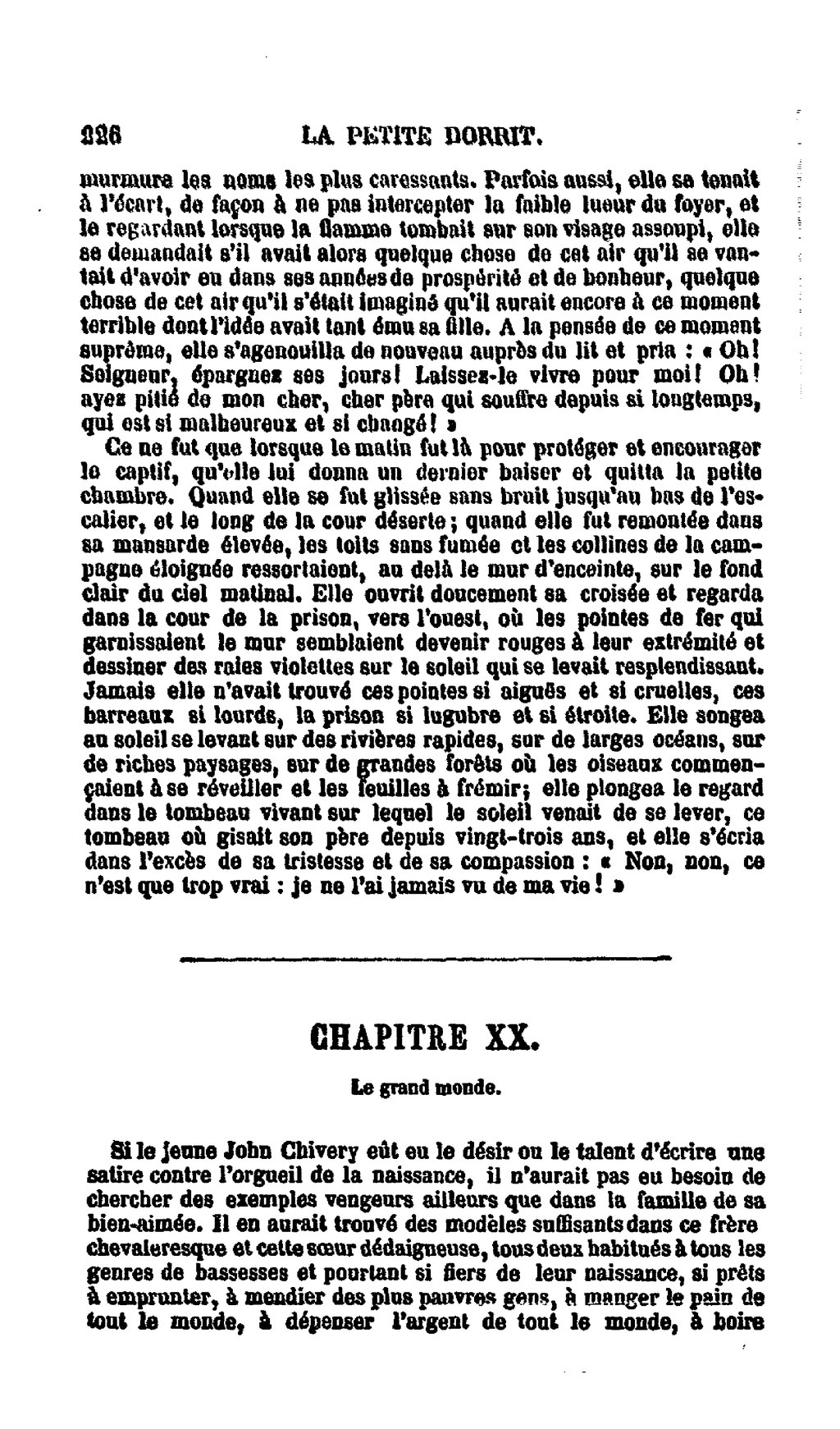murmure les noms les plus caressants. Parfois aussi, elle se tenait à l’écart, de façon à ne pas intercepter la faible lueur du foyer, et le regardant lorsque la flamme tombait sur son visage assoupi, elle se demandait s’il avait alors quelque chose de cet air qu’il se vantait d’avoir eu dans ses années de prospérité et de bonheur, quelque chose de cet air qu’il s’était imaginé qu’il aurait encore à ce moment terrible dont l’idée avait tant ému sa fille. À la pensée de ce moment suprême, elle s’agenouilla de nouveau auprès du lit et pria : « Oh Seigneur, épargnez ses jours ! Laissez-le vivre pour moi ! Oh ! ayez pitié de mon cher, cher père qui souffre depuis si longtemps, qui est si malheureux et si changé ! »
Ce ne fut que lorsque le matin fut là pour protéger et encourager le captif, qu’elle lui donna un dernier baiser et quitta la petite chambre. Quand elle se fut glissée sans bruit jusqu’au bas de l’escalier, et le long de la cour déserte ; quand elle fut remontée dans sa mansarde élevée, les toits sans fumée et les collines de la campagne éloignée ressortaient, au delà le mur d’enceinte, sur le fond clair du ciel matinal. Elle ouvrit doucement sa croisée et regarda dans la cour de la prison, vers l’ouest, où les pointes de fer qui garnissaient le mur semblaient devenir rouges à leur extrémité et dessiner des raies violettes sur le soleil qui se levait resplendissant. Jamais elle n’avait trouvé ces pointes si aiguës et si cruelles, ces barreaux si lourds, la prison si lugubre et si étroite. Elle songea au soleil se levant sur des rivières rapides, sur de larges océans, sur de riches paysages, sur de grandes forêts où les oiseaux commençaient à se réveiller et les feuilles à frémir ; elle plongea le regard dans le tombeau vivant sur lequel le soleil venait de se lever, ce tombeau où gisait son père depuis vingt-trois ans, et elle s’écria dans l’excès de sa tristesse et de sa compassion : « Non, non, ce n’est que trop vrai : je ne l’ai jamais vu de ma vie ! »
CHAPITRE XX.
Le grand monde.
Si le jeune John Chivery eût eu le désir ou le talent d’écrire une satire contre l’orgueil de la naissance, il n’aurait pas eu besoin de chercher des exemples vengeurs ailleurs que dans la famille de sa bien-aimée. Il en aurait trouvé des modèles suffisants dans ce frère chevaleresque et cette sœur dédaigneuse, tous deux habitués à tous les genres de bassesses et pourtant si fiers de leur naissance, si prêts à emprunter, à mendier des plus pauvres gens, à manger le pain de tout le monde, à dépenser l’argent de tout le monde, à boire