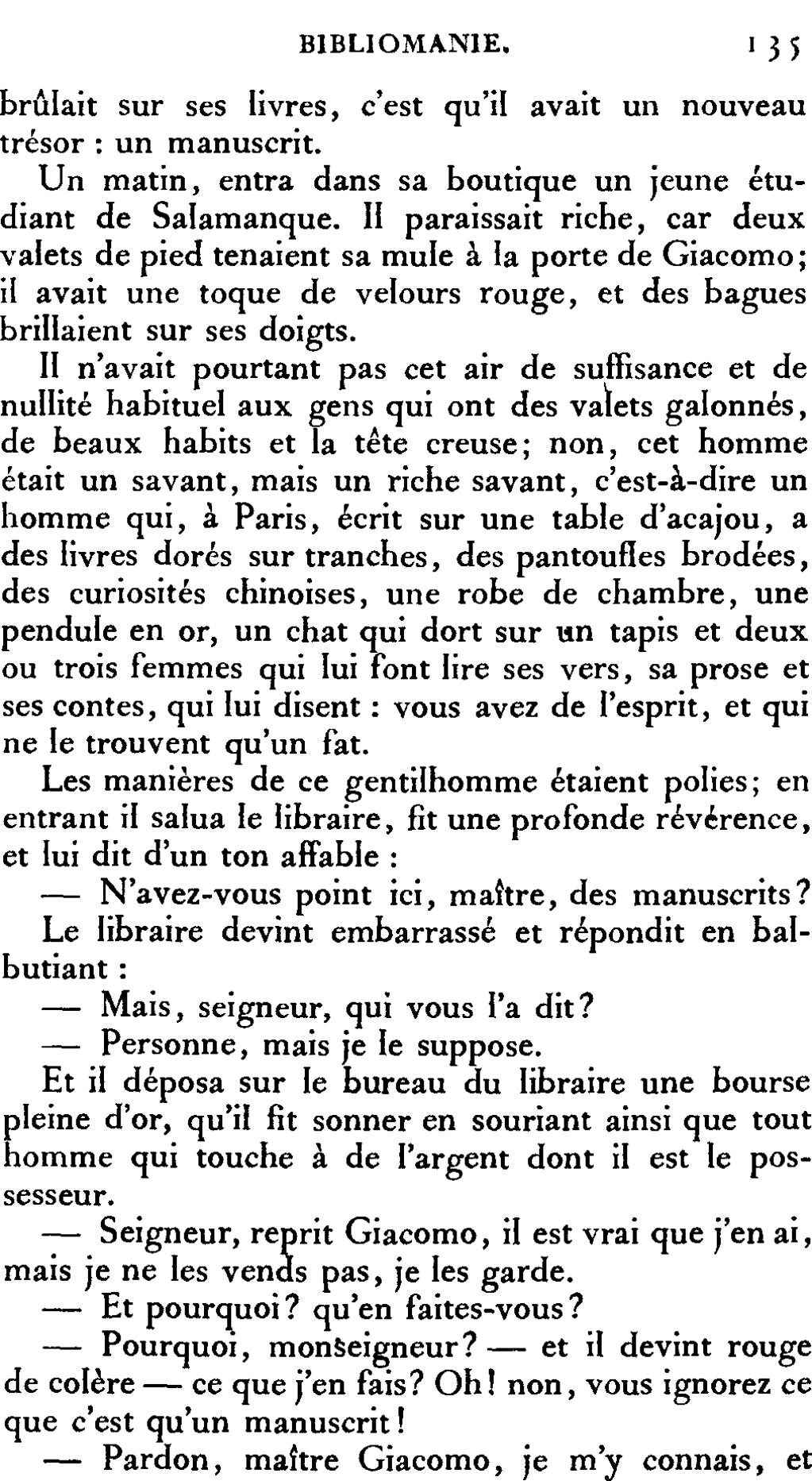brûlait sur ses livres, c’est qu’il avait un nouveau trésor : un manuscrit.
Un matin, entra dans sa boutique un jeune étudiant de Salamanque. Il paraissait riche, car deux valets de pied tenaient sa mule à la porte de Giacomo ; il avait une toque de velours rouge, et des bagues brillaient sur ses doigts.
Il n’avait pourtant pas cet air de suffisance et de nullité habituel aux gens qui ont des valets galonnés, de beaux habits et la tête creuse ; non, cet homme était un savant, mais un riche savant, c’est-à-dire un homme qui, à Paris, écrit sur une table d’acajou, a des livres dorés sur tranches, des pantoufles brodées, des curiosités chinoises, une robe de chambre, une pendule en or, un chat qui dort sur un tapis et deux ou trois femmes qui lui font lire ses vers, sa prose et ses contes, qui lui disent : vous avez de l’esprit, et qui ne le trouvent qu’un fat.
Les manières de ce gentilhomme étaient polies ; en entrant il salua le libraire, fit une profonde révérence, et lui dit d’un ton affable :
— N’avez-vous point ici, maître, des manuscrits ?
Le libraire devint embarrassé et répondit en balbutiant :
— Mais, seigneur, qui vous l’a dit ?
— Personne, mais je le suppose.
Et il déposa sur le bureau du libraire une bourse pleine d’or, qu’il fit sonner en souriant ainsi que tout homme qui touche à de l’argent dont il est le possesseur.
— Seigneur, reprit Giacomo, il est vrai que j’en ai, mais je ne les vends pas, je les garde.
— Et pourquoi ? qu’en faites-vous ?
— Pourquoi, monseigneur ? — et il devint rouge de colère — ce que j’en fais ? Oh ! non, vous ignorez ce que c’est qu’un manuscrit !
— Pardon, maître Giacomo, je m’y connais, et