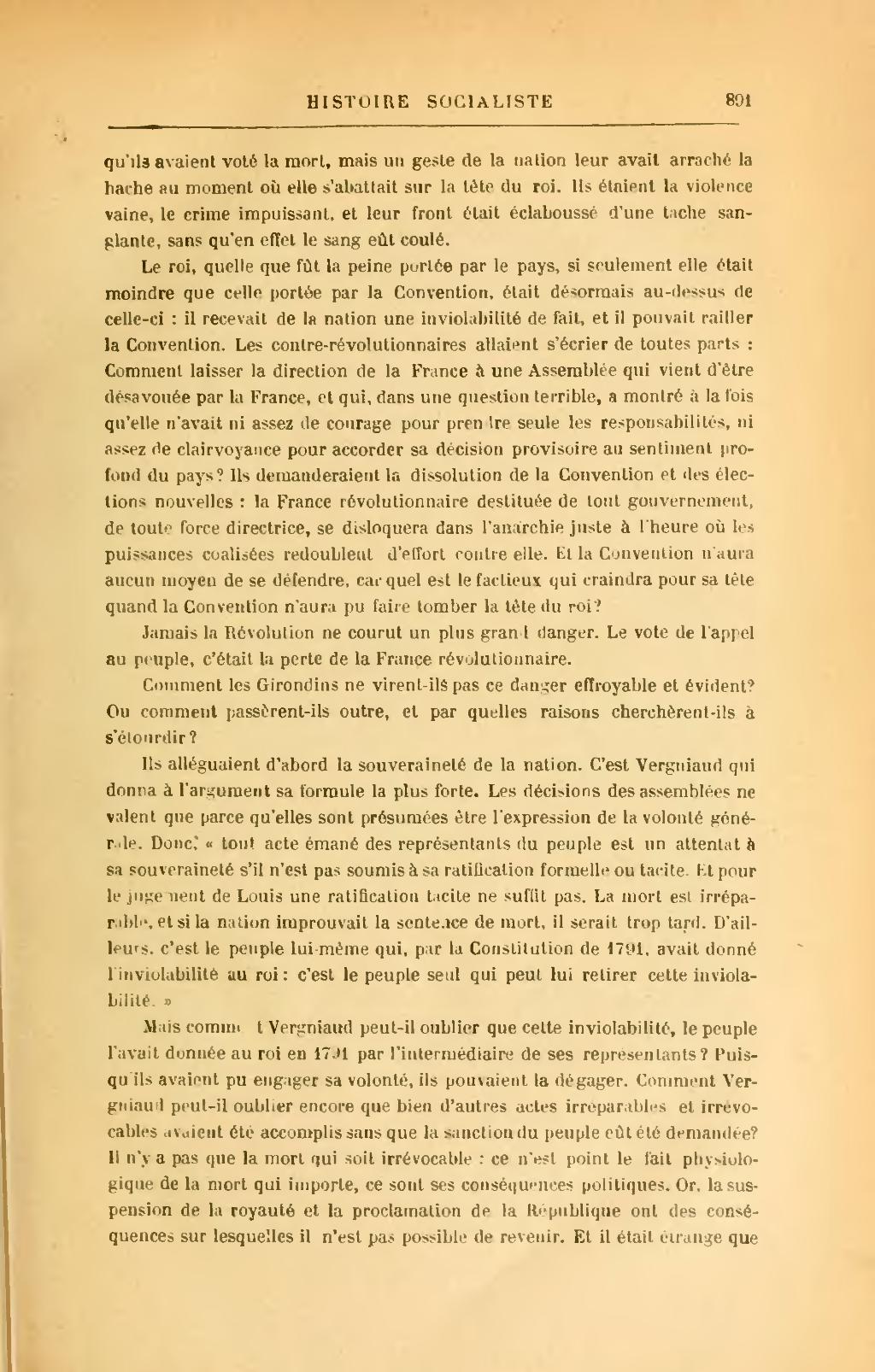avaient voté la mort, mais un geste de la nation leur avait arraché la hache au moment où elle s’abattait sur la tête du roi. Ils étaient la violence vaine, le crime impuissant, et leur front était éclaboussé d’une tache sanglante, sans qu’en effet le sang eût coulé.
Le roi, quelle que fût la peine portée par le pays, si seulement elle était moindre que celle portée par la Convention, était désormais au-dessus de celle-ci : il recevait de la nation une inviolabilité de fait, et il pouvait railler la Convention. Les contre-révolutionnaires allaient s’écrier de toutes parts : Comment laisser la direction de la France à une Assemblée qui vient d’être désavouée par la France, et qui, dans une question terrible, a montré à la fois qu’elle n’avait ni assez de courage pour prendre seule les responsabilités, ni assez de clairvoyance pour accorder sa décision provisoire au sentiment profond du pays ? Ils demanderaient la dissolution de la Convention et des élections nouvelles : la France révolutionnaire destituée de tout gouvernement, de toute force directrice, se disloquera dans l’anarchie juste à l’heure où les puissances coalisées redoublent d’effort contre elle. Et la Convention n’aura aucun moyen de se défendre, car quel est le factieux qui craindra pour sa tête quand la Convention n’aura pu faire tomber la tête du roi ?
Jamais la Révolution ne courut un plus grand danger. Le vote de l’appel au peuple, c’était la perte de la France révolutionnaire.
Comment les Girondins ne virent-ils pas ce danger effroyable et évident ? Ou comment passèrent-ils outre, et par quelles raisons cherchèrent-ils à s’étourdir ?
Ils alléguaient d’abord la souveraineté de la nation. C’est Vergniaud qui donna à l’argument sa formule la plus forte. Les décisions des assemblées ne valent que parce qu’elles sont présumées être l’expression de la volonté générale. Donc, « tout acte émané des représentants du peuple est un attentat à sa souveraineté s’il n’est pas soumis à sa ratification formelle ou tacite. Et pour le jugement de Louis une ratification tacite ne suffit pas. La mort est irréparable, et si la nation improuvait la sentence de mort, il serait trop tard. D’ailleurs, c’est le peuple lui-même qui, par la Constitution de 1791, avait donné l’inviolabilité au roi : c’est le peuple seul qui peut lui retirer cette inviolabilité. »
Mais comment Vergniaud peut-il oublier que cette inviolabilité, le peuple l’avait donnée au roi en 1791 par l’intermédiaire de ses représentants ? Puisqu’ils avaient pu engager sa volonté, ils pouvaient la dégager. Comment Vergniaud peut-il oublier encore que bien d’autres actes irréparables et irrévocables avaient été accomplis sans que la sanction du peuple eût été demandée ? Il n’y a pas que la mort qui soit irrévocable : ce n’est point le fait physiologique de la mort qui importe, ce sont ses conséquences politiques. Or, la suspension de la royauté et la proclamation de la République ont des conséquences sur lesquelles il n’est pas possible de revenir. Et il était étrange que