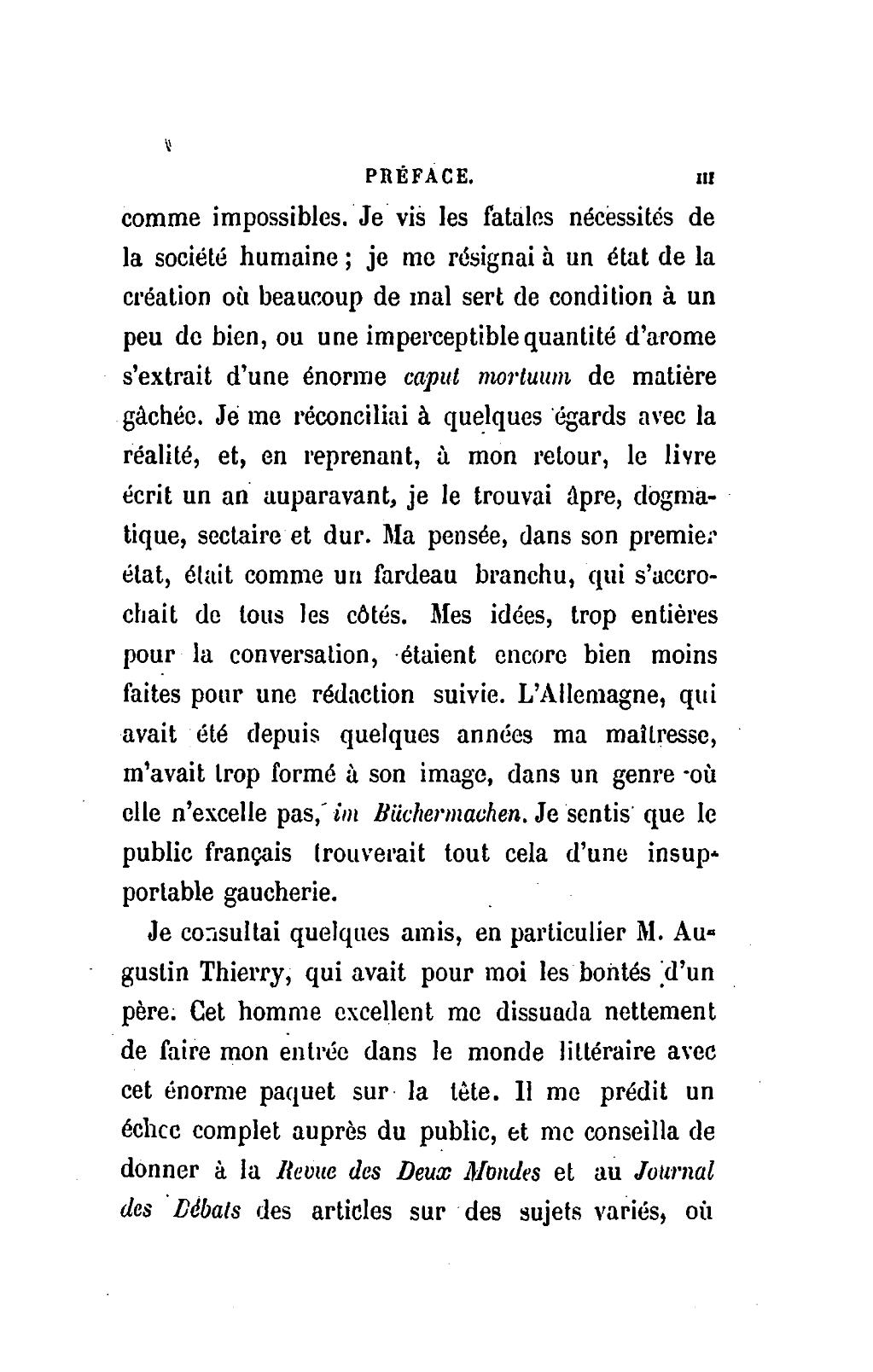comme impossibles. Je vis les fatales nécessités de la société humaine ; je me résignai à un état de la création où beaucoup de mal sert de condition à un peu de bien, ou une imperceptible quantité d’arôme s’extrait d’une énorme caput mortuum de matière gâchée. Je me réconciliai à quelques égards avec la réalité, et, en reprenant, à mon retour, le livre écrit un an auparavant, je le trouvai âpre, dogmatique, sectaire et dur. Ma pensée, dans son premier état, était comme un fardeau branchu, qui s’accrochait de tous les côtés. Mes idées, trop entières pour la conversation, étaient encore bien moins faites pour une rédaction suivie. L’Allemagne, qui avait été depuis quelques années ma maîtresse, m’avait trop formé à son image, dans un genre où elle n’excelle pas, im Büchermachen. Je sentis que le public français trouverait tout cela d’une insupportable gaucherie.
Je consultai quelques amis, en particulier M. Augustin Thierry, qui avait pour moi les bontés d’un père. Cet homme excellent me dissuada nettement de faire mon entrée dans le monde littéraire avec cet énorme paquet sur la tête. Il me prédit un échec complet auprès du public, et me conseilla de donner à la Revue des Deux Mondes et au Journal des Débats des articles sur des sujets variés, où