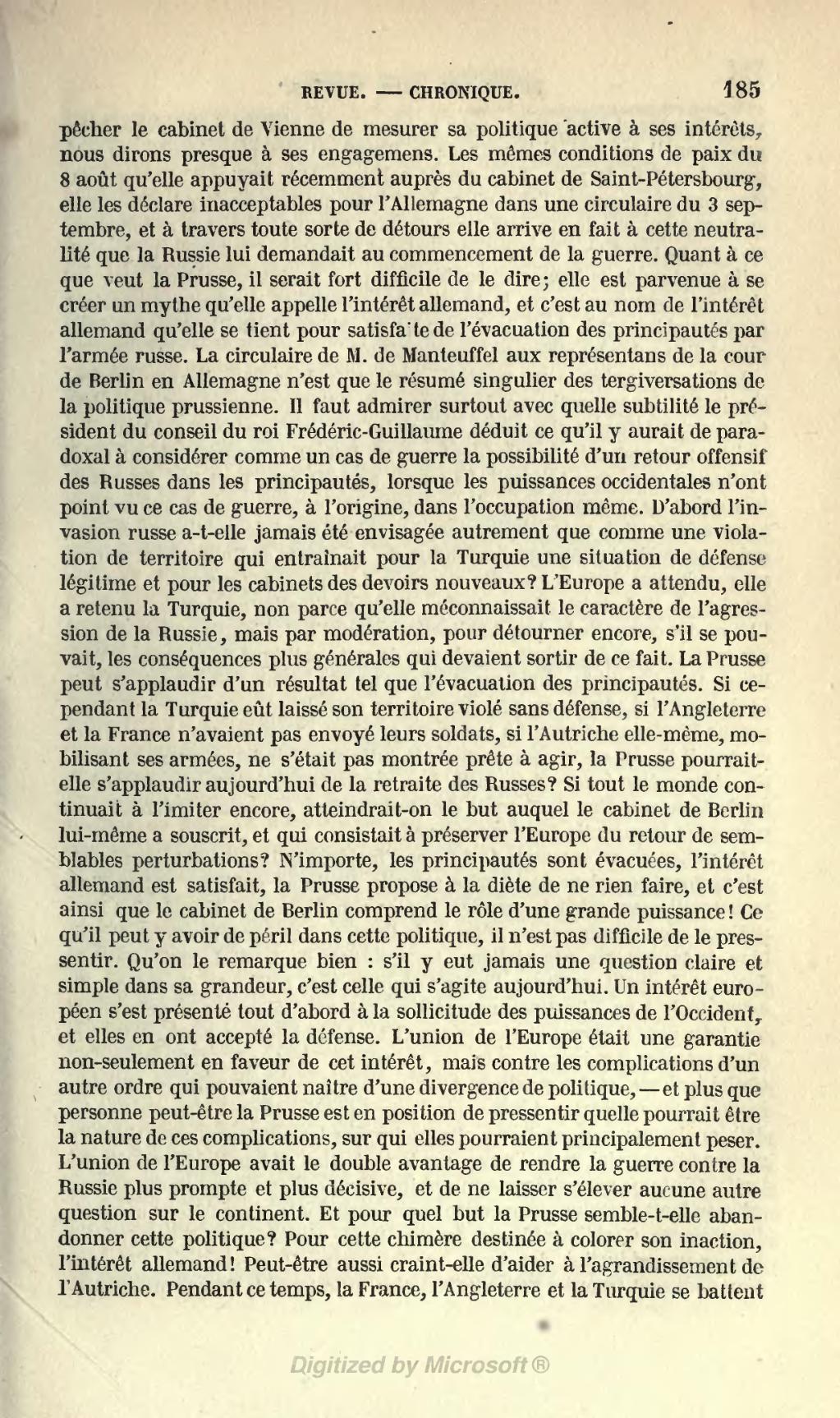em- le cabinet de Vienne de mesurer sa politique active à ses intérêts, nous dirons presque à ses engagemens. Les mêmes conditions de paix du 8 août qu’elle appuyait récemment auprès du cabinet de Saint-Pétersbourg, elle les déclare inacceptables pour l’Allemagne dans une circulaire du 3 septembre, et à travers toute sorte de détours elle arrive en fait à cette neutralité que la Russie lui demandait au commencement de la guerre. Quant à ce que veut la Prusse, il serait fort difficile de le dire ; elle est parvenue à se créer un mythe qu’elle appelle l’intérêt allemand, et c’est au nom de l’intérêt allemand qu’elle se tient pour satisfaite de l’évacuation des principautés par l’armée russe. La circulaire de M. de Manteuffel aux représentans de la cour de Berlin en Allemagne n’est que le résumé singulier des tergiversations de la politique prussienne. Il faut admirer surtout avec quelle subtilité le président du conseil du roi Frédéric-Guillaume déduit ce qu’il y aurait de paradoxal à considérer comme un cas de guerre la possibilité d’un retour offensif des Russes dans les principautés, lorsque les puissances occidentales n’ont point vu ce cas de guerre, à l’origine, dans l’occupation même. D’abord l’invasion russe a-t-elle jamais été envisagée autrement que comme une violation de territoire qui entraînait pour la Turquie une situation de défense légitime et pour les cabinets des devoirs nouveaux ? L’Europe a attendu, elle a retenu la Turquie, non parce qu’elle méconnaissait le caractère de l’agression de la Russie, mais par modération, pour détourner encore, s’il se pouvait, les conséquences plus générales qui devaient sortir de ce fait. La Prusse peut s’applaudir d’un résultat tel que l’évacuation des principautés. Si cependant la Turquie eût laissé son territoire violé sans défense, si l’Angleterre et la France n’avaient pas envoyé leurs soldats, si l’Autriche elle-même, mobilisant ses armées, ne s’était pas montrée prête à agir, la Prusse pourrait-elle s’applaudir aujourd’hui de la retraite des Russes ? Si tout le monde continuait à l’imiter encore, atteindrait-on le but auquel le cabinet de Berlin lui-même a souscrit, et qui consistait à préserver l’Europe du retour de semblables perturbations ? N’importe, les principautés sont évacuées, l’intérêt allemand est satisfait, la Prusse propose à la diète de ne rien faire, et c’est ainsi que le cabinet de Berlin comprend le rôle d’une grande puissance ! Ce qu’il peut y avoir de péril dans cette politique, il n’est pas difficile de le pressentir. Qu’on le remarque bien : s’il y eut jamais une question claire et simple dans sa grandeur, c’est celle qui s’agite aujourd’hui. Un intérêt européen s’est présenté tout d’abord à la sollicitude des puissances de l’Occident, et elles en ont accepté la défense. L’union de l’Europe était une garantie non-seulement en faveur de cet intérêt, mais contre les complications d’un autre ordre qui pouvaient naître d’une divergence de politique, — et plus que personne peut-être la Prusse est en position de pressentir quelle pourrait être la nature de ces complications, sur qui elles pourraient principalement peser. L’union de l’Europe avait le double avantage de rendre la guerre contre la Russie plus prompte et plus décisive, et de ne laisser s’élever aucune autre question sur le continent. Et pour quel but la Prusse semble-t-elle abandonner cette politique ? Pour cette chimère destinée à colorer son inaction, l’intérêt allemand ! Peut-être aussi craint-elle d’aider à l’agrandissement de l’Autriche. Pendant ce temps, la France, l’Angleterre et la Turquie se battent