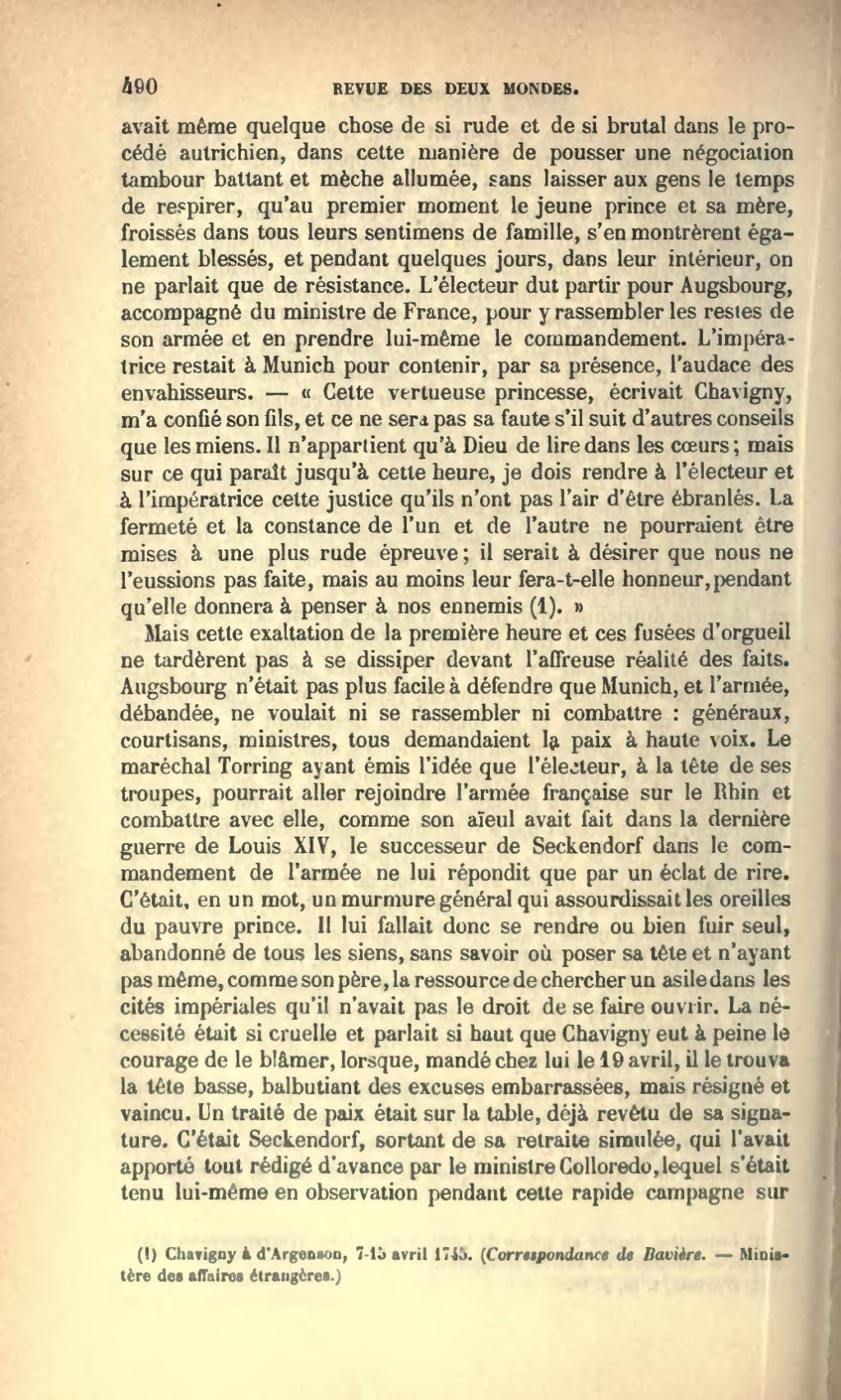avait même quelque chose de si rude et de si brutal dans le procédé autrichien, dans cette manière de pousser une négociation tambour battant et mèche allumée, sans laisser aux gens le temps de respirer, qu’au premier moment le jeune prince et sa mère, froissés dans tous leurs sentimens de famille, s’en montrèrent également blessés, et pendant quelques jours, dans leur intérieur, on ne parlait que de résistance. L’électeur dut partir pour Augsbourg, accompagné du ministre de France, pour y rassembler les restes de son armée et en prendre lui-même le commandement. L’impératrice restait à Munich pour contenir, par sa présence, l’audace des envahisseurs. — « Cette vertueuse princesse, écrivait Chavigny, m’a confié son fils, et ce ne sera pas sa faute s’il suit d’autres conseils que les miens. Il n’appartient qu’à Dieu de lire dans les cœurs ; mais sur ce qui parait jusqu’à cette heure, je dois rendre à l’électeur et à l’impératrice cette justice qu’ils n’ont pas l’air d’être ébranlés. La fermeté et la constance de l’un et de l’autre ne pourraient être mises à une plus rude épreuve ; il serait à désirer que nous ne l’eussions pas faite, mais au moins leur fera-t-elle honneur, pendant qu’elle donnera à penser à nos ennemis[1]. »
Mais cette exaltation de la première heure et ces fusées d’orgueil ne tardèrent pas à se dissiper devant l’affreuse réalité des faits. Augsbourg n’était pas plus facile à défendre que Munich, et l’armée, débandée, ne voulait ni se rassembler ni combattre : généraux, courtisans, ministres, tous demandaient la paix à haute voix. Le maréchal Torring ayant émis l’idée que l’électeur, à la tête de ses troupes, pourrait aller rejoindre l’armée française sur le Rhin et combattre avec elle, comme son aïeul avait fait dans la dernière guerre de Louis XIV, le successeur de Seckendorf dans le commandement de l’armée ne lui répondit que par un éclat de rire. C’était, en un mot, un murmure général qui assourdissait les oreilles du pauvre prince. Il lui fallait donc se rendre ou bien fuir seul, abandonné de tous les siens, sans savoir où poser sa tête et n’ayant pas même, comme son père, la ressource de chercher un asile dans les cités impériales qu’il n’avait pas le droit de se faire ouvrir. La nécessité était si cruelle et parlait si haut que Chavigny eut à peine le courage de le blâmer, lorsque, mandé chez lui le 19 avril, il le trouva la tête basse, balbutiant des excuses embarrassées, mais résigné et vaincu. Un traité de paix était sur la table, déjà revêtu de sa signature. C’était Seckendorf, sortant de sa retraite simulée, qui l’avait apporté tout rédigé d’avance par le ministre Colloredo, lequel s’était tenu lui-même en observation pendant cette rapide campagne sur
- ↑ Chavigny à d’Argenson, 7-15 avril 1745. (Correspondance de Bavière. — Ministère des affaires étrangères.)