Trois Contes (Flaubert)/Texte entier
de
GUSTAVE FLAUBERT
LA LÉGENDE DE SAINT JULIEN L’HOSPITALIER
HÉRODIAS

UN CŒUR SIMPLE.
I
endant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l’Évêque envièrent à Mme Aubain sa servante Félicité.
Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, — qui cependant n’était pas une personne agréable.
Elle avait épousé un beau garçon sans fortune, mort au commencement de 1809, en lui laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes. Alors, elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Toucques et la ferme de Geffosses, dont les rentes montaient à 5,000 francs tout au plus, et elle quitta sa maison de Saint-Melaine pour en habiter une autre moins dispendieuse, ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles.
Cette maison, revêtue d’ardoises, se trouvait entre un passage et une ruelle aboutissant à la rivière. Elle avait intérieurement des différences de niveau qui faisaient trébucher. Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où Mme Aubain se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un fauteuil de paille. Contre le lambris, peint en blanc, s’alignaient huit chaises d’acajou. Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons. Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en marbre jaune et de style Louis XV. La pendule, au milieu, représentait un temple de Vesta, — et tout l’appartement sentait un peu le moisi, car le plancher était plus bas que le jardin.
Au premier étage, il y avait d’abord la chambre de « Madame », très grande, tendue d’un papier à fleurs pâles, et contenant le portrait de « Monsieur » en costume de muscadin. Elle communiquait avec une chambre plus petite, où l’on voyait deux couchettes d’enfants, sans matelas. Puis venait le salon, toujours fermé, et rempli de meubles recouverts d’un drap. Ensuite un corridor menait à un cabinet d’étude ; des livres et des paperasses garnissaient les rayons d’une bibliothèque entourant de ses trois côtés un large bureau de bois noir. Les deux panneaux en retour disparaissaient sous des dessins à la plume, des paysages à la gouache et des gravures d’Audran, souvenirs d’un temps meilleur et d’un luxe évanoui. Une lucarne, au second étage, éclairait la chambre de Félicité, ayant vue sur les prairies.
Elle se levait dès l’aube, pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu’au soir sans interruption ; puis le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s’endormait devant l’âtre, son rosaire à la main. Personne, dans les marchandages, ne montrait plus d’entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur, et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain, — un pain de douze livres, cuit exprès pour elle, et qui durait vingt jours.
En toute saison elle portait un mouchoir d’indienne fixé dans le dos par une épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-dessus sa camisole un tablier à bavette, comme les infirmières d’hôpital.
Son visage était maigre et sa voix aiguë. À vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante ; dès la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge ; — et, toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés, semblait une femme en bois, fonctionnant d’une manière automatique.
II
lle avait eu, comme une autre, son histoire d’amour.
Son père, un maçon, s’était tué en tombant d’un échafaudage. Puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit, et l’employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l’eau des mares, à propos de rien était battue, et finalement fut chassée pour un vol de trente sols, qu’elle n’avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour, et, comme elle plaisait aux patrons, ses camarades la jalousaient.
Un soir du mois d’août (elle avait alors dix-huit ans), ils l’entraînèrent à l’assemblée de Colleville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d’or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l’écart modestement, quand un jeune homme d’apparence cossue et qui fumait sa pipe les deux coudes sur le timon d’un banneau, vint l’inviter à la danse. Il lui paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et, s’imaginant qu’elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d’un champ d’avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s’éloigna.
Un autre soir, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foin qui avançait lentement, et en frôlant les roues elle reconnut Théodore.
Il l’aborda d’un air tranquille, disant qu’il fallait tout pardonner, puisque c’était « la faute de la boisson ».
Elle ne sut que répondre et avait envie de s’enfuir.
Aussitôt il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père avait abandonné Colleville pour la ferme des Écots, de sorte que maintenant ils se trouvaient voisins.
— Ah ! dit-elle.
Il ajouta qu’on désirait l’établir. Du reste il n’était pas pressé, et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle reprit, en souriant, que c’était mal de se moquer.
— Mais non, je vous jure !
Et du bras gauche il lui entoura la taille. Elle marchait soutenue par son étreinte ; ils se ralentirent. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l’énorme charretée de foin oscillait devant eux ; et les quatre chevaux, en traînant leurs pas, soulevaient de la poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l’embrassa encore une fois. Elle disparut dans l’ombre.
Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous.
Ils se rencontraient au fond des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé. Elle n’était pas innocente à la manière des demoiselles, — les animaux l’avaient instruite ; — mais la raison et l’instinct de l’honneur l’empêchèrent de faillir. Cette résistance exaspéra l’amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire (ou naïvement peut-être) il proposa de l’épouser. Elle hésitait à le croire. Il fit de grands serments.
Bientôt il avoua quelque chose de fâcheux : ses parents, l’année dernière, lui avaient acheté un homme ; mais d’un jour à l’autre on pouvait le reprendre ; l’idée de servir l’effrayait. Cette couardise fut pour Félicité une preuve de tendresse ; la sienne en redoubla. Elle s’échappait la nuit, et parvenue au rendez-vous, Théodore la torturait avec ses inquiétudes et ses instances.
Enfin, il annonça qu’il irait lui-même à la Préfecture prendre des informations, et les apporterait dimanche prochain, entre onze heures et minuit.
Le moment arrivé, elle courut vers l’amoureux.
À sa place, elle trouva un de ses amis.
Il lui apprit qu’elle ne devait plus le revoir. Pour se garantir de la conscription, Théodore avait épousé une vieille femme très riche, Mme Lehoussais, de Toucques.
Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu et gémit toute seule dans la campagne jusqu’au soleil levant. Puis, elle revint à la ferme, déclara son intention d’en partir ; et, au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir, et se rendit à Pont-l’Évêque.
Devant l’auberge, elle questionna une bourgeoise en capeline de veuve, et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d’exigences que Madame Aubain finit par dire :
— Soit, je vous accepte !
Félicité, un quart d’heure après, était installée chez elle.
D’abord, elle y vécut dans une sorte de tremblement, que lui causaient « le genre de la maison » et le souvenir de « Monsieur », planant sur tout ! Paul et Virginie, l’un âgé de sept ans, l’autre de quatre à peine, lui semblaient formés d’une matière précieuse ; elle les portait sur son dos comme un cheval ; et Mme Aubain lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant elle se trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse.
Tous les jeudis, des habitués venaient faire une partie de boston. Félicité préparait d’avance les cartes et les chaufferettes. Ils arrivaient à huit heures bien juste, et se retiraient avant le coup de onze.
Chaque lundi matin, le brocanteur qui logeait sous l’allée étalait par terre ses ferrailles. Puis la ville se remplissait d’un bourdonnement de voix, où se mêlaient des hennissements de chevaux, des bêlements d’agneaux, des grognements de cochon, avec le bruit sec des carrioles dans la rue. Vers midi, au plus fort du marché, on voyait paraître sur le seuil un vieux paysan de haute taille, la casquette en arrière, le nez crochu, et qui était Robelin, le fermier de Geffosses. Peu de temps après, — c’était Liébard, le fermier de Toucques, petit, rouge, obèse, portant une veste grise et des houseaux armés d’éperons.
Tous les deux offraient à leur propriétaire des poules ou des fromages. Félicité invariablement déjouait leurs astuces ; et ils s’en allaient pleins de considération pour elle.
À des époques indéterminées, Mme Aubain recevait la visite du marquis de Gremanville, un de ses oncles, ruiné par la crapule et qui vivait à Falaise sur le dernier lopin de ses terres. Il se présentait toujours à l’heure du déjeuner, avec un affreux caniche dont les pattes salissaient tous les meubles. Malgré ses efforts pour paraître gentilhomme jusqu’à soulever son chapeau chaque fois qu’il disait : « Feu mon père », l’habitude l’entraînant, il se versait à boire coup sur coup, et lâchait des gaillardises. Félicité le poussait dehors poliment :
— Vous en avez assez, M. de Gremanville ! À une autre fois !
Et elle refermait la porte.
Elle l’ouvrait avec plaisir devant M. Bourais, ancien avoué. Sa cravate blanche et sa calvitie, le jabot de sa chemise, son ample redingote brune, sa façon de priser en arrondissant le bras, tout son individu lui produisait ce trouble où nous jette le spectacle des hommes extraordinaires.
Comme il gérait les propriétés de « Madame », il s’enfermait avec elle pendant des heures dans le cabinet de « Monsieur », et craignait toujours de se compromettre, respectait infiniment la magistrature, avait des prétentions au latin.
Pour instruire les enfants d’une manière agréable, il leur fit cadeau d’une géographie en estampes. Elles représentaient différentes scènes du monde, des anthropophages coiffés de plumes, un singe enlevant une demoiselle, des Bédouins dans le désert, une baleine qu’on harponnait, etc.
Paul donna l’explication de ces gravures à Félicité. Ce fut même toute son éducation littéraire.
Celle des enfants était faite par Guyot, un pauvre diable employé à la Mairie, fameux pour sa belle main, et qui repassait son canif sur sa botte.
Quand le temps était clair, on s’en allait de bonne heure à la ferme de Geffosses.
La cour est en pente, la maison dans le milieu ; et la mer, au loin, apparaît comme une tache grise.
Félicité retirait de son cabas des tranches de viande froide, et on déjeunait dans un appartement faisant suite à la laiterie. Il était le seul reste d’une habitation de plaisance maintenant disparue. Le papier de la muraille, en lambeaux, tremblait aux courants d’air. Mme Aubain penchait son front, accablée de souvenirs ; les enfants n’osaient plus parler.
— Mais jouez donc ! disait-elle.
Ils décampaient.
Paul montait dans la grange, attrapait des oiseaux, faisait des ricochets sur la mare, ou tapait avec un bâton les grosses futailles qui résonnaient comme des tambours.
Virginie donnait à manger aux lapins, se précipitait pour cueillir des bluets, et la rapidité de ses jambes découvrait ses petits pantalons brodés.
Un soir d’automne, on s’en retourna par les herbages.
La lune à son premier quartier éclairait une partie du ciel, et un brouillard flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la Toucques. Des bœufs, étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces quatre personnes passer. Dans la troisième pâture, quelques-uns se levèrent, puis se mirent en rond devant elles. — « Ne craignez rien ! » dit Félicité ; et, murmurant une sorte de complainte, elle flatta sur l’échine, celui qui se trouvait le plus près ; il fit volte-face, les autres l’imitèrent. Mais quand l’herbage suivant fut traversé, un beuglement formidable s’éleva. C’était un taureau que cachait le brouillard. Il avança vers les deux femmes. Mme Aubain allait courir.
— Non ! non ! moins vite !
Elles pressaient le pas cependant, et entendaient par-derrière un souffle sonore qui se rapprochait. Ses sabots, comme des marteaux, battaient l’herbe de la prairie ; voilà qu’il galopait maintenant ! Félicité se retourna et elle arrachait à deux mains des plaques de terre qu’elle lui jetait dans les yeux. Il baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant horriblement. Mme Aubain, au bout de l’herbage avec ses deux petits, cherchait éperdue comment franchir le haut-bord. Félicité reculait toujours devant le taureau, et continuellement lançait des mottes de gazon qui l’aveuglaient, tandis qu’elle criait :
— Dépêchez-vous ! dépêchez-vous !
Mme Aubain descendit le fossé, poussa Virginie, Paul ensuite, tomba plusieurs fois en tâchant de gravir le talus, et à force de courage y parvint.
Le taureau avait acculé Félicité contre une claire-voie ; sa bave lui rejaillissait à la figure, une seconde de plus il l’éventrait. Elle eut le temps de se couler entre deux barreaux, et la grosse bête, toute surprise, s’arrêta.
Cet événement, pendant bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l’Évêque. Félicité n’en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu’elle eût rien fait d’héroïque.
Virginie l’occupait exclusivement ; — car elle eut, à la suite de son effroi, une affection nerveuse, et M. Poupart, le docteur, conseilla les bains de mer de Trouville.
Dans ce temps-là, ils n’étaient pas fréquentés. Mme Aubain prit des renseignements, consulta Bourais, fit des préparatifs, comme pour un long voyage.
Ses colis partirent la veille, dans la charrette de Liébard. Le lendemain, il amena deux chevaux dont l’un avait une selle de femme, munie d’un dossier de velours ; et sur la croupe du second un manteau roulé formait une manière de siège. Mme Aubain y monta, derrière lui. Félicité se chargea de Virginie, et Paul enfourcha l’âne de M. Lechaptois, prêté sous la condition d’en avoir grand soin.
La route était si mauvaise que ses huit kilomètres exigèrent deux heures. Les chevaux enfonçaient jusqu’aux paturons dans la boue, et faisaient pour en sortir de brusques mouvements des hanches ; ou bien ils butaient contre les ornières ; d’autres fois, il leur fallait sauter. La jument de Liébard, à de certains endroits, s’arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu’elle se remît en marche ; et il parlait des personnes dont les propriétés bordaient la route, ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ainsi, au milieu de Toucques, comme on passait sous des fenêtres entourées de capucines, il dit, avec un haussement d’épaules :
— En voilà une Mme Lehoussais, qui au lieu de prendre un jeune homme…
Félicité n’entendit pas le reste ; les chevaux trottaient, l’âne galopait ; tous enfilèrent un sentier, une barrière tourna, deux garçons parurent, et l’on descendit devant le purin, sur le seuil même de la porte.
La mère Liébard, en apercevant sa maîtresse, prodigua les démonstrations de joie. Elle lui servit un déjeuner, où il y avait un aloyau, des tripes, du boudin, une fricassée de poulet, du cidre mousseux, une tarte aux compotes et des prunes à l’eau-de-vie, accompagnant le tout de politesses à Madame qui paraissait en meilleure santé, à Mademoiselle devenue « magnifique », à M. Paul singulièrement « forci », sans oublier leurs grands-parents défunts, que les Liébard avaient connus, étant au service de la famille depuis plusieurs générations. La ferme avait, comme eux, un caractère d’ancienneté. Les poutrelles du plafond étaient vermoulues, les murailles noires de fumée, les carreaux gris de poussière. Un dressoir en chêne supportait toutes sortes d’ustensiles, des brocs, des assiettes, des écuelles d’étain, des pièges à loup, des forces pour les moutons ; une seringue énorme fit rire les enfants. Pas un arbre des trois cours qui n’eût des champignons à sa base, ou dans ses rameaux une touffe de gui. Le vent en avait jeté bas plusieurs. Ils avaient repris par le milieu ; et tous fléchissaient sous la quantité de leurs pommes. Les toits de paille, pareils à du velours brun et inégaux d’épaisseur, résistaient aux plus fortes bourrasques. Cependant la charreterie tombait en ruine. Mme Aubain dit qu’elle aviserait et commanda de reharnacher les bêtes.
On fut encore une demi-heure avant d’atteindre Trouville. La petite caravane mit pied à terre pour passer les Écores ; c’était une falaise surplombant des bateaux ; et trois minutes plus tard, au bout du quai, on entra dans la cour de l’Agneau d’or, chez la mère David.
Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du changement d’air et de l’action des bains. Elle les prenait en chemise, à défaut d’un costume ; et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douanier qui servait aux baigneurs.
L’après-midi, on s’en allait avec l’âne au-delà des Roches-Noires, du côté d’Hennequeville. Le sentier, d’abord, montait entre des terrains vallonnés comme la pelouse d’un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des pâturages et des champs en labour. À la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des houx se dressaient ; çà et là, un grand arbre mort faisait sur l’air bleu des zigzags avec ses branches.
Presque toujours on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, le Havre à droite et en face la pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme un miroir, tellement douce qu’on entendait à peine son murmure ; des moineaux cachés pépiaient, et la voûte immense du ciel recouvrait tout cela. Mme Aubain, assise, travaillait à son ouvrage de couture ; Virginie près d’elle tressait des joncs ; Félicité sarclait des fleurs de lavande ; Paul, qui s’ennuyait, voulait partir.
D’autres fois, ayant passé la Toucques en bateau, ils cherchaient des coquilles. La marée basse laissait à découvert des oursins, des godefiches, des méduses ; et les enfants couraient, pour saisir des flocons d’écume que le vent emportait. Les flots endormis, en tombant sur le sable, se déroulaient le long de la grève ; elle s’étendait à perte de vue, mais du côté de la terre avait pour limite les dunes la séparant du Marais, large prairie en forme d’hippodrome. Quand ils revenaient par là, Trouville, au fond sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait, et avec toutes ses maisons inégales semblait s’épanouir dans un désordre gai.
Les jours qu’il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre. L’éblouissante clarté du dehors plaquait des barres de lumière entre les lames des jalousies. Aucun bruit dans le village. En bas, sur le trottoir, personne. Ce silence épandu augmentait la tranquillité des choses. Au loin, les marteaux des calfats tamponnaient des carènes, et une brise lourde apportait la senteur du goudron.
Le principal divertissement était le retour des barques. Dès qu’elles avaient franchi les balises, elles commençaient à louvoyer. Leurs voiles descendaient aux deux tiers des mâts ; et, la misaine gonflée comme un ballon, elles avançaient, glissaient dans le clapotement des vagues, jusqu’au milieu du port, où l’ancre tout à coup tombait. Ensuite le bateau se plaçait contre le quai. Les matelots jetaient par-dessus le bordage des poissons palpitants ; une file de charrettes les attendait, et des femmes en bonnet de coton s’élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser leurs hommes.
Une d’elles un jour aborda Félicité, qui peu de temps après entra dans la chambre, toute joyeuse. Elle avait trouvé une sœur ; et Nastasie Barette, femme Leroux, apparut, tenant un nourrisson à sa poitrine, de la main droite un autre enfant. À sa gauche un petit mousse les poings sur les hanches et le béret sur l’oreille.
Au bout d’un quart d’heure, Mme Aubain la congédia.
On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine, ou dans les promenades que l’on faisait. Le mari ne se montrait pas.
Félicité se prit d’affection pour eux. Elle leur acheta une couverture, des chemises, un fourneau ; évidemment ils l’exploitaient. Cette faiblesse agaçait Mme Aubain, qui d’ailleurs n’aimait pas les familiarités du neveu, — car il tutoyait son fils ; — et, comme Virginie toussait et que la saison n’était plus bonne, elle revint à Pont-l’Évêque.
M. Bourais l’éclaira sur le choix d’un collège. Celui de Caen passait pour le meilleur. Paul y fut envoyé ; et fit bravement ses adieux, satisfait d’aller vivre dans une maison où il aurait des camarades.
Mme Aubain se résigna à l’éloignement de son fils, parce qu’il était indispensable. Virginie y songea de moins en moins. Félicité regrettait son tapage. Mais une occupation vint la distraire. À partir de Noël, elle mena tous les jours la petite fille au catéchisme.
III
uand elle avait fait à la porte une génuflexion, elle s’avançait sous la haute nef entre la double ligne des chaises, ouvrait le banc de Mme Aubain, s’asseyait, et promenait ses yeux autour d’elle.
Les garçons à droite, les filles à gauche, emplissaient les stalles du chœur ; le curé se tenait debout près du lutrin ; sur un vitrail de l’abside, le Saint-Esprit dominait la Vierge ; un autre la montrait à genoux devant l’Enfant-Jésus, et, derrière le tabernacle, un groupe en bois représentait saint Michel terrassant le dragon.
Le prêtre fit d’abord un abrégé de l’Histoire Sainte. Elle croyait voir le paradis, le déluge, la tour de Babel, des villes tout en flammes, des peuples qui mouraient, des idoles renversées ; et elle garda de cet éblouissement le respect du Très-Haut et la crainte de sa colère. Puis elle pleura en écoutant la Passion. Pourquoi l’avaient-ils crucifié, lui qui chérissait les enfants, nourrissait les foules, guérissait les aveugles, et avait voulu, par douceur, naître au milieu des pauvres sur le fumier d’une étable ? Les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont parle l’Évangile se trouvaient dans sa vie ; le passage de Dieu les avait sanctifiées ; et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l’Agneau, les colombes à cause du Saint-Esprit.
Elle avait peine à imaginer sa personne ; car il n’était pas seulement oiseau, mais encore un feu, et d’autres fois un souffle. C’est peut-être sa lumière qui voltige la nuit aux bords des marécages, son haleine qui pousse les nuées, sa voix qui rend les cloches harmonieuses ; et elle demeurait dans une adoration, jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l’église.
Quant aux dogmes, elle n’y comprenait rien, ne tâcha même pas de comprendre. Le curé discourait, les enfants récitaient, elle finissait par s’endormir ; et se réveillait tout à coup, quand ils faisaient en s’en allant claquer leurs sabots sur les dalles.
Ce fut de cette manière, à force de l’entendre, qu’elle apprit le catéchisme, son éducation religieuse ayant été négligée dans sa jeunesse ; et dès lors elle imita toutes les pratiques de Virginie, jeûnait comme elle, se confessait avec elle. À la Fête-Dieu, elles firent ensemble un reposoir.
La première communion la tourmentait d’avance. Elle s’agita pour les souliers, pour le chapelet, pour le livre, pour les gants. Avec quel tremblement elle aida sa mère à l’habiller !
Pendant toute la messe, elle éprouva une angoisse. M. Bourais lui cachait un côté du chœur ; mais juste en face, le troupeau des vierges portant des couronnes blanches par-dessus leurs voiles abaissés formait comme un champ de neige ; et elle reconnaissait de loin la chère petite à son cou plus mignon et son attitude recueillie. La cloche tinta. Les têtes se courbèrent ; il y eut un silence. Aux éclats de l’orgue, les chantres et la foule entonnèrent l’Agnus Dei ; puis le défilé des garçons commença ; et, après eux, les filles se levèrent. Pas à pas, et les mains jointes, elles allaient vers l’autel tout illuminé, s’agenouillaient sur la première marche, recevaient l’hostie successivement, et dans le même ordre revenaient à leurs prie-Dieu. Quand ce fut le tour de Virginie, Félicité se pencha pour la voir ; et, avec l’imagination que donnent les vraies tendresses, il lui sembla qu’elle était elle-même cette enfant ; sa figure devenait la sienne, sa robe l’habillait, son cœur lui battait dans la poitrine ; au moment d’ouvrir la bouche, en fermant les paupières, elle manqua s’évanouir.
Le lendemain, de bonne heure, elle se présenta dans la sacristie, pour que M. le curé lui donnât la communion. Elle la reçut dévotement, mais n’y goûta pas les mêmes délices.
Mme Aubain voulait faire de sa fille une personne accomplie ; et, comme Guyot ne pouvait lui montrer ni l’anglais ni la musique, elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines de Honfleur.
L’enfant n’objecta rien. Félicité soupirait, trouvant Madame insensible. Puis elle songea que sa maîtresse, peut-être, avait raison. Ces choses dépassaient sa compétence.
Enfin, un jour, une vieille tapissière s’arrêta devant la porte ; et il en descendit une religieuse qui venait chercher Mademoiselle. Félicité monta les bagages sur l’impériale, fit des recommandations au cocher, et plaça dans le coffre six pots de confitures et une douzaine de poires, avec un bouquet de violettes.
Virginie, au dernier moment, fut prise d’un grand sanglot. Elle embrassait sa mère qui la baisait au front, en répétant.
— Allons ! du courage ! du courage !
Le marchepied se releva, la voiture partit.
Alors Mme Aubain eut une défaillance ; et le soir tous ses amis, le ménage Lormeau, Mme Lechaptois, ces demoiselles Rochefeuille, M. de Houppeville et Bourais se présentèrent pour la consoler.
La privation de sa fille lui fut d’abord très douloureuse. Mais trois fois la semaine, elle en recevait une lettre, les autres jours lui écrivait, se promenait dans son jardin, lisait un peu, et de cette façon comblait le vide des heures.
Le matin, par habitude, Félicité entrait dans la chambre de Virginie, et regardait les murailles. Elle s’ennuyait de n’avoir plus à peigner ses cheveux, à lui lacer ses bottines, à la border dans son lit, — et de ne plus voir continuellement sa gentille figure, de ne plus la tenir par la main quand elles sortaient ensemble. Dans son désœuvrement, elle essaya de faire de la dentelle. Ses doigts trop lourds cassaient les fils ; elle n’entendait à rien, avait perdu le sommeil, suivant son mot, était « minée ».
Pour « se dissiper », elle demanda la permission de recevoir son neveu Victor.
Il arrivait le dimanche après la Messe, les joues roses, la poitrine nue, et sentant l’odeur de la campagne qu’il avait traversée. Tout de suite, elle dressait son couvert. Ils déjeunaient l’un en face de l’autre ; et, mangeant elle-même le moins possible pour épargner la dépense, elle le bourrait tellement de nourriture qu’il finissait par s’endormir. Au premier coup des vêpres, elle le réveillait, brossait son pantalon, nouait sa cravate, et se rendait à l’église, appuyée sur son bras dans un orgueil maternel.
Ses parents le chargeaient toujours d’en tirer quelque chose, soit un paquet de cassonade, du savon, de l’eau-de-vie, parfois même de l’argent. Il apportait ses nippes à raccommoder ; et elle acceptait cette besogne, heureuse d’une occasion qui le forçait à revenir.
Au mois d’août, son père l’emmena au cabotage.
C’était l’époque des vacances. L’arrivée des enfants la consola. Mais Paul devenait capricieux, et Virginie n’avait plus l’âge d’être tutoyée, ce qui mettait une gêne, une barrière entre elles.
Victor alla successivement à Morlaix, à Dunkerque et à Brighton ; au retour de chaque voyage, il lui offrait un cadeau. La première fois, ce fut une boîte en coquilles ; la seconde, une tasse à café ; la troisième, un grand bonhomme en pain d’épice. Il embellissait, avait la taille bien prise, un peu de moustache, de bons yeux francs, et un petit chapeau de cuir, placé en arrière comme un pilote. Il l’amusait, en lui racontant des histoires mêlées de termes marins.
Un lundi, 14 juillet 1819 (elle n’oublia pas la date), Victor annonça qu’il était engagé au long cours, et, dans la nuit du surlendemain, par le paquebot de Honfleur, irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement. Il serait, peut-être, deux ans parti.
La perspective d’une telle absence désola Félicité ; et pour lui dire encore adieu, le mercredi soir, après le dîner de Madame, elle chaussa des galoches, et avala les quatre lieues qui séparent Pont-l’Évêque de Honfleur.
Quand elle fut devant le Calvaire, au lieu de prendre à gauche, elle prit à droite, se perdit dans des chantiers, revint sur ses pas ; des gens qu’elle accosta l’engagèrent à se hâter. Elle fit le tour du bassin rempli de navires, se heurtait contre des amarres. Puis le terrain s’abaissa, des lumières s’entrecroisèrent, et elle se crut folle, en apercevant des chevaux dans le ciel.
Au bord du quai, d’autres hennissaient, effrayés par la mer. Un palan qui les enlevait les descendait dans un bateau, où des voyageurs se bousculaient entre les barriques de cidre, les paniers de fromage, les sacs de grain ; on entendait chanter des poules, le capitaine jurait ; et un mousse restait accoudé sur le bossoir, indifférent à tout cela. Félicité, qui ne l’avait pas reconnu, criait « Victor ! » ; il leva la tête ; elle s’élançait, quand on retira l’échelle tout à coup.
Le paquebot, que des femmes halaient en chantant, sortit du port. Sa membrure craquait, les vagues pesantes fouettaient sa proue. La voile avait tourné. On ne vit plus personne ; — et, sur la mer argentée par la lune, il faisait une tache noire qui pâlissait toujours, s’enfonça, disparut.
Félicité, en passant près du Calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu’elle chérissait le plus ; et elle pria pendant longtemps, debout, la face baignée de pleurs, les yeux vers les nuages. La ville dormait, des douaniers se promenaient ; et de l’eau tombait sans discontinuer par les trous de l’écluse, avec un bruit de torrent. Deux heures sonnèrent.
Le parloir n’ouvrirait pas avant le jour. Un retard, bien sûr, contrarierait Madame ; et, malgré son désir d’embrasser l’autre enfant, elle s’en retourna. Les filles de l’auberge s’éveillaient, comme elle entrait à Pont-l’Évêque.
Le gamin, durant des mois, allait donc rouler sur les flots ! Ses précédents voyages ne l’avaient pas effrayée. De l’Angleterre et de la Bretagne, on revenait. Mais l’Amérique, les Colonies, les Îles, cela était perdu dans une région incertaine, à l’autre bout du monde.
Dès lors, Félicité pensa exclusivement à son neveu. Les jours de soleil, elle se tourmentait de la soif ; quand il faisait de l’orage, craignait pour lui la foudre. En écoutant le vent qui grondait dans la cheminée et emportait les ardoises, elle le voyait battu par cette même tempête, au sommet d’un mât fracassé, tout le corps en arrière, sous une nappe d’écume ; ou bien, — souvenir de la géographie en estampes, — il était mangé par les sauvages, pris dans un bois par des singes, se mourait le long d’une plage déserte. Et jamais elle ne parlait de ces inquiétudes.
Mme Aubain en avait d’autres sur sa fille.
Les bonnes sœurs trouvaient qu’elle était affectueuse, mais délicate. La moindre émotion l’énervait. Il fallut abandonner le piano.
Sa mère exigeait du couvent une correspondance réglée. Un matin que le facteur n’était pas venu, elle s’impatienta ; et elle marchait dans la salle, de son fauteuil à la fenêtre. C’était vraiment extraordinaire ! Depuis quatre jours, pas de nouvelles !
Pour qu’elle se consolât par son exemple, Félicité lui dit :
— Moi, Madame, voilà six mois que je n’en ai reçu !…
— De qui donc ?…
La servante répliqua doucement :
— Mais… de mon neveu !
— Ah ! votre neveu !
Et, haussant les épaules, Mme Aubain reprit sa promenade, ce qui voulait dire : « Je n’y pensais pas !… Au surplus, je m’en moque ! un mousse, un gueux, belle affaire !… tandis que ma fille… Songez donc !… »
Félicité, bien que nourrie dans la rudesse, fut indignée contre Madame, puis oublia.
Il lui paraissait tout simple de perdre la tête à l’occasion de la petite.
Les deux enfants avaient une importance égale ; un lien de son cœur les unissait, et leurs destinées devaient être la même.
Le pharmacien lui apprit que le bateau de Victor était arrivé à la Havane ; il avait lu ce renseignement dans une gazette.
À cause des cigares, elle imaginait la Havane un pays où l’on ne fait pas autre chose que de fumer, et Victor circulait parmi des nègres dans un nuage de tabac. Pouvait-on « en cas de besoin » s’en retourner par terre ? À quelle distance était-ce de Pont-l’Évêque ? Pour le savoir, elle interrogea M. Bourais.
Il atteignit son atlas, puis commença des explications sur les longitudes ; et il avait un beau sourire de cuistre devant l’ahurissement de Félicité. Enfin, avec son porte-crayon, il indiqua, dans les découpures d’une tache ovale, un point noir, imperceptible, en ajoutant « Voici. »
Elle se pencha sur la carte ; ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue, sans lui rien apprendre ; et Bourais, l’invitant à dire ce qui l’embarrassait, elle le pria de lui montrer la maison où demeurait Victor. Bourais leva les bras, il éternua, rit énormément ; une candeur pareille excitait sa joie ; et Félicité n’en comprenait pas le motif, — elle qui s’attendait peut-être à voir jusqu’au portrait de son neveu, tant son intelligence était bornée !
Ce fut quinze jours après que Liébard, à l’heure du marché comme d’habitude, entra dans la cuisine ; et lui remit une lettre qu’envoyait son beau-frère. Ne sachant lire aucun des deux, elle eut recours à sa maîtresse.
Mme Aubain, qui comptait les mailles d’un tricot, le posa près d’elle, décacheta la lettre, tressaillit, et, d’une voix basse, avec un regard profond.
— C’est un malheur… qu’on vous annonce. Votre neveu…
Il était mort. On n’en disait pas davantage.
Félicité tomba sur une chaise, en s’appuyant la tête à la cloison, et ferma ses paupières, qui devinrent roses tout à coup. Puis, le front baissé, les mains pendantes, l’œil fixe, elle répétait par intervalles :
— Pauvre petit gars ! pauvre petit gars !
Liébard la considérait en exhalant des soupirs. Mme Aubain tremblait un peu.
Elle lui proposa d’aller voir sa sœur, à Trouville.
Félicité répondit, par un geste, qu’elle n’en avait pas besoin.
Il y eut un silence. Le bonhomme Liébard jugea convenable de se retirer. Alors elle dit :
— Ça ne leur fait rien, à eux !
Sa tête retomba ; et machinalement elle soulevait, de temps à autre, les longues aiguilles sur la table à ouvrage.
Des femmes passèrent dans la cour avec un bard d’où dégouttelait du linge.
En les apercevant par les carreaux, elle se rappela sa lessive ; l’ayant coulée la veille, il fallait aujourd’hui la rincer ; et elle sortit de l’appartement.
Sa planche et son tonneau étaient au bord de la Toucques. Elle jeta sur la berge un tas de chemises, retroussa ses manches, prit son battoir ; et les coups forts qu’elle donnait s’entendaient dans les autres jardins à côté. Les prairies étaient vides, le vent agitait la rivière ; au fond, de grandes herbes s’y penchaient, comme des chevelures de cadavres flottant dans l’eau. Elle retenait sa douleur, jusqu’au soir fut très brave ; mais dans sa chambre, elle s’y abandonna, à plat ventre sur son matelas, le visage dans l’oreiller, et les deux poings contre les tempes.
Beaucoup plus tard, par le capitaine de Victor lui-même, elle connut les circonstances de sa fin.
On l’avait trop saigné à l’hôpital, pour la fièvre jaune. Quatre médecins le tenaient à la fois. Il était mort immédiatement, et le chef avait dit :
— Bon ! encore un !
Ses parents l’avaient toujours traité avec barbarie. Elle aima mieux ne pas les revoir ; et ils ne firent aucune avance, par oubli, ou endurcissement de misérables.
Virginie s’affaiblissait.
Des oppressions, de la toux, une fièvre continuelle et des marbrures aux pommettes décelaient quelque affection profonde. M. Poupart avait conseillé un séjour en Provence. Mme Aubain s’y décida, et eût tout de suite repris sa fille à la maison, sans le climat de Pont-l’Évêque.
Elle fit un arrangement avec un loueur de voitures, qui la menait au couvent chaque mardi. Il y a dans le jardin une terrasse d’où l’on découvre la Seine. Virginie s’y promenait à son bras, sur les feuilles de pampre tombées. Quelquefois le soleil traversant les nuages la forçait à cligner ses paupières, pendant qu’elle regardait les voiles au loin et tout l’horizon, depuis le château de Tancarville jusqu’aux phares du Havre. Ensuite on se reposait sous la tonnelle. Sa mère s’était procuré un petit fût d’excellent vin de Malaga ; et riant à l’idée d’être grise, elle en buvait deux doigts, pas davantage.
Ses forces reparurent. L’automne s’écoula doucement. Félicité rassurait Mme Aubain. Mais, un soir qu’elle avait été aux environs faire une course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de M. Poupart ; et il était dans le vestibule. Mme Aubain nouait son chapeau.
— Donnez-moi ma chaufferette, ma bourse, mes gants ! Plus vite donc !
Virginie avait une fluxion de poitrine ; c’était peut-être désespéré.
— Pas encore ! dit le médecin.
Et tous deux montèrent dans la voiture, sous des flocons de neige qui tourbillonnaient. La nuit allait venir. Il faisait très froid.
Félicité se précipita dans l’église, pour allumer un cierge. Puis elle courut après le cabriolet, qu’elle rejoignit une heure plus tard, sauta légèrement par derrière, où elle se tenait aux torsades, quand une réflexion lui vint : « La cour n’était pas fermée ! si des voleurs s’introduisaient ? » Et elle descendit.
Le lendemain, dès l’aube, elle se présenta chez le Docteur. Il était rentré et reparti à la campagne. Puis elle resta dans l’auberge, croyant que des inconnus apporteraient une lettre. Enfin, au petit jour, elle prit la diligence de Lisieux.
Le couvent se trouvait au fond d’une ruelle escarpée. Vers le milieu, elle entendit des sons étranges, un glas de mort. « C’est pour d’autres » pensa-t-elle ; et Félicité tira violemment le marteau.
Au bout de plusieurs minutes, des savates se traînèrent, la porte s’entrebâilla, et une religieuse parut.
La Bonne-Sœur avec un air de componction dit qu’« elle venait de passer ». En même temps, le glas de Saint-Léonard redoublait.
Félicité parvint au second étage.
Dès le seuil de la chambre, elle aperçut Virginie étalée sur le dos, les mains jointes, la bouche ouverte, et la tête en arrière sous une croix noire s’inclinant vers elle, entre les rideaux immobiles, moins pâles que sa figure. Mme Aubain, au pied de la couche qu’elle tenait dans ses bras, poussait des hoquets d’agonie. La supérieure était debout, à droite. Trois chandeliers sur la commode faisaient des taches rouges, et le brouillard blanchissait les fenêtres. Des religieuses emportèrent Mme Aubain.
Pendant deux nuits, Félicité ne quitta pas la morte. Elle répétait les mêmes prières, jetait de l’eau bénite sur les draps, revenait s’asseoir, et la contemplait. À la fin de la première veille, elle remarqua que la figure avait jauni, les lèvres bleuirent, le nez se pinçait, les yeux s’enfonçaient. Elle les baisa plusieurs fois ; et n’eût pas éprouvé un immense étonnement si Virginie les eût rouverts ; pour de pareilles âmes le surnaturel est tout simple. Elle fit sa toilette, l’enveloppa de son linceul, la descendit dans sa bière, lui posa une couronne, étala ses cheveux. Ils étaient blonds, et extraordinaires de longueur à son âge. Félicité en coupa une grosse mèche, dont elle glissa la moitié dans sa poitrine, résolue à ne jamais s’en dessaisir.
Le corps fut ramené à Pont-l’Évêque, suivant les intentions de Mme Aubain, qui suivait le corbillard, dans une voiture fermée.
Après la messe, il fallut encore trois quarts d’heure pour atteindre le cimetière. Paul marchait en tête et sanglotait. M. Bourais était derrière, ensuite les principaux habitants, les femmes, couvertes de mantes noires, et Félicité. Elle songeait à son neveu, et n’ayant pu lui rendre ces honneurs, avait un surcroît de tristesse, comme si on l’eût enterrée avec l’autre.
Le désespoir de Mme Aubain fut illimité.
D’abord elle se révolta contre Dieu, le trouvant injuste de lui avoir pris sa fille, — elle, qui n’avait jamais fait le mal, et dont la conscience était si pure ! — Mais non ! elle aurait dû l’emporter dans le Midi. D’autres docteurs l’auraient sauvée ! Elle s’accusait, voulait la rejoindre, criait en détresse au milieu de ses rêves. Un, surtout, l’obsédait. Son mari, costumé comme un matelot, revenait d’un long voyage, et lui disait en pleurant qu’il avait reçu l’ordre d’emmener Virginie. Alors ils se concertaient pour découvrir une cachette quelque part.
Une fois, elle rentra du jardin, bouleversée. Tout à l’heure (elle montrait l’endroit), le père et la fille lui étaient apparus l’un auprès de l’autre, et ils ne faisaient rien ; ils la regardaient.
Pendant plusieurs mois, elle resta dans sa chambre, inerte. Félicité la sermonnait doucement. Il fallait se conserver pour son fils, et pour l’autre, en souvenir « d’elle ».
— « Elle ? » reprenait Mme Aubain, comme se réveillant. Ah ! oui !… oui !… Vous ne l’oubliez pas !
Allusion au cimetière, qu’on lui avait scrupuleusement défendu.
Félicité tous les jours s’y rendait.
À quatre heures précises, elle passait au bord des maisons, montait la côte, ouvrait la barrière, et arrivait devant la tombe de Virginie. C’était une petite colonne de marbre rose, avec une dalle dans le bas, et des chaînes autour enfermant un jardinet. Les plates-bandes disparaissaient sous une couverture de fleurs. Elle arrosait leurs feuilles, renouvelait le sable, se mettait à genoux pour mieux labourer la terre. Mme Aubain, quand elle put y venir, en éprouva un soulagement, une espèce de consolation.
Puis des années s’écoulèrent, toutes pareilles, et sans autres épisodes que le retour des grandes fêtes : Pâques, l’Assomption, la Toussaint. Des événements intérieurs faisaient une date, où l’on se reportait plus tard. Ainsi, en 1825, deux vitriers badigeonnèrent le vestibule ; en 1827, une portion du toit, tombant dans la cour, faillit tuer un homme. L’été de 1828, ce fut à Madame d’offrir le pain bénit ; Bourais, vers cette époque, s’absenta mystérieusement ; et les anciennes connaissances peu à peu s’en allèrent : Guyot, Liébard, Mme Lechaptois, Robelin, l’oncle Gremanville, paralysé depuis longtemps.
Une nuit, le conducteur de la malle-poste annonça dans Pont-l’Évêque la Révolution de Juillet. Un sous-préfet nouveau, peu de jours après, fut nommé : le baron de Larsonnière, ex-consul en Amérique, et qui avait chez lui, outre sa femme, sa belle-sœur avec trois demoiselles, assez grandes déjà. On les apercevait sur leur gazon, habillées de blouses flottantes ; elles possédaient un nègre et un perroquet. Mme Aubain eut leur visite, et ne manqua pas de la rendre. Du plus loin qu’elles paraissaient, Félicité accourait pour la prévenir. Mais une chose était seule capable de l’émouvoir, les lettres de son fils.
Il ne pouvait suivre aucune carrière, étant absorbé dans les estaminets. Elle lui payait ses dettes ; il en refaisait d’autres ; et les soupirs que poussait Mme Aubain, en tricotant près de la fenêtre, arrivaient à Félicité, qui tournait son rouet dans la cuisine.
Elles se promenaient ensemble le long de l’espalier ; et causaient toujours de Virginie, se demandant si telle chose lui aurait plu, en telle occasion ce qu’elle eût dit probablement.
Toutes ses petites affaires occupaient un placard dans la chambre à deux lits. Mme Aubain les inspectait le moins souvent possible. Un jour d’été, elle se résigna ; et des papillons s’envolèrent de l’armoire.
Ses robes étaient en ligne sous une planche où il y avait trois poupées, des cerceaux, un ménage, la cuvette qui lui servait. Elles retirèrent également les jupons, les bas, les mouchoirs, et les étendirent sur les deux couches, avant de les replier. Le soleil éclairait ces pauvres objets, en faisait voir les taches, et des plis formés par les mouvements du corps. L’air était chaud et bleu. Un merle gazouillait, tout semblait vivre dans une douceur profonde. Elles retrouvèrent un petit chapeau de peluche, à longs poils, couleur marron. Mais il était tout mangé de vermine. Félicité le réclama pour elle-même. Leurs yeux se fixèrent l’une sur l’autre, s’emplirent de larmes ; enfin la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s’y jeta, et elles s’étreignirent, satisfaisant leur douleur dans un baiser qui les égalisait.
C’était la première fois de leur vie, Mme Aubain n’étant pas d’une nature expansive. Félicité lui en fut reconnaissante comme d’un bienfait, et désormais la chérit avec un dévouement bestial et une vénération religieuse.
La bonté de son cœur se développa.
Quand elle entendait dans la rue les tambours d’un régiment en marche, elle se mettait devant la porte avec une cruche de cidre, et offrait à boire aux soldats. Elle soigna des cholériques. Elle protégeait les Polonais, et même il y en eut un qui déclarait la vouloir épouser. Mais ils se fâchèrent ; car un matin, en rentrant de l’Angélus, elle le trouva dans sa cuisine, où il s’était introduit, et accommodé une vinaigrette qu’il mangeait tranquillement.
Après les Polonais, ce fut le père Colmiche, un vieillard passant pour avoir fait des horreurs en 93. Il vivait au bord de la rivière, dans les décombres d’une porcherie. Les gamins le regardaient par les fentes du mur, et lui jetaient des cailloux, qui tombaient sur son grabat, où il gisait, continuellement secoué par un catarrhe, avec des cheveux très longs, les paupières enflammées, et au bras une tumeur plus grosse que sa tête. Elle lui procura du linge, tâcha de nettoyer son bouge, rêvait à l’établir dans le fournil, sans qu’il gênât Madame. Quand le cancer eut crevé, elle le pansa tous les jours, lui apportait de la galette, le plaçait au soleil sur une botte de paille ; et le pauvre vieux, en bavant et en tremblant, la remerciait de sa voix éteinte, craignait de la perdre ; allongeait les mains dès qu’il la voyait s’éloigner. Il mourut ; elle fit dire une messe pour le repos de son âme.
Ce jour-là, il lui advint un grand bonheur : au moment du dîner, le nègre de Mme de Larsonnière se présenta, tenant le perroquet dans sa cage, avec le bâton, la chaîne et le cadenas. Un billet de la Baronne annonçait à Mme Aubain que, son mari étant élevé à une préfecture, ils partaient le soir ; et elle la priait d’accepter cet oiseau comme un souvenir et en témoignage de ses respects.
Il occupait depuis longtemps l’imagination de Félicité, car il venait d’Amérique et ce mot lui rappelait Victor, si bien qu’elle s’en informait auprès du nègre. Une fois même elle avait dit :
— C’est Madame qui serait heureuse de l’avoir !
Le nègre avait redit le propos à sa maîtresse, qui, ne pouvant l’emmener, s’en débarrassait de cette façon.
IV
l s’appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes rose, son front bleu et sa gorge dorée.
Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s’arrachait les plumes, éparpillait ses ordures, répandait l’eau de sa baignoire ; Mme Aubain, qu’il ennuyait, le donna pour toujours à Félicité.
Elle entreprit de l’instruire ; bientôt il répéta : « Charmant garçon ! Serviteur, monsieur ! Je vous salue, Marie ! » Il était placé auprès de la porte, et plusieurs s’étonnaient qu’il ne répondît pas au nom de Jacquot, puisque tous les perroquets s’appellent Jacquot. On le comparait à une dinde, à une bûche : autant de coups de poignard pour Félicité ! Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu’on le regardait !
Néanmoins il recherchait la compagnie ; car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, M. de Houppeville et de nouveaux habitués : Onfroy l’apothicaire, M. Varin et le capitaine Mathieu, faisaient leur partie de cartes, il cognait les vitres avec ses ailes, et se démenait si furieusement qu’il était impossible de s’entendre.
La figure de Bourais, sans doute, lui paraissait très drôle. Dès qu’il l’apercevait, il commençait à rire, à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l’écho les répétait, les voisins se mettaient à leurs fenêtres, riaient aussi ; et, pour n’être pas vu du perroquet, M. Bourais se coulait le long du mur, en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière puis entrait par la porte du jardin ; et les regards qu’il envoyait à l’oiseau manquaient de tendresse.
Loulou avait reçu du garçon boucher une chiquenaude, s’étant permis d’enfoncer la tête dans sa corbeille ; et depuis lors il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Fabu menaçait de lui tordre le col, bien qu’il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de ses bras, et ses gros favoris. Au contraire ! il avait plutôt du penchant pour le perroquet, jusqu’à vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité, que ces manières effrayaient, le plaça dans la cuisine. Sa chaînette fut retirée, et il circulait dans la maison.
Quand il descendait l’escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite, puis la gauche ; et elle avait peur qu’une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements. Il devint malade, ne pouvait plus parler ni manger. C’était sous sa langue une épaisseur, comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit, en arrachant cette pellicule avec ses ongles. M. Paul, un jour, eut l’imprudence de lui souffler aux narines la fumée d’un cigare ; une autre fois que Mme Lormeau l’agaçait du bout de son ombrelle, il en happa la virole ; enfin, il se perdit.
Elle l’avait posé sur l’herbe pour le rafraîchir, s’absenta une minute ; et, quand elle revint, plus de perroquet ! D’abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l’eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait :
— Prenez donc garde ! vous êtes folle !
Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l’Évêque ; et elle arrêtait les passants.
— Vous n’auriez pas vu, quelquefois, par hasard, mon perroquet ?
À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait. Mais au haut de la côte, rien ! Un porte-balle lui affirma qu’il l’avait rencontré tout à l’heure, à Sainte-Melaine, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu’elle voulait dire. Enfin elle rentra épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l’âme ; et, assise au milieu du banc, près de Madame, elle racontait toutes ses démarches, quand un poids léger lui tomba sur l’épaule : Loulou ! Que diable avait-il fait ? Peut-être qu’il s’était promené aux environs ?
Elle eut du mal à s’en remettre, ou plutôt ne s’en remit jamais.
Par suite d’un refroidissement, il lui vint une angine ; peu de temps après, un mal d’oreilles. Trois ans plus tard, elle était sourde ; et elle parlait très haut, même à l’église. Bien que ses péchés auraient pu sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les coins du diocèse, M. le Curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie.
Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent, sa maîtresse lui disait :
— Mon Dieu ! comme vous êtes bête !
Elle répliquait :
— Oui, Madame, en cherchant quelque chose autour d’elle.
Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore, et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n’existaient plus ! Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet.
Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tournebroche, l’appel aigu du vendeur de poisson, la scie du menuisier qui logeait en face ; et, aux coups de la sonnette, imitait Mme Aubain.
— Félicité ! la porte, la porte !
Ils avaient des dialogues, lui, débitant à satiété les trois phrases de son répertoire, et elle, y répondant par des mots sans plus de suite, mais où son cœur s’épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu ; et, comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l’oiseau frémissaient ensemble.
Quand des nuages s’amoncelaient et que le tonnerre grondait, il poussait des cris, se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales. Le ruissellement de l’eau excitait son délire ; il voletait éperdu, montait au plafond, renversait tout, et par la fenêtre allait barboter dans le jardin ; mais revenait vite sur un des chenets, et, sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec.
Un matin du terrible hiver de 1837, qu’elle l’avait mis devant la cheminée, à cause du froid, elle le trouva mort au milieu de sa cage, la tête en bas, et les ongles dans les fils de fer. Une congestion l’avait tué, sans doute. Elle crut à un empoisonnement par le persil ; et, malgré l’absence de toute preuve, ses soupçons portèrent sur Fabu.
Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit :
— Eh bien ! faites-le empailler !
Alors elle demanda conseil au pharmacien, qui avait toujours été bon pour le perroquet.
Il écrivit au Havre. Un certain Fellacher se chargea de cette besogne. Mais, comme la diligence égarait parfois les colis, elle résolut de le porter elle-même, jusqu’à Honfleur.
Les pommiers sans feuilles se succédaient aux bords de la route. De la glace couvrait les fossés. Des chiens aboyaient autour des fermes ; et les mains sous son mantelet, avec ses petits sabots noirs et son cabas, elle marchait prestement, sur le milieu du pavé.
Elle traversa la forêt, dépassa le Haut-Chêne, atteignit Saint-Gatien.
Derrière elle, dans un nuage de poussière et emportée par la descente, une malle-poste au grand galop se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, le conducteur se dressa par-dessus la capote, et le postillon criait aussi pendant que ses quatre chevaux, qu’il ne pouvait retenir, accéléraient leur train ; les deux premiers la frôlaient ; d’une secousse de ses guides, il les jeta dans le débord, mais furieux releva le bras, et à pleine volée, avec son grand fouet, lui cingla du ventre au chignon un tel coup qu’elle tomba sur le dos.
Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d’ouvrir son panier. Loulou n’avait rien, heureusement. Elle sentit une brûlure à la joue droite ; ses mains qu’elle y porta étaient rouges. Le sang coulait.
Elle s’assit sur un mètre de cailloux, se tamponna le visage avec son mouchoir, puis elle mangea une croûte de pain, mise dans son panier par précaution, et se consolait de sa blessure en regardant l’oiseau.
Arrivée au sommet d’Ecquemauville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d’étoiles ; la mer, plus loin, s’étalait confusément. Alors, une faiblesse l’arrêta ; et la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie, comme les flots d’une marée, revinrent à la fois, et, lui montant à la gorge, l’étouffaient.
Puis elle voulut parler au capitaine du bateau ; et sans dire ce qu’elle envoyait, lui fit des recommandations.
Fellacher garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine prochaine ; au bout de six mois, il annonça le départ d’une caisse ; et il n’en fut plus question. C’était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. « Ils me l’auront volé ! » pensait-elle.
Enfin, il arriva, — et splendide, droit sur une branche d’arbre, qui se vissait dans un socle d’acajou, une patte en l’air, la tête oblique, et mordant une noix, que l’empailleur par amour du grandiose avait dorée.
Elle l’enferma dans sa chambre.
Cet endroit, où elle admettait peu de monde, avait l’air tout à la fois d’une chapelle et d’un bazar, tant il contenait d’objets religieux et de choses hétéroclites.
Une grande armoire gênait pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre surplombant le jardin, un œil-de-bœuf regardait la cour ; une table près du lit de sangle, supportait un pot à l’eau, deux peignes, et un cube de savon bleu dans une assiette ébréchée. On voyait contre les murs : des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes Vierges, un bénitier en noix de coco ; sur la commode, couverte d’un drap comme un autel, la boîte en coquillages que lui avait donnée Victor ; puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d’écriture, la géographie en estampes, une paire de bottines ; et au clou du miroir, accroché par ses rubans, le petit chapeau de peluche ! Félicité poussait même ce genre de respect si loin qu’elle conservait une des redingotes de Monsieur. Toutes les vieilleries dont ne voulait plus Mme Aubain, elle les prenait pour sa chambre. C’est ainsi qu’il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode, et le portrait du comte d’Artois dans l’enfoncement de la lucarne.
Au moyen d’une planchette, Loulou fut établi sur un corps de cheminée qui avançait dans l’appartement. Chaque matin, en s’éveillant, elle l’apercevait à la clarté de l’aube, et se rappelait alors les jours disparus, et d’insignifiantes actions jusqu’en leurs moindres détails, sans douleur, pleine de tranquillité.
Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la Fête-Dieu la ranimaient. Elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons, afin d’embellir le reposoir que l’on dressait dans la rue.
À l’église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit, et observa qu’il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d’Épinal, représentant le baptême de Notre-Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d’émeraude, c’était vraiment le portrait de Loulou.
L’ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d’Artois, — de sorte que, du même coup d’œil, elle les voyait ensemble. Ils s’associèrent dans sa pensée, le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit, qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le Père, pour s’énoncer, n’avait pu choisir une colombe, puisque ces bêtes-là n’ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait en regardant l’image, mais de temps à autre se tournait un peu vers l’oiseau.
Elle eut envie de se mettre dans les demoiselles de la Vierge. Mme Aubain l’en dissuada.
Un événement considérable surgit : le mariage de Paul.
Après avoir été, d’abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions, et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à trente-six ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voie : l’enregistrement ! et y montrait de si hautes facultés qu’un vérificateur lui avait offert sa fille, en lui promettant sa protection.
Paul, devenu sérieux, l’amena chez sa mère.
Elle dénigra les usages de Pont-l’Évêque, fit la princesse, blessa Félicité. Mme Aubain, à son départ, sentit un allégement.
La semaine suivante, on apprit la mort de M. Bourais, en basse Bretagne, dans une auberge. La rumeur d’un suicide se confirma ; des doutes s’élevèrent sur sa probité. Mme Aubain étudia ses comptes, et ne tarda pas à connaître la kyrielle de ses noirceurs : détournements d’arrérages, ventes de bois dissimulées, fausses quittances, etc. De plus, il avait un enfant naturel, et « des relations avec une personne de Dozulé ».
Ces turpitudes l’affligèrent beaucoup. Au mois de mars 1853, elle fut prise d’une douleur dans la poitrine ; sa langue paraissait couverte de fumée, les sangsues ne calmèrent pas l’oppression ; et le neuvième soir elle expira, ayant juste soixante-douze ans.
On la croyait moins vieille, à cause de ses cheveux bruns, dont les bandeaux entouraient sa figure blême, marquée de petite vérole. Peu d’amis la regrettèrent, ses façons étant d’une hauteur qui éloignait.
Félicité la pleura, comme on ne pleure pas les maîtres. Que Madame mourût avant elle, cela troublait ses idées, lui semblait contraire à l’ordre des choses, inadmissible et monstrueux.
Dix jours après (le temps d’accourir de Besançon), les héritiers survinrent. La bru fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis ils regagnèrent l’enregistrement.
Le fauteuil de Madame, son guéridon, sa chaufferette, les huit chaises, étaient partis ! La place des gravures se dessinait en carrés jaunes au milieu des cloisons. Ils avaient emporté les deux couchettes, avec leurs matelas, et dans le placard on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie ! Félicité remonta les étages, ivre de tristesse.
Le lendemain il y avait sur la porte une affiche ; l’apothicaire lui cria dans l’oreille que la maison était à vendre.
Elle chancela, et fut obligée de s’asseoir.
Ce qui la désolait principalement, c’était d’abandonner sa chambre, — si commode pour le pauvre Loulou. En l’enveloppant d’un regard d’angoisse, elle implorait le Saint-Esprit, et contracta l’habitude idolâtre de dire ses oraisons, agenouillée devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant par la lucarne frappait son œil de verre, et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase.
Elle avait une rente de trois cent quatre-vingt francs, léguée par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes. Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu’à la fin de ses jours, et épargnait l’éclairage en se couchant dès le crépuscule.
Elle ne sortait guère, afin d’éviter la boutique du brocanteur, où s’étalaient quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe ; et, ses forces diminuant, la mère Simon, ruinée dans l’épicerie, venait tous les matins fendre son bois et pomper de l’eau.
Ses yeux s’affaiblirent. Les persiennes n’ouvraient plus. Bien des années se passèrent. Et la maison ne se louait pas, et ne se vendait pas.
Dans la crainte qu’on ne la renvoyât, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourrissaient ; pendant tout un hiver son traversin fut mouillé. Après Pâques, elle cracha du sang.
Alors la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu’elle avait. Mais, trop sourde pour entendre, un seul mot lui parvint : « Pneumonie ». Il lui était connu, et elle répliqua doucement :
— Ah ! comme Madame, trouvant naturel de suivre sa maîtresse.
Le moment des reposoirs approchait.
Le premier était toujours au bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là ; et les paroissiennes choisirent finalement la cour de Mme Aubain.
Les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir. Au moins, si elle avait pu y mettre quelque chose ! Alors elle songea au perroquet. Ce n’était pas convenable, objectèrent les voisines. Mais le Curé accorda cette permission ; elle en fut tellement heureuse qu’elle le pria d’accepter, quand elle serait morte, Loulou, sa seule richesse.
Du mardi au samedi, veille de la Fête-Dieu, elle toussa fréquemment. Le soir son visage était grippé, ses lèvres se collaient à ses gencives, les vomissements parurent ; et le lendemain, au petit jour, se sentant très bas, elle fit appeler un prêtre.
Trois bonnes femmes l’entouraient pendant l’extrême-onction. Puis elle déclara qu’elle avait besoin de parler à Fabu.
Il arriva en toilette des dimanches, mal à son aise dans cette atmosphère lugubre.
— Pardonnez-moi, dit-elle, avec un effort pour étendre le bras, je croyais que c’était vous qui l’aviez tué !
Que signifiaient des potins pareils ? L’avoir soupçonné d’un meurtre, un homme comme lui ! et il s’indignait, allait faire du tapage.
— Elle n’a plus sa tête, vous voyez bien !
Félicité de temps à autre parlait à des ombres. Les bonnes femmes s’en allèrent. La Simonne déjeuna.
Un peu plus tard, elle prit Loulou, et, l’approchant de Félicité :
— Allons ! dites-lui adieu !
Bien qu’il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient ; une de ses ailes était cassée, l’étoupe lui sortait du ventre. Mais, aveugle à présent, elle le baisa au front, et le gardait contre sa joue. La Simonne le reprit, pour le mettre sur le reposoir.
V
es herbages envoyaient l’odeur de l’été ; des mouches bourdonnaient ; le soleil faisait luire la rivière, chauffait les ardoises. La mère Simon, revenue dans la chambre, s’endormait doucement.
Des coups de cloche la réveillèrent ; on sortait des vêpres. Le délire de Félicité tomba. En songeant à la procession, elle la voyait, comme si elle l’eût suivie.
Tous les enfants des écoles, les chantres et les pompiers marchaient sur les trottoirs tandis qu’au milieu de la rue, s’avançaient premièrement : le suisse armé de sa hallebarde, le bedeau avec une grande croix, l’instituteur surveillant les gamins, la religieuse inquiète de ses petites filles ; trois des plus mignonnes, frisées comme des anges, jetaient dans l’air des pétales de roses ; le diacre, les bras écartés, modérait la musique ; et deux encenseurs se retournaient à chaque pas vers le Saint-Sacrement, que portait, sous un dais de velours ponceau tenu par quatre fabriciens, M. le curé, dans sa belle chasuble. Un flot de monde se poussait derrière, entre les nappes blanches couvrant le mur des maisons ; et l’on arriva au bas de la côte.
Une sueur froide mouillait les tempes de Félicité. La Simonne l’épongeait avec un linge, en se disant qu’un jour il lui faudrait passer par là.
Le murmure de la foule grossit, fut un moment très fort, s’éloignait.
Une fusillade ébranla les carreaux. C’étaient les postillons saluant l’ostensoir. Félicité roula ses prunelles, et elle dit, le moins bas qu’elle put :
— Est-il bien ? tourmentée du perroquet.
Son agonie commença. Un râle, de plus en plus précipité, lui soulevait les côtes. Des bouillons d’écume venaient aux coins de sa bouche, et tout son corps tremblait.
Bientôt, on distingua le ronflement des ophicléides, les voix claires des enfants, la voix profonde des hommes. Tout se taisait par intervalles, et le battement des pas, que des fleurs amortissaient, faisait le bruit d’un troupeau sur du gazon.
Le clergé parut dans la cour. La Simonne grimpa sur une chaise pour atteindre l’œil-de-bœuf, et de cette manière dominait le reposoir.
Des guirlandes vertes pendaient sur l’autel, orné d’un falbala en point d’Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des reliques, deux orangers dans les angles, et, tout le long, des flambeaux d’argent et des vases en porcelaine, d’où s’élançaient des tournesols, des lis, des pivoines, des digitales, des touffes d’hortensias. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement, du premier étage jusqu’au tapis se prolongeant sur les pavés ; et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violettes, des pendeloques en pierres d’Alençon brillaient sur de la mousse, deux écrans chinois montraient leurs paysages. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis.
Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches, et posa sur la dentelle son grand soleil d’or qui rayonnait. Tous s’agenouillèrent. Il se fit un grand silence. Et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes.
Une vapeur d’azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines, en la humant avec une sensualité mystique ; puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements du cœur se ralentirent un à un, plus vagues chaque fois, plus doux, comme une fontaine s’épuise, comme un écho disparaît ; et, quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir, dans les cieux entr’ouverts, un perroquet gigantesque, planant au-dessus de sa tête.
Flaubert connut dans l’intimité les personnages de Un Cœur simple : Mme Aubain n’est autre que sa grand-tante Mme Allais, mère de deux enfants, un garçon et une fille ; Félicité en était la servante naïve et bonne, dévotement attachée à son perroquet. Le paysage où Flaubert les a placés est celui où il passa une partie de sa jeunesse. Écrite sous l’empire du découragement, cette nouvelle lui procura les émotions qu’on éprouve en remontant le cours de sa vie.
LES ÉBAUCHES.
Il y eut de Un Cœur simple, avant l’écriture du manuscrit définitif, trois ébauches. Au milieu des surcharges et corrections de chacune d’elles, nous avons essayé de suivre le développement de quelques épisodes, de reconstituer quelques phrases et de les comparer, mais les deux premières ébauches sont indéchiffrables.
Le procédé de travail est ici le même qui fut employé pour
Madame Bovary. Flaubert rassemble la documentation la plus
étendue, souvent disproportionnée, puis trace un plan de son
œuvre, le scénario des chapitres et des épisodes principaux, et
développe d’esquisse en esquisse, corrigeant, surchargeant, 

La documentation de Un Cœur simple comprend de nombreux feuillets, où des notes sont écrites en tous sens. Sur le premier feuillet nous en trouvons le plan.
I. Figure de Félicité et la maison de Mme Aubain.
II. Son histoire, entre chez Mme Aubain — les enfants — personnages secondaires — Geffosses — le taureau — Trouville — Paul envoyé au collège.
III. Catéchisme de Virginie — 1re communion.
Départ pour le couvent.
Son neveu.
Paquebot d’Honfleur.
inquiétudes de son sort — Le Havre.
Sa mort.
Maladie, mort de Virginie.
Veille et enterrement.
Désespoir — hypocondrie de Mme Aubain.
Monotonie de leur existence — petits faits.
Revue de ses affaires.
Arrivée du perroquet.
IV. Descriptions, gentillesses de Loulou.
Crevé dans sa cage.
Le porte à Honfleur.
Empaillé.
Dépouillement de la maison à vendre ou à louer.
Puis viennent de nombreuses notes ; les unes énumèrent longuement tous les psaumes, litanies, cantiques chantés par la procession quand meurt Félicité ; les autres, les symptômes de la pneumonie et de la pleurésie : frisson — vomissements glaireux — fièvre — pouls — toux rare, etc. etc. etc. ; puis le traitement : ventouses, emplâtre sur le point de côté, etc. Un autre feuillet porte la mention catéchisme et contient les prescriptions de l’enseignement religieux : abrégé d’Histoire sainte, jeûne, bénédicité, etc. Une grande page pliée en deux porte en tête le mot Perroquet ; au-dessous s’étend une annotation commentée du perroquet d’après Desmaret, Monographie des perroquets (Ruhl et Levaillant, édit.) : aspects, caractère, nature, nourriture — boisson — bain — manies. Au verso de cette page le même travail de documentation a été fait pour le Perroquet amazone d’après Gerbe, Dictionnaire universel d’histoire naturelle et la Vie des animaux, par Muhée Brahn (trad. Gerbe) : boissons — nourriture — caresses — voix — se cache. — Le perroquet deux repas par jour. Sur une autre page est détaillé le cérémonial de l’office divin :
On sonne trois fois, gdes volées.
Après le 3e coup, le prêtre monte à l’autel.
introït
gloria.
l’épitre — après l’épitre le prêtre se lève et lit.
l’Évangile.
l’offertoire.
Quand il a levé 3 fois les bras au-dessus de sa tête, il rompt
le pain, l’avale, puis boit. Agnus dei est chanté par les chantres. Bénédiction.
Puis vient un résumé des épisodes principaux de Un cœur simple. Nous en déchiffrons la fin, c’est toute la physionomie de Félicité :
Ne pouvait pas rire. Quand elle voulait rire, elle toussait. Le perroquet est la première chose au monde qui la fait rire. Dans IV : (introduire dans le chapitre IV) son genre de rêverie ou plutôt de méditations, idées décousues et profondes, manière de penser comme en rêve. Ses idées les plus disparates se succèdent, ou elle reste béante devant la même sans l’approfondir.
La prendre ainsi dans sa cuisine pendant que Mme Aubain est
dans la salle assise près de la fenêtre.
Enfin sur les derniers feuillets, au milieu de ratures incalculables et de reprises en tout sens, on devine, plutôt qu’on ne lit, un exposé développé du conte.
La première ébauche comprend 105 feuillets de papier bleu grand format.
Ces 105 feuillets sont paginés 1 à 37, le même étant répété souvent cinq ou six fois, reprenant l’esquisse modifiée d’un même passage. Les ratures témoignent d’un grand effort « … mais depuis trois jours, je ne décolère pas, je ne peux mettre en train mon Histoire d’un cœur simple. J’ai travaillé hier pendant 16 heures, aujourd’hui toute la journée, et ce soir, enfin, j’ai terminé la première page. » (Lettre à Mme Roger des Genettes. Corresp., t. IV.)
La deuxième ébauche est écrite au verso de ces 105 feuillets ; elle présente le même aspect que la première sans moins de surcharges. Quant à la troisième, elle comprend 34 feuillets de papier bleu grand format paginés 1 à 34. Elle équivaut en réalité au manuscrit. Le papier blanc qui l’enferme porte cette inscription :
Quelques pages sont encore très corrigées, mais c’est le texte exact du manuscrit définitif (Voir note à la fin du volume.)
Un Cœur simple a paru en feuilleton dans le Moniteur universel, du 12 au 19 avril 1877.

VARIANTES DE UN CŒUR SIMPLE
D’APRÈS LE MANUSCRIT ORIGINAL.
Page 3, ligne 5, repassait, nettoyait le jardin, servait…
Page 3, ligne 7, beurre, et aima toujours sa maîtresse, qui n’était pas cependant…
Page 4, ligne 23, contenant dans son alcôve le portrait…
Page 5, ligne 17, poli de ses casseroles…
Page 7, ligne 8, mares, couchait sur la paille, servait les domestiques, à propos…
Page 9, ligne 6, était lourd, des étoiles…
Page 10, ligne 26, volonté avec si peu…
Page 12, ligne 3, Tous deux offrait…
Page 12, ligne 9, crapule, et vivant à Falaise…
Page 12, ligne 26, lui procurait ce trouble…
Page 13, ligne 20, milieu, et au fond la mer au loin…
Page 14, ligne 4, Et bien vite ils décampaient…
Page 14, ligne 7, les énormes futailles…
Page 14, ligne 10, la vitesse de ses jambes…
Page 15, ligne 13, continuellement lui lançait…
Page 16, ligne 15, M. Lestiboudois, prêté…
Page 17, ligne 3, Mme Houssais, qui…
Page 17, ligne 9, la ferme.
Page 19, ligne 18, flots comme endormis…
Page 19, ligne 21, dunes la séparant du marais…
Page 20, ligne 8, avaient franchi les balises…
Page 20, ligne 25, poings contre les hanches…
Page 2 1, ligne 18, y pensa de moins…
Page 30, ligne 6, qui diminuait toujours…
Page 30, ligne 19, entrait dans Pont-l’Évêque…
Page 30, ligne 20, Le gamin…
Page 30, ligne 27, de chaleur, elle…
Page 31, ligne 1, L’hiver, en écoutant…
Page 32, ligne 19, À combien de distance…
Page 33, ligne 11, sa cuisine…
Page 34, ligne 25, mais à peine dans…
Page 37, ligne 14, une large croix…
Page 40, ligne 23, blouses ; elles…
Page 41, ligne 3, en faisait d’autres…
Page 42, ligne 6, pas de nature expansive. Félicité lui en…
Page 45, ligne 11, Il était toujours auprès de la porte dans l’angle du perron, et plusieurs…
Page 47, ligne 1, Sa chaîne…
Page 49, ligne 25, l’eau que crachaient la gouttières, excitait…
Page 53, ligne 11 ; visage du comte…
Page 55, ligne 19, croyait plus jeune, à…
Page 58, ligne 21, l’avait tué !
Page 63, ligne 9, se continuant sur…
Page 63, ligne 21, fit un silence. Et les encensoirs, allant à pleine volée.
Page 63, ligne 27, mouvements du cœur…
LA LÉGENDE
DE
SAINT JULIEN L’HOSPITALIER
LA LÉGENDE
DE
SAINT JULIEN L’HOSPITALIER.
I
e père et la mère de Julien habitaient un château, au milieu des bois, sur la pente d’une colline.
Les quatre tours aux angles avaient des toits pointus recouverts d’écailles de plomb, et la base des murs s’appuyait sur les quartiers de rocs, qui dévalaient abruptement jusqu’au fond des douves.
Les pavés de la cour étaient nets comme le dallage d’une église. De longues gouttières, figurant des dragons la gueule en bas, crachaient l’eau des pluies vers la citerne ; et sur le bord des fenêtres, à tous les étages, dans un pot d’argile peinte, un basilic ou un héliotrope s’épanouissait.
Une seconde enceinte, faite de pieux, comprenait d’abord un verger d’arbres à fruits, ensuite un parterre où des combinaisons de fleurs dessinaient des chiffres, puis une treille avec des berceaux pour prendre le frais, et un jeu de mail qui servait au divertissement des pages. De l’autre côté se trouvaient le chenil, les écuries, la boulangerie, le pressoir et les granges. Un pâturage de gazon vert se développait tout autour, enclos lui-même d’une forte haie d’épines.
On vivait en paix depuis si longtemps que la herse ne s’abaissait plus ; les fossés étaient pleins d’herbe ; des hirondelles faisaient leur nid dans la fente des créneaux ; et l’archer qui tout le long du jour se promenait sur la courtine, dès que le soleil brillait trop fort, rentrait dans l’échauguette, et s’endormait comme un moine.
À l’intérieur, les ferrures partout reluisaient ; des tapisseries dans les chambres protégeaient du froid ; et les armoires regorgeaient de linge, les tonnes de vin s’empilaient dans les celliers, les coffres de chêne craquaient sous le poids des sacs d’argent.
On voyait dans la salle d’armes, entre des étendards et des mufles de bêtes fauves, des armes de tous les temps et de toutes les nations, depuis les frondes des Amalécites et les javelots des Garamantes jusqu’aux braquemarts des Sarrasins et aux cottes de mailles des Normands.
La maîtresse broche de la cuisine pouvait faire tourner un bœuf ; la chapelle était somptueuse comme l’oratoire d’un roi. Il y avait même, dans un endroit écarté, une étuve à la romaine ; mais le bon seigneur s’en privait, estimant que c’est un usage des idolâtres.
Toujours enveloppé d’une pelisse de renard, il se promenait dans sa maison, rendait la justice à ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins. Pendant l’hiver, il regardait les flocons de neige tomber, ou se faisait lire des histoires. Dès les premiers beaux jours, il s’en allait sur sa mule le long des petits chemins, au bord des blés qui verdoyaient, et causait avec les manants, auxquels il donnait des conseils. Après beaucoup d’aventures, il avait pris pour femme une demoiselle de haut lignage.
Elle était très blanche, un peu fière et sérieuse. Les cornes de son hennin frôlaient le linteau des portes ; la queue de sa robe de drap traînait de trois pas derrière elle. Son domestique était réglé comme l’intérieur d’un monastère ; chaque matin elle distribuait la besogne à ses servantes, surveillait les confitures et les onguents, filait à la quenouille ou brodait des nappes d’autel. À force de prier Dieu, il lui vint un fils.
Alors il y eut de grandes réjouissances, et un repas qui dura trois jours et quatre nuits, dans l’illumination des flambeaux, au son des harpes, sur des jonchées de feuillages. On y mangea les plus rares épices, avec des poules grosses comme des moutons ; par divertissement, un nain sortit d’un pâté ; et, les écuelles ne suffisant plus, car la foule augmentait toujours, on fut obligé de boire dans les oliphants et dans les casques.
La nouvelle accouchée n’assista pas à ces fêtes. Elle se tenait dans son lit, tranquillement. Un soir, elle se réveilla, et elle aperçut, sous un rayon de la lune qui entrait par la fenêtre, comme une ombre mouvante. C’était un vieillard en froc de bure, avec un chapelet au côté, une besace sur l’épaule, toute l’apparence d’un ermite. Il s’approcha de son chevet et lui dit, sans desserrer les lèvres :
— Réjouis-toi, ô mère ! ton fils sera un saint !
Elle allait crier ; mais, glissant sur les rais de la lune, il s’éleva dans l’air doucement, puis disparut. Les chants du banquet éclatèrent plus fort. Elle entendit les voix des anges ; et sa tête retomba sur l’oreiller, que dominait un os de martyr dans un cadre d’escarboucles.
Le lendemain, tous les serviteurs interrogés déclarèrent qu’ils n’avaient pas vu d’ermite. Songe ou réalité, cela devait être une communication du ciel ; mais elle eut soin de n’en rien dire, ayant peur qu’on ne l’accusât d’orgueil.
Les convives s’en allèrent au petit jour ; et le père de Julien se trouvait en dehors de la poterne, où il venait de reconduire le dernier, quand tout à coup un mendiant se dressa devant lui, dans le brouillard. C’était un Bohême à barbe tressée, avec des anneaux d’argent aux deux bras et les prunelles flamboyantes. Il bégaya d’un air inspiré ces mots sans suite :
— Ah ! ah ! ton fils !… beaucoup de sang !… beaucoup de gloire !… toujours heureux ! la famille d’un empereur.
Et, se baissant pour ramasser son aumône, il se perdit dans l’herbe, s’évanouit.
Le bon châtelain regarda de droite et de gauche, appela tant qu’il put. Personne. Le vent sifflait, les brumes du matin s’envolaient.
Il attribua cette vision à la fatigue de sa tête pour avoir trop peu dormi.
« Si j’en parle, on se moquera de moi, » se dit-il.
Cependant les splendeurs destinées à son fils l’éblouissaient, bien que la promesse n’en fût pas claire et qu’il doutât même de l’avoir entendue.
Les époux se cachèrent leur secret. Mais tous deux chérissaient l’enfant d’un pareil amour ; et, le respectant comme marqué de Dieu, ils eurent pour sa personne des égards infinis. Sa couchette était rembourrée du plus fin duvet ; une lampe en forme de colombe brûlait dessus, continuellement ; trois nourrices le berçaient ; et, bien serré dans ses langes, la mine rose et les yeux bleus, avec son manteau de brocart et son béguin chargé de perles, il ressemblait à un petit Jésus. Les dents lui poussèrent sans qu’il pleurât une seule fois.
Quand il eut sept ans, sa mère lui apprit à chanter. Pour le rendre courageux, son père le hissa sur un gros cheval. L’enfant souriait d’aise, et ne tarda pas à savoir tout ce qui concerne les destriers.
Un vieux moine très savant lui enseigna l’Écriture sainte, la numération des Arabes, les lettres latines, et à faire sur le vélin des peintures mignonnes. Ils travaillaient ensemble, tout en haut d’une tourelle, à l’écart du bruit.
La leçon terminée, ils descendaient dans le jardin, où, se promenant pas à pas, ils étudiaient les fleurs.
Quelquefois on apercevait, cheminant au fond de la vallée, une file de bêtes de somme, conduites par un piéton, accoutré à l’orientale. Le châtelain, qui l’avait reconnu pour un marchand, expédiait vers lui un valet. L’étranger, prenant confiance, se détournait de sa route ; et, introduit dans le parloir, il retirait de ses coffres des pièces de velours et de soie, des orfèvreries, des aromates, des choses singulières d’un usage inconnu ; à la fin le bonhomme s’en allait, avec un gros profit, sans avoir enduré aucune violence. D’autres fois, une troupe de pèlerins frappait à la porte. Leurs habits mouillés fumaient devant l’âtre ; et, quand ils étaient repus, ils racontaient leurs voyages : les erreurs des nefs sur la mer écumeuse, les marches à pied dans les sables brûlants, la férocité des païens, les cavernes de la Syrie, la Crèche et le Sépulcre. Puis ils donnaient au jeune seigneur des coquilles de leur manteau.
Souvent le châtelain festoyait ses vieux compagnons d’armes. Tout en buvant, ils se rappelaient leurs guerres, les assauts des forteresses avec le battement des machines et les prodigieuses blessures. Julien, qui les écoutait, en poussait des cris ; alors son père ne doutait pas qu’il ne fût plus tard un conquérant. Mais le soir, au sortir de l’Angélus, quand il passait entre les pauvres inclinés, il puisait dans son escarcelle avec tant de modestie et d’un air si noble, que sa mère comptait bien le voir par la suite archevêque.
Sa place dans la chapelle était aux côtés de ses parents ; et, si longs que fussent les offices, il restait à genoux sur son prie-Dieu, la toque par terre et les mains jointes.
Un jour, pendant la messe, il aperçut, en relevant la tête, une petite souris blanche qui sortait d’un trou, dans la muraille. Elle trottina sur la première marche de l’autel, et, après deux ou trois tours de droite et de gauche, s’enfuit du même côté. Le dimanche suivant, l’idée qu’il pourrait la revoir le troubla. Elle revint ; et, chaque dimanche il l’attendait, en était importuné, fut pris de haine contre elle, et résolut de s’en défaire.
Ayant donc fermé la porte, et semé sur les marches les miettes d’un gâteau, il se posta devant le trou, une baguette à la main.
Au bout de très longtemps un museau rose parut, puis la souris tout entière. Il frappa un coup léger, et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus. Une goutte de sang tachait la dalle. Il l’essuya bien vite avec sa manche, jeta la souris dehors, et n’en dit rien à personne.
Toutes sortes d’oisillons picoraient les graines du jardin. Il imagina de mettre des pois dans un roseau creux. Quand il entendait gazouiller dans un arbre, il en approchait avec douceur, puis levait son tube, enflait ses joues ; et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules si abondamment qu’il ne pouvait s’empêcher de rire, heureux de sa malice.
Un matin, comme il s’en retournait par la courtine, il vit sur la crête du rempart un gros pigeon qui se rengorgeait au soleil. Julien s’arrêta pour le regarder ; le mur en cet endroit ayant une brèche, un éclat de pierre se rencontra sous ses doigts. Il tourna son bras, et la pierre abattit l’oiseau qui tomba d’un bloc dans un fossé.
Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, furetant partout, plus leste qu’un jeune chien.
Le pigeon, les ailes cassées, palpitait, suspendu dans les branches d’un troène.
La persistance de sa vie irrita l’enfant. Il se mit à l’étrangler ; et les convulsions de l’oiseau faisaient battre son cœur, l’emplissaient d’une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier roidissement, il se sentit défaillir.
Le soir, pendant le souper, son père déclara que l’on devait à son âge apprendre la vénerie ; et il alla chercher un vieux cahier d’écriture contenant, par demandes et réponses, tout le déduit des chasses. Un maître y démontrait à son élève l’art de dresser les chiens et d’affaiter les faucons, de tendre les pièges, comment reconnaître le cerf à ses fumées, le renard à ses empreintes, le loup à ses déchaussures, le bon moyen de discerner leurs voies, de quelle manière on les lance, où se trouvent ordinairement leurs refuges, quels sont les vents les plus propices, avec l’énumération des cris et les règles de la curée.
Quand Julien put réciter par cœur toutes ces choses, son père lui composa une meute.
D’abord on y distinguait vingt-quatre lévriers barbaresques, plus véloces que des gazelles, mais sujets à s’emporter ; puis dix-sept couples de chiens bretons, tiquetés de blanc sur fond rouge, inébranlables dans leur créance, forts de poitrine et grands hurleurs. Pour l’attaque du sanglier et les refuites périlleuses, il y avait quarante griffons, poilus comme des ours. Des mâtins de Tartarie, presque aussi hauts que des ânes, couleur de feu, l’échine large et le jarret droit, étaient destinés à poursuivre les aurochs. La robe noire des épagneuls luisait comme du satin ; le jappement des talbots valait celui des bigles chanteurs. Dans une cour à part, grondaient, en secouant leur chaîne et roulant leurs prunelles, huit dogues alains, bêtes formidables qui sautent au ventre des cavaliers et n’ont pas peur des lions.
Tous mangeaient du pain de froment, buvaient dans des auges de pierre, et portaient un nom sonore.
La fauconnerie, peut-être, dépassait la meute ; le bon seigneur, à force d’argent, s’était procuré des tiercelets du Caucase, des sacres de Babylone, des gerfauts d’Allemagne, et des faucons pèlerins, capturés sur les falaises, au bord des mers froides, en de lointains pays. Ils logeaient dans un hangar couvert de chaume, et, attachés par rang de taille sur le perchoir, avaient devant eux une motte de gazon, où de temps à autre on les posait afin de les dégourdir.
Des bourses, des hameçons, des chausse-trapes, toute sorte d’engins, furent confectionnés.
Souvent on menait dans la campagne des chiens d’oysel, qui tombaient bien vite en arrêt. Alors les piqueurs, s’avançant pas à pas, étendaient avec précaution sur leurs corps impassibles un immense filet. Un commandement les faisait aboyer ; des cailles s’envolaient ; et les dames des alentours conviées avec leurs maris, les enfants, les camérières, tout le monde se jetait dessus, et les prenait facilement.
D’autres fois, pour débucher les lièvres, on battait du tambour ; des renards tombaient dans des fosses, ou bien un ressort, se débandant, attrapait un loup par le pied.
Mais Julien méprisa ces commodes artifices ; il préférait chasser loin du monde, avec son cheval et son faucon. C’était presque toujours un grand tartaret de Scythie, blanc comme la neige. Son capuchon de cuir était surmonté d’un panache, des grelots d’or tremblaient à ses pieds bleus ; et il se tenait ferme sur le bras de son maître pendant que le cheval galopait, et que les plaines se déroulaient. Julien, dénouant ses longes, le lâchait tout à coup ; la bête hardie montait droit dans l’air comme une flèche ; et l’on voyait deux taches inégales tourner, se joindre, puis disparaître dans les hauteurs de l’azur. Le faucon ne tardait pas à descendre en déchirant quelque oiseau, et revenait se poser sur le gantelet, les deux ailes frémissantes.
Julien vola de cette manière le héron, le milan, la corneille et le vautour.
Il aimait, en sonnant de la trompe, à suivre ses chiens qui couraient sur le versant des collines, sautaient les ruisseaux, remontaient vers le bois ; et, quand le cerf commençait à gémir sous les morsures, il l’abattait prestement, puis se délectait à la furie des mâtins qui le dévoraient, coupé en pièces sur sa peau fumante.
Les jours de brume, il s’enfonçait dans un marais pour guetter les oies, les loutres et les halbrans.
Trois écuyers, dès l’aube, l’attendaient au bas du perron ; et le vieux moine, se penchant à sa lucarne, avait beau faire des signes pour le rappeler, Julien ne se retournait pas. Il allait à l’ardeur du soleil, sous la pluie, par la tempête, buvait l’eau des sources dans sa main, mangeait en trottant des pommes sauvages, s’il était fatigué se reposait sous un chêne ; et il rentrait au milieu de la nuit, couvert de sang et de boue, avec des épines dans les cheveux et sentant l’odeur des bêtes farouches. Il devint comme elles. Quand sa mère l’embrassait, il acceptait froidement son étreinte, paraissant rêver à des choses profondes.
Il tua des ours à coups de couteau, des taureaux avec la hache ; des sangliers avec l’épieu ; et même une fois, n’ayant plus qu’un bâton, se défendit contre des loups qui rongeaient des cadavres au pied d’un gibet.
Un matin d’hiver, il partit avant le jour, bien équipé, une arbalète sur l’épaule et un trousseau de flèches à l’arçon de la selle.
Son genet danois, suivi de deux bassets, en marchant d’un pas égal faisait résonner la terre. Des gouttes de verglas se collaient à son manteau, une brise violente soufflait. Un côté de l’horizon s’éclaircit ; et, dans la blancheur du crépuscule, il aperçut des lapins sautillant au bord de leurs terriers. Les deux bassets, tout de suite, se précipitèrent sur eux ; et, çà et là, vivement, leur brisaient l’échine.
Bientôt, il entra dans un bois. Au bout d’une branche, un coq de bruyère engourdi par le froid dormait la tête sous l’aile. Julien, d’un revers d’épée, lui faucha les deux pattes, et sans le ramasser continua sa route.
Trois heures après, il se trouva sur la pointe d’une montagne tellement haute que le ciel semblait presque noir. Devant lui, un rocher pareil à un long mur s’abaissait, en surplombant un précipice ; et, à l’extrémité, deux boucs sauvages regardaient l’abîme. Comme il n’avait pas ses flèches (car son cheval était resté en arrière), il imagina de descendre jusqu’à eux ; à demi courbé, pieds nus, il arriva enfin au premier des boucs, et lui enfonça un poignard sous les côtes. Le second, pris de terreur, sauta dans le vide. Julien s’élança pour le frapper, et, glissant du pied droit, tomba sur le cadavre de l’autre, la face au-dessus de l’abîme et les deux bras écartés.
Redescendu dans la plaine, il suivit des saules qui bordaient une rivière. Des grues, volant très bas, de temps à autre, passaient au-dessus de sa tête. Julien les assommait avec son fouet, et n’en manqua pas une.
Cependant l’air plus tiède avait fondu le givre, de larges vapeurs flottaient, et le soleil se montra. Il vit reluire tout au loin un lac figé, qui ressemblait à du plomb. Au milieu du lac, il y avait une bête que Julien ne connaissait pas, un castor à museau noir. Malgré la distance, une flèche l’abattit ; et il fut chagrin de ne pouvoir emporter la peau.
Puis il s’avança dans une avenue de grands arbres, formant avec leurs cimes comme un arc de triomphe, à l’entrée d’une forêt. Un chevreuil bondit hors d’un fourré, un daim parut dans un carrefour, un blaireau sortit d’un trou, un paon sur le gazon déploya sa queue ; — et quand il les eut tous occis, d’autres chevreuils se présentèrent, d’autres daims, d’autres blaireaux, d’autres paons, et des merles, des geais, des putois, des renards, des hérissons, des lynx, une infinité de bêtes, à chaque pas plus nombreuses. Elles tournaient autour de lui, tremblantes, avec un regard plein de douceur et de supplication. Mais Julien ne se fatiguait pas de tuer, tour à tour bandant son arbalète, dégainant l’épée, pointant du coutelas, et ne pensait à rien, n’avait souvenir de quoi que ce fût. Il était en chasse dans un pays quelconque, depuis un temps indéterminé, par le fait seul de sa propre existence, tout s’accomplissant avec la facilité que l’on éprouve dans les rêves. Un spectacle extraordinaire l’arrêta. Des cerfs emplissaient un vallon ayant la forme d’un cirque ; et tassés, les uns près des autres, ils se réchauffaient avec leurs haleines que l’on voyait fumer dans le brouillard.
L’espoir d’un pareil carnage, pendant quelques minutes, le suffoqua de plaisir. Puis il descendit de cheval, retroussa ses manches, et se mit à tirer.
Au sifflement de la première flèche, tous les cerfs à la fois tournèrent la tête. Il se fit des enfonçures dans leur masse ; des voix plaintives s’élevaient, et un grand mouvement agita le troupeau.
Le rebord du vallon était trop haut pour le franchir. Ils bondissaient dans l’enceinte, cherchant à s’échapper. Julien visait, tirait ; et les flèches tombaient comme les rayons d’une pluie d’orage. Les cerfs rendus furieux se battirent, se cabraient, montaient les uns par-dessus les autres ; et leurs corps avec leurs ramures emmêlées faisaient un large monticule, qui s’écroulait, en se déplaçant.
Enfin ils moururent, couchés sur le sable, la bave aux naseaux, les entrailles sorties, et l’ondulation de leurs ventres s’abaissant par degrés. Puis tout fut immobile.
La nuit allait venir ; et derrière le bois, dans les intervalles des branches, le ciel était rouge comme une nappe de sang.
Julien s’adossa contre un arbre. Il contemplait d’un œil béant l’énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire.
De l’autre côté du vallon, sur le bord de la forêt, il aperçut un cerf, une biche et son faon.
Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait seize andouillers avec une barbe blanche. La biche, blonde comme les feuilles mortes, broutait le gazon ; et le faon tacheté, sans l’interrompre dans sa marche, lui tétait la mamelle.
L’arbalète encore une fois ronfla. Le faon, tout de suite, fut tué. Alors sa mère, en regardant le ciel, brama d’une voix profonde, déchirante, humaine. Julien exaspéré, d’un coup en plein poitrail, l’étendit par terre.
Le grand cerf l’avait vu, fit un bond. Julien lui envoya sa dernière flèche. Elle l’atteignit au front, et y resta plantée.
Le grand cerf n’eut pas l’air de la sentir ; en enjambant par-dessus les morts, il avançait toujours, allait fondre sur lui, l’éventrer ; et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal s’arrêta ; et les yeux flamboyants, solennel comme un patriarche et comme un justicier, pendant qu’une cloche au loin tintait, il répéta trois fois :
— Maudit ! maudit ! maudit ! Un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère !
Il plia les genoux, ferma doucement ses paupières, et mourut.
Julien fut stupéfait, puis accablé d’une fatigue soudaine ; et un dégoût, une tristesse immense l’envahit. Le front dans les deux mains, il pleura pendant longtemps.
Son cheval était perdu ; ses chiens l’avaient abandonné ; la solitude qui l’enveloppait lui sembla toute menaçante de périls indéfinis. Alors, poussé par un effroi, il prit sa course à travers la campagne, choisit au hasard un sentier, et se trouva presque immédiatement à la porte du château.
La nuit, il ne dormit pas. Sous le vacillement de la lampe suspendue, il revoyait toujours le grand cerf noir. Sa prédiction l’obsédait ; il se débattait contre elle :
— Non ! non ! non ! je ne peux pas les tuer !
Puis il songeait :
— Si je le voulais, pourtant ?…
Et il avait peur que le Diable ne lui en inspirât l’envie.
Durant trois mois, sa mère en angoisse pria au chevet de son lit, et son père, en gémissant, marchait continuellement dans les couloirs. Il manda les maîtres mires les plus fameux, lesquels ordonnèrent des quantités de drogues. Le mal de Julien, disaient-ils, avait pour cause un vent funeste, ou un désir d’amour. Mais le jeune homme, à toutes les questions, secouait la tête.
Les forces lui revinrent ; et on le promenait dans la cour, le vieux moine et le bon seigneur le soutenant chacun par un bras. Quand il fut rétabli complètement, il s’obstina à ne point chasser.
Son père, le voulant réjouir, lui fit cadeau d’une grande épée sarrasine.
Elle était au haut d’un pilier, dans une panoplie. Pour l’atteindre, il fallut une échelle. Julien y monta. L’épée trop lourde lui échappa des doigts, et en tombant frôla le bon seigneur de si près que sa houppelande en fut coupée ; Julien crut avoir tué son père, et s’évanouit.
Dès lors, il redouta les armes. L’aspect d’un fer nu le faisait pâlir. Cette faiblesse était une désolation pour sa famille.
Enfin le vieux moine, au nom de Dieu, de l’honneur et des ancêtres, lui commanda de reprendre ses exercices de gentilhomme.
Les écuyers, tous les jours, s’amusaient au maniement de la javeline. Julien y excella bien vite. Il envoyait la sienne dans le goulot des bouteilles, cassait les dents des girouettes, frappait à cent pas les clous des portes.
Un soir d’été, à l’heure où la brume rend les choses indistinctes, étant sous la treille du jardin, il aperçut tout au fond deux ailes blanches qui voletaient à la hauteur de l’espalier. Il ne douta pas que ce ne fût une cigogne ; et il lança son javelot.
Un cri déchirant partit.
C’était sa mère, dont le bonnet à longues barbes restait cloué contre le mur.
Julien s’enfuit du château, et ne reparut plus.
II
l s’engagea dans une troupe d’aventuriers qui passaient.
Il connut la faim, la soif, les fièvres et la vermine. Il s’accoutuma au fracas des mêlées, à l’aspect des moribonds. Le vent tanna sa peau. Ses membres se durcirent par le contact des armures ; et comme il était très fort, courageux, tempérant, avisé, il obtint sans peine le commandement d’une compagnie.
Au début des batailles, il enlevait ses soldats d’un grand geste de son épée. Avec une corde à nœuds, il grimpait aux murs des citadelles, la nuit, balancé par l’ouragan, pendant que les flammèches du feu grégeois se collaient à sa cuirasse, et que la résine bouillante et le plomb fondu ruisselaient des créneaux. Souvent le heurt d’une pierre fracassa son bouclier. Des ponts trop chargés d’hommes croulèrent sous lui. En tournant sa masse d’armes, il se débarrassa de quatorze cavaliers. Il défit, en champ clos, tous ceux qui se proposèrent. Plus de vingt fois, on le crut mort.
Grâce à la faveur divine, il en réchappa toujours ; car il protégeait les gens d’église, les orphelins, les veuves, et principalement les vieillards. Quand il en voyait un marchant devant lui, il criait pour connaître sa figure, comme s’il avait eu peur de le tuer par méprise.
Des esclaves en fuite, des manants révoltés, des bâtards sans fortune, toutes sortes d’intrépides affluèrent sous son drapeau, et il se composa une armée.
Elle grossit. Il devint fameux. On le recherchait.
Tour à tour, il secourut le dauphin de France et le roi d’Angleterre, les templiers de Jérusalem, le suréna des Parthes, le négud d’Abyssinie et l’empereur de Calicut. Il combattit des Scandinaves recouverts d’écailles de poisson, des Nègres munis de rondaches en cuir d’hippopotame et montés sur des ânes rouges, des Indiens couleur d’or et brandissant par-dessus leurs diadèmes de larges sabres, plus clairs que des miroirs. Il vainquit les Troglodytes et les Anthropophages. Il traversa des régions si torrides que sous l’ardeur du soleil les chevelures s’allumaient d’elles-mêmes comme des flambeaux ; et d’autres qui étaient si glaciales que les bras, se détachant du corps, tombaient par terre ; et des pays où il y avait tant de brouillards que l’on marchait environné de fantômes.
Des républiques en embarras le consultèrent. Aux entrevues d’ambassadeurs, il obtenait des conditions inespérées. Si un monarque se conduisait trop mal, il arrivait tout à coup et lui faisait des remontrances. Il affranchit des peuples. Il délivra des reines enfermées dans des tours. C’est lui, et pas un autre, qui assomma la guivre de Milan et le dragon d’Oberbirbach.
Or l’empereur d’Occitanie, ayant triomphé des Musulmans espagnols, s’était joint par concubinage à la sœur du calife de Cordoue ; et il en conservait une fille, qu’il avait élevée chrétiennement. Mais le calife, faisant mine de vouloir se convertir, vint lui rendre visite, accompagné d’une escorte nombreuse, massacra toute sa garnison, et le plongea dans un cul de basse-fosse, où il le traitait durement, afin d’en extirper des trésors.
Julien accourut à son aide, détruisit l’armée des infidèles, assiégea la ville, tua le calife, coupa sa tête, et la jeta comme une boule par-dessus les remparts. Puis il tira l’empereur de sa prison, et le fit remonter sur son trône, en présence de toute sa cour.
L’empereur, pour prix d’un tel service, lui présenta dans des corbeilles beaucoup d’argent ; Julien n’en voulut pas. Croyant qu’il en désirait davantage, il lui offrit les trois quarts de ses richesses ; nouveau refus ; puis de partager son royaume ; Julien le remercia. Et l’empereur en pleurait de dépit, ne sachant de quelle manière témoigner sa reconnaissance, quand il se frappa le front, dit un mot à l’oreille d’un courtisan ; les rideaux d’une tapisserie se relevèrent, et une jeune fille parut.
Ses grands yeux noirs brillaient comme deux lampes très douces. Un sourire charmant écartait ses lèvres. Les anneaux de sa chevelure s’accrochaient aux pierreries de sa robe entrouverte ; et, sous la transparence de sa tunique, on devinait la jeunesse de son corps. Elle était toute mignonne et potelée, avec la taille fine.
Julien fut ébloui d’amour, d’autant plus qu’il avait mené jusqu’alors une vie très chaste.
Donc il reçut en mariage la fille de l’empereur, avec un château qu’elle tenait de sa mère ; et, les noces étant terminées, on se quitta, après des politesses infinies de part et d’autre.
C’était un palais de marbre blanc, bâti à la moresque, sur un promontoire, dans un bois d’orangers. Des terrasses de fleurs descendaient jusqu’au bord d’un golfe, où des coquilles roses craquaient sous les pas. Derrière le château, s’étendait une forêt ayant le dessin d’un éventail. Le ciel continuellement était bleu, et les arbres se penchaient tour à tour sous la brise de la mer et le vent des montagnes, qui fermaient au loin l’horizon.
Les chambres, pleines de crépuscule, se trouvaient éclairées par les incrustations des murailles. De hautes colonnettes, minces comme des roseaux, supportaient la voûte des coupoles, décorées de reliefs imitant les stalactites des grottes.
Il y avait des jets d’eau dans les salles, des mosaïques dans les cours, des cloisons festonnées, mille délicatesses d’architecture, et partout un tel silence que l’on entendait le frôlement d’une écharpe ou l’écho d’un soupir.
Julien ne faisait plus la guerre. Il se reposait, entouré d’un peuple tranquille ; et chaque jour, une foule passait devant lui, avec des génuflexions et des baise-mains à l’orientale.
Vêtu de pourpre, il restait accoudé dans l’embrasure d’une fenêtre, en se rappelant ses chasses d’autrefois ; et il aurait voulu courir sur le désert après les gazelles et les autruches, être caché dans les bambous à l’affût des léopards, traverser des forêts pleines de rhinocéros, atteindre au sommet des monts les plus inaccessibles pour viser mieux les aigles, et sur les glaçons de la mer combattre les ours blancs.
Quelquefois, dans un rêve, il se voyait comme notre père Adam au milieu du paradis, entre toutes les bêtes ; en allongeant le bras, il les faisait mourir ; ou bien, elles défilaient, deux à deux, par rang de taille, depuis les éléphants et les lions jusqu’aux hermines et aux canards, comme le jour qu’elles entrèrent dans l’arche de Noé. À l’ombre d’une caverne, il dardait sur elles des javelots infaillibles ; il en survenait d’autres ; cela n’en finissait pas ; et il se réveillait en roulant des yeux farouches.
Des princes de ses amis l’invitèrent à chasser. Il s’y refusa toujours, croyant, par cette sorte de pénitence, détourner son malheur ; car il lui semblait que du meurtre des animaux dépendait le sort de ses parents. Mais il souffrait de ne pas les voir, et son autre envie devenait insupportable.
Sa femme, pour le récréer, fit venir des jongleurs et des danseuses.
Elle se promenait avec lui, en litière ouverte, dans la campagne ; d’autres fois, étendus sur le bord d’une chaloupe, ils regardaient les poissons vagabonder dans l’eau, claire comme le ciel. Souvent elle lui jetait des fleurs au visage ; accroupie devant ses pieds, elle tirait des airs d’une mandoline à trois cordes ; puis, lui posant sur l’épaule ses deux mains jointes, disait d’une voix timide :
— Qu’avez-vous donc, cher seigneur ?
Il ne répondait pas, ou éclatait en sanglots ; enfin, un jour, il avoua son horrible pensée.
Elle la combattit en raisonnant très bien ; son père et sa mère, probablement, étaient morts ; si jamais il les revoyait, par quel hasard, dans quel but, arriverait-il à cette abomination ? Donc, sa crainte n’avait pas de cause, et il devait se remettre à chasser.
Julien souriait en l’écoutant, mais ne se décidait pas à satisfaire son désir.
Un soir du mois d’août qu’ils étaient dans leur chambre, elle venait de se coucher et il s’agenouillait pour sa prière quand il entendit le jappement d’un renard, puis des pas légers sous la fenêtre ; et il entrevit dans l’ombre comme des apparences d’animaux. La tentation était trop forte. Il décrocha son carquois.
Elle parut surprise.
— C’est pour t’obéir ! dit-il, au lever du soleil, je serai revenu.
Cependant elle redoutait une aventure funeste.
Il la rassura, puis sortit, étonné de l’inconséquence de son humeur.
Peu de temps après, un page vint annoncer que deux inconnus, à défaut du seigneur absent, réclamaient tout de suite la seigneuresse.
Et bientôt entrèrent dans la chambre un vieil homme et une vieille femme, courbés, poudreux, en habits de toile, et s’appuyant sur un bâton.
Ils s’enhardirent et déclarèrent qu’ils apportaient à Julien des nouvelles de ses parents.
Elle se pencha pour les entendre.
Mais, s’étant concertés du regard, ils lui demandèrent s’il les aimait toujours, s’il parlait d’eux quelquefois.
— Oh ! oui ! dit-elle.
Alors, ils s’écrièrent :
— Eh bien ! c’est nous !
Et ils s’assirent, étant fort las et recrus de fatigue.
Rien n’assurait à la jeune femme que son époux fût leur fils.
Ils en donnèrent la preuve, en décrivant des signes particuliers qu’il avait sur la peau.
Elle sauta hors sa couche, appela son page, et on leur servit un repas.
Bien qu’ils eussent grand’faim, ils ne pouvaient guère manger ; et elle observait à l’écart le tremblement de leurs mains osseuses, en prenant les gobelets.
Ils firent mille questions sur Julien. Elle répondait à chacune, mais eut soin de taire l’idée funèbre qui les concernait.
Ne le voyant pas revenir, ils étaient partis de leur château ; et ils marchaient depuis plusieurs années, sur de vagues indications, sans perdre l’espoir. Il avait fallu tant d’argent au péage des fleuves et dans les hôtelleries, pour les droits des princes et les exigences des voleurs, que le fond de leur bourse était vide, et qu’ils mendiaient, maintenant. Qu’importe, puisque bientôt, ils embrasseraient leur fils ? Ils exaltaient son bonheur d’avoir une femme aussi gentille, et ne se lassaient point de la contempler et de la baiser.
La richesse de l’appartement les étonnait beaucoup ; et le vieux, ayant examiné les murs, demanda pourquoi s’y trouvait le blason de l’empereur d’Occitanie.
Elle répliqua :
— C’est mon père !
Alors il tressaillit, se rappelant la prédiction du Bohême ; et la vieille songeait à la parole de l’Ermite. Sans doute la gloire de son fils n’était que l’aurore des splendeurs éternelles ; et tous les deux restaient béants, sous la lumière du candélabre qui éclairait la table.
Ils avaient dû être très beaux dans leur jeunesse. La mère avait encore tous ses cheveux, dont les bandeaux fins, pareils à des plaques de neige, pendaient jusqu’au bas de ses joues ; et le père, avec sa taille haute et sa grande barbe, ressemblait à une statue d’église.
La femme de Julien les engagea à ne pas l’attendre. Elle les coucha elle-même dans son lit, puis ferma la croisée ; ils s’endormirent. Le jour allait paraître, et, derrière le vitrail, les petits oiseaux commençaient à chanter.
Julien avait traversé le parc ; et il marchait dans la forêt d’un pas nerveux, jouissant de la mollesse du gazon et de la douceur de l’air.
Les ombres des arbres s’étendaient sur la mousse. Quelquefois la lune faisait des taches blanches dans les clairières, et il hésitait à s’avancer, croyant apercevoir une flaque d’eau, ou bien la surface des mares tranquilles se confondait avec la couleur de l’herbe. C’était partout un grand silence ; et il ne découvrait aucune des bêtes qui, peu de minutes auparavant, erraient à l’entour de son château.
Le bois s’épaissit, l’obscurité devint profonde. Des bouffées de vent chaud passaient, pleines de senteurs amollissantes. Il enfonçait dans des tas de feuilles mortes, et il s’appuya contre un chêne pour haleter un peu.
Tout à coup, derrière son dos, bondit une masse plus noire, un sanglier. Julien n’eut pas le temps de saisir son arc, et il s’en affligea comme d’un malheur.
Puis, étant sorti du bois, il aperçut un loup qui filait le long d’une haie.
Julien lui envoya une flèche. Le loup s’arrêta, tourna la tête pour le voir et reprit sa course. Il trottait en gardant toujours la même distance, s’arrêtait de temps à autre, et, sitôt qu’il était visé, recommençait à fuir.
Julien parcourut de cette manière une plaine interminable, puis des monticules de sable, et enfin, il se trouva sur un plateau dominant un grand espace de pays. Des pierres plates étaient clairsemées entre des caveaux en ruine. On trébuchait sur des ossements de morts ; de place en place, des croix vermoulues se penchaient d’un air lamentable. Mais des formes remuèrent dans l’ombre indécise des tombeaux ; et il en surgit des hyènes, tout effarées, pantelantes. En faisant claquer leurs ongles sur les dalles, elles vinrent à lui et le flairaient avec un bâillement qui découvrait leurs gencives. Il dégaina son sabre. Elles partirent à la fois dans toutes les directions, et, continuant leur galop boiteux et précipité, se perdirent au loin sous un flot de poussière.
Une heure après, il rencontra dans un ravin un taureau furieux, les cornes en avant, et qui grattait le sable avec son pied. Julien lui pointa sa lance sous les fanons. Elle éclata, comme si l’animal eût été de bronze ; il ferma les yeux, attendant sa mort. Quand il les rouvrit, le taureau avait disparu.
Alors son âme s’affaissa de honte. Un pouvoir supérieur détruisait sa force ; et pour s’en retourner chez lui, il rentra dans la forêt.
Elle était embarrassée de lianes ; et il les coupait, avec son sabre quand une fouine glissa brusquement entre ses jambes, une panthère fit un bond par-dessus son épaule, un serpent monta en spirale autour d’un frêne.
Il y avait dans son feuillage un choucas monstrueux, qui regardait Julien ; et, çà et là, parurent entre les branches quantités de larges étincelles, comme si le firmament eût fait pleuvoir dans la forêt toutes ses étoiles. C’étaient des yeux d’animaux, des chats sauvages, des écureuils, des hiboux, des perroquets, des singes.
Julien darda contre eux ses flèches ; les flèches, avec leurs plumes, se posaient sur les feuilles comme des papillons blancs. Il leur jeta des pierres ; les pierres, sans rien toucher, retombaient. Il se maudit, aurait voulu se battre, hurla des imprécations, étouffait de rage.
Et tous les animaux qu’il avait poursuivis se représentèrent, faisant autour de lui un cercle étroit. Les uns étaient assis sur leur croupe, les autres dressés de toute leur taille. Il restait au milieu, glacé de terreur, incapable du moindre mouvement. Par un effort suprême de sa volonté il fit un pas ; ceux qui perchaient sur les arbres ouvrirent leurs ailes, ceux qui foulaient le sol déplacèrent leurs membres ; et tous l’accompagnaient.
Les hyènes marchaient devant lui, le loup et le sanglier par-derrière. Le taureau, à sa droite, balançait la tête ; et, à sa gauche, le serpent ondulait dans les herbes, tandis que la panthère, bombant son dos, avançait à pas de velours et à grandes enjambées. Il allait le plus lentement possible pour ne pas les irriter ; et il voyait sortir de la profondeur des buissons des porcs-épics, des renards, des vipères, des chacals et des ours.
Julien se mit à courir ; ils coururent. Le serpent sifflait, les bêtes puantes bavaient. Le sanglier lui frottait les talons avec ses défenses, le loup, l’intérieur des mains avec les poils de son museau. Les singes le pinçaient en grimaçant, la fouine se roulait sur ses pieds. Un ours, d’un revers de patte, lui enleva son chapeau ; et la panthère, dédaigneusement, laissa tomber une flèche qu’elle portait à sa gueule.
Une ironie perçait dans leurs allures sournoises. Tout en l’observant du coin de leurs prunelles, ils semblaient méditer un plan de vengeance ; et, assourdi par le bourdonnement des insectes, battu par des queues d’oiseau, suffoqué par des haleines, il marchait les bras tendus et les paupières closes comme un aveugle, sans même avoir la force de crier « grâce ! »
Le chant d’un coq vibra dans l’air. D’autres y répondirent ; c’était le jour ; et il reconnut, au-delà des orangers, le faîte de son palais.
Puis, au bord d’un champ, il vit, à trois pas d’intervalle, des perdrix rouges qui voletaient dans les chaumes. Il dégrafa son manteau, et l’abattit sur elles comme un filet. Quand il les eut découvertes, il n’en trouva qu’une seule, et morte depuis longtemps, pourrie.
Cette déception l’exaspéra plus que toutes les autres. Sa soif de carnage le reprenait ; les bêtes manquant, il aurait voulu massacrer des hommes.
Il gravit les trois terrasses, enfonça la porte d’un coup de poing ; mais, au bas de l’escalier, le souvenir de sa chère femme détendit son cœur. Elle dormait sans doute, et il allait la surprendre.
Ayant retiré ses sandales, il tourna doucement la serrure, et entra.
Les vitraux garnis de plomb obscurcissaient la pâleur de l’aube. Julien se prit les pieds dans des vêtements, par terre ; un peu plus loin, il heurta une crédence encore chargée de vaisselle. « Sans doute, elle aura mangé », se dit-il ; et il avançait vers le lit, perdu dans les ténèbres, au fond de la chambre. Quand il fut au bord, afin d’embrasser sa femme, il se pencha sur l’oreiller où les deux têtes reposaient l’une près de l’autre. Alors, il sentit contre sa bouche l’impression d’une barbe.
Il se recula, croyant devenir fou ; mais il revint près du lit, et ses doigts, en palpant, rencontrèrent des cheveux, qui étaient très longs. Pour se convaincre de son erreur, il repassa lentement sa main sur l’oreiller. C’était bien une barbe, cette fois, et un homme ! un homme couché avec sa femme !
Éclatant d’une colère démesurée, il bondit sur eux, à coups de poignard ; et il trépignait, écumait, avec des hurlements de bête fauve. Puis il s’arrêta. Les morts, percés au cœur, n’avaient pas même bougé. Il écoutait attentivement leurs deux râles presque égaux, et, à mesure qu’ils s’affaiblissaient, un autre, tout au loin, les continuait. Incertaine d’abord, cette voix plaintive, longuement poussée, se rapprochait, s’enfla, devint cruelle, et il reconnut, terrifié, le bramement du grand cerf noir.
Et comme il se retournait, il crut voir, dans l’encadrure de la porte, le fantôme de sa femme, une lumière à la main.
Le tapage du meurtre l’avait attirée. D’un large coup d’œil, elle comprit tout, et s’enfuyant d’horreur laissa tomber son flambeau.
Il le ramassa.
Son père et sa mère étaient devant lui, étendus sur le dos, avec un trou dans la poitrine ; et leurs visages, d’une majestueuse douceur, avaient l’air de garder comme un secret éternel. Des éclaboussures et des flaques de sang s’étalaient au milieu de leur peau blanche, sur les draps du lit, par terre, le long d’un Christ d’ivoire suspendu dans l’alcôve. Le reflet écarlate du vitrail, alors frappé par le soleil, éclairait ces taches rouges, et en jetait de plus nombreuses dans tout l’appartement. Julien marcha vers les deux morts en se disant, en voulant croire que cela n’était pas possible, qu’il s’était trompé, qu’il y a parfois des ressemblances inexplicables. Enfin, il se baissa légèrement pour voir de tout près le vieillard ; et il aperçut, entre ses paupières mal fermées, une prunelle éteinte, qui le brûla comme du feu. Puis il se porta de l’autre côté de la couche, occupé par l’autre corps, dont les cheveux blancs masquaient une partie de la figure. Julien lui passa les doigts sous ses bandeaux, leva sa tête ; — et il la regardait, en la tenant au bout de son bras roidi, pendant que de l’autre main, il s’éclairait avec le flambeau. Des gouttes, suintant du matelas, tombaient une à une sur le plancher.
À la fin du jour, il se présenta devant sa femme ; et, d’une voix différente de la sienne, il lui commande premièrement de ne pas lui répondre, de ne pas l’approcher, de ne plus même le regarder, et qu’elle eût à suivre, sous peine de damnation, tous ses ordres qui étaient irrévocables.
Les funérailles seraient faites selon les instructions qu’il avait laissées par écrit, sur un prie-Dieu, dans la chambre des morts. Il lui abandonnait son palais, ses vassaux, tous ses biens, sans même retenir les vêtements de son corps, et ses sandales, que l’on trouverait au haut de l’escalier.
Elle avait obéi à la volonté de Dieu, en occasionnant son crime, et devait prier pour son âme, puisque désormais il n’existait plus.
On enterra les morts avec magnificence, dans l’église d’un monastère à trois journées du château. Un moine en cagoule rabattue suivit le cortège, loin de tous les autres, sans que personne osât lui parler.
Il resta, pendant la messe, à plat ventre au milieu du portail, les bras en croix, et le front dans la poussière.
Après l’ensevelissement, on le vit prendre le chemin qui menait aux montagnes. Il se retourna plusieurs fois et finit par disparaître.
III
l s’en alla, mendiant sa vie par le monde.
Il tendait sa main aux cavaliers sur les routes, avec des génuflexions s’approchait des moissonneurs, ou restait immobile devant la barrière des cours ; et son visage était si triste que jamais on ne lui refusait l’aumône.
Par esprit d’humilité, il racontait son histoire ; alors tous s’enfuyaient, en faisant des signes de croix. Dans les villages où il avait déjà passé, sitôt qu’il était reconnu, on fermait les portes, on lui criait des menaces, on lui jetait des pierres. Les plus charitables posaient une écuelle sur le bord de leur fenêtre, puis fermaient l’auvent pour ne pas l’apercevoir.
Repoussé de partout, il évita les hommes ; et il se nourrit de racines, de plantes, de fruits perdus, et de coquillages qu’il cherchait le long des grèves.
Quelquefois, au tournant d’une côte, il voyait sous ses yeux une confusion de toits pressés, avec des flèches de pierre, des points, des tours, des rues noires s’entrecroisant, et d’où montait jusqu’à lui un bourdonnement continuel.
Le besoin de se mêler à l’existence des autres le faisait descendre dans la ville. Mais l’air bestial des figures, le tapage des métiers, l’indifférence des propos glaçaient son cœur. Les jours de fête, quand le bourdon des cathédrales mettait en joie dès l’aurore le peuple entier, il regardait les habitants sortir de leurs maisons, puis les danses sur les places, les fontaines de cervoise dans les carrefours, les tentures de damas devant le logis des princes, et le soir venu, par le vitrage des rez-de-chaussée, les longues tables de famille, où des aïeux tenaient des petits enfants sur leurs genoux ; des sanglots l’étouffaient, et il s’en retournait vers la campagne.
Il contemplait avec des élancements d’amour les poulains dans les herbages, les oiseaux dans leurs nids, les insectes sur les fleurs ; tous, à son approche, couraient plus loin, se cachaient effarés, s’envolaient bien vite.
Il rechercha les solitudes. Mais le vent apportait à son oreille comme des râles d’agonie ; les larmes de la rosée tombant par terre lui rappelaient d’autres gouttes d’un poids plus lourd. Le soleil, tous les soirs, étalait du sang dans les nuages ; et chaque nuit, en rêve, son parricide recommençait.
Il se fit un cilice avec des pointes de fer. Il monta sur les deux genoux toutes les collines ayant une chapelle à leur sommet. Mais l’impitoyable pensée obscurcissait la splendeur des tabernacles, le torturait à travers les macérations de la pénitence.
Il ne se révoltait pas contre Dieu qui lui avait infligé cette action, et pourtant se désespérait de l’avoir pu commettre.
Sa propre personne lui faisait tellement horreur qu’espérant s’en délivrer il l’aventura dans des périls. Il sauva des paralytiques des incendies, des enfants du fond des gouffres. L’abîme le rejetait, les flammes l’épargnaient.
Le temps n’apaisa pas sa souffrance. Elle devenait intolérable. Il résolut de mourir.
Et un jour qu’il se trouvait au bord d’une fontaine, comme il se penchait dessus pour juger de la profondeur de l’eau, il vit paraître en face de lui un vieillard tout décharné, à barbe blanche, et d’un aspect si lamentable qu’il lui fut impossible de retenir ses pleurs. L’autre, aussi, pleurait. Sans reconnaître son image, Julien se rappelait confusément une figure ressemblant à celle-là. Tout à coup, il poussa un cri. C’était son père, et il ne pensa plus à se tuer.
Ainsi, portant le poids de son souvenir, il parcourut beaucoup de pays ; et il arriva près d’un fleuve dont la traversée était dangereuse, à cause de sa violence, et parce qu’il y avait sur les rives une grande étendue de vase. Personne depuis longtemps n’osait plus le passer.
Une vieille barque, enfouie à l’arrière, dressait sa proue dans les roseaux. Julien, en l’examinant découvrit une paire d’avirons ; et l’idée lui vint d’employer son existence au service des autres.
Il commença par établir sur la berge une manière de chaussée qui permettait de descendre jusqu’au chenal ; et il se brisait les ongles à remuer les pierres énormes, les appuyait contre son ventre pour les transporter, glissait dans la vase, y enfonçait, manqua périr plusieurs fois.
Ensuite, il répara le bateau avec des épaves de navires, et il se fit une cahute avec de la terre glaise et des troncs d’arbres.
Le passage étant connu, les voyageurs se présentèrent. Ils l’appelaient de l’autre bord, en agitant des drapeaux ; Julien bien vite sautait dans sa barque. Elle était très lourde ; et on la surchargeait par toutes sortes de bagages et de fardeaux, sans compter les bêtes de somme, qui, ruant de peur, augmentaient l’encombrement. Il ne demandait rien pour sa peine ; quelques-uns lui donnaient des restes de victuailles qu’ils tiraient de leur bissac, ou les habits trop usés dont ils ne voulaient plus. Des brutaux vociféraient des blasphèmes. Julien les reprenait avec douceur ; et ils ripostaient par des injures. Il se contentait de les bénir.
Une petite table, un escabeau, un lit de feuilles mortes et trois coupes d’argile, voilà tout ce qu’était son mobilier. Deux trous dans la muraille servaient de fenêtres. D’un côté s’étendaient à perte de vue des plaines stériles ayant sur leur surface de pâles étangs, çà et là ; et le grand fleuve, devant lui, roulait ses flots verdâtres. Au printemps, la terre humide avait une odeur de pourriture. Puis un vent désordonné soulevait la poussière en tourbillons. Elle entrait partout, embourbait l’eau, craquait sous les gencives. Un peu plus tard, c’étaient des nuages de moustiques, dont la susurration et les piqûres ne s’arrêtaient ni jour ni nuit. Ensuite, survenaient d’atroces gelées qui donnaient aux choses la rigidité de la pierre, et inspiraient un besoin fou de manger de la viande.
Des mois s’écoulaient sans que Julien vît personne. Souvent il fermait les yeux, tâchant, par la mémoire, de revenir dans sa jeunesse ; — et la cour d’un château apparaissait, avec des lévriers sur un perron, des valets dans la salle d’armes, et, sous un berceau de pampres, un adolescent à cheveux blonds entre un vieillard couvert de fourrures et une dame à grand hennin ; tout à coup, les deux cadavres étaient là ; il se jetait à plat ventre sur son lit, et répétait en pleurant :
— Ah ! pauvre père ! pauvre mère ! pauvre mère !
Et tombait dans un assoupissement où les visions funèbres continuaient.
Une nuit qu’il dormait, il crut entendre quelqu’un l’appeler. Il tendit l’oreille et ne distingua que le mugissement des flots.
Mais la même voix reprit :
— Julien !
Elle venait de l’autre bord, ce qui lui parut extraordinaire, vu la largeur du fleuve.
Une troisième fois on appela :
— Julien !
Et cette voix haute avait l’intonation d’une cloche d’église.
Ayant allumé sa lanterne, il sortit de la cahute. Un ouragan furieux emplissait la nuit. Les ténèbres étaient profondes, et çà et là déchirées par la blancheur des vagues qui bondissaient.
Après une minute d’hésitation, Julien dénoua l’amarre. L’eau, tout de suite, devint tranquille, la barque glissa dessus et toucha l’autre berge, où un homme attendait.
Il était enveloppé d’une toile en lambeaux, la figure pareille à un masque de plâtre et les deux yeux plus rouges que des charbons. En approchant de lui la lanterne, Julien s’aperçut qu’une lèpre hideuse le recouvrait ; cependant, il avait dans son attitude comme une majesté de roi.
Dès qu’il entra dans la barque, elle enfonça prodigieusement, écrasée par son poids ; une secousse la remonta ; et Julien se mit à ramer.
À chaque coup d’aviron, le ressac des flots la soulevait par l’avant. L’eau, plus noire que de l’encre, courait avec furie des deux côtés du bordage. Elle creusait des abîmes, elle faisait des montagnes, et la chaloupe sautait dessus, puis redescendait dans des profondeurs où elle tournoyait, ballottée par le vent.
Julien penchait son corps, dépliait les bras, et, s’arc-boutant des pieds, se renversait avec une torsion de la taille, pour avoir plus de force. La grêle cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos, la violence de l’air l’étouffait, il s’arrêta. Alors le bateau fut emporté à la dérive. Mais, comprenant qu’il s’agissait d’une chose considérable, d’un ordre auquel il ne fallait pas désobéir, il reprit ses avirons ; et le claquement des tolets coupait la clameur de la tempête.
La petite lanterne brûlait devant lui. Des oiseaux, en voletant, la cachaient par intervalles. Mais toujours il apercevait les prunelles du lépreux, qui se tenait debout à l’arrière, immobile comme une colonne.
Et cela dura longtemps, très longtemps !
Quand ils furent arrivés dans la cahute, Julien ferma la porte ; et il le vit siégeant sur l’escabeau. L’espèce de linceul qui le recouvrait était tombé jusqu’à ses hanches ; et ses épaules, sa poitrine, ses bras maigres disparaissaient sous des plaques de pustules écailleuses. Des rides énormes labouraient son front. Tel qu’un squelette, il avait un trou à la place du nez ; et ses lèvres bleuâtres dégageaient une haleine épaisse comme un brouillard et nauséabonde.
— J’ai faim ! dit-il.
Julien lui donna ce qu’il possédait, un vieux quartier de lard et les croûtes d’un pain noir.
Quand il les eut dévorés, la table, l’écuelle et le manche du couteau portaient les mêmes taches que l’on voyait sur son corps.
Ensuite, il dit :
— J’ai soif !
Julien alla chercher sa cruche ; et, comme il la prenait, il en sortit un arôme qui dilata son cœur et ses narines. C’était du vin ; quelle trouvaille ! mais le lépreux avança le bras et d’un trait vida toute la cruche.
Puis il dit :
— J’ai froid !
Julien, avec sa chandelle, enflamma un paquet de fougères, au milieu de la cabane.
Le Lépreux vint s’y chauffer ; et, accroupi sur les talons, il tremblait de tous ses membres, s’affaiblissait ; ses yeux ne brillaient plus, ses ulcères coulaient, et, d’une voix presque éteinte, il murmura :
— Ton lit !
Julien l’aida doucement à s’y traîner, et même étendit sur lui, pour le couvrir, la toile de son bateau.
Le lépreux gémissait. Les coins de sa bouche découvraient ses dents, un râle accéléré lui secouait la poitrine, et son ventre, à chacune de ses aspirations, se creusait jusqu’aux vertèbres.
Puis il ferma les paupières.
— C’est comme de la glace dans mes os ! Viens près de moi !
Et Julien, écartant la toile, se coucha sur les feuilles mortes, près de lui, côte à côte.
Le Lépreux tourna la tête.
— Déshabille-toi, pour que j’aie la chaleur de ton corps !
Julien ôta ses vêtements ; puis, nu comme au jour de sa naissance, se replaça dans le lit ; et il sentait contre sa cuisse la peau du Lépreux, plus froide qu’un serpent et rude comme une lime.
Il tâchait de l’encourager ; et l’autre répondait, en haletant :
— Ah ! je vais mourir !… Rapproche-toi, réchauffe-moi ! Pas avec les mains ! non ! toute ta personne !
Julien s’étala dessus complètement, bouche contre bouche, poitrine sur poitrine.
Alors le lépreux l’étreignit ; et ses yeux tout à coup prirent une clarté d’étoiles ; ses cheveux s’allongèrent comme les rais du soleil ; le souffle de ses narines avait la douceur des roses ; un nuage d’encens s’éleva du foyer, les flots chantaient.
Cependant une abondance de délices, une joie surhumaine descendait comme une inondation, dans l’âme de Julien pâmé ; et celui dont les bras le serraient toujours, grandissait, grandissait, touchant de sa tête et de ses pieds les deux murs de la cabane. Le toit s’envola, le firmament se déployait ; — et Julien monta vers les espaces bleus, face à face avec Notre-Seigneur Jésus, qui l’emportait dans le ciel.
Et voilà l’histoire de saint Julien-l’Hospitalier, telle à peu près qu’on la trouve, sur un vitrail d’église, dans mon pays.
LA LÉGENDE DE SAINT JULIEN
« Et voilà l’histoire de Saint Julien l’Hospitalier, telle à peu près qu’on la trouve, sur un vitrail d’église, dans mon pays. » Ces lignes qui terminent le conte nous en donnent l’origine. Nous en trouvons la confirmation dans les Souvenirs littéraires de Maxime Du Camp : « Saint Julien l’Hospitalier a été conçu à la vue d’un vitrail d’église normande. » Nous ne pouvons affirmer s’il s’agit d’un vitrail de la cathédrale de Rouen qui possède une verrière du XIIIe siècle représentant dans ses médaillons et cartels les scènes principales de la vie de saint Julien, ou d’un vitrail de l’église de Caudebec-en-Caux où l’on voit le saint agenouillé devant un cerf miraculeux ; dans cette même église, existe une petite statuette de saint Julien l’Hospitalier qui, également, a pu inspirer Flaubert. Toutefois il écrivait en 1879 à son éditeur Charpentier qui avait projeté une nouvelle édition des Trois Contes : « Je désirais mettre à la suite de Saint Julien le vitrail de la cathédrale de Rouen…, cette illustration me plaisait parce que ce n’était pas une illustration, mais un document historique. En comparant l’image au texte on se serait dit : Je n’y comprends rien. Comment a-t-il tiré ceci de cela ? » (Corresp., t. IV.)
La Légende de Saint Julien l’Hospitalier fut la première des trois nouvelles qu’écrivit Flaubert. Elle fut pour lui un délassement ; il était alors installé à l’Hôtel Sergent, à Concarneau, près de son ami Georges Pouchet. (Voir note à la fin du volume.) Le 11 décembre 1875, il écrit à George Sand : « Vous savez que j’ai

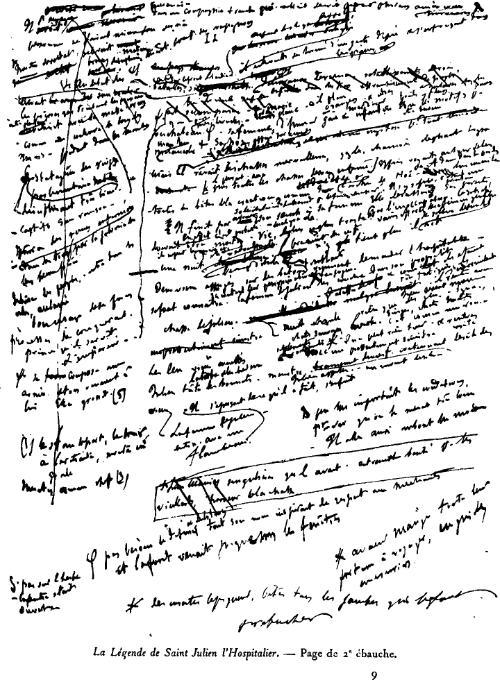
quitté mon grand roman[1] pour écrire une petite bêtise moyenâgeuse qui n’aura pas plus de 30 pages. Cela me met dans un milieu plus propre que le monde moderne et me fait du bien. » (Corresp., t. IV.)
LES ÉBAUCHES.
Il y eut deux ébauches absolument indéchiffrables de ce conte ; elles s’étendent sur 74 feuillets, le verso ayant servi à la seconde ébauche. Le procédé de travail est ici le même qui fut employé pour le conte précédent.
Un dossier contient, criblé de ratures, le scénario illisible et les notes documentaires.
Sur le premier feuillet de ces notes, en tête, est écrit le mot Chiens. Suit alors l’énumération des races différentes de chiens, leurs qualités, caractères, dons, etc., puis toute une annotation de la mission du chien de chasse, ses ruses, le dressage, les soins, etc.
Sur un autre feuillet, le mot Cerf au-dessous duquel est une annotation détaillée du cerf, la façon dont on le chasse, à quelle époque, les moyens auxquels on reconnaît le passage du cerf dans les prairies, bois, comment il meurt, etc.
Sur un autre feuillet, le mot Vol, où nous trouvons une annotation sur le vol du gerfaut, du faucon, leurs mœurs.
Un dernier feuillet à cette désignation : Vautrait, puis viennent des notes sur le loup, le sanglier, etc.
Nous n’avons pas trouvé de notes particulières rappelant l’image du vitrail, ni de croquis comme en trace quelquefois Flaubert sur ses feuillets d’ébauches.
Le manuscrit est une recopie très nette où n’apparaissent que de très rares corrections sans importance. (Voir note à la fin du volume.)
La Légende de Saint Julien l’Hospitalier a paru en feuilleton dans le Bien public, du 19 au 22 avril 1877.


VARIANTES
de
LA LÉGENDE DE SAINT JULIEN
L’HOSPITALIER
Page 78, ligne 20, chambres défendaient du froid…
Page 79, ligne 25, ses suivantes, surveillait…
Page 80, ligne 2, dura quatre jours et trois nuits…
Page 82, ligne 3, brûlait au-dessus continuellement…
Page 82, ligne 14, savant, venu exprès des Calabres, lui…
Page 84, ligne 21, il s’en approchait…
Page 84, ligne 26, pigeon à pattes roses qui…
Page 85, ligne 1, rencontra par hasard sous ses doigts. Alors il…
Page 85, ligne 15, père lui déclara…
Page 89, ligne 19, soufflait. Mais un côté…
Page 89, ligne 19, leur cassaient l’échine.
Page 90, ligne 11, face en dehors du précipice et les deux…
Page 90, ligne 23, flèche l’atteignit ; et il…
Page 92, ligne 22, mais de l’autre côté du vallon, sur le bord de la forêt tout à coup il aperçut…
Page 93, ligne 12, indicible. Mais le prodigieux…
Page 94, ligne 9, Puis, il pensait :
Page 98, ligne 18, le Roi de France et le Dauphin d’Angleterre…
Page 99, ligne 5, l’on avançait environné…
Page 100, ligne 5, pas. Alors croyant…
Page 100, ligne 10, quand tout à coup il se…
Page 100, ligne 22, jusqu’à présent une…
Page 102, ligne 20, revoir, et son…
Page 102, ligne 24, campagne ; ou bien, étendus…
Page 102, ligne 26, ciel. Quelquefois elle lui…
Page 104, ligne 16, Fort essoufflé et…
Page 108, ligne 28, représentèrent, formant autour…
Page 109, ligne 26, portait à sa gueule…
Page 110, ligne 1, semblaient ruminer un…
Page 110, ligne 7, Tout à coup le chant…
Page 111, ligne 6, l’impression légère d’une…
Page 111, ligne 17, cœur, tout de suite, n’avaient…
Page 111, ligne 22, rapprochait, s’enflait, devint…
Page 115, ligne 8, tous s’éloignaient, en faisant…
Page 115, ligne 13, puis tiraient l’auvent…
Page 116, ligne 28, insectes aux ailes d’or posés…
Page 117, ligne 18, des voyageurs du fond…
Page 117, ligne 28, son visage, Julien…
Page 118, ligne 1, celle-là. Tout à coup il…
Page 122, ligne 12, porte ; et tout à coup il le vit…
Page 124, ligne 12, avec tes mains…
HÉRODIAS.
I
a citadelle de Machærous se dressait à l’orient de la mer Morte, sur un pic de basalte ayant la forme d’un cône. Quatre vallées profondes l’entouraient, deux vers les flancs, une en face, la quatrième au-delà. Des maisons se tassaient contre sa base, dans le cercle d’un mur qui ondulait suivant les inégalités du terrain ; et, par un chemin en zigzag tailladant le rocher, la ville se reliait à la forteresse, dont les murailles étaient hautes de cent vingt coudées, avec des angles nombreux, des créneaux sur le bord, et, çà et là, des tours, qui faisaient comme des fleurons à cette couronne de pierre, suspendue au-dessus de l’abîme.
Il y avait dans l’intérieur un palais orné de portiques, et couvert d’une terrasse que fermait une balustrade en bois de sycomore, où des mâts étaient disposés pour tendre un vélarium.
Un matin, avant le jour, le Tétrarque Hérode Antipas vint s’y accouder, et regarda.
Les montagnes, immédiatement sous lui, commençaient à découvrir leurs crêtes, pendant que leur masse, jusqu’au fond des abîmes, était encore dans l’ombre. Un brouillard flottait, il se déchira, et les contours de la mer Morte apparurent. L’aube, qui se levait derrière Machærous, épandait une rougeur. Elle illumina bientôt les sables de la grève, des collines, le désert, et, plus loin, tous les monts de la Judée, inclinant leurs surfaces raboteuses et grises. Engaddi, au milieu, traçait une barre noire ; Hébron, dans l’enfoncement, s’arrondissait en dôme ; Esquol avait des grenadiers, Sorek des vignes, Karmel des champs de sésame ; et la tour Antonia, de son cube monstrueux, dominait Jérusalem. Le Tétrarque en détourna la vue pour contempler, à droite, les palmiers de Jéricho ; et il songea aux autres villes de sa Galilée : Capharnaüm, Endor, Nazareth, Tibérias où peut-être il ne reviendrait plus. Cependant le Jourdain coulait sur la plaine aride. Toute blanche, elle éblouissait comme une nappe de neige. Le lac, maintenant, semblait en lapis-lazuli ; et à sa pointe méridionale, du côté de l’Yémen, Antipas reconnut ce qu’il craignait d’apercevoir. Des tentes brunes étaient dispersées ; des hommes avec des lances circulaient entre les chevaux, et des feux s’éteignant brillaient comme des étincelles à ras du sol.
C’étaient les troupes du roi des Arabes, dont il avait répudié la fille pour prendre Hérodias, mariée à l’un de ses frères, qui vivait en Italie, sans prétentions au pouvoir.
Antipas attendait les secours des Romains ; et Vitelius, gouverneur de la Syrie, tardant à paraître, il se rongeait d’inquiétudes.
Agrippa, sans doute, l’avait ruiné chez l’Empereur ? Philippe, son troisième frère, souverain de la Batanée, s’armait clandestinement. Les Juifs ne voulaient plus de ses mœurs idolâtres, tous les autres de sa domination ; si bien qu’il hésitait entre deux projets : adoucir les Arabes ou conclure une alliance avec les Parthes ; et, sous le prétexte de fêter son anniversaire, il avait convié, pour ce jour même, à un grand festin, les chefs de ses troupes, les régisseurs de ses campagnes et les principaux de la Galilée.
Il fouilla d’un regard aigu toutes les routes. Elles étaient vides. Des aigles volaient au-dessus de sa tête ; les soldats, le long du rempart, dormaient contre les murs ; rien ne bougeait dans le château.
Tout à coup, une voix lointaine, comme échappée des profondeurs de la terre, fit pâlir le Tétrarque. Il se pencha pour écouter ; elle avait disparu. Elle reprit ; et en claquant dans ses mains, il cria :
— Mannaëi ! Mannaëi !
Un homme se présenta, nu jusqu’à la ceinture, comme les masseurs des bains. Il était très grand, vieux, décharné, et portait sur la cuisse un coutelas dans une gaine de bronze. Sa chevelure, relevée par un peigne, exagérait la longueur de son front. Une somnolence décolorait ses yeux, mais ses dents brillaient, et ses orteils posaient légèrement sur les dalles, tout son corps ayant la souplesse d’un singe, et sa figure l’impassibilité d’une momie.
— Où est-il ? demanda le Tétrarque.
Mannaëi répondit, en indiquant avec son pouce un objet derrière eux :
— Là ! toujours !
— J’avais cru l’entendre !
Et Antipas, quand il eut respiré largement, s’informa de Iaokanann, le même que les Latins appellent saint Jean-Baptiste. Avait-on revu ces deux hommes, admis par indulgence, l’autre mois, dans son cachot, et savait-on, depuis lors, ce qu’ils étaient venus faire ?
Mannaëi répliqua :
— Ils ont échangé avec lui des paroles mystérieuses, comme les voleurs, le soir, aux carrefours des routes. Ensuite, ils sont partis vers la Haute-Galilée, en annonçant qu’ils apporteraient une grande nouvelle.
Antipas baissa la tête ; puis d’un air d’épouvante :
— Garde-le ! garde-le ! Et ne laisse entrer personne ! Ferme bien la porte ! Couvre la fosse ! On ne doit pas même soupçonner qu’il vit !
Sans avoir reçu ces ordres, Mannaëi les accomplissait ; car Iaokanann était Juif, et il exécrait les Juifs comme tous les Samaritains.
Leur temple de Garizim, désigné par Moïse pour être le centre d’Israël, n’existait plus depuis le roi Hyrcan, et celui de Jérusalem les mettait dans la fureur d’un outrage, et d’une injustice permanente. Mannaëi s’y était introduit, afin d’en souiller l’autel avec des os de morts. Ses compagnons, moins rapides, avaient été décapités.
Il l’aperçut dans l’écartement de deux collines. Le soleil faisait resplendir ses murailles de marbre blanc et les lames d’or de sa toiture. C’était comme une montagne lumineuse, quelque chose de surhumain, écrasant tout de son opulence et de son orgueil.
Alors il étendit les bras du côté de Sion ; et, la taille droite, le visage en arrière, les poings fermés, lui jeta un anathème, croyant que les mots avaient un pouvoir effectif.
Antipas écoutait sans paraître scandalisé.
Le Samaritain dit encore :
— Par moments il s’agite, il voudrait fuir, il espère une délivrance. D’autres fois, il a l’air tranquille d’une bête malade ; ou bien je le vois qui marche dans les ténèbres, en répétant : « Qu’importe ! Pour qu’il grandisse, il faut que je diminue ! »
Antipas et Mannaëi se regardèrent. Mais le Tétrarque était las de réfléchir.
Tous ces monts autour de lui, comme des étages de grands flots pétrifiés, les gouffres noirs sur le flanc des falaises, l’immensité du ciel bleu, l’éclat violent du jour, la profondeur des abîmes le troublaient ; et une désolation l’envahissait au spectacle du désert, qui figure, dans le bouleversement de ses terrains, des amphithéâtres et des palais abattus. Le vent chaud apportait, avec l’odeur du soufre, comme l’exhalaison des villes maudites, ensevelies plus bas que le rivage sous les eaux pesantes. Ces marques d’une colère immortelle effrayaient sa pensée ; et il restait les deux coudes sur la balustrade, les yeux fixes et les tempes dans les mains. Quelqu’un l’avait touché. Il se retourna. Hérodias était devant lui.
Une simarre de pourpre légère l’enveloppait jusqu’aux sandales. Sortie précipitamment de sa chambre, elle n’avait ni colliers ni pendants d’oreilles ; une tresse de ses cheveux noirs lui tombait sur un bras, et s’enfonçait, par le bout, dans l’intervalle de ses deux seins. Ses narines, trop remontées, palpitaient ; la joie d’un triomphe éclairait sa figure ; et, d’une voix forte, secouant le Tétrarque :
— César nous aime ! Agrippa est en prison !
— Qui te l’a dit ?
— Je le sais !
Elle ajouta :
— C’est pour avoir souhaité l’empire à Caïus !
Tout en vivant de leurs aumônes, il avait brigué le titre de roi, qu’ils ambitionnaient comme lui. Mais dans l’avenir plus de craintes !
— Les cachots de Tibère s’ouvrent difficilement, et quelquefois l’existence n’y est pas sûre !
Antipas la comprit ; et, bien qu’elle fût la sœur d’Agrippa, son intention atroce lui sembla justifiée. Ces meurtres étaient une conséquence des choses, une fatalité des maisons royales. Dans celle d’Hérode, on ne les comptait plus.
Puis elle étala son entreprise : les clients achetés, les lettres découvertes, des espions à toutes les portes, et comment elle était parvenue à séduire Eutychès le dénonciateur.
— Rien ne me coûtait ! Pour toi, n’ai-je pas fait plus ?… J’ai abandonné ma fille !
Après son divorce, elle avait laissé dans Rome cette enfant, espérant bien en avoir d’autres du Tétrarque. Jamais elle n’en parlait. Il se demanda pourquoi son accès de tendresse.
On avait déplié le vélarium et apporté vivement de larges coussins auprès d’eux. Hérodias s’y affaissa, et pleurait, en tournant le dos. Puis elle se passa la main sur les paupières, dit qu’elle n’y voulait plus songer, qu’elle se trouvait heureuse ; et elle lui rappela leurs causeries là-bas, dans l’atrium, les rencontres aux étuves, leurs promenades le long de la voie Sacrée, et les soirs, dans les grandes villas, au murmure des jets d’eau, sous des arcs de fleurs, devant la campagne romaine. Elle le regardait comme autrefois, en se frôlant contre sa poitrine, avec des gestes câlins. — Il la repoussa. L’amour qu’elle tâchait de ranimer était si loin, maintenant ! Et tous ses malheurs en découlaient ; car, depuis douze ans bientôt, la guerre continuait. Elle avait vieilli le Tétrarque. Ses épaules se voûtaient dans une toge sombre, à bordure violette ; ses cheveux blancs se mêlaient à sa barbe, et le soleil, qui traversait la voile, baignait de lumière son front chagrin. Celui d’Hérodias également avait des plis ; et, l’un en face de l’autre, ils se considéraient d’une manière farouche.
Les chemins dans la montagne commencèrent à se peupler. Des pasteurs piquaient des bœufs, des enfants tiraient des ânes, des palefreniers conduisaient des chevaux. Ceux qui descendaient les hauteurs au delà de Machærous disparaissaient derrière le château ; d’autres montaient le ravin en face, et, parvenus à la ville, déchargeaient leurs bagages dans les cours. C’étaient les pourvoyeurs du Tétrarque, et des valets, précédant ses convives.
Mais au fond de la terrasse, à gauche, un Essénien parut, en robe blanche, nu-pieds, l’air stoïque. Mannaëi, du côté droit, se précipitait en levant son coutelas.
Hérodias lui cria :
— Tue-le !
— Arrête ! dit le Tétrarque.
Il devint immobile ; l’autre aussi.
Puis ils se retirèrent, chacun par un escalier différent, à reculons, sans se perdre des yeux.
— Je le connais, dit Hérodias, il se nomme Phanuel, et cherche à voir Iaokanann, puisque tu as l’aveuglement de le conserver !
Antipas objecta qu’il pouvait un jour servir. Ses attaques contre Jérusalem gagnaient à eux le reste des Juifs.
— Non ! reprit-elle, ils acceptent tous les
maîtres, et ne sont pas capables de faire une
patrie.
Quant à celui qui remuait le peuple avec des espérances conservées depuis Néhémias, la meilleure politique était de le supprimer.
Rien ne pressait, selon le Tétrarque. Iaokanann dangereux ! Allons donc ! Il affectait d’en rire.
— Tais-toi !
Et elle redit son humiliation, un jour qu’elle allait vers Galaad, pour la récolte du baume.
— Des gens, au bord du fleuve, remettaient leurs habits. Sur un monticule, à côté, un homme parlait. Il avait une peau de chameau autour des reins, et sa tête ressemblait à celle d’un lion. Dès qu’il m’aperçut, il cracha sur moi toutes les malédictions des prophètes. Ses prunelles flamboyaient, sa voix rugissait ; il levait les bras, comme pour arracher le tonnerre. Impossible de fuir ! les roues de mon char avaient du sable jusqu’aux essieux ; et je m’éloignais lentement, m’abritant sous mon manteau, glacée par ces injures qui tombaient comme une pluie d’orage.
Iaokanann l’empêchait de vivre. Quand on l’avait pris et lié avec des cordes, les soldats devaient le poignarder s’il résistait ; il s’était montré doux. On avait mis des serpents dans sa prison ; ils étaient morts.
L’inanité de ces embûches exaspérait Hérodias. D’ailleurs, pourquoi sa guerre contre elle ? Quel intérêt le poussait ? Ses discours, criés à des foules, s’étaient répandus, circulaient ; elle les entendait partout, ils emplissaient l’air. Contre des légions, elle aurait eu de la bravoure. Mais cette force plus pernicieuse que les glaives, et qu’on ne pouvait saisir, était stupéfiante ; et elle parcourait la terrasse, blêmie par sa colère, manquant de mots pour exprimer ce qui l’étouffait.
Elle songeait aussi que le Tétrarque, cédant à l’opinion, s’aviserait peut-être de la répudier. Alors tout serait perdu ! Depuis son enfance, elle nourrissait le rêve d’un grand empire. C’était pour y atteindre que, délaissant son premier époux, elle s’était jointe à celui-là, qui l’avait dupée, pensait-elle.
— J’ai pris un bon soutien, en entrant dans ta famille !
— Elle vaut la tienne ! dit simplement le Tétrarque.
Hérodias sentit bouillonner dans ses veines le sang des prêtres et des rois ses aïeux.
— Mais ton grand-père balayait le temple d’Ascalon ! Les autres étaient bergers, bandits, conducteurs de caravanes, une horde, tributaire de Juda depuis le roi David ! Tous mes ancêtres ont battu les tiens ! Le premier des Makkabi vous a chassés d’Hébron, Hyrcan forcés à vous circoncire !
Et, exhalant le mépris de la patricienne pour le plébéien, la haine de Jacob contre Édom, elle lui reprocha son indifférence aux outrages, sa mollesse envers les Pharisiens qui le trahissaient, sa lâcheté pour le peuple qui la détestait.
— Tu es comme lui, avoue-le ! et tu regrettes la fille arabe qui danse autour des pierres. Reprends-la ! Va-t’en vivre avec elle, dans sa maison de toile ! dévore son pain cuit sous la cendre ! avale le lait caillé de ses brebis ! baise ses joues bleues ! et oublie-moi !
Le Tétrarque n’écoutait plus. Il regardait la plate-forme d’une maison, où il y avait une jeune fille, et une vieille femme tenant un parasol à manche de roseau, long comme la ligne d’un pêcheur. Au milieu du tapis, un grand panier de voyage restait ouvert. Des ceintures, des voiles, des pendeloques d’orfèvrerie en débordaient confusément. La jeune fille, par intervalles, se penchait vers ces choses, et les secouait à l’air. Elle était vêtue comme les Romaines, d’une tunique calamistrée avec un péplum à glands d’émeraude ; et des lanières bleues enfermaient sa chevelure, trop lourde, sans doute, car, de temps à autre, elle y portait la main. L’ombre du parasol se promenait au-dessus d’elle, en la cachant à demi. Antipas aperçut deux ou trois fois son col délicat, l’angle d’un œil, le coin d’une petite bouche. Mais il voyait, des hanches à la nuque, toute sa taille qui s’inclinait pour se redresser d’une manière élastique. Il épiait le retour de ce mouvement, et sa respiration devenait plus forte ; des flammes s’allumaient dans ses yeux. Hérodias l’observait.
Il demanda :
— Qui est-ce ?
Elle répondit n’en rien savoir, et s’en alla soudainement apaisée.
Le Tétrarque était attendu sous les portiques par des Galiléens, le maître des écritures, le chef des pâturages, l’administrateur des salines et un Juif de Babylone, commandant ses cavaliers. Tous le saluèrent d’une acclamation. Puis, il disparut vers les chambres intérieures.
Phanuel surgit à l’angle d’un couloir.
— Ah ! encore ? Tu viens pour Iaokanann, sans doute ?
— Et pour toi ! j’ai à t’apprendre une chose considérable.
Et, sans quitter Antipas, il pénétra, derrière lui, dans un appartement obscur.
Le jour tombait par un grillage, se développant tout du long sous la corniche. Les murailles étaient peintes d’une couleur grenat, presque noir. Dans le fond, s’étalait un lit d’ébène, avec des sangles en peau de bœuf. Un bouclier d’or, au-dessus, luisait comme un soleil.
Antipas traversa toute la salle, se coucha sur le lit.
Phanuel était debout. Il leva son bras, et dans une attitude inspirée :
— Le Très-Haut envoie par moment un de ses fils. Iaokanann en est un. Si tu l’opprimes, tu seras châtié.
— C’est lui qui me persécute ! s’écria Antipas. Il a voulu de moi une action impossible. Depuis ce temps-là il me déchire. Et je n’étais pas dur, au commencement ! Il a même dépêché de Machærous des hommes qui bouleversent mes provinces. Malheur à sa vie ! Puisqu’il m’attaque, je me défends !
— Ses colères ont trop de violence, répliqua Phanuel. N’importe ! il faut le délivrer.
— On ne relâche pas les bêtes furieuses ! dit le Tétrarque.
L’Essénien répondit :
— Ne t’inquiète plus ! Il ira chez les Arabes, les Gaulois, les Scythes. Son œuvre doit s’étendre jusqu’au bout de la terre !
Antipas semblait perdu dans une vision.
— Sa puissance est forte !… Malgré moi, je l’aime !
— Alors, qu’il soit libre !
Le Tétrarque hocha la tête. Il craignait Hérodias, Mannaeï, et l’inconnu.
Phanuel tâcha de le persuader, en alléguant, pour garantie de ses projets, la soumission des Esséniens aux rois. On respectait ces hommes pauvres, indomptables par les supplices, vêtus de lin, et qui lisaient l’avenir dans les étoiles.
Antipas se rappela un mot de lui, tout à l’heure.
— Quelle est cette chose, que tu m’annonçais comme importante ?
Un nègre survint. Son corps était blanc de poussière. Il râlait et ne put que dire :
— Vitellius !
— Comment ? il arrive ?
— Je l’ai vu. Avant trois heures, il est ici.
Les portières des corridors furent agitées comme par le vent. Une rumeur emplit le château, un vacarme de gens qui couraient, de meubles qu’on traînait, d’argenteries s’écroulant ; et, du haut des tours, des buccins sonnaient, pour avertir les esclaves dispersés.
II
es remparts étaient couverts de monde
quand Vitellius entra dans la cour. Il s’appuyait
sur le bras de son interprète, suivi
d’une grande litière rouge ornée de panaches et
de miroirs, ayant la toge, le laticlave, les brodequins
d’un consul et des licteurs autour de sa personne.
Ils plantèrent contre la porte leurs douze faisceaux, des baguettes reliées par une courroie avec une hache dans le milieu. Alors, tous frémirent devant la majesté du peuple romain.
La litière, que huit hommes manœuvraient, s’arrêta. Il en sortit un adolescent, le ventre gros, la face bourgeonnée, des perles le long des doigts. On lui offrit une coupe pleine de vin et d’aromates. Il la but, et en réclama une seconde.
Le Tétrarque était tombé aux genoux du Proconsul, chagrin, disait-il, de n’avoir pas connu plus tôt la faveur de sa présence. Autrement, il eût ordonné sur les routes tout ce qu’il fallait pour les Vitellius. Ils descendaient de la déesse Vitellia. Une voie, menant du Janicule à la mer, portait encore leur nom. Les questures, les consulats étaient innombrables dans la famille ; et quant à Lucius, maintenant son hôte, on devait le remercier, comme vainqueur des Clites et père de ce jeune Aulus, qui semblait revenir dans son domaine, puisque l’Orient était la patrie des dieux. Ces hyperboles furent exprimées en latin. Vitellius les accepta impassiblement.
Il répondit que le grand Hérode suffisait à la gloire d’une nation. Les Athéniens lui avaient donné la surintendance des jeux Olympiques. Il avait bâti des temples en l’honneur d’Auguste, été patient, ingénieux, terrible, et fidèle toujours aux Césars.
Entre les colonnes à chapiteaux d’airain, on aperçut Hérodias qui s’avançait d’un air d’impératrice, au milieu de femmes et d’eunuques tenant sur des plateaux de vermeil des parfums allumés.
Le Proconsul fit trois pas à sa rencontre ; et, l’ayant saluée d’une inclinaison de tête :
— Quel bonheur ! s’écria-t-elle, que désormais Agrippa, l’ennemi de Tibère, fût dans l’impossibilité de nuire !
Il ignorait l’événement, elle lui parut dangereuse ; et comme Antipas jurait qu’il ferait tout pour l’Empereur, Vitellius ajouta :
— Même au détriment des autres ?
Il avait tiré des otages du roi des Parthes, et l’Empereur n’y songeait plus ; car Antipas, présent à la conférence, pour se faire valoir, en avait tout de suite expédié la nouvelle. De là, une haine profonde, et les retards à fournir des secours.
Le Tétrarque balbutia. Mais Aulus dit en riant :
— Calme-toi, je te protège !
Le Proconsul feignit de n’avoir pas entendu. La fortune du père dépendait de la souillure du fils ; et cette fleur des fanges de Caprée lui procurait des bénéfices tellement considérables, qu’il l’entourait d’égards, tout en se méfiant, parce qu’elle était vénéneuse.
Un tumulte s’éleva sous la porte. On introduisait une file de mules blanches, montées par des personnages en costume de prêtres. C’étaient des Sadducéens et des Pharisiens, que la même ambition poussait à Machærous, les premiers voulant obtenir la sacrificature, et les autres la conserver. Leurs visages étaient sombres, ceux des Pharisiens surtout, ennemis de Rome et du Tétrarque. Les pans de leur tunique les embarrassaient dans la cohue ; et leur tiare chancelait à leur front par-dessus des bandelettes de parchemin, où des écritures étaient tracées.
Presque en même temps, arrivèrent des soldats de l’avant-garde. Ils avaient mis leurs boucliers dans des sacs, par précaution contre la poussière ; et derrière eux était Marcellus, lieutenant du Pro-consul, avec des publicains, serrant sous leurs aisselles des tablettes de bois.
Antipas nomma les principaux de son entourage : Tolmaï, Kanthera, Séhon, Ammonius d’Alexandrie, qui lui achetait de l’asphalte, Naâmann, capitaine de ses vélites, Iaçim le Babylonien.
Vitellius avait remarqué Mannaeï.
— Celui-là, qu’est-ce donc ?
Le Tétrarque fit comprendre d’un geste, que c’était le bourreau.
Puis, il présenta les Sadducéens.
Jonathas, un petit homme libre d’allures et parlant grec, supplia le maître de les honorer d’une visite à Jérusalem. Il s’y rendrait probablement.
Éléazar, le nez crochu et la barbe longue, réclama pour les Pharisiens le manteau du grand prêtre détenu dans la tour Antonia par l’autorité civile.
Ensuite, les Galiléens dénoncèrent Ponce-Pilate. À l’occasion d’un fou qui cherchait les vases d’or de David dans une caverne, près de Samarie, il avait tué des habitants ; et tous parlaient à la fois, Mannaeï plus violemment que les autres. Vitellius affirma que les criminels seraient punis.
Des vociférations éclatèrent en face d’un portique, où les soldat savaient suspendu leurs boucliers. Les housses étant défaites, on voyait sur les umbo la figure de César. C’était pour les Juifs une idolâtrie. Antipas les harangua, pendant que Vitellius, dans la colonnade, sur un siège élevé, s’étonnait de leur fureur. Tibère avait eu raison d’en exiler quatre cents en Sardaigne. Mais chez eux ils étaient forts ; et il commanda de retirer les boucliers.
Alors, ils entourèrent le Proconsul, en implorant des réparations d’injustices, des privilèges, des aumônes. Les vêtements étaient déchirés, on s’écrasait ; et, pour faire de la place, des esclaves avec des bâtons frappaient de droite et de gauche. Les plus voisins de la porte descendirent sur le sentier, d’autres le montaient ; ils refluèrent ; deux courants se croisaient dans cette masse d’hommes qui oscillait, comprimée par l’enceinte des murs.
Vitellius demanda pourquoi tant de monde. Antipas en dit la cause : le festin de son anniversaire ; et il montra plusieurs de ses gens, qui, penchés sur les créneaux, halaient d’immenses corbeilles de viandes, de fruits, de légumes, des antilopes et des cigognes, de larges poissons couleur d’azur, des raisins, des pastèques, des grenades élevées en pyramides. Aulus n’y tint pas. Il se précipita vers les cuisines, emporté par cette goinfrerie qui devait surprendre l’univers.
En passant près d’un caveau, il aperçut des marmites pareilles à des cuirasses. Vitellius vint les regarder ; et exigea qu’on lui ouvrît les chambres souterraines de la forteresse.
Elles étaient taillées dans le roc en hautes voûtes, avec des piliers de distance en distance. La première contenait de vieilles armures ; mais la seconde regorgeait de piques, et qui allongeaient toutes leurs pointes, émergeant d’un bouquet de plumes. La troisième semblait tapissée en nattes de roseaux, tant les flèches minces étaient perpendiculairement les unes à côté des autres. Des lames de cimeterres couvraient les parois de la quatrième. Au milieu de la cinquième, des rangs de casques faisaient, avec leurs crêtes, comme un bataillon de serpents rouges. On ne voyait dans la sixième que des carquois ; dans la septième, que des cnémides ; dans la huitième, que des brassards ; dans les suivantes, des fourches, des grappins, des échelles, des cordages, jusqu’à des mâts pour les catapultes, jusqu’à des grelots pour le poitrail des dromadaires ! et comme la montagne allait en s’élargissant vers sa base, évidée à l’intérieur telle qu’une ruche d’abeilles, au-dessous de ces chambres il y en avait de plus nombreuses, et d’encore plus profondes.
Vitellius, Phinées son interprète, et Sisenna le chef des publicains, les parcouraient à la lumière des flambeaux, que portaient trois eunuques.
On distinguait dans l’ombre des choses hideuses inventées par les barbares : casse-têtes garnis de clous, javelots empoisonnant les blessures, tenailles qui ressemblaient à des mâchoires de crocodiles ; enfin le Tétrarque possédait dans Machærous des munitions de guerre pour quarante mille hommes.
Il les avait rassemblées en prévision d’une alliance de ses ennemis. Mais le Proconsul pouvait croire, ou dire, que c’était pour combattre les Romains, et il cherchait des explications.
Elles n’étaient pas à lui ; beaucoup servaient à le défendre des brigands ; d’ailleurs il en fallait contre les Arabes ; ou bien, tout cela avait appartenu à son père. Et, au lieu de marcher derrière le Proconsul, il allait devant, à pas rapides. Puis il se rangea le long du mur, qu’il masquait de sa toge, avec ses deux coudes écartés ; mais le haut d’une porte dépassait sa tête. Vitellius la remarqua et voulut savoir ce qu’elle enfermait.
Le Babylonien pouvait seul l’ouvrir.
— Appelle le Babylonien !
On l’attendit.
Son père était venu des bords de l’Euphrate s’offrir au grand Hérode, avec cinq cents cavaliers, pour défendre les frontières orientales. Après le partage du royaume, Iaçim était demeuré chez Philippe, et maintenant servait Antipas.
Il se présenta, un arc sur l’épaule, un fouet à la main. Des cordons multicolores serraient étroitement ses jambes torses. Ses gros bras sortaient d’une tunique sans manches, et un bonnet de fourrure ombrageait sa mine dont la barbe était frisée en anneaux.
D’abord, il eut l’air de ne pas comprendre l’interprète. Mais Vitellius lança un coup d’œil à Antipas, qui répéta tout de suite son commandement. Alors Iaçim appliqua ses deux mains contre la porte. Elle glissa dans le mur.
Un souffle d’air chaud s’exhala des ténèbres. Une allée descendait en tournant ; ils la prirent et arrivèrent au seuil d’une grotte, plus étendue que les autres souterrains.
Une arcade s’ouvrait au fond sur le précipice, qui de ce côté-là défendait la citadelle. Un chèvrefeuille, se cramponnant à la voûte, laissait retomber ses fleurs en pleine lumière. À ras du sol, un filet d’eau murmurait.
Des chevaux blancs étaient là, une centaine peut-être, et qui mangeaient de l’orge sur une planche au niveau de leur bouche. Ils avaient tous la crinière peinte en bleu, les sabots dans des mitaines de sparterie, et les poils d’entre les oreilles bouffant sur le frontal, comme une perruque. Avec leur queue très longue, ils se battaient mollement les jarrets. Le Proconsul en resta muet d’admiration.
C’étaient de merveilleuses bêtes, souples comme des serpents, légères comme des oiseaux. Elles partaient avec la flèche du cavalier, renversaient les hommes en les mordant au ventre, se tiraient de l’embarras des rochers, sautaient par-dessus des abîmes, et pendant tout un jour continuaient dans les plaines leur galop frénétique ; un mot les arrêtait. Dès que Iaçim entra, elles vinrent à lui, comme des moutons quand paraît le berger ; et avançant leur encolure, elles le regardaient inquiètes avec leurs yeux d’enfant. Par habitude, il lança du fond de sa gorge un cri rauque qui les mit en gaieté ; et elles se cabraient, affamées d’espace, demandant à courir.
Antipas, de peur que Vitellius ne les enlevât, les avait emprisonnées dans cet endroit, spécial pour les animaux, en cas de siège.
— L’écurie est mauvaise, dit le Proconsul, et tu risques de les perdre ! Fais l’inventaire, Sisenna !
Le publicain retira une tablette de sa ceinture ; compta les chevaux et les inscrivit.
Les agents des compagnies fiscales corrompaient les gouverneurs, pour piller les provinces. Celui-là flairait partout, avec sa mâchoire de fouine et ses paupières clignotantes.
Enfin, on remonta dans la cour.
Des rondelles de bronze au milieu des pavés, çà et là, couvraient les citernes. Il en observa une plus grande que les autres, et qui n’avait pas sous les talons leur sonorité. Il les frappa toutes alternativement, puis hurla en piétinant :
— Je l’ai ! je l’ai ! C’est ici le trésor d’Hérode !
La recherche de ses trésors était une folie des Romains.
Ils n’existaient pas, jura le Tétrarque.
Cependant, qu’y avait-il là-dessous !
— Rien ! un homme, un prisonnier.
— Montre-le ! dit Vitellius.
Le Tétrarque n’obéit pas ; les Juifs auraient connu son secret. Sa répugnance à ouvrir la rondelle impatientait Vitellius.
— Enfoncez-la ! cria-t-il aux licteurs.
Mannaeï avait deviné ce qui les occupait. Il crut en voyant une hache, qu’on allait décapiter Iaokanann ; et il arrêta le licteur au premier coup sur la plaque, insinua entre elle et les pavés une manière de crochet, puis, roidissant ses longs bras maigres, la souleva doucement, elle s’abattit ; tous admirèrent la force de ce vieillard. Sous le couvercle doublé de bois, s’étendait une trappe de même dimension. D’un coup de poing, elle se replia en deux panneaux ; on vit alors un trou, une fosse énorme que contournait un escalier sans rampe ; et ceux qui se penchèrent sur le bord aperçurent au fond quelque chose de vague et d’effrayant.
Un être humain était couché par terre, sous de longs cheveux se confondant avec les poils de bête qui garnissaient son dos. Il se leva. Son front touchait à une grille horizontalement scellée ; et, de temps à autre, il disparaissait dans les profondeurs de son antre.
Le soleil faisait briller la pointe des tiares, le pommeau des glaives, chauffait à outrance les dalles ; et des colombes, s’envolant des frises, tournoyaient au-dessus de la cour. C’était l’heure où Mannaeï, ordinairement, leur jetait du grain. Il se tenait accroupi devant le Tétrarque, qui était debout près de Vitellius. Les Galiléens, les prêtres, les soldats, formaient un cercle par derrière ; tous se taisaient, dans l’angoisse de ce qui allait arriver.
Ce fut d’abord un grand soupir, poussé d’une voix caverneuse.
Hérodias l’entendit à l’autre bout du palais. Vaincue par une fascination, elle traversa la foule ; et elle écoutait, une main sur l’épaule de Mannaeï, le corps incliné.
La voix s’éleva :
— Malheur à vous, Pharisiens et Sadducéens, race de vipères, outres gonflées, cymbales retentissantes !
On avait reconnu Iaokanann. Son nom circulait. D’autres accoururent.
— Malheur à toi, ô peuple ! et aux traîtres de Juda, aux ivrognes d’Éphraïm, à ceux qui habitent la vallée grasse, et que les vapeurs du vin font chanceler !
Qu’ils se dissipent comme l’eau qui s’écoule, comme la limace qui se fond en marchant, comme l’avorton d’une femme qui ne voit pas le soleil.
Il faudra, Moab, te réfugier dans les cyprès comme les passereaux, dans les cavernes comme les gerboises. Les portes des forteresses seront plus vite brisées que des écailles de noix, les murs crouleront, les villes brûleront ; et le fléau de l’Éternel ne s’arrêtera pas. Il retournera vos membres dans votre sang, comme de la laine dans la cuve d’un teinturier. Il vous déchirera comme une herse neuve ; il répandra sur les montagnes tous les morceaux de votre chair !
De quel conquérant parlait-il ! Était-ce de Vitellius ? Les Romains seuls pouvaient produire cette extermination. Des plaintes s’échappaient :
— Assez ! assez ! qu’il finisse !
Il continua, plus haut :
— Auprès du cadavre de leurs mères, les petits enfants se traîneront sur les cendres. On ira, la nuit, chercher son pain à travers les décombres, au hasard des épées. Les chacals s’arracheront des ossements sur les places publiques, où le soir les vieillards causaient. Tes vierges, en avalant leurs pleurs, joueront de la cithare dans les festins de l’étranger, et tes fils les plus braves baisseront leur échine, écorchée par des fardeaux trop lourds !
Le peuple revoyait les jours de son exil, toutes les catastrophes de son histoire. C’étaient les paroles des anciens prophètes. Iaokanann les envoyait, comme de grands coups, l’une après l’autre.
Mais la voix se fit douce, harmonieuse, chantante. Il annonçait un affranchissement, des splendeurs au ciel, le nouveau-né un bras dans la caverne du dragon, l’or à la place de l’argile, le désert s’épanouissant comme une rose :
— Ce qui maintenant vaut soixante kiccars ne coûtera pas une obole. Des fontaines de lait jailliront des rochers ; on s’endormira dans les pressoirs le ventre plein ! Quand viendras-tu, toi que j’espère ? D’avance, tous les peuples s’agenouillent, et ta domination sera éternelle, fils de David !
Le Tétrarque se rejeta en arrière, l’existence d’un fils de David l’outrageant comme une menace.
Iaokanann l’invectiva pour sa royauté.
— Il n’y a pas d’autre roi que l’Éternel ! et pour ses jardins, pour ses statues, pour ses meubles d’ivoire, comme l’impie Achab !
Antipas brisa la cordelette du cachet suspendu à sa poitrine, et le lança dans la fosse, en lui commandant de se taire.
La voix répondit :
— Je crierai comme un ours, comme un âne sauvage, comme une femme qui enfante !
Le châtiment est déjà dans ton inceste, Dieu t’afflige de la stérilité du mulet !
Et des rires s’élevèrent, pareils au clapotement des flots.
Vitellius s’obstinait à rester. L’interprète, d’un ton impassible, redisait, dans la langue des Romains, toutes les injures que Iaokanann rugissait dans la sienne. Le Tétrarque et Hérodias étaient forcés de les subir deux fois. Il haletait, pendant qu’elle observait béante le fond du puits.
L’homme effroyable se renversa la tête ; et, empoignant les barreaux, y colla son visage, qui avait l’air d’une broussaille, où étincelaient deux charbons :
— Ah ! c’est toi, Iézabel !
Tu as pris son cœur avec le craquement de ta chaussure. Tu hennissais comme une cavale. Tu as dressé ta couche sur les monts, pour accomplir tes sacrifices !
Le Seigneur arrachera tes pendants d’oreilles, tes robes de pourpre, tes voiles de lin, les anneaux de tes bras, les bagues de tes pieds, et les petits croissants d’or qui tremblent sur ton front, tes miroirs d’argent, tes éventails en plumes d’autruche, les patins de nacre qui haussent ta taille, l’orgueil de tes diamants, les senteurs de tes cheveux, la peinture de tes ongles, tous les artifices de ta mollesse ; et les cailloux manqueront pour lapider l’adultère !
Elle chercha du regard une défense autour d’elle. Les Pharisiens baissaient hypocritement leurs yeux. Les Sadducéens tournaient la tête, craignant d’offenser le Proconsul. Antipas paraissait mourir.
La voix grossissait, se développait, roulait avec des déchirements de tonnerre, et, l’écho dans la montagne la répétant, elle foudroyait Machærous d’éclats multipliés.
— Étale-toi dans la poussière, fille de Babylone ! Fais moudre la farine ! Ôte ta ceinture, détache ton soulier, trousse-toi, passe les fleuves ! ta honte sera découverte, ton opprobre sera vu ! tes sanglots te briseront les dents ! L’Éternel exècre la puanteur de tes crimes ! Maudite ! maudite ! Crève comme une chienne !
La trappe se ferma, le couvercle se rabattit. Mannaëi voulait étrangler Iaokanann.
Hérodias disparut. Les Pharisiens étaient scandalisés. Antipas, au milieu d’eux, se justifiait.
— Sans doute, reprit Éléazar, il faut épouser la femme de son frère, mais Hérodias n’était pas veuve, et de plus elle avait un enfant, ce qui constituait l’abomination.
— Erreur ! erreur ! objecta le Sadducéen Jonathas. La Loi condamne ces mariages, sans les proscrire absolument.
— N’importe ! On est pour moi bien injuste ! disait Antipas, car, enfin, Absalon a couché avec les femmes de son père, Juda avec sa bru, Ammon avec sa sœur, Lot avec ses filles.
Aulus, qui venait de dormir, reparut à ce moment-là. Quand il fut instruit de l’affaire, il approuva le Tétrarque. On ne devait point se gêner pour de pareilles sottises ; et il riait beaucoup du blâme des prêtres, et de la fureur de Iaokanann.
Hérodias, au milieu du perron, se retourna vers lui.
— Tu as tort, mon maître ! Il ordonne au peuple de refuser l’impôt.
— Est-ce vrai ? demanda tout de suite le publicain.
Les réponses furent généralement affirmatives. Le Tétrarque les renforçait.
Vitellius songea que le prisonnier pouvait s’enfuir ; et comme la conduite d’Antipas lui semblait douteuse, il établit des sentinelles aux portes, le long des murs et dans la cour.
Ensuite, il alla vers son appartement. Les députations des prêtres l’accompagnèrent.
Sans aborder la question de la sacrificature, chacune émettait ses griefs.
Tous l’obsédaient. Il les congédia.
Jonathas le quittait, quand il aperçut, dans un créneau, Antipas causant avec un homme à longs cheveux et en robe blanche, un Essénien ; et il regretta de l’avoir soutenu.
Une réflexion avait consolé le Tétrarque. Iaokanann ne dépendait plus de lui ; les Romains s’en chargeaient. Quel soulagement ! Phanuel se promenait alors sur le chemin de ronde.
Il l’appela, et, désignant les soldats :
— Ils sont les plus forts ! je ne peux le délivrer ! ce n’est pas ma faute !
La cour était vide. Les esclaves se reposaient. Sur la rougeur du ciel, qui enflammait l’horizon, les moindres objets perpendiculaires se détachaient en noir. Antipas distingua les salines à l’autre bout de la mer Morte, et ne voyait plus les tentes des Arabes. Sans doute ils étaient partis ? La lune se levait ; un apaisement descendait dans son cœur.
Phanuel, accablé, restait le menton sur la poitrine.
Enfin, il révéla ce qu’il avait à dire.
Depuis le commencement du mois, il étudiait le ciel avant l’aube, la constellation de Persée se trouvant au zénith. Agalah se montrait à peine, Algol brillait moins, Mira-Cœti avait disparu ; d’où il augurait la mort d’un homme considérable, cette nuit même, dans Machærous.
Lequel ? Vitellius était trop bien entouré. On n’exécuterait pas Iaokanann. « C’est donc moi ! » pensa le Tétrarque.
Peut-être que les Arabes allaient revenir ? Le Proconsul découvrirait ses relations avec les Parthes ! Des sicaires de Jérusalem escortaient les prêtres ; ils avaient sous leurs vêtements des poignards ; et le Tétrarque ne doutait pas de la science de Phanuel.
Il eut l’idée de recourir à Hérodias. Il la haïssait pourtant. Mais elle lui donnerait du courage ; et tous les liens n’étaient pas rompus de l’ensorcellement qu’il avait autrefois subi.
Quand il entra dans sa chambre, du cinnamome fumait sur une vasque de porphyre ; et des poudres, des onguents, des étoffes pareilles à des nuages, des broderies plus légères que des plumes, étaient dispersées.
Il ne dit pas la prédiction de Phanuel, ni sa peur des Juifs et des Arabes ; elle l’eût accusé d’être lâche. Il parla seulement des Romains ; Vitellius ne lui avait rien confié de ses projets militaires. Il le supposait ami de Caïus, que fréquentait Agrippa ; et il serait envoyé en exil, ou peut-être on l’égorgerait.
Hérodias, avec une indulgence dédaigneuse, tâcha de le rassurer. Enfin, elle tira d’un petit coffre une médaille bizarre, ornée du profil de Tibère. Cela suffisait à faire pâlir les licteurs et fondre les accusations.
Antipas, ému de reconnaissance, lui demanda comment elle l’avait.
— On me l’a donnée, reprit-elle.
Sous une portière en face, un bras nu s’avança, un bras jeune, charmant et comme tourné dans l’ivoire par Polyclète. D’une façon un peu gauche, et cependant gracieuse, il ramait dans l’air, pour saisir une tunique oubliée sur une escabelle près de la muraille.
Une vieille femme la passa doucement, en écartant le rideau.
Le Tétrarque eut un souvenir, qu’il ne pouvait préciser.
— Cette esclave est-elle à toi ?
— Que t’importe ? répondit Hérodias.
III
es convives emplissaient la salle du festin.
Elle avait trois nefs, comme une basilique, et que séparaient des colonnes en bois d’algumin, avec des chapiteaux de bronze couverts de sculptures. Deux galeries à claire-voie s’appuyaient dessus ; et une troisième en filigrane d’or se bombait au fond, vis-à-vis d’un cintre énorme, qui s’ouvrait à l’autre bout.
Des candélabres, brûlant sur les tables alignées dans toute la longueur du vaisseau, faisaient des buissons de feux, entre les coupes de terre peinte et les plats de cuivre, les cubes de neige, les monceaux de raisin ; mais ces clartés rouges se perdaient progressivement, à cause de la hauteur du plafond, et des points lumineux brillaient, comme des étoiles, la nuit, à travers des branches. Par l’ouverture de la grande baie, on apercevait des flambeaux sur les terrasses des maisons ; car Antipas fêtait ses amis, son peuple, et tous ceux qui s’étaient présentés.
Des esclaves, alertes comme des chiens et les orteils dans des sandales de feutre, circulaient, en portant des plateaux.
La table proconsulaire occupait, sous la tribune dorée, une estrade en planches de sycomore. Des tapis de Babylone l’enfermaient dans une espèce de pavillon.
Trois lits d’ivoire, un en face et deux sur les flancs, contenaient Vitellius, son fils et Antipas ; le Proconsul étant près de la porte, à gauche, Aulus à droite, le Tétrarque au milieu.
Il avait un lourd manteau noir, dont la trame disparaissait sous des applications de couleur, du fard aux pommettes, la barbe en éventail, et de la poudre d’azur dans ses cheveux, serrés par un diadème de pierreries. Vitellius gardait son baudrier de pourpre, qui descendait en diagonale sur une toge de lin. Aulus s’était fait nouer dans le dos les manches de sa robe en soie violette, lamée d’argent. Les boudins de sa chevelure formaient des étages, et un collier de saphirs étincelait à sa poitrine, grasse et blanche comme celle d’une femme. Près de lui, sur une natte et jambes croisées, se tenait un enfant très beau, qui souriait toujours. Il l’avait vu dans les cuisines, ne pouvait plus s’en passer, et, ayant peine à retenir son nom chaldéen, l’appelait simplement : « l’Asiatique. » De temps à autre, il s’étalait sur le triclinium. Alors, ses pieds nus dominaient l’assemblée.
De ce côté-là, il y avait les prêtres et les officiers d’Antipas, des habitants de Jérusalem, les principaux des villes grecques ; et, sous le Proconsul : Marcellus avec les publicains, des amis du Tétrarque, les personnages de Kana, Ptolémaïde, Jéricho ; puis, pêle-mêle, des montagnards du Liban, et les vieux soldats d’Hérode : douze Thraces, un Gaulois, deux Germains, des chasseurs de gazelles, des pâtres de l’Idumée, le sultan de Palmyre, des marins d’Éziongaber. Chacun avait devant soi une galette de pâte molle, pour s’essuyer les doigts ; et les bras, s’allongeant comme des cous de vautour, prenaient des olives, des pistaches, des amandes. Toutes les figures étaient joyeuses, sous des couronnes de fleurs.
Les Pharisiens les avaient repoussées comme indécence romaine. Ils frissonnèrent quand on les aspergea de galbanum et d’encens, composition réservée aux usages du Temple.
Aulus en frotta son aisselle, et Antipas lui en promit tout un chargement, avec trois couches de ce véritable baume, qui avait fait convoiter la Palestine à Cléopâtre.
Un capitaine de sa garnison de Tibériade, survenu tout à l’heure, s’était placé derrière lui, pour l’entretenir d’événements extraordinaires. Mais son attention était partagée entre le Proconsul et ce qu’on disait aux tables voisines.
On y causait de Iaokanann et des gens de son espèce ; Simon de Gittoï lavait les péchés avec du feu. Un certain Jésus…
— Le pire de tous, s’écria Éléazar. Quel infâme bateleur !
Derrière le Tétrarque, un homme se leva, pâle comme la bordure de sa chlamyde. Il descendit l’estrade, et, interpellant les Pharisiens :
— Mensonge ! Jésus fait des miracles !
Antipas désirait en voir.
— Tu aurais dû l’amener ! Renseigne-nous !
Alors il conta que lui, Jacob, ayant une fille malade, s’était rendu à Capharnaüm, pour supplier le Maître de vouloir la guérir. Le Maître avait répondu : « Retourne chez toi, elle est guérie ! » Et il l’avait trouvée sur le seuil, étant sortie de sa couche quand le gnomon du palais marquait la troisième heure, l’instant même où il abordait Jésus.
Certainement, objectèrent les Pharisiens, il existait des pratiques, des herbes puissantes ! Ici même, à Machærous, quelquefois on trouvait le baaras qui rend invulnérable ; mais guérir sans voir ni toucher était une chose impossible, à moins que Jésus n’employât les démons.
Et les amis d’Antipas, les principaux de la Galilée, reprirent, en hochant la tête :
— Les démons, évidemment.
Jacob, debout entre leur table et celle des prêtres, se taisait d’une manière hautaine et douce.
Ils le sommaient de parler :
— Justifie son pouvoir !
Il courba les épaules, et à voix basse, lentement, comme effrayé de lui-même :
— Vous ne savez donc pas que c’est le Messie ?
Tous les prêtres se regardèrent ; et Vitellius demanda l’explication du mot. Son interprète fut une minute avant de répondre.
Ils appelaient ainsi un libérateur qui leur apporterait la jouissance de tous les biens et la domination de tous les peuples. Quelques-uns même soutenaient qu’il fallait compter sur deux. Le premier serait vaincu par Gog et Magog, des démons du Nord ; mais l’autre exterminerait le Prince du Mal, et, depuis des siècles, ils l’attendaient à chaque minute.
Les prêtres s’étant concertés, Éléazar prit la parole.
D’abord le Messie serait enfant de David, et non d’un charpentier ; il confirmerait la Loi. Ce Nazaréen l’attaquait ; et, argument plus fort, il devait être précédé de la venue d’Élie.
Jacob répliqua :
— Mais il est venu, Élie !
— Élie ! Élie ! répéta la foule, jusqu’à l’autre bout de la salle.
Tous, par l’imagination, apercevaient un vieillard sous un vol de corbeaux, la foudre allumant un autel, des pontifes idolâtres jetés aux torrents ; et les femmes, dans les tribunes, songeaient à la veuve de Sarepta.
Jacob s’épuisait à redire qu’il le connaissait ! Il l’avait vu ! et le peuple aussi !
— Son nom ?
Alors, il cria de toutes ses forces :
— Iaokanann !
Antipas se renversa comme frappé en pleine poitrine. Les Sadducéens avaient bondi sur Jacob. Éléazar pérorait, pour se faire écouter.
Quand le silence fut établi, il drapa son manteau, et comme un juge posa des questions.
— Puisque le prophète est mort…
Des murmures l’interrompirent. On croyait Élie disparu seulement.
Il s’emporta contre la foule, et, continuant son enquête :
— Tu penses qu’il est ressuscité ?
— Pourquoi pas ? dit Jacob.
Les Sadducéens haussèrent les épaules ; Jonathas, écarquillant ses petits yeux, s’efforçait de rire comme un bouffon. Rien de plus sot que la prétention du corps à la vie éternelle ; et il déclama, pour le Proconsul, ce vers d’un poëte contemporain :
Mais Aulus était penché au bord du triclinium, le front en sueur, le visage vert, les poings sur l’estomac.
Les Sadducéens feignirent un grand émoi ; — le lendemain, la sacrificature leur fut rendue ; — Antipas étalait du désespoir ; Vitellius demeurait impassible. Ses angoisses étaient pourtant violentes ; avec son fils il perdait sa fortune.
Aulus n’avait pas fini de se faire vomir, qu’il voulut remanger.
— Qu’on me donne de la râpure de marbre, du schiste de Naxos, de l’eau de mer, n’importe quoi ! Si je prenais un bain ?
Il croqua de la neige, puis, ayant balancé entre une terrine de Commagène et des merles roses, se décida pour des courges au miel. L’Asiatique le contemplait, cette faculté d’engloutissement dénotant un être prodigieux et d’une race supérieure.
On servit des rognons de taureau, des loirs, des rossignols, des hachis dans des feuilles de pampre ; et les prêtres discutaient sur la résurrection. Ammonius, élève de Philon le Platonicien, les jugeait stupides, et le disait à des Grecs qui se moquaient des oracles. Marcellus et Jacob s’étaient joints. Le premier narrait au second le bonheur qu’il avait ressenti sous le baptême de Mithra, et Jacob l’engageait à suivre Jésus. Les vins de palme et de tamaris, ceux de Safet et de Byblos, coulaient des amphores dans les cratères, des cratères dans les coupes, des coupes dans les gosiers ; on bavardait, les cœurs s’épanchaient. Iaçim, bien que Juif, ne cachait plus son adoration des planètes. Un marchand d’Aphaka ébahissait des nomades, en détaillant les merveilles du temple d’Hiérapolis ; et ils demandaient combien coûterait le pèlerinage. D’autres tenaient à leur religion natale. Un Germain presque aveugle chantait un hymne célébrant ce promontoire de la Scandinavie, où les dieux apparaissent avec les rayons de leurs figures ; et des gens de Sichem ne mangèrent pas de tourterelles, par déférence pour la colombe Azima.
Plusieurs causaient debout, au milieu de la salle ; et la vapeur des haleines avec les fumées des candélabres faisait un brouillard dans l’air. Phanuel passa le long des murs. Il venait encore d’étudier le firmament, mais n’avançait pas jusqu’au Tétrarque, redoutant les taches d’huile qui, pour les Esséniens, étaient une grande souillure.
Des coups retentirent contre la porte du château.
On savait maintenant que Iaokanann s’y trouvait détenu. Des hommes avec des torches grimpaient le sentier ; une masse noire fourmillait dans le ravin ; et ils hurlaient de temps à autre :
— Iaokanann ! Iaokanann !
— Il dérange tout ! dit Jonathas.
— On n’aura plus d’argent, s’il continue ! ajoutèrent les Pharisiens.
Et des récriminations partaient :
— Protège-nous !
— Qu’on en finisse !
— Tu abandonnes la religion !
— Impie comme les Hérode !
— Moins que vous ! répliqua Antipas. C’est mon père qui a édifié votre temple !
Alors, les Pharisiens, les fils des proscrits, les partisans des Matathias, accusèrent le Tétrarque des crimes de sa famille.
Ils avaient des crânes pointus, la barbe hérissée, des mains faibles et méchantes, ou la face camuse, de gros yeux ronds, l’air de bouledogues. Une douzaine, scribes et valets des prêtres, nourris par le rebut des holocaustes, s’élancèrent jusqu’au bas de l’estrade ; et avec des couteaux ils menaçaient Antipas, qui les haranguait, pendant que les Sadducéens le défendaient mollement. Il aperçut Mannaëi, et lui fit signe de s’en aller, Vitellius indiquant par sa contenance que ces choses ne le regardaient pas.
Les Pharisiens, restés sur leur triclinium, se mirent dans une fureur démoniaque. Ils brisèrent les plats devant eux. On leur avait servi le ragoût chéri de Mécène, de l’âne sauvage, une viande immonde.
Aulus les railla à propos de la tête d’âne, qu’ils honoraient, disait-on, et débita d’autres sarcasmes sur leur antipathie du pourceau. C’était sans doute parce que cette grosse bête avait tué leur Bacchus ; et ils aimaient trop le vin, puisqu’on avait découvert dans le Temple une vigne d’or.
Les prêtres ne comprenaient pas ses paroles. Phinées, Galiléen d’origine, refusa de les traduire. Alors sa colère fut démesurée, d’autant plus que l’Asiatique, pris de peur, avait disparu ; et le repas lui déplaisait, les mets étant vulgaires, point déguisés suffisamment ! Il se calma, en voyant des queues de brebis syriennes, qui sont des paquets de graisse.
Le caractère des Juifs semblait hideux à Vitellius. Leur dieu pouvait bien être Moloch, dont il avait rencontré des autels sur la route ; et les sacrifices d’enfants lui revinrent à l’esprit, avec l’histoire de l’homme qu’ils engraissaient mystérieusement. Son cœur de Latin était soulevé de dégoût par leur intolérance, leur rage iconoclaste, leur achoppement de brute. Le Proconsul voulait partir. Aulus s’y refusa.
La robe abaissée jusqu’aux hanches, il gisait derrière un monceau de victuailles, trop repu pour en prendre, mais s’obstinant à ne point les quitter.
L’exaltation du peuple grandit. Ils s’abandonnèrent à des projets d’indépendance. On rappelait la gloire d’Israël. Tous les conquérants avaient été châtiés : Antigone, Crassus, Varus…
— Misérables ! dit le Proconsul.
Car il entendait le syriaque ; son interprète ne servait qu’à lui donner du loisir pour répondre. Antipas, bien vite, tira la médaille de l’Empereur, et, l’observant avec tremblement, il la présentait du côté de l’image.
Les panneaux de la tribune d’or se déployèrent tout à coup ; et à la splendeur des cierges, entre ses esclaves et des festons d’anémone, Hérodias apparut, — coiffée d’une mitre assyrienne qu’une mentonnière attachait à son front ; ses cheveux en spirales s’épandaient sur un péplos d’écarlate, fendu dans la longueur des manches. Deux monstres en pierre, pareils à ceux du trésor des Atrides, se caressant contre la porte, elle ressemblait à Cybèle accotée de ses lions ; et du haut de la balustrade qui dominait Antipas, avec une patère à la main, elle cria :
— Longue vie à César !
Cet hommage fut répété par Vitellius, Antipas et les prêtres.
Mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d’admiration. Une jeune fille venait d’entrer.
Sous un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de ses yeux, les calcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie gorge-pigeon, en couvrant les épaules, tenait aux reins par une ceinture d’orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragores, et d’une manière indolente elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri.
Sur le haut de l’estrade, elle retira son voile. C’était Hérodias, comme autrefois dans sa jeunesse. Puis, elle se mit à danser.
Ses pieds passaient l’un devant l’autre, au rythme de la flûte et d’une paire de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu’un, qui s’enfuyait toujours. Elle le poursuivait, plus légère qu’un papillon, comme une Psyché curieuse, comme une âme vagabonde, et semblait prête à s’envoler.
Les sons funèbres de la gingras remplacèrent les crotales. L’accablement avait suivi l’espoir. Ses attitudes exprimaient des soupirs, et toute sa personne une telle langueur qu’on ne savait pas si elle pleurait un dieu, ou se mourait dans sa caresse. Les paupières entre-closes, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins, et son visage demeurait immobile, et ses pieds n’arrêtaient pas.
Vitellius la compara à Mnester, le pantomime. Aulus vomissait encore. Le Tétrarque se perdait dans un rêve, et ne songeait plus à Hérodias. Il crut la voir près des Sadducéens. La vision s’éloigna. Ce n’était pas une vision. Elle avait fait instruire, loin de Machærous, Salomé sa fille, que le Tétrarque aimerait ; et l’idée était bonne. Elle en était sûre, maintenant !
Puis ce fut l’emportement de l’amour qui veut être assouvi. Elle dansa comme les prêtresses des Indes, comme les Nubiennes des cataractes, comme les bacchantes de Lydie. Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite. Les brillants de ses oreilles sautaient, l’étoffe de son dos chatoyait ; de ses bras, de ses pieds, de ses vêtements jaillissaient d’invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Une harpe chanta ; la multitude y répondit par des acclamations. Sans fléchir ses genoux en écartant les jambes, elle se courba si bien que son menton frôlait le plancher ; et les nomades habitués à l’abstinence, les soldats de Rome experts en débauches, les avares publicains, les vieux prêtres aigris par les disputes, tous, dilatant leurs narines, palpitaient de convoitise.
Ensuite elle tourna autour de la table d’Antipas, frénétiquement, comme le rhombe des sorcières ; et d’une voix que des sanglots de volupté entrecoupaient, il lui disait :
— Viens ! viens !
Elle tournait toujours ; les tympanons sonnaient à éclater, la foule hurlait.
Mais le Tétrarque criait plus fort :
— Viens ! viens ! Tu auras Capharnaüm ! la plaine de Tibérias ! mes citadelles ! la moitié de mon royaume !
Elle se jeta sur les mains, les talons en l’air, parcourut ainsi l’estrade comme un grand scarabée ; et s’arrêta, brusquement.
Sa nuque et ses vertèbres faisaient un angle droit. Les fourreaux de couleur qui enveloppaient ses jambes, lui passant par-dessus l’épaule, comme des arcs-en-ciel, accompagnaient sa figure à une coudée du sol. Ses lèvres étaient peintes, ses sourcils très noirs, ses yeux presque terribles, et des gouttelettes à son front semblaient une vapeur sur du marbre blanc.
Elle ne parlait pas. Ils se regardaient.
Un claquement de doigts se fit dans la tribune. Elle y monta, reparut ; et, en zézayant un peu, prononça ces mots, d’un air enfantin :
— Je veux que tu me donnes dans un plat, la tête…
Elle avait oublié le nom, mais reprit en souriant :
— La tête de Iaokanann !
Le Tétrarque s’affaissa sur lui-même, écrasé.
Il était contraint par sa parole, et le peuple attendait. Mais la mort qu’on lui avait prédite, en s’appliquant à un autre, peut-être détournerait la sienne ? Si Iaokanann était véritablement Élie, il pourrait s’y soustraire ; s’il ne l’était pas, le meurtre n’avait plus d’importance.
Mannaëi était à ses côtés, et comprit son intention.
Vitellius le rappela pour lui confier le mot d’ordre, des sentinelles gardant la fosse.
Ce fut un soulagement. Dans une minute, tout serait fini !
Cependant, Mannaëi n’était guère prompt en besogne.
Il rentra, mais bouleversé.
Depuis quarante ans il exerçait la fonction de bourreau. C’était lui qui avait noyé Aristobule, étranglé Alexandre, brûlé vif Matathias, décapité Sosime, Pappus, Joseph et Antipater ; et il n’osait tuer Iaokanann ! Ses dents claquaient, tout son corps tremblait.
Il avait aperçu devant la fosse le Grand Ange des Samaritains, tout couvert d’yeux et brandissant un immense glaive, rouge, et dentelé comme une flamme. Deux soldats amenés en témoignage pouvaient le dire.
Ils n’avaient rien vu, sauf un capitaine juif, qui s’était précipité sur eux, et qui n’existait plus.
La fureur d’Hérodias dégorgea en un torrent d’injures populacières et sanglantes. Elle se cassa les ongles au grillage de la tribune, et les deux lions sculptés semblaient mordre ses épaules et rugir comme elle.
Antipas l’imita, les prêtres, les soldats, les Pharisiens, tous réclamant une vengeance, et les autres, indignés qu’on retardât leur plaisir.
Mannaëi sortit, en se cachant la face.
Les convives trouvèrent le temps encore plus long que la première fois. On s’ennuyait.
Tout à coup, un bruit de pas se répercuta dans les couloirs. Le malaise devenait intolérable.
La tête entra ; — et Mannaëi la tenait par les cheveux, au bout de son bras, fier des applaudissements.
Quand il l’eut mise sur un plat, il l’offrit à Salomé.
Elle monta lestement dans la tribune ; plusieurs minutes après, la tête fut rapportée par cette vieille femme que le Tétrarque avait distinguée le matin sur la plate-forme d’une maison, et tantôt dans la chambre d’Hérodias.
Il se reculait pour ne pas la voir. Vitellius y jeta un regard indifférent.
Mannaëi descendit l’estrade, et l’exhiba aux capitaines romains, puis à tous ceux qui mangeaient de ce côté.
Ils l’examinèrent.
La lame aiguë de l’instrument, glissant du haut en bas, avait entamé la mâchoire. Une convulsion tirait les coins de la bouche. Du sang, caillé déjà, parsemait la barbe. Les paupières closes étaient blêmes comme des coquilles ; et les candélabres à l’entour envoyaient des rayons.
Elle arriva à la table des prêtres. Un Pharisien la retourna curieusement ; et Mannaëi, l’ayant remise d’aplomb, la posa devant Aulus, qui en fut réveillé. Par l’ouverture de leurs cils, les prunelles mortes et les prunelles éteintes semblaient se dire quelque chose.
Ensuite, Mannaëi la présenta à Antipas. Des pleurs coulèrent sur les joues du Tétrarque.
Les flambeaux s’éteignaient. Les convives partirent ; et il ne resta plus dans la salle qu’Antipas, les mains contre ses tempes, et regardant toujours la tête coupée, tandis que Phanuel, debout au milieu de la grande nef, murmurait des prières, les bras étendus.
À l’instant où se levait le soleil, deux hommes, expédiés autrefois par Iaokanann, survinrent, avec la réponse si longtemps espérée.
Ils la confièrent à Phanuel, qui en eut un ravissement.
Puis il leur montra l’objet lugubre, sur le plateau, entre les débris du festin. Un des hommes lui dit :
— Console-toi ! Il est descendu chez les morts annoncer le Christ !
L’Essénien comprenait maintenant ces paroles : « Pour qu’il croisse, il faut que je diminue. »
Et tous les trois, ayant pris la tête de Iaokanann, s’en allèrent du côté de la Galilée.
Comme elle était très lourde, ils la portaient alternativement.
Chacun connaît la source où Flaubert a recueilli les développements de ce conte : deux courts passages des Évangiles de Marc et de Mathieu. La pieuse tradition lui a fourni les protagonistes et les péripéties du drame et jusqu’à certaines indications en quelque sorte scéniques : le banquet, les hésitations du tétrarque, l’intervention d’Hérodias, la danse de Salomé, le serment d’Hérode Antipas. Quant au personnage du Baptiste, Flaubert en connaissait, à la vérité, fort peu de chose, et nous n’en savons guère plus que lui.
Il était contemporain de Jésus. Il mourut quelques années avant lui, sous le règne de Tibère, par ordre du tétrarque Antipas.
C’était un homme extraordinaire. Sa jeunesse était entourée de légendes, et l’on disait que des miracles avaient favorisé sa naissance. Comme les Esséniens ses frères, il vivait, dans la solitude, sur les bords de la mer Morte, parmi les sables et les rochers de Judée, la vie délicieuse et rude des anachorètes. Insensibles aux douceurs du monde, n’ayant pour tout vêtement qu’un grossier manteau en poil de chameau, ils se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage et chaque matin purifiaient leur corps dans l’eau des fontaines. C’est pourquoi on les appela les baptistes ; et ils se nommaient aussi thérapeutes ou guérisseurs des âmes.
Mais Jean les surpassait tous par sa sainteté : elle était merveilleuse et terrible. Parfois, il sortait de sa retraite pour appeler les foules au baptême ; alors, avec des paroles enflammées, il dénonçait les impuretés, flétrissait l’avidité des riches et vouait leurs crimes à l’exécration des fidèles. Son invective était affreuse et magnifique. Jamais, depuis Élie, le peuple n’en avait entendu de plus éloquente. Animé par l’esprit des prophètes, la bouche pleine de catastrophes, il semblait porter en lui le génie d’un Dieu irrité. On disait qu’il était Élie, ressuscité d’entre les morts pour annoncer le jugement dernier. Son influence grandissait tous les jours ; il eût pu, s’il l’avait voulu, provoquer des émeutes.
Et parce que son zèle à poursuivre le vice ne connaissait aucune borne, il osa s’attaquer au tétrarque Antipas. Fils de cet Hérode, roi des Juifs, qui par l’atrocité de ses crimes autant que par ses talents a mérité d’être appelé le Grand, Antipas régnait sur ces territoires ou Jean avait entrepris d’étonner les hommes par la candeur de son âme et la violence de son langage. L’impureté de ce prince le désignait aux imprécations du Baptiste : en épousant Hérodias il avait scandalisé les docteurs, violé la loi religieuse et assis l’adultère et l’inceste[2] sur le trône. Car Hérodias était sa belle-sœur et sa nièce. Le jour où il la rencontra, ils étaient déjà mariés l’un et l’autre, lui avec une princesse arabe, elle avec un frère d’Antipas. Elle vivait avec cet Hérode en Italie, tristement, loin du pouvoir et le cœur dévoré d’ambition, lorsque Antipas lui apparut : il se rendait à Rome et venait demander à son frère l’hospitalité. Séduit par la beauté d’Hérodias, il oublia dans ses bras leur parenté, leur condition, les lois divines et humaines. Et l’ayant prise à son frère il l’épousa, après avoir chassé sa première femme sous les tentes paternelles.
Jean-Baptiste n’hésita pas à dénoncer le crime d’Antipas. C’est pourquoi il fut arrêté, chargé de liens et jeté au fond d’une fosse, dans la citadelle de Machœrous. Cela se passait entre la vingt-sixième et la trentième année de notre ère.
« Or Hérode, ayant envoyé saisir Jean, l’avait fait lier et mettre en prison, à cause d’Hérodias, femme de Philippe[3] son frère, qu’il avait épousée ;
« Parce que Jean disait à Hérode : il ne vous est pas permis d’avoir la femme de votre frère. »
« Hérode aurait voulu le faire mourir, mais il craignait le peuple, parce qu’on regardait Jean comme un prophète.
« Mais le jour de la naissance d’Hérode, il fit un festin aux grands de sa cour, aux premiers officiers de ses troupes et aux principaux de la Galilée.
« Et la fille d’Hérodias, étant entrée, et ayant dansé devant Hérode, lui plut tellement, et à ceux qui étaient à table avec lui, qu’il lui dit : « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. »
« Et il dit avec serment : « Je te donnerai tout ce que tu me demanderas, quand ce serait la moitié de mon royaume. »
« Et elle, étant sortie, dit à sa mère : « Que demanderai-je ? » Sa mère lui répondit : « La tête de Jean le Baptiste. »
Et étant rentrée tout aussitôt où était Hérode, elle lui dit :
« Je veux tout présentement, dans un plateau, la tête de Jean le Baptiste. »
« Hérode en fut attristé. Néanmoins, à cause du serment qu’il avait fait, et de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas lui refuser.
« Aussi, ayant envoyé un de ses gardes, il commanda qu’on apportât la tête de Jean dans un plateau. Et le garde lui coupa la tête dans sa prison.
« Et il apporta la tête dans un plateau, la donna à la fille et la fille la donna à la mère.
« Ce que des disciples de Jean ayant appris, ils vinrent enlever son corps et le mirent dans un tombeau. »
Ainsi s’expriment Marc et Mathieu, évangélistes. Ne cherchons pas à savoir si leur pieuse relation doit être crue tout entière ; ne nous demandons pas s’ils ont fidèlement rapporté les circonstances de la mort du Baptiste, et si la vérité ne serait pas plutôt dans ce récit de l’historien Josèphe (Ant. Jud., xviii) qui, sans faire intervenir Hérodias, ni Salomé, fait périr saint Jean pour la crainte politique que son influence inspirait à Hérode Antipas. Il est vain de chercher ici la vérité historique. En une semblable matière, c’est le récit le plus fécond en pathétique, en beauté, qui est le plus vrai. Des deux versions, celle de Flavius Josèphe et celle des évangélistes, la première est peut-être plus fidèle, mais elle est demeurée stérile. La seconde seule fut féconde ; elle le fut infiniment. Et, pour avoir suscité le conte admirable de Flaubert, elle mérite d’être tenue pour l’expression d’une vérité supérieure.
Agrippa, frère d’Hérodias ; il était né, comme elle, du mariage de Bérénice et d’Aristobule, un des fils d’Hérode le Grand. Il remplit quelque temps à Tibérias la charge de surveillant des marchés : mais l’autorité du tétrarque Antipas, dont il relevait, pesait à son âme ambitieuse. Il démissionna, se rendit en Syrie, puis à Rome, où il avait été élevé comme la plupart de ses frères, et parvint à se faire admettre dans l’entourage intime de Caïus (Caligula), l’héritier présomptif de l’Empire. Son zèle pour Caïus faillit lui coûter la vie : il souhaitait la mort de Tibère avec si peu de discrétion, que l’empereur lui-même en fut informé. Il le fit jeter en prison.
C’est à cette incarcération qu’Hérodias fait allusion par deux fois, page 143 et page 154 : elle en offre la nouvelle d’abord à Antipas, puis à Vitellius. Malheureusement, le désir, manifeste chez Flaubert, de concentrer dans son récit le plus de faits historiques possible, lui a fait commettre là une erreur chronologique assez grave : lorsque Agrippa fut emprisonné, non seulement Iaokanann était mort depuis longtemps, mais il y avait plusieurs années que Jésus lui-même avait été crucifié. L’incarcération d’Agrippa a précédé de six mois, d’un an au plus, la mort de Tibère : elle est donc de la fin de l’année 36 ap. Jésus-Christ ; or Jean le Baptiste a été décapité entre 26 et 30. Dans le scénario du conte (voir ci-après p. 206) l’erreur de chronologie était encore plus accentuée : Flaubert y annonçait non plus l’incarcération d’Agrippa, mais sa mort, survenue longtemps après. En vérifiant ses notes, Flaubert a atténué ce lapsus, mais ne l’a pas fait entièrement disparaître du conte.
(Voyez Eutychès).
Alexandre, dont le supplice est relaté par Flaubert page 188, était un des fils d’Hérode le Grand et de la belle Mariamne. Comme son frère Aristobule, il fut étranglé à Sébaste (Samarie), l’an 6 av. J.-C., par ordre de son père, pour avoir conspiré contre sa vie. Cette accusation, qui avait été portée contre Alexandre et Aristobule par l’exécrable Antipater, leur demi-frère, ne paraît avoir eu de fondement que dans les odieuses imaginations de ce dernier.
Antigone (p. 183), roi des Juifs, prédécesseur d’Hérode le Grand. C’est sur lui qu’Hérode conquit le royaume de Judée, après de sanglantes batailles et malgré les secours que les Parthes apportaient à Antigone. Hérode ne triompha que grâce à l’appui des troupes romaines, dont un général, Sosius, finit par s’emparer d’Antigone dans Jérusalem. Marc-Antoine fit trancher la tête au prisonnier.
Antipas était le septième de quatorze enfants que le Grand Hérode avait eus de ses huit femmes (Doris ; Mariamne l’Asmonéenne, si belle qu’après l’avoir fait mettre à mort sur un soupçon d’adultère, Hérode fut pris d’un remords affreux et fit conserver dans du miel, pendant sept ans, le corps de cette princesse ; Mariamne II, fille de Simon le grand-prêtre ; Malthace la Samaritaine, mère d’Hérode Antipas ; Cléopâtre de Jérusalem ; Pallas ; Phèdre et Elpis ; sans compter deux autres femmes, dont le nom n’a pas été conservé).
Ceux des autres fils d’Hérode que Flaubert a mentionnés sont : Philippe, futur mari de Salomé ; Alexandre, Antipater, tués sur l’ordre de leur père ; enfin le premier mari d’Hérodias, Hérode, déshérité par son père et qui vivait en Italie. Antipas, auquel le testament d’Hérode le Grand attribuait la tétrarchie de Galilée et de Pérée, fut maintenu dans ses fonctions par Auguste. Il les conserva jusqu’à ce que Caligula les lui eût retirées et l’eût envoyé en exil.
Antipater (IV), dont l’exécution est rappelée page 188, était fils d’Hérode le Grand et de Doris, sa première femme.
Après avoir dénoncé à Hérode d’imaginaires complots, qui lui permirent de compromettre et de faire exécuter deux de ses frères (Alexandre et Aristobule), Antipater finit par conspirer lui-même contre la vie de son père, à la faveur de la maladie qui terrassait ce dernier. Hérode découvrit le complot, et, tout moribond qu’il était, fit exécuter Antipater (4. av. J.-C.).
Antonia (Tour), forteresse élevée en l’honneur de Marc-Antoine à Jérusalem par Hérode le Grand.
Aristobule, dont Flaubert rappelle le meurtre page 188, n’est pas celui dont il a été question ci-dessus (v° Antipater) : c’est son oncle, le frère de Mariamne. Hérode l’éleva à dix-sept ans à la dignité de Grand sacrificateur ; mais un an ne s’était pas écoulé que, jaloux de sa prodigieuse beauté et inquiet de son influence, il le fit noyer (33 av. J.-C.).
Aulus (Vittelius), fils de L. Vitellius, le proconsul. Proclamé Empereur par les légions de Germanie (68 ap. J.-C.) il fut tué à Rome avant d’avoir pu jouir du pouvoir, par les partisans de Vespasien, qui, de son côté, s’était fait proclamer Empereur par les légions de Judée et de Syrie.
Aulus a-t-il assisté à l’exécution de Jean le Baptiste ? C’est peu probable. En tout cas, il était fort jeune lorsque cet événement se produisit. La décollation de Jean se place entre 26 et 30 après Jésus-Christ. Aulus, qui était né le 14 septembre de l’an 15, avait donc, à ce moment, entre onze et quinze ans.
(Voyez : Vitellius).
Azima. — « On a coutume de citer que les Samaritains ont rendu, sur Garizim, les honneurs divins à une colombe, sous le nom d’Achima. C’est une inculpation juive, qui n’est provenue sans doute que d’une fausse interprétation faite à dessein ». (Strauss, Vie de Jésus, t. l, sect. II, chap. II, § L).
Baaras, plante du Liban, à laquelle on attribuait des propriétés merveilleuses : lumineuse la nuit, invisible le jour, elle conjurait l’effet des maléfices et changeait en or les métaux.
Caïus, Empereur (37-41), sous le nom de Caligula ; il était héritier présomptif au moment de la mort de Jean le Baptiste.
Clites, peuples de la Cilicie que Vitellius contraignit à payer l’impôt impérial.
Engaddi, ville de Palestine, près de la mer Morte. Ses environs sont fertiles en vignes ; ils produisirent, d’après la tradition, la fameuse grappe de raisin que les explorateurs envoyés par Moïse rapportèrent sur un bâton.
C’est aussi dans le voisinage de cette ville que les anachorètes esséniens, au temps d’Hérode Antipas, vivaient leur existence singulière.
Esséniens, sectaires juifs, qui dépassaient les Pharisiens eux-mêmes par leur austérité, leur piété et la sévérité de leurs principes. Préoccupés d’éviter tout contact impur, de se laver de toute souillure, même inconsciente, d’atteindre par la prière et la pratique d’une vie édifiante une sorte d’extase prophétique, ils menaient une existence exemplaire dont les traits caractéristiques étaient la recherche de la solitude ascétique et le bain quotidien purificateur. Iaokanann était des leurs.
Eutychès. — Hérodias, annonçant au tétrarque que son frère Agrippa vient d’être jeté en prison par Tibère pour avoir souhaité l’Empire à Caïus, s’attribue le mérite de cette incarcération : « Elle étala son entreprise ; les clients achetés, les lettres découvertes,… et comment elle était parvenue à séduire Eutychès le dénonciateur », etc. (p. 143).
Que le propos d’Agrippa sur la mort de Tibère, trop lente à son gré, ait été rapporté à l’Empereur par un certain Eutychus ou Eutychès, c’est ce que l’historien Flavius Josèphe déclare en effet (xviii, 8). Mais il ne semble pas qu’Hérodias ait été pour rien dans sa dénonciation, ni qu’on ait eu besoin de si savantes machinations pour compromettre Agrippa : il était homme à se compromettre tout seul, comme Eutychus à le trahir. « Un jour qu’Agrippa était dans son char avec Caïus, ils en vinrent à parler de Tibère. Agrippa exprima le vœu qu’il fit bientôt place à Caïus. Eutychès, son affranchi, qui conduisait le char, entendit ce propos ; et quelque temps après, Agrippa l’ayant accusé de l’avoir volé, ce qui était exact, au lieu de se défendre contre cette accusation, il se déclara en mesure de révéler à Tibère un secret qui importait à sa sûreté. C’est ainsi que l’Empereur apprit les paroles d’Agrippa. »
Tel est le récit de Josèphe. Il n’accordait pas assez aux intrigues d’Hérodias pour que Flaubert l’accueillît sans l’orner.
Galbanum, résine d’une ombellifère de Syrie.
Garizim, montagne de Palestine dans la tribu d’Ephraïm, sur laquelle les Samaritains élevèrent un temple.
Gingras, petites flûtes usitées en Phénicie.
Hébron. La plus ancienne ville de Palestine, à 35 kilomètres de Jérusalem. C’est la terre rouge d’Hébron qui, d’après la tradition, aurait servi à former le premier homme, et c’est à Hébron qu’Adam, fondateur de la ville, serait mort. Abraham, Sarah, Isaac, Rébecca, Jacob et Lia y ont été également ensevelis. On croit que Iaokanann était originaire d’Hébron.
Hérodias ou Hérodiade, fille d’Aristobule (un des fils d’Hérode le Grand) et de Bérénice. Hérodias épousa d’abord un de ses oncles nommé Hérode., (Voyez la Notice.)
[La version de Marc (Évangile, vi, 17) et de Mathieu (Évangile, xiv, 3) qui donnent à Hérodias pour premier mari Philippe, est erronée. Philippe, qui était également un des oncles d’Hérodias, épousa non pas Hérodias, mais sa fille Salomé.]
Puis, ayant séduit le tétrarque Antipas, frère de son mari, et, par conséquent, lui aussi son oncle, elle se fit épouser par lui.
Lorsque Caligula retira à Antipas sa tétrarchie et l’exila dans les Gaules, à Lyon, Hérodias refusa de subir un sort meilleur : elle le suivit dans son exil. D’un passage de Flavius Josèphe (De bell. Jud., xvi) il semble résulter que, de Lyon, ils allèrent en Espagne.
Hyrcan (Hyrcanus II). — Ce grand-prêtre et roi de Jérusalem, l’un des plus cléments et des plus faibles qui aient régné sur la Judée (19-40 av. J.-C.), subit les fortunes les plus diverses et connut tour à tour la douceur et l’amertume du pouvoir. Renversé par son jeune Frère Aristobule, il fut rétabli par Jules César avec le titre d’ethnarque (47 av. J.-C.). Son triomphe fut de courte durée : le fils d’Aristobule, Antigone, le détrôna de nouveau et, non content de l’avoir exilé à Babylone, lui coupa les oreilles, ce qui le rendait impropre à exercer les fonctions de grand-prêtre. Mais c’est encore Hérode qui devait infliger à ce malheureux le dernier supplice : il l’attira à Jérusalem, le combla de présents et lui fit trancher la tête sous prétexte qu’il complotait contre lui avec le roi des Arabes (33 av. J.-C.).
Iaokanann (Jean le Baptiste). — Voyez la notice en tête de l’Index, et, en outre : Renan, Vie de Jésus, passim. ; Strauss, Nouv. Vie de Jésus, liv. I, xxx ; Grætz, Hist. des Juifs, II, Sectes ; Jewish Encycl., s. vo John the Baptist, etc.
Jézabel, femme d’Achab ; reine impie qui persécuta les prophètes, menaça de mort Élie, etc. (Rois, xvi, 31 ; xviii, 5, 13 ; xix, 2 ; etc.)
Joseph (p. 188 : « il avait décapité Joseph »).
Ce Joseph était l’oncle d’Hérode le Grand ; il était également son beau-frère, ayant épousé Salomé, sœur d’Hérode. Lorsque Hérode dut se rendre à Laodicée, pour se justifier devant l’Empereur du meurtre d’Aristobule (voir ci-dessus), il confia à Joseph sa femme Mariamne l’Asmonéenne, avec ordre de la mettre à mort s’il ne revenait pas. Il revint ; mais ce fut pour apprendre que Joseph avait employé pour consoler la belle Mariamne des moyens qu’Hérode entendait se réserver. Joseph avait-il été vraiment adultère ? Cette accusation n’était-elle pas plutôt une calomnie de sa femme, la ténébreuse Salomé ? Hérode, sans approfondir le problème, trouva plus simple de le résoudre en supprimant son objet : Joseph fut exécuté sans jugement l’an 33 avant Jésus-Christ.
La même mésaventure devait arriver, trois ans plus tard, à l’un des familiers d’Hérode, Sohémus (voir Sosime).
Laticlave, robe bordée d’une bande de pourpre, portée par les sénateurs romains.
Machœrus (Machœrus, Mulcaur ou Machero). — Cette citadelle, édifiée par Alexandre Jannée, roi des Juifs, élevait, aux confins de la Palestine et de l’Arabie, à l’Est de la mer Morte, ses murailles où les princes Asmonéens abritaient leurs trésors. Elle subit plus d’une fois les rigueurs de la guerre. Assiégée et conquise par Gabinius, général romain, qui en fit saper les fortifications et la rasa jusqu’au sol, puis reprise par le roi Aristobule, et de nouveau abandonnée, la citadelle fut restaurée par Hérode, qui, pour se protéger contre les attaques des Arabes, porta au plus haut degré la puissance de la forteresse : c’était, dit Pline, la place la plus forte de la Palestine, après Jérusalem.
La ville de Machœrus serait l’actuelle Mulsaur (Raumer, Palästina, p. 264.). Voir Jewish Encycl., s. vo Machœrus.
Mattathias (ben Margalot), docteur de la loi, brûlé vif sur l’ordre d’Hérode le Grand, avec quarante-deux habitants de Jérusalem, pour avoir voulu enlever les aigles romaines de la grille du Temple (p. 188).
Mithra ou Mithras, dieu des anciens Perses, dont le culte s’introduisit à Rome vers 67 avant Jésus-Christ et fut aboli au IVe siècle.
Néhémias ou Néhémie. — Juif qui raconte sa propre histoire dans le second livre d’Esdras (Ve siècle avant J.-C.). Captif en Perse, il obtint du roi Artaxercès Longue-Main, dont il était l’échanson et le favori, le droit d’aller relever Jérusalem. Il accomplit cette œuvre avec un génie admirable, rebâtissant les quartiers de la ville et ses murs, pacifiant le peuple, lui enseignant la foi dans ses destinées, remettant surtout la loi (thora) en vigueur. C’est sous son gouvernement que le dernier des prophètes, Malachie, prédit qu’un jour Élie ressusciterait d’entre les morts pour annoncer le Jugement dernier ; et c’est, sans doute, à cette prophétie que Flaubert fait allusion, page 146.
Pappus (p.188), général d’Antigone ; il dirigeait les troupes de ce dernier contre les trois Hérode (Hérode le Grand, Joseph et Phéroras, ses deux frères). Joseph ayant été défait et tué par Pappus, celui-ci fit trancher la tête de son cadavre, malgré les supplications de Phéroras qui offrait de racheter le corps de son frère pour cinquante talents. Mais Pappus, à son tour, fut battu et tué par les troupes d’Hérode. Hérode fit trancher la tête de son cadavre et envoya ce trophée à Joseph, pour le consoler du sort de Phéroras, leur frère commun.
Pharisiens. — Juifs orthodoxes, conservateurs, qui professaient l’observance rigoureuse de la loi et de la tradition.
Philippe (Hérode), oncle d’Hérodias et d’Agrippa, et frère du tétrarque Antipas. Philippe avait reçu d’Hérode le Grand, son père, la tétrarchie de Batanée, de Gaulanitide et de Trachonitide, avec la ville de Panéas, ou Césarée de Philippe. Il épousa Salomé, fille d’Hérodias.
Sadducéens, secte juive, qui recrutait principalement ses adeptes dans le clergé et l’aristocratie. Comme ils détenaient en général l’autorité politique, les Sadducéens étaient, par la force même des choses et par l’effet de leurs fonctions, obligés de compter avec le siècle. De là des principes religieux moins rigoureux et moins traditionalistes que ceux des Pharisiens, qui leur reprochaient de vouloir accommoder la Loi avec le temporel.
Salomé, fille d’Hérodias et de son premier mari Hérode. C’est elle qui, selon la tradition évangélique, aurait obtenu du tétrarque Antipas la tête de Iaokanann.
On ne doit pas la confondre avec les autres princesses de ce nom, notamment avec Salomé, sœur d’Hérode le Grand.
Sarepta ou Sarybtha. — Ville ou le prophète Élie fut nourri par une pauvre veuve, dont il ressuscita le fils (Rois, xvii, 9).
Sosime. — Ce personnage, dont Flaubert mentionne l’exécution p. 188, ne semble pas avoir été nommé par les historiens d’Hérode le Grand. Peut-être s’agit-il de ce Sobémus, qui, pour avoir été constitué gardien de la belle Mariamne, pendant un voyage d’Hérode (30 av. J.-C.), se vit, au retour du roi, accusé comme l’avait été Joseph (voir ci-dessus) et fut mis à mort comme lui.
Tétrarque. — Dans l’ancien droit public grec, lorsqu’une cité ou un état était divisé en quatre parties, le gouverneur de chacune d’elles portait le titre de tétrarque. Cette institution, tombée en désuétude à l’époque historique, puis rétablie en Macédoine par Philippe, fut empruntée aux Grecs par les Romains. Mais elle ne correspondait plus exactement à ce qu’elle était à l’origine. Les tétrarques romains étaient des sortes de rois-protégés.
Tibérias ou Tibériade. — Ville qu’Hérode Antipas fonda sur les bords du lac de Génézareth et qu’il appela de ce nom pour se concilier la faveur de Tibère.
Umbo, partie centrale du bouclier.
Vitellius (Lucius), proconsul, père d’Aulus Vitellius.
Sa présence à Machærous le jour du supplice de Jean le Baptiste n’est qu’une ingénieuse hypothèse artistique de Flaubert, qui s’autorise peut-être de ce passage de Saint-Marc (Évangile, vi, 21) : « Hérode fit un festin aux grands de sa cour, aux premiers officiers de ses troupes et aux principaux de la Galilée ».
En réalité, l’arrivée de Vitellius et des troupes romaines en Galilée est notablement postérieure à l’exécution du Baptiste. C’est du moins ce qui résulte formellement de Josèphe (Ant. Jud., xviii, 7). En effet, d’après ce texte, si Vitellius vint en Galilée, ce fut, comme l’a d’ailleurs noté Flaubert, pour répondre à l’appel d’Antipas, dont l’armée venait d’être taillée en pièces par l’émir de Pétra. « Or, le peuple avait vu dans cette défaite le châtiment de la mort du Baptiste. » Il faut donc admettre que la décollation de Jean et les hostilités contre l’émir ont précédé, et sans doute de plusieurs mois, l’arrivée de Vitellius.
Quant à la haine de Vitellius contre le tétrarque Antipas, elle avait une origine historique ; mais Flaubert, dans son désir d’«expliquer » le moins possible, l’a-t-il rendue suffisamment intelligible au lecteur ? « Vitellius, dit-il, avait tiré des otages du roi des Parthes, et l’Empereur n’y songeait plus ; car Antipas, présent à la conférence, pour se faire valoir, en avait tout de suite expédié la nouvelle. De là une haine profonde, et les retards à fournir des secours » (page 155.)
Ce passage, qui, par son extrême concision, est un des exemples les plus typiques du procédé d’exposition synthétique cher à Flaubert, demeurerait fort obscur si l’on ne se souvenait du récit suivant de Flavius Josèphe, dont il n’est que la condensation : « Tibère, désirant contracter alliance avec le roi des Parthes Artabane, ce prince et Vitellius se rencontrèrent sur un pont de l’Euphrate. Lorsqu’ils furent convenus des conditions du traité, Hérode le Tétrarque leur donna un superbe et somptueux festin ; peu après, Artabane envoya son propre fils en otage à Tibère, avec de nombreux présents… ; Hérode, voulant être le premier à donner à Tibère la nouvelle des otages qu’on avait obtenus d’Artabane, lui envoya en toute hâte un courrier et l’informa de toutes choses si minutieusement, que Vitellius ne pouvait plus rien lui mander qu’il ne sût déjà. Aussi, lorsque Tibère reçut le message de Vitellius, ne put-il rien lui répondre, si ce n’est que ce message ne lui apprenait rien. De là, chez Vitellius, une haine violente contre Hérode Antipas. » (Ant. Jud., xviii, 7).
NOTES
de
HÉRODIAS.
« Hérodias a été inspiré par les sculptures d’un des portails latéraux de la cathédrale de Rouen. » (Max. Du Camp, Souvenirs littéraires.) C’est à Paris, après avoir achevé un Cœur simple, que Flaubert songea à développer l’histoire de saint Jean-Baptiste qu’il méditait depuis longtemps. Si je m’y mets, écrivait-il, cela me ferait trois contes, de quoi publier à l’automne un volume assez drôle. « L’histoire d’Hérodias, telle que je la comprends, n’a aucun rapport avec la religion. Ce qui me séduit là dedans, c’est la mine officielle d’Hérode (qui était un vrai préfet) et la figure farouche d’Hérodias, une sorte de Cléopâtre et de Maintenon ; la question des races dominait tout. » (Lettre à Mme Roger des Genettes, Correspond., t. IV.) Quelques mois plus tard, rentré à Croisset, il rassemble aussitôt la documentation scientifique de ce conte et, le 25 octobre 1876, il écrit à Maupassant : « Dans sept ou huit jours (enfin) je commence mon Hérodias, mes notes sont terminées et maintenant je débrouille mon plan. Le difficile, là dedans, c’est de se passer autant que possible d’explications indispensables. » On verra plus loin, dans la lettre qu’il écrivit à Flaubert, comment Taine interprète cette absence d’explications.
LE PLAN DE HÉRODIAS.
Les notes documentaires de Hérodias se composent de 57 feuillets de grand format, recouverts d’une feuille de papier blanc sur laquelle Flaubert a écrit : Notes. Le premier feuillet est le scénario du conte ; en voici le texte et la disposition :
Puis vient une documentation étendue extraite de l’ouvrage de Aug. Parent, Machaerous (Franck 1868) : Machaerous — Description des forteresses, teinte des montagnes, costumes, etc. D’autres notes sont empruntées à l’Essai sur l’Histoire et la Géographie de la Palestine, d’après les Thalmuds et les autres sources rabbiniques de Derenbourg (Franck 1867) et nous trouvons tout un passage sur les Phéniciens, puis quelques commentaires sur Rome, Tibère, d’après Rome sous la Judée, par Champagny, et sur Auguste (30 ans av. J.-C. — 14 ans après J.-C.). Un feuillet est consacré aux mœurs romaines orientales, puis sur quatre autres feuillets sont transcrites des notes les plus diverses extraites de l’Histoire des Juifs de Flavius Josèphe.
Puis viennent des notes sur :
Les inscriptions arabes (voir Waddington, — Inscriptions).
Les Religions orientales et romaines.
La magie chez les Chaldéens et les origines (voir Lenormant).
Les Doctrines religieuses des Juifs.
Saint Jean-Baptiste, d’après Luc, Mathieu, Marc, Jean.
Saint Jean-Baptiste et Hérode avant le baptême.
Les coutumes religieuses de tous les peuples (Beaunier I).
Les Prophètes.
Les psaumes (traduction Reuss).
Le livre d’Enoch.
Les jeux.
Les Festins (voir Desaubry, t. l, p. 333).
Hérode (Dictionnary of the Bible) (Smith).
Les Machabées.
L’Histoire d’Hérode (d’après Saulcy).
L’administration militaire et religieuse.
Les paysages.
Un autre feuillet ayant pour titre : Personnages contient les notes suivantes :
Hérodias. Juive, mais par ses aïeux et de nature, monarchique. Ses ancêtres avaient été rois et sacrificateurs — et le peuple en voulait aux Asmonéens qui s’étaient imposés comme grands prêtres.
Se moquait d’Antipas, comme la gallemand Mariamne s’était moquée d’Hérode. On avait cru que Mariamne avait donné un philtre à Hérode, — on pouvait croire la même chose d’Hérodias, par rapport à Antipas. Son premier mari Hérode vivait à Rome des bienfaits d’Auguste. C’est là qu’Antipas l’avait vue ; personnage insignifiant, Hérode ne l’avait pas comprise. Antipas lui convenait mieux pour ses plans d’ambition. Sa mère Bérénice (veuve d’Aristobule) et fille de Salomé vivait à Rome et avait pour amie Antonia, mère de Germanicus et de Claude. Herrenius, gouverneur de Damnia, était l’ennemi d’Agrippa.
Io Kim, fils de Zamarès, Juif Babylonien.
Le Bourreau Samaritain — avait participé au sacrilège du temple — os des morts.
Vitellius (suivent des lignes illisibles).
Enfin, nous trouvons deux réponses de M. Clermont-Ganneau et une de M. Baudry à une demande de références de Flaubert. En voici le texte :
- Mon cher Monsieur,
Je serais fort en peine de vous dire si Iazer est visible ou non de Machærous, par la simple raison que messieurs les exégètes ne savent pas trop où placer sur le terrain cette ville problématique.
L’opinion la plus en faveur veut reconnaître Iazer dans d’intéressantes ruines nommées Scir ou Sir, droit au nord de Machaerous, entre Philadelphie et le Jourdain. Dans ce cas, je crains que le lieu ne soit masqué par les hauteurs interposées du mont Nebo et du Djebel atarus. Du moment que vous ne tenez pas à vous cantonner pour votre panorama dans la région située à l’ouest de la mer Morte et du Jourdain, ne pourriez-vous prendre, droit au nord, le mont Nebo et la ville du même nom ? Vous pourriez encore vous servir de Hesbon un peu à l’Est.
Je ne me rappelle plus si nous avons tiré parti du Baal Meon, qui n’est séparé de Machaerous que par la profonde entaille de la vallée du Zerqa Maïn.
Tout à vous bien cordialement et toujours à votre disposition.
Mon cher Monsieur,
Voici quelques noms dissyllabes qui pourraient peut-être trouver place dans le panorama de Machaerous :
Karmel, localité biblique au sud de Hébron (entièrement distinct du mont Carmel).
Maon, tout près de Karmel.
Halboul, au nord de Hébron.
Il y aurait aussi quelque chose qui irait bien, malheureusement c’est un trissyllabe : Herodium, la haute montagne conique (au sud-est de Bethléem), au sommet de laquelle Hérode le Grand avait été enseveli une vingtaine d’années auparavant dans un splendide mausolée.
Tout à vous, bien cordialement.
À cette lettre était joint un plan du panorama de Machaerous.


Mon cher Ami,
J’en perds la tête, de courir après vos noms de constellations et d’étoiles, et cela en un moment où la besogne me déborde et où mes yeux refusent presque le service. Jusqu’ici je n’ai rien pu accrocher pour Persée et pour Mira Cœti. On m’avait promis pour hier et je l’attends encore.
Mais en attendant, comme je connais votre impatience congéniale, je vous envoie ce que j’ai recueilli :
Les noms hébreux et les noms arabes sont les mêmes.
La grande Ourse se nomme en hébreu Agalah : le char, arabe Adjilet ; Algol est le mot arabe lui-même, Al-gol, la goule, le vampire. C’est la traduction de la tête de Méduse que cette étoile est censée figurer, dans la constellation, sur le bouclier de Persée.
Tout à vous.
D’autre part son ami M. Laporte lui écrit : « Voici, mon bon géant, tout ce que je trouve dans Arago : L’étoile Alcor (le Petit Poucet), située près de l’étoile Mizar de la Grande Ourse, était appelée Saidab par les Arabes, c’est-à-dire l’épreuve, parce qu’ils s’en servaient pour éprouver la portée de la vue (Arago, t. l, p. 338). »
Et nous trouvons enfin un dessin des ruines du palais d’Hyrcan (176 av. J.-C.) et celui d’une porte qui paraît être une reconstitution des portes de ce palais.
LES ÉBAUCHES.
« Cette histoire d’Hérodias, à mesure que le moment de l’écrire approche, m’inspire une venette biblique. J’ai peur de retomber dans les effets produits par Salammbô, car mes personnages sont

de la même race et c’est un peu le même milieu. » (Lettre à
Mme Roger des Genettes. Correspond., t. IV.)
L’état des ébauches indique en effet une grande indécision, de nombreux tâtonnements pour arriver à l’expression définitive. C’est ainsi que dans un exposé développé du conte, composé de 16 feuillets de papier blanc, la 1re page du chapitre I est reprise 9 fois et celle du chapitre II 7 fois. L’écriture en est illisible et il faut renoncer à suivre Flaubert à la recherche de sa phrase.
Il existe deux ébauches de Hérodias. Elles comprennent 118 feuillets de papier bleu grand format. Selon son habitude, Flaubert a tracé sa seconde ébauche au verso de la première après avoir barré celle-ci de deux traits en diagonale. La pagination est ici assez imprécise : quelques feuillets sont sans no d’ordre, d’autres sont paginés en lettres, selon les reprises, et la plupart en chiffres.
Le dernier de ces 118 feuillets porte le no 31 ; nous lisons au-dessous de la dernière ligne du conte : Comme elle était très lourde, ils la portaient alternativement, l’indication suivante :
Ces deux ébauches donnent l’impression d’un travail prodigieux. Nous avons trouvé, mêlés à ces deux ébauches, les 22 premiers feuillets recopiés de Hérodias, mais néanmoins très surchargés. Il est fort probable que Flaubert, encore peu satisfait, avait entrepris une troisième ébauche de sa nouvelle.
Le manuscrit définitif est une copie, sans corrections, écrite
par Flaubert.
VARIANTES DE HÉRODIAS
Page 137, ligne 13, pierres, se tenant au-dessus…
Page 138, ligne 9, des ravins, étaient…
Page 138, ligne 19, vignes, gazer des champs…
Page 144, ligne 5, Cependant on avait…
Page 146, ligne 4, pressait, suivant le Tétrarque…
Page 149, ligne 23, jour y tombait…
Page 157, ligne 14, cents dans la Sardaigne…
Page 164, ligne 25, teinturier. Il vous pilera comme du grain. il vous…
Page 165, ligne 17, des vieux prophètes.
Page 165, ligne 21, annonçait une ère de justice et de prospérité, un…
Page 166, ligne 9, statues, pour ses théâtres, pour…
Page 173, ligne 15, brillaient dans les tribunes, comme…
Page 179, ligne 14, désespoir, pendant que Vitellius…
Page 188, ligne 15, La colère d’Hérodias…
Page 189, ligne 14, mangeaient du même côté.
NOTES
des
TROIS CONTES.
En 1872 Flaubert perdit sa mère ; en 1875, voulant secourir son neveu, dont les affaires périclitaient, il perdit sa fortune. Dominant son chagrin, il acheva La Tentation et travailla à l’énorme documentation de Bouvard et Pécuchet dont le plan s’élargissait sans cesse. Sensible au coup qui l’a frappé, accablé par les soucis de la vie, pour la première fois il pense à interrompre son énorme labeur et va rejoindre à Concarneau son ami le naturaliste Georges Pouchet. « Comme j’ai besoin de sortir du milieu où j’agonise, dès le commencement de septembre, je m’en irai à Concarneau près de Georges Pouchet qui travaille là-bas des poissons. » (Lettre à Émile Zola. Correspond., t. IV.) Il séjourna à l’Hôtel Sergent, sur la façade de laquelle fut apposée le 25 avril 1908, une plaque commémorant le séjour qu’il y fit en 1875. Quelques jours de repos sur la plage bretonne suffisent pour calmer ses accès de découragement et, là-bas, il reprend la plume pour écrire La Légende de Saint Julien l’Hospitalier. « Voilà quinze jours que je suis ici et, sans être d’une gaieté folâtre, je me calme un peu. Le pire de la situation, c’est que je me sens mortellement atteint. Pour faire de l’art, il faut un insouci que je n’ai plus… Je ne pense plus qu’aux jours écoulés et aux gens qui ne peuvent revenir. Signe de vieillesse et de décadence. Quant à la littérature, je ne crois plus en moi, je me trouve vide, ce qui est une découverte peu consolante. Bouvard et Pécuchet étaient trop difficiles, j’y renonce ; je cherche un autre roman sans rien découvrir. En attendant je vais me mettre à écrire La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, uniquement pour m’occuper à quelque chose… » (Lettre à Mme Roger des Genettes. Correspond., t. IV.) Il écrivit en effet cette légende avec sa méthode habituelle, rassemblant ses documents, ébauchant des plans, écrivant d’esquisse en esquisse (voir note de Saint Julien l’Hospitalier). Après un séjour à Paris, Flaubert rentre à Croisset en 1876 ; il achève Un Cœur simple, récit de la vie obscure d’une fille de campagne et écrit Hérodias, épisode de la mort de saint Jean le Baptiste, qu’il achève en 1877. L’écriture des Trois Contes, livre de repos, aura duré dix-huit mois, mais jamais l’art ne fut mieux défendu, jamais en si peu de mots, l’image ne fut plus exacte et la pensée plus complète.
Le manuscrit des Trois Contes est composé de 85 feuillets de papier bleu grand format. Sur la feuille de papier blanc qui les recouvre, Flaubert a écrit :
La Légende de Saint Julien l’Hospitalier.
Hérodias.
C’est la mise au net d’ébauches indéchiffrables que nous indiquons
précédemment, car ce manuscrit ne comporte, en fait de
corrections, que des suppressions.
Un Cœur simple est paginé 1 à 30 ; La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, 1 à 27 ; Hérodias, 1 à 28.
Flaubert a écrit un double de ces manuscrits pour l’offrir à son ami M. Laporte.
TROIS CONTES
et
LES AUTEURS CONTEMPORAINS.
Cher Maître,
J’étais seul, et triste, dans ma chambre de malade ; essoufflé. Puis, votre beau livre est venu me visiter. Et, aussitôt, j’ai complètement oublié ma guenille, je n’ai plus vécu que de la vie navrante de Félicité, puis je me suis oublié avec délices au milieu des couleurs adorablement naïves du vieux vitrail de Saint Julien, — enfin, du haut de Machaerous, me prenant pour le Tétrarque lui-même, j’ai saigné de ses soucis rendus par vous lancinants à travers la poussière de vingt siècles, et, dégoûté d’Hérodias, lâche devant Vitellius, Salomé me portant à la peau, j’ai laissé décapiter Iaokanann dans l’espoir d’avoir dans mon lit les cuisses « en caleçons noirs semés de mandragores » de la jeune danseuse… Et, quand j’ai eu tout fini, je me suis mis à vous relire. Maintenant il me reste encore la joie de vous écrire, — et celle de me souvenir.
Merci donc, cher maître d’avoir pensé à moi. Le pleurétique en a déjà moins d’eau dans sa plèvre droite. Et il ira vous voir dimanche si le temps le permet. Et il vous serre affectueusement la main, avec l’émotion douce de la reconnaissance.
Mon cher Ami,
Je n’ai jamais rien lu de plus complètement beau que vos Trois Contes. C’est la force du génie, et je ne veux gâter par aucun mot la sincérité de mon admiration. La semaine prochaine, je parlerai de ce merveilleux livre dans mon Feuilleton[4] ; je ne le fais pas cette fois, parce qu’il y a des opérettes ! Mais, mon cher ami, quel régal pour un poète. Pas un mot qui ne soit une grâce et une joie ! C’est de toute mon âme et aussi de tout mon esprit que je suis votre mille fois reconnaissant
Mon cher Ami,
Je vous ai hier remercié du livre ; il m’importe aujourd’hui d’en faire autant pour l’énorme plaisir que m’a procuré l’absorption d’iceluy. Au milieu des ruades des ânes, je me réjouis d’apercevoir enfin la grille du lion. Le livre est tout à fait bien ! un instrument à trois cordes également superbes et sonores.
Tout à vous.
Cher Maître,
Je viens de dévorer vos Trois Contes. Dire lequel je préfère m’est impossible. Je les aime également tous les trois. Vous divulguez la vie moderne et vous reconstituez celle qui fut. Telle est votre magie que, grâce à vous, je connais Hérodias et Julien aussi bien que Félicité. Vous êtes un évocateur et un voyant, de plus vous avez ce qui manque à la plupart de vos cadets : une érudition sans bornes. Il est très facile de faire fi de cette revêche, mais l’acquérir, bernique ! Ce serait trop dur et trop aride pour nos cerveaux amoureux de tout ce clinquant qu’on attrape à la volée. Allons, demain, quand Hugo nous aura quittés et que vous vous reposerez, ce sera bien fini, nous aurons encore des photographes et des enlumineurs, mais plus de peintres, et par peintres j’entends non pas les barbouilleurs qui s’intitulent ainsi, mais ceux possèdent la couleur et l’appliquent à bon escient. Eh ! certes, le rouge, l’écarlate, voire le bleu plaisent à tout le monde, mais faut-il n’en pas mettre partout et les distribuer congrûment. Tonnerre de Dieu ! comme dit notre excellent ami Zola, la littérature n’est point chose aisée. Ou commence-t-elle ? ou finit-elle ? Comment la régler ? En l’an 1900 personne ne le dira. Le tempérament aura tué la science, et sans la science qui n’ânonnera point un brin ? Plus je vais, moi, qui, d’après vous, suis le bon Cladel, et plus je me figure que pour un livre, ce qui s’appelle un livre ! vingt ans de travail suffisent à peine. Il est vrai que j’appartiens à ce clan des trébucheurs qui ne savent à quel mot s’accrocher pour ne point choir ; or, voilà par exemple ! une maladie peu contagieuse et que n’attraperont pas ceux qui n’en ont pas le germe en naissant. Ah ! troubleur que vous êtes ! où diable avez-vous pris ce rutilant pinceau dont vous brossez vos toiles, les petites comme les grandes, et cette sobriété que certains latins vous envieraient ? Être à la fois Chateaubriand et Stendhal, et de plus Flaubert, voilà qui roule et vous nous roulez. Merci !
Votre
Oui, mon cher ami, j’ai, il y a près de quinze jours, reçu tes Trois Contes et les ai dévorés ; depuis il ne m’a pas été possible de les relire, mais je me propose de me donner ce plaisir à bref délai et de les déguster le plus longuement possible, car ils m’ont fort séduit, et je ne crois pas que tu aies jamais rien écrit de mieux, et je sais que tu écris d’habitude assez proprement. Voilà tout ce que je puis te dire aujourd’hui ; je te remercie tout uniment de ton envoi ; je t’exprime tout le plaisir qu’il m’a fait et me propose de me le donner encore. Bonne santé et tout à toi.
13 mai 1877.
Cher Monsieur,
Je suis véritablement honteux de ne vous avoir pas envoyé plus tôt les remerciements que je vous dois pour votre aimable envoi. Je sors à peine des ennuis d’un déménagement, c’est tout dire.
Je n’ai pas besoin de vous dire avec quel plaisir j’ai relu Hérodias : et lu les deux autres contes qui l’accompagnent. Cela fait une admirable et exquise trilogie où le savant trouve son compte tout autant que le poète. Ces trois êtres si divers qui se tiennent par la main font la chaîne du passé au présent ; toute l’histoire humaine est là, et vos trois illuminés m’ont tout l’air de s’éclairer au même rayon, à travers les siècles. Vous avez prouvé une fois de plus que vous êtes passé maître dans la biologie des choses mortes et l’exégèse des choses vivantes. Tout à vous bien cordialement.
Il est trop tard pour vous souhaiter le succès — c’est fait — il ne reste plus qu’à vous en féliciter.
Cher Vieux,
Va pour vendredi !
Je n’ai encore lu que le Cœur simple, mais je le trouve, selon l’expression du maître, tout à fait, tout à fait chef-d’œuvreux. Tout au pur, au vertueux, à l’honnête auteur des Trois Contes.
Si vous aviez le déshonneur d’être couronné de force par l’Académie !!!!!!
Mon Cher Ami,
J’ai enfin ton adresse, après l’avoir inutilement cherchée pendant huit jours. J’ai lu deux fois ton livre avec la sérieuse attention que je mets à lire tout ce que tu écris. Ton premier conte, Un Cœur simple, est une merveille de netteté, d’observation infaillible et de certitude d’expression. La Légende de Saint Julien et Hérodias n’ont pu être signés que par l’auteur de Salammbô et de la Tentation. Tu as un grand et puissant talent, et nul n’en est plus convaincu et plus heureux que ton vieil ami.
Tes Trois Contes, mon cher Gustave, me plaisent infiniment ; je les ai lus tout d’une haleine, et maintenant je vais les relire. Mais auparavant, je tiens à te remercier de tout le plaisir que tu m’as fait, et à te dire que ton souvenir ne pouvait arriver ici plus à propos. J’étais souffrante samedi matin, je me sentais un peu triste, la solitude m’accablait ; ton livre est venu à moi comme un ami, et la seule vue de sa couverture jaune m’a tout de suite réchauffé le cœur. J’ai commencé incontinent, par le premier conte. J’ai suivi pas à pas l’humble servante Félicité dans sa vie de travail et d’abnégation, je suis entrée dans cette maison de petite ville où les jours succèdent aux jours avec une si désespérante monotonie ; puis j’ai aimé le pauvre Loulou, le perroquet vert, qui s’envole si bien au pays du rêve en dépit de son aile cassée, de son œil de verre et de son ventre bourré d’étoupe.
Cette étude est exquise, dans ses demi-teintes si fondues et si fines.
La Légende de Saint Julien offre des beautés d’un autre genre, et je ne me souviens pas d’avoir éprouvé jamais un plus complet éblouissement. La goutte de sang de la petite souris blanche m’a donné le même frisson que le meurtre des deux vieillards ; la venue de la princesse aux doux yeux m’a charmée comme la céleste vision de la fin. Tout cela est rapide, dramatique, entraînant, et pourtant parfait dans les détails, ciselé à la manière des maîtres joailliers d’autrefois. On peut bien dire que c’est là une vraie merveille, un rare chef-d’œuvre !
Ton dernier conte, l’étude antique intitulée Hérodias, me paraît également des plus remarquables. C’est largement fait et très brillant de couleur. Les personnages sont vivants et circulent bien dans ces grandes salles où s’étale tout le luxe de l’époque romaine. Les mets étrangers fument sur les tables, les convives se gorgent de viande et de vin, et l’infâme Aulus est bien près de faire partager ses nausées au lecteur… passons vite… Voici venir la belle Salomé, avec sa danse enivrante, et la tête du pauvre saint Jean ne tient plus guère sur ses épaules…
Comme il ira tout droit au paradis, je n’ai pas besoin de m’apitoyer sur son sort, et je puis me livrer tout entière au sentiment d’admiration que m’inspirent tant de belles pages. Pourrai-je jamais, mon bon ami, te remercier assez des heures charmantes que tu m’as fait passer ?
Il me reste encore un peu de temps et un peu de place pour te parler de moi : mais je n’ai pas grand-chose à te dire qui vaille la peine d’être noté. Je n’ose guère essayer de te décrire la vie que je mène ici ; elle ressemble trop à certains tableaux si bien tracés dans Un Cœur simple…
Allons adieu, mon cher camarade, assez bavardé comme cela, je t’embrasse fort et te serre la main de tout mon cœur. Mille tendres souvenirs à ton aimable nièce, que j’aime beaucoup, et mes compliments bien empressés à Monsieur Commanville.
Ta vieille amie,
Merci !
Nous causerons longuement de vos contes, mon grand ami, et je vous embrasserai pour la peine. Vous avez eu des nouvelles de la conférence de Sarcey ; vous a-t-il dit qu’il vous comparait à Goya ? — Si vous n’êtes pas content de lui après ça !
L’embarras est de jeter la pomme à vos trois fantaisies, je suis perplexe.
Vous m’aiderez à me tirer de là.
Encore merci.
Georges Pouchet habitait Concarneau. C’est auprès de lui que Flaubert écrivit La Légende de Saint Julien l’Hospitalier.
Cher grand Poète,
Je viens d’avaler vos trois nouvelles comme mon ami Carrière avale trois verres de bon vieux rhum en une heure. Vous avez été plus grand peintre ailleurs peut-être, nulle part vous n’avez été plus grand poète. Vous n’avez pas seulement vu les choses extérieures en les rendant avec le relief que l’on appelle le trompe-l’œil ; vous avez vu des âmes et les avez fait voir. Le Cœur simple m’a paru une étude psychologique magistrale. J’ai pleuré une seconde fois en lisant cette féerique Légende de Saint Julien. J’ai eu des éblouissements dans les yeux en lisant Hérodias. Me permettez-vous deux ou trois remarques de détail ?
1o Dans cette dernière, à la page 211, vers le milieu, au paragraphe finissant par « l’impie Achab », n’y a-t-il pas quelque obscurité, quelque chose d’oublié ou tout au moins quelque vice de ponctuation ?
2o Page 125, en haut, vous dites « extirper des trésors » ; le mot extirper, en prenant sa signification étymologique de stirps, racine, se dit très bien de tout ce qui tient à un homme comme ses sentiments, ses vertus ou ses vices, qui sont comme une végétation. Mais les trésors tiennent-ils d’assez près à la personne, même d’un empereur, pour dire « en extirper des trésors » ? N’est ce pas une faute d’impression pour « extorquer » ?
Pardon de ce pédantisme. Merci pour votre gracieux envoi et pour tout le plaisir que m’a donné cette lecture.
Bien à vous.
4 mai.
Mon cher Flaubert,
Je partais pour la campagne le jour où votre livre m’est arrivé. Je l’ai lu deux fois, et je vous en fais tous mes compliments, chaque conte est un tout complet, savamment pondéré ; on reconnaît le maître, l’homme sait composer, harmoniser tous ses effets, et ne lâche pas un trait, pas un mot qui ne concoure à l’impression finale. De plus votre calme, votre perpétuelle absence est toute-puissante ; comme disait Tourguéneff, cela coupe le fil ombilical qui rattache presque toujours une œuvre à son auteur.
À mon avis, le chef-d’œuvre est Hérodias. Julien. est très vrai, mais c’est le monde imaginé par le moyen âge, et non le moyen âge lui-même ; ce que vous souhaitiez, puisque vous vouliez produire l’effet d’un vitrail ; cet effet y est ; la poursuite de Julien par les bêtes, le lépreux, tout du pur idéal de l’an 1200. Mais Hérodias est la Judée 30 ans après J.-C., la Judée réelle, et bien plus difficile à rendre, parce qu’il s’agit d’une autre race, d’une autre civilisation, d’un autre climat. Vous aviez bien raison de me dire qu’à présent l’histoire et le roman ne peuvent plus se distinguer. — Oui, à condition de faire du roman comme vous. Ces 80 pages m’en apprennent plus sur les alentours, les origines et le fond du christianisme que l’ouvrage de Renan ; pourtant vous savez si j’admire les Apôtres, son Saint Paul et son Antéchrist. Mais la totalité des mœurs, des sentiments, du décor ne peut être rendue que par votre procédé et par votre lucidité. À force d’art, et par le style, vous avez esquivé les plus grandes difficultés, levées de l’horreur et de l’indécence ; on devine Asprée, on voit Vitellius et Salomé, et il n’y a pas de gros mots, ni de mots crus ; pourtant rien n’est omis, les deux attitudes essentielles de Salomé y sont et même le hurlement de Jean. (Avez-vous lu dans Leconte de Lisle un superbe morceau semblable, Élie maudissant Achab et Jésabel.)
Deux ou trois chicanes : page 170, ligne 4, pour éviter toute obscurité à la première lecture, il vaudrait peut-être mieux mettre « l’un de ses Frères Agrippa » ; 6 lignes après, on voit Agrippa et on ne l’identifie pas du premier coup. — Ibidem, ligne 7, pour plus de clarté, mettre « Hérode Antipas », ou « le Tétrarque ». — Songez que le lecteur n’est pas habitué à tous ces noms, dignités et parentés ! — l’âge 177, comment Agrippa est-il à la fois le Frère d’Hérodias et d’Hérode Antipas ? — Si cela est, il faut un mot d’explication, pour moi, j’ai oublié les généalogies. — Ibidem, page 192, il y a un peu d’incertitude à la première lecture pour le lecteur ignorant sur les Vitellius, dont l’un, le père, est Lucius Vitellius, et l’autre, le fils, Aulus Vitellius.
Magnifique le passage 203 sur les chevaux et leur écurie souterraine avec une percée de lumière. Tous les mots du festin y sont précieux, et à étudier, à savourer pour sentir ce monde que vous avez fait revivre. — C’est aussi fort, et plus allégé que Salammbô.
234. « Des mains faibles et méchantes » n’est clair qu’en réfléchissant beaucoup, et pas à tout le monde. Tout le reste superbe, et rien de profond comme l’antagonisme intime du Juif et du Latin.
238. Avant-dernier alinéa « C’était Hérodias » pas très clair non plus pour le lecteur non préparé, on ne comprend qu’après, à la page suivante.
Voilà tout, mon cher ami, je vous serre la main et vous félicite.
Pour moi je ponds douloureusement et lentement, l’œuf étant trop gros.
À vous.
Bien cher Maître,
C’est en vous serrant la main que je pourrai seulement vous remercier, comme je le désire, de l’envoi de votre nouveau livre. Cette marque d’affectueux souvenir est pour moi, croyez-le bien, des plus précieuses, car, après mon admiration pour vos œuvres, ma grande sympathie pour l’écrivain, je ne pouvais rien désirer tant que l’amitié de celui vers qui tout me poussait. J’ai voulu vous écrire avant de vous avoir entièrement lu, votre œuvre étant de celle qu’on déguste et qu’on lit amoureusement sans passer une phrase, un mot, une épithète. J’ai commencé par Hérodias, attiré par l’intérêt que vous savez. Vous complimenter serait banal ; sachez seulement que je ne puis qu’admirer et relire, avec le sentiment de petitesse et de noble jalousie qui vous écrase devant l’œuvre du maître. Vos phrases, après le charme étrange et irrésistible dont elles enveloppent le lecteur, mordent l’esprit comme l’eau-forte mord la plaque de cuivre, y gravant d’une façon indélébile les tableaux et les caractères que vous tracez si puissamment.
J’espère bien demain, après avoir également lu La Légende de Saint Julien et Un Cœur simple, pouvoir en causant avec vous, mon cher maître, vous exprimer de nouveau tout le plaisir que m’a fait votre bienveillante et aimable attention. Ce ne sera qu’une preuve de plus de l’affectueuse sympathie et du respect de votre bien dévoué et bien reconnaissant
Les Trois Contes parurent le 24 avril 1877 ; peu après les manifestations
du 16 mai accaparaient la presse. Flaubert s’en
émut : « Cet idiot de Mac-Mahon nuit beaucoup au débit des
Trois Contes… J’ai fait dire, selon ma coutume, beaucoup de
bêtises, car j’ai le don d’ahurir la critique. Elle a presque passé
sous silence Hérodias ; quelques-uns même, comme Sarcey, ont
eu la bonne foi de déclarer que c’était trop fort pour eux. Un
monsieur dans l’Union, trouve que Félicité c’est Germinie Lacerteux
aux pays du cidre. Ingénieux rapprochement. » (Lettre à
Mme Roger des Genettes. Correspond., t. IV.)
Nous donnons quelques extraits des principaux articles consacrés aux Trois Contes :
La Liberté, 23 mai 1877 (Drumont).
… Ces trois nouvelles s’appellent : Un Cœur simple ; La Légende de Saint Julien l’Hospitalier ; Hérodias. — Et je suis fort embarrassé, je l’avoue, de vous expliquer en quoi ce sont des merveilles, de vous communiquer l’impression d’admiration que tous les lettrés ressentiront devant ces trois médailles si magnifiquement frappées, d’un fini si minutieux et, en même temps, d’une exécution si large, d’un dessin si élégant et si ferme à la fois.
Les gens pressés qui dévorent un volume en une heure, en oubliant parfois de couper quelques feuillets, ne découvriront là rien de remarquable ; mais il se produit dans la presse ce qui se produit pour ceux qui, sans fabriquer des joyaux, ont l’habitude d’en voir et d’en manier ; ils reconnaissent immédiatement ce qui est véritablement beau ; les artisans en ce métier ont des éclairs de joie devant les créations des artistes…
En ce volume, l’auteur transporte dans des régions absolument dissemblables cette puissance native de reconstituer la vie d’un être disparu, que cet être soit une reine, une servante, un cénobite. Il excelle, comme les réalistes, à rendre éloquents les moindres objets, le paysage, le temps ; mais parmi tous ces accessoires qui ont une indiscutable importance, il met quelqu’un qui se meut dans cette atmosphère, une créature animée à laquelle se rapportent tous ces témoins inanimés.
Il est encore une fois presque impossible de donner l’idée de la valeur littéraire de ces Trois Contes. On n’y trouve point à louer un détail particulier, bien au contraire ; l’auteur s’est gardé soigneusement contre tout ce qui pouvait étonner, c’est-à-dire détonner ; et c’est à supprimer, très certainement, qu’il a le plus travaillé, afin que tout se fondît dans un ensemble harmonieux. Il faut s’arrêter longuement devant son œuvre, comme on s’arrête devant quelque toile de maître, pour bien comprendre par quelles gradations de nuances insensibles, l’effet parvient à cette intensité.
Prenez, par exemple, « Un Cœur simple ». C’est l’histoire d’un être qui n’a point d’histoire, d’une servante de province qui est entrée à seize ans dans la maison d’une honnête bourgeoise, qu’elle n’a quittée que pour le cimetière. Les enfants qu’elle voit naître, qu’elle soigne, qu’elle pleure morts, un perroquet auquel elle s’attache, et c’est tout. Soixante années pendant lesquelles deux ou trois trônes se sont écroulés, ont passé sur cette douce créature sans l’agiter davantage que quelque tempête effroyable ne trouble le polype en sa tranquillité profonde. Confiez un tel sujet à beaucoup, même parmi ceux qui savent tenir une plume, et je crois qu’ils n’y verront pas grand-chose. Celui qui a peint si superbement les ardeurs de la passion dans Madame Bovary, s’est surpassé lui-même dans ce tour de force d’attendrir les plus raffinés sur cette existence en quelque sorte rudimentaire. Cet esprit supérieur s’est assimilé les pensées de cette humble campagnarde, il a réfléchi longuement les sensations que les spectacles les plus insignifiants devaient lui procurer. Il n’a pas indiqué une idée qui dépasse cette cervelle bornée…
Ce conte nous intéresse prodigieusement, en nous présentant une ménagère coiffée d’un bonnet et tenant un trousseau de clefs.
Hérodias est un tour de force dans le sens opposé. Le monde entier est rassemblé dans cette salle de banquet, où une Salomé plus implacable que celle de Regnault et plus fascinante que celle de Gustave Moreau, vient demander la tête de Jean. Voici Rome avec le proconsul Vitellius qui se gorge de viandes, avec Aulus, l’éphèbe cher au Tibère de Caprée, qui vomit entre une terrine de Comagène et un plat de merles roses ; voici Jérusalem avec le Tétrarque, les Sadducéens, les Pharisiens, les luttes religieuses, les formules hiératiques. Au fond de la citerne, Iaokanann crie ses anathèmes. Une page d’histoire se déroule ainsi devant le lecteur, étourdissante de mouvement, admirablement restituée jusqu’au moindre détail, instructive, terrible, émouvante. Dans cette composition magnifique tout à sa place, sa signification, son importance ; il n’est pas un coup de pinceau qui ne concoure à l’ensemble, qui ne jette une note utile dans le concert. Tout parle dans cet œuvre, ou d’innombrables personnages s’agitent sans confusion ; tout à son rôle, depuis l’umbo du bouclier qui porte l’image de César, jusqu’aux petites pantoufles en duvet de colibri qu’a chaussées la fille d’Hérodias pour danser.
En vingt-quatre heures l’univers a défilé devant nous, depuis le moment où Vitellius arrive dans sa grande litière rouge ornée de panaches et de miroirs, jusqu’au moment où, à la lumière vacillante des flambeaux qui s’éteignent dans la salle du festin, Antipas, resté seul, contemple fixement la tête coupée, tandis que des messagers courent vers la Galilée annoncer que les prophéties sont accomplies.
Ne supposez point que l’auteur ait cédé à la tentation puérile de décrire, qu’il ait voulu s’abandonner à quelques-unes de ces débauches de couleur auxquelles on se livrait volontiers aux premiers temps du romantisme. C’est l’originalité de ce tableau incomparable, qu’il serait impossible d’y ajouter ou d’y retrancher une phrase ou une épithète sans en détruire l’équilibre. Un tempérament qui s’est dompté lui-même, une imagination qui a appris à se dominer, une langue d’une richesse inouïe, mais aussi d’une simplicité magistrale, tels sont les caractères de ce volume à propos duquel on peut hardiment prononcer le mot de perfection.
Le National, 14 mai 1877 (De Banville).
L’illustre auteur de Salammbô et de La Tentation de Saint Antoine, M. Gustave Flaubert, vient de publier un livre intitulé simplement Trois Contes, mais ces contes sont trois chefs-d’œuvre absolus et parfaits créés avec la puissance d’un poète sur de son art, et dont il ne faut parler qu’avec la respectueuse admiration due au génie. J’ai dit un poète, et ce mot doit être pris dans son sens rigoureux ; car le grand écrivain dont je parle ici a su conquérir une forme essentielle et définitive, où chaque phrase, chaque mot ont leur raison d’être nécessaire et fatale, et à laquelle il est impossible de rien changer, non plus, que dans une ode d’Horace ou dans une fable de La Fontaine. Il possède au plus haut degré l’intuition qui nous révèle les choses que nul n’a vues et entendues ; mais en même temps il a tout étudié, il sait tout, ayant ainsi doublé l’inventeur qui est en lui d’un ouvrier impeccable ; aussi trouve-t-il toujours le mot juste, propre, décisif ; et peut-il tout peindre même les époques et les figures les plus idéales, sans employer jamais le secours d’un verbe inutile ou d’un adjectif parasite.
C’est là le dernier mot de l’art et il serait difficile de comprendre comment le pays qui eut le bonheur de produire un tel artiste ne lui décerne pas les plus grands honneurs, si nous ne savions depuis longtemps que telle action n’est pas faite, par l’unique raison qu’elle devait être faite. Il serait puéril de dire que l’auteur de Madame Bovary devrait être à l’Académie ; mais ce qu’on peut affirmer avec raison, c’est que l’Académie devrait être à l’auteur de Madame Bovary. S’il est vrai que dans un élan spontané de justice elle soit allée au-devant d’un de ses membres les plus célèbres, récemment élu, ne devrait-elle pas aller en corps chercher M. Gustave Flaubert, et étendre sous ses pas un tapis de pourpre ? Mais ce sont là ses affaires et non les miennes ; pour moi je me contente de faire comme tout le monde, d’admirer passionnément : Un Cœur simple, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier et Hérodias, et de remercier avec la reconnaissance la plus émue et la plus fière, l’homme qui m’a donné une telle joie.
Je le sais bien, il est difficile de s’habituer à cette idée que ces grands créateurs sont nos contemporains, qu’on les touche, qu’on leur parle et qu’il faut s’incliner devant leur pensée souveraine, sans avoir la satisfaction de les savoir morts et solidement cloués sous la lame ; mais enfin il faut en prendre son parti, comme de beaucoup d’autres incommodités. Étonnamment variés, car ils parcourent tout le cercle des âges, les Trois Contes qui mettent en scène, l’un une pauvre servante de Pont-l’Évêque, à moitié idiote, l’autre un chasseur qui devient héros, puis saint, et fut enlevé dans le ciel, le troisième, cette Salomé qui tient dans ses mains la tête de Jean-Baptiste et que les poètes adorent à jamais, ne sont pas cependant des contes détachés ; ils sont unis au contraire par un lien étroit, qui est l’exaltation de la charité, de la bonté inconsciente et surnaturelle. La Judée, au temps de Tibère, le monde romain sont évoqués avec une impérieuse et victorieuse magie dans Hérodias ; mais ne sont-ce pas des jeux pour le poète de Salammbô ? Des tableaux éclatants d’une couleur harmonieuse comme des Delacroix, et voluptueusement douloureux, des scènes qui resteront dans la pensée éternellement, comme celle où après avoir vu sa femelle et son faon inexorablement tués par Julien, le cerf, portant encore fichée dans son front la flèche du féroce chasseur, trouve une voix humaine pour le maudire, et comme celle où, après avoir réchauffé sur son sein et sur ses lèvres le lépreux hideux, Julien le voit se transfigurer, égalent ce livre aux plus beaux et aux plus renommés d’entre les poèmes. Mais je ne puis résister au désir d’en transcrire ici quelques lignes :
« Alors le lépreux l’étreignit ; et ses yeux tout à coup prirent une clarté d’étoiles ; ses cheveux s’allongèrent comme les rais du soleil ; le souffle de ses narines avait la douceur des roses ; un nuage d’encens s’éleva du foyer ; les flots chantaient. Cependant une abondance de délices, une joie surhumaine descendait comme une inondation dans l’âme de Julien pâmé, et celui dont les bras le serraient toujours, grandissait, grandissait, touchant de sa tête et de ses pieds les deux murs de la cabane. » Voilà une citation bien courte ; mais qu’importe, puisqu’on lira tout le livre ?
Le Gaulois, 4 mai 1877 (Fourcaud).
… Si je me suis bien fait comprendre, on a vu trois signes caractériser l’écrivain : l’exactitude logique, le sens poétique et le goût — excessif quelquefois — de l’archéologie. Et des qualités qui en dérivent, répandues sur son œuvre entier, se rencontrent ensemble et concentrées dans les Trois Contes nouveaux dont il est bruit. Qui connaît Flaubert l’y retrouve entier, et qui ne le connaît pas l’y apprend.
Le premier est un petit roman de mœurs : Un Cœur simple, l’histoire d’une humble servante à qui rien ne réussit. Jeune, son amoureux l’abandonne ; ses maîtres la battent et la chassent ; plus âgée, un neveu qu’elle aime comme un fils meurt loin d’elle. Elle entre chez une maîtresse dont la fille expire quand elle s’est bien attachée à cette enfant. Un perroquet qu’on lui donne meurt empoisonné. Tout pour elle se change en chagrin, jusqu’à sa mort. Les détails vivants affluent dans cette étude touchante. On y reconnaît l’auteur de Madame Bovary à de certaines touches et à l’exagération après coup de ces touches. Par exemple quand la vieille fille a perdu son perroquet, elle le fait empailler, et, chaque soir, elle ressasse devant lui ses prières. À l’église, elle a vu la colombe mystique de l’Esprit Saint se balancer au-dessus de l’autel : ces deux oiseaux lui semblent avoir de vagues ressemblances. Le trait est charmant. Pourquoi M. Flaubert l’affaiblit-il en prêtant à son héroïne des raisonnements comme celui-ci : « Le Père n’a pu exprimer ses volontés par le moyen d’une colombe ; les colombes ne parlent pas. Il a dû se servir d’un perroquet. » Le perroquet du Saint-Esprit est d’une déduction un peu subtile.
Le conte suivant : La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, conçu dans la manière des légendes du moyen âge, est de tout point une admirable page. Des messagers de Dieu ont prédit au père de Julien que son fils serait un guerrier ; à sa mère, qu’il serait un grand saint. On lui donne une éducation raffinée ; mais un vieux cerf à longs poils blancs, qu’il tue à la chasse, lui brame ces mots en mourant, avec une voix humaine : « Maudit, tu tueras tes parents ! » En quelles circonstances mystérieuses cette prédiction terrible s’accomplit, c’est ce qui est développé dans la suite du livre. Si l’on a reconnu dans Un Cœur simple la patte et l’œil de l’observateur réaliste, l’aile et la main du poète seront trouvées ici.
Dans Hérodias, au contraire, c’est surtout l’archéologie qui s’affiche. La mort de saint Jean le Précurseur y est savamment et curieusement mise en scène. Les noms orientaux n’y sont pas épargnés, saint Jean-Baptiste y est nommé Iaokanann. Je n’apprécie pas plus qu’il ne faut cette érudition qui s’attaque même aux noms. Je dois dire cependant que l’auteur y a beaucoup moins sacrifié dans ce compte qu’à l’ordinaire, et qu’il a fait effort pour être intelligible à tout le monde.
Tel qu’il est, ce volume, d’une lecture sérieuse, est frappé au bon coin de M. Flaubert avec ses qualités et ses défauts. Le style en est superbe, quoique, à mon gré, trop tendu et trop ennemi des répétitions des mots, ce qui l’obscurcit maintes lois. Les grandes images saisissantes y sont prodiguées et les descriptions étincellent d’une vie singulière. Les détails y fourmillent, oiseusement souvent, et coupent court à l’intérêt. L’écrivain, très sobre dans le jeu de sa phrase, est essentiellement prolixe en fait d’explications. Il a le tort de tous les romanciers dits naturalistes, il veut trop dire et trop décrire. Il faut pourtant bien laisser quelque chose à faire à l’imagination du lecteur.
La Patrie, 8 mai 1877 (G. de Saint-Valry).
Réalisme idéal… voilà deux mots dont la réunion a l’air d’une dispute. Rien cependant ne peut mieux rendre, à mon gré, l’impression que laisse le récent volume de M. Flaubert, cette admirable combinaison d’exactitude et de poésie, cette compréhension étonnante du vrai extérieur jointe à une pénétration exquise du sens intime et idéal des choses.
Je ne suis pas tenté, on le voit, d’atténuer le plaisir que m’a procuré la lecture de ce petit volume de deux cent cinquante pages. Parmi les productions de l’imagination contemporaine, vouées pour la plupart à un prochain et légitime oubli, celle-ci survivra sur le rayon de choix ou sont rangés Salammbô, Madame Bovary, même La Tentation de Saint Antoine.
Mais je ne cherche pas seulement à faire valoir l’unité et la rectitude de cette vie littéraire, je voudrais faire voir aussi comment, dans ce dernier volume, le plus, bref de tous ceux que M. Flaubert a jusqu’ici donnés au public, les idées, le talent, les procédés artistiques de l’écrivain se sont en quelque sorte condensés et résumés dans une synthèse finale.
Supposez que par une série de cataclysmes, qui semblent désormais impossibles avec la diffusion illimitée des écrits modernes, l’œuvre de Flaubert disparaisse tout entière, comme il est advenu de celle de quelques écrivains de l’antiquité, et qu’il ne surnage de lui dans l’histoire littéraire des siècles à venir que son nom, quelques fragments d’articles de Sainte-Beuve et ce petit volume, ces Trois Contes. Ces trois cent cinquante pages suffiraient aux critiques futurs pour se former une idée exacte de la portion perdue.
On y saisirait à merveille la méthode de ce réalisme idéal, ce don de rendre en quelques traits non seulement la réalité extérieure des personnages, mais la vie intérieure de leur âme, l’association et les contre-coups de leurs sensations. On y retrouverait également l’admirable facilité de paysagiste que possède l’auteur, cette perception de la nature vraie et sentie dont il est doué. Ce n’est pas tout, on y retrouverait encore cette puissance de reconstitution des civilisations ensevelies, cette sorte de divinisation poétique et savante qui a produit Salammbô et La Tentation de Saint Antoine, et dont La Légende de Saint Julien et Hérodias présentent l’élixir, pour ainsi parler, la cristallisation, de même que Un Cœur simple offre un résumé de l’art qui a produit Madame Bovary et L’Éducation sentimentale.
Remarquez que le procédé réaliste, qui s’applique avec tant de bonheur à ces étonnants efforts d’imagination qui ont produit les restitutions poétiques de M. Flaubert, ce réalisme, quand il s’emploie à la peinture de la vie moderne, garde de sa cohabitation avec la poésie et l’imagination une saveur, une élévation de sentiment que les derniers venus de l’école — gens de grand talent pourtant — ont l’air de repousser comme une faiblesse.
C’est là, je l’ai mainte fois expliqué, mon unique querelle avec eux. Sont-ils persuadés que la platitude, la vulgarité, la laideur sont les seules expressions de la réalité ? Le premier conte de M. Flaubert suffit pour démontrer l’étroitesse de cette théorie ; rien de plus profondément réaliste, si vous entendez par réalisme la peinture fidèle et minutieuse de la vie. Croyez-vous que l’étude des petits, des simples, des humbles soit la matière préférée du réalisme ? Sur ce point encore aucune objection.
L’héroïne de M. Flaubert est une pauvre servante attachée et une modeste bourgeoise de Pont-l’Évêque, Mme Aubain, qu’elle sert cinquante ans. Nul incident extraordinaire, aucun événement dramatique dans cette existence uniforme et effacée ; la maîtresse et la servante traversent le monde sans y faire aucun bruit, sans avoir jamais dépassé, même en pensée, le cercle extraordinairement borné des habitudes de la petite ville somnolente ; les années suivent les années, apportant aux deux femmes l’inévitable contingent des chagrins terrestres ; mais les chagrins eux-mêmes sont ordinaires et sans éclat. La vie poursuit son cours monotone, Mme Aubain meurt, Félicité reste dans la maison vide, qui ne trouve pas d’acquéreur ; elle meurt à son tour pendant que la procession de la Fête-Dieu, grand événement annuel dans Pont-l’Évêque, s’arrête au reposoir adossé à la maison et que la bénédiction du curé monte à sa mansarde ouverte.
Et puis c’est tout ! Voilà le romanesque de ce simple récit. Avec cela, avec cette donnée d’une si correcte banalité, M. Flaubert a fait un chef-d’œuvre de vie, d’émotion, et j’ajoute d’élévation morale.
Non ! certes il n’est pas besoin pour captiver l’intérêt de mettre en scènes des seigneurs et des reines, de faire passer sous nos yeux des tableaux d’un monde éblouissant. J’accepte sans m’en plaindre l’inclination des réalistes pour les humbles et pour les simples, mais pour que l’intérêt s’attache à ces existences absolument intérieures, dans lesquelles le train vulgaire des choses n’apporte aucune variété, il est indispensable que le peintre soit doué d’une pénétration profonde et qu’il démêle avec un tact raffiné la psychologie de ces âmes naïves.
C’est là surtout ce qui me semble au niveau des plus grands éloges dans le récit de M. Flaubert ; il explique avec une perspicacité admirable le jeu des pensées et des sentiments de son modèle, il montre de la façon la plus délicate l’association de ses idées, phénomène aussi attrayant, aussi difficile à saisir dans l’âme d’une paysanne que dans le cerveau du philosophe le plus cultivé. Je citerai un seul exemple de cet art consommé ; l’auteur dépeint la naissance et le développement des sentiments religieux dans le cœur simple de Félicité, accompagnant au catéchisme la fille de sa maîtresse :
Cette même pénétration, dans laquelle se combinent l’exactitude et la poésie, M. Flaubert l’applique à la nature. Est-il possible d’en reproduire avec plus de précision les aspects et en même temps d’en mieux deviner la saveur secrète, la grâce fuyante, l’ondoiement ? Réaliste tant qu’on voudra, mais réaliste de la famille d’Hobema, le peintre, et de Burus, le poète.
Je l’avouerai pourtant, il est possible que ces peintures de la nature normande aient pour moi un charme que ne sentiront pas au même degré ceux qui n’ont pas, dès l’enfance, respiré l’air humide de nos campagnes vertes et senti sur leur front la fraîcheur lourde de notre ciel varié ; tous les personnages, tous les aspects de ce conte délicieux, je crois les retrouver ; ce sont des connaissances de première jeunesse. Honnêtes petites villes endormies, dont Pont-l’Évêque est un échantillon, et qui retentissent seulement, dans la semaine, du cliquetis des sabots des bonnes femmes et des petits gars ; correctes veuves tricotant à la fenêtre de maisons immuables ; admirables servantes si dévouées et si bonnes cuisinières ; le progrès moderne, le chemin de fer et le Paris. Les bains de mer ne vous ont pas encore absolument supprimés ; rendez grâce au poète précis qui vient de fixer, avant qu’elles disparaissent sans retour, vos grâces discrètes, vos humbles mérites et vos silencieuses vertus !
Ce que j’ai dit plus haut de la puissance imaginative de M. Flaubert, du don qu’il possède de reconstruire les mondes disparus, s’applique aux deux récits qui complètent le présent volume : La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, Hérodias. Au point de vue de l’exécution artistique, la Légende de Saint Julien est certainement une œuvre plus achevée ; mais Hérodias, dans un cadre plus étroit, est une tentative aussi originale que Salammbô.
L’auteur s’est proposé en effet de mettre en scène l’épisode de la décollation de saint Jean-Baptiste, en reconstituant cette cour singulière, ce monde composite groupé autour du Tétrarque de Judée, Hérode. Cette phase obscure de l’histoire juive a laissé, s’il se peut, encore moins de renseignements positifs que celle de Carthage. Le tableau de M. Flaubert, dans lequel il a rassemblé les éléments israélites, orientaux et romains s’agitent dans la forteresse du Tétrarque, est une merveille de divination. Il est possible que l’archéologie en soit discutable ; l’animation et le coloris du tableau frapperont néanmoins tous les yeux.
Je ne suis pas, tant s’en faut, on s’en aperçoit, un adversaire absolu de la théorie réaliste ; aussi j’espère que cette œuvre, ou tout ce qu’il y a de plus élevé dans la doctrine se trouve mis en œuvre par un talent de premier ordre, rencontrera à meilleur escient, auprès de la masse du public, quelque chose de l’empressement qu’ont excité L’Assommoir et La Fille Élisa.
Le XIXe Siècle, 13 juin 1877 (Charles Bigot).
Il y a longtemps que M. Gustave Flaubert n’avait rien publié. Ce n’est pas un auteur qui se prodigue. En ce temps de littérature facile, c’est presque un phénomène que cet écrivain qui tous les six ou sept ans sort de son repos pour livrer au public un ouvrage longuement médité, exécuté avec patience, porté lentement par son auteur au degré qu’il considère comme la perfection.
L’événement n’a pas toujours répondu ni à l’effort dépensé ni à l’espérance générale. Il est d’honnêtes gens qui ne sont parvenus ni à rendre pleine justice à l’érudition pittoresque de Salammbô ni à bien comprendre l’Éducation sentimentale ou La Tentation de Saint Antoine. M. Flaubert a eu cette fois moins hautes ambitions. L’art de la mise en page aidant, il a fait un volume avec trois courtes nouvelles. Il l’a modestement intitulé : Trois Contes. Mais ces trois contes feront peut-être plus pour la gloire de l’auteur que n’auraient fait autant de longues œuvres. Encore en est-il un que j’abandonnerais volontiers aux critiques sévères. C’est le récit intitulé Hérodias, et qui retrace la mort de Iaokanann, plus connu des profanes sous le nom de saint Jean-Baptiste. Il y a là trop d’archéologie pour que le lecteur se sente fortement ému ; l’œuvre est étrange plus que vivante et humaine, et ce que j’en préfère, pour ma part, c’est certaine vue de Judée au soleil levant, découverte du haut de la terrasse du palais d’Hérode Antipas, qui est à coup sûr d’un grand paysagiste élève de Decamps. Le reste m’a laissé froid. Mais je ne saurais en revanche dire assez de bien des deux premiers récits du livre intitulés, l’un Un Cœur simple, l’autre La Légende de Saint Julien l’Hospitalier. Mérimée n’a rien fait de plus vigoureux, ni de plus achevé que ces deux récits. M. Flaubert s’est trouvé poète à son insu et presque malgré lui par l’intensité de la vision artistique. On a fait tant d’éloges mérités de la première nouvelle, Un Cœur simple, que je puis bien lui préférer encore, sans faire tort à l’auteur, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier. L’auteur dit qu’il a trouvé cette légende sur les vitraux d’une vieille église de Normandie. Il l’a lue avec bonne foi et simplicité. Ses tableaux sont tellement saisissants, chaque trait est si juste, la fantaisie et le merveilleux se marient si heureusement avec l’observation exacte de la réalité que l’on finit même par oublier ce qu’il y a de trop rigoureusement voulu et dans la composition et dans le style de l’écrivain. Il y a là un tableau de chasse fantastique et un récit de la mort du saint qui comptent parmi les plus belles pages de français écrites depuis de longues années.
Le Moniteur, 28 avril 1877.
L’orateur (M. F. Sarcey) du boulevard des Capucines assimile Hérodias à La Tentation de Saint Antoine. Il n’a pas plus compris l’un que l’autre de ces ouvrages ; il n’en distingue pas le but ; il n’en reconnaît pas l’utilité ; il se demande pourquoi ils ont été écrits.
En revanche, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, et surtout Un Cœur simple, ont séduit la critique. La vie extraordinaire de saint Julien l’Hospitalier a été recueillie par l’auteur dans une humble église de village normand, sur un vitrail du temps où on écrivait l’histoire sur le verre. Elle lui a servi de prétexte à une fort belle étude sur l’homme dominé par la passion du sang.
M. Flaubert est un maître qu’il faut étudier ; tous les écrivains de l’école qu’il a créée ont bénéficié de sa méthode descriptive, bien différente, quoi qu’on en ait dit, de celle de Balzac.
Le grand Balzac sculptait le cadre au milieu duquel l’action devait se dérouler, avant d’avoir fait entrer en scène ses héros. Les romanciers qui ont eu pour maître G. Flaubert présentent au contraire les descriptions des lieux en même temps que les situations se produisent, parfois au cours du dialogue, incidemment, afin que les personnages apparaissent éclairés par la lumière qui convient mieux à leur physionomie et entourés des choses qui contribuent à donner une idée plus puissante de leur caractère.
Tous les élèves de M. Flaubert ont en eux l’étoffe d’un peintre. Chacun des livres qu’ils ont écrits est, non pas une immense toile, mais comme une galerie de tableaux de genre que l’on oublie d’autant moins qu’ils sont traversés par un très petit nombre de figures.
Le style de M. Flaubert donne aussi à tous les passages descriptifs une vigueur de touche qui ne se trouve dans aucune œuvre antérieure à la publication de Madame Bovary.
L’auteur ne se contente pas seulement d’être un peintre, il est aussi un musicien ; la plume a trouvé, par des phrases incidentes, par une ponctuation qui lui est propre, par des adverbes sonores, le secret de rendre le son des voix, le bruit du vent, le galop des chevaux, le timbre des cloches, le cri d’un mourant.
N’entend-on pas hurler dans la souffrance ce malheureux pied-bot, opéré par Charles Bovary, à l’auberge du Lion d’or.
Revue des Deux Mondes, 15 juin 1877. L’érudition dans le roman (Brunetière).
Après avoir exposé qu’il n’est pas toujours, dans les lettres ni ailleurs, une si bonne fortune que de débuter bruyamment, avec éclat, fracas, demi-scandale, et qu’il vaudrait mieux pour Flaubert pouvoir inverser la succession chronologique de ses œuvres, partir de La Tentation de Saint Antoine pour arriver à Madame Bovary, en passant par Salammbô, le malheureux essai du Candidat, L’Éducation sentimentale, — parce qu’ainsi chaque effort nouveau de Flaubert eût marqué un nouveau progrès de l’auteur vers la perfection de son genre, — Brunetière, visiblement hostile à Flaubert et à son école, continue dans une vigoureuse attaque :
Mais la logique ne gouverne pas les hommes comme elle fait les idées… Et voilà pourquoi les trois nouvelles, ou les Trois Contes, que vient de publier M. Flaubert, sont certainement ce qu’il avait encore exécuté de plus faible.
Ce n’est pas à la vérité parce que le cadre est plus étroit. Disons seulement qu’il y a quelque surprise dont on se défend mal, à voir un écrivain finir par où les autres commencent, ayant commencé par où les autres finissent… Il n’eut tenu qu’à l’auteur d’étendre les proportions de ses contes jusqu’au cadre du roman, puisqu’il avait depuis longtemps prouvé qu’il en était capable ; et c’est un talent si rare de nos jours, une ambition si peu commune, de vouloir et de savoir faire court, qu’il faudrait plutôt remercier M. Flaubert, chef d’école, pour l’exemple et la leçon qu’il donne…
On retrouvera donc, dans Un Cœur simple, ce même accent d’irritation sourde contre la bêtise humaine et les vertus bourgeoises ; ce même et profond mépris du romancier pour ses personnages et pour l’homme ; cette même dérision, cette même rudesse, et cette même brutalité comique dont les boutades soulèvent parfois un rire plus triste que les larmes — comme, dans Hérodias, on retrouvera cet étalage d’érudition, ce déploiement de magnificence orientale, ces couleurs aveuglantes, ces lourds parfums asiatiques et ces provocations de la chair qui sont, s’il était permis de joindre les deux expressions, la poésie du réalisme.
Dans la forme, ai-je besoin de dire que c’est toujours la même habileté d’exécution, trop vantée d’ailleurs ; — le même scrupule, ou plutôt la même religion d’artiste ; mais aussi la même préoccupation de l’effet, trop peu dissimulée ; — la même tension du style, pénible, fatigante, importune, les mêmes procédés obstinément matérialistes…
Dans l’école moderne, quand on a pris une fois le parti d’admirer, l’admiration ne se divise pas, et l’on a contracté du même coup l’engagement de trouver tout admirable. Il est donc loisible, il est même éloquent à M. Flaubert d’appeler Vitellius cette fleur des anges de Caprée ». Quels rires cependant, si c’était dans Thomas que l’on découvrît cette étonnante périphrase, et comme on aurait raison !
… Nous retrouvons M. Flaubert, c’est vrai, mais nous le retrouvons tel que nous le connaissions de longue date, et c’est précisément, c’est surtout de quoi nous nous plaignons.
Certes, si ces Trois Contes, après tout, ne nous rappelaient qu’une manière d’artiste et des procédés de composition connus, bien loin qu’il y eût la prétexte seulement à critique, au contraire, il y faudrait louer une vigoureuse organisation qui, du premier effort, ayant donné toute sa mesure, persiste résolument dans ses qualités et dans ses défauts, parce que ses défauts eux-mêmes sont une part, — et quelquefois la meilleure part, — de son originalité. Malheureusement ce n’est pas une manière, ce sont des paysages, des scènes entières, des visages connus qu’ils nous rappellent, ces Trois Contes ! Les mêmes dessins sur les mêmes fonds, les mêmes tableaux dans les mêmes cadres ; et ceci c’est la marque d’une invention qui tarit…
Revue Bleue, 11 et 18 octobre 1879. Les Romanciers contemporains (Jules Lemaître).
Sur Un Cœur simple :
Ce roman, très court, est consolant après les autres, sans toutefois les contredire. Félicité n’est pas plus un être idéal que Mme Bovary. Ce n’est point une héroïne, mais une bête à Bon Dieu. Ses joies, ses chagrins, ses actions, ses rares paroles, sa religion, ses associations d’idées, tout cela est d’une simplicité qui touche et tourne aux humbles devoirs de sa profession, a l’affection désintéressée, au dévouement absolu et machinal…
Nulle part la manière de Flaubert n’est plus serrée ; on dirait qu’il craint de verser dans l’émotion.
On lui reprochera d’avoir fait la bonté idiote ; on lui dira que c’est rabaisser la vertu d’en faire un produit naturel du tempérament, de la rendre futile et inconsciente. Il répondra qu’on a assez montré, au théâtre et dans le roman, d’héroïnes à falbalas, qui sont des victoires démesurées de la volonté sur la nature… Peut-être aimerais-je mieux que Félicité fût un peu plus intelligente ; mais je ne voudrais pas qu’elle le fût trop, car elle ne pourrait plus avec vraisemblance être aussi merveilleusement bonne ; elle saurait qu’elle l’est, et ce ne serait plus la même chose.
- Sur Hérodias :
Hérodias est dans les mêmes teintes (l’expression est exacte) que Salammbô… Mais ici un effort excessif se fait sentir dans cette brièveté ; les personnages et les actions ne sont pas assez expliqués ; il y a trop de laconisme dans ce papillotage asiatique, et cela ne peut plaire qu’aux fidèles de M. Flaubert, à ceux qui l’aiment, même et surtout dans l’outrance de ses partis pris. Hérodias est à peu près à Salammbô ce qu’Un Cœur simple est à Madame Bovary.
- Sur La Légende de Saint Julien l’Hospitalier :
La Légende de Saint Julien est un bijou gothique d’une rare perfection… Chaque page évoque l’idée d’un vitrail ou d’une enluminure de missel. Ceci est du moyen âge cuit patiemment avec une lampe d’émailleur, non barbouillé avec fougue, comme on faisait vers 1830… Je la trouve vraie (cette légende en ce que Julien, parricide et saint, avec son amour du sang et son amour de Dieu, symbolise à merveille le moyen âge, violent et mystique.
