Anecdotes pour servir à l’histoire secrète des Ebugors. Statuts des sodomites au XVIIe siècle./Texte entier

INTRODUCTION

 n dépit de toutes les prescriptions,
de toutes les menaces, de tous les
châtiments, en dépit même des
injonctions que la tradition met
dans la bouche du Créateur, le baiser exista
dès que la chair des deux sexes fut en contact ;
et tout de suite, sans initiation nécessaire,
il alla jusqu’au raffinement, à la perversion,
à la luxure, avec une superbe impassibilité,
affirmant inconsciemment, mais
inéluctablement, le normal développement
de toutes les fonctions morales et physiques
de l’être humain.
n dépit de toutes les prescriptions,
de toutes les menaces, de tous les
châtiments, en dépit même des
injonctions que la tradition met
dans la bouche du Créateur, le baiser exista
dès que la chair des deux sexes fut en contact ;
et tout de suite, sans initiation nécessaire,
il alla jusqu’au raffinement, à la perversion,
à la luxure, avec une superbe impassibilité,
affirmant inconsciemment, mais
inéluctablement, le normal développement
de toutes les fonctions morales et physiques
de l’être humain.
Ainsi l’étude des antiques civilisations nous apprend que Moïse et les livres saints légiféraient en vain avec une inflexible sévérité contre le baiser sodomique :
« Si quelqu’un a recherché les baisers d’un homme comme si c’était une femme (dormierit cum masculo coitu femineo), qu’il soit puai de mort, ainsi que son complice de luxure[1]. »
Le législateur songeait, en lançant son anathème, à la corruption de Sodome et de Gomorrhe, que lui-même avait narrée à son peuple pour l’en dégoûter. Peine inutile : le vice était né avec l’homme. On le retrouve inévitablement chez tous les peuples.
De pudiques commentateurs, comme le professeur Welcker, ont émis l’étrange opinion que « la pédérastie fortifiait, chez les Grecs, les liens de l’amitié, et même que ce vice n’était pas le résultat de la sensualité mal entendue, mais d’un principe élevé de la théorie du beau[2] ». Mais ce n’est là que l’expression d’un désir personnel, à moins que ce ne soit simplement une querelle de mots.
En réalité, comme l’écrivait le savant Karl Forberg, « les Grecs et les Romains furent d’aussi enragés pédicons que des cinèdes accomplis ; car dans les œuvres des écrivains des deux nations, à la grande indignation des éducateurs, le baiser mâle s’étale à chaque page[3] ».
Et le bibliothécaire de Cobourg appuie son affirmation d’un passage remarquable de la Satyre sotadique de Nicolas Chorier :
« Tous brûlaient de la même ardeur, et le peuple, et les grands, et les rois. Cette passion causa la mort de Philippe, roi de Macédoine, lequel périt de la main de Pausanias qu’il avait souillé. Elle mit aux pieds du roi Nicomède Jules César, qui se transformait en femme pour tous les hommes, comme il était homme pour toutes les femmes. Auguste n’a pas échappé à la contagion, Tibère et Néron s’en faisaient gloire. Néron épousa Tigellin, Sporus épousa Néron. Trajan, le meilleur des empereurs, parcourant l’Orient en triomphateur, se faisait accompagner d’un pœdagogium. On appelait ainsi une troupe de jeunes garçons des plus jolis qu’il provoquait jour et nuit à recevoir ses embrassements. Antinoüs, rival de Plautine, et rival heureux, servit de maîtresse à Hadrien. L’empereur porta le deuil de sa mort et plaça au rang des dieux, en lui consacrant des autels et des temples, celui qui avait cessé de compter parmi les vivants. Antoine Héliogabale, neveu de Sévère, avait coutume de recevoir le baiser dans toutes les cavités du corps, au dire d’un écrivain de l’antiquité, et ses contemporains le tinrent pour un monstre. Les philosophes même, à l’austère gravité, sacrifièrent à cette Vénus et se mêlèrent au chœur des pédérastes. Alcibiade et Phédon couchaient avec Socrate chaque fois qu’ils voulaient procurer quelque jouissance à leur maître. Et les amours de cet homme si vénéré ont donné naissance au dicton appliqué au baiser : aimer à la façon de Socrate. Tous les faits et gestes, toutes les paroles de Socrate revêtent en quelque sorte un caractère sacré pour les philosophes de toutes les sectes qui lui ont consacré des temples, élevé des autels. Ses actes avaient force de lois, ses paroles tenaient lieu d’oracles. Les philosophes se gardèrent bien de s’écarter de l’exemple de leur héros, véritable dieu national, car Socrate prit rang parmi les héros. Lycurgue, qui légiféra à Sparte quelques siècles avant Socrate, affirmait qu’un citoyen ne pouvait être vraiment honnête et utile à la République s’il n’avait pas un ami avec qui il couchât. Il ordonnait que les jeunes filles parussent toutes nues sur le théâtre pour y exécuter des danses, afin que l’aspect de leurs charmes, ouvertement exposés, émoussât l’amour que les jeunes gens concevaient naturellement pour elles et rendit plus ardent celui qu’ils portaient à leurs amis et compagnons. Car on n’est plus aussi touché des objets que l’on voit souvent.
« Que dire des poètes ? Anacréon aime Bathylle. Les plaisanteries de Plaute roulent presque toutes sur cette matière ; ainsi : « Je ferai comme les jeunes garçons, je me courberai vers les petits trous. » Et encore : « L’épieu du soldat s’adaptait-il bien à ton fourreau ? » Mieux encore, Virgile, le maître poète, qui reçut le surnom de « Virginal » à cause de sa pureté naturelle, aimait Alexandre, dont Pollion lui avait fait présent, et le couvrait de compliments dans ses écrits sous le nom d’Alexis. Ovide ressentit la même passion ; toutefois il préféra les filles aux garçons, disant que la jouissance devait être commune aux deux partenaires, et non le privilège d’un seul.
« Les jeunes filles se voyant négligées de leurs amoureux, et les épouses de leur maris, si elles se bornaient à fournir le service du baiser féminin, se laissèrent aller à jouer le rôle de mignons. Les passions en arrivèrent à un tel point de démence que les nouvelles mariées, après les épouses, durent se plier à cette complaisance : alors on quittait un jeune garçon pour entreprendre une jeune fille : les deux sexes se trouvaient confondus en un seul et même corps. Dans les jeux poétiques des anciens, Priape menace tout voleur de légumes qui s’approchera de son pieu de lui prendre de force « ce que, la première nuit de ses noces, la vierge accorde à l’ardeur de son époux, alors que la petite sotte redoute d’être blessée en l’autre fente. » (Priapée II.)
« Comme ce fut de tout temps le privilège des poètes et des peintres d’avoir toutes les audaces, ne voyons-nous pas Valère Martial (Epigr. xi, 43) imaginer que son épouse lui adresse des reproches, attestant qu’elle aussi a des fesses, et cherchant à le détourner de son amour insensé des garçons ? Elle dit que Junon sut plaire de ce côté à Jupiter ; mais le mari ne se laisse pas convaincre, prétendant que le mignon a son rôle, la femme le sien. Son épouse doit se contenter du sien.
« Dans les lupanars, sous l’écriteau et sous la lampe, se tenaient assis des garçons et des filles, les premiers parés sous la robe de vêtements féminins, celles-ci portant peu d’ajustements sous la tunique de garçon, et le visage arrangé pour ressembler à des mignons. Sous un sexe, on retrouvait l’autre.
« L’Asie a été le premier siège du mal. Cependant l’Afrique n’en a pas été garantie, et c’est de chez elle que la contagion gagna la Grèce et les contrées voisines en Europe. Orphée mit le premier ce fétide plaisir en usage dans la Thrace, et les femmes ciconiennes, se voyant méprisées, « déchirèrent son corps pendant les mystères de Bacchus et ses nocturnes orgies, et en dispersèrent à travers champs tous les morceaux ». (Virgile, Géorgiques, IV, 521.)
« On dit qu’autrefois les Celtes se moquaient de ceux qui n’étaient pas atteints de cette folie ; Ils leur refusaient même toute participation aux charges et aux honneurs. Ceux qui parvenaient à conserver des mœurs pures étaient marqués d’impureté et isolés. Tant il est vrai qu’il n’est pas bon, dans la démence publique de toute une ville, d’être seul sage ; et cela n’est pas plus convenable que ce n’est bon[4]. »
Dans les temps modernes, Forberg constate que le baiser mâle fut goûté à peu près par toutes les nations : il excepte cependant les Anglais, « qui considèrent cette passion comme chose abominable et criminelle ». Mais il met hors de pair, à ce titre, les Espagnols et surtout les Italiens, pour des raisons physiologiques que la Satyre de Chorier développe avec quelque crudité dans le même dialogue. Il est certain que nul poète n’a osé chanter les voluptés du baiser mâle, comme le fit le patricien de Venise Giorgio Baffo. Pierre Arétin lui-même y mit plus de réserve, bien qu’il ait déclaré : « Car il n’est pas homme celui qui n’est pas bougre. » Sonnet II[5].
C’est d’ailleurs à l’influence des Italiens que la France dut, au seizième siècle, la recrudescence de la passion sodomique. « Aujourd’hui, dit Henri Estienne, la sodomie devient de plus en plus commune, parce qu’on fréquente les pays qui en font métier et marchandise. Au reste, si on regarde quels sont les Français qui s’adonnent à tels vices, on trouvera que quasi tous ont été en Italie ou en Turquie, ou, sans bouger de France, ont fréquenté avec ceux de ces pays-là, ou pour le moins ont conversé avec ceux qui avaient été à leur école. Les mots dont nous usons pour exprimer cette infamie sont empruntés au langage italien. Quelle est la ville d’Italie qui exporte chez nous ces coutumes ? En Italie même, un proverbe dit que Sienne se vante, entre autres choses, des bardaches et des putains. Mais, au dire des connaisseurs, Rome doit aller devant Sienne comme sodomie[6]. »
Le seizième siècle, c’est l’époque des mignons de Henri III, ces insolents et turbulents, frisés et pomponnés Hermaphrodites, « garces du cabinet », qui savaient « branler à propos la crête d’un panache, garnir et bas et haut de roses et de nœuds des cheveux poudrés, soigner leur dents aux pastilles de musc, farder leur teint de blanc d’Espagne, de rouge, faire les bègues, les las, avoir une voix molle et claire, une paupière languissante et pesante ». Le mignon de cour, le frontispice d’un pamphlet mordant nous en a transmis le portrait en costume Henri III, tête de femme, corsage et col Henri III, culotte et courte épée, avec cette inscription :
Je ne suis mâle ni femelle,
Et si je suis bien en cervelle
Lequel des deux je dois choisir.
Mais qu’importe à qui on ressemble,
Il vaut mieux les avoir ensemble,
On en reçoit double plaisir[7].
Le vice avait aussi pénétré dans les familles et souillé jusqu’au lit conjugal ; Brantôme conte qu’une dame éperdument éprise d’un gentilhomme qui manifestait quelques craintes du mari, lui dit : « N’ayez pas peur ; car il n’oserait rien faire, craignant que je l’accuse de m’avoir voulu user de l’arrière-Vénus. »
Le chroniqueur a d’ailleurs ouï dire que plusieurs maris étaient atteints de sodomie et s’accommodaient de leurs femmes plus par le derrière que par le devant. Aussi beaucoup de femmes, si elles étaient visitées par les sages-femmes, ne se trouveraient non plus pucelles par le derrière que par le devant. Peut-être y prennent-elles quelque plaisir ; ou bien elles n’osent le découvrir de peur de scandale, ou encore elles se taisent pour tenir leurs maris en sujétion et pouvoir de leur côté prendre des amants.
Le sire de Bourdeille a poussé ses révélations plus loin encore ; les contes gras ne l’effrayaient pas.
« Un mari de qualité, dit-il, était vilainement épris d’un jeune homme qui aimait fort sa femme et en était aimé. Un jour qu’il les surprit couchés et accouplés ensemble, menaçant le jeune homme de le tuer s’il ne satisfaisait à sa passion, il l’investit tout couché, et joint et collé sur sa femme, et en jouit ; dont sortit le problème, comme trois amants furent jouissants et contents tous ensemble[8]. »
Henri IV, le « chevalier banal de la France », essaya vainement d’enrayer le mal et de détourner la passion des plaisirs ultramontains vers le baiser naturel. « À la cour, dit Lestoile, dans son Journal d’Henri IV, on ne parle que de duels, puteries et maquerellages ; le jeu et le blasphème y sont en crédit ; la sodomie y règne tellement qu’il y a presse à mettre la main aux braguettes : les instruments desquelles ils appellent entre eux, par un vilain jargon, les épées de chevet. »
Les sodomites sont tellement en faveur que, comme au temps de Martial, les rimeurs savaient aller au-devant du succès en présentant à leurs lecteurs le portrait du « mignon » idéal :
Je veux qu’en plusieurs lieux mon ami soit ombré
D’un beau poil crépelu, poil que je tiens sacré,
Comme m’advant-courant le doux fruit que je cueille,
Et principalement je veux que son menton
Aye un petit duvet d’un blondoyant coton.
Oserai-je oublier ce que je veux surtout,
Le fregon de mon four, bâton qui n’a qu’un bout,
Mon mignon boute-feu de ma flamme amiable,
L’ithyphalle gaillard qu’il me faut amorcer,
Qui sans caresse peut un monde caresser,
De grandeur naturelle et de grosseur semblable.
Toujours prompt, vif, ardent, ayant un sang altier,
Et deux braves témoins pour me certifier
Qu’il est prêt, bien en point, gonflé d’ardeur féconde,
Encore que sa forme enseigne sa valeur,
Son chef, son front, son nez, n’est-ce pas un beau cœur,
Qui sans cesse combat la plus grand’part du monde[9] ?
Après la mort de Henri IV, la veulerie de Louis XIII qui le conduisit, semble-t-il, jusqu’à des pratiques sodomites, laissa se développer ces passions autour de lui.
Mlle de Gournay elle-même, la fille adoptive de Montaigne, à qui l’on demandait si la pédérastie n’était pas un crime : « À Dieu ne plaise, répondit-elle, que je condamne ce que Socrate a pratiqué. »
Et plus tard, au dire de la duchesse d’Orléans, tous les héros du vice italien se proposent pour modèles Hercule, Thésée, Alexandre, César, qui tous avaient leurs favoris. Ceux qui s’adonnent à ce vice et qui croient dans la sainte Écriture s’imaginent que c’était seulement un péché lorsqu’il y avait peu de gens dans le monde, et qu’on était ainsi coupable en empêchant qu’il ne se peuplât ; mais depuis que la terre est toute peuplée, ils ne regardent plus cela que comme un divertissement ; on évite cependant, autant que possible, d’être accusé de ces vices parmi le peuple, mais, entre gens de qualité, on en parle publiquement ; on regarde comme une gentillesse de dire que depuis Sodome et Gomorrhe, le Seigneur n’a puni personne pour ces méfaits.
Les exemples ne manquaient point pour confirmer ces assertions. M. de Schomberg, accusé d’aimer « les ragoûts de delà les monts », s’étant attaché à Mme Le Page, Bautru disait : « Je ne m’étonne pas qu’il l’aime, son nom même a des charmes pour lui : elle s’appelle Mme Le Page. »
Mme de Saint-Germain Beaupré découvrit à son père, M. le président Le Bailleul, que Saint-Germain la voulait forcer à lui accorder ce qu’on appelle ogni piacer en Italie, et qu’il était si adonné à ce vice que, pour résoudre un page à satisfaire sa brutalité, il avait voulu contraindre sa femme à s’abandonner au page.
Des Barreaux, ayant perdu trop tôt son père, se mit à fréquenter Théophile et d’autres débauchés, qui lui gâtèrent l’esprit et lui firent faire mille saletés. C’est à lui que Théophile écrit ses lettres latines avec la suscription : Theophilus Vallaeo suo. On ne manqua pas de dire en ce temps-là que Théophile en était amoureux, et le reste.
Quant à l’abbé de Boisrobert,
Cet admirable Patelin,
Aimant le genre masculin,
il fut surnommé le « bourgmestre de Sodome ». Ninon de Lenclos, qu’il appelait sa divine, le plaisantait souvent à ce sujet, mais sans grande méchanceté. Alors que Ninon était enfermée dans un couvent, à Lagny, Boisrobert y fut pour voir sa divine. Il avait un petit laquais, et quand il fut parti, une servante de l’hôtel de l’Épée royale dit à quelqu’un qui occupait la même chambre : « Monsieur, ne fera-t-on qu’un lit pour vous et pour votre laquais, comme à M. l’abbé de Boisrobert ? » Ninon lui en fit la guerre et lui dit : « Au moins, je ne voudrais point des laquais. — Vous ne vous y entendez pas, lui dit-il, la livrée, c’est le ragoût. »
Pour montrer combien peu il se fâchait de ses petites complexions, il disait que Ninon lui écrivait, parlant du bon traitement que lui faisaient les Madelonnettes, où les dévots la firent mettre : « Je pense qu’à votre imitation, je commencerai à aimer mon sexe[10]. »
Sous Louis XIV, les pédérastes sont moins à leur aise ; le grand Alexandre aurait bien voulu abolir ce vice. Au moins prend-il contre les pratiquants des mesures rigoureuses, surtout contre les petits. Il fait enfermer et mettre au secret un nommé Antoine Fenelle, « surpris dans le crime de sodomie » ; il fait mettre à la Bastille des gens de livrée sodomites, Langlois, La Boie, Alexandre ; et informé que les cours du Louvre servent aux usages les plus infâmes de prostitution et de débauche, il fait fermer le passage au public[11].
Les grands, eux, se sentant menacés, ou peut-être recherchant un piment nouveau dans le mystère, jugèrent à propos de rassembler en une association fermée aux profanes les plus marquants, les mieux appréciés parmi les partenaires de la pédérastie. L’histoire de cette société, le formulaire de ses statuts nous ont été transmis par Bussy-Rabutin en quelques pages que nous publions plus loin.
La malignité publique n’en avait pas moins chansonné, parfois même avec quelque brutalité, certains partisans notoires du baiser masculin.
Sur les Sodomites. (1680.)
Les jeunes gens de votre cour
De leur corps font folie,
Et se régalent tour à tour
Des plaisirs d’Italie.
Autrefois pareille action
Eût mérité la braise.
Mais ils ont un trop bon patron
Dans le père La Chaise.
Sur Achille de Harlay, premier président du parlement de Paris, accusé de sodomie, et qui a puni très sévèrement son fils parce qu’il entretenait une fille assez jolie, appelée Mademoiselle Vallereau. (1690.)
Le goût du premier Président
Est d’enfiler le parlement ;
Il débauche les fils aux pères,
Lère la lère lan lère,
Lère la lère lan la.
Il a bien puni son enfant
D’avoir commencé par devant,
Il voulait qu’il fit par derrière
Lère la lère lan lère,
Lère la lère lan la.
Sur le duc de Vendôme. (1695.)
Vendôme, animé par son père,
Par Chemeraut, par Barbezière,
Devient d’un commerce fâcheux ;
Sans raison il s’emporte, il gronde ;
Mais quand il n’agit plus par eux,
C’est le meilleur bougre du monde.
Cette dernière chanson est accompagnée, dans le manuscrit, de la note suivante :
« Ce dernier vers indique que le duc de Vendôme était sodomite. Mais il eût été à souhaiter qu’au lieu de bougre l’auteur eût pu mettre bardache, car le grand plaisir de ce duc était de se faire enculer ; il se servait pour cela de valets et de paysans, faute de plus gentils ouvriers. On dit même que les paysans des environs de sa belle maison d’Anet se tenaient avec soin sur son chemin lorsqu’il y allait à la chasse, parce qu’il les écartait souvent dans les bois pour se faire f..... et leur donnait à chacun une pistole pour le prix de leur travail. »
Vers pour mettre sous le portrait du duc
de Vendôme. (1702.)
Ce héros, que tu vois ici représenté,
Favori de Vénus, favori de Bellone,
Prit la vérole et Barcelone,
Toutes deux du mauvais côté.
Sur la mort de Monsieur, duc d’Orléans,
frère unique du Roi, le 9 juin 1701.
Philippe est mort la bouteille à la main ;
Le proverbe est fort incertain
Qui dit que l’homme meurt comme il vit d’ordinaire ;
Il nous montre bien le contraire,
Car s’il fût mort comme il avait vécu,
il serait mort le v.. au cu[12].
Le Régent Philippe d’Orléans, le fils de celui qu’on chansonnait si vertement, avait lui-même trop d’écarts licencieux à se faire pardonner, était trop occupé par ailleurs pour songer à réfréner quelque passion que ce fût. Aussi les chroniqueurs contemporains ont-ils constaté comme une recrudescence de la pédérastie.
La duchesse d’Orléans écrit en 1717 que le premier dauphin était soupçonné « d’un goût qui commençait à se répandre » ; mais il n’aimait que les femmes. Au contraire, le chevalier de Lorraine et le comte de Marsan courent après les hommes. « Le vice d’aimer les jeunes garçons est aussi la plus grande passion du duc de Villars ; et le joli prince d’Eisenach voulut une fois lui faire donner des coups de bâton, parce qu’il lui avait fait une déclaration d’amour[13]. »
Le duc de Richelieu raconte que, se rendant un soir secrètement dans l’appartement de la duchesse de Charolais, sa maîtresse, il fut suivi avec empressement par un homme qui, dit-il, appartenait à une secte à laquelle Louis XIV avait vainement fait une guerre acharnée. Il ajoute qu’un groupe de dix-sept courtisans se livra, dans le jardin de Versailles, au clair de la lune et presque sous les fenêtres du jeune roi, aux excès les plus dégoûtants de la luxure.
Le jeune duc de Boufflers, le marquis de Rambure et le marquis d’Alincourt étant allés dans un bosquet, le duc de Boufflers voulut violer Rambure et n’en put venir à bout. D’Alincourt dit qu’il voulait prendre la revanche de son beau-frère Boufflers. Rambure ne s’en défendit point et en passa doucement par là.
À la suite de ces débauches, des lettres de cachet ont été données, et le maréchal de Villeroy les a demandées contre sa propre famille. M. d’Alincourt, son petit-fils, fut exilé à Joigny, et sa femme dut aller l’y trouver. La duchesse de Retz est renvoyée de la cour. Le duc de Boufflers est exilé en Picardie, sa femme s’y retire avec lui, et on lui donne un gouverneur comme à un enfant. Le marquis de Rambure, patient de toutes manières, a été mis à la Bastille.
Quand le roi a demandé pourquoi tous ces exils contre ces jeunes seigneurs, on lui a dit qu’ils avaient arraché des palissades dans les jardins, et à présent on ne donne d’autre nom à ces jeunes seigneurs qu’arracheurs de palissades.
La jeunesse de la cour voulait donner au Roi un goût pour les hommes. Sur quoi la duchesse de La Ferté avait dit qu’on remarquait dans l’histoire que la galanterie des rois roulait, l’un après l’autre, sur les hommes et sur les femmes : qu’Henri II et Charles IX aimaient les femmes, Louis XIII les hommes, Louis XIV les femmes, et qu’à présent le tour des mignons était revenu.
Il paraît certain que Louis XV, malgré toutes ces tentatives, ne fut pas gagné aux pratiques sodomites : l’amant des cinq sœurs de Nesle, de Mme de Pompadour, de la comtesse du Barry, le sultan du Parc-aux-Cerfs a donné de trop indiscutables preuves de son goût personnel pour le sexe féminin. Mais autour de lui, dans le relâchement des mœurs, les « bougres » retrouvaient toutes facilités pour exercer leur passion unisexuelle. Ils comptent d’ailleurs des adeptes de choix. Ainsi, le duc de Villars, le fils de l’illustre maréchal et qui lui succède dans la plupart de ses dignités, avait ces goûts invétérés, qui lui valurent, comme au comte de Mirabeau père, le surnom ironique de l’Ami des hommes.
Les rapports du policier Marais signalent, en 1769, l’ambassadeur de Venise comme affilié à la secte des sodomites. Le vice, d’ailleurs, n’est-il pas dit italien ?
« On assure, écrit-il, que l’ambassadeur de Venise vient de faire huit mille livres de rentes au petit Fleury, comédien de la troupe de Montansier, et malgré cela il lui donne trente louis par mois. » Et encore : « L’ambassadeur de Venise vient de donner au petit Fleury un cabriolet avec un cheval pour venir plus souvent à Paris. Il l’entretient comme une jolie femme. »
Le duc d’Elbeuf lui-même, au dire de Casanova, s’était entouré de mignons qui, à tour de rôle, étaient admis dans sa couche[14].
Nous pourrions à plaisir allonger la liste ; mais nous en avons assez dit pour expliquer la publication des Anecdotes secrètes pour servir à l’histoire, secrète des Ebugors. Sans doute la Société des sodomites, contre laquelle Louis XIV avait engagé la guerre, n’avait pas encore été dissoute, ou bien, si elfe avait disparu quelque temps, s’était-elle reconstituée clandestinement. Ce sont, en effet, ses membres que l’auteur anonyme des Anecdotes appelle, par un anagramme facile, des Ebugors (bougres). C’est leurs luttes contre les Cythéréennes, contre les amoureuses, qu’il conte sous une forme imagée, avec des allusions translucides aux événements et ans personnages du temps.
La valeur de ce pamphlet a pu être discutée ; toutefois, il n’est pas superflu de constater que l’indignation de vertueux moralistes a surtout contribué à faire classer cette pièce curieuse parmi les productions ignobles du xviiie siècle. C’est beaucoup, c’est trop dire. En réalité, elle est pour nous, avant tout, une pièce fort rare et des plus intéressantes à connaître pour l’étude des mœurs du siècle galant. N’est-ce pas là un fort suffisant mérite ?
L’auteur de ce pamphlet est tout à fait inconnu. Drujon, constatant que le procédé employé pour déguiser les noms ressemble singulièrement à celui dont a fait usage le chevalier de Mouhy, dans le recueil de récits obscènes intitulé Les Mille et une faveurs, en vient à penser que ce chevalier pourrait bien être l’auteur des Anecdotes. De Mouhy, neveu du baron de Longepierre, fécond romancier, a laissé nombre d’ouvrages qui, au dire de Palissot lui-même, sont les plus riches modèles du style plat et du genre niais. Or il est telle page des Anecdotes qui dénote, chez l’auteur, un maniement aisé, délicat de l’allusion à fleur de peau. Quant aux Mille et une faveurs, « contes de cour, tirés de l’ancien gaulois par la reine de Navarre, et publiés par le chevalier de Mouhy », ils appartiennent, en effet, au genre allégorique et ennuyeux, et les anagrammes des noms propres y sont tellement compliqués que leur obscénité apparaît à grand’peine. Nous laissons à la sagacité des lecteurs le soin de deviner quelles grossièretés se dissimulent sous des noms comme oturfe, lodeobarty, cernogla.
La première édition de notre pamphlet porte le titre suivant :
Anecdotes pour servir à l’Histoire secrète des Ebugors, à Medoso (anagramme de Sodome), L’an de l’ère des Ebugors MMMCCCXXXIII (1733). In-12 de 106 pages, dont 4 paires pour la clef. À la fin se trouve l’indication de l’imprimeur : Amsterdam, chez J. P. du Valis.
Le seul exemplaire que possède la Bibliothèque nationale (Enfer, 113) porte sur le titre la signature autographe A. Horn, et sur le plat de la reliure, en lettres capitales dorées : ADAM HORN.
Nous ne connaissons pas d’autre réimpression que celle qu’en a faite Kistemaekers en 1813, à Bruxelles, petit in-8, tirage à 200 exemplaires.
Cependant M. de Paulmy, dit-on, en possédait une édition (n° 6070 de son catal. ms), sans lieu ni date, avec figures au nombre de vingt[15].

La France devenue italienne, avec les autres désordres de la cour,qui nous a transmis les statuts des sodomites au xviie siècle, fait partie d’un ensemble de libelles portant le titre L’Histoire amoureuse des Gaules, et attribués à Bussy-Rabutin. Ces pamphlets furent publiés séparément et clandestinement, en Hollande pour la plupart, de 1665 à 1691, et il est difficile de déterminer exactement lesquels appartiennent vraiment au comte Roger de Bussy-Rabutin.
La France devenue italienne figure en tête du tome V de la jolie édition de l’Histoire amoureuse des Gaules, publiée en 1754 (s. l.), en 5 volumes in-12, avec titres gravés. Un exemplaire relié en veau marbré, portant sur le plat les armes de Marie-Antoinette, est à la Bibliothèque nationale (L. B. 37, 3523 D. Réserve).

LES STATUTS
DES SODOMITES
au XVIIe siècle.

 A facilité de toutes les dames
avait rendu leurs charmes si
méprisables à la jeunesse,
qu’on ne savait presque plus à
la cour ce que c’était que de les regarder ;
la débauche y régnait plus qu’en aucun lieu
du monde, et quoique le Roi eût témoigné
plusieurs fois une horreur inconcevable
pour ces sortes de plaisirs, il n’y avait
qu’en cela qu’il ne pouvait être obéi. Le
vin et ce que je n’ose dire étaient si fort à
la mode qu’on ne regardait presque plus
ceux qui recherchaient à passer leur temps
plus agréablement, et quelque penchant
qu’ils eussent à vivre selon l’ordre de la
nature, comme le nombre était plus grand
de ceux qui vivaient dans le désordre, leur
exemple les pervertissait tellement qu’ils
ne demeuraient pas longtemps dans les
mêmes sentiments.
A facilité de toutes les dames
avait rendu leurs charmes si
méprisables à la jeunesse,
qu’on ne savait presque plus à
la cour ce que c’était que de les regarder ;
la débauche y régnait plus qu’en aucun lieu
du monde, et quoique le Roi eût témoigné
plusieurs fois une horreur inconcevable
pour ces sortes de plaisirs, il n’y avait
qu’en cela qu’il ne pouvait être obéi. Le
vin et ce que je n’ose dire étaient si fort à
la mode qu’on ne regardait presque plus
ceux qui recherchaient à passer leur temps
plus agréablement, et quelque penchant
qu’ils eussent à vivre selon l’ordre de la
nature, comme le nombre était plus grand
de ceux qui vivaient dans le désordre, leur
exemple les pervertissait tellement qu’ils
ne demeuraient pas longtemps dans les
mêmes sentiments.
La plupart des gens de qualité étaient non seulement de ce caractère, mais il y avait encore des princes, ce qui fâchait extraordinairement le Roi. Ils se cachaient cependant autant qu’ils pouvaient pour ne lui pas déplaire, et cela les obligeait à courir toute la nuit, espérant que les ténèbres leur seraient favorables. Mais le Roi (qui était averti de tout) sut qu’un jour après son coucher ils étaient venus à Paris, où ils avaient fait une telle débauche qu’il y en avait beaucoup qui s’en étaient retournés saoûls dans leurs carrosses. Et comme cela s’était passé dans le cabaret (car ils ne prenaient pas plus de précautions pour cacher leurs désordres), il prit sujet de là d’en faire une grande mercuriale à un jeune prince qui s’y était trouvé, en qui il prenait intérêt. Il lui dit que du moins, s’il était assez malheureux pour être adonné au vin, il bût chez lui tout son saoûl et non pas dans un endroit comme celui-là, qui était de toutes façons si indigne pour une personne de sa naissance.
Le reste de la cabale n’essuya pas les mêmes reproches, parce qu’il n’y en avait pas un qui touchât le Roi de si près ; mais, en récompense, il leur témoigna un si grand mépris qu’ils furent bien mortifiés. Et, à la vérité, ils furent quelque temps sans oser rien faire qu’en cachette ; mais, comme leur caractère ne leur permettait pas de se contraindre longtemps, ils en revinrent bientôt à leur inclination, qui les portait à faire les choses avec plus d’éclat.
Pour ne pas s’attirer néanmoins la colère du Roi, ils jugèrent à propos de faire serment et de le faire faire à tous ceux qui entreraient dans leur confrérie de renoncer à toutes les femmes ; car ils accusaient un d’entre eux d’avoir révélé leurs mystères à une dame avec qui il était bien, et ils croyaient que c’était par là que le Roi apprenait tout ce qu’ils faisaient. Ils résolurent même de ne le plus admettre dans leur compagnie ; mais s’étant présenté pour y être reçu et ayant juré de ne plus voir cette femme, on lui fit grâce pour cette fois, à condition que s’il y retournait il n’y aurait plus de miséricorde. Ce fut la première règle de leur confrérie ; mais la plupart ayant dit que, leur ordre allant devenir bientôt aussi grand que celui de Saint-François, il était nécessaire d’en établir de solides et auxquelles on serait obligé de se tenir ; le reste approuva cette résolution et il ne fut plus question que de choisir celui qui travaillerait à ce formulaire. Les avis furent partagés là-dessus et comme on voyait bien que c’était proprement déclarer chef de l’Ordre celui à qui l’on donnerait ce soin, chacun brigua les voix et fit paraître de l’émulation pour un si bel emploi. Manicamp, le duc de Grammont et le chevalier de Tilladet[16] étaient ceux qui faisaient le plus de bruit dans le chapitre et qui prétendaient s’attribuer cet honneur à l’exclusion l’un de l’autre : Manicamp, parce qu’il avait plus d’expérience qu’aucun dans le métier ; le duc de Grammont, parce qu’il était duc et pair et qu’il ne manquait pas aussi d’acquit ; pour ce qui est du chevalier de Tilladet, il fondait ses prétentions sur ce qu’étant chevalier de Malte, c’était une qualité si essentielle pour être parfaitement débauché que, quelque avantage qu’eussent les autres, comme ils n’avaient pas celui-là, il était sûr qu’il les surpasserait de beaucoup dans la pratique des vertus.
Comme ils avaient tous trois du crédit dans le chapitre, on eut de la peine à s’accorder sur le choix, et quelqu’un ayant été d’opinion qu’ils devaient donner des reproches les uns contre les autres, afin que l’on choisît après cela celui qui serait le plus parfait, chacun approuva cette méthode. Et le chevalier de Tilladet, prenant la parole en même temps, dit qu’il était ravi qu’on eût pris cette voie et qu’elle allait lui faire obtenir ce qu’il désirait ; que Manicamp aurait pu autrefois entrer en concurrence avec lui et qu’il ne l’aurait pas trouvé étrange, parce que le bruit était qu’il avait eu de grandes qualités, mais qu’aujourd’hui que ses forces étaient énervées, c’était un abus que de le vouloir constituer en charge, à moins qu’on ne déclarât que ce qu’on en ferait ne tirerait à aucune conséquence pour l’avenir ; qu’en effet, il n’avait plus rien de bon que la langue et que toutes les autres parties de son corps étaient mortes en lui.
Manicamp ne put souffrir qu’on lui fît ainsi son procès en si bonne compagnie, et ayant peur qu’après cela personne ne le voulût plus approcher, il dit qu’il n’était pas encore si infirme qu’il n’eût rendu quelque service à la maréchale d’Estrées, sa sœur[17] ; qu’elle en avait été assez contente pour ne pas chercher parti ailleurs ; que ceux qui la connaissaient savaient pourtant bien qu’elle ne se satisfaisait pas de si peu de chose et que, puisqu’elle ne s’était pas plainte, c’était une marque qu’il valait mieux qu’on ne disait.
Il y en eut qui voulurent dire que cette raison n’était pas convaincante et qu’une femme qui avait pris un mari à quatre-vingt-quinze ou seize ans n’était pas partie capable d’en juger ; mais ceux qui connaissaient son tempérament leur imposèrent silence et soutinrent qu’elle s’y connaissait mieux que personne.
Le chevalier de Tilladet fut un peu démonté par cette réponse ; néanmoins il dit encore beaucoup de choses pour soutenir son droit, et, entre autres, qu’il avait eu affaire à Manicamp et qu’il n’avait pas éprouvé cette grande vigueur dont il faisait tant de parade. On fut obligé de l’en croire sur sa parole, et il s’éleva un murmure dans la compagnie qui fit juger à Manicamp que son affaire n’irait pas bien. Quand ce murmure fut apaisé, le chevalier de Tilladet reprit la parole et dit qu’à l’égard du duc de Grammont il y avait un péché originel qui l’excluait de ses prétentions : qu’il aimait trop sa femme, et que, comme cela était incompatible avec la chose dont il s’agissait, il n’avait point d’autres reproches à faire contre lui.
Le duc de Grammont, qui ne s’attendait pas à cette insulte, ne balança point un moment sur la réponse qu’il avait à faire ; et comme il savait qu’il n’y a rien de tel que de dire la vérité, il avoua de bonne foi que cela avait été autrefois, mais que cela n’était plus. La raison qu’il en rapporta fut qu’il s’était mépris à son tempérament ; qu’il avait attribué les faveurs qu’il en avait obtenues avant son mariage au penchant qu’elle avait pour lui ; mais que celles qu’elle avait données depuis à son valet de chambre lui ayant fait connaître qu’il était impossible de répondre d’une femme, il lui avait si bien ôté son amitié qu’il lui avait fait succéder le mépris ; que c’était pour cela qu’il avait renoncé à l’amour du beau sexe, lequel avait eu autrefois son étoile, et qui l’aurait peut-être encore si l’on pouvait prendre quelque confiance ; que, quoiqu’il fût fils d’un père et cadet d’un frère[18] qui avaient eu tous deux de grandes parties pour obtenir les plus hautes dignités de l’Ordre, il était cependant moins redevable de son mérite à ce qu’il avait hérité d’eux qu’à son dépit ; que Dieu se servait de toutes choses pour attirer à la perfection ; qu’ainsi, bien loin de murmurer contre sa Providence pour les sujets de chagrin qu’il lui envoyait, il avouait tous les jours qu’il lui en était bien redevable.
Le chevalier de Tilladet n’eut rien à répondre à cela, et chacun crut que l’humilité du duc de Grammont, jointe à une si grande sincérité, ferait faire réflexion aux avantages qu’il avait par-dessus les autres, soit pour les charmes de sa personne ou pour le rang qu’il tenait. En effet, il allait obtenir tout d’une voix la chose pour laquelle on était alors assemblé, si le comte de Tallard[19] ne se fût avisé de dire que l’Ordre allait devenir trop fameux pour n’avoir qu’un grand maître ; que tous trois étaient dignes de cette charge, et qu’à l’exemple de celui de Saint-Lazare, où l’on venait d’établir plusieurs grands prieurs, on ne pouvait manquer de les choisir tous trois.
Chacun, qui prétendait à son tour de parvenir à cette dignité, approuva cette opinion ; mais comme on fit réflexion que dans quelques établissements que ce soit, c’est dans les commencements où l’on a particulièrement besoin d’esprit, on résolut de faire choix d’un quatrième, parce que les trois autres n’étaient pas soupçonnés de pouvoir jamais faire une hérésie nouvelle. Le choix tomba sur le marquis de Biran[20], homme qui avait plus d’esprit qu’il n’était gros, mais dont la trop grande jeunesse l’eût exclu de cet honneur sans le besoin qu’on en avait. D’abord que l’élection fut faite, on les pria de travailler tous quatre aux règles de l’Ordre, dont le principal but consistait de bannir les femmes de leur compagnie. Pour pouvoir vaquer à une chose si sainte, ils quittèrent non seulement la cour, mais encore la ville de Paris, où ils craignaient de recevoir quelque distraction, et, étant enfermés dans une maison de campagne, ils donnèrent rendez-vous aux autres, deux jours après, leur promettant qu’il ne leur en fallait pas davantage pour être inspirés. En effet, chacun les étant allé trouver au bout de ce temps-là, on trouva qu’ils avaient rédigé ces règles par écrit, dont voici les articles :
I.
Qu’on ne recevrait plus dorénavant dans l’Ordre des personnes qui ne fussent visitées par les grands maîtres, pour voir si toutes les parties de leur corps étaient saines, afin qu’elles pussent supporter les austérités.
II.
Qu’ils feraient vœu d’obéissance et de chasteté à l’égard des femmes, et que si aucun y contrevenait, il serait chassé de la compagnie, sans pouvoir y rentrer sous quelque prétexte que ce fût.
III.
Que chacun serait admis indifféremment dans l’Ordre, sans distinction de qualité, laquelle n’empêchait point qu’on ne se soumit aux rigueurs du noviciat qui durerait jusqu’à ce que la barbe fût venue au menton.
IV.
Que si aucun des frères se mariait, il serait obligé de déclarer que ce n’était que pour le bien de ses affaires, ou parce que ses parents l’y obligeaient, ou parce qu’il fallait laisser un héritier. Qu’il ferait serment en même temps de ne jamais aimer sa femme, de ne coucher avec elle que jusqu’à ce qu’il en eût un, et que cependant il en demanderait permission, laquelle ne pourrait lui être accordée que pour un jour de la semaine.
V.
Qu’on diviserait les frères en quatre classes, afin que chaque grand prieur en eût autant l’un que l’autre. Et qu’à l’égard de ceux qui se présenteraient pour entrer dans l’Ordre, les quatre grands prieurs les auraient à tour de rôle, afin que la jalousie ne pût donner atteinte à leur union.
VI.
Qu’on se dirait les uns aux autres tout ce qui se serait passé en particulier, afin que quand il viendrait une charge à vaquer, elle ne s’accordât qu’au mérite, lequel serait reconnu par ce moyen.
VII.
Qu’à l’égard des personnes indifférentes, il ne serait pas permis de leur révéler les mystères, et que quiconque le ferait en serait privé lui-même pendant huit jours, et même davantage, si le grand maître dont il dépendrait le jugeait à propos.
VIII.
Que néanmoins l’on pourrait s’ouvrir à ceux qu’on aurait espérance d’attirer dans l’Ordre ; mais qu’il faudrait que ce fût avec tant de discrétion, que l’on fût sûr du succès avant que de faire cette démarche.
IX.
Que ceux qui amèneraient des frères au couvent jouiraient des mêmes prérogatives, pendant deux jours, dont les grands maîtres jouissaient ; bien entendu, néanmoins, qu’ils laisseraient passer les grands maîtres devant et se contenteraient d’avoir ce qu’on aurait desservi de dessus leur table.
C’est ainsi que les règles de l’Ordre furent dressées, et ayant été lues en présence de tout le monde, elles furent approuvées généralement, à la réserve que quelques-uns furent d’avis qu’on apportât quelque tempérament à l’égard des femmes, crime qu’ils voulaient n’être pas traité à la dernière rigueur, mais pour lequel ils souhaitaient qu’on pût obtenir grâce, après néanmoins qu’on l’aurait demandé en plein chapitre et observé quelque forme de pénitence. Mais tous les grands maîtres se trouvèrent si zélés que ceux qui avaient ouvert cette opinion pensèrent être chassés sur-le-champ, et s’ils n’avaient témoigné un grand repentir, on ne leur aurait jamais pardonné leur faute.
On célébra dans cette maison de campagne de grandes réjouissances pour être venu à bout si facilement d’une si grande entreprise, et après bien des choses qui se passèrent, et qu’il est bon de taire, on convint que les chevaliers porteraient une croix entre la chemise et le justaucorps, où il y aurait élevé en bosse un homme qui foulerait une femme aux pieds, à l’exemple des croix de saint Michel, où l’on voit que ce saint foule aux pieds le démon.
Après qu’on eût accompli ces saints mystères, chacun s’en revint à Paris, et quelqu’un n’ayant pas gardé le secret, il se répandit bientôt un bruit de tout ce qui s’était passé dans cette maison de campagne, de sorte que les uns excités par leur inclination, les autres par la nouveauté du fait, s’empressèrent d’entrer dans l’Ordre.
Un prince, dont il n’est pas permis de révéler le nom, ayant eu ce désir, fut présenté au chapitre par le marquis de Biran, et ayant demandé à être relevé des cérémonies, on lui fit réponse que cela ne se pouvait et qu’il fallait qu’il montrât exemple aux autres. Tout ce qu’on fit pour lui, c’est qu’on lui accorda qu’il choisirait celui des grands maîtres qui lui plairait le plus, et il choisit celui qui l’avait présenté, ce qui fit grand dépit aux autres, qui le voyaient beau, jeune et bien fait.
Cette grâce fut encore suivie d’une autre qu’on lui accorda, savoir : qu’il pourrait choisir de tous les frères celui qui lui serait le plus agréable, dont néanmoins la plupart commencèrent à murmurer, disant que, puisqu’on violait sitôt les règles, tout serait bientôt perverti. Mais on leur fit réponse que ces règles, quelque étroites qu’elles pussent être, pouvaient souffrir quelque modération à l’égard d’une personne de si grande qualité ; que quoiqu’on eût dit qu’elles seraient égales pour tout le monde, c’est qu’on n’avait pas cru qu’il se dût présenter un prince d’un si haut rang ; que, comme à Malte les princes de maison souveraine étaient naturellement chevaliers grand’croix, il était bien juste qu’ils eussent pareillement quelque privilège dans leur Ordre ; autrement qu’ils n’y entreraient pas, ce qui ne leur apporterait pas grand honneur.
On n’eut garde de ne se pas rendre à de si bonnes raisons, et chacun ayant calmé sa colère, on complimenta le prince sur l’avantage qui revenait à l’Ordre d’avoir une personne de sa naissance, et il n’y en eut point qui ne s’offrit à lui donner toute sorte de contentement. Il se montra fort civil envers tout le monde et promit qu’on verrait dans peu qu’il ne serait pas le moins zélé des chevaliers. En effet, il n’eut pas plutôt révélé les mystères à ses amis que chacun se fit un mérite d’entrer dans l’Ordre, de sorte qu’il fut bientôt rempli de toutes sortes d’honnêtes gens.
Mais comme le trop grand zèle est nuisible en toutes choses, le Roi fut bientôt averti de ce qui se passait et que même on avait séduit un autre prince, en qui il prenait encore plus d’intérêt qu’en celui dont je viens de parler. Le Roi, qui haïssait à la mort ces sortes de débauches, voulut beaucoup de mal à tous ceux qui en étaient accusés ; mais eux, qui ne croyaient pas qu’on les en pût convaincre, se présentèrent devant lui comme auparavant, jusqu’à ce que, s’étant informé plus particulièrement de la chose, il en relégua quelques-uns dans des villes éloignées de la cour, fit donner le fouet à un de ces princes en sa présence, envoya l’autre à Chantilly, et enfin témoigna une si grande aversion pour tous ceux qui y avaient trempé que personne n’osa parler pour eux.
Le chevalier de Tilladet, qui était cousin germain du marquis de Louvois, se servit de la faveur de ce ministre pour obtenir sa grâce, et lui protesta si bien qu’il était innocent qu’il en fut parler à l’heure même à Sa Majesté. Mais Elle, qui ne croyait pas légèrement, ne s’en voulut pas rapporter à ce qu’il lui disait et remit à lui faire réponse quand il en serait instruit plus particulièrement. Pour cet effet, il fit appeler le jeune prince qui avait eu le fouet, et lui ayant commandé, en présence du marquis de Louvois, de lui dire la vérité, le marquis de Louvois fut si fâché d’entendre que le chevalier de Tilladet lui avait menti, qu’il s’en fut du même pas lui dire tout ce que la rage et le dépit étaient capables de lui inspirer.
Il n’y eut que le duc de Grammont à qui le Roi ne parla de rien, comme s’il n’eût pas été du nombre ; ce qui donna lieu de murmurer aux parents des exilés, qui étaient fâchés de le voir rester à Paris pendant que les autres s’en allaient dans le fond des provinces. Mais le Roi, sachant leur mécontentement, dit qu’ils ne devaient pas s’en étonner ; qu’il y avait longtemps que le duc de Grammont lui était devenu si méprisable que tout ce qu’il pouvait faire lui était indifférent, de sorte que ce serait lui faire trop d’honneur que d’avoir quelque ressentiment contre lui. La cour était trop peste pour cacher au duc une réponse comme celle-là, et au lieu qu’il tirait vanité auparavant d’avoir été oublié, il eut tant de sujet de s’en affliger que tout autre que lui en serait mort de douleur.
La cabale fut dissipée par ce moyen ; mais, quelque pouvoir qu’eût le Roi, il lui fut impossible d’arracher de l’esprit de la jeunesse la semence de débauche qui y était trop fortement enracinée pour être sitôt éteinte. Cependant, les dames firent de grandes réjouissances de ce qui venait d’arriver, et, quelques-unes des croix de ces chevaliers étant tombées entre leurs mains, elles les jugèrent dignes du feu, quoique ce fût une faible vengeance pour elles. Après cela, elles crurent que cette jeunesse serait obligée de revenir à elles ; mais elle se jeta dans le vin, de sorte que tous les jours on ne faisait qu’entendre parler de ses excès.
Cependant, quelque débauche qu’elle fît, pas une n’approcha de celle qui fut faite dans un honnête lieu où, après avoir traité à la mode d’Italie celles des courtisanes qui lui parurent les plus belles, elle en prit une par force, lui attacha les bras et les jambes aux quenouilles du lit, puis lui ayant mis une fusée dans un endroit que la bienséance ne me permet pas de nommer, elle y mit le feu impitoyablement, sans être touchée des cris de cette misérable, qui se désespérait. Après une action si enragée, elle poussa sa brutalité jusqu’au dernier excès : elle courut les rues toute la nuit, brisant un nombre infini de lanternes et ne s’arrêtant que sur le pont de bois qui aboutit dans l’île, où, pour comble de fureur, ou pour mieux dire d’impiété, elle arracha le crucifix qui était au milieu ; de quoi n’étant pas encore contente, elle tâcha de mettre le feu au pont dont elle ne put venir à bout.
Un excès si abominable fit grand bruit dans Paris ; on l’attribua à des laquais, ne croyant pas que des gens de qualité fussent capables d’une chose si épouvantable ; mais la femme chez qui ils avaient fait la débauche étant venue trouver M. Colbert le lendemain, sous prétexte de lui présenter un placet, lui dit que, s’il ne lui faisait justice de son fils le chevalier, qui était fourré des plus avant, elle allait se jeter aux pieds du Roi et lui apprendre que ceux-là qui avaient servi de bourreaux à la fille étaient les mêmes qui avaient arraché le crucifix ; elle ajouta qu’elle les avait suivis à la piste, dans le dessein de les faire arrêter par le guet, mais que malheureusement il s’était déjà retiré.
M. Colbert n’eut pas de peine à croire cela de son fils[21], qui lui avait déjà fait d’autres pièces de cette nature : et comme il appréhendait sur toutes choses que cela ne vint aux oreilles du Roi, non seulement il prit soin de la fille, mais il empêcha encore sous main qu’on ne fit une perquisition exacte de ce qui était arrivé la nuit. Mais quelque précaution qu’il eût, la chose pensa éclater lorsqu’il y pensait le moins. Un laquais de ces débauchés fut pris, deux ou trois mois après, pour vol ; et étant menacé par Deffita, lieutenant criminel, d’être appliqué à la question s’il ne révélait tous les crimes qu’il pourrait avoir commis, il avoua de bonne foi que pas un ne lui faisait tant de peine que d’avoir aidé au chevalier Colbert à arracher le crucifix dont nous avons parlé ; qu’il en demandait pardon à Dieu, et qu’il croyait que c’était pour cela qu’il le punissait. Mais il en arriva tout autrement, et ce fut au contraire la cause de son salut ; car Deffita, qui était homme à faire sa cour au préjudice de sa conscience, s’en fut trouver au même temps M. Colbert, et lui demanda ce qu’il voulait qu’il fit du prisonnier, après lui avoir insinué toutefois, auparavant, qu’il était dangereux qu’il ne parlât si on le faisait mourir. M. Colbert le remercia du soin qu’il avait de sa famille et, l’ayant prié de sauver ce misérable, il le rendit blanc comme neige, quoiqu’il méritât mille fois plutôt d’être roué.

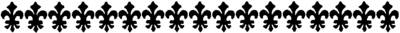
NOTE
Les nobles protagonistes de cet amour ultramontain ont été chansonnés « en famille » dans les couplets suivants :
Contre les bougres de France,
Pon patapon tarare pon pon,
Nous verrons au premier jour,
À la ville et à la Cour,
Publier cette défense,
Pon patapon tarare pon pon.
On suit de bien près la piste
De tous les anticonistes,
Pon patapon tarare pon pon,
Les Dames, dans leur chagrin,
Travaillent soir et matin
Pour en composer la liste,
Pon patapon tarare pon pon.
Gramont fait une partie
Pour aller en Italie,
Pon patapon tarare pon pon,
Ceux qui furent du repas
Y suivront bientôt ses pas,
Pon patapon tarare pon pon.
Dans ce repas agréable
L’amiral devint traitable,
Pon patapon tarare pon pon.
Des convives secondé,
Se leva bientôt de table,
Pon patapon tarare pon pon.
Après certain badinage,
L’amiral tourna visage,
Pon patapon tarare pon pon.
Celui qui fut son vainqueur
En reçut beaucoup d’honneur,
Chacun lui rendit hommage,
Pon patapon tarare pon pon.
Biran, dont la beauté brille,
Surtout lorsqu’il est en fille,
Pon patapon tarare pon pon,
Voudrait, pour tous ses appas,
Avoir été du repas :
Il eût conduit le quadrille,
Pon patapon tarare pon pon.
Louvois, qui prend son parti,
En aura le démenti,
Car il est sur le mémoire,
Pon patapon tarare pon pon.
Les Roncis ont mis leur père
Dans une extrême colère,
Pon patapon tarare pon pon,
On peut bien, dit-il, choisir
De l’un ou l’autre plaisir,
Pourvu qu’on sache se taire,
Pon patapon tarare pon pon.
Mailly, sans cette aventure,
Était en bonne figure,
Pon patapon tarare pon pon.
Il est au rang des proscrits,
Son frère a, dans ses écrits,
Un secret pour la brûlure,
Pon patapon tarare pon pon.
La Ferté, dans son jeune âge,
Était amoureux d’un page,
Pon patapon tarare pon pon.
Mais une nouvelle amour
Fait qu’on le souffre à la Cour.
Biran dit qu’il n’est pas sage,
Pon patapon tarare pon pon.
Mimur était sans reproche,
Mais enfin on le chevauche,
Pon patapon tarare pon pon.
Il est déchu par malheur
Du titre d’enfant d’honneur ;
Il est enfant de débauche,
Pon patapon tarare pon pon[22].



ÉPÎTRE DÉDICATOIRE

 l n’y a qu’un Héros du premier
ordre qui puisse réunir dans sa
personne des talents qui paraissent
incompatibles et dont un
seul suffirait pour faire un Guerrier accompli.
Vous avez, Monseigneur, acquis
tant de gloire au service des Ebugors et
des Cythéréennes, qu’il serait difficile de
décider dans quel genre de combat vous
réussissez davantage. Tout ce qu’on peut
dire, sans crainte de tomber dans l’erreur,
c’est que vous êtes Doctor in utroque. À
qui pouvais-je donc mieux dédier un
ouvrage destiné à publier les vertus de
deux belliqueuses Nations qu’à celui qui a
été l’ornement de l’une et de l’autre ? Daignez
donc, Monseigneur, agréer l’hommage
que rend aujourd’hui à votre double
mérite celui qui fut toujours l’admirateur
de vos exploits et qui a l’honneur d’être,
avec un très profond respect,
l n’y a qu’un Héros du premier
ordre qui puisse réunir dans sa
personne des talents qui paraissent
incompatibles et dont un
seul suffirait pour faire un Guerrier accompli.
Vous avez, Monseigneur, acquis
tant de gloire au service des Ebugors et
des Cythéréennes, qu’il serait difficile de
décider dans quel genre de combat vous
réussissez davantage. Tout ce qu’on peut
dire, sans crainte de tomber dans l’erreur,
c’est que vous êtes Doctor in utroque. À
qui pouvais-je donc mieux dédier un
ouvrage destiné à publier les vertus de
deux belliqueuses Nations qu’à celui qui a
été l’ornement de l’une et de l’autre ? Daignez
donc, Monseigneur, agréer l’hommage
que rend aujourd’hui à votre double
mérite celui qui fut toujours l’admirateur
de vos exploits et qui a l’honneur d’être,
avec un très profond respect,
Et très soumis Serviteur in utroque.

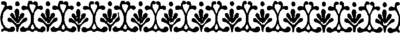
AVANT-PROPOS

 ’est aux villes assiégées que
nous sommes redevables des
plus beaux ouvrages que puisse
enfanter l’esprit humain ; Troie
a fourni la matière de l’Iliade, et les suites
de ce fameux siège ont donné naissance à
l’Enéide. Le Tasse a chanté la délivrance
de Jérusalem, et c’est au siège de Paris
que nous devons la Henriade. On aurait
aussi pu trouver le sujet d’un excellent
poème épique dans Cythère assiégée ; on
s’est contenté d’en faire un opéra-comique.
Un pareil ouvrage ne doit être regardé tout
au plus que comme une miniature : peut-être
nous donnera-t-on quelque jour un
plus noble tableau. En attendant qu’on
puisse employer les brillantes couleurs de
la poésie, j’aurai recours à la simplicité de
la prose ; il m’est plus facile de parler le
langage des hommes que celui des dieux.
Au lieu d’un poème, je vais donc composer
une histoire. Tous les faits que j’avancerai
sont incontestables ; je ne travaille point
sur des mémoires. Tout ce que je vais
raconter s’est passé sous mes yeux. J’ai eu
l’honneur de servir pendant cette guerre,
’est aux villes assiégées que
nous sommes redevables des
plus beaux ouvrages que puisse
enfanter l’esprit humain ; Troie
a fourni la matière de l’Iliade, et les suites
de ce fameux siège ont donné naissance à
l’Enéide. Le Tasse a chanté la délivrance
de Jérusalem, et c’est au siège de Paris
que nous devons la Henriade. On aurait
aussi pu trouver le sujet d’un excellent
poème épique dans Cythère assiégée ; on
s’est contenté d’en faire un opéra-comique.
Un pareil ouvrage ne doit être regardé tout
au plus que comme une miniature : peut-être
nous donnera-t-on quelque jour un
plus noble tableau. En attendant qu’on
puisse employer les brillantes couleurs de
la poésie, j’aurai recours à la simplicité de
la prose ; il m’est plus facile de parler le
langage des hommes que celui des dieux.
Au lieu d’un poème, je vais donc composer
une histoire. Tous les faits que j’avancerai
sont incontestables ; je ne travaille point
sur des mémoires. Tout ce que je vais
raconter s’est passé sous mes yeux. J’ai eu
l’honneur de servir pendant cette guerre,
Et militavi non sine gloria.
Je ne suis pas de ces écrivains qui ont passé leur vie dans l’obscurité d’un cabinet et qui viennent nous parler d’opérations militaires dont ils n’ont que des idées très imparfaites. Pour bien traiter une matière, il faut la connaître à fond. Or dans la profession des armes, je ne crois pas qu’on puisse me taxer d’ignorance. Aux lumières que je puis avoir là-dessus, je joins encore une qualité bien essentielle à un historien, c’est l’impartialité. Ainsi, si cet ouvrage ne plaît pas par la beauté du style, il sera du goût de ceux qui aiment mieux la Vérité toute nue que des Fables embellies.


ANECDOTES
POUR SERVIR À L’HISTOIRE SECRÈTE
DES EBUGORS

CHAPITRE I
DES CAUSES DE LA GUERRE
ENTRE LES CYTHÉRÉENNES ET LES EBUGORS

Depuis longtemps les Cythéréennes et
les Ebugors se regardaient d’un œil jaloux.
Les premières, accoutumées à donner des
lois à tout l’Univers, ne pouvaient voir
avec indifférence les rapides progrès que
leurs voisins faisaient tous les jours. Ceux-ci,
de leur côté, songeaient aux moyens
d’affaiblir une puissance sous laquelle ils
craignaient de succomber eux-mêmes. Plusieurs
d’entre eux désertaient chaque jour
et rendaient par là le parti ennemi plus
redoutable. Peu de Cythéréennes quittaient
leurs drapeaux pour se ranger sous les
étendards des Ebugors. L’avantage devenait
grand pour les Amazones de Cythère, dont
le nombre augmentait, et les Ebugors se
voyaient tous les jours harcelés par des
partis bleus qui leur enlevaient, à la vue
de leur camp, leurs capitaines même les
plus expérimentés. Ils ne Voulaient point
d’égaux : les Cythéréennes ne pouvaient
souffrir de maître. Ce n’était pas de quoi
vivre en paix d’un côté ni de l’autre.
Avec de telles dispositions, il n’était pas possible que la paix pût subsister entre les deux Nations. De part et d’autre on cherchait à se faire tout le mal possible ; les discours injurieux, les écrits satyriques, les railleries piquantes, rien de tout cela ne fut épargné. Les Ebugors perdirent enfin patience et résolurent d’en venir à une guerre ouverte. Comme ils ne se sentaient pas les plus forts, ils eurent recours à leurs alliés qui promirent de les secourir efficacement ; ensuite, pour justifier leur démarche, ils instruisirent, selon la coutume, le Public des raisons qui les engageaient à prendre les armes. Voici comment ils s’exprimaient dans un de leurs manifestes :


CHAPITRE II
MANIFESTE DES EBUGORS CONTRE
LES CYTHÉRÉENNES

« Personne n’ignore à quel haut degré de puissance sont parvenues les Cythéréennes ; cette ambitieuse Nation s’est toujours persuadée que les hommes sont faits pour être ses esclaves. Tous les jours on la voit s’agrandir par de nouvelles conquêtes ; il semble qu’elle aspire à la Monarchie universelle, mais c’est moins à son courage qu’à la faiblesse de ses adversaires qu’elle est redevable de ses succès, car les Cythéréennes n’ont qu’à se montrer pour remporter la victoire. Un seul de leurs regards suffit pour terrasser l’ennemi, qui, après sa défaite, se voit condamné à un honteux esclavage. La perte de sa liberté n’est pas le seul des maux qu’il ait à souffrir ; il faut encore essuyer les caprices de ces impérieux tyrans, exécuter sans délai leurs ordres les plus injustes, baiser même avec respect les fers sous le poids desquels ils vous accablent. Ce n’est qu’après avoir sacrifié la meilleure partie de leurs biens que les captifs peuvent rompre leurs chaînes, ou lorsque la délicatesse de leur complexion ou les infirmités de la vieillesse les mettent hors d’état de supporter les travaux auxquels ils sont condamnés. Malgré des traitements si durs, personne ne fait des efforts pour se soustraire à cette affreuse tyrannie. L’amour que nous portons à nos semblables nous oblige de prendre les armes en leur faveur. C’est à nous de secourir des malheureux qui n’ont pour toute nourriture que des soupirs et des larmes, que les soucis et les inquiétudes empêchent de goûter les douceurs du sommeil ; dont les corps faibles et abattus sont un indice certain des rigueurs qu’on exerce à leur égard ; il faudrait être insensé pour n’être pas touché à la vue d’un tel spectacle. Peut-on manquer d’approuver notre conduite quand on saura les louables motifs qui nous déterminent à déclarer la guerre ? Il est de notre intérêt comme de notre gloire de détruire une Nation qui ne cherche à assujettir les hommes que pour les rendre misérables. »
Les Cythéréennes, dont ce n’est pas la coutume de demeurer sans réplique, répandirent aussi de leur côté un manifeste détaillé dont voici le contenu :


CHAPITRE III
MANIFESTE DES CYTHÉRÉENNES
EN RÉPONSE À CELUI DES EBUGORS

« C’est avec la plus grande surprise que la Reine de Cythère a vu le manifeste imposant, mais peu vrai, des Ebugors, ses ennemis. Obligés de temps immémorial à payer des tributs que le monde entier se fait un plaisir d’acquitter, eux seuls prétendent refuser aux Cythéréennes l’hommage qu’ils leur doivent. Esclaves nés de notre puissance, nous nous sommes fait un plaisir d’adoucir de tout notre pouvoir ce que leur servitude avait de fâcheux. Combien de fois n’avons-nous pas prêté une main secourable à ceux d’entre eux que quelques-unes de nous pouvaient avoir fatigués trop cruellement par le poids d’un esclavage peu ménagé. Notre Reine, même notre aimable Reine, oubliant ce qu’elle devait à son rang et à sa dignité, s’est mille fois abaissée au-dessous de ses esclaves. Elle s’est mille fois soumise à leurs faiblesses, pour partager avec eux les peines de leurs redevances. Hélas ! tout est perdu devant les ingrats, les bienfaits dont on les comble ne font qu’ajouter à leur mauvaise volonté. Ils ont lancé contre nous des millions de reproches sur ce qui devait leur prouver combien nous avions d’attentions pour eux. Nos vastes bontés leur ont déplu. Nous élargissions notre être pour donner plus de champ à l’abîme des biens où nous les recevions et plus de matière à leur reconnaissance. Ils nous ont fait des crimes de ce qui ne méritait que des louanges. Tout ce qui a un air de grandeur les choque et leur déplaît. Voilà ce qu’ils nous objectent et sur quoi ils fondent leur révolte et le déni des tributs qui nous sont dus et dont nous devons compte à la Nature.
« Ces malheureux, que leur sacrilège fureur aveugle, renversent l’ordre établi de tous les temps : Ils consomment entre eux et à pure perte des fruits dont nous devions disposer et que nous savions faire valoir et pour leur utilité et pour la nôtre. Ils se dévorent l’un l’autre par une feinte amitié qui ne tend à rien moins qu’à la destruction entière du genre humain. Chaque nouvelle recrue dont ils augmentent leur nombre est un nouveau vol qu’ils font à la Société et un attentat contre les plus anciennes coutumes.
« Nous sommes les plus intéressées à nous opposer à de si dangereuses innovations. Malheureuses d’être contraintes de faire tomber de la main de ces criminels des armes que nous leur permettions quelquefois de tourner contre nous-mêmes et sans en prévenir les conséquences fatales. La trahison préside maintenant à leurs exploits : ils n’osent plus se présenter en face devant nous et attendent le moment de nous attaquer, comme des lâches qu’ils sont ; mais qu’ils ne se flattent pas que nous leur tournions jamais le dos. C’est par devant qu’ils doivent nous combattre pour triompher de notre valeur, et nous sommes prêtes à nous sacrifier et à répandre la dernière goutte de notre sang. Nous combattons pour les plaisirs du monde : quel motif plus important peut nous engager à soutenir une querelle plus importante ? »
Après cela, on ne tarda pas à en venir aux actes d’hostilité. Avant d’entrer dans le détail de tout ce qui se passa pendant ce siège mémorable, il est bon de faire connaître le pays et les mœurs des différentes nations qui composaient les deux armées.


CHAPITRE IV
SITUATION DE CYTHÈRE

On a souvent fait des descriptions de l’île de Cythère, mais les auteurs ne se sont pas toujours piqués d’exactitude : les plus aveuglés par la prévention, les autres se laissant emporter par le ressentiment. Les poètes, selon leur coutume, ont pris plaisir à embellir ces lieux aux dépens de la vérité. Le devoir d’un historien fidèle est de dire les choses telles qu’elles sont. Ceux qui connaissent la carte de ce pays verront si j’ai cherché à en imposer au public.
Cythère est placée sous la zone torride ; les chaleurs, par conséquent, doivent y être excessives. Aussi, le sang bouillonne dans les veines de quiconque met le pied pour la première fois dans ce brûlant climat. Ce n’est qu’après un long séjour que cette fermentation diminue insensiblement. Le ciel n’y est pas toujours pur et serein ; on y est exposé à de malignes influences ; pour s’en garantir, il faut avoir la précaution de porter certain habillement d’une peau très fine, appelé Docnon, avec lequel on n’a point à craindre le mauvais air. Au milieu de l’île, on voit la capitale, qui est au fond d’un vallon délicieux ; elle est de figure ovale. Plusieurs rangs d’arbres, plantés sur les remparts, forment les plus agréables points de vue qu’on puisse imaginer. À quelque distance s’élèvent deux grosses tours qu’il est nécessaire de prendre avant d’attaquer le corps de la place. Les faubourgs ont beaucoup d’étendue et les voyageurs s’y arrêtent quelquefois pour en considérer les beautés ; mais on n’y voit demeurer habituellement que des Alabandises : c’est le nom que l’on donne à une troupe de gens lâches et mous, qui n’ont pas la permission d’entrer dans la ville.

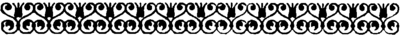
CHAPITRE V
CARACTÈRE DES HABITANTS DE CYTHÈRE
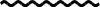
Rien de plus aimable que l’extérieur des Cythéréennes ; mais quand on vient à les approfondir, quelle différence ! Si l’on n’est pas sur ses gardes et qu’on se livre à elles sans réserve, on n’est pas longtemps sans avoir lieu de s’en repentir : elles sont fourbes, capricieuses, intéressées, inconstantes et perfides. À ces défauts se joignent aussi de grandes qualités. Qui peut égaler leur courage ? Une seule peut tenir tête à plusieurs ennemis, rarement les voit-on demander quartier. Elles ont toutes du goût pour la guerre, leurs inclinations belliqueuses se manifestent de fort bonne heure ; quand elles ne sont pas encore en âge de servir, on les voit elles-mêmes préluder aux combats qu’elles doivent livrer un jour. Lenula est la divinité qu’elles adorent et qui préside à leurs actions. Chaque mois, elles ensanglantent les autels à l’honneur de cette déesse. Il n’y a que dans leur enfance ou dans un âge avancé qu’elles sont exemptes de faire ces sortes de sacrifices.

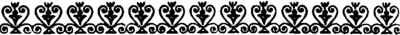
CHAPITRE VI
PORTRAIT DE LA COMMANDANTE
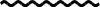
Dans presque tous les pays du monde on ne confie le commandement des armées ou le gouvernement des places importantes qu’à des personnes qui ont vieilli sous les armes ; à Cythère, les usages sont différents, les vieilles forment le grand Conseil de la Nation ; le sénat, composé de personnes respectables, décide souverainement de toutes les affaires d’État. C’est là qu’on examine s’il est à propos de déclarer la guerre, les moyens qu’on doit employer pour réussir, les pièges qu’il faut tendre à l’ennemi, les avantages qu’on doit retirer de la victoire. Quand toutes les matières ont été soigneusement discutées, les jeunes Cythéréennes sont chargées de l’exécution. Celle qui commandait à Cythère pendant le siège avait à peine atteint son cinquième lustre.
Aux âmes bien nées,
La valeur n’attend pas le nombre des années.
Plusieurs actions éclatantes l’avaient élevée à ce poste sublime ; elle avait porté le ravage dans le territoire des Friscaniens. Après avoir fait sur eux un butin immense, elle chercha à s’illustrer par de plus glorieuses conquêtes. Les Conobluders fournissaient un vaste champ à son ambition, elle les attaque et vient à bout de les soumettre. De si brillants succès ne devaient pas rester sans récompense ; aussi, quand il fut question d’élire une générale, tous les suffrages se réunirent en faveur de la belle Divutemia. Je ne m’amuserai pas à faire la description de son visage et de sa taille. Il vaut mieux faire connaître cette héroïne par des endroits plus intéressants.
Divutemia n’avait que les connaissances nécessaires à sa profession, mais elle les possédait dans un degré éminent. Si son esprit n’était pas fort étendu, son cœur était extrêmement vaste. Rien ne pouvait en remplir les désirs. Elle avait le coup d’œil admirable, voyait tout d’un coup l’endroit faible par où il fallait attaquer l’ennemi, tantôt fondait sur lui brusquement, et tantôt l’attendait de pied ferme. Maîtresse de tous ses mouvements, pendant la chaleur du combat elle paraissait animée de fureur et de rage, et cependant son âme jouissait d’une tranquillité parfaite. Infatigable, à peine avait-elle achevé une expédition qu’elle était prête à en entreprendre une autre ; intrépide, elle aurait affronté les plus grands périls pour satisfaire son avide cupidité. Telle était Divutemia.

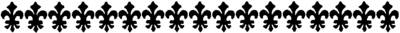
CHAPITRE VII
EN QUOI CONSISTAIT LA GARNISON DE
CYTHÈRE

Il y avait dans la place une forte garnison composée d’Emécondines, de Durpes, de Quetokes, de Carges et de Meauraquex.
Les Emécondines étaient les meilleures troupes de la place. Instruites de bonne heure dans le métier de la guerre, elles en connaissent les plus fines pratiques. Aussi tout l’Univers retentit du bruit de leurs exploits. Ce corps a une si grande réputation qu’il suffit d’y être enrôlé pour qu’on n’ose révoquer en doute votre courage, n’en eussiez-vous jamais donné aucune preuve. Dans le combat, les Emécondines n’en veulent qu’aux principaux officiers de l’armée ennemie ; comme elles sont plus avides de butin que de carnage, si quelqu’un tombe entre leurs mains, elles ne le renvoient qu’après l’avoir entièrement dépouillé. Quand elles ont vieilli dans le service, on les fait passer au ministère, et si pendant leur jeunesse elles ont fait voir beaucoup de valeur, elles ne montrent pas moins de prudence dans un âge avancé.
Les Durpes n’ont point cet air grenadier qui sied si bien à des guerrières. On dirait en les voyant qu’il n’y a rien à craindre de leur part, mais personne n’entend mieux toutes les ruses de l’art militaire. Quand l’ennemi paraît, elles font semblant de prendre la fuite, et par ce stratagème attirent dans les lieux commodes ceux qui les poursuivent. Il faut alors en venir aux coups, elles se défendent avec opiniâtreté et n’ont coutume de se rendre qu’après avoir fait acheter bien cher la victoire.
Rien n’est plus difficile à dompter que les Quetokes. Ce sont des troupes légères qui vous échappent dans le temps même que vous croyez les tenir. Elles se trouvent au milieu du feu le plus vif sans en craindre les effets. Leur cuirasse est impénétrable à tous les traits ; elles savent à merveille garantir leur cœur des coups qu’on voudrait lui porter. Le seul désir d’acquérir de la gloire leur met les armes à la main. Quand l’ennemi est vaincu, elles se contentent de l’emmener en triomphe et ne poussent pas ordinairement plus loin les avantages que leur donne la victoire.
La troupe la moins estimée était celle des Carges. C’était une milice qu’on avait levée dans les campagnes ou parmi les plus vils artisans de la ville. Leur occupation est de faire la patrouille pendant la nuit. On les met aussi en faction dans toutes les rues étroites, les carrefours, les places publiques ; si quelqu’un vient à passer, elles examinent s’il ne porte point d’armes à feu, et si elles trouvent un fusil ou un pistolet prêt à tirer, elles s’en saisissent et ne vous le rendent qu’après en avoir fait la décharge.
Il y avait outre cela quelques brigades de Meauraquex. Ce sont les gardes du corps de la générale. Ils vont ordinairement à la découverte de l’ennemi et tâchent de l’attirer dans les lieux où les Cythéréennes se tiennent en embuscade. Quand ils ont engagé le combat, ils se retirent tranquillement, jusqu’à ce que l’affaire soit décidée. Comme ils connaissent parfaitement les véritables intérêts de leur pays, ce sont eux qu’on députe chez les Nations voisines pour y ménager quelque accommodement. Tantôt ils font les fonctions de guerriers, tantôt celles d’ambassadeurs ; ils sont également propres à ces deux emplois.
La place était abondamment fournie de toute sorte de provisions et en état de faire une longue résistance. Aussi les Cythéréennes étaient bien résolues de combattre jusqu’à la dernière extrémité. L’envie de soutenir leur réputation et la haine qu’elles portaient à leurs ennemis les soutenaient dans ces généreux sentiments. Les Ebugors de leur côté ne visaient à rien moins qu’à la destruction totale de Cythère ; ils avaient une puissante armée à laquelle ils ne croyaient pas qu’on pût résister longtemps. La suite nous fera voir s’ils ne se trompaient pas dans leurs conjectures.
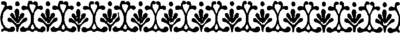
CHAPITRE VIII
MŒURS DES EBUGORS, CARACTÈRE
DE BLUCISER
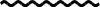
Les Ebugors ou Modosistes sont un peuple fort ancien ; ils formaient autrefois un corps de nation. Modose était la capitale de leurs États. Un Egan (c’est le nom que l’on donne à certains ambassadeurs) passant un jour par cette ville fut gracieusement accueilli par les principaux habitants. Quoiqu’on ne sût pas le caractère dont ce jeune seigneur était revêtu, comme il était d’une figure aimable, chacun vint lui offrir sa maison. Il accepta celle d’un bourgeois nommé Tol : les autres, jaloux de cette préférence, vinrent insulter le voyageur chez son hôte. L’Egan sort brusquement et part pour aller porter ses plaintes au Roi son maître ; celui-ci, pour venger son ambassadeur, fit tirer à boulets rouges sur la ville de Modose et la réduisit en cendres. Depuis ce temps, les Ebugors sont dispersés dans tous les lieux du monde. Les descendants de ce peuple malheureux, après avoir erré longtemps, arrivèrent à Séthane, où ils se soutinrent avec honneur pendant un espace de temps assez considérable. Ils firent dans ce pays plusieurs prosélytes, parmi lesquels on compte le fameux Ascrote. De nouveaux malheurs les obligèrent de passer en Elitia : en leur accorda dans ce pays de si grands privilèges, qu’ils oublièrent leurs anciennes disgrâces. On les vit même parvenir aux plus éminentes dignités.
Le nombre des Modosistes augmentant tous les jours, ils résolurent d’envoyer des Colonies dans quelques-uns des États voisins ; ils tâchèrent de s’établir dans le royaume des Valges : Thirosirem les reçut favorablement, mais après la mort de ce roi, ils ne furent pas fort considérés. Pour se procurer Un établissement favorable parmi les Valgois, ils travaillèrent à mettre dans leurs intérêts la plus haute Noblesse, et ils y réussirent.
Il faut, à présent, faire connaître les mœurs d’un peuple qui fait aujourd’hui tant de bruit dans le monde. Les Ebugors sont naturellement spirituels, ennemis des préjugés et d’un caractère fort liant ; leur commerce est dangereux. En votre présence, ils vous font mille protestations d’amitié, tandis que par derrière ils vous rendent de fort mauvais services. Ce sont des soldats hardis, la crainte du feu ne les a jamais arrêtés ; faut-il pénétrer dans une place, ils n’examinent pas si la brèche est praticable ; ils déchirent, ils mettent en pièces tout ce qui s’oppose à leur fureur ; les cris des blessés ne sont pas capables de les émouvoir. Mais après l’action ils deviennent beaucoup plus traitables. Quoi qu’on en dise, leur service n’est pas gracieux, et je suis persuadé qu’on entre plutôt dans ce corps par vanité que par goût.
Ils avaient à leur tête Kulisber. Ce général avait fait ses premières campagnes parmi les Caginiens. Après avoir passé successivement par tous les emplois subalternes, il parvint au premier grade militaire ; son mérite seul l’éleva à cette sublime dignité. C’était un homme zélé pour sa Nation et prêt à sacrifier tout pour elle ; actif, entreprenant, plein de feu, il n’aimait pas à combattre en rase campagne ; il se tirait beaucoup mieux d’affaire dans le défilé le plus étroit. Sa valeur, se trouvant alors resserrée, se raidissait contre les obstacles et franchissait avec impétuosité les plus fortes barrières.


CHAPITRE IX
LES OMINES
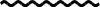
Les Omines parurent aussi sur les rangs pour attaquer Cythère ; mais on ne faisait qu’un très médiocre fond sur eux. Ils étaient presque tous partisans des Cythéréennes et se seraient très volontiers déclarés pour elles, si certaines raisons de politique ne les en avaient empêchés. Les Omines s’exercent de bonne heure dans la discipline militaire ; leur nourriture est frugale, leur habillement grossier ; ils couchent sur la dure et exécutent sur-le-champ les ordres d’un commandant impérieux. La plupart de leurs officiers font le métier de racoleur. Quand ils voient un jeune homme propre à devenir un bon soldat, ils l’accostent avec un air doux et affable ; ils le questionnent sur le parti qu’il a dessein de prendre ; ils parlent avec mépris de toutes les professions, même les plus honorables, afin d’avoir occasion d’exalter celle des Omines ; ils font sonner bien haut les avantages de leur état, et pour donner plus de poids à leurs raisons, ils font couler à grands flots les vins les plus délicieux. Comme ordinairement la jeunesse a beaucoup de penchant pour les Cythéréennes et que les Omines se lient par serment à leur déclarer la guerre, on fait entendre aux jeunes gens qui tombent dans leurs filets qu’il y a plus de liaison entre ces aimables héroïnes et eux qu’on ne se l’imagine, mais qu’il faut dans ce commerce user de ménagements et de précautions pour sauver l’honneur du corps. Cet article est, en effet, un de ceux qu’on leur accuse avec plus de sincérité. Personne n’ignore que dans quelques contrées que soient établis les Omines, ils y entretiennent les plus étroites correspondances avec les Cythéréennes, et que malgré les plus secrètes précautions qu’ils apportent à dérober aux yeux du public leurs intrigues avec elles, il arrive néanmoins fort souvent que leur jeu venant à se découvrir donne matière à la critique des médisants qui ne manquent pas d’habiller en ridicule un serment que les Omines font de la manière la plus solennelle, et qu’ils ne font pas scrupule de violer à chaque instant avec la plus grande facilité du monde. Quoi qu’il en soit, c’est avec de pareils artifices qu’ils font leurs recrues. Ceux qui se laissent séduire par leurs discours prennent parti sous leurs drapeaux et s’engagent avec eux : c’est pour toute leur vie. Ils ne sont pas longtemps à s’apercevoir qu’on les a trompés, le repentir suit de près l’engagement ; mais à quoi bon ? Ils sont obligés de prendre patience, dût-ce être en enrageant. Ils ne doivent plus songer à sortir de l’esclavage et recouvrer leur liberté, toutes les voies leur sont interdites et fermées pour toujours. Les peines les plus terribles sont le châtiment de la désertion.
Les Omines composaient la meilleure partie de l’armée des assiégeants. Chacun de leurs régiments était distingué par un uniforme bizarre.
Les Pacicnus avaient d’épaisses moustaches et portaient un casque qui représentait la figure d’un clocher : ils entendaient assez bien la petite guerre, et on se servait d’eux pour piller le paysan.
Les Lidercores étaient les plus beaux hommes de l’armée ; avant de combattre on leur ordonnait de crier de toutes leurs forces pour effrayer l’ennemi.
Les Macres portaient par devant et par derrière une petite cuirasse large de deux ou trois doigts, qui les préservait, disaient-ils, de tout accident, mais qui ne les pouvait pas sûrement garantir des traits que leur lancent les Cythéréennes.
Les Nicomidains marchaient ensuite, chargés de plusieurs longues chaînes dont chacune était composée de quinze gros anneaux et de cent cinquante petits. Cette troupe doit son institution à un certain Niquomide qui fut leur premier chef. Ils rendent une espèce de culte et d’hommage à une divinité fabuleuse appelée Remia, mortelle ennemie des Cythéréennes, et cela, disent-ils, parce que, par la faveur du Grand Génie Vedi, elle eut l’adresse de conserver dans son entier sa fleur virginale et d’être en même temps mère d’un fils qui, sous le nom de Sives, prit naissance contre toutes les règles de la Nature, c’est-à-dire sans connaître de père, ni légitime ni naturel. C’est de cette prétendue pucelle et mère tout à la fois qu’ils se vantent d’avoir reçu les chaînes qu’ils portent à leur ceinture. C’est en mémoire de ce don qu’ils sont obligés d’en compter tous les jours un certain nombre de fois tous les chaînons, l’un après l’autre, en marmottant entre leurs dents quelques paroles mystiques à l’honneur de Remia. Le principal avantage qu’ils tirent de ces chaînes est d’en lier étroitement ceux dont ils veulent vider la bourse.
Les Caginiens formaient un corps des plus considérables et des plus redoutés d’entre les Ebugors ; ils n’avaient point de casque en tête comme les autres, mais ils portaient de grands chapeaux à larges ailes rabattues, à l’ombre desquels ils envisageaient obliquement l’ennemi qu’ils avaient à combattre ; ils marchaient tous le col tors et la tête inclinée, figure symbolique de leur cœur faux et pétri, pour ainsi dire, de fourberies et de ruses. Jamais ils n’attaquaient leurs adversaires en face, mais ils ne faisaient pas bon leur tourner le dos, car alors ils poursuivaient les fuyards avec acharnement et ne leur faisaient point de quartier ; tout leur courage et leur habileté se réduisant à épier et saisir l’instant de prendre l’ennemi par derrière. Ces Omines, ainsi que les précédents, ont aussi une singulière vénération pour la déesse Remia, du moins en apparence.


CHAPITRE X
LES BRULARNES
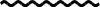
Dès qu’il fut question des troubles qui allaient allumer cette sanglante guerre entre les Cythéréennes et les Ebugors, chacun des deux partis tâcha de se ménager une alliance avec les Brularnes, espèce de peuple républicain, et de les engager à se déclarer pour ou contre. C’était une négociation très difficile et même impossible. Ces peuples, plutôt ennemis qu’amis des Ebugors, qu’ils voient avec horreur, n’ont pour les Cythéréennes qu’une indifférence invincible. Ce qui fait qu’ils n’ont aucun commerce avec ces deux nations. D’ailleurs, sans sortir de chez eux, ils peuvent fournir à tous leurs besoins. Telle est leur politique, que quelque grands que soient leurs revenus, ils ne sont pas d’humeur à les prodiguer au service d’autrui. S’ils font de la dépense, ce n’est que dans le particulier ; les effets n’en rejaillissent que sur eux seuls, et point du tout sur l’étranger. Avec de telles dispositions, il n’est point étonnant qu’ils refusassent de prendre part dans une querelle qui ne pouvait leur procurer aucun avantage. Les Cythéréennes eurent beau leur représenter les services qu’elles leur avaient généreusement rendus en plus d’une occasion, on leur répondit brutalement que ces services avaient été bien payés et qu’on ne se croyait, par conséquent, obligé à aucune reconnaissance. Les Ebugors faisaient entendre que, si les habitants de Cythère avaient le dessus, ils chercheraient immanquablement à se venger de l’indifférence que leur témoignaient les Brularnes. Ceux-ci déclarèrent hautement que tandis qu’ils auraient l’usage de leurs mains, ils n’avaient rien à craindre ; de sorte que, tout considéré, ils s’en tinrent à la neutralité et permirent seulement à ceux de leurs sujets, qui avaient envie de faire quelques campagnes, d’aller servir dans l’une ou l’autre armée en qualité de volontaires ; mais ils ne voulurent point qu’ils s’y engageassent entièrement, afin d’être toujours prêts à revenir à leur corps à la première sommation qui leur en serait faite.

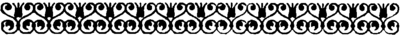
CHAPITRE XI
LES TODÈVES

Il se fait souvent des réformes dans les troupes de Cythère : quand les soldats de ce royaume ont servi pendant au certain temps, on les congédie et on leur laisse la liberté de prendre parti du côté que bon leur semble. Ils vont ordinairement s’enrôler dans le régiment des Todéves.
C’est une milice redoutable : elle est commandée par des Cerutedirs. Ce sont des officiers qui n’ont point cet air étourdi qu’on remarque communément dans les militaires ; leur maintien est grave et composé, leur uniforme simple et modeste, leurs discours insinuants et flatteurs ; ils ont le talent de se faire aimer de ceux à qui ils commandent ; aussi faut-il avouer qu’ils ont de grands égards pour leurs soldats. Ceux-ci, en considération, sacrifient la meilleure partie de leur paye pour l’entretien de leurs chefs. Heureux qui peut attraper une compagnie dans ce régiment ! Le dépit qu’ont les Todéves d’avoir essuyé une honteuse réforme leur inspire des sentiments de haine et de vengeance, qu’on ne peut exprimer.
Les transports qui les agitent sont d’autant plus à craindre qu’ils n’éclatent pas sur leurs visages. Si l’on en veut juger par l’extérieur, rien n’est plus doux, plus humble, plus humain ; mais que leur cœur est bien différent ! Ces troupes ont une façon de combattre qui leur est particulière ; elles se tiennent éloignées de l’ennemi et se cachent dans des lieux où on ne peut les apercevoir. C’est de là qu’elles lancent des flèches empoisonnées, dont la blessure est incurable ; leurs traits sont poussés avec tant de vigueur que d’un seul coup elles percent plusieurs personnes.

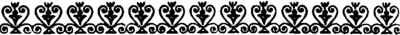
CHAPITRE XII
CYTHÈRE EST INVESTIE

Aussitôt que les troupes des assiégeants furent assemblées, on avança vers Cythère. D’abord on examina lequel des côtés de la place était le plus faible, afin de l’attaquer par là. Il se tint à ce sujet un grand conseil de guerre, où les sentiments furent partagés : la plupart des généraux voulaient qu’on commençât par s’emparer des deux grosses tours ; mais Teuscotoser, officier de réputation parmi les Omines, fut d’un avis contraire. Il soutint qu’il fallait aller tout de suite au corps de la place ; puis adressant la parole à Kulisber, il lui dit :
Le poste éminent que vous occupez est une preuve certaine de vos talents. Jamais on ne vous aurait vu à notre tête si l’on ne vous avait pas jugé digne de nous commander. Mais, pour réussir dans cette guerre, il ne suffit pas de joindre, comme vous faites, la prudence au courage, il faut encore connaître à fond le génie des peuples que nous allons combattre. Permettez-moi de le dire, seigneur, jusqu’ici vous n’avez eu affaire qu’à des Chadabers. Cette nation est bien différente des Cythéréennes ; ce n’est qu’à force de temps et de patience qu’on vient à bout de soumettre les premiers. Au contraire, il faut attaquer les autres brusquement et ne pas leur donner le loisir de se reconnaître. Si j’ai acquis quelque gloire dans les différents combats où je me suis trouvé, je puis dire que je n’ai dû mes succès qu’à la promptitude avec laquelle je me suis jeté sur l’ennemi aussitôt qu’il paraissait. Je fondais sur lui avec impétuosité ; de sorte que le voir, l’attaquer et le vaincre était la même chose pour moi. Bien des personnes se sont repenties d’avoir suivi une méthode tout opposée. Quand une Cythéréenne a le temps de se remettre du trouble où la jette la présence d’un guerrier redoutable, il est bien difficile alors d’en pouvoir triompher : elle se tient sur ses gardes, examine tous vos mouvements, prévoit toutes vos démarches, et se met en état de n’avoir rien à craindre de votre part. C’est pourquoi, si l’on veut m’en croire, nous tâcherons de prendre la ville d’assaut. J’avoue qu’il y a du danger ; mais les périls peuvent-ils intimider des cœurs tels que les nôtres ? Pour moi, je suis prêt à donner l’exemple et à montrer à toute l’armée ce que peut un Omine animé par le désir d’acquérir de la gloire.
En même temps, il prend ses armes, qui étaient en très bon état, les fait briller aux yeux de l’assemblée et demande qu’on le laisse marcher à l’ennemi.
Kulisber fut très mécontent de cette harangue. Il ne put souffrir qu’on doutât de ses lumières ; c’est pourquoi il se rangea du parti de ceux qui voulaient qu’on fît le siège dans toutes les formes. En conséquence, il déclara qu’il fallait commencer par attaquer les ouvrages extérieurs devant que d’aller au corps de la place.
Quand toutes les opérations eurent été réglées, la ville ne tarda pas d’être investie. Bientôt après, la tranchée fut ouverte. On commanda quelques compagnies de Panutiers pour s’emparer des deux grosses tours. Mais ils furent repoussés vivement et n’osèrent point retourner une seconde fois à la charge.
Pendant ce temps-là, on délibérait à Cythère, pour savoir si on ne lâcherait pas les écluses qui retenaient les eaux du fleuve Nerui. Si cette résolution eût été suivie, c’en était fait des assiégeants ; mais il fut décidé, à la pluralité des voix, qu’on n’aurait point recours à des moyens extraordinaires, que l’on ne devait jamais employer que dans le cas d’une nécessité trop urgente.

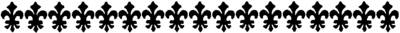
CHAPITRE XIII
SUPPLICE D’UN EBUGOR ESPION
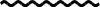
Les Ebugors, voulant reconnaître les forces de la place, résolurent d’envoyer un espion qui pût avec adresse leur en rapporter un fidèle compte. Leur choix pour cet effet tomba sur un jeune officier de bonne mine et qui paraissait très propre à s’acquitter de cette commission. Celui-ci se chargea volontiers d’un si périlleux emploi. Après qu’on lui eût donné les instructions nécessaires, il prit des habits de Cythéréenne, et à la faveur de ce déguisement il s’introduisit dans la ville. On le prit d’abord pour une étrangère qui venait tenter fortune : ses attraits lui procurèrent un accès facile dans toutes les maisons. On lui offrit de l’emploi, et pour l’engager à prendre parti, on lui fit entendre qu’avec les bonnes qualités qu’il paraissait avoir, il ne pouvait pas manquer de faire son chemin. Il répondit de son mieux à des discours aussi obligeants, et refusa tout ce qu’on pouvait lui proposer de plus avantageux. Personne ne pouvait pénétrer les motifs d’une conduite si extraordinaire ; on était accoutumé, à Cythère, à voir les gens exercer de très bonne heure leurs talents. L’espion profitait cependant de l’erreur où l’on était sur son compte pour examiner tout ce qui se passait ; il n’aurait peut-être même jamais été découvert sans une aventure qu’il eut avec un Meauraque. Ce dernier était un garçon d’une aimable figure, auquel l’Ebugor fit quelques agaceries ; on lui répondit sur le même ton. Le Meauraque est d’abord renversé, l’officier se jette sur lui, tire son poignard, est prêt à frapper ; l’autre, saisi de frayeur, jette les hauts cris. La garde vole et s’empare des deux combattants. L’espion est reconnu ; les Cythéréennes, indignées contre le traître qu’elles avaient reçu dans leur sein avec tant de complaisance et d’humanité, demandent vengeance avec une juste fureur que leur inspirait la honte d’avoir été presque les dupes de ce fourbe. Leur demande était juste : bientôt son procès est instruit ; il est condamné au supplice de la Veconofeutrie. C’est le châtiment que les Ebugors ont le plus en horreur. Le coupable écouta sa sentence sans la moindre marque d’altération ou de faiblesse ; mais bientôt sa fermeté l’abandonna, lorsqu’il vit paraître à ses yeux l’instrument fatal de son supplice. Il frémit à la vue du cloaque infect qui l’allait engloutir.
Ce cloaque, appelé Canelos en langue du pays, est une espèce de gouffre dont les bords sont hérissés de broussailles qui servent de repaire à un nombre prodigieux d’insectes tenaces, dont la piqûre est insupportable : on les nomme Piromons. Dès qu’un malheureux en approche, ces animaux s’en emparent, le tourmentent sans relâche et se remplissent de son sang, qu’ils sucent avec une avidité que rien ne ralentit. En vain entreprendrait-on de les détruire l’un après l’autre ; l’unique moyen de se soustraire à leur rage est d’employer une sorte de poison que l’on nomme Gont Sirguen. Les côtés intérieurs du gouffre sont souvent occupés par d’autres animaux encore plus dangereux appelés Heneracs. Ceux-ci, par leur morsure cruelle, communiquent leur poison et multiplient en quelque sorte leur être. Au fond est un lac d’une eau sale, puante, verdâtre et empoisonnée qui distille sans cesse le long des parois du canelos. C’est là-dedans qu’on précipite le criminel, et lorsqu’il est au fond il est obligé de faire jouer une pompe foulante et aspirante par le moyen de laquelle il se voit inondé de cette même eau bourbeuse au milieu de laquelle il expire. C’est de cette manière que se vit traiter l’espion infortuné des Ebugors.

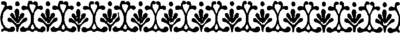
CHAPITRE XIV
TUMULTE QUI ARRIVE DANS LE CAMP DES
ALLIÉS
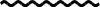
Tandis que les soldats exposaient leur vie, les généraux s’occupaient à quelque chose de plus amusant. On donna dans le camp des alliés un magnifique repas à l’occasion de la fête de Termobanel, général des Omines ; rien de tout ce qui peut contribuer à la bonne chère ne fut épargné. Les plus habiles cuisiniers d’entre les Macres firent connaître qu’ils portaient leur art jusqu’à la perfection. Pendant le festin on ne songea qu’à bien se réjouir. Les Nicomidains juraient, les Lidercores chantaient ; les Todéves médisaient, les Caginiens méditaient la destruction de quelque royaume et le meurtre de quelque monarque : chacun suivait son penchant. Tout allait le mieux du monde, quand la Discorde vint apporter le trouble dans les lieux consacrés aux plaisirs. On fut sur le point de voir se renouveler les combats des Centaures et des Lapites. Un Lidercore, pris de vin, attaqua une Todéve. Celle-ci, qu’on n’insultait pas impunément, répondit avec vivacité. Des paroles on en vient bientôt aux mains. Cependant, comme le lieu n’était pas propre à vider une querelle, on se donna un rendez-vous. Les deux champions se levaient déjà pour se transporter sur le champ de bataille. Un Cerutedir qui avait été témoin de la dispute, voulut en empêcher les suites ; il arrête l’impétueux Omine et lui dit d’un ton impérieux qu’il eût à modérer ses emportements.
Le Lidercore fit sentir par une action très expressive combien son discours lui déplaisait. Aussitôt tous les convives sont en rumeur. Chacun prend parti dans la dispute, les ustensiles de Comus furent changés en autant d’instruments du dieu Mars. Cela veut dire en bon français et sans aucun style figuré ni poétique, qu’on prit pour armes tout ce qui se trouva sur la table. On se saisit des plats et des assiettes, bientôt on les voit voltiger en l’air avec une active rapidité ; tout se mêle, tout se confond ; les coups sont portés au hasard, mais toujours assénés avec vigueur. Termobanel, le brave Termobanel fait des prodiges de valeur. Il empoigne une cruche pleine de vin et la brise sur la tête de l’auteur de tout ce désordre ; le blessé, plus sensible à la perte de la liqueur bachique qu’à l’effusion de son sang, prétend s’en venger sur un Pacicnu. Il lui arrache impitoyablement la moustache et la foule aux pieds. Le malheureux Omine épilé frémit de rage en se voyant dépouillé de son plus bel ornement.
Les Todéves, au défaut d’armes meurtrières, se servent de leurs dents et de leurs ongles, elles mordent, elles déchirent, elles égratignent, et laissent sur tous les visages de sanglantes traces de leur rage et de leur fureur.
Les choses auraient été poussées plus loin si un Caginien, par son éloquence, n’eut arrêté les effets de cette funeste division. Peu à peu il calma les esprits. On sépara les combattants, qui en furent quittes pour quelques contusions, égratignures et écorchures. De peur que la dispute ne vînt à se renouveler, Kulisber ordonne qu’on se retire. La plupart eurent bien de la peine à traîner leurs corps chancelants jusque dans leurs tentes. Il y en eut même plusieurs que le sommeil surprit avant qu’ils pussent arriver chez eux.


CHAPITRE XV
LES CYTHÉRÉENNES FONT UNE SORTIE
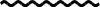
Cependant les Cythéréennes furent informées par leurs espions du désordre qui régnait dans l’armée des assiégeants ; elles résolurent de profiter de cette occasion pour faire une vigoureuse sortie sur l’ennemi. L’officier général qui était de tranchée ce jour-là se vit abattu sous les coups d’une Emécondine. On encloua plusieurs pièces de gros canon qui furent mises hors d’état de tirer, jusqu’à ce qu’elles eussent été refondues. Après cela, ces braves Amazones se répandirent dans le camp des ennemis. Les Carges surtout pénétrèrent dans les tentes des soldats sur qui elles firent main basse. Dieux ! de combien d’actions glorieuses l’envieuse Nuit ne nous déroba-t-elle point la connaissance ? Les Durpes surent bien profiter des ténèbres pour signaler leur courage.
Les assiégeants, qui ne s’attendaient pas à être réveillés de la sorte, ne s’oublièrent point en cette occasion. Ceux à qui les fumées du vin n’avaient pas troublé la cervelle se mirent en état de défense et se battirent en furieux. Teuscotoser fit des exploits dignes d’un éternel souvenir. Tous ceux qui se présentèrent à lui furent aussitôt étendus par terre et immolés à son vif ressentiment. À combien de malheureuses victimes Kulisber ne fit-il pas mordre la poussière ! Ceux qui expirèrent sous ses coups n’eurent pas la consolation de tourner vers le ciel leurs mourants et derniers regards.
Cependant le jour commençait à paraître. Il fallut songer à se retirer dans la ville. Les Cythéréennes y rentrèrent en bon ordre ; elles furent poursuivies par les Caginiens, qui mirent tout en pièces une brigade de Meauraquex qui faisaient l’arrière-garde. Ce ne fut que lorsque le soleil fit briller ses premiers rayons qu’on reconnut l’horrible ravage qui s’était fait dans le camp pendant la nuit. La plupart des soldats furent si maltraités dans cette affaire qu’il leur fallut plusieurs jours pour se remettre de leurs fatigues. Au bout de quelque temps, ils se trouvèrent en état de continuer leurs opérations, et ils poussèrent le siège avec plus de vigueur que jamais. Quoique leur feu fût très vif, il l’était cependant beaucoup moins que celui des Cythéréennes. Celles-ci faisaient double et triple décharge, tandis que leurs ennemis pouvaient à peine en faire une seule. Mais si les forces manquaient aux alliés, ils trouvaient des ressources infinies dans la grandeur de leur courage.


CHAPITRE XVI
UN OFFICIER DES EBUGORS
CASSÉ À LA TÊTE DE SON RÉGIMENT
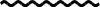
Kulisber fit un acte de sévérité bien capable de contenir les officiers dans le devoir. Il avait expressément défendu qu’on fît aucun quartier aux Cythéréennes ; malgré cette défense, un capitaine, voyant un des aides de camp de Divutemia au pouvoir d’un Omine, proposa à celui-ci de relâcher sa prisonnière et d’accepter un Chadaber en échange. La proposition fut acceptée. Le capitaine emmène dans sa tente la belle captive et tâche, par toutes sortes de bons traitements, de lui faire oublier la rigueur de son sort. Cette infraction des ordonnances du général parvint bientôt aux oreilles de Kulisber, qui en fut extrêmement irrité ; il fit assembler tous ceux qui servaient sous lui et, leur adressant la parole, il leur dit :
C’est avec une extrême douleur que je me vois aujourd’hui réduit à vous révéler la honte et l’infamie d’un de vos confrères. Un Ebugor, qui l’aurait jamais cru ? un Ebugor, au mépris de nos lois, a eu la faiblesse d’épargner une de nos plus mortelles ennemies. Que dis-je, d’épargner ? Il l’a comblée de bienfaits. Il soustrait à notre haine, il protège contre nous une personne qui ne devait attendre de lui que les traitements les plus cruels. Quel affront pour notre illustre corps ? Quel triomphe pour les Cythéréennes ! Elles vont désormais nous reprocher que nous sommes aussi faits pour porter leurs fers et que c’est à tort que nous nous vantons sans cesse de n’avoir point, à l’exemple des autres peuples, subi leur ignominieux joug. Je m’aperçois que ces reproches vous font frémir. La juste indignation qui se peint sur vos visages m’est un sûr garant de l’approbation que vous allez donner au châtiment qui va suivre la faute du coupable.
Ainsi parla Kulisber, et toute l’assemblée, par un silence respectueux, témoigna l’horreur que ce forfait inspirait à tous les assistants et fit connaître qu’ils approuvaient la sévérité du général. L’officier fut introduit dans le cercle où, d’abord, on lui arracha la livrée sacrée des Ebugors. Et on la foula aux pieds. À la suite de cette honteuse cérémonie, on le cassa de son office, il fut déclaré incapable de servir. Il fut fait défense très expresse à tous Chadabers non seulement de lui obéir en rien, mais encore d’entretenir aucune liaison avec lui, sous quelque prétexte que ce fût. Après cette dégradation, l’infortuné capitaine se retira à Cythère, où on lui fournit, du mieux que l’on put, les moyens de se consoler de sa triste aventure.
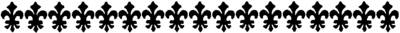
CHAPITRE XVII
BELLE ET GLORIEUSE RÉSOLUTION
D’UNE ÉMÉCONDINE

Malgré l’ardeur et le courage des alliés, le siège n’avançait cependant pas beaucoup. C’était en vain qu’on avait déjà fait plusieurs attaques pour tâcher de se rendre maître, soit par force, soit par adresse, des deux tours qui servaient de forts avancés pour couvrir Cythère. Elles étaient si bien défendues qu’on ne pouvait en approcher ; toutes les tentatives que l’on faisait à cet effet restaient vaines et sans succès, de sorte qu’il était à présumer que le blocus durerait encore longtemps. Cette opiniâtre résistance désespérait surtout les Omines, qui s’étaient imaginé que la place ne tiendrait que fort peu devant eux. Ils brûlaient d’envie de se voir possesseurs de la ville, afin de pouvoir s’y livrer à tous les excès dont est ordinairement capable un soldat effréné. Cette troupe fournissait les plus ardents travailleurs de toute l’armée ; quoique, dans l’ouverture de la campagne, on ne comptât pas beaucoup sur eux, ils détruisirent bientôt la prévention où l’on était contre leur corps par une activité invincible dans les travaux.
Cependant, le feu continuait de part et d’autre avec une égale violence et sans relâche. Chacun des deux partis ne respirait que meurtre et que carnage, lorsqu’une Emécondine, enflammée d’un bouillant désir de gloire, résolut d’aller défier en combat singulier les plus vaillants d’entre les Ebugors. Pleine d’un si hardi projet, elle n’en respire que l’exécution. Déjà, elle ne balance plus ; elle va trouver Divutemia : « Princesse, lui dit-elle en la regardant avec des yeux où se peignait la grandeur de son courage, Princesse, jusqu’à quand souffrirons-nous l’arrogance de nos ennemis ? Quoi ! les Ebugors pourront se vanter un jour de nous avoir forcées à nous enfermer dans nos retranchements ? Ils oseront se glorifier de nous avoir réduites à les craindre ! Suffit-il donc à notre gloire de défendre notre domaine contre leurs attentats ? Serions-nous donc trop faibles pour porter le fer et la flamme jusque dans leur camp ? Pourquoi craindrions-nous de les combattre à découvert ? Si mon zèle vous est connu, si, plus d’une fois, vous m’avez vu sacrifier avec joie et mon cœur et mon corps à la gloire et à l’accroissement de notre Empire, il me reste encore du sang dans les veines et ce même cœur est toujours animé du même désir. Permettez que je sorte et que j’appelle au combat leurs plus hardis champions. Il est beau de vaincre quand on a de tels adversaires et la défaite en est moins honteuse pour le vaincu. »
Ainsi parla cette généreuse amazone ; la commandante et toute l’assemblée applaudirent à un si noble dessein. Plusieurs, que tant de grandeur d’âme animait, eurent envie de courir à la même carrière et sollicitèrent fortement pour en obtenir la permission. Mais Divutemia leur représenta qu’il n’était pas à propos de dégarnir tout d’un coup la place de tout ce qu’elle avait de plus brave ; que ce serait une imprudence qui pourrait avoir de très mauvaises suites. Elle leur dit qu’elle leur permettrait une autre fois de signaler tour à tour leur valeur ; mais que pour le présent il était juste d’accorder l’honneur du pas à celle qui avait la première fait une si belle proposition. Ces illustres héroïnes, satisfaites des flatteuses promesses de leur souveraine, se retirèrent et coururent aux remparts, pour y être spectatrices de la gloire dont leur vaillante compagne allait à jamais se couronner.

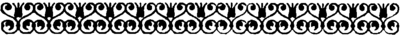
CHAPITRE XVIII
CARTEL. DÉFAITE D’UN BRULARNE. COMBAT
SINGULIER DE L’ÉMÉCONDINE CONTRE
UN LIDERCORE
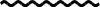
Bientôt notre généreuse Emécondine parut hors des lignes, suivie d’un Meauraque qui lui servait de héraut d’armes. Elle s’arrêta à quelque distance des sentinelles avancées du camp des ennemis. Le Meauraque, ayant fait signe qu’il avait à parlementer, un officier général se présenta. Aussitôt le héraut, tirant de son sein le cartel du défi, il le lut à haute voix. Il était conçu dans ces termes :
commandante à
CYTHÈRE
« Il est permis à la vaillante amazone qui s’offre à vos regards de venir appeler en combat singulier tel d’entre vous qui osera lui prêter le collet. C’est au plus redoutable des Ebugors qu’elle présente le défi. Les lois qu’elle prescrit sont de se battre à outrance et en champ libre. Que celui qui l’acceptera sorte avec armes égales ou non égales ; la brave Tuefosue est prête à le recevoir. »
Un grand murmure s’éleva dans le camp des alliés. Tant de présomption semblait les étonner. Cependant l’Emécondine attendait impatiemment qu’il se présentât quelque combattant contre qui elle put exercer la grandeur de son courage. Personne ne paraissait encore ; déjà même elle commençait à s’impatienter et le Meauraque allait publier une seconde fois son cartel, lorsqu’on vit tout à coup paraître un Brularne. Cet audacieux osa relever le gantelet et accepter le défi ; mais il ne fut pas longtemps sans porter la peine de sa témérité. À peine était-il entré en lice qu’il se vit presque aussitôt hors de combat. La faiblesse de ses armes et le mauvais état où elles se trouvaient lui en ôtèrent l’usage. Vainement il revint plusieurs fois à la charge, aucun de ses coups ne put porter et sa lame sans vigueur pliait même avant de toucher sa redoutable ennemie ; la Cythéréenne fit tout ce qu’elle put pour ranimer son courage et l’exciter à mieux faire ; mais, voyant que tous ses efforts restaient vains et qu’à peine il donnait le moindre signe de vie, elle se retira pleine du dépit le plus amer qu’elle exprima par ces paroles :
Lâche, ton cœur est en alarmes,
Devant moi tu baisses les armes.
Retire-toi ; c’est insulter
Notre gloire
Que de savoir mal disputer
La victoire.
Cette fatale aventure acheva de décrier les Brularnes dans l’un et l’autre parti. Les Cythéréennes surtout ne les regardèrent plus qu’avec le dernier mépris et comme des troupes molles et énervées, desquelles on ne devait rien espérer.
Cependant l’honneur des assiégeants se trouvait trop intéressé dans cette malheureuse catastrophe pour qu’ils ne cherchassent pas à le réparer avec le plus d’avantage qu’ils pourraient. Dans cette vue, on jeta les yeux sur un des plus vaillants Lidercores qu’il y eut parmi les alliés. Le valeureux Omine parut bientôt devant son ennemie, avec cet air fier et assuré, preuves non suspectes de la grandeur de son courage et de l’immensité de ses forces. Il portait une lance d’une trempe excellente, peu longue à la vérité, mais prodigieusement grosse et forte. Ses membres nerveux et couverts d’un poil épais et noir témoignaient assez qu’il était fait pour manier de telles armes. À peine parut-il dans l’arène que les choses prirent bien une autre face. Au premier choc, l’Emécondine fut renversée ; mais la fière amazone, sans s’étonner du coup, aussi adroite que brave, s’étant saisie de la lance de son adversaire, l’entraîna dans sa chute avec elle ; c’est alors qu’il faisait beau voir ces deux superbes combattants se charger l’un l’autre avec fureur. La terre tremblait sous leurs coups et l’écho en faisait retentir tous les lieux d’alentour. Aucun des deux ne songeait à parer, mais l’un et l’autre étaient uniquement attentifs à porter à son ennemi les plus vives atteintes. Étroitement serrées et liées pour ainsi dire, comme par des chaînes, toutes les parties de leur corps s’entrechoquaient. Leurs yeux semblaient lancer la foudre et les éclairs ; leurs visages enflammés exprimaient leurs passions ; ils écumaient de rage et de colère ; rien en un mot, ne put ralentir leur animosité. Enfin leurs forces, épuisées par la lassitude et la durée du combat, les abandonnèrent. Tous deux ils succombèrent ; on les sépara, mais par leurs regards menaçants, ils semblaient se vouloir dire l’un à l’autre qu’ils n’avaient besoin que d’un peu de repos pour renouer la partie et commencer un nouveau combat.

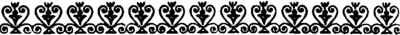
CHAPITRE XIX
RECETTE POUR FAIRE REVENIR LE COURAGE

Rien n’est plus contagieux que le mauvais exemple ; on en fit une triste expérience dans le camp des alliés. Les Brularnes, qui y servaient en qualité de volontaires, corrompirent les plus vigoureux soldats, qui tombèrent bientôt dans une mollesse fort préjudiciable aux intérêts des assiégeants. Dès que l’on connut le mal, on travailla à y apporter remède. D’abord on tâcha de les ranimer par le récit des plus belles actions guerrières. Les vives descriptions de combats, les détails curieux, les particularités intéressantes, rien de tout cela ne fut omis. Si les discours ne faisaient pas une assez vive impression, on exposait à leurs yeux les portraits de ces fameux héros et de ces héroïnes célèbres, dont la peinture a pour jamais immortalisé les vertus. Les différentes attitudes de ces illustres personnages, la vivacité de leurs regards, les transports dont ils paraissaient animés, tout cela produisait ordinairement des effets merveilleux sur l’âme des spectateurs. S’il s’en trouvait quelqu’un qui y fût insensible, on avait recours à un moyen fort extraordinaire : on dépouillait le lâche, on s’armait de verges, et des bras puissants faisaient tomber une grêle de coups sur les parties les plus charnues de son corps. Cette opération met tout le sang en mouvement, ranime les esprits et rappelle le courage dans les cœurs. Presque toujours par cette épreuve,
Redit in præcordia virtus.
Ceux qui avaient passé par cette cérémonie sans donner aucun signe de conversion étaient regardés comme des malades incurables, et à cet effet on les reléguait aux invalides de Modose.
Cette dernière recette, dont les Ebugors se servent comme d’un remède efficace, est employée comme punition chez les Todéves. Lorsqu’elles ont commis quelques fautes, les Cerutedirs prennent les fouets vengeurs et déchirent la peau des coupables. Ces cruels exécuteurs goûtent encore une satisfaction infinie à considérer les vestiges de leur cruauté, et cette vue excite toujours en eux des mouvements qui tournent à l’avantage des Todéves qu’ils ont ainsi châtiées. Tant est vrai le proverbe qui dit que mal est souvent propre à un grand bien.


CHAPITRE XX
LE FEU PREND À L’ARSENAL DE CYTHÈRE
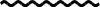
Les Ebugors, ennuyés de la longueur du siège, qui malgré leurs travaux continuels n’avançait presque point, assemblèrent un grand conseil dans lequel on résolut qu’on tâcherait de découvrir de quel côté était l’arsenal de Cythère, et que dès qu’on en serait informé, on dresserait une batterie à bombes et à boulets rouges, afin d’y mettre le feu si l’on pouvait. Tous les assistants goûtèrent fort ce projet, et personne ne douta que, si l’on pouvait venir à l’exécution, ce serait un des plus courts moyens d’affaiblir extrêmement la garnison de Cythère.
La Fortune sembla favoriser cette entreprise. Un Caginien, que l’on avait envoyé faire la découverte, ayant rapporté fidèlement la situation des lieux, la batterie fut bientôt prête et commença à jouer avec tant de violence que bientôt le quartier de la ville où étaient les magasins fut tout en feu. L’arsenal surtout devint la proie des flammes, qui se répandirent de côté et d’autre, avec une fureur qu’il semblait que rien ne dût arrêter. L’Eau de Vadanel[23] et les Madopes[24], dont cet endroit était plein, donnaient encore de nouvelles forces à l’incendie. Les Cythéréennes, alarmées, firent tous leurs efforts pour en arrêter les progrès. Le fleuve Nerui leur fut d’un grand secours dans cette occasion, et le hasard voulut que les pompes de la ville se trouvèrent heureusement en bon état. On les fit jouer avec succès, et par ce moyen on préserva de la voracité des flammes le corps de cet important édifice ; mais tous les soins que l’on apporta n’empêchèrent pourtant pas que la perte que les Cythéréennes souffrirent ne fût très considérable.
Le Draf, le Vogre, les Choumes[25] furent entièrement consumés. Les jeunes Cythéréennes ne furent que médiocrement sensibles à ce dommage ; mais les vieilles furent inconsolables. « Comment, disaient ces dernières, oserons-nous paraître devant l’ennemi ? Ce n’est point assez d’avoir du courage, si l’on n’a pas d’ailleurs de quoi se faire redouter. Nous voilà dépouillées de ce qui faisait notre principale force ; nous n’avons désormais d’autre parti à prendre que celui de rester chez nous et nous ensevelir toutes vives dans nos maisons, pour ne pas nous exposer au plus sanglant des affronts. Il n’y aura plus maintenant de différence entre les Todéves et nous. Nous serons confondues avec cette perfide nation. Dieux ! cette idée seule fait frémir. Mais, hélas ! que servent nos plaintes et nos gémissements ? Ce sont nos pertes qu’il faut songer à réparer ; si l’on veut que nous ne restions pas inutiles à la garnison, qu’on nous fournisse au plus tôt les moyens de continuer notre service. »
On eut égard à de si justes plaintes, on donna à ces vieilles désolées toutes les choses dont elles avaient le plus besoin pour les expéditions militaires. Les jeunes, qui pouvaient absolument se passer de tout cet attirail, s’en défirent bien généreusement en faveur de celles pour qui ces choses étaient d’une nécessité indispensable.

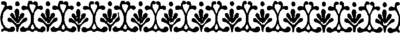
CHAPITRE XXI
STRATAGÈME DONT SE SERVENT
LES CYTHÉRÉENNES POUR AFFAIBLIR
L’ARMÉE DES ASSIÉGEANTS
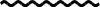
Les Cythéréennes, craignant à la fin de succomber sous les efforts de leurs ennemis, travaillèrent à détacher les Caginiens de l’alliance qu’ils avaient contractée avec les Ebugors. Pour cela, elles firent jouer une machine qui pensa leur réussir. Ce fut de Calederia[26] qu’on se servit pour cette importante affaire. Ripergader, commandant des Caginiens, avait des liaisons intimes avec les principales de la garnison ; par leur canal, il n’ignorait rien de tout ce qui se passait. Tous les secrets de Cythère lui étaient révélés, jusque-là qu’il était même instruit des moindres détails. C’est ainsi qu’il réglait toutes ses opérations sur les connaissances qu’il acquérait.
Calederia fit en sorte de s’introduire dans les bonnes grâces de Ripergader. Elle en vint à bout. Bientôt elle ne songea plus qu’à faire tourner à l’avantage de sa nation l’amitié que lui portait cet officier général. Après avoir réfléchi sur les moyens les plus propres à faire réussir son entreprise, elle s’avisa d’un stratagème fort singulier. Elle se frotta les pieds et les mains du sang qu’elle venait de répandre à l’honneur de la déesse Lenula. Dans cet état, elle va trouver son Caginien.
« Les dieux protecteurs de Cythère, lui dit-elle du ton d’une sibylle inspirée, vous ordonnent par ma voix d’abandonner le parti des Ebugors. Depuis longtemps vous nous faites une guerre injuste : cette conduite vous déshonore dans l’esprit de tous ceux qui n’ont pas des inclinations perverses. Calmez des bruits qui vous sont injurieux, et faites voir au monde entier que, si quelquefois un Caginien peut donner dans le travers, il peut aussi bien qu’un autre enfiler le droit chemin, lorsqu’il vient à le connaître. Au reste, si vous ne voulez pas vous rendre à mes discours, du moins ne soyez point rebelle aux dieux dont je suis l’interprète. Voyez, ajouta-t-elle en se découvrant, les marques sanglantes que je porte sur mon corps ; c’est la divinité même qui les a imprimées sur moi, pour que vous ne puissiez révoquer en doute les grands mystères que je viens de vous révéler. »
Ripergader est saisi de crainte et d’étonnement à la vue de ce spectacle ; il tombe aux genoux de Calederia et baise avec respect ces empreintes sacrées. Il jure un dévouement éternel aux Cythéréennes et donne sur-le-champ à leur ambassadrice des preuves convaincantes du zèle dont il se sent embrasé pour la nation ; cependant, il prend des mesures pour qu’on ne s’aperçoive pas qu’il a changé de parti ; mais, il eut beau faire, toutes ses précautions ne purent empêcher que l’affaire ne transpirât. Les Caginiens firent tous leurs efforts pour l’assoupir, mais inutilement. On tint un grand conseil de guerre, où tout d’une voix le coupable fut déclaré digne d’un châtiment exemplaire. Cependant, le crédit de ses confrères le tira de ce mauvais pas. On lui ordonna les arrêts pour quelque temps ; et ce fut toute la punition que l’on fit subir à cet homme qui, après s’être engagé solennellement avec les Ebugors, fut sur le point de les abandonner et de ruiner par là le parti d’un peuple avec lequel les Caginiens avaient toujours été très étroitement unis.

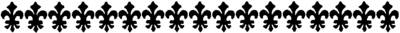
CHAPITRE XXII
LE GÉNÉRAL KULISBER FAIT UNE FAUSSE
ATTAQUE

La tranchée était ouverte du côté que le fleuve Nerui faisait couler ses eaux, et c’était par là qu’on battait la place. Kulisber crut qu’en l’attaquant par l’endroit opposé on en viendrait plus facilement à bout. Ce fut en vain que son conseil lui représenta qu’il aurait à essuyer certains vents orageux qui retarderaient beaucoup ses opérations. Il persista dans son sentiment et se mit en marche avec l’élite de ses Ebugors. À voir la joie qui brillait sur leurs visages, on eût dit qu’ils volaient à la victoire. Quatre Chadabers, en qualité d’aides de camp, marchaient aux côtés du général ; après cela venaient quelques officiers des Caginiens qui avaient voulu le suivre à cette expédition.
Le fier Kulisber portait un casque orné d’une magnifique aigrette ; il tenait une lance énorme dont la vue seule inspirait de l’horreur ; le cheval qu’il montait rongeait fièrement son frein et semblait ne respirer que les combats. Mais ce qui méritait le plus d’attention, c’était son bouclier. Le travail en était merveilleux. On y voyait Jupiter qui, sous la forme d’un aigle, enlevait le jeune Ganymède. Apollon y paraissait inconsolable de la mort de son cher Hyacinthe. Le beau Narcisse cherchait inutilement à contenter sur lui-même la passion dont il était l’objet. Le tendre Nisus venait offrir sa vie aux Rutules pour sauver celle de son cher Euryale. Alexandre déposait l’orgueil du diadème aux pieds d’Ephestion, et le fougueux Alcibiade écoutait avec docilité les leçons du vertueux Socrate. Mais le graveur s’était voulu surpasser en représentant l’apothéose du célèbre Fouruchuda[27], qui reçut de son vivant des honneurs qu’on n’accordait aux empereurs romains qu’après leur mort.
Kulisber contemplait avec plaisir les images de ces héros. Il paraissait animé du désir de marcher sur leurs traces. Plein de ces nobles sentiments, il avance vers l’endroit qu’il voulait attaquer. Tous s’empressent à le suivre ; déjà il se croit sûr de la victoire et se flatte que tout va céder à ses puissants efforts. Mais il éprouva une résistance à laquelle il ne s’attendait pas. On fit sur lui et sur sa troupe une si furieuse décharge de mousqueterie que tous ses soldats épouvantés prirent la fuite et se retirèrent en désordre. Kulisber, furieux, s’écria dans l’excès de sa rage :
Eh quoi ! lâches, vous fuyez tous !
Des femmes triomphent de vous.
Que devient cette audace altière ?
Soldats, ranimez votre ardeur guerrière.
Mais non, je puis sans vous
Mettre tout Cythère
Sens dessus dessous.
Toute réflexion faite, se voyant ainsi abandonné des siens, il ne jugea pas à propos de s’exposer tout seul au péril qui le menaçait. Il revint joindre les alliés pour délibérer avec les autres généraux sur les mesures qu’il fallait prendre pour se rendre maîtres de la place.


CHAPITRE XXIII
ARTIFICE DES EBUGORS POUR S’EMPARER
PROMPTEMENT DE LA VILLE ASSIÉGÉE

Tous les efforts des assiégeants n’avaient encore pu réussir et le siège n’était guère plus avancé que les premiers jours. Les alliés comprirent à la fin que ce n’était point par la force qu’ils pouvaient réussir dans leur projet ; ils employèrent un autre moyen dont ils se promirent les plus heureux succès.
Dolus, an Virtus, quid in hoste requirat ?
Ils empoisonnèrent les sources qui fournissaient de l’eau aux Cythéréennes. Alors la contagion se répandit dans la ville. La Lorève, ce fléau plus terrible que la famine et la guerre, fit bientôt des ravages affreux. En peu de temps la meilleure partie de la garnison fut hors de combat. Les hôpitaux étaient remplis de malades. On ne reconnaissait plus ces braves guerrières, tant elles étaient changées. Leurs visages, auparavant frais et vermeils, étaient devenus pâles et livides. Leurs corps maigres et décharnés n’offraient à la vue qu’un squelette hideux. Dans les horribles convulsions qui les agitaient, l’écume leur sortait par la bouche. Des insomnies cruelles les empêchaient de trouver le moindre relâche à leurs souffrances. Les mets les plus flatteurs leur étaient interdits ; à la place de ces liqueurs qui portent la joie jusqu’au fond de l’âme, on ne leur présentait qu’une boisson fade et insipide ; dans ce triste état elles n’avaient d’autre consolation que de maudire à chaque instant les cruels auteurs de leurs maux. Il s’en trouva cependant qui, quoique atteintes du poison mortel, osèrent encore attaquer l’ennemi et le firent repentir plus d’une fois d’avoir combattu contre elles.
Cependant le mal pressait de plus en plus ; les Cythéréennes furent consulter le grand prêtre pour savoir comment elles pourraient trouver quelques remèdes à leurs cuisantes douleurs ; il leur répondit, d’un ton grave, qu’il fallait avoir recours au Dieu Recumer, et qu’il fallait mériter la protection de cette Divinité bienfaisante par les veilles, les abstinences et surtout par de riches offrandes qu’on devait apporter au ministre, qui servirait de médiateur.
Mais les assiégeants, qui étaient parfaitement instruits de tout ce qui se passait dans la ville, profitèrent de cette circonstance pour livrer un assaut général. On disposa toutes choses pour cette expédition. Nous verrons dans le chapitre suivant par quel heureux hasard les Cythéréennes échappèrent au malheur qui les menaçait.

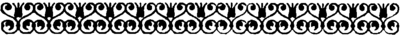
CHAPITRE XXIV
LES EBUGORS LÈVENT LE SIÈGE ET FONT
TRAITÉ AVEC LES CYTHÉRÉENNES

Cythère se trouvait serrée de fort près, comme on vient de le voir ci-dessus, il n’y avait guère d’apparence qu’elle pût résister davantage. Déjà même on songeait à se rendre, lorsqu’on aperçut de loin une puissante armée d’Ominesses qui venait au secours des Cythéréennes. Ces braves amazones jouèrent autrefois un grand rôle dans le monde sous le commandement de Phosa. Après la mort de cette illustre générale, leur Empire était tombé en décadence ; mais il commence à reprendre un nouvel éclat. Les Ominesses n’ont pour toute arme qu’un Chémidoge ; c’est une espèce d’épée fort courte dont elles se servent très avantageusement. Rien ne peut égaler l’aversion qu’elles ont pour tous les hommes. Leur gouvernement est à peu près semblable à celui des Ebugors. Elles ont beaucoup de penchant pour les Cythéréennes, quoique les lois et les coutumes de ces deux nations soient bien différentes. C’est à cette inclination que les assiégées furent redevables de leur salut. Sans ce secours qui vint si à propos, c’en était fait de Cythère. Il serait difficile d’exprimer quelle fut la consternation des assiégeants quand ils virent qu’on venait leur arracher leur proie. On assembla derechef le conseil, dont le résultat fut qu’il fallait porter des propositions de paix et conclure un traité dans lequel on ménagerait, autant qu’il serait possible, l’honneur des alliés. Plusieurs d’entre les Cythéréennes ne voulaient entendre parler d’aucun accommodement et étaient d’avis qu’on devait profiter des circonstances présentes pour écraser entièrement l’ennemi. Mais les plus modérées jugèrent qu’il suffisait à leur honneur de faire une paix glorieuse qui les mit pour toujours à couvert des insultes de leurs adversaires. Voici quels furent les articles de ce fameux traité :


ARTICLES
DU TRAITÉ DE PAIX
Entre les Ebugors et les Cythéréennes.

Aussitôt après la signature du présent traité, les Ebugors et leurs alliés se retireront de devant la place et s’en retourneront dans leurs États respectifs.
Les Ebugors n’étendront pas davantage leur domination à cause des inconvénients qui en résulteraient pour le bien commun. Ils pourront vivre selon leurs lois et leurs usages, mais ils ne décrieront pas comme ils ont fait jusqu’ici le gouvernement des Cythéréennes. Au contraire, les deux peuples travailleront de concert à entretenir la paix et auront l’un pour l’autre les égards qu’ils se doivent réciproquement.
Les Cythéréennes auront, comme avant la guerre, la liberté du commerce ; mais elles auront soin de ne fournir que des marchandises de bon aloi ; pour cet effet, il sera établi des bureaux dont les commis seront chargés de visiter exactement tout ce qui sera exposé en vente ; on transportera les marchandises gâtées dans les magasins d’où elles ne sortiront qu’après avoir été mises en état d’être vendues ; il y en aura à tout prix pour la commodité de ceux qui voudront faire emplette.
Les Cythéréennes traiteront désormais leurs prisonniers avec plus de douceur et n’exigeront point une rançon exorbitante ; elle sera réglée sur la qualité des captifs. Cet article ne regarde pas les Friscaniens, sur qui on pourra prendre tout ce qu’ils prennent aux autres.
Les Emécondines ne pourront trafiquer qu’avec les grands seigneurs, auxquels elles auront le privilège de vendre comme belles marchandises ce qui n’a qu’un éclat éblouissant.
On permet aux Todéves de venir faire des recrues à Cythère, mais il leur est défendu d’enrôler personne qui ait moins de quarante ans.
Il est ordonné aux Omines de ne plus se mêler désormais de toutes les affaires qui pourraient survenir dans la suite entre les puissances contractantes. Il leur est enjoint d’aller s’établir parmi les Brularnes et de faire ensemble un seul corps de nation. Comme les Cythéréennes ne veulent point commercer ouvertement avec les Omines, ceux-ci ne viendront qu’en secret à Cythère, et l’on s’engage à leur rendre dans le particulier toute sorte de bons offices.
Les Caginiens pourront, comme à l’ordinaire, faire ligue offensive et défensive avec les Ebugors.
Il y aura toujours une sentinelle à la porte des magasins de Cythère pour empêcher les disputes qui pourraient survenir entre les vendeurs et les acheteurs.
Il y avait encore quelques articles secrets dont on ne juge pas à propos de donner connaissance au public.
Telle fut la fin de ce siège fameux, pendant lequel on fit voir de part et d’autre tout ce que peuvent la valeur et l’adresse réunies. Lorsque la guerre s’alluma entre les Cythéréennes et les Ebugors, il y avait lieu de croire qu’elle ne se terminerait que par la perte d’une des deux nations. Heureusement, les suites n’ont pas été si funestes.
Fasse le Ciel que cette paix soit durable ! Ce sont là les vœux que je fais tous les jours dans ma solitude. Pendant ma jeunesse, je ne respirais que les combats ; aujourd’hui que je me vois avancé en âge, couvert de glorieuses cicatrices et comblé d’honneurs militaires, je n’aspire plus qu’après le repos et la tranquillité.
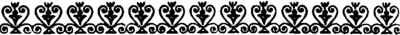
CLEF
pour servir à l’intelligence de ces
Mémoires.

| Livrée sacrée des Ebugors | ... | C’est un ruban couleur de rose, ou autre, qu’ils attachent ordinairement par derrière à la ceinture de la culotte en guise de fontange. |

APPENDICE

PROCÈS DE CATHERINE CADIÈRE
CONTRE LE PÈRE GIRARD
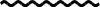
 E Père Jean-Baptiste Girard, jésuite
et prédicateur français,
fut nommé, vers 1728, recteur
du séminaire royal de la marine
à Toulon. Là, une de ses pénitentes,
Catherine Cadière, âgée de dix-huit ans,
d’une famille honnête et d’une grande
beauté, s’attacha à lui avec une exaltation
mystique fomentée par la lecture imprudente
des livres ascétiques : elle se prétendait
l’objet de toutes sortes de miracles.
Le Père Girard l’encouragea tout d’abord
dans cette voie dangereuse ; mais bientôt,
s’étant rendu compte de la supercherie, il
se retira. La demoiselle Cadière, piquée de
cet abandon, en fit confidence au prieur du
couvent des Carmélites, janséniste fervent
et grand ennemi des jésuites. Ce religieux
lui fit répéter ses accusations devant témoins.
Les jésuites réussirent alors à faire
enfermer la Cadière aux Ursulines. Cet
abus d’autorité leur fut très préjudiciable.
L’affaire fut portée devant le parlement
d’Aix, où Catherine Cadière accusa le Père
Girard de séduction, d’inceste spirituel, de
magie et de sorcellerie. Après de longs et
tumultueux débats, le Père Girard fut mis
hors de cour et de procès à la majorité
d’une voix : sur vingt-cinq juges, douze
l’avaient condamné à être brûlé vif. Le
peuple avait d’ailleurs ouvertement pris
parti contre lui ; il dut quitter secrètement
Toulon. Il se rendit à Lyon et de là à
Dôle, où il mourut deux ans après, le
4 juillet 1733.
E Père Jean-Baptiste Girard, jésuite
et prédicateur français,
fut nommé, vers 1728, recteur
du séminaire royal de la marine
à Toulon. Là, une de ses pénitentes,
Catherine Cadière, âgée de dix-huit ans,
d’une famille honnête et d’une grande
beauté, s’attacha à lui avec une exaltation
mystique fomentée par la lecture imprudente
des livres ascétiques : elle se prétendait
l’objet de toutes sortes de miracles.
Le Père Girard l’encouragea tout d’abord
dans cette voie dangereuse ; mais bientôt,
s’étant rendu compte de la supercherie, il
se retira. La demoiselle Cadière, piquée de
cet abandon, en fit confidence au prieur du
couvent des Carmélites, janséniste fervent
et grand ennemi des jésuites. Ce religieux
lui fit répéter ses accusations devant témoins.
Les jésuites réussirent alors à faire
enfermer la Cadière aux Ursulines. Cet
abus d’autorité leur fut très préjudiciable.
L’affaire fut portée devant le parlement
d’Aix, où Catherine Cadière accusa le Père
Girard de séduction, d’inceste spirituel, de
magie et de sorcellerie. Après de longs et
tumultueux débats, le Père Girard fut mis
hors de cour et de procès à la majorité
d’une voix : sur vingt-cinq juges, douze
l’avaient condamné à être brûlé vif. Le
peuple avait d’ailleurs ouvertement pris
parti contre lui ; il dut quitter secrètement
Toulon. Il se rendit à Lyon et de là à
Dôle, où il mourut deux ans après, le
4 juillet 1733.
Nous retrouvons dans le journal de l’avocat Barbier quelques échos du fameux procès :
« Les jésuites sont malencontreux ; en même temps que les affaires de la religion et les persécutions dont tant de prêtres sont l’objet leur ont attiré, on peut le dire, la haine de la plus grande partie de Paris, il est arrivé une diable d’histoire au recteur de la maison des jésuites de Toulon, homme de cinquante ans, appelé le P. Girard. Il est accusé d’avoir suborné une pénitente de dix-huit ans, nommée mademoiselle Cadière, de l’avoir ensorcelée, de l’avoir rendue mère et de l’avoir fait avorter. Cela fait un procès épouvantable au parlement d’Aix, et nombre de mémoires imprimés, de part et d’autre, se distribuent publiquement à la porte des promenades et des spectacles. Ils s’impriment à Paris, quoique faits à Aix, et on ne peut pas y suffire. »
« L’affaire du P. Girard et de la demoiselle Cadière, au parlement d’Aix, est ce qui occupe aujourd’hui toute la France et même l’Europe, car on en envoie les mémoires partout. Voici les conclusions du parquet, du 11 septembre : le P. Girard hors de cour et de procès ; la demoiselle Cadière condamnée à être pendue et auparavant appliquée à la question, etc. M. de Gaufridy, premier avocat général, était d’avis de faire pendre et brûler le P. Girard, et mettre tous les autres hors de cour ; mais, au parlement d’Aix, on compte les voix au parquet pour formuler les conclusions, et c’est l’autre avis qui a prévalu. On a été ici fort surpris de l’étrange différence des opinions de ces messieurs. »
« Enfin, cette fameuse affaire a été jugée le 10 de ce mois, et le jugement est des plus singuliers. On décharge le P. Girard des accusations formées contre lui et des crimes à lui imputés. On renvoie la demoiselle Cadière chez sa mère, pour en avoir soin, et on la met hors de cour et de procès, ainsi que tous les siens. Il n’y a pas le moindre dommages et intérêts prononcé par ce jugement. Onze juges ont condamné le P. Girard à être pendu et brûlé, et onze l’ont déchargé purement et simplement. En sorte que dans cette affaire, qui a fait tant de bruit, il y a beaucoup de crimes et point de criminels. La bonne ville de Paris est fort irritée de cet arrêt, qu’on regarde comme très injuste. On voulait absolument que le P. Girard fût brûlé. Cependant il ne devait pas l’être, car par l’anagramme de son nom il lui était prédit qu’on le ferait sortir de prison pour éviter le feu.
Jean-Baptiste Girard :
Abi, pater : ignis ardet[28].
Cette affaire fut le prétexte d’un roman obscène attribué au marquis d’Argens, Thérèse philosophe, dans lequel les deux adversaires sont présentés sous les anagrammes de Dirrag et d’Eradice. Thérèse y présente les faits de la façon suivante :
« Toute l’Europe a su l’aventure du Père Dirrag et de Mlle Eradice ; tout le monde en a raisonné ; mais peu de personnes ont connu réellement le fond de cette histoire, qui était devenue une affaire de parti entre les M… et les J… Je ne répéterai point ici ce qui en a été dit ; toutes les procédures vous sont connues, vous avez vu les factums, les écrits qui ont paru de part et d’autre et vous savez quelle en a été la suite. Voici le peu que j’en sais par moi-même, au delà du fait dont je viens de vous rendre compte.
« Mademoiselle Eradice est à peu près de mon âge. Elle est née à Volnot, fille d’un marchand auprès duquel ma mère se logea, lorsqu’elle alla s’établir dans cette ville. Sa taille est bien prise ; sa peau d’une beauté singulière, blanche à ravir ; ses cheveux noirs comme geai ; de très beaux yeux ; un air de Vierge. Nous avons été amies dans l’enfance ; mais lorsque je fus mise au couvent, je la perdis de vue. Sa passion dominante était de se distinguer de ses compagnes, de faire parler d’elle. Cette passion, jointe à un grand fond de tendresse, lui fit choisir le parti de la dévotion, comme le plus propre à son projet. Elle aima Dieu comme on aime son amant. Dans le temps que je la retrouvai, pénitente du Père Dirrag, elle ne parlait que de méditation, de contemplation, d’oraisons. C’était alors le style de la gent mystique de la ville et même de la province. Ses manières modestes lui avaient acquis depuis longtemps la réputation d’une haute vertu. Eradice avait de l’esprit ; mais elle ne l’appliquait qu’à parvenir à satisfaire l’envie démesurée qu’elle avait de faire des miracles ; tout ce qui flattait cette passion devenait pour elle une vérité incontestable. Tels sont les faibles humains : la passion dont chacun d’eux est affecté absorbe toujours toutes les autres ; ils n’agissent qu’en conséquence de cette passion ; elle leur empêche d’apercevoir les notions les plus claires qui devraient servir à la détruire.
« Le Père Dirrag était né à Lode. Lors de son aventure, il avait environ cinquante-trois ans ; son visage était tel que celui que nos peintres donnent aux satyres. Quoiqu’excessivement laid, dans la physionomie. La paillardise, l’impudicité étaient peintes dans ses yeux ; dans ses actions, il ne paraissait occupé que du salut des âmes et de la gloire de Dieu. Il avait beaucoup de talent pour la chaire ; ses exhortations, ses discours étaient pleins de douceur, d’onction. Il avait l’art de persuader. Né avec beaucoup d’esprit, il l’employait tout entier à acquérir la réputation de convertisseur ; et, en effet, un nombre considérable de femmes et de filles du monde ont embrassé le parti de la pénitence sous sa direction.
« On voit que la ressemblance-des caractères et des vues de ce Père et de Mlle Eradice suffisait pour les unir. Aussi, dès que le premier parut à Volnot, où sa réputation était déjà parvenue avant lui, Eradice se jeta, pour ainsi dire, dans ses bras. À peine se connurent-ils qu’ils se regardèrent mutuellement comme des sujets propres à augmenter leurs gloires réciproques. Eradice était certainement d’abord dans la bonne foi ; mais Dirrag savait à quoi s’en tenir ; l’aimable figure de sa nouvelle pénitente l’avait séduit ; et il entrevit qu’il séduirait à son tour et tromperait facilement un cœur flexible, tendre, rempli de préjugés, un esprit qui recevrait avec la docilité et la persuasion la plus entière, le ridicule des insinuations et des exhortations mystiques. De là, il forma son plan tel que je l’ai peint plus haut. Les premières branches de ce plan lui assuraient bien de l’amusement voluptueux de la fustigation, et il y avait quelque temps que le bon Père en usait avec quelques autres de ses pénitentes : c’était jusqu’alors à quoi s’étaient bornés ses plaisirs libidineux avec elles ; mais la fermeté, le contour, la blancheur des fesses d’Eradice avaient tellement échauffé son imagination qu’il résolut de franchir le pas. Les grands hommes percent à travers les plus grands obstacles : celui-ci imagina donc l’introduction d’un morceau du cordon de saint François, relique qui, par son intromission, devait chasser tout ce qui resterait d’impur et de charnel dans sa pénitente et la conduire à l’extase. Ce fut alors qu’il imagina les stigmates imités de ceux de saint François. Il fit venir secrètement à Volnot une de ses anciennes pénitentes qui avait toute sa confiance et qui remplissait ci-devant, avec connaissance de cause, les fonctions qu’il destinait intérieurement à Eradice. Il trouvait celle-ci trop jeune et trop enthousiasmée de l’envie de faire des miracles pour aventurer de la rendre dépositaire de son secret.
« La vieille pénitente arriva et fit bientôt connaissance de dévotion avec Eradice, à qui elle tâcha d’en insinuer une particulière pour saint François, son patron. On composa une eau qui devait opérer des plaies imitées des stigmates, et le jeudi saint, sous le prétexte de la Cène, la vieille pénitente lava les pieds d’Eradice et y appliqua de cette eau, qui fit son effet.
« Eradice confia deux jours après à la vieille qu’elle avait une blessure sur chaque pied. « Quel bonheur ! Quelle gloire pour vous ! s’écria celle-ci. Saint François vous a communiqué ses stigmates : Dieu veut faire de vous la plus grande sainte. Voyons si, comme votre grand Patron, votre côté ne sera pas aussi stigmatisé. » Elle porta ensuite ta main sous le téton gauche d’Eradice, où elle appliqua pareillement de son eau : le lendemain, nouveau stigmate.
« Eradice ne manqua pas de parler de ce miracle à son directeur, qui, craignant l’éclat, lui recommanda l’humilité et le secret. Ce fut inutilement ; la passion dominante de celle-ci étant de paraître sainte, sa joie perça : elle fit des confidences ; les stigmates firent du bruit, et toutes les pénitentes du Père voulurent être stigmatisées.
« Dirrag sentit qu’il était nécessaire de soutenir sa réputation, mais en même temps de tâcher de faire une diversion qui empêchât les yeux du public de rester fixés sur la seule Eradice. Quelques autres pénitentes furent donc aussi stigmatisées par les mêmes moyens : tout réussit.
« Eradice cependant se voua à saint François ; son directeur l’assura qu’il avait lui-même la plus grande confiance en son intercession : il ajouta qu’il avait opéré nombre de miracles par le moyen d’un grand morceau de cordon de ce saint, qu’un Père de la Société lui avait rapporté de Rome, et qu’il avait chassé, par la vertu de cette relique, le diable du corps de plusieurs démoniaques, en l’introduisant dans leurs bouches ou dans quelque autre conduit de la nature, suivant l’exigence du cas. Il lui montra enfin ce prétendu cordon, qui n’était autre chose qu’un assez gros morceau de corde de huit pouces de longueur, enduit d’un mastic qui le rendait dur et uni. Il était recouvert proprement d’un étui de velours cramoisi, qui lui servait de fourreau ; en un mot, c’était un de ces meubles de religieuses que l’on nomme Godemichis. Sans doute que Dirrag tenait ce présent de quelque vieille abbesse, de qui il l’avait exigé. Quoi qu’il en soit, Eradice eut bien de la peine d’obtenir la permission de baiser humblement cette relique, que le Père assurait ne pouvoir être touchée sans crime par des mains profanes.
« Ce fut ainsi, mon cher comte, que le Père Dirrag conduisit par degrés sa nouvelle pénitente à souffrir pendant plusieurs mois ses impudiques embrassements, lorsqu’elle ne croyait jouir que d’un bonheur purement spirituel et céleste.
« C’est d’elle que j’ai su toutes ces circonstances, quelque temps après le jugement de son procès. Elle me confia que ce fut un certain moine (qui a joué un grand rôle dans cette affaire) qui lui dessilla les yeux. Il était jeune, beau, bien fait, passionnément amoureux d’elle, ami de son frère et de sa mère, chez qui ils mangeaient souvent ensemble. Il s’attira sa confiance ; il démasqua l’impudique Dirrag ; et je compris sensiblement, à travers de tout ce qu’elle me dit, qu’elle se livra alors de bonne foi aux embrassements du luxurieux moine ; j’entrevis même que celui-ci n’avait pas démenti la réputation de son ordre, et par une heureuse conformation, comme par des leçons redoublées, il dédommagea amplement sa nouvelle prosélyte du sacrifice qu’elle lui fit des supercheries hebdomadaires du vieux druide.
« Dès qu’Eradice eut reconnu l’illusion du feint cordon de Dirrag, par l’application amiable du membre naturel du moine, l’élégance de cette démonstration lui fit sentir qu’elle avait été grossièrement dupée. Sa vanité se trouva blessée, et la vengeance la porta à tous les excès que vous avez connus, de concert avec le fier moine, qui, outre l’esprit de parti qui l’animait, était encore jaloux des faveurs que Dirrag avait surprises à son amante. Ses charmes étaient un bien qu’il croyait créé pour lui seul ; c’était un vol manifeste qu’il prétendait lui avoir été fait, dont il se flattait d’obtenir une punition exemplaire ; la grillade seule de son rival, qu’il méditait, pouvait assouvir son ressentiment et sa vengeance[29]. »

- ↑ Le Lévitique, xx, 13.
- ↑ Voir Un point curieux des mœurs privées de la Grèce, par O. D***. Athènes, 1871.
- ↑ F.-K. Forberg, De figuris Véneris, chap. II.
- ↑ Aloysiae Sygeae Satyra sotadica, dial. VI. (Voir l’Œuvre libertine de Nicolas Chorier. Bibliothèque des Curieux, 1910.)
- ↑ Voir l’Œuvre de Giorgio Baffo ; — l’Œuvre du divin Arétin, 2 volumes (Bibliothèque des Curieux, 1909 et 1910).
- ↑ Henri Etienne, Apologie pour Hérodote, t. I, p. 115.
- ↑ Description de l’Isle des Hermaphrodites nouvellement
découverte. Cologne, 1724. - ↑ Brantôme, Discours I, 158 pp. et suiv.
- ↑ Les premières œuvres poétiques du capitaine Lasphrise. Paris, 1587 : Stances de la délice d’amour, p. 271. — Voir Mignons et courtisanes au XVIe siècle, par Jean Hervez (Biblioth. des Curieux, 1908).
- ↑ Tallemant des Réaux, Historiettes. Edon 1854-1860, II, 345, 405 ; IV, 46 ; V, 399 ; VI, 11, 173. — Correspondance de Madame, duchesse d’Orléans, 13 décembre 1701.
- ↑ Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, publiée par Depping, Paris, 1851, passim.
- ↑ Chansonnier Maurepas, VI, 437 ; VIII, 229 ; XXVIII, 107, 285. — Chansonnier Clairambault, III, 257 (Bibl. Nat. Mss franç.)
- ↑ Correspondance de Madame, duchesse d’Orléans, 22 septembre 1717.
- ↑ Voir les Chroniques du XVIIIe siècle, par Jean Hervez. La Régence galante, La Galanterie parisienne sous Louis XV (Bibliothèque des Curieux 1909-1910).
- ↑ Voir Fernand Drujon, Les livres à clef, Paris, 1888, col. 51 ; — Analectes du Bibliophile (dirr M. Jules Gay). Bruxelles, 2e livraison. Été 1876, P. 15 ; — Comte d’I***. Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour.
- ↑ Au livre premier de l’Histoire amoureuse des
Gaules, Bussy-Rabutin trace de Manicamp un long
portrait, au cours duquel il dit que le comte de Guiche
et lui s’aimaient fortement, « comme s’ils eussent été
de différents sexes ».
Le duc de Grammont, fils du maréchal et frère du comte de Guiche. Il épousa, le 15 mai 1668, Marie-Charlotte de Castelnau, fille du maréchal de ce nom.
Gabriel de Cassagnet, dit le chevalier de Tilladet, chevalier de Malte en 1646, fut lieutenant général des armées du roi et gouverneur d’Aire. Il mourut en 1702.
- ↑ Gabrielle de Longueval, sœur du marquis de Manicamp, était la troisième femme du maréchal d’Estrées ; elle avait épousé en 1663 le vieux duc, qui mourut en 1670. Elle-même mourut dix-sept ans plus tard, en 1687.
- ↑ Le comte de Guiche, frère du duc de Grammont, « avait une beauté du premier choix parmi celles qui ne sont pas viriles ». Il fut surtout l’ami préféré du duc d’Anjou et de Manicamp. On l’avait marié à Mlle de Béthune, petite-fille de Séguier, âgée de 13 ans ; mais il ne consentit jamais à feindre de l’aimer et l’abandonna. Il mourut en 1673. La Comtesse d’Olonne, comédie attribuée à Bussy-Rabutin, confirme l’accusation de sodomie portée contre le comte de Guiche.
- ↑ Camille d’Hostun, duc de Haston, marquis de La Beaune, comte de Tallard, né en 1652. Il est question de lui dans l’Histoire de la maréchale de La Ferté, une autre partie de l’Histoire amoureuse des Gaules.
- ↑ Gaston-Jean-Baptiste-Antoine de Roqueraule, fils de Gaston, duc de Roqueraule, et de Mlle du Lude, porta le nom de marquis de Biran jusqu’à la mort de son père, en mars 1683. Il fut nommé maréchal de France le 2 février 1724.
- ↑ C’était le troisième fils de Jean-Baptiste Colbert et de Marie Charron. Il faisait partie, avec Biran, d’une bande de jeunes débauchés, terreur des filles de joie. Dans La France galante ou Histoires amoureuses de la Cour, Bussy Rabutin conte un autre exploit de ces débauchés : « Ils firent en ce temps-là une débauche qui alla un peu trop loin et qui fit beaucoup de bruit et à la Cour et dans la ville ; car, après avoir passé toute la journée chez des courtisanes où ils avaient fait mille désordres, ils furent souper aux Cuillers, dans la rue aux Ours. Ils se prirent là de vin, et, étant soûls, pour ainsi dire, comme des cochons, ils firent monter un oublieur, à qui ils coupèrent les parties viriles et les lui mirent dans son corbillon. Ce pauvre malheureux, se voyant entre les mains de ces satellites, alarma non seulement toute la maison, mais encore toute la rue par ses cris et ses lamentations ; mais, quoiqu’il survînt beaucoup de monde qui les voulait détourner d’un coup si inhumain, ils n’en voulurent rien démordre et l’opération étant faite, ils renvoyèrent le malheureux oublieur, qui s’en alla mourir chez son maître. »
- ↑ Chansonnier Maurepas, XXV, 251.
- ↑ L’Eau de Vadanel est une liqueur dont on se sert après le combat pour bassiner l’endroit où les coups ont porté. (N. de l’A.)
- ↑ Madopes. Il y en a de différentes espèces : celle surtout dont il est ici question est une sorte d’onguent que l’on emploie pour guérir les blessures. Il a la propriété de rapprocher si bien les lèvres de la plaie qu’il faut être fin connaisseur pour s’apercevoir quand quelqu’un en a fait usage. On l’appelle communément Madope de la Providence, parce que celui qui a le premier découvert ce secret demeure à Spira, à l’enseigne de la Providence ; autrement, on la nomme Madope Purocrilesnoscréte. (N. de l’A.)
- ↑ Le Draf, le Vogre, les Choumes, parure guerrière dont se servent les Cythéréennes pour se rendre plus formidables à l’ennemi. (N. de l’A.)
- ↑ Anagramme de Mlle la Cadière, la pénitente et l’accusatrice du Père Girard. Voir en appendice les notes relatives à ce procès.
- ↑ Fouruchuda, célèbre habitant de Spira, qui par zèle pour la défense d’une très nombreuse armée d’Ebugore, ayant été pris dans le combat, fut condamné et ensuite jeté au feu par l’ordre et le jugement
des principaux partisans des Cythéréennes.(N. de l’A.)
Les Mémoires du duc de Richelieu content que Louis XIV faillit être gâté de bonne heure par de mauvaises fréquentations : de la Trémoille, d’Epernon, dont les mœurs étaient très décriées. Ces intimités étant suspectes au cardinal de Fleury, celui-ci fit poursuivre avec la dernière rigueur les impudents sodomites. Un peintre fameux se donna la mort pour éviter le supplice que la police lui avait destiné et qui, selon nos anciennes coutumes, en est la peine légale. Du Chauffour le subit, et la police, qui le jugea par commission, fit proclamer le crime et la peine comme un grand événement. (Mémoires du maréchal duc de Richelieu, Paris, 1792, t. V, p. 50.)
- ↑ Journal de J.-F. Barbier, août, septembre, octobre 1731.
- ↑ Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’Argens, Thérèse philosophe ou Mémoires pour servir à l’histoire du P. Dirrag et de Mlle Eradice. La Haye, 1748 (Bibl. Nat. Enfer, 402), pp. 56-68.
