Cent Proverbes/Texte entier
rue Saint-Benoit, 7
rue Saint-Benoît, 7



LES PROVERBES VENGÉS

igurez-vous, Mesdames, un château des environs de Paris ; devant ce château, une vaste pelouse unie comme le velours et ornée de toutes les fleurs, bordures et plantes rares que votre imagination et vos serres-chaudes vous fourniront. Les oiseaux chantent à demi-voix, les feuilles des arbres frémissent à peine ; on respire l’odeur des violettes, des jonquilles, des calycanthus, des jasmins, des tubéreuses, des jacinthes, des roses et de beaucoup d’autres fleurs que je citerais, si je ne craignais de faire pousser les fleurs d’automne en même temps que celles du printemps.
Là-bas, autour de ce tulipier, vous apercevez sur des bancs de gazon une assemblée de vingt à trente personnes : plusieurs femmes sont jeunes et jolies, plusieurs hommes sont empressés et galants. Les femmes ont toutes de ces toilettes de campagne, soi-disant négligées, qu’inspirent la nature et les journaux de modes ; les hommes sont nonchalamment couchés sur l’herbe à leurs pieds.
Cependant, malgré la beauté de la journée, malgré les agréments du lieu, toute cette intéressante réunion s’ennuie, Mesdames, oh ! mais s’ennuie à tel point que la conversation vient de s’éteindre brusquement, et sans que personne songe à la ranimer. Et notez bien que cet ennui-là dure depuis plusieurs jours, et qu’on n’est encore qu’au commencement d’avril, et qu’il est deux heures de l’après-midi, et que la cloche du dîner, cette cloche douce et vénérée, ne sonnera guère que dans quatre heures.
Alors, un homme déjà sur le retour, poudré à frimas, habit vert-pomme, bottes à revers, figure ouverte et réjouie, se lève et tousse… On l’appelle « chevalier ». (Le chevalier ne se trouve plus qu’à la campagne.)
Après avoir considéré tout le monde attentivement et s’être frotté le front d’un air de satisfaction :
— Si nous jouions des proverbes ? s’écrie-t-il.
— Des proverbes ! y pensez-vous, chevalier ? dirent toutes les dames à la fois ; mais il y a un siècle qu’on ne joue plus de proverbes. – Sommes-nous donc à Saint-Malo ou à Carpentras ? Autant vaudrait nous affubler du chignon, des paniers et des falbalas. – Ah ! ah ! jouer des proverbes ! voilà qui est plaisant, ajouta avec un rire forcé un grand jeune homme à moustaches blondes. Je me souviens, Mesdames, d’avoir figuré une seule fois en ma vie dans un proverbe ; c’était au collège, le mot était asinus asinum fricat… J’étais un si bon écolier que tout le monde disait que je devais me charger des deux rôles.
On s’égaya ainsi pendant quelques instants aux dépens du pauvre chevalier, qui, sans ajouter un seul mot, alla reprendre sa place sur la pelouse en cachant un sourire malicieux sous un air d’indifférence. Cependant, pour chasser l’ennui, on eut recours à divers expédients.
Le jeune homme à moustaches blondes tira de sa poche un volume de poésies intitulé Crises nerveuses, et se mit à déclamer les passages les plus saisissants. Au bout de deux pages, plusieurs dames prirent leurs flacons ; par précaution sanitaire, la lecture fut interrompue.
Une autre personne déploya un journal, et proposa de lire la suite d’un roman en trois cent soixante-cinq feuilletons, qui avait commencé le premier janvier et devait finir à la Saint-Sylvestre. L’auteur n’en était encore qu’aux gelées blanches ; on résolut de l’attendre aux chaleurs.
On essaya aussi de la musique : on entonna des chœurs, des nocturnes, des mélodies sur la mort, les tombeaux, le suicide, les fluxions de poitrine, etc. Alors quelqu’un demanda le De profundis ; on applaudit, et les voix se turent.
Enfin, quand on eut épuisé toutes les distractions et tous les passe-temps possibles, il arriva… Mais comment vous dire, Mesdames, ce qui arriva ? Comment vous peindre toutes ces jolies têtes s’inclinant à demi sur ces blanches épaules ; ces paupières se fermant à la fois comme des belles de nuit ; les hommes bâillant de leur côté et cédant à ce sommeil frais et doux que le far niente répand dans l’après-dîner sur le front des heureux habitants de Naples ? Au bout de quelques instants, vous n’eussiez plus vu dans toute la réunion un seul œil ouvert ; toutes les poitrines murmuraient à l’unisson ; c’était le palais de la Belle au bois dormant.
Mais à peine l’assemblée fut-elle assoupie que la pelouse s’agita, les arbres tremblèrent, et l’on entendit dans toute l’étendue du parc un bruit pareil à celui qui se fit dans le jardin du duc, au moment où le brave don Quichotte de la Manche et son fidèle Sancho se disposèrent à monter sur le dos de Chevillard.
Des timbales, des fifres, des clairons, des instruments guerriers, mêlés au son du tonnerre et à des décharges d’artillerie, firent d’abord un vacarme effroyable ; puis une nuit épaisse couvrit la pelouse, et, après quelques minutes d’une obscurité profonde, tout le parc parut illuminé. On vit alors sortir de toutes les allées des personnages bizarrement accoutrés ; les uns ailés, les autres diaphanes ; celui-ci haut comme un géant, celui-là rabougri comme un nain. Quand cette fantastique multitude fut rassemblée devant le château, on entendit ces paroles sortir des rangs : – Vengeons-nous, vengeons-nous ! Guerre aux téméraires qui ont osé nous mépriser, nous, les seuls dieux ; nous, les seuls enchanteurs de ce monde ; nous, qui avons inventé et mis en circulation toutes les légendes, diableries, scènes, fabliaux, histoires, nouvelles, traditions, comédies, que messieurs les poëtes et romanciers de tous les âges n’ont fait que nous emprunter pour les varier suivant leur fantaisie !
Un coup de sifflet vint couper court à cette improvisation remarquable ; la nuit régna de nouveau, et bientôt un personnage d’une haute taille, vêtu d’habits couleur de feu jusqu’à la ceinture, et couleur de fumée depuis la ceinture jusqu’aux pieds, se mit à parcourir la pelouse, une torche à la main, en ayant l’air de faire des préparatifs :
– Vous voyez en moi, dit-il, le plus vieux et le plus célèbre artificier de la terre ; car sans le secours de ma tête et de mes pieds, je défie tous les Ruggieri du monde de lancer en l’air la moindre fusée volante…
En disant cela, il frappa du pied, et l’on vit commencer un feu d’artifice si éblouissant, si nouveau, si hardi, que l’on comprit bien que l’enfer en personne y avait mis la main. Après une succession de feux de toute espèce, et dont le moindre eût fait pâlir de jalousie tous les bouquets de notre pyrotechnie officielle, on vit s’élever en l’air un palais tout de flammes, au milieu duquel était assis sur un trône phosphorescent le personnage éminemment combustible qui s’était annoncé, avec raison, comme le premier artificier du monde. Sur sa tête, on lisait cette phrase écrite en majuscules flamboyantes sur un fond noir :
On voulait porter en triomphe le proverbe de l’artifice ; mais le palais de flammes s’éteignit aussitôt, et il en résulta une fumée si noire et si épaisse, que les spectateurs, tout endormis qu’ils étaient, furent obligés de se frotter les yeux en proclamant la vérité du proverbe.
Leurs yeux se rouvrirent pour contempler un spectacle d’un tout autre genre. La pelouse parut illuminée d’innombrables bougies et ornée de roses du Bengale, de buissons vert-pomme, de cascades bleues, de piédestaux, de vases, de statues ; chacun reconnut l’île des Ballets.
On vit sortir de dessous terre de charmants petits Amours, hauts de trois pieds tout au plus, ayant les cheveux couleur d’azur, portant des colliers formés de cailloux transparents, une urne sous le bras, des couronnes de cresson sur la tête. Ils allèrent tous se jeter les uns après les autres, la tête la première, dans un réservoir entouré de fleurs, placé sur le devant de la scène. Quand le dernier Amour eut fait le saut périlleux, il s’éleva du fond du réservoir une nymphe d’une haute stature, couronnée de roseaux, aux mouvements sinueux, qui se mit à exécuter plusieurs pas charmants en forme de méandres.
On demanda l’auteur, et on apprit que ce ballet avait été composé par un vieux proverbe connu sous le nom de :
Mais voici que tout à coup s’élève de terre une ville d’Orient avec ses fontaines odoriférantes, ses dômes, ses minarets, ses tours en pierre dorée ; c’est Bagdad du temps du célèbre Haroun-Alraschild. Un pauvre jeune homme s’avance et déplore la perte de ses biens ; on apprend par son récit qu’il est devenu le plus pauvre particulier de Bagdad : mais un moment après il est l’homme le plus riche et le plus puissant de la ville, car le voilà assis sur le trône du kalife lui-même ; il est vêtu de brocard, d’or et de perles, entouré d’eunuques noirs, d’émirs et de dames de la plus grande beauté, qui attendent un de ses regards. Chacun le reconnaît ; c’est ce bon Abou-Hassan, le Dormeur Éveillé ; on applaudit. – C’est moi, dit à demi-voix un vieillard en habit de brahmane, caché dans l’ombre, qui suis le véritable auteur de cette vive et brillante comédie ; moi, qui ne suis pourtant qu’un pauvre vieux proverbe qu’on appelle :
Au même instant, une divinité descend sur un nuage ; c’est la Vérité. Elle ouvre un livre d’or, qui n’est autre que le livre des proverbes, et elle trace au premier feuillet cette phrase au milieu de tant d’autres du même genre que Rabelais, Cervantes, La Fontaine, Molière, Boileau, Sterne, Lesage, n’ont pas dédaigné d’inscrire de leur propre main dans ce registre immortel.
Je renonce, Mesdames, à vous décrire toutes les scènes drôlatiques, mythiques, allégoriques, comiques, satiriques ou même pastorales, que représentèrent successivement les étranges magiciens qui s’étaient tout à coup emparés du parc et du château. Mais je vous laisse à deviner quel fut l’étonnement des personnes que nous avons vues dans le milieu du jour réunies sur la pelouse et accablées d’un si mortel ennui, lorsqu’à leur réveil elles se trouvèrent transportées, comme par enchantement, dans le château, et se virent revêtues d’habits de théâtre, poudrées, fardées, prêtes enfin à figurer dans toute espèce de comédies.
On entendit aussitôt sonner une cloche, mais qui, cette fois, n’avait rien de diabolique ; – c’était la cloche du dîner. On passa dans la salle à manger ; une porte à deux battants s’ouvrit, et on aperçut une galerie où se trouvait un théâtre qui avait dû être improvisé en moins de quelques heures. Le rideau se leva, et on vit s’avancer, en costume de Bacchus, le chevalier, qui dit, après s’être incliné profondément : – Le proverbe, Mesdames, que nous allons avoir l’honneur de représenter devant vous ce soir, a pour titre…
– Comment ! nous allons représenter un proverbe !… Est-il vrai ?… Se peut-il ?… On applaudit de tous les côtés ; on cria vivat aux proverbes qui s’étaient si bien vengés par eux-mêmes en se faisant commenter, conter, orner et mettre en scène par leurs détracteurs. – Mais enfin, le titre du proverbe que nous allons jouer ?…
– Le titre du proverbe, Mesdames, dit le chevalier en avalant un verre de vin de Champagne, est :
OU IL NE FAUT PAS DIRE :
Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.



ÉLÈVE LE CORBEAU
IL TE CRÈVERA LES YEUX


ers la fin du seizième siècle, il y avait dans le comté de Dumfries, en Écosse, un honnête fermier nommé Robert Effing, qui était bien le meilleur et le plus vaillant jeune homme de la contrée.
Robert n’avait ni frère ni sœur ; mais Dieu, qui ne voulait pas lui faire une solitude amère, lui avait donné une cousine, charmante fille aux yeux noirs, qui gazouillait autour de la maison comme une fauvette. Quand Lucy accourait au-devant de lui et jetait autour de son cou ses beaux bras nus, avec ce naïf sourire que l’innocence fait éclore sur les lèvres des enfants, Robert se sentait le cœur joyeux et n’aurait pas donné sa ferme pour un royaume.
Un jour que Robert passait dans un vallon, il vit un rouge-gorge sautiller de branche en branche dans une haie de sureaux. C’était bien le plus joli oiseau qu’il eût jamais aperçu ; il avait le plumage pourpre, et son bec brillait comme de l’ivoire. Tout à coup, et tandis que le rouge-gorge chantait ses plus mélodieuses chansons, un épervier fondit sur lui du haut des nues. Déjà l’épervier, rasant les buissons de ses serres recourbées, allait ravir le rouge-gorge, lorsque Robert Effing saisit sa carabine et tira sur le bandit ailé. L’épervier tomba, et le rouge-gorge s’enfonça sous l’asile fleuri des sureaux.
Robert Effing achevait de recharger sa carabine, quand une voix, douce comme le soupir d’une flûte, murmura ces mots dans l’air :
— Merci, Robert ; tu m’as sauvé la vie ; je m’en souviendrai.
Le fermier tourna la tête autour de lui, et ne vit que le petit oiseau qui, de son bec, lustrait ses plumes tout au haut d’une branche.
— Est-ce que je rêve ? se dit-il.
Mais Lucy vint surprendre Robert en l’embrassant, et Robert ne pensa plus au rouge-gorge.
Or, on vivait en ce temps-là au milieu de rapines et de troubles perpétuels. Toutes sortes de gens sans aveu parcouraient le pays, ne se faisant faute d’attaquer les fermes isolées, de détrousser les voyageurs, de piller les châteaux.
La ferme de Robert Effing, étant une des plus considérables du comté, tentait la cupidité des maraudeurs qui battaient la campagne ; un soir, on s’aperçut que plusieurs d’entre eux furetaient autour de la ferme ; on se tint sur ses gardes, et durant une semaine il n’en fut plus question. Mais, par une nuit sombre, tout à coup on fut réveillé par des cris, des aboiements furieux et des coups de fusil. La bande pillarde venait d’attaquer la ferme. Robert sauta sur ses armes, chacun l’imita, et les cultivateurs, voyant leur jeune maître s’élancer dans la cour dont la porte venait d’être forcée, se précipitèrent à sa suite.
Robert était généralement aimé ; ses ouvriers se battirent comme de vieux soldats, et bientôt les bandits, surpris de cette résistance inattendue, prirent la fuite de tous côtés. Plusieurs restèrent sur le terrain, et le reste, vivement poursuivi, se dispersa dans la forêt voisine. Parmi ceux qui tombèrent au pouvoir de Robert, blessés ou saisis dans le désordre de la retraite, se trouvait un jeune adolescent à moitié nu. Robert, ému à la vue de cet enfant dont les yeux noirs brillaient sous un front pâli par la terreur, défendit qu’on lui fît aucun mal. Les brigands étaient vaincus ; les instincts généreux de Robert revenaient avec la confiance et la sécurité. Il interrogea le prisonnier.
— Je m’appelle Snag ; les gens que vous avez repoussés m’ont enlevé, il y a déjà longtemps, à ma famille qui habite un comté d’Angleterre ; depuis lors, je les ai suivis.
— Veux-tu rester avec nous ?
— Volontiers.
— Touche là ; oublie le passé, deviens honnête, et tu n’auras pas à te plaindre de moi.
Robert fit donner des habits à Snag, le présenta à Lucy, qui ne put retenir un mouvement d’effroi en voyant sa figure olivâtre et l’éclair rapide de ses yeux sauvages, et malgré les observations des vieux fermiers il l’installa dans l’intérieur des bâtiments. Puis, quand tout fut rentré dans l’ordre, Robert se retira dans sa chambre.
Le lendemain, Snag se mêla aux travailleurs ; c’était le plus leste et le plus adroit des garçons de la ferme ; nul ne le distançait à la course, aucun ne savait mieux dompter un cheval, diriger la balle d’un mousquet, franchir un torrent à la nage, grimper à la cime d’un arbre. Robert ne tarda pas à le prendre en affection ; son adresse le charmait, son intelligence l’étonnait. Bientôt ce fut à Snag qu’il confia le soin de panser son cheval favori, de soigner ses chiens de chasse, d’entretenir ses armes ; Snag l’accompagnait quand il allait battre les collines à la poursuite des coqs de bruyère, pêcher le saumon dans la rivière, attendre les canards à l’affût sur le bord des étangs. Snag ne craignait ni le vent, ni la pluie, ni la neige ; les rayons du soleil d’été glissaient sur son front bronzé, et les brouillards de décembre ne l’empêchaient pas d’exposer sa poitrine aux brises froides qui viennent de l’Océan.
Malgré l’amitié croissante de Robert pour Snag, Lucy n’avait aucune sympathie pour le jeune captif. Elle ne pouvait s’empêcher de baisser les yeux quand elle rencontrait les siens, ardents comme une flamme sous leurs épais sourcils. Souvent le regard hardi du bohémien faisait monter à ses joues les couleurs empourprées de la fleur du grenadier. Quand elle le rencontrait, Lucy s’écartait de son chemin.
— Vous n’aimez pas mon pauvre Snag, lui disait parfois Robert.
— Ce n’est pas mon cousin, répondait en souriant l’aimable fille à qui l’amour enseignait la coquetterie.
— Vous qui êtes si bonne pour tous, pourquoi êtes-vous dédaigneuse pour lui seul ?
— Oh ! Robert, ne m’en veuillez pas ! s’écriait alors Lucy. J’ai froid au cœur quand le regard de Snag s’arrête sur moi ; son sourire est amer comme une raillerie, et lorsque dans mes promenades j’entends sa voix, je tressaille comme au cri de l’orfraie.
Cependant, tandis que Snag gagnait de plus en plus la confiance de son maître, des vols étaient chaque jour commis à la ferme. Tantôt un mouton disparaissait, tantôt un bœuf ne rentrait pas à l’étable ; les lavandières cherchaient vainement les plus belles pièces de toile étendues le soir sur l’herbe des prairies. Mille rumeurs circulaient parmi les gens de la ferme à l’heure du repas, les vieux pâtres se parlaient bas à l’oreille en regardant Snag ; mais Snag demeurait dédaigneux et muet, et nul n’osait dire ses soupçons à Robert Effing.
Parfois Snag s’éloignait aux premières clartés du jour, et ne rentrait qu’après le soleil couchant. Il était alors tout trempé de sueur, et semblait avoir fourni une longue carrière dans les halliers et les marécages, tant ses habits étaient souillés de fange et ses jambes déchirées par les ronces.
Lorsque Robert lui demandait d’où il venait, Snag répondait en riant qu’il avait suivi la piste d’un troupeau de daims.
— Que Dieu vous garde de ce gibier maudit ! reprit un jour un vieux chasseur qui avait appris à Robert à tirer ses premiers coups de fusil.
À quelque temps de là, Robert pensa que nulle part il ne trouverait cœur plus tendre et beauté plus virginale que le cœur et la beauté de Lucy. Il le dit à sa cousine un soir qu’ils se promenaient ensemble sous les saules, au bord d’un ruisseau. Lucy rougit, et mit sa main dans la main de Robert.
— Tu seras ma femme dans trois jours, dit le jeune homme, et il se pencha sur le front de Lucy.
Au moment où ses lèvres touchaient le front d’ivoire de la belle enfant, elle tressaillit, et du doigt lui montra Snag qui se glissait entre les saules, souple et agile comme un chat tigre.
— Toujours lui ! dit-elle.
Le matin du jour des noces, un berger raconta aux gens de la ferme que, tout en parcourant les bruyères, il avait vu passer des hommes à visages sinistres.
— Veillons, frères, dit le vieux chasseur.
Après les danses et les festins les convives se séparèrent ; quelque temps on vit briller les torches dans les ténèbres de la campagne où sifflait le vent d’automne ; puis les clartés s’éteignirent, et Robert, prenant la main de Lucy rougissante, la conduisit vers sa chambre nuptiale, toute parée de bouquets.
La ferme dormait ; et le silence profond étendait ses doux mystères des bois aux collines. Robert roula son bras autour de la taille de Lucy, et sa main détachait déjà les fleurs d’oranger, lorsque vingt coups de fusil éclatèrent dans l’ombre ; trente bandits escaladèrent les murs avec des cris sauvages, et Snag, à leur tête, une hache à la main, bondit dans la cour.
Robert voulut s’élancer, mais une balle le frappa à la poitrine ; il poussa un cri et ouvrit les yeux…
Le soleil inondait la chambre de ses purs rayons ; mille chants joyeux retentissaient entre les branches des tilleuls fleuris ; Robert était sur son lit. Il passa la main sur son front, et les événements de la nuit lui revinrent à la mémoire.
— J’ai rêvé ! dit-il.
— Oui, c’est un rêve, répondit la voix douce comme le soupir d’une flûte.
Robert tressaillit. Sur le rebord de la fenêtre un joli rouge-gorge sautillait.
— Tu m’as sauvé la vie, reprit la voix, un jour que j’allais être pris par un oiseau de proie ; je t’avais promis de m’en souvenir. Cet enfant que tu as recueilli sous ton toit est un bohémien ; sa chevelure semblable à l’aile du corbeau est moins noire que son âme. J’ai prié ma sœur, la fée Mab, de verser le sommeil sur tes paupières, et, dans un songe, je t’ai fait voir la vérité. Lève-toi donc, et hâte-toi de renvoyer Snag.
— Mais qui donc es-tu ? demanda Robert Effing.
— Je suis le lutin Elphy. Chaque année, pendant trois jours, je suis obligé, par la loi qui gouverne les esprits, de prendre la forme d’une créature vivante. J’étais perdu sans ton secours généreux. Ma captivité finit ce matin. Adieu, Robert Effing, adieu ; souviens-toi de cet adage écossais :
En achevant ces mots, le rouge-gorge ouvrit ses ailes et disparut dans un tourbillon de flammes roses et bleues.
Robert se leva. Snag était dans la cour ; se croyant seul, il glissait dans sa poche une tasse d’argent.
— Elphy a raison, dit le jeune homme, et, prenant sa carabine, il descendit. Une heure après, Snag quittait la ferme en compagnie du vieux chasseur qui avait ordre de l’embarquer à bord du premier navire en charge sur la côte.
— Ô Lucy ! ma colombe, dit Robert à sa cousine, le corbeau n’est plus sous notre toit. Le ciel bénira notre union.



DERRIÈRE LA CROIX
SOUVENT SE TIENT LE DIABLE

 tienne Galabert venait de passer de sa chambre à coucher dans la salle à manger, où une espèce de gouvernante disposait un plateau à thé sur un petit guéridon.
tienne Galabert venait de passer de sa chambre à coucher dans la salle à manger, où une espèce de gouvernante disposait un plateau à thé sur un petit guéridon.
— Madame Gauthier, dit-il tout à coup, voilà trois jours que je suis resté à la chasse, vous devez avoir reçu des lettres pour moi ?
— Des lettres, non ; mais une lettre, oui ; elle vous attend depuis hier ou avant-hier. La voilà.
Étienne Galabert brisa le cachet, et lut rapidement cette lettre en murmurant quelques paroles à demi-voix.
— Quoi ! de mon vieil ami Jacques Maubertin !… « Quand on a traduit Virgile sur les mêmes bancs à Sainte-Barbe, on ne saurait se marier sans… » Il se marie ! lui ! il m’invite à l’assister en qualité de témoin ! Ah ! mon Dieu ! Madame Gauthier, vite mon habit le plus noir, ma cravate la plus blanche, mon gilet le plus beau, mes gants les plus jaunes, mon chapeau le plus neuf… Je ne déjeune pas.
Étienne Galabert s’habilla à la hâte, descendit l’escalier, sauta dans un cabriolet de place, et cria au cocher, en lui glissant une pièce de cent sous dans la main : Rue de Provence, 40 !
Au bout d’un quart d’heure, Galabert s’arrêtait devant une maison de belle apparence, et bientôt il entrait dans un appartement coquet, au premier sans entresol.
— Tu te maries ! s’écria Étienne aussitôt qu’il aperçut son ami. Bien sûr tu te maries, toi ? Toi qui, comme moi, remerciais chaque jour Dieu de t’avoir conservé célibataire en te faisant naître rentier ?
— Je me marie, et tu ferais comme moi s’il pouvait y avoir deux Rosine dans le monde, répondit Jacques.
— Ah ! elle s’appelle Rosine ?
— Rosine de Fernange. Quelle femme, mon ami ! Elle a toutes les grâces, comme elle a toutes les vertus de son sexe.
— C’est-à-dire que tu en es amoureux ?
— Je lui rends justice… D’ailleurs tu la verras.
— Où donc as-tu rencontré cette merveille ?
— Ici, rue de Provence, 40, au premier. Ah ! Étienne, que tu l’aurais adorée si tu l’avais vue comme moi ! Chaque jour Rosine allait à la messe de Notre-Dame-de-Lorette, sa paroisse ; jamais on ne la surprenait au bal, au concert, au théâtre ; sa charité soulageait les malheureux dans l’ombre ; nulle visite chez elle. Ah ! que de peine j’ai eue à me faire admettre dans son délicieux petit ermitage ! Si je n’avais pas eu de cheveux gris, peut-être n’y serais-je jamais parvenu.
— Voyez pourtant à quoi tient le bonheur ! En voilà un qui était suspendu à une nuance ! s’écria Galabert.
— Quel langage ! Ah ! mon cher Étienne, tu ne sais donc plus honorer la vertu ?
— Pardonne-moi, mon cher Maubertin, j’oublie toujours qu’un témoin doit être sérieux quand même ; mais la gravité ne tardera sans doute pas à venir, j’ai déjà l’habit de l’emploi. Cependant permets-moi encore une question ; tu m’as dit le nom et les vertus de ta prétendue, mais tu ne m’as rien dit de son état social. Qui est-elle ? fille ou veuve, riche ou pauvre ?
— Madame de Fernange est veuve d’un lieutenant général mort en Afrique.
— Mon ami, ne te semble-t-il pas que l’Afrique tue trop d’officiers-généraux ? Les veuves de la jeune armée se multiplient à faire peur.
— Madame de Fernange a du bien du côté de sa mère, une terre en Bourbonnais, où sa famille était fort considérée.
— Noblesse d’épée sans doute ? reprit Étienne avec un sourire que ne vit pas Jacques Maubertin.
— Noblesse de robe, répondit sérieusement le prétendu. Mais suis-moi, et je te présenterai à ma Rosine.
— Va donc, Almaviva.
Madame Rosine de Fernange se tenait dans un boudoir gris-perle rehaussé d’or ; c’était une femme blonde, frêle, délicate ; ses cheveux bouclés à l’anglaise descendaient jusque sur sa poitrine ; et ses yeux bleus, le plus souvent baissés vers la terre, ne se relevaient que pour regarder le ciel ; mais elle avait le nez pointu et les lèvres minces. Elle accueillit Étienne Galabert avec un sourire charmant, et un instant son regard glissa sur le visage du célibataire avec la rapidité d’un éclair. Bientôt Jacques Mauberun se retira, voulant, disait-il, leur laisser toute liberté de faire connaissance.
Madame de Fernange, bien que modeste et toute pleine de timidité, avait l’esprit alerte et la parole facile. La conversation fut promptement engagée entre elle et Étienne Galabert. En deux heures, cette conversation fit le tour du monde ; de la Madeleine à la Bastille il n’y avait qu’une réplique, et l’on se promena au travers de Paris à vol de parole.
Mais, quoi qu’il dît, et de quelque formule qu’il se servît, au premier mot qui ne sentait pas l’orthodoxie, madame Rosine de Fernange ramenait Étienne Galabert au sentier de la vertu. Quand le célibataire se cabrait sous les admonestations de la jeune veuve, elle lui prenait la main avec un sourire mignard ; le célibataire se penchait et baisait cette main qu’on lui abandonnait un instant.
— Oh ! je vous convertirai, lui disait-on.
Dans ces moments-là, quand il sentait sous ses lèvres la peau fine et lustrée de la jeune prude, Étienne Galabert n’était pas loin d’être touché par la grâce. Cependant Jacques Maubertin rentra, et le célibataire prit congé de madame de Fernange.
— Eh bien ! qu’en dis-tu ? s’écria le prétendu quand ils furent seuls.
— Je dis que ta Rosine est une rosière. À un château elle préfère une chaumière ; à un hôtel, une maisonnette ; à une calèche, la promenade au fond des bois, à pied, mais à deux.
— Oui, quand le second est moi, son futur mari. Oh ! je n’ignore rien ; je sais que madame de Fernange préfère à un bal le coin du feu ; à un manteau de velours, un châle de laine ; à des laquais poudrés, une bonne en socques ; aux vaudevilles de MM. Duvert et Lausanne, les homélies de M. l’abbé Combalot ; aux plaisirs des eaux, les soins de son ménage. Bref, elle a les grâces d’une païenne, unies à l’âme d’une abbesse.
— Diable ! que de vertus chez une femme si jeune et si jolie !
— Et cet ange va m’appartenir, à moi, qui ai quarante ans déjà et seulement quarante mille livres de rentes avec. Mais, mon ami, si nous trouvons une autre Rosine, celle-là sera pour toi.
— Merci, mon cher ; j’ai failli me marier il y a dix ans, et j’ai rompu les négociations, tout simplement parce que ma femme avait trop de qualités. Or, ta fiancée en a deux fois davantage ; c’est quatre fois plus qu’il n’en faut.
Le lendemain, Étienne retourna chez madame de Fernange, et le contrat fut signé le soir même. Jacques se demandait si Dieu, voulant faire un miracle en sa faveur, n’avait pas logé le paradis rue de Provence.
Deux jours après, Étienne Galabert s’absenta pour un voyage. À son retour à Paris, vers la fin de l’hiver, il n’eut rien de plus pressé que de se rendre chez Jacques Maubertin.
Aussitôt qu’il l’aperçut, Jacques Maubertin lui tendit la main. Hélas ! que le pauvre homme était changé ! La pâleur s’étendait sur ses joues ; un cercle bleuâtre entourait ses paupières ; un triste sourire errait sur ses lèvres.
— Es-tu malade ? s’écria Étienne.
— Non ; mais je suis marié, répondit Jacques.
— Quoi ! ton archange ?…
— Est un démon.
— Écoute, mon ami Jacques ; je crois que tu exagères encore ; si je ne crois pas aux séraphins, je ne crois pas non plus aux diables. Je veux bien supposer, puisque tu l’exiges, que ta femme n’est pas la Sainte-Vierge ; mais encore permets-moi de n’être pas convaincu que ce soit Lucifer.
— C’est au moins son cousin, Astaroth ou Belzébuth.
— Quoi ! l’héritière d’une famille de noblesse de robe du Bourbonnais !
— Belle noblesse, ma foi ! Pour rendre service à leurs amis, son père et sa mère aunaient du calicot dans un faubourg de Moulins.
— La veuve d’un lieutenant-général !
— Lieutenant, oui ; mais général, non.
— Une femme qui a des goûts si modestes !
— Regarde : elle marche sur l’aubusson, s’assied sur le velours, se couche dans la batiste.
— Elle qui ne voulait qu’un pauvre châle de laine !
— Pourvu que cette laine vînt de Cachemire.
— Tu la calomnies ! Elle a horreur du vaudeville et tient le mélodrame en abomination !
— Oui ; mais elle a sa loge aux Italiens et une autre à l’Opéra.
— Elle adorait le coin du feu !
— Elle le chérit encore, quand il y a cinq cents personnes à l’entour.
— Et sa passion pour les chaumières et les maisonnettes ?
— Elle la nourrit toujours ; ses albums en sont pleins, chaumières à l’aquarelle et maisonnettes à la sepia.
— Une Rosine qui ne voulait vivre que pour ses enfants !
— Elle n’en a pas.
— Une dévote qui préfère une bonne en socques à des laquais en poudre !
— Aussi n’a-t-elle que des grooms ou des chasseurs.
— Une veuve qui faisait fi des eaux !
— Elle ne compte pas en prendre ; mais elle est très résolue à y aller. La vertu propose, et la névrose dispose.
— Elle qui ne comprenait pas qu’on pût user d’une calèche !
— Sans doute, et c’est pourquoi elle a pris un coupé. Tiens, mon ami, regarde.
En ce moment, les roues d’un brillant équipage ébranlèrent les pavés de la cour. Madame Maubertin descendit gaiement appuyée sur le bras d’un jeune homme ganté et verni comme une gravure de mode.
Étienne interrogea du regard son ami Jacques.
— Oh ! c’est un cousin… Je l’ai à peine vu… Noblesse d’épée, celle-là ; il est, je crois, officier de spahis à Constantine.
Tout en parlant, Jacques s’approcha d’une magnifique jardinière qui arrondissait sa gerbe de fleurs dans une embrasure de fenêtre ; d’une main impatiente il voulut arracher une rose, mais une épine lui déchira le doigt.
— Oh ! dit-il en retirant sa main rougie de gouttes de sang.
— C’est un symbole, mon ami, lui dit Étienne ; si derrière la fleur se tient l’épine,



ZÉPHIRINE
À QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON

 u’on se représente le salon de madame la marquise de M… (nous pourrions aussi bien dire la duchesse) ; tous ses amis s’y trouvent réunis. La soirée a un but sérieux. Il ne s’agit cependant ni de tirer une loterie, ni d’organiser une souscription en faveur de quelque œuvre pieuse, ni même de danser la polka ; la question à l’ordre du jour est le choix du proverbe à jouer pour la fête de la maîtresse de la maison.
u’on se représente le salon de madame la marquise de M… (nous pourrions aussi bien dire la duchesse) ; tous ses amis s’y trouvent réunis. La soirée a un but sérieux. Il ne s’agit cependant ni de tirer une loterie, ni d’organiser une souscription en faveur de quelque œuvre pieuse, ni même de danser la polka ; la question à l’ordre du jour est le choix du proverbe à jouer pour la fête de la maîtresse de la maison.
Comme il arrive toujours en pareil cas, après avoir été aussi ardente que possible, la discussion se traînait péniblement au milieu de l’indifférence générale, et menaçait même de s’éteindre, lorsqu’une voix, partie d’un des angles du salon, s’écria tout à coup : — Si je vous contais une histoire ?
— Une histoire de revenants ? demanda une jeune dame blonde, qui avait proposé pour sujet de proverbe :
— Les revenants sont passés de mode ; mais il s’agit d’une histoire d’amour, ce qui vaut bien tous les spectres d’Anna Radcliffe.
Nous dirons tout de suite au lecteur impatient de connaître celui qui va lui raconter une histoire d’amour, qu’il se nomme D…, qu’il est notaire à la résidence de C…, âgé de trente-quatre à quarante ans, portant des lunettes, et renommé pour son esprit dans tous les châteaux de l’arrondissement d’A…
D… prit place devant la cheminée, et, le coude renversé, la jambe droite posée sur la gauche, la botte en pointe, il commença ainsi :
— Vous vous étonnez sans doute, Messieurs et Mesdames, qu’un garçon aussi bien tourné que moi, jouissant de toutes ses facultés et d’une étude bien achalandée, soit resté célibataire. Ne vous hâtez pas de me juger ; n’allez pas croire que je sois resté constamment insensible aux traits de Cupidon. Mon cœur de notaire a battu, trop battu même ; et l’amour, qui depuis Troie a perdu tant de choses, a été la cause de ma ruine, je veux dire de mon célibat. Je vais vous révéler ce mystère ; écoutez la confession d’un enfant du siècle.
Dans les premières années qui suivirent la révolution de juillet, mon père m’avait placé chez un notaire de ses amis. J’avais un cœur de vingt ans, un habit de vingt ans, en un mot toutes les passions et tous les charmes de la jeunesse. Mes larmes coulent rien qu’en songeant à ce temps heureux où l’âme chasse aux papillons, où l’on est blond, où l’on est habillé en drap bleu-barbeau.
Pénétré des devoirs qu’impose la cléricature, je n’avais encore gravé dans mon cœur que quelques articles du Code de procédure civile, lorsqu’un matin, en m’asseyant devant mon bureau, je vis sur la grande place, en face de la fenêtre de l’étude, une image dont le souvenir gracieux me poursuit encore. C’était une toile de plusieurs pieds de haut, représentant une femme sauvage avalant des cailloux et des lames de sabre ; je la vis, et soudain j’en devins amoureux.
— De la femme sauvage ? demanda la marquise.
— De Zéphyrine, de l’adorable Zéphyrine ! Elle se tenait debout montrant la toile avec sa baguette. Immobile contre la vitre, je l’admirais accueillant les amateurs avec un irrésistible sourire, et recevant les gros sous de sa main blanche et agile. Je la vois encore, le bras arrondi sur la hanche, la taille cambrée, l’œil noir, le teint nuancé de rose, la narine mobile, le nez vif et droit, son jupon bleu chamarré de paillettes laissant voir ses jambes mignonnes, auxquelles s’attachaient deux pieds de fée. Je vous épargne l’ennui de mes premières émotions ; je ne vous dis ni mes regards ardents, ni mes soupirs de flamme, ni mes lettres frénétiques…
— Vous écrivîtes à Zéphyrine ?
— Je lui écrivis, et je me rappelle encore ma première lettre :
« Vierge de mes songes, je t’ai vue, et je t’ai aimée ; te voir et te le dire, voilà ma seule ambition. Tu es belle comme Vénus, et modeste comme Minerve. La rosée que l’Aurore dépose au sein des fleurs est moins pure que toi. Âme de mon âme, tu tiens ma vie entre tes mains ; aime-moi, si tu ne veux voir mourir à tes pieds celui que tu peux faire le plus heureux ou le plus malheureux des mortels. »
Après une correspondance des plus orageuses, elle me répondit qu’elle m’aimait, en post-scriptum. Je baisai et rebaisai cent fois le bas de sa lettre, et je me mis à marcher à grands pas dans ma chambre, cherchant les moyens de me réunir pour jamais à celle que j’adorais, et de l’arracher à un métier qui n’était pas fait pour elle.
Non ; m’écriais-je dans mon enthousiasme, tu n’es point née pour vivre avec des saltimbanques qui abuseront tôt ou tard de ton innocence, pour te faire avaler des cailloux et des lames de sabre ! Je saurai soustraire ton palais à cette ignominieuse extrémité ; ta voix, qui s’enroue à vanter les superbes qualités de la femme sauvage, ne devrait murmurer que des paroles d’amour ; ta main, si fine et si petite, ne devrait tenir d’autre baguette que celle d’une fée ; je te rendrai au monde dont tu feras le plus bel ornement ; avant un mois, je veux que tu danses dans les salons de la préfecture !
J’en étais là de ce monologue, quand j’entendis ma porte s’ouvrir doucement, et je reçus dans mes bras Zéphyrine palpitante.
Avec quel plaisir je la regardais ! Avec quelle anxiété je suivais sur ses traits la trace des émotions que devait faire naître dans son âme une situation si nouvelle ! Je voulus lui prendre la main, elle me repoussa d’un air plein de dignité.
— Monsieur, me dit-elle, ne me faites pas repentir de ma confiance ; je ne suis point ce que vous croyez. Je m’appelle Zéphyrine de Valcour ; mon père, officier supérieur de la garde, mort en juillet….
— Ô Zéphyrine ! m’écriai-je hors de moi-même, mes pressentiments ne m’ont point trompé ; tu n’es pas née saltimbanque ; mais hélas ! quelle distance nous sépare ! Le fatal préjugé de la noblesse…
— Ne m’empêchera pas de vous donner ma main si vous vous en montrez digne. Il faut me soustraire aux persécutions d’un homme qui, après avoir juré à mon père mourant de veiller sur moi, m’exploite indignement, et veut me forcer à épouser son paillasse Cabochard, dit l’incomparable Mexicain.
— Je te sauverai, Zéphyrine, je t’enlèverai à ces misérables. Je vais tout préparer pour notre fuite ; en attendant, cette chambre te servira d’asile ; je t’y laisse sous la sauvegarde de l’honneur et de l’amour.
J’ai oublié de vous dire que mon patron était maire de la ville. Comme j’allais chercher dans mon bureau quelques centaines de francs, fruit de mes économies de jeune homme, il me fit entrer dans son cabinet, et, me montrant un homme d’assez mauvaise mine qui se tenait debout à son côté, il me dit d’un ton brusque et menaçant :
— C’est donc vous qui voulez réduire à la misère ce digne Bilboquet qui fait depuis trente ans les délices de notre ville, en lui enlevant une artiste qui n’a pas sa pareille pour le saut périlleux ? Je vous somme, au nom de la loi et de la morale, de déclarer où vous l’avez cachée.
— C’est aussi au nom de la morale et de la loi, répondis-je avec une indignation contenue, que je vous somme de faire arrêter le susdit Bilboquet, coupable de suppression d’état à l’égard de mademoiselle Zéphyrine de Valcour, fille de M. le comte de Valcour, officier supérieur de la garde, mort à Paris en 1830, victime de son dévouement à la monarchie.
Bilboquet haussa les épaules, et me toisa dédaigneusement.
— Connu ! connu ! s’écria-t-il ; c’est la troisième fois que Zéphyrine s’amuse ainsi aux dépens des âmes sensibles qui ont comme vous vingt ans et un habit bleu-barbeau. Elle éprouve de temps en temps le besoin de me quitter ; mais elle revient toujours au bercail : je suis si bon pour mes pensionnaires ! Rendez-moi Zéphyrine, jeune imprudent ; la représentation va commencer, et il faut bien que quelqu’un crie : Prenez vos billets !
— Tu mens, tu n’es qu’un vil imposteur ! Je demande justice pour mademoiselle de Valcour.
— Voilà, reprit Bilboquet, des papiers qui constatent que mademoiselle de Valcour est sortie de l’hospice des Enfants-Trouvés. Je voulais les faire légaliser par M. le maire, afin de procéder tout de suite au mariage de mademoiselle Zéphyrine, saltimbanque, avec M. Cabochard, paillasse. Pourvu qu’il ignore l’escapade de sa prétendue ! L’incomparable Mexicain serait capable de n’en plus vouloir ; et vous êtes trop généreux, jeune homme, pour compromettre une faible femme.
Âmes sensibles, cœurs qui avez aimé, vous comprendrez mon désespoir ! Je voulus me tuer après avoir plongé un poignard dans le sein de la perfide ; mais elle disparut le jour même. J’ai eu plus tard la consolation d’apprendre que je n’avais pas nui à son avenir. Zéphyrine devint madame Cabochard.
Ce qu’il y avait de plus terrible dans ma situation, c’est que je ne trouvais personne à qui confier mes chagrins ; tout le monde riait en voyant ma physionomie de douloureuse résignation.
Mon patron s’était hâté de raconter mon aventure à mes collègues de l’étude, elle avait couru tout le pays ; j’étais devenu un héros à dix lieues à la ronde : si bien que, quelque temps après, lorsque mon père songea à me marier, je me hasardais difficilement à me montrer en plein jour dans les rues.
Ma prétendue était jolie, ses parents bien disposés en ma faveur. Je fis ma première visite ; à peine m’étais-je approché de mademoiselle Henriette pour lui adresser un compliment, qu’elle se leva, mit sa main sur sa bouche, et disparut en poussant un éclat de rire étouffé : le souvenir de ma déplorable passion avait produit son effet. Je l’entendis ensuite dans la chambre voisine rire tout à son aise ; sa mère me dit qu’elle était sujette à ces accès, qui devenaient plus rares de jour en jour, et que le mariage devait faire disparaître.
— En fîtes-vous l’essai ? demanda la maîtresse de la maison.
— Non vraiment. Depuis, je n’ai plus voulu me marier.
— Eh bien ! dit un des assistants, vous venez, sans vous en douter, de nous donner le sujet du proverbe que nous cherchions tout à l’heure.
— Voyons le titre.



IL FAUT AMADOUER LA POULE
POUR AVOIR LES POUSSINS

 ademoiselle Euphrosine monta vers la brune dans la chambre qu’elle occupait au faîte d’une maison de la rue des Cinq Diamants, tenant à la main un boisseau de charbon enveloppé dans un numéro de la Gazette des Tribunaux, et bien déterminée à en finir.
ademoiselle Euphrosine monta vers la brune dans la chambre qu’elle occupait au faîte d’une maison de la rue des Cinq Diamants, tenant à la main un boisseau de charbon enveloppé dans un numéro de la Gazette des Tribunaux, et bien déterminée à en finir.
— Que fais-je dans la vie ? dit-elle d’une voix sombre ; où vais-je ? que suis-je ? d’où sors-je, et à qui plais-je ?…
Elle ne put continuer ces harmonieuses exclamations, et alla ouvrir un tiroir où se trouvait un paquet de lettres qu’elle déploya d’une main égarée par le désespoir. Elle tomba sur les passages les plus échevelés :
« Ô mon hange ! ô ma perle ! sais-tu bien que ma destinée est antièrement confondue dedans la tienne ? Oui, jeune fille, tu est mon incendit, mon Vésuve ! Grasse à toi, hange d’essieu, mon existance est enivrante, haromatique comme l’Arabie ; il me semble que tout est autour de moi vanille, amande douce, crème de rose, Portugal…
Euphrosine aussi était artiste ; — artiste en corsets.
— Et il me trahit ! ajouta-t-elle, et pour qui ?… Pour une personne qui pesait cent soixante-dix-neuf livres sept onces et neuf gros à la dernière fête de Saint-Cloud… Ah ! le…
Elle n’acheva pas.
Elle ferma le tiroir aux lettres, boucha hermétiquement la fente de sa porte et sa fenêtre à tabatière, renversa la braise sur un fourneau, et quand tout fut prêt… elle prit son accordéon, et se mit à entonner le chant du cygne, en jouant dans les cordes lugubres de l’instrument, dans l’octave du canard.
L’accordéon se tut, et l’instrumentiste se décida à vivre encore une nuit ; mais c’était la dernière, oh ! oui, la dernière, à moins pourtant que…
Elle souffla sa chandelle et s’endormit.
Le lendemain, elle descendit à la boutique à l’heure ordinaire ; mais elle eut beau regarder dans la rue, cherchant à apercevoir Zéphyrin, elle n’aperçut rien, et la pudeur ne lui permit pas de rester plus longtemps sur le seuil de la porte.
Vers les dix heures du matin, on vit paraître dans la boutique celle qu’Euphrosine appelait sa rivale, la radieuse madame Rosalba Louchard, jeune veuve âgée de neuf lustres et très-rigide dans ses principes.
Quelques mois auparavant, il ne s’en était pas fallu de l’épaisseur d’un cheveu que madame Louchard ne congédiât sa première ouvrière, mademoiselle Euphrosine, qui attirait dans le magasin un petit garçon coiffeur du voisinage, nommé Zéphyrin, qu’elle avait surpris un jour devant le comptoir, gesticulant, et faisant à mademoiselle Euphrosine une déclaration d’amour, tirée des profondeurs de sa poitrine d’homme, comme à l’Ambigu.
Cependant, depuis quelque temps, madame Louchard trouvait Zéphyrin plus posé, et susceptible d’apprécier une personne d’éducation, quels que fussent son âge et son poids. Le bruit courait même dans le quartier que madame Louchard songeait à se remarier ; Zéphyrin n’avait rien, il est vrai ; mais la maîtresse corsetière avait, disait-on, du foin dans ses socles ; et pourquoi l’amour sans capitaux ne s’unirait-il pas à l’embonpoint inscrit à la Caisse d’épargne ?
— Zéphyrin n’est pas encore venu ? dit madame Louchard en caressant les mèches de son tour.
— Non, il n’est pas venu, murmura Euphrosine entre ses dents, vieille…
Elle n’acheva pas.
Au même instant, une apparition, sentant l’huile de Macassar, traversa la boutique comme un éclair : c’était Zéphyrin. Il s’élança d’un bond dans l’arrière-boutique, où l’attendait madame Louchard ; et là, il se mit à la coiffer, ou plutôt à coiffer son tour, comme on ne coiffe plus que dans la rue des Cinq-Diamants : c’était à la fois vaporeux et monumental. Madame Louchard parut rajeunie d’au moins cinq semaines : son tour, c’était sa vie.
Zéphyrin retraversa la boutique comme l’éclair, sans même jeter un mot, une œillade au comptoir. Et cependant Euphrosine était là !… Elle est là, ton Euphrosine, ingrat coiffeur !
— Ah ! c’est trop fort ! dit Euphrosine en elle-même ; ne pas daigner me gratifier du simple coup d’œil que se doivent au moins les personnes bien élevées !
Elle regretta de n’en avoir pas fini la veille. Mais qu’importe ? Le charbon est tout prêt ; et, pour ne plus souffrir, pour se venger d’un être atroce, que faut-il ?… Un moment de résolution et une allumette chimique.
Madame Louchard et son tour sortirent pour aller faire des visites. Alors Euphrosine n’hésite plus, elle prend un prétexte pour monter à sa mansarde ; mais, au moment où elle va quitter le comptoir pour accomplir son fatal dessein, l’Amour parut dans la boutique.
Oui, l’Amour lui-même, représenté par Zéphyrin, qui tient sur ses deux poings deux perruques de débardeur qu’il va porter dans le voisinage pour un bal masqué du soir.
Il se place devant Euphrosine ; il s’écrie en agitant ses deux perruques :
— Oh ! mais quoi !… Qui ?… Toi ?… De moi ?… Pour elle ?… Non… Ciel !… Terre !… Mort !… Enfer !!!
— Ah ! je te comprends, s’écrie Euphrosine ; mais explique-toi.
— Non ; vois-tu, ajoute Zéphyrin toujours avec ses deux perruques à la main, dans les veines de ce bras-là bouillonne du sang d’artiste… Qui, moi, je végéterais ! J’emploierais éternellement mon existence d’homme à crêper et à poudrer des crinières !… Pitié !… J’aime l’art en grand, il me faut la carrière du ténor… J’ai l’ut ; oui, l’ut…
Une sonnette se fait entendre à l’extrémité de la rue.
— On y va ! s’écrie le coiffeur de l’avenir.
— Arrête, oh ! arrête, dit Euphrosine ; plus qu’un mot…
Mais Zéphyrin ne l’entend plus ; il est déjà dans la rue, il lève en l’air ses deux perruques, et les secoue d’un mouvement frénétique en criant : « Hourrah ! »
— Il m’aime encore ! se dit Euphrosine ; mais comment accorder ces preuves d’amour avec ce qu’il est pour madame Louchard ?… Zéphyrin, Zéphyrin, mangeriez-vous à deux râteliers ?
Cependant, malgré cette idée, la journée fut meilleure pour Euphrosine qu’elle n’aurait cru. Mais que devint-elle, et quelle nouvelle secousse, lorsque madame Louchard, rentrant vers quatre heures, dit en traversant la boutique : — Je vais ce soir aux Folies-Dramatiques avec Zéphyrin !
À ces mots, le corset qu’Euphrosine achevait lui tomba des mains. Ses yeux se fermèrent ; elle fut sur le point de s’évanouir ; mais elle pensa que ce serait assurer le triomphe de sa rivale, et parvint à reprendre son sang froid et son corset.
À six heures précises, un fiacre s’arrêta devant la boutique ; c’était encore l’Amour ; mais cette fois, l’Amour régulier, correct ; plus de perruques de débardeur, de la distinction, de la tenue, gants serin à 29.
Zéphyrin s’approcha familièrement de madame Louchard, et, après avoir retouché sa coiffure, lui adressa quelques paroles à l’oreille. Celle-ci sourit agréablement, et dit, en se tournant vers la cantonnade :
— Mesdemoiselles, c’est demain dimanche ; M. Zéphyrin veut bien vous inviter à une promenade à Romainville… Il y aura des ânes…
Il faudrait connaître la langue musicale de M. Sudre pour rendre l’accent d’amertume et de raillerie avec lequel cette phrase fut prononcée. Euphrosine ne répondit pas ; elle avait pris son parti : tout cela était évidemment trop mesquin.
— Non, non, s’écria-t-elle dès que le fiacre se fut éloigné, ce n’est plus la mort cachée, ignorée, qu’il me faut ; c’est la mort en plein vent, à la campagne, à la face du ciel, sous tes propres yeux, monstre !… Demain, il y aura des ânes, dis-tu, à Romainville ; eh bien ! je choisirai l’animal le plus fougueux, le plus sauvage, et je veux qu’il m’entraîne n’importe où… J’irai finir ma vie dans le fond de quelque précipice… comme Mazetta…
La journée du lendemain fut pour la sensible Euphrosine une série de chagrins et de vexations. Elle eut le plus mauvais âne de la société ; un de ces ânes sans amour-propre, que, ni la persuasion, ni les épingles, ne peuvent faire marcher.
Madame Louchard triomphait au contraire ; Zéphyrin n’avait d’attentions et de cajoleries que pour elle. Il s’était fait son premier écuyer. Madame Louchard était montée sur un âne d’un tempérament extraordinaire, qui voltigeait, galopait, caracolait à volonté ; un volcan, un amour d’âne.
À l’heure du dîner, on revint par la grande allée de la forêt ; tous les ânes, électrisés par leur écurie, allaient comme le vent. Madame Louchard était en tête, fendant les airs, échevelée, délirante ; Zéphyrin lui-même avait peine à la suivre. On criait : « Vive madame Louchard ! » quand tout à coup son âne fait un chassé-croisé, la selle tourne, et voilà la perle des amazones qui tombe à la renverse sur le gazon.
On la crut blessée ; mais elle n’était qu’émue. Dès qu’elle fut remise sur ses jambes, son premier mouvement fut de s’écrier d’un ton désespéré : — Et mon tour ! mon tour !
— Preuve qu’elle pense toujours à Zéphyrin, se dit Euphrosine.
Le tour était resté sous l’âne, qui se roulait sur le gazon.
On transporta madame Louchard à l’auberge du Tourne-Bride. Zéphyrin, qui voyait que son plus grand chagrin était de se sentir décoiffée, était déjà en fonctions, les manches retroussées, les pincettes en main. Toutes les jeunes filles étaient occupées à rendre la forme humaine au chapeau de madame Louchard.
— Ne craignez rien, dit Zéphyrin à l’infortunée corsetière, tout sera bientôt réparé, oh ! ma poule…
— Sa poule ! s’écrie Euphrosine sur le point d’éclater.
Zéphyrin lui marche violemment sur l’orteil :
— Aidez-moi donc au moins, lui dit-il en affectant de la brusquer, vous qui êtes là à me regarder les bras croisés… Tenez-moi cela… En même temps, il lui met dans la main un papier en forme de triangle, sur lequel elle jette machinalement les yeux.
Ô surprise ! ô joie ! qui l’eût pensé ? Ô sublime adresse d’une âme sensible, qui ne s’arrête devant aucune espèce de désagrément, d’abnégation ni de ficelle !
Euphrosine, transportée tout à coup du dernier paroxysme de la désolation au faîte de l’enchantement, a lu sur le papier triangulaire, destiné à former la plus belle papillote du tour de madame Louchard, ce proverbe, ce proverbe du bonheur qui la rend à la vie en lui expliquant de point en point la conduite du coiffeur :



CHAQUE OISEAU
TROUVE SON NID BEAU

 ne aigrette de fleurs à son chapeau, le matin est arrivé, d’un pas leste et le front joyeux, au sommet de la colline. Il regarde les maisons du village d’un air doux et bienveillant. Le coq, à son approche, s’est mis à chanter de joie. Toutes les fenêtres s’ouvrent ; celle de Colette n’est pas la dernière à fêter sa bienvenue. Colette aime à voir le matin, et le matin sourit à Colette ; n’est-elle pas la plus jolie comme la plus sage des filles de l’endroit ? Que de belles promesses, que de galants propos le maître du château a perdus en causant avec elle ! Colette est fiancée à Colin, elle ne veut pas d’autre mari que lui. En un tour de main sa toilette est achevée ; vermeille comme l’Aurore, elle paraît un instant, pour respirer la brise sans doute ; mais non, une autre croisée est ouverte depuis longtemps en face de la sienne. C’est le fiancé qui épie le réveil de la fiancée ; enfin elle se montre. — Bonjour, Colette ! — Bonjour, Colin !
ne aigrette de fleurs à son chapeau, le matin est arrivé, d’un pas leste et le front joyeux, au sommet de la colline. Il regarde les maisons du village d’un air doux et bienveillant. Le coq, à son approche, s’est mis à chanter de joie. Toutes les fenêtres s’ouvrent ; celle de Colette n’est pas la dernière à fêter sa bienvenue. Colette aime à voir le matin, et le matin sourit à Colette ; n’est-elle pas la plus jolie comme la plus sage des filles de l’endroit ? Que de belles promesses, que de galants propos le maître du château a perdus en causant avec elle ! Colette est fiancée à Colin, elle ne veut pas d’autre mari que lui. En un tour de main sa toilette est achevée ; vermeille comme l’Aurore, elle paraît un instant, pour respirer la brise sans doute ; mais non, une autre croisée est ouverte depuis longtemps en face de la sienne. C’est le fiancé qui épie le réveil de la fiancée ; enfin elle se montre. — Bonjour, Colette ! — Bonjour, Colin !
Le village a pris un air de travail et d’activité ; tout le monde en passant salue Colette ; le bouvier pique ses bœufs indolents, les faneuses se dirigent en chantant vers le pré, Colin conduit son blond troupeau en jouant de la musette.
Où vont ces deux moineaux tenant chacun un brin de paille dans leur bec ? Ils se posent dans une fente de mur, juste à côté de la fenêtre où Colette vient de suspendre une cage habitée par deux fauvettes.
Colette a mis tout en ordre chez elle. Frais réduit de la villageoise, comme vous êtes propre, comme vous êtes gai ! Elle-même, comme elle est heureuse en regardant son rouet, son vase de fleurs, son crucifix, et quelquefois aussi le miroir dans lequel se reflètent ses traits naïfs !
Pendant que Colette travaille et file sa laine, l’abeille butine sur le vase de fleurs, les fauvettes chantent dans leur cage, et les moineaux babillent sur le mur. Le ménage ailé s’est placé sur le rebord de sa demeure et semble appeler ses voisins ; les fauvettes avancent la tête hors de leurs barreaux, comme pour se prêter de meilleure grâce à la conversation. Que se disent-ils entre eux ?
Colette les comprend ; car Colette est filleule d’une fée. Elle peut parler avec les oiseaux, comme le Petit Chaperon Rouge s’amusait le soir à causer avec les rouges-gorges le long des buissons.
La fauvette disait au moineau :
— Regarde mon nid, comme il est gracieux et doux, suspendu entre ces deux bâtons qui soutiendront ma couvée ! Ce sont les doigts de Colette qui ont préparé la laine sur laquelle s’étendront mes petits. Je ne crains ni le hibou qui loge à ton côté, ni le chat qui rôde sur la gouttière, ni la pluie, ni l’orage, ni le vent. Il n’est pas de nid plus beau que le mien.
Le moineau répondait à la fauvette :
— J’ai ramassé les fleurs fanées que Colette laisse tomber chaque soir de ses cheveux, et avec leurs tiges entrelacées j’ai bâti mon nid ; je l’ai garni avec le duvet dont le printemps couvre les jeunes saules. C’est un abri sûr et impénétrable, d’où ma famille s’élancera pleine de force et de gaîté. Mon nid est celui d’un oiseau libre, il est plus beau que le tien.
Du haut du toit, une hirondelle éleva la voix :
— Vous ne savez ce que vous dites, gazouillait-elle aux fauvettes et aux moineaux. Mon nid est fait de ciment comme une forteresse ; les architectes les plus habiles n’ont rien à lui comparer pour la hardiesse de sa construction ; le soleil le dore le premier à son lever, et son dernier rayon s’arrête sur lui avec complaisance. Mon nid est le plus beau de tous les nids.
Colette écoutait tous ces discours en souriant.
— La fauvette, disait-elle, s’endort sur la laine que je lui ai préparée ; le moineau est fier parce qu’il cache sa couvée dans mes vieux bouquets ; l’hirondelle s’enorgueillit de sa citadelle aérienne ; mais ma demeure est bien plus jolie que leurs nids. Comme la lumière se joue gaîment au milieu de mes fleurs ! La vigne qui grimpe me fait un rideau de ses jets capricieux ; je vois la rivière qui coule à travers la claire feuillée, et le vent m’apporte avec le frémissement des arbres les sons de la musette de Colin. La fauvette, le moineau et l’hirondelle ont beau se vanter, ils ne sont pas mieux logés que moi.
Et Colette, jetant autour d’elle un regard de satisfaction, se tut pour écouter : c’était l’heure sans doute où Colin confiait à l’écho les accents de sa chanson amoureuse.
Mais la pauvre musette aura bien de la peine à se faire entendre aujourd’hui ! Le seigneur du village revient de la chasse ; les piqueurs crient, les chiens aboient, la fanfare retentit. Le seigneur est monté sur un magnifique cheval blanc ; une chaîne d’or brille à son cou, son œil est fier, et sa plume rouge flotte au vent.
Il s’arrête, comme d’habitude, sous la fenêtre de Colette, et pour la saluer il ôte son chaperon.
— Que faites-vous ainsi toute seule dans votre chambrette, la belle fille aux yeux bleus ? Ne vous ennuyez-vous point entre ces quatre murs tristes et nus ? Venez dans mon palais, je vous donnerai des pages ; je remplacerai par des perles les fleurs qui sont dans vos cheveux ; aujourd’hui vous n’êtes qu’une bergère, vous serez duchesse demain si vous consentez à quitter votre chaumière.
— Et pourquoi, répondit Colette, quitterais-je ma chaumière ? Non, Monseigneur, je la trouve plus belle que vos palais. À quoi bon les diamants, quand on a les fleurs de la prairie ? À quoi servent les titres, quand on a déjà le bonheur ? D’autres recevront avec plaisir vos hommages, elles seront heureuses et fières d’être duchesses ; moi je veux être toujours votre vassale, Monseigneur. Je viens de l’apprendre tout à l’heure, chaque oiseau trouve son nid beau ; moi, je dis comme les oiseaux, et je reste dans ma chambrette.
L’écho lointain répéta les sons d’une musette. On eût dit que Colin chantait pour remercier Colette.
Le seigneur s’était éloigné triste et baissant la tête, car il aimait la jeune fille.
La bergère descend pour se mêler aux danses qui terminent les travaux de la journée. Jamais le ménétrier n’a été plus en train. Voici l’instant où le danseur embrasse sa danseuse ; on s’arrête un instant, puis la danse recommence. Le gai ménétrier fait entendre une seconde fois le trille impératif ; il faut que tout le monde obéisse. La ronde villageoise a noué la main de Colette à celle de Colin ; elle rougit, son sein palpite ; le berger, non moins ému, presse doucement les doigts qu’on lui confie ; il l’entraîne sous l’ormeau, il lui peint son amoureux délire, il lui parle des dangers que l’amour du seigneur lui fait courir ; il est si pressant, si tendre, si éloquent, que la jeune fille ne lui répond que par des soupirs.
— À quand notre mariage, Colette ?
— À demain, Colin.
Dix heures sonnent à l’horloge de l’église. Les fauvettes se sont endormies sur leur édredon, les moineaux sur leur litière de fleurs ; l’hirondelle, pour être prête au premier signal d’alarme, montre sa tête vigilante au créneau de sa tour ; le hibou lui-même quitte à regret le nid qu’il aime pour effleurer les toits de son aile cotonneuse ; le repos descend sur le village. Après ce qui vient de se passer, la demeure de Colette lui semble encore embellie. Elle fait sa prière, et s’endort en pensant à son bonheur du lendemain.
L’essaim des songes heureux s’abat sur les chaumières ; tandis que les paysans dorment, le seigneur du village veille seul, et jetant un regard dédaigneux sur ses vastes appartements, que Colette n’a pas voulu habiter, il s’écrie : Sans elle, je ne pourrai jamais dire :


QUAND VIENT LA GLOIRE
S’EN VA LA MÉMOIRE

 e 14 août de l’an 1840, M. Jean-François-Claude Perrin, chef de la maison Jean-François Perrin, Dumolard et Cie, était dans un grand trouble et dans un grand émoi. L’honnête manufacturier n’avait pas dormi depuis trois nuits, et, dès l’aurore de cette fameuse journée, sa cuisinière l’avait vu se glisser dans son cabinet, déjà rasé, et portant la cravate blanche des solennités et l’habit noir des cérémonies, C’est que, ce jour-là, la destinée électorale de M. Jean-François-Claude Perrin allait se jouer au jeu du scrutin. Il s’agissait de vaincre ou de mourir ; de rester l’une des unités inscrites au grand livre des vingt-cinq mille adresses, ou d’être député ; de n’être rien ou d’être tout.
e 14 août de l’an 1840, M. Jean-François-Claude Perrin, chef de la maison Jean-François Perrin, Dumolard et Cie, était dans un grand trouble et dans un grand émoi. L’honnête manufacturier n’avait pas dormi depuis trois nuits, et, dès l’aurore de cette fameuse journée, sa cuisinière l’avait vu se glisser dans son cabinet, déjà rasé, et portant la cravate blanche des solennités et l’habit noir des cérémonies, C’est que, ce jour-là, la destinée électorale de M. Jean-François-Claude Perrin allait se jouer au jeu du scrutin. Il s’agissait de vaincre ou de mourir ; de rester l’une des unités inscrites au grand livre des vingt-cinq mille adresses, ou d’être député ; de n’être rien ou d’être tout.
Tandis que, pour la vingtième fois, il supputait les listes électorales, marquant à l’encre rouge les noms douteux, un domestique vint lui annoncer à voix basse, en homme qui comprenait toute la gravité des circonstances, que M. Dumolard, son associé, et deux messieurs demandaient à lui parler.
— Mais qu’ils entrent donc ! s’écria le candidat en s’avançant vers la porte. Eh ! c’est mon fidèle Achate, avec Buisson et ce cher Coustou, mes deux appuis dans le collége ! Est-ce à vous à vous faire annoncer ? Je croyais que ma maison était la vôtre.
— Excellent Perrin ! répondit Dumolard ; toujours le même ! Ah ! çà, mon cher associé, vous savez que c’est aujourd’hui que nous triomphons. Je viens de voir nos amis, j’ai réchauffé leur zèle ; nos chances sont excellentes ce matin.
— Les voix portées hier sur M. Bagou se porteront aujourd’hui sur vous, dit M. Coustou.
— Et vous serez nommé à une imposante majorité, s’écria M. Buisson.
— C’est à vous que je devrai mon mandat, dit alors M. Jean-François Perrin en serrant la main à ses amis.
En ce moment, madame Perrin entra chez son mari ; elle était suivie de mademoiselle Alphonsine Perrin, leur unique héritière.

— Eh ! bonjour, ma filleule, s’écria M. Dumolard ; venez vite embrasser votre parrain. Qu’elle est donc jolie, ma filleule ! On la prendrait déjà pour votre sœur, tant elle est embellie, ajouta-t-il en se tournant vers madame Perrin.
— Flatteur, dit la mère en minaudant.
— Ah ! ça, vous n’oubliez pas, reprit M. Dumolard, que vous dînez tous chez moi demain ? Mon neveu y sera ; mon gaillard est en train de finir son stage ; vous le pousserez, monsieur le député.
— Nous en parlerons ce soir ; car si nous dînons chez vous demain, vous dînez tous ici aujourd’hui.
Quelques électeurs entrèrent, et les dames Perrin s’esquivèrent.
— Le neveu Gustave y sera ; as-tu entendu, ma fille ? dit la mère.
— Oui, maman, répondit Alphonsine en baissant les yeux.
La rougeur qui se répandit sur son front révélait tout un secret de famille. Depuis longtemps les deux associés, Perrin et Dumolard, avaient conçu le projet de resserrer leurs liens commerciaux par une plus intime union ; les paroles étaient échangées ; et si les jeunes gens n’en avaient rien appris, il est permis de croire qu’ils l’avaient deviné.
À cinq heures, M. Dumolard entra d’un bond dans le salon de la famille Perrin.
— Victoire ! s’écria-t-il tout essoufflé. La nomination est enlevée à cent vingt-trois voix de majorité.
Ce furent pendant un quart d’heure mille embrassements, après lesquels M. Dumolard partit pour réparer sa toilette, toute ébouriffée par la bataille électorale. Mais, quand il revint avec son neveu Gustave, M. Perrin n’était plus au logis. Pendant l’absence de M. Dumolard, une lettre était arrivée en croupe d’un cuirassier ; cette lettre, émanée du sous-secrétariat du ministère de l’intérieur, invitait M. Perrin à passer sur le champ chez l’honorable chef de cette importante partie du service ; M. Perrin, à qui sa nouvelle position créait de nouveaux devoirs, n’avait pas cru pouvoir se dispenser de cette visite.
— Mais que contenait donc de si pressant ce billet ministériel ? demanda M. Dumolard déjà effarouché.
— Mon Dieu ! si je m’en souviens bien, reprit madame Perrin, le dernier paragraphe était à peu près conçu en ces termes : « Vous avez tracé, pour le quartier des Bourdonnais, un plan d’alignement qu’on dit fort ingénieux. Tout ce qui peut contribuer à l’assainissement de Paris m’intéresse à un haut degré. L’administration supérieure, qui s’occupe d’un plan général, serait heureuse de connaître celui qui a fait le sujet de vos études. Je vous attends ce soir chez moi à six heures ; nous causerons de son opportunité en dînant. Pas de refus ; c’est une affaire de service. »
— Et mon ami Perrin a accepté ? s’écria M. Dumolard.
— Sans doute. Ainsi que mon mari l’a dit lui-même, il se doit tout entier à ses commettants.
M. Dumolard ne répondit pas ; mais le dîner n’eut pas la gaité que promettait la suite d’une première victoire.
Le lendemain, M. Jean-François-Claude Perrin s’enferma seul dans son cabinet ; sa porte fut condamnée. À ceux qui venaient le demander le domestique répondait toujours que le député était en affaire. Or, cette affaire, qui prenait tout le temps de M. Perrin, n’était autre chose que l’élaboration du fameux plan d’alignement du quartier des Bourdonnais.
La veille, M. le sous-secrétaire d’État avait dit au nouvel élu, après avoir écouté les indications de son projet : « Monsieur Perrin, il y a des architectes qui seraient fiers de votre idée, et j’ai souvent demandé au ministre le ruban de la Légion-d’Honneur en faveur de gens qui avaient fait moins que vous pour le bien du pays. »
Vers midi, un cabriolet de place amena M. Dumolard devant la porte de la maison de la rue des Bourdonnais ; au même instant, un hussard, lancé au grand trot, passa sous la porte cochère, et remit au concierge un pli scellé de cire rouge. Le pli et M. Dumolard parvinrent ensemble dans l’appartement de M. Perrin ; mais le papier entra avant l’ami. Alors qu’il s’apprêtait à frapper au cabinet de son associé, M. Dumolard eut la mortification d’entendre celui-ci crier à son domestique : — Étienne, je n’y suis pour personne ; pour personne, comprenez-vous ?
M. Dumolard tourna les talons, et dégringola les degrés. Au même instant M. Perrin passa chez madame Perrin, le pli ouvert à la main. On éloigna les femmes de chambre, et une conférence conjugale s’ouvrit.
— Ma chère amie, dit le député d’un air joyeux, apprêtez votre plus gracieuse toilette ; nous assistons au concert que Son Excellence le ministre de l’intérieur donne ce soir.
— Ce soir ?
— Ce soir même, en famille.
— Mais, mon ami, nous sommes invités chez M. Dumolard, et nous avons promis.
— Sans doute ; mais je ne saurais vous répéter trop souvent ce que je vous ai déjà dit : je me dois à mes commettants. M. Dumolard soupe à huit heures ; qui est-ce qui soupe à cette heure aujourd’hui ? Un homme politique doit faire passer les affaires du pays avant ses plaisirs. Ce soir, pendant le concert, le ministre veut m’entretenir de mon projet. Vous le voyez, je ne puis pas me dispenser de me rendre à cette invitation. D’ailleurs, je viens de répondre à M. le sous-secrétaire ; il a ma parole.
— Alphonsine doit-elle nous accompagner ?
— Certainement. La femme du sous-secrétaire d’État veut absolument la conduire demain à l’Opéra, dans sa loge. Elle l’a vue une fois, et notre fille lui a plu au-delà de toute expression. « Si j’étais homme, m’a-t-elle dit, je ne voudrais pas d’autre femme. » En parlant ainsi, son regard s’est dirigé vers un de ses cousins, maître des requêtes au conseil d’État, M. de Cerny.
Ici la conversation fit un détour, et la communauté pesa les espérances qu’elle pouvait asseoir sur ce regard. Un post-scriptum de la lettre d’invitation, portant que M. de Cerny se rappelait au souvenir de l’honorable député, donna fort à réfléchir à M. et à madame Perrin ; et il fut décidé, à l’unanimité des voix, qu’Alphonsine serait bien plus heureuse sous le nom de madame de Cerny que sous le nom de madame Dumolard.
On fit appeler mademoiselle Alphonsine, et la nouvelle du concert lui fut annoncée ; les apprêts d’une toilette ministérielle réclamaient tout son temps et tous ses soins. Alphonsine battit des mains d’abord, puis le souvenir du dîner chez M. Dumolard lui traversa l’esprit.
— Mais l’invitation de mon parrain ? fit-elle observer.
— Ma chère fille, répondit M. Perrin, il faut savoir se soumettre aux circonstances. Je suis député, et je me dois à mon pays ; ce concert est une affaire. Et puis, ne vous l’ai-je pas dit ? je dois prendre jour avec Son Excellence pour présenter au Roi mon projet d’assainissement.
— Au Roi ! répétèrent les deux femmes ensemble.
— Oui, à Sa Majesté qui a bien voulu me faire féliciter sur l’excellence de mes idées. Nous serons portés, l’an prochain, sur les listes d’invitation aux bals de la cour.
À ces dernières paroles, madame et mademoiselle Perrin tressaillirent.
— Nous irons aux bals de la cour ! s’écria Alphonsine.
— J’en ai la promesse, dit M. Perrin d’un ton parlementaire. Ah ! ce sont de beaux bals ! On y rencontre les gens les plus distingués, ceux parmi lesquels je prétends te choisir un mari, ma fille.
Alphonsine rougit ; mais cette fois elle ne pensait plus à Gustave.
M. Buisson, qui demeurait à l’étage au-dessus, et qui était du dîner Dumolard, vint, sur ces entrefaites, s’informer si la famille Perrin était prête. Il insistait pour entrer.
— Mais c’est une tyrannie ! s’écria M. Perrin ; parce qu’on a bien voulu s’aider de leur concours pour emporter l’élection d’assaut, ces gens-là se croient tout permis. On n’est plus libre chez soi ! Dites à M. Buisson qu’il parte seul ; nous n’irons pas.
Après que M. Buisson se fut éloigné tout étourdi, M. Perrin se tourna vers sa femme et sa fille :
— Allez et hâtez-vous ; l’exactitude est la politesse des députés.
M. Buisson arriva, contrit et confus, chez M. Dumolard, qui déjà s’impatientait. À la première parole de son invité, M. Dumolard fronça le sourcil. — C’est impossible, dit-il.
Presque aussitôt, un domestique lui remit une lettre où M. et madame Perrin s’excusaient en trois lignes de ne pouvoir se rendre à son dîner. Le ministre les attendait, disaient-ils.
— Tiens, lis ! s’écria M. Dumolard en passant le billet à son neveu.
— C’est inutile, répliqua Gustave, j’en devine le contenu ; en voici la traduction libre :


DEUX MOINEAUX SUR MÊME ÉPI
NE SONT PAS LONGTEMPS UNIS.

 l y avait une fois, au temps où les animaux parlaient, dans une campagne toute parsemée de bosquets, aux bords de l’Euphrate, un jardin charmant qu’habitait une colonie de chardonnerets. Les fruits les plus savoureux, les baies les plus succulentes se mêlaient aux fleurs, et, sur l’herbe des prés, murmurait l’eau cristalline des fontaines.
l y avait une fois, au temps où les animaux parlaient, dans une campagne toute parsemée de bosquets, aux bords de l’Euphrate, un jardin charmant qu’habitait une colonie de chardonnerets. Les fruits les plus savoureux, les baies les plus succulentes se mêlaient aux fleurs, et, sur l’herbe des prés, murmurait l’eau cristalline des fontaines.
Un jour, un jeune chardonneret, qui était allé rendre visite à une alouette de ses amies, rencontra sur la lisière d’un bois un oiseau dont le plumage lui était entièrement inconnu.
Cet étranger était perché tout en haut d’un arbre, et regardait au loin dans les champs. Mille perles blanches constellaient sa robe brune, et, quand un rayon de soleil glissait sur ses ailes moirées, on voyait luire un éclair chatoyant comme le reflet d’une émeraude. Le chardonneret s’approcha à tire-d’aile du bel oiseau, et, l’ayant salué, lui demanda s’il ne pourrait pas lui être bon à quelque chose.
— Ma foi, vous me tirez d’un grand embarras, répondit l’autre ; tel que vous me voyez, j’arrive d’un pays lointain, et voilà vingt-quatre heures que je n’ai rien mis sous mon bec.
Le chardonneret invita poliment l’oiseau à déjeuner, et tous les deux prirent en l’air le chemin du beau verger.
Le chardonneret était fort curieux d’apprendre le nom et les aventures du voyageur ; mais, en personne discrète, il n’osait le questionner. L’oiseau n’imita pas cette réserve, et, chemin faisant, il ne se lassa pas d’interroger son guide sur les mœurs, les habitudes, le gouvernement de son peuple. Le chardonneret répondait à tout avec discernement et civilité.
Quand on fut arrivé au nid du chardonneret, l’étranger se mit à manger d’un si grand appétit que son hôte fut bientôt à court de provisions. Après avoir dépêché une dernière

— Voilà le meilleur déjeuner que j’aie fait depuis longtemps ! s’écria-t-il.
— Il ne tient qu’à vous d’en faire tous les jours autant, reprit le chardonneret ; vous n’avez qu’à vous établir dans ce canton.
— Si mes frères les étourneaux se doutaient des repas qui les attendent ici, je crois qu’ils ne demanderaient pas mieux.
— Ah ! vous êtes étourneau ?
— De père en fils. Je suis né en Germanie ; à six mois j’avais déjà vu la moitié de l’Europe. Me trouvant au bord de la mer, aux colonnes d’Hercule, j’ai profité de l’occasion d’un coup de vent qui m’a conduit dans l’île de Calypso ; là, je me suis marié. Ma femme étant morte au bout de cinq semaines, j’ai repris mon vol. En Égypte, je me suis rencontré avec une compagnie d’étourneaux en train de faire le tour du monde ; ils m’ont engagé à les suivre, et nous sommes partis il y a quelques jours. Quand vous m’avez aperçu, je prenais le frais en attendant l’occasion de prendre autre chose.
— Et vos camarades ?
— Ils font la sieste dans le bois. Venez avec moi ; je vous présenterai à toute la bande, qui sera enchantée de faire votre connaissance.
Le chardonneret n’avait jamais quitté ses bosquets ; il croyait que toute la terre ressemblait à ce séjour qui faisait partie jadis du jardin d’Eden, et qu’il n’y avait pas d’autre fleuve que l’Euphrate. Les discours de l’étourneau le remplirent d’étonnement ; les récits qu’il faisait des différentes contrées où habitent tant de races diverses, son langage pittoresque, les histoires merveilleuses qu’il racontait sur les mœurs, les goûts, les usages, les guerres, les amours de mille espèces d’oiseaux, inspirèrent au chardonneret le désir de retenir dans sa patrie de si gentils savants.
Il communiqua son projet à la tribu ; on discuta. Les vieux hochèrent la tête ; les jeunes crièrent à plein bec que les étourneaux donneraient à leurs enfants l’éducation qui leur manquait ; que ce serait pour tout le monde une grande joie d’entendre l’odyssée de leurs voyages pendant les longues soirées d’hiver ; que ceux qui ont beaucoup vu peuvent avoir beaucoup retenu, et que, par conséquent, la présence des illustres voyageurs assurerait la prépondérance des chardonnerets sur les pinçons, linots, mésanges et grives du voisinage. Cet avis prévalut, et on envoya une ambassade aux étourneaux pour les prier de s’arrêter aux bords de l’Euphrate.
Les étourneaux, étant quelque peu las, acceptèrent et se mirent en disposition de déménager du bois.
Cependant, quelques chardonnerets inquiets se rendirent chez une vieille pie qui avait bâti son nid dans un antique noyer.
Cette pie, qui datait du temps où les anges se promenaient sur la terre, passait pour sorcière dans le pays ; tous les oiseaux venaient la consulter, et ses prophéties n’étaient jamais démenties par l’événement. La pie s’assit à l’entrée de son nid, les deux pattes appuyées sur une béquille qui lui servait à marcher ; puis, ayant écouté les chardonnerets, elle caqueta cette réponse symbolique :
Ne sont pas longtemps unis.
Après qu’elle eut parlé, elle demanda deux douzaines de figues pour sa récompense, et rentra dans son domicile.
— Bon ! il s’agit de moineaux ! s’écria l’un des oiseaux ; ça ne nous regarde pas.
— Hum ! la lettre tue ! murmura un vieux chardonneret. Mais on ne l’écouta pas, et les étourneaux s’établirent dans le jardin des chardonnerets.
Pendant les premiers jours, tout alla pour le mieux ; les étourneaux racontaient leurs voyages ; on venait les entendre de tous les vergers, de toutes les prairies, de tous les bois d’alentour ; on ne se lassait pas de les écouter. Chaque soir, c’était un nouveau plaisir, et l’on dansait après. Mais, tandis que les discours allaient leur train, les vivres diminuaient à vue d’œil ; chaque étourneau mangeait pour trois chardonnerets.
Il fallut songer aux provisions ; les chefs de la tribu assemblèrent les plus forts, et on fut à la picorée ; celui-ci rapportait une prune, celui-là une cerise ; les plus vaillants traînaient un abricot. Pendant que la colonie s’épuisait en efforts, les étourneaux, qui restaient au logis, faisaient la cour aux plus jolies filles de leurs hôtes. D’étranges perturbations éclatèrent au milieu des nids; les chardonnerets s’en aperçurent, et prièrent les étrangers de voler aux champs avec eux.
Les étourneaux se mirent à siffler de toutes leurs forces ; les plus roués d’entre eux chansonnèrent les pauvres maris, et plus d’un chardonneret dut s’esquiver au milieu des éclats de rire.
En attendant, les déjeuners, les diners et les soupers allaient de plus belle. Tout ce que récoltaient les pauvres chardonnerets disparaissait à mesure. Quand les travailleurs rentraient le soir, ils trouvaient les étourneaux frais, reposés, la queue bien peignée, l’œil brillant, les ailes lustrées, jouant aux jeux innocents de buisson en buisson, avec leurs sœurs, leurs filles et leurs femmes. Ce spectacle leur déchirait le cœur.
Un jour, un des plus fougueux chardonnerets surprit un étourneau en conversation très-animée avec sa cousine, au plus épais d’une haie. Le chardonneret fondit sur l’étourneau, la cousine s’évanouit, et l’étourneau cria au meurtre ; ses camarades accoururent. Quelques chardonnerets vinrent au secours de leur ami. Personne ne voulait avoir tort ; plus on jacassait, et moins on s’entendait ; bientôt les injures volèrent de bec en bec, et les coups de pattes s’en mêlèrent. Les chardonnerets, depuis quelque temps, faisaient maigre chère, ils étaient fatigués ; ils furent battus.
En ce moment la vieille pie passait par là : — Tu l’as voulu, Georges Dandin ! dit-elle.
Les étourneaux chantèrent victoire, soupèrent gaîment, et se couchèrent dans les nids de leurs hôtes.
Mais, pendant la nuit, les chardonnerets, groupés sur un grand chêne, tinrent conseil. Il fut décidé qu’une députation serait envoyée au pacha qui gouvernait la province, avec prière d’expulser les étrangers. Ce pacha était un vieux grand-duc qui habitait le creux d’un sapin ; il était fort sage, fort expert, et ne se montrait presque jamais, à la manière des princes d’Orient. Après qu’il eut écouté la harangue des ambassadeurs, il fit appeler son connétable, et lui commanda de partir sur le champ avec un escadron de sa garde noire ; c’était le nom qu’on donnait à un régiment de merles, commandé par un fameux corbeau revêtu du haut grade de connétable.
Les merles partirent à tire d’ailes, guidés par les chardonnerets.
Quand leurs premiers rangs atteignirent le verger, les étourneaux dormaient encore. Les uns se laissèrent arrêter sans opposer de résistance ; les plus mutins furent garrottés ; et bientôt toute la bande, gardée à vue par les merles, prit la route des grandes forêts qui sont derrière l’Euphrate.
Mais, avant de quitter le verger, le connétable rassembla tous les chardonnerets autour de lui, et leur tint à peu près ce langage :
— Ô chardonnerets imprudents ! vous avez donc des oreilles pour ne pas entendre ! Souvenez-vous de la réponse de l’oracle. La pie ne vous a-t-elle pas dit :
Ne sont pas longtemps unis.
Ce qui s’applique aux moineaux s’applique aux chardonnerets, aux étourneaux, aux merles, à tous les oiseaux ; et ce qui s’applique aux oiseaux peut s’appliquer aux hommes nos ennemis !
Ayant ainsi parlé, le corbeau ouvrit les ailes et partit.


CHAT GANTÉ
N’A JAMAIS PRIS DE SOURIS

 e plus grand homme d’état, le ministre le plus profond et le plus habile des temps modernes, c’est sans contredit le Chat Botté.
e plus grand homme d’état, le ministre le plus profond et le plus habile des temps modernes, c’est sans contredit le Chat Botté.
Qu’est-ce qu’un ministre ? un homme qui conserve à son roi ou à son empereur ses états dans leur plus complète intégrité. Le Chat Botté fait mieux que cela ; il invente un royaume, il improvise un fief, ce fameux fief de Carabas ; il est à la fois Christophe Colomb et Olivarès ; et quelle modestie dans ses prétentions ! son portefeuille, c’est une paire de bottes.
L’histoire a été bien injuste et bien froide envers le Chat Botté. Perrault, son historien, n’a pas même introduit son portrait dans ses hommes illustres. Ce même Perrault, qui a reçu de la main de Nicolas Boileau tant de coups de griffes, termine ainsi l’histoire de cet idéal des chats : « Le chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir. » Un si grand chat méritait mieux que cette insuffisante conclusion. Quoi ! après qu’il a fait du fils du meunier un prince souverain, qu’il lui a constitué un marquisat avec tous les prés, champs, castels et bourgades qu’il rencontre sur sa route, y compris les gardes-champêtres ; après enfin que son maître est devenu le gendre du roi, deux lignes seulement sur la biographie future de cet immortel quadrupède ! Est-ce ainsi, je vous le demande, qu’on écourte l’histoire ? Ce Perrault mériterait d’être traité comme le fut Racine à l’époque d’Hernani.
Cependant, à force de fureter au milieu des souricières de la Bibliothèque du Roi, nous avons fini par arracher aux rats de la section des manuscrits quelques renseignements relatifs au Chat Botté.
Il est certain qu’il florit dans la seconde moitié du xviie siècle. Son maître, qui lui devait tant, l’avait comblé de biens ; et, quoiqu’à la cour de Louis XIV on n’aimât guère les bêtes, le roi l’y voyait toujours venir d’un bon œil. Il donnait lui-même des ordres pour qu’un Vatel (moins le suicide) préparât au maître chat un repas composé des plus délicieuses souris parmi celles qui commençaient dès lors à trotter dans les salles basses du château de

Le Chat Botté eut donc en partage une grande simplicité de manières, unie à beaucoup de prudence. Il transmit sa simplicité et ses bottes à son fils, lequel hérita à sa mort d’une immense fortune, accrue encore par de nouvelles donations faites par la famille des Carabas, la même qui vint s’éteindre sous la Restauration dans une chanson de Béranger.
Chat Botté fils continua à aller comme son père en bottes fortes, et sans que le régent songeât à s’en plaindre. Mais, sous Louis XV, il tomba en disgrâce complète, et le roi finit même par l’éloigner de sa cour et l’envoyer faire des rosières parmi les chattes de ses terres.
À quoi tiennent cependant les grandeurs humaines ! Savez-vous ce qui occasionna l’exil de notre héros ? Ce fut le duc de Richelieu. Le vainqueur de Mahon et de madame Michelin avait hérité de l’aversion insurmontable qu’avait toujours eue pour les chats son grand-oncle le fameux cardinal, qui n’avait absolument que cette faiblesse-là avec celle de la tragédie. Richelieu intrigua tellement auprès de mesdames de Châteauroux, de Pompadour, Dubarry, et de toutes les chattes successivement blotties sous les coussins du trône de France, qu’il obtint que le Chat Botté ne mettrait jamais la patte à Versailles.
À l’époque de la révolution, de nouveaux malheurs attendaient le descendant de l’illustre premier ministre du marquis de Carabas. Le château de Carabas fut jeté par terre ; on confisqua tout le domaine, et du même coup de griffe toutes les terres du chat, qui se trouvaient englobées dans le marquisat. On lui prit tout, fors ses bottes.
Mais avec des bottes on va loin, surtout une fois qu’on est placé sur la pente de l’exil. Le Chat Botté émigra ; il erra longtemps dans toutes les gouttières de l’Europe ; il fut réduit à d’étranges extrémités. Un certain jour, il se trouvait à Vienne, sur un toit ; il s’était assoupi doucement. Tout à coup, il sent autour de lui comme un tremblement de terre ; il entend un vacarme effroyable qui s’étend d’un bout de l’Europe à l’autre. Il aperçoit près du toit de l’exil où il est étendu une sorte de mât de cocagne ; il y grimpe pour observer l’horizon politique ; mais à peine est-il arrivé au sommet que le prétendu mât se met à gesticuler. Le chat s’aperçoit qu’il est juché au faîte d’un télégraphe, qui s’agite pour annoncer au monde entier que le général Bonaparte vient d’être proclamé Empereur des Français.
Ce que devint le Chat Botté sous l’Empire, on l’ignore ; il est probable pourtant qu’à titre de chat émigré il fut dans l’opposition. La Restauration arriva ; il eut sa large part dans le milliard d’indemnité ; on le réintégra dans tous ses biens ; mais il eut le bon esprit de vendre ses terres, qui faisaient partie du domaine de Carabas, de crainte de nouveau naufrage. Sentant sa fin prochaine, il acheta de la rente, et s’éteignit paisiblement entre les pattes de son fils, qui le miaula pendant plus de trois mois, et coucha dans la hutte d’un charbonnier en signe de deuil.
Cependant, dès que Chat Botté iii eut secoué son affliction, il résolut de faire danser les pistoles paternelles. Il donna, oreilles baissées, dans les spéculations ; il acheta des terrains à l’infini ; il prétendit que son père et que son grand-père, qui lui avaient laissé une immense fortune, n’entendaient rien à l’existence. Amasser une fortune, beau mérite ! Il faut savoir en user, en abuser même ; osons, spéculons, risquons, buvons, rions, chantons ! — Ainsi s’exprimaient en chœur le Chat Botté et ses amis.
Bientôt même il rougit de son nom de Chat Botté ; il prit en aversion ses bottes, ses bottes immortelles, l’origine de sa splendeur, la perle de son blason, que son père lui avait fait promettre à son lit de mort de ne jamais quitter. Il les quitta et prit tilbury ; dès lors, ce ne fut plus Chat Botté, ce fut Chat lion, Chat gant-jaune.
Il se jeta dans les folies les plus monstrueuses. Que vous dirai-je ? Il devint éperdument amoureux d’une petite chatte grosse comme le poing, douée, il est vrai, d’une queue blanche magnifique, et qui avait déjà ruiné trois angoras anglais. Il lui loua un vaste hôtel gris de souris ; les chambres à coucher, le salon, le boudoir, furent entièrement tapissés d’hermine. Jugez du reste d’après cela.
Enfin, ses yeux se dessillèrent ; il vit que cette chatte le trompait, et n’avait absolument d’affection que pour les fourrures dont il ne cessait d’entourer son âme égoïste et glacée. Les fourrures s’usèrent ; l’ingrate bayadère à la queue blanche déclara que son amour était usé aussi, et lui ferma sa porte.
Alors les malheurs se succédèrent ; il fut obligé de vendre son hôtel, de congédier ses gens, jusqu’à son secrétaire intime, le docte et littéraire Murr, qui l’endormait tous les soirs en lui racontant des contes fantastiques et complétement inédits, que lui donnait jadis à titre de gages son ancien maître, le fameux Hoffmann, qui l’avait eu longtemps à son service.
Quand il se vit dénué de tout, il alla frapper à la porte des anciens amis de son père ; plusieurs d’entre eux lui devaient leur fortune ; mais pas un ne voulut le reconnaître.
— Vous, le fils du Chat Botté, de ce chat de tant de bon sens et de finesse, qui attrapait tout le monde, et courait plus vite que tous ses rivaux et ses concurrents à l’aide de ses grosses bottes, toujours couvertes de poussière ! Où sont vos bottes ? Vous avez des gants à vos pattes de devant ; vous avez fait vernir vos pattes de derrière. Allez, allez, mon jeune gentilhomme, ce n’est pas en pareil équipage qu’on fait son chemin dans la vie !
Le pauvre chat était d’autant plus désespéré de ce qu’il entendait, qu’au milieu de ses désastres il tenait toujours à afficher une certaine élégance. Rentrer dans ses grosses bottes qui le rendaient souverainement ridicule jusqu’à la ceinture ! Ah ! plutôt la mort !
La mort ne vint pas, et l’argent non plus.
Le descendant des anciens serviteurs de la maison de Carabas tomba dans une telle détresse, qu’il lui fallut songer à entrer en condition. Il alla frapper à plusieurs portes ; il fit insérer dans les petites affiches : « Un chat pour tout faire, etc. » On lui proposa… devinez quoi ?
On lui proposa de se faire comédien, lui, le petit-fils du noble personnage qui avait eu ses grandes et petites entrées dans les souricières de Louis XIV !
Dans un de ces théâtres en plein vent d’origine napolitaine, qu’on voit s’élever dans la grande allée des Champs-Élysées, un de ces théâtres que Pierre Bayle et Charles Nodier affectionnaient tant, et que quelques-uns de leurs élèves ont égalé à Molière et à Shakespeare, le théâtre des marionnettes, enfin, pour parler sans métaphore ; ce fut là seulement que notre héros trouva de l’emploi. Le matou qui donnait la réplique à Polichinelle venait de mourir d’un coup de bâton, par trop paradoxal, que celui-ci lui avait appliqué. On proposa cette condition au pauvre chat, qui la refusa, ne voulant pas descendre à ce degré d’avilissement.
Il préféra se retirer fièrement dans un grenier ; et lui, qui était habitué à vivre d’alouettes, de grives, d’ortolans, il résolut de braver les coups du sort et de vivre, comme ses pères, de souris.
Mais, hélas ! il avait entièrement oublié le métier d’attrapeur de souris, qui exige plus de main d’œuvre et de pratique qu’on ne croit ; sa patte manquait d’agilité, sa griffe était rouillée. La famine lui pendait à l’oreille.
Il ne lui restait plus du mobilier de ses pères qu’une huche beaucoup trop rustique et délabrée pour qu’aucun brocanteur eût jamais daigné l’estimer ; elle remontait cependant à une haute antiquité. Le chat l’ouvrit et se coucha au fond, bien décidé à se laisser mourir d’inanition. Mais, comme il fermait les yeux, il avisa, à l’un des angles du meuble, les lignes suivantes griffonnées par son aïeul :
« 16… — Quand mon fils, petit-fils ou arrière-petit-fils, s’avisera « d’ouvrir cette huche, je crains bien qu’il n’ait pas trop à se louer de la destinée. J’ai cependant, durant toute ma jeunesse, dormi et couché dans ce vieux meuble qui appartenait au meunier, le père de mon maître ; et c’est là que j’ai ruminé le plan du fameux marquisat de Carabas, qui a fait notre fortune. Si mes enfants ou petits-enfants tombaient jamais dans le malheur, qu’ils sachent qu’il n’est pas de position, fausse ou désespérée, dont on ne puisse se tirer dans ce monde ; témoin cette huche dont je suis sorti, et dont ils peuvent sortir à leur tour, pourvu qu’ils méditent seulement sur cette simple phrase qui a toujours été ma devise :


PIERRE QUI ROULE
N’AMASSE PAS MOUSSE.

 ous est-il arrivé de rencontrer, sur les bords d’une route poudreuse, une claire fontaine ombragée de saules et de peupliers ? L’herbe qui croît à l’entour invite le voyageur fatigué à s’étendre ; le murmure de l’eau l’engage à se désaltérer ; la fraîcheur de l’ombrage lui fait oublier que sa demeure est encore loin, et peut-être qu’il n’a pas de demeure.
ous est-il arrivé de rencontrer, sur les bords d’une route poudreuse, une claire fontaine ombragée de saules et de peupliers ? L’herbe qui croît à l’entour invite le voyageur fatigué à s’étendre ; le murmure de l’eau l’engage à se désaltérer ; la fraîcheur de l’ombrage lui fait oublier que sa demeure est encore loin, et peut-être qu’il n’a pas de demeure.
La plus riante, la plus fraîche, la plus voluptueuse de ces oasis, s’élève à quelque distance de Séville. Quand vient l’époque des fêtes de la Giralda, qui se célèbrent chaque année dans cette ville, la fontaine del Pueblo est fréquentée par tous les marchands forains, piétons, saltimbanques, pipeurs de dés, étudiants, qui vont chercher fortune, et troubler l’eau des citadins pour y pêcher plus à leur aise.
Arrêtez-vous un moment devant cette champêtre Cour des Miracles ; prêtez l’oreille à la conversation de ces cinq ou six compagnons assis sur l’herbe ; elle doit être intéressante, à en juger par leur costume délabré et par leur physionomie originale.
— Parbleu, camarades, disait l’un des étrangers, puisque l’heure de la sieste est passée, et que par des raisons particulières nous désirons n’entrer dans la ville qu’à la nuit, que chacun de nous raconte aux autres son histoire ; cela nous aidera à passer le temps, et à regarder nos misères d’un œil plus philosophique. Si vous acceptez ma proposition, je donnerai l’exemple.
Celui qui parlait ainsi était un petit vieillard sec et maigre, à l’œil gris, à la physionomie burlesque ; son costume offrait un bizarre mélange de toutes les professions.
Ses compagnons n’étaient pas gens, comme on le verra par la suite, à refuser une telle offre ; on lui donna la parole avec empressement, et il commença en ces termes :
— Tel que vous me voyez, mes chers gentilshommes, je suis un personnage ; j’ai composé trois cents autos sacramentales, sans compter les comedias famosas. Mon nom a dû voler jusqu’à vous. Je suis le célèbre Miguel Zapata !

Il se fit dans l’auditoire un silence qui donnait un démenti formel aux prétentions du narrateur ; mais celui-ci prit ce silence pour un acquiescement, et il continua.
— J’ai toujours eu un penchant décidé pour l’art dramatique ; à seize ans je m’engageai dans une troupe de comédiens qui parcouraient la province. Je débutai dans la capitale de l’Estramadure avec un succès prodigieux ; l’Aragon ne me fut pas moins favorable ; j’étais l’idole du public et le soutien de la troupe.
La femme du directeur avait quelque penchant pour moi, et je faisais semblant de ne pas m’en apercevoir ; à cette époque, je recevais au moins cinq ou six visites de duègnes par jour, Cependant notre directeur mourut, laissant quelque vingt mille réaux à sa femme ; elle m’offrit alors de me mettre à la tête de sa troupe si je consentais à l’épouser ; j’acceptai par amour de l’art.
Investi des fonctions difficiles et importantes de directeur, je ne bornai pas ma tâche à la mise en scène des pièces, à la distribution des rôles ; je devins auteur moi-même, et j’ose dire que mes ouvrages ne furent pas médiocrement goûtés de la portion intelligente du public. L’autre portion s’obstinait, il est vrai, à les trouver froids et ennuyeux ; mais les suffrages des gens de goût me vengèrent. Cependant, nos recettes baissant, nous résolûmes de nous embarquer pour le Mexique, où l’art dramatique, disait-on, conduisait directement à la fortune.
Pendant la traversée, je fis ample provision de sujets que je comptais traiter selon le goût du Nouveau-Monde. Arrivés à Mexico, nous nous empressâmes d’annoncer nos représentations ; personne n’y vint. Les auto-da-fé et les processions nous faisaient une concurrence trop redoutable ; pour comble de malheur, ma femme me quitta pour suivre un Cacique converti, non sans enlever la caisse.
Depuis cette époque, je n’ai pas cessé un seul instant d’être malheureux ; j’adressai des petits vers aux maîtresses des grands seigneurs, qui ne les lurent pas ; je demandai l’aumône aux prêtres, qui me la refusèrent. Enfin un collecteur du fisc me prit pour domestique, et me ramena en Espagne. Une telle condition n’était pas faite pour moi ; je quittai le service, et je voulus remonter sur les planches ; mais on ne me trouva bon qu’à remplir le vil emploi de bouffon : c’est dans les rôles de gracioso que la vieillesse m’a surpris. Maintenant je ne puis plus trouver d’engagement ; ces oripeaux qui couvrent mon corps, derniers débris de ma garde-robe dramatique, sont tout ce que je possède ; je suis perdu si je ne trouve pas à Séville quelque âme charitable qui prenne pitié de moi. En attendant, je me suis arrêté ici pour faire la sieste, et pour rêver à la meilleure manière de sortir d’embarras.
— Ton histoire est un peu longue, digne Miguel Zapata, et tu aurais pu la résumer d’un seul mot, « comédien ambulant » ; nous aurions parfaitement deviné ton passé, ton présent et ton avenir. Puisqu’il faut, mes chers camarades, que je vous apprenne mon histoire, vous saurez que je me suis beaucoup battu, et que j’ai quelque peu écrit ; mes combats m’ont rapporté des blessures, mes livres m’ont valu la misère. Je suis poëte ; qu’est-il besoin de vous en dire davantage ? Je m’inquiète peu de l’avenir, je prends la vie comme elle est, les hommes comme ils veulent, le temps comme il vient, et je me suis arrêté ici pour faire la sieste en attendant l’heure d’entrer à Séville pour y demander l’aumône à la porte des églises.
La physionomie de l’interlocuteur était remarquable par un certain air de noblesse et de mélancolie ; son regard vif et perçant, sa bouche sardonique, sa parole mordante, annonçaient la supériorité d’une intelligence éprouvée. Soldat et poëte, comme il l’avait dit, il portait un justaucorps de buffle et un manteau d’étudiant, usés par de longs et pénibles services. À ses côtés était étendue une béquille qui lui servait à soutenir son corps affaibli par de nombreuses blessures ; un rouleau de papier sortait de ses poches, et sur les marges déjà jaunies on eût pu lire ce nom : Don Quichotte.
Quand il eut fini, un de ses voisins commença son histoire.
— Je suis né, dit-il, dans la ville d’Ormuz ; dès mon enfance, je désirai voyager sur mer ; c’est ce qui me fit donner le surnom de Syndbad le Marin. J’ai trafiqué avec tous les peuples, j’ai visité des pays inconnus au reste des mortels ; je rentrais dans ma patrie, maître d’une fortune considérable, lorsque le vaisseau qui me portait a fait naufrage en vue des côtes d’Espagne. Je n’ai pu sauver que ma vie ; toutes mes richesses ont été englouties. Je me suis arrêté ici pour faire la sieste, avant de me rendre à Séville et de voir si ses négociants, qui sont renommés par tout le globe, voudraient me placer à la tête d’une nouvelle expédition.
Le tour du plus jeune de la bande était arrivé. On voyait à la coupe de ses habits qu’il avait eu des prétentions à l’élégance ; la plume de sa toque était flétrie et brisée ; le velours de ses chausses montrait la corde ; il avait été obligé d’envelopper dans des espardilles ses souliers de satin crevés en maints endroits.
— Messieurs, commença-t-il, je suis Italien de naissance, et troubadour de mon métier. J’ai cru qu’avec une jolie figure, un cœur sensible, des talents, il était aisé de faire fortune. J’ai mis tout cela au service des femmes ; les unes ont aimé mes chansons, les autres ma jeunesse ; celles-ci m’accueillaient parce que je leur apprenais à danser, celles-là parce que je leur enseignais les belles manières ; je trompais les maris, et j’étais trompé à mon tour. L’Allemagne, l’Angleterre, la France, ont vu mes triomphes éphémères ; maintenant la fleur de ma jeunesse commence à se flétrir ; je suis connu, c’est-à-dire usé ; les châteaux se ferment devant moi. Il me restait à visiter l’Espagne ; c’est ce que je fais en ce moment. Je me suis arrêté ici pour faire la sieste et réparer un peu le désordre de ma toilette avant de gagner Séville, où j’espère trouver une femme qui m’aimera ; car on dit que les Espagnoles ont le cœur tendre.
Un cinquième compagnon allait prendre la parole, lorsqu’un inconnu, qui s’était approché de la fontaine sans que personne fit attention à lui, arrêta le narrateur à son début.
L’étranger s’appuyait sur un bâton long et noueux ; sa barbe descendait sur sa poitrine ; une espèce de caftan flottait sur ses épaules ; son front sillonné de rides se cachait sous un bonnet fourré ; des bottes de cuir flexible étaient fixées à ses jambes par des bandelettes rouges. Cet accoutrememnt fantastique donnait à l’homme qui le portait un aspect puissant et singulier qu’augmentait encore l’éclat bizarre de ses yeux. Tous les assistants le regardèrent avec étonnement.
Il commença par demander pardon à la société d’oser ainsi se mêler à la conversation ; il reprit ensuite :
— Comédiens, troubadours, négociants, poêtes, vous avez cherché la gloire, la fortune, l’amour ; vous n’avez rencontré que la misère : ceci prouve que pour être heureux il faut n’avoir point de désirs. Le ciel vous donnera peut-être un jour d’atteindre le but que vous avez poursuivi ; seul je vois toujours ma prière repoussée, et pourtant je ne demande que le repos !
Je suis le plus malheureux de tous ceux qui cherchent sur la terre ; permettez-moi à ce titre de vous offrir mes petits services. Voici cinq sous que je prie chacun de vous d’accepter ; si je pouvais m’arrêter plus d’un quart d’heure au même endroit, je vous donnerais davantage ; mais il y a longtemps que je parle, et il faut que je vous quitte sans délai.
Il s’éloigna en même temps, et au bout de quelques minutes on le vit disparaître à l’horizon.
— Miséricorde ! s’écria Miguel Zapata, ne touchez pas à ces cinq sous ; nous venons de voir le Juif Errant.
— Pour moi, je les accepte, reprit l’homme au manuscrit ; si c’est là le Juif Errant, il faut convenir que Dieu a bien fait de l’empêcher de s’arrêter plus d’un quart d’heure au même endroit, car c’est un métaphysicien bien ennuyeux. Puisque vous avez voyagé en France, ajouta-t-il en s’adressant à Joconde, vous devez avoir retenu un proverbe qui définit mieux notre situation que toutes les tirades de maître Ahasvérus.
— C’est vrai, répondit tristement le troubadour :


METS TON MANTEAU
COMME VIENT LE VENT

 our peu qu’on se soit promené sur le boulevard des Italiens, trois ou quatre heures par jour, pendant trois ou quatre ans, on ne doit pas manquer de connaître Paul Dufresny.
our peu qu’on se soit promené sur le boulevard des Italiens, trois ou quatre heures par jour, pendant trois ou quatre ans, on ne doit pas manquer de connaître Paul Dufresny.
Paul Dufresny demeurait rue Taitbout, à deux pas de ce boulevard, où il passait le plus clair de son temps ; il donnait le reste à ses plaisirs : si bien qu’il pouvait justement être cité pour le garçon le plus inoccupé d’une ville où il y a beaucoup d’oisifs. Mais c’était en outre un des jeunes gens les plus originaux qui fussent du Jockey-Club au Café de Paris.
Son père lui avait laissé une fort honnête fortune, trente à quarante mille livres de rente à peu près, et le titre de baron. Paul avait accepté l’héritage et refusé le titre. À ceux qui lui demandaient la raison de ce dédain, il répondait gravement que la qualité de baron n’allait qu’aux personnes douées par la Providence d’un gros ventre et de lunettes d’or. « J’ai le malheur d’être passablement maigre, ajoutait-il, et le malheur plus grand encore d’y voir très-bien. » La vérité est que Paul ne voulait pas d’un titre dont son père n’avait jamais pu lui expliquer clairement l’origine, le grand-père de Paul étant un riche armateur de Nantes, fort roturier de naissance.
M. Dufresny en agissait largement avec sa fortune. Quand on le faisait jouer, il jouait ; et, s’il perdait quelque argent, il n’y pensait guère. Ses chevaux étaient à tout le monde, et l’on ne pouvait pas dire qu’il eût rien à lui ; rien, pas même mademoiselle Florestine, coryphée de l’Opéra, qui l’honorait de son estime. Au demeurant, il mangeait bien, dormait mieux, riait au vaudeville, s’attendrissait au mélodrame, et trouvait dans un cigare l’oubli de tous les petits ennuis qui s’attachent aux pas des gens fortunés.
Un beau matin, le bruit se répandit que le notaire auquel Paul avait confié ses fonds s’était subitement enfui de Paris. Le soir même, en dînant au Café Anglais, Paul confirma cette nouvelle à ses amis.
— Que te reste-t-il donc ? s’écria l’un d’eux,

— Cinq à six mille francs que j’ai chez moi, et ma créance sur un débiteur insolvable.
— Diable ! mais c’est un coup terrible.
— Peuh ! on n’en meurt pas.
Paul dîna de fort bon appétit, et passa la soirée à l’Opéra.
Le lendemain, on apprit qu’il vendait tout, chevaux, voiture, mobilier ; et, vers cinq heures, on le rencontra au coin de la rue Laffitte, flânant les mains dans ses poches ; gants paille et bottes vernies avaient disparu.
— Ah ! ça, d’où viens-tu dans cet équipage ? lui dit un de ses camarades.
— De chez mademoiselle Florestine. Elle n’a pas voulu me recevoir, prétextant que ma vue la ferait fondre en larmes.
— L’ingrate !
— Bah ! les pleurs rougissent les yeux et gâtent le teint. Il faut bien que tout le monde vive !
— Et que comptes-tu faire ?
— Je pars demain. Dans ma jeunesse j’ai ouvert des livres de mathématiques ; il m’en reste assez pour monter, en qualité de lieutenant, à bord de quelque brick. J’ai réalisé vingt à vingt-cinq mille francs que je convertirai en marchandises, et je naviguerai.
— Toi ? toi, qui ne pouvais pas aller à pied jusqu’aux Champs-Élysées ?
— Oui, quand j’avais un coupé ; mais à présent que je n’ai rien, j’irai jusqu’au bout du monde à la voile.
Paul Dufresny tint parole. Il se rendit à Nantes, où les vieux armateurs se souvenaient encore de son grand’père. Il trouva bientôt à s’embarquer ; et le dandy, transformé en marin, partit pour le Brésil, à bord de la Jeune Adolphine.
Paul rencontra à Rio-Janeiro un ami de sa famille, qui était en marché pour acheter une sucrerie ; Paul vendit sa pacotille et s’associa au planteur. Trois jours après, il s’installa dans la campagne.
Les habitués du boulevard des Italiens rirent beaucoup à la réception d’une lettre où l’on remarquait ce passage : « Je fume des cigares de la Havane fabriqués à Rio avec des feuilles de tabac du Maryland ; j’ai un pantalon blanc, une veste blanche et des bas blancs, le tout en coton ; un chapeau de paille me défend des ardeurs de la canicule. Au Brésil, on ne connaît qu’un seul mois, le mois d’août. Il y a des instants où je passerais pour un vrai Paul si j’avais la moindre Virginie ; mais je n’ai autour de moi que des nègres : je les appelle tous Domingo. Ils plantent des cannes du matin au soir en chantant des ballades sénégalaises… Notre habitation ressemble à une décoration d’opéra-comique… Je dîne de perroquets et soupe de singes. J’apprends la langue franque… Quand j’aurai découvert une mine de topazes, j’enverrai à mademoiselle Florestine le collier de rubis que mon notaire m’a empêché de lui donner… S’il vous prend fantaisie de chasser aux alligators, venez me voir ; j’ai, dans mon parc, qui est une forêt vierge, une rivière où ils grouillent comme des goujons… »
Il y en avait dix pages sur ce ton-là.
Au bout de quatre ans, on vit arriver Paul à Paris. Son premier soin fut de se rendre au boulevard des Italiens. Il n’était pas changé, si ce n’est qu’il avait un peu bruni.
— Tiens, voilà Paul ! Paul le colon ! Paul le planteur ! s’écrièrent dix jeunes gens.
— Paul lui-même, répondit-il ; j’ai tiré une assez jolie fortune de mes cannes et de mes caféiers, et je me suis tout de suite souvenu du boulevard.
L’appartement de la rue Taitbout fut bien vite reloué et remeublé ; Paul reparut à l’Opéra, et mademoiselle Florestine lui écrivit, en style chorégraphique, qu’elle serait ravie d’entendre le récit de ses aventures.
Mais, sur ces entrefaites, le vent jeta à la côte le navire qui portait les richesses de M. Dufresny. Un correspondant avait négligé de les faire assurer. Tout était perdu.
Paul prit cette fois, comme la première, le parti de tout vendre, et, le soir meme, on le vit, en pantalon de gros drap, en blouse de toile, chaussé de lourds souliers garnis de guêtres de cuir, et coiffé d’un feutre gris à larges bords, se diriger vers les messageries Laffitte et Gaillard.
— Pars-tu pour les Grandes-Indes ? lui dit-on.
— Non ma foi, c’est trop loin ; je vais en Normandie gérer une terre qui appartient à un de mes oncles ; d’un planteur on peut bien faire un métayer.
Et, roulant autour de ses épaules une limousine à raies noires, Paul grimpa sur la banquette d’une diligence.
Il y avait non loin de cette ferme, aux environs de Caen, un château dont le propriétaire avait maintes fois soupé avec Paul à la suite d’un bal masqué. Un jour qu’il chassait à courre, la meute tomba sur un champ où deux charrues manœuvraient sous la direction d’un jeune agriculteur en sayon de velours. Le propriétaire eut quelque peine à reconnaître Paul.
— Que diable faites-vous là, mon cher ? lui dit-il en retenant son cheval empêtré dans les terres labourées.
— Eh ! mais, j’essaie deux extirpateurs de nouvelle invention. L’expérience a réussi ; je crois que je les adopterai.
— Quoi ! vous vous êtes fait agronome ?
— C’est la nécessité qui l’a voulu ; elle a parlé, et je me suis souvenu de Cincinnatus, répondit Paul. Faites place à mes bœufs, s’il vous plaît ; la chasse ne doit pas déranger l’agriculture.
L’oncle ne laissa pas longtemps son neveu dans la ferme. Jugeant de sa dextérité et de son jugement par ce qu’il avait fait au Brésil et ce qu’il faisait à la ferme, il le fit venir auprès de lui, à Rouen, et le mit à la tête de sa maison, en attendant que son fils aîné fût en âge de la diriger.
Un des amis de Paul, que le désœuvrement conduisait au Hâvre, passa par Rouen. La première personne qu’il rencontra sur le quai, ce fut Paul, un carnet à la main, surveillant le déchargement d’un navire ; autour de lui s’élevaient des barricades de caisses et de tonneaux. Le Parisien eut quelque peine à reconnaître le dandy. Paul avait coupé sa barbe et taillé ses cheveux ; un bout de plume passait entre sa tempe et son oreille ; sa toilette était propre, mais sentait la Normandie d’une lieue. Paul vit un sourire sur les lèvres du touriste.
— Parbleu ! lui dit-il, si tu veux te moquer de moi, ne te gêne pas ; je t’abandonne le négociant, le commerce n’a pas d’amour-propre.
L’oncle normand armait chaque année un ou deux baleiniers. Paul avait montré tant d’aptitude et de zèle, que l’oncle lui proposa de partir sur un de ces bâtiments pour la mer du Sud. Paul accepta ; c’était sa coutume. Dix à douze mois après, un de ses amis de Paris reçut, par la voie de Valparaiso, une lettre où on lisait entre autres choses : « J’ai vu le pôle Antarctique, où j’ai failli perdre le nez, tant il y faisait froid. Mon trois-mâts flâne dans l’Océan, à la poursuite des baleines qui s’obstinent à ne pas se montrer. La baleine est un mythe ; quant aux cachalots, on n’en voit plus que dans les dictionnaires d’histoire naturelle. Nous avons relâché aux îles Marquises, où j’ai mangé à table d’hôte de l’épagneul en salmis ; c’est fort bon. Je comprends maintenant pourquoi Dieu a donné le Kings Charles à l’homme… Dans ce pays-ci les sauvagesses font la sieste une moitié du jour, et lisent la Bible après. Durant cette première moitié, elles oublient ce qu’elles ont appris pendant l’autre… Je suis vêtu de peau comme Robinson Crusoe ; si je n’avais pas un oncle, je m’abandonnerais dans une île déserte pour mettre le roman en action ; il y a justement à bord un nègre qui me servirait de Vendredi… »
Après dix-huit mois de navigation, Paul revint au Hâvre, où il apprit que son ami du Brésil était mort du vomito-negro, non sans l’avoir institué son légataire universel. La sucrerie, les comptoirs et les marchandises valaient bien un million. Paul envoya sa procuration au consul français à Rio-Janeiro, et partit pour Paris après avoir remercié son oncle l’armateur.
La limousine et l’habit de peau avaient fait place au tweed.
— C’est encore Paul ! répétèrent ses amis quand ils le virent sur le boulevard des Italiens. Es-tu riche pour longtemps ?
— Qui le sait ? Mais si je me ruine encore, cette fois je prendrai un burnous et me ferai spahis. On n’est jamais perdu quand on sait


MOINE QUI DEMANDE POUR DIEU
DEMANDE POUR DEUX.

 rois personnes étaient réunies un matin, autour d’une petite table, dans un élégant appartement de la Chaussée-d’Antin : un monsieur d’âge mûr, le front chauve, une cravate blanche autour du cou et vêtu d’une robe de chambre à ramages ; une dame qui pouvait avoir de vingt-sept à trente-cinq ans, l’un ou l’autre, selon l’heure à laquelle on la voyait ; et un jeune homme mis avec une simplicité pleine de distinction. Ces trois personnes déjeunaient ; les tièdes rayons d’un soleil du mois de mai étincelaient sur les cristaux, qui renvoyaient des gerbes diamantées. Dans une chambre voisine, on entendait une voix claire et vibrante qui chantait sur divers tons :
rois personnes étaient réunies un matin, autour d’une petite table, dans un élégant appartement de la Chaussée-d’Antin : un monsieur d’âge mûr, le front chauve, une cravate blanche autour du cou et vêtu d’une robe de chambre à ramages ; une dame qui pouvait avoir de vingt-sept à trente-cinq ans, l’un ou l’autre, selon l’heure à laquelle on la voyait ; et un jeune homme mis avec une simplicité pleine de distinction. Ces trois personnes déjeunaient ; les tièdes rayons d’un soleil du mois de mai étincelaient sur les cristaux, qui renvoyaient des gerbes diamantées. Dans une chambre voisine, on entendait une voix claire et vibrante qui chantait sur divers tons :
Oh ! oh ! oh ! qu’il était beau,
Le postillon de Lonjumeau !
— Ce cher enfant ! il s’amuse, dit la dame en tournant vers la porte entre-bâillée un regard plein de sollicitude maternelle.
— Eh ! notre Alfred court sur ses onze ans, s’écria le monsieur. Tandis qu’il s’amuse, nous devons penser à son avenir ; il est temps d’y songer. Qu’en ferons-nous ?
— Faites-en un philanthrope, répondit le jeune homme.
— Un philanthrope ? dit la dame en lançant un regard interrogateur.
— Eh ! ne voyez-vous pas, ma chère Hortense, que Georges en veut toujours à ce digne M. de Suriac, dont je lui citais tout à l’heure les admirables traits de charité.
— Une charité qui ne l’empêche pas de vivre en un fort bel hôtel.
— Ne voulez-vous pas que, par bonté d’âme, il se loge dans un grenier ? Mais tenez, j’ai justement à parler à M. de Suriac pour affaire qui concerne le bureau de bienfaisance de son arrondissement ; accompagnez-moi dans ma visite ; vous verrez cet honnête homme, vous l’entendrez et le jugerez mieux.
— Soit, dit Georges, je ne serai pas fâché de voir la philanthropie dans son intérieur.
M. et madame de Plantade se levèrent de table, la dame

M. de Plantade laissa sa femme au salon chez madame de Suriac, et pénétra, avec son neveu, dans le cabinet du mari.
Ce cabinet, grand et bien aéré, avait vue sur un jardin planté d’arbustes exotiques et de magnifiques tilleuls. Tout autour de l’appartement s’élevaient des casiers remplis de cartons, et sur les murs, tapissés d’une étoffe brune, on voyait divers plans d’édifices et des vues de monuments d’un aspect sévère. M. de Suriac se tenait assis derrière un bureau à cylindre surchargé de paperasses et de dossiers. C’était un homme encore vert, portant lunettes ; sur son habit noir brillait la rosette d’officier de la Légion d’Honneur.
— Toujours occupé ! dit M. de Plantade en entrant.
— Eh ! mon Dieu ! il le faut bien ; la misère est si grande cette année que toutes mes heures sont dues à nos pauvres. Je rédigeais un mémoire au ministre pour solliciter l’établissement d’une maison de secours en faveur des femmes de chambre sans emploi. À quels dangers ne sont pas exposées ces infortunées dans une ville où la corruption fait chaque jour de nouveaux progrès !
— Ce sera une bien sage institution, dit Georges gravement.
— M. de Plantade, à qui j’en ai parlé, pourra vous en faire apprécier l’importance. Mais puisque vous vous intéressez à ces matières, permettez-moi, Monsieur, de vous faire hommage d’un volume que j’ai naguère publié sur l’utilité d’une maison de refuge pour les postillons mis à la réforme par les chemins de fer.
— Je le lirai avec d’autant plus d’intérêt que le ministre, jugeant de son mérite par votre réputation, en a fait prendre, je crois, pour toutes les bibliothèques du royaume.
— Oui, Monsieur, le garde-des-sceaux, M. le ministre de l’Intérieur et celui des Travaux Publics en ont pris deux mille exemplaires. S. M. elle-même a bien voulu souscrire pour les châteaux royaux.
— En vous donnant quinze mille francs on n’a pas même payé le premier chapitre de cet excellent travail, dit Georges toujours sérieusement.
M. de Suriac sourit et s’inclina.
— C’est à peine si j’aurai le temps de terminer le travail dont je vous parlais tout à l’heure, reprit M. de Suriac ; le gouvernement vient justement de me charger d’une mission en Hollande pour étudier le système pénitentiaire de ce royaume, et à mon retour je devrai me rendre dans le Périgord, où s’élève en ce moment une maison de détention dont j’ai fourni les plans. J’en surveillerai les travaux.
— N’avez-vous pas par là un beau domaine ? demanda Georges d’un petit air innocent.
— Un modeste manoir qui avait jadis appartenu à ma famille, et que j’ai racheté avec mes économies ; c’est la dette du souvenir.
Quand l’affaire du bureau de bienfaisance fut terminée. M. de Plantade fit demander sa femme.
— Eh bien ? ma tante, dit Georges, que vous a donc appris madame de Suriac ? Si elle partage les goûts de son mari, j’imagine que vous devez être édifiée.
— Elle m’a proposé des billets pour un bal par souscription qu’elle organise au profit des réfugiés Monténégrins. J’en ai pris trois.
— Et vous avez bien fait, Hortense ; ah ! si toutes les familles suivaient l’exemple de ce digne ménage, il n’y aurait plus ni pauvres ni criminels en France !
— Mais, mon oncle, s’il n’y avait plus de pauvres et plus de criminels, il n’y aurait plus ni maisons de refuge, ni prisons. Que deviendraient les inspecteurs ? Ceci ne ferait pas le compte de M. de Suriac.
— Quoi ! ce que vous avez vu ne vous a pas converti ?
— Ma foi, j’ai vu une foule de cartons et de tiroirs tout cousus d’étiquettes : Mémoires sur les inondés Des Deux-sèvres… Maisons cellulaires… Système de Pensylvanie… Suppression de la gélatine… Quêtes à domicile… Hospice pour les orphelines de la Sarthe… Réforme dans le régime alimentaire… Souscriptions diverses… Plan d’un pénitencier modèle… Recherches sur l’emploi du navet et de la carotte substitués au riz… Préau d’aliénés… Pétitions à examiner… distributions de comestibles… Mémoires sur l’établissement d’un chauffoir public… J’ai vu bien d’autres choses encore ; mais j’ai vu aussi que M. de Suriac ne marche qu’en coupé, qu’il a vingt-quatre mille francs sur le budget à divers titres, qu’il achète par-ci par-là une ou deux terres, et qu’il mange, le pauvre homme, dans de la porcelaine de Chine. Quant à sa femme, elle ne saurait porter une robe si elle n’était de velours ou tout au moins de satin ; c’est apparemment pour faire en plus galant équipage les honneurs de ses bals charitables.
M. de Plantade ne répondit rien ; mais, prenant le bras de sa femme, il l’entraîna vivement après avoir lancé un regard furibond à son jeune parent.
La plupart des personnes qui auraient entendu Georges auraient fait comme M. de Plantade. En vingt endroits la réputation de M. de Suriac était solidement établie ; on en parlait comme d’un homme austère, grave, voué dès sa jeunesse à l’étude des plus sérieuses questions sociales, qu’on était sûr de rencontrer à la tête des fondations utiles et des comités philanthropiques. Cependant, quelques personnes gangrenées par l’incrédulité du siècle hochaient la tête à cette renommée de vertu ; l’association du dévouement et du luxe, de la richesse et du désintéressement, leur paraissait tout au moins douteuse.
À quelque temps de là, on apprit que madame de Suriac, en l’absence de son mari, avait fait renouveler le mobilier de son hôtel.
— Un bienfait n’est jamais perdu, dit Georges. Voilà ce que c’est que d’organiser des concerts au profit des vignerons grelés.
— C’est bien la peine de médire, s’écria M. de Plantade ; ne sait-on pas que M. de Suriac s’est intéressé dans une entreprise de fers galvanisés qui rapporte de beaux bénéfices ?
— Vraiment, je suis heureux d’apprendre que M. de Suriac possède une de ces charités qui ne vont pas jusqu’à proscrire la spéculation.
M. de Plantade lui tourna le dos.
Un peu plus tard, M. de Suriac se rendit acquéreur d’une ferme en Beauce. Cette acquisition suivit de près la fondation d’un comité central pour les secours envoyés à de certains incendiés du Languedoc.
— Il est avec la philanthropie des accommodements, dit Georges tout bas.
— La belle affaire ! Ignorez-vous qu’une partie des fonds de M. de Suriac était placée sur les actions du chemin de fer d’Orléans ? Faut-il que lui seul ne profite pas d’une hausse ?
— Sans doute ; charité bien ordonnée commence par soi. M. de Plantade donna un furieux coup de canne contre un meuble, et sortit.
Un peu plus tard encore, après l’adoption par le ministère d’un système de réforme philanthropique applicable aux maisons de détention, et imaginé par M. de Suriac, on vit l’ingénieux réformateur acheter un hôtel dans la Chaussée-d’Antin. Pour le coup, M. de Plantade ne chercha point à dissimuler son étonnement.
— Je ne le savais engagé dans aucune spéculation, dit-il.
— Bah ! répondit Georges ; de l’aisance à la fortune le plus court chemin est la charité.
— Ne raillez pas, mon cher ; cet achat me surprend surtout dans les circonstances actuelles ; M. de Suriac se plaignait à moi dernièrement de n’avoir plus même un billet de cinq cents francs disponible pour les besoins du bureau de bienfaisance dont il est un des administrateurs. Je sais encore que tout son temps était pris par les conférences auxquelles a donné lieu son projet de réforme pour lequel il a sollicité une allocation de huit cent mille francs à un million.
— Qu’il a obtenus ?
— Sans doute. Mais pourquoi riez-vous ?
— Oh ! pour peu de chose. Cette sollicitation charitable me rappelle un vieux proverbe espagnol que voici :


Z’AFAI CABRIS
C’E PAS Z’AFFAI MOUTONS.[1]

Monsieur et cher époux,
 e ne sais s’il ne vous semblera point fâcheux de recevoir, après un long silence, la marque d’un souvenir que vous semblez vouloir détruire par les preuves réitérées de votre indifférence. Depuis plus d’un an, reléguée par vos ordres dans une retraite qui serait un paradis si vous la partagiez avec moi, je n’ai point osé vous importuner de mes lettres. Je m’y vois aujourd’hui forcée par les circonstances, et vous m’excuserez d’y avoir cédé.
e ne sais s’il ne vous semblera point fâcheux de recevoir, après un long silence, la marque d’un souvenir que vous semblez vouloir détruire par les preuves réitérées de votre indifférence. Depuis plus d’un an, reléguée par vos ordres dans une retraite qui serait un paradis si vous la partagiez avec moi, je n’ai point osé vous importuner de mes lettres. Je m’y vois aujourd’hui forcée par les circonstances, et vous m’excuserez d’y avoir cédé.
Madame T…, dont vous n’avez peut-être pas oublié le nom, et qui a donné à mon éducation tant de soins dévoués, est en ce moment privée de son fils unique. De mauvais conseils et de pernicieuses liaisons ont égaré ce jeune homme. Enfin, tout dernièrement, pressé par le besoin aussi bien que par un désir insensé d’échapper aux remontrances de sa famille, le malheureux s’est engagé, sous un nom supposé. Après beaucoup de recherches, sa mère et ses amis ont pu retrouver ses traces ; et l’on a su que le recruteur auquel il s’est vendu pour quelques écus, appartenait au régiment que vous tenez de la bonté du roi.
À cette nouvelle, madame T… n’a pas douté un instant que son fils ne lui fût rendu. Elle est venue de sa province éloignée se jeter à mes genoux, et je ne saurais vous rendre les paroles touchantes qu’elle a fait entendre à son ancienne élève. Les larmes vraies dont elle les accompagnait ont pénétré mon cœur, et je me suis dit que bien certainement elles trouveraient accès dans le vôtre. Il ne s’agit, à ce qu’il paraît, que d’un engagement à déchirer ; et la circonstance du nom supposé, rend encore plus facile cette bonne action qui dépend de vous, de vous seul.
Je n’ai pas cru m’engager trop, au vis-à-vis de la mère éplorée, en promettant que vous l’aideriez, sur ma prière, à réparer le coup de tête de ce jeune insensé qu’elle aime plus que la vie. Songez, Monsieur, que par cet acte si juste en lui-même vous me donnez le moyen d’acquitter une

Puisse votre réponse ne pas me dire trop brièvement que mon humble requête a trouvé grâce devant vous !
Je suis désespéré, Madame, que le service du roi ne me permette pas de rendre libre le jeune homme auquel vous voulez bien prendre intérêt ; mais il serait mon parent, que je ne saurais prendre cela sur moi, maintenant surtout que l’engagement est sorti de mes mains pour passer dans les bureaux du ministre.
Croyez à tout le regret que j’ai d’être obligé de vous refuser, et à toute ma reconnaissance pour les sentiments exprimés dans votre lettre. Ils se retrouvent naturellement dans le cœur
La presante, chaire camarade, ait pour te dire comme quoi mon povre jeune homme que tu sais a eu l’enfantiage de se lesser raccoler par désespoir, vu qu’il n’avet plus le çou, et qu’il étet toujour de plus en plus amoureux de moi. G’oret pu fère demandé sa grasse au marki de C… son colonel par mon filosofe amériquain auquel je suis attachée, mais ça lui depleret, à sept homme, tout filosofe qu’il ait. Toi qui ait si bonne camarade, tu oras du marki colonel tout ce que tu voudra, car il eme les demoiselles ; et je te seré toujour reconnaissante, a jamais et pour la vie, si tu otes mon povre petit de la peine où il ait, dont voici le nom de son regiman au bas de la page. Il t’interaiseret si tu le connesset, ce cher ami, tendre, elevé, charman et toujour enchanté. Dans l’aucasion, tu peux ocy compter sur la pareille, comme cela se doigt antre amies. Je t’embrase de cœur, mille, mille et cent fois.
On dit que vous êtes plein de sentiment, monsieur le marquis, et je vous ai toujours distingué de ces êtres machines qui tourbillonnant, bourdonnant autour de moi, sans cesse m’obsèdent. Vous comprendrez donc l’intérêt que je porte à un jeune homme de mes parents qu’on veut emmener dans les armées. Je suis cause de sa perte, vu que ses sentiments pour moi l’ont égaré à s’enrôler depuis un mois dans votre régiment sous le nom de Valentin, qui n’est pas le sien. Voyez donc le joli soldat que vous auriez, amoureux à n’en pouvoir plus, et qui déserterait comme l’Alexis de M. Sedaine. Allons, monsieur le marquis, rendez-le moi de suite, ce pauvre garçon. Vous ne trouverez pas toujours une aussi belle occasion d’obliger une petite personne dont l’ingratitude n’est pas le péché mignon, et qui sera heureuse de vous montrer la reconnaissance avec laquelle elle ose se dire, en attendant mieux,
Manon, Manon, je suis libre : la grâce a touché mon farouche colonel. Il avait refusé à la marquise, sa femme, d’annuler mon engagement, et je croyais t’avoir à jamais perdue, lorsque hier, par son ordre, un sergent m’a conduit à son hôtel. Je soupçonne que tu sais déjà la scène de comédie, où j’ai dû jouer, impromptu, le rôle le plus bizarre.
Le marquis était, en négligé du matin, dans un petit salon, derrière sa chambre à coucher : près de lui, sur un fauteuil, une petite femme, qui tournait le dos à la porte, et dont je n’apercevais d’abord que les mules de satin rose. Pardonne, Manon : je crus un instant que c’était toi ; mon sang bouillonnait déjà dans mes veines, quand cette jolie personne se leva pour accourir au-devant de moi, et ne m’offrit qu’un visage inconnu :
— Mon cousin, me dit-elle, je n’ignore pas que je suis pour beaucoup dans le mauvais parti que vous avez pris et qui désolait notre famille. Je me suis crue obligée de réparer le mal que j’avais fait sans le vouloir ; et j’y suis parvenue grâce à la générosité de monsieur votre colonel. Cédant à mes instances, il m’a rendu ce papier que je vous rends à mon tour, en vous priant de ne pas me forcer à vous racheter une seconde fois.
Pendant ce discours, où je ne comprenais goutte, et qui égayait visiblement le colonel, j’ai dû faire une mine des plus hébétées et des plus tristes. Aussi, ma cousine m’a-t-elle tourné le dos avec un sourire de pitié, tandis que le marquis me congédiait, ce qu’il a fait de très-bonne grâce, en me reconduisant jusqu’à la pièce voisine. Là il m’a dit à demi-voix :
— Ne vous désolez point trop, Monsieur. Vous êtes plus aimé que moi. Cela suffit pour que je ne sois pas longtemps votre rival. Ne m’en veuillez pas d’avoir profité de mes avantages, et, en échange de la liberté que je vous rends, laissez-moi espérer de vous un léger service.
Madame votre mère et la marquise m’avaient demandé sans l’obtenir ce que j’accorde à mademoiselle votre cousine… Ceci tient uniquement, je vous prie de le croire, au talent avec lequel cette aimable personne rédige ses placets et fait valoir les causes dont elle se charge… Mais comme ma complaisance pour elle serait peut-être mal interprétée, vous m’aiderez à persuader votre mère que je vous rends à elle… et à son élève.
J’ai tout promis, comme tu peux le penser, sans faire part au colonel de toutes mes conjectures et de toutes mes réflexions. La plus sérieuse que m’inspire cette folle aventure est que chacun ici-bas a son talent, son petit savoir, et doit s’occuper des affaires où ils sont de mise. Madame la marquise a bien des vertus ; mais si je n’avais pas eu de meilleures protectrices, j’allais tout droit au régiment. Pour servir dans l’occasion un mauvais sujet de mon espèce, rien ne vaut des femmes comme vous. Au revoir, ma Terpsichore !


EN LA MAISON DU MÉNÉTRIER
CHACUN EST DANSEUR.

 fortune ennemie ! quand cesseras-tu de me poursuivre ? Et toi, Terpsichore, si jamais mes entrechats te furent agréables, si jamais tu daignas sourire à mes pirouettes, prends en pitié un de tes plus fidèles serviteurs. Depuis le jour fatal où l’imprudence d’un machiniste de province me précipita du haut de l’Olympe et me rendit boiteux, cette affreuse déesse qu’on nomme la débine n’a cessé de me poursuivre. J’ai dû dire adieu à la danse, au public, et surtout aux engagements de dix mille francs. Je ne danse plus, et je suis forcé de faire danser les autres ; j’étais dieu, et je suis devenu ménétrier ; je racle des contredanses pour un orchestre de barrière, à trente francs par mois. Heureux encore si cette ressource me restait ; mais l’infâme directeur du Bal d’Idalie vient de faire banqueroute, il s’est enfui en emportant la caisse ! Deux mois d’appointements me sont enlevés ; qu’allons-nous devenir ? »
fortune ennemie ! quand cesseras-tu de me poursuivre ? Et toi, Terpsichore, si jamais mes entrechats te furent agréables, si jamais tu daignas sourire à mes pirouettes, prends en pitié un de tes plus fidèles serviteurs. Depuis le jour fatal où l’imprudence d’un machiniste de province me précipita du haut de l’Olympe et me rendit boiteux, cette affreuse déesse qu’on nomme la débine n’a cessé de me poursuivre. J’ai dû dire adieu à la danse, au public, et surtout aux engagements de dix mille francs. Je ne danse plus, et je suis forcé de faire danser les autres ; j’étais dieu, et je suis devenu ménétrier ; je racle des contredanses pour un orchestre de barrière, à trente francs par mois. Heureux encore si cette ressource me restait ; mais l’infâme directeur du Bal d’Idalie vient de faire banqueroute, il s’est enfui en emportant la caisse ! Deux mois d’appointements me sont enlevés ; qu’allons-nous devenir ? »
Ainsi parlait le père Pastourel en se laissant tomber dans son vieux fauteuil ; d’un geste désespéré, il lança son violon sur son lit, et l’instrument rendit un sourd murmure comme pour se plaindre. Pastourel croisa ses bras contre sa poitrine, ramena sur ses genoux les vastes pans de sa redingote, et darda contre le ciel un regard menaçant. Après quelques minutes de cette pantomime antique, il parcourut sa chambre à grands pas ; puis il s’arrêta en disant : « Je casserais bien une croûte.
« Mais, hélas ! je suis sûr qu’il n’y a rien à la maison ; cherche dans tes armoires, malheureux, tu n’y trouveras que le vide ; contemple ton foyer, misérable, il ne contient que des cendres. Et que vont dire Fanny et Irma quand elles rentreront ? J’avais promis de les régaler aujourd’hui d’une tourte aux boulettes et d’un flan au café ; ô espérance folle ! ô bizarrerie de la vie ! ô vengeance du sort ! la tourte court sur la route de la Belgique, et le flan est tombé dans le gouffre du déficit. Après tout, elles feront comme moi, puisque, malgré mes conseils, elles veulent devenir artistes. Pourquoi n’ont-elles pas suivi l’exemple de leur frère, de ce bon Joseph, qui fera, j’en suis sûr, un excellent menuisier, et qui deviendra le soutien de son père ! »
Des pas légers se font entendre à la porte du grenier ; elle s’ouvre, c’est Irma et Fanny qui entrent. Chapeau de paille, tartan, cabas, robe d’indienne frangée de boue, vous les reconnaîtriez entre mille ; ce sont des élèves du cours de danse de l’Opéra ; deux petites filles, à l’œil vif et mobile, à la bouche fine et délicate, charmantes souris qui brûlent de grandir et de montrer dans les coulisses leur museau de rats.
Elles se jettent au cou de leur père ; puis quand elles ont déposé et chapeau, et tartan, et cabas, dans leur chambrette, elles se disent qu’il est temps de mettre le couvert. L’une apporte la nappe, l’autre les assiettes ; en un clin d’œil la table est prête. Fanny a une faim de loup, Irma un appétit violent. — Où avez-vous mis la tourte aux boulettes, bon papa ? — Qu’avez-vous fait du flan, petit père ?
Figurez-vous la situation du pauvre Pastourel ; pour moi, je n’ai pas le courage de vous la dépeindre.
Il fallut bien cependant raconter et la fuite du directeur, et la perte des appointements, et l’absence forcée de comestibles qui en résultait. Quand Pastourel eut achevé ce menu, les deux jeunes filles se regardèrent.
— As-tu encore faim, Fanny ?
— Non, je m’étais trompée ; la faim m’a passé. Et toi, Irma ?
— Ma migraine m’a repris ; il me serait impossible de manger.
Pastourel s’approcha de la fenêtre pour essuyer une larme ; il était sensible, quoique danseur.

Les croisées situées au fond de la cour étaient ouvertes aussi ; l’une était traversée par une guirlande de fleurs artificielles ; à l’autre on voyait flotter du linge qui séchait au soleil : une fleuriste et une blanchisseuse habitaient les modestes mansardes qui regardaient celle de Pastourel. L’heure du repas était arrivée, et les deux ouvrières, assises devant une table proprette, mangeaient du meilleur appétit. À ce spectacle, Pastourel ne put s’empêcher de faire un triste retour sur lui-même. Il appela ses filles.
Fanny appuya sa joue sur l’épaule de son père, et passa son bras autour de son cou ; Irma en fit autant de son côté.
Un poète aurait comparé Pastourel à un vieux cocotier entouré de lianes flexibles ; un peintre se serait arrêté pour dessiner ce groupe, dont nous nous bornons à indiquer la grâce.
— Si tu avais voulu, Fanny, dit le vieux danseur à sa fille en lui montrant la fleuriste, tu serais une ouvrière laborieuse, gagnant de quoi dîner tous les jours, et de quoi acheter une robe de soie pour le dimanche.
En même temps, le père Pastourel soupira.
— Et toi, Irma, continua-t-il, n’envies-tu pas le sort de cette gentille repasseuse ? Elle n’est pas obligée de se contenter d’une migraine pour dîner. Écoutez mes conseils, enfants, pendant qu’il en est temps encore : tous les beaux-arts de la terre ne valent pas un bon métier. Quelle jolie fleuriste tu serais, Fanny ! Et toi, Irma, quelle charmante blanchisseuse ! Vous ne manqueriez pas d’amoureux, j’en suis sûr ; les amoureux deviendraient bien vite des maris ; je jetterais mon violon aux orties, et je ne ferais plus danser que vos enfants sur mes genoux. Pastourel soupira encore.
Irma et Fanny répondirent par une moue à l’allocution paternelle.
— À mon tour, dit Irma, de vous faire remarquer quelque chose. Voyez-vous cette calèche qui entre dans la cour ? une dame en descend ; comme elle est élégante et parée ! Pour elle notre voisine la fleuriste sera trop heureuse de quitter sa table et de laisser son dîner ; elle s’inclinera devant elle, l’accablera de salutations, se fera humble et petite ; tout cela pour qu’elle joigne à sa commande de fleurs un billet pour la représentation de demain. Cette dame, c’est la première danseuse de l’Opéra ; elle gagne trente mille francs par an ; toutes les fois qu’elle danse, on la couvre de bouquets et de bravos. Un jour nous serons comme elle ; nous aurons un équipage ; vous verrez briller sur l’affiche les noms de vos deux filles, mesdemoiselles Pastourel 1re et Pastourel 2me ; vous lirez notre éloge dans les journaux ; vous nous accompagnerez dans une bonne chaise de poste quand nous irons en congé.
— Mais vous n’avez pas seulement débuté, reprit le père, souriant à demi à la perspective qu’Irma venait d’ouvrir devant ses yeux.
Ce fut Fanny qui lui répondit :
— Dans un mois nous ferons partie du corps de ballet, sans compter qu’aujourd’hui même, en me voyant prendre ma leçon, le professeur a dit : « Voilà une pirouette qui avant un an ira à Londres. »
— Le professeur a dit cela ?
— Et il a fait le même compliment à ma sœur ; voyons, petit père, nous reprochez-vous encore d’avoir voulu être artistes comme vous ?
Deux baisers viennent se poser à la fois sur les joues du vieillard.
— Tout cela est fort beau sans doute ; mais en attendant il faut dîner, et comment s’y prendre ? Il me vient une idée.
— Laquelle ? demandèrent à la fois mesdemoiselles Pastourel 1re et Pastourel 2me.
— Heureusement pour vous, mes enfants, vous avez un frère pour lequel la vie d’artiste n’a jamais eu d’attraits ; celui-là aime la tranquillité, la paix, le travail ; il est modeste, laborieux et rangé ; il n’ambitionne ni le vain bruit des applaudissements, ni les éloges des journaux. Je vais le trouver à son atelier, son bourgeois ne refusera pas de lui avancer une petite somme, et Terpsichore dînera aujourd’hui aux frais du rabot.
Les deux sœurs se regardèrent en même temps ; Irma fit un mouvement comme pour parler, mais Fanny la retint. — Qu’allais-tu faire ? dit-elle à sa sœur quand le vieillard fut parti ; il vaut bien mieux qu’il l’apprenne par d’autres que par nous.
Au bout d’une heure, Pastourel était de retour. Il froissait entre ses mains crispées une lettre que le portier lui avait remise, et qu’il n’avait pas même pris la peine de décacheter. La douleur et le désespoir auxquels nous l’avons vu en proie au commencement de cette histoire, ne sont rien auprès de ce qu’il éprouve en ce moment.
— Ô jour funeste ! s’écrie-t-il, jour de deuil et de malédiction ! puisses-tu être le dernier de mes jours ! Je perds à la fois ma place et mon fils ; il ne me reste plus qu’à perdre la vie. Le malheureux s’est engagé dans une troupe ambulante ! Pendant que je le croyais occupé à manier la scie ou le marteau, il désertait l’atelier, il allait prendre des leçons de danse ; il me trompait, le scélérat, il trompait tout le monde ! Le mensonge conduit à tout, cet enfant déshonorera mes cheveux blancs !
Fanny et Irma se mirent aux genoux de leur père, et essayèrent de le calmer.
— Laissez-moi ! continua-t-il en les repoussant ; je lui donne ma malédiction. Mépriser mes avis et s’engager dans une troupe de cabotins ! est-ce là, je vous prie, le début d’un artiste véritable ? Qu’y a-t-il à faire pour un danseur sur des planches nomades ? Quelques misérables entrées dans une obscure bourgade ; tout au plus un pas de deux si l’on s’élève jusqu’à la sous-préfecture.
— Mais ne faut-il pas un commencement à tout ? reprit doucement Fanny. Notre frère ne s’en tiendra pas là ; il nous a dit en nous embrassant : « Je reviendrai bientôt débuter à Paris ; moi aussi, je veux être artiste comme mon père. »
— Toujours la même réponse ! Ingrates filles, non contentes de perdre mon Joseph, vous l’avez aidé dans sa fuite, vous n’avez pas craint de devenir ses complices. Je vous maudirais comme lui, si vous n’étiez à jeun… Y a-t-il longtemps qu’il est parti ?
— Une semaine.
— Reviendra-t-il bientôt ?
— Il nous fera savoir l’époque de son retour.
— Ce n’est pas que je désire le revoir, au moins ; je l’ai pour jamais banni de ma présence ; qu’il ne s’avise pas de mettre les pieds chez moi, je le chasserais.
Au même instant Irma poussa un cri de joie, et remit à son père la lettre que la colère l’avait empêché de lire.
— De Joseph ? dit Pastourel en essayant de cacher sa joie.
— De votre directeur ; lisez.
Le vieux danseur mit ses lunettes et lut.
Placé, en vertu d’une délibération des actionnaires, à la tête du Bal d’Idalie, j’ai l’honneur de vous informer que les soirées dansantes de cet établissement recommenceront à partir de demain ; vous êtes en conséquence invité à vous rendre à votre poste aux heures accoutumées. La nouvelle entreprise, désireuse de stimuler le zèle des artistes, paiera l’arriéré à bureau ouvert ; il vous suffira de présenter vos titres au siège de l’administration.
— Voilà un trait qui fait honneur à l’espèce humaine ; ce Bagnolet est un honnête homme qui mérite de prospérer ; mon archet lui est tout dévoué. Puisse Joseph avoir toujours affaire à des directeurs pareils !
— Vous lui pardonnez donc à ce pauvre Joseph ?
— Je vous dirai cela à mon retour, mes enfants ; je vais voir si la caisse est ouverte ; en attendant remettez dans son étui mon bon vieux violon que tout à l’heure j’ai manqué de briser.
— Soyez tranquille, petit père, nous aurons bien soin de lui, à condition que vous ne reprocherez plus à Fanny, à moi, à Joseph, de n’être ni fleuriste, ni blanchisseuse, ni menuisier. Vous nous le promettez, n’est-ce pas ?
— Si je l’oublie, rappelez-moi ce proverbe qui me force à la résignation :


NE CRACHEZ PAS DANS LE PUITS
VOUS POUVEZ EN BOIRE L’EAU

— Ernest !
Les habitués du café de Paris entendent fort peu de ces exclamations que la surprise et l’élan du cœur font vibrer sur de jeunes lèvres. De tous côtés les yeux se levèrent, le bruit des fourchettes s’arrêta ; il y eut une suspension d’hostilités sur ce champ de bataille déjà couvert de victimes.
Mais quand on vit deux jeunes gens se lever en même temps, et, quelque peu interdits de l’effet qu’ils avaient produit, échanger à demi-voix, avec une cordiale poignée de mains, leurs félicitations réciproques, la curiosité ne tint pas longtemps la gastronomie en arrêt. Chacun se remit à l’œuvre de plus belle ; et nos deux amis, à qui personne ne prenait garde, s’attablèrent paisiblement, côte à côte, autour d’une table où trois autres convives avaient pris place. C’étaient de joyeux garçons, invités, à ce qu’il semblait, par le dandy qui répondait au nom de Philippe.
Leur conversation, que chacun put écouter sans scrupule vu le diapason très-élevé qu’ils lui avaient donné, courait et sautelait d’un sujet à l’autre avec une prestesse éminemment parisienne. On questionna d’abord M. Ernest qui revenait du Yucatan, où il était allé dessiner je ne sais quels anciens temples d’une architecture idéale. Ceci conduisit à parler de Fernand Cortez et des jambes d’une choriste.
Il fut ensuite question d’un suicide, et l’on disserta longuement sur de nouveaux pistolets à double détente, perfectionnés par un armurier allemand dont le nom m’échappe.
L’Allemagne mit sur le tapis un académicien récemment élu, dont on discuta vivement les titres philosophiques, et, pour bien peu, la grande question de l’enseignement universitaire allait tout envahir. Par bonheur, une méchante épigramme sur un ex-ministre de l’instruction publique détourna l’orage, et l’on ne parla plus, durant un gros quart d’heure, que d’une tentative d’assassinat pratiquée naguère par une dame poëte sur un romancier

Prenant enfin la parole comme par inspiration :
— Puisque nous parlons de bas-bleus, s’écria-t-il, donnez-moi des nouvelles d’Antonia Fouinard !
À ce nom prononcé sans le moindre embarras, et tout uniment jeté dans le courant du dialogue, une vive surprise se peignit sur la figure des trois convives de Philippe. Philippe lui-même pâlit légèrement, et voulut couper la parole à son ami.
— Veux-tu des fraises ? lui demanda-t-il. Ernest pelait une orange, et ne s’aperçut de rien.
— Merci, répondit-il négligemment ; Antonia Fouinard, cette jolie personne que Philippe appelait sans façon Nini, et que je surnommai Nini-Fo le jour où je lus dans un dictionnaire mythologique :
« Nini-fo, déesse de la volupté chez les Chinois. »
Sur ce trait spirituel, Ernest s’arrêta d’autant plus volontiers qu’il venait d’avaler son premier quartier d’orange.
Mais comme personne n’avait ri, le pauvre garçon pensa que son mot ratait. « Je reviens du Yucatan, se dit-il, et je n’ai pas le sens commun. Tentons encore la fortune. »
— Ah ! reprit-il, quelles bonnes soirées nous passions à nous moquer d’elle ! Imaginez-vous, Messieurs, que le seigneur Philippe, ici présent, avait eu l’indigne faiblesse, quinze jours durant, de la prendre au sérieux. Il faisait des vers pour elle… Ne t’en défends pas, je les ai lus… Elle l’appelait son Clair de lune !… Le surnom passa dans le commerce, et trois ou quatre mauvais sujets, dont j’étais, se donnèrent le plaisir de rendre Philippe infidèle pour pouvoir écrire à madame Antonia que son clair de l’une était aussi le clair de l’autre…
Cet abominable calembour n’obtint aucun succès. Deux des convives avaient le nez sur leur assiette, le troisième roulait des yeux ébaubis. Le malaise de Philippe allait croissant.
— Voyons, veux-tu des fraises ? redemanda-t-il au malencontreux Mexicain, qui, plus que jamais, maudissait le Yucatan, séjour mortel pour un bel esprit de Paris.
Ernest saisit le plat qu’on lui tendait, et, par une heureuse distraction, le renversa tout entier sur ce qui restait de son orange. Écrasé pêle-mêle, et noblement sucré, ceci forme un délicieux sorbet que je recommande à mes lecteurs ; s’ils peuvent y émietter une moitié de grenade, le régal sera complet.
Ranimé par ce rafraîchissant mélange :
— Ça, mon bon Philippe, tu n’es pas devenu bavard depuis trois ans. Antonia Fouinard t’inspirait mieux autrefois. Caramba ! pour peu que ce nom fût prononcé, — quand tu fus guéri de ton fatal amour, — c’étaient des histoires, des facéties, des charges à n’en plus finir.
— Je n’ai pas le moindre souvenir de ces sornettes.
— Vraiment ?… On oublie donc bien vite par ici ! Pour moi, j’en avais l’esprit si bien garni, que j’en ai fait rire trois señoras mexicaines, en déjeunant avec elles dans un corridor des ruines de Palenqué. Il me fallut, je m’en souviens, un peu de temps, et pas mal de définitions pour leur faire comprendre, — par à peu près, — ce que pouvait être le curieux animal appelé chez nous femme de lettres ; mais tes caricatures, Philippe, m’aidèrent merveilleusement.
— Mes… caricatures ? Je ne sais de quoi tu veux parler.
— Allons,… fais le bon apôtre, à présent… Est-ce que tu veux entrer à l’Académie, toi aussi ?… Comment ? tu n’as plus souvenance de cette ravissante pochade où la sublime Antonia était représentée avec le corps allongé, le museau pointu, l’œil méchant de la fouine, — heureuse allusion au joli nom de son mari, — et ravageant un poulailler dont tu étais un des habitants les plus maltraités ?… Edouard, Henri, le petit Roussac, — celui que nous appelions le Petit Albert ; — ils étaient tous là, très ressemblants, ma foi ; mais sous forme de poulets… Et, comme, — votre cadet à tous, — je restais aussi le seul de notre bande que la fouine eût jusqu’alors épargné, tu m’avais mis dans un coin, poussin à peine éclos, montrant tout juste mon petit bec hors de l’œuf…
— Tout cela est bien vieux, mon brave Ernest, et je ne pense pas que ces messieurs prennent un grand intérêt…
— Peut-être as-tu raison ; mais c’est ton affectation de tout à l’heure qui m’avait mis hors de moi… Renier Antonia, la joie de notre jeunesse, la marotte de nos dîners d’artistes, le but obligé de toutes nos méchantes plaisanteries pendant plus d’un an ! Elle qui chantait si bien, entre deux élégies, des couplets à casser les vitres ! Elle qui improvisait si lestement, entre deux cigares, un conte moral à l’usage de la jeunesse !… Oublier Nini, les turbans de Nini, les raouts excentriques de Nini, les petits billets passionnés de Nini, sur papier à vignettes, empestés de vétiver et cachetés de cire jaune !… Oublier enfin tout ce dont je me souviens si bien, moi, le Juif Errant, moi, le voyageur aventureux, moi, dont elle n’a jamais été…
Cette foudroyante tirade en était là, quand Ernest s’aperçut que son auditoire lui faisait faux bond. Philippe causait à demi-voix avec son voisin, et les deux autres convives imitaient, — non sans une intention marquée, — l’exemple donné par leur amphitryon.
L’orateur, averti par un instinct secret qu’il avait lâché quelque sottise, prit un peu tard le parti de se taire, et couvrit sa retraite en avalant coup sur coup une demi-bouteille de tisane-champagne. Le dîner était fini. On se sépara tristement, sans effusion, sans cordialité, sans regret. Un mur de glace semblait être tombé tout à coup entre ces jeunes gens si affectueux au début. Philippe paraissait en proie à quelque accès d’hypocondrie.
Ernest apprit le soir même ce qu’il eût dû savoir avant le dîner : le mariage de Philippe et de madame Antonia, veuve Fouinard, ornée d’un brillant héritage, lauréat de l’Académie, et protégée par un de nos plus influents députés. Cette audacieuse union s’était accomplie trois mois auparavant, à la grande stupéfaction de beaucoup de gens.
D’abord un peu confus de l’aventure, mais ensuite riant sous cape, Ernest fit un petit paquet des chansons, épigrammes, caricatures, etc., dont il avait été question pendant le dîner, et, dès le lendemain, il l’adressa sous une double enveloppe à l’imprudent détracteur de la belle Antonia.
Sur le second pli, se trouvait écrit le proverbe moscovite que nos lecteurs ont vu en tête de ce véridique chapitre.


QUI SE COUCHE AVEC DES CHIENS
SE LÈVE AVEC DES PUCES

 n aurait vainement cherché, en l’an de grâce 1584, depuis les collines du royaume des Algarves jusqu’aux plaines d’Oporto, un cavalier plus content de sa personne et s’estimant plus heureux que dom Bartholomeo-Henrique Gamboa, licencié de l’Université de Coïmbre.
n aurait vainement cherché, en l’an de grâce 1584, depuis les collines du royaume des Algarves jusqu’aux plaines d’Oporto, un cavalier plus content de sa personne et s’estimant plus heureux que dom Bartholomeo-Henrique Gamboa, licencié de l’Université de Coïmbre.
L’honorable dom Bartholomeo-Henrique Gamboa était arrivé de la veille seulement dans la capitale du Portugal, et déjà il se promenait sur les rives du Tage avec l’air d’un cavalier qui a goûté de tous les plaisirs d’une grande ville.
Si le jeune gentilhomme avait répété tout haut les propos que sa pensée lui redisait tout bas, on aurait entendu l’étrange discours que voici :
— Parbleu ! si la vice-reine me voyait passer, ne me prendrait-elle pas pour un infant d’Espagne, tant j’ai bonne mine ? Mon père, un digne homme, ma foi ! me donne un bon cheval, vingt écus d’or, et une lettre pour Sa Seigneurie le marquis de Belcazer, grand d’Espagne, un des hommes les plus influents auprès de l’illustre Vasconcellos. « Va me dit-il, et fais ton chemin dans le monde. » J’arrive à Lisbonne, et je descends à l’hôtellerie des Trois-Mages, où tout d’abord je rencontre un honnête cavalier qui se prend d’amitié pour moi sur l’air de ma figure. Le seigneur dom César Mandurio, marquis de Torreal, m’invite à souper, et me conduit, après m’avoir fait boire les meilleurs vins, chez la senhora Dorothea de Santa-Cruz. Je trouve chez cette aimable personne les gens qui peuvent le mieux me pousser à la cour ; on fait de la musique, on danse, on joue, et je gagne cent écus d’or ; je crois même que la senhora Dorothea n’a pas été trop insensible à ma tournure, si j’en juge par les regards qu’elle m’a jetés. J’ai eu l’honneur de prêter mon cheval au noble marquis pour faire ce matin une promenade jusqu’aux jardins du grand inquisiteur, à qui il m’a promis de me présenter. Je l’attends pour dîner chez le meilleur traiteur de Lisbonne ; je suis habillé comme un fils de prince, et ce soir je reverrai la senhora Dorothea de Santa-Cruz !
Le seigneur Gamboa en était là de ses discours intimes, lorsqu’une main s’appuya familièrement sur son épaule.
— Quoi ! c’est vous déjà, Seigneur dom César ? s’écria dom Bartholomeo. — Moi-même, grâce à votre cheval qui va comme une hirondelle. Quand vous voudrez vous en défaire, j’ai cent écus à votre disposition. Mais, pourrais-je vous demander, Seigneur dom Bartholomeo, quelle pensée vous occupait tout à l’heure ? — Je revais, dit le jeune gentilhomme. — Je gage mon épée contre un maravédi que vous songiez à la belle dona Dorothea de Santa-Cruz ? — C’est la vérité ; le souvenir de ses beaux yeux me suit partout. — Eh bien ! seigneur cavalier, la fortune vous traite en enfant gâté ; car la senhora, en brillante compagnie, a fait la partie de déjeuner ce matin au bord de l’eau. Si vous voulez me suivre, nous la trouverons dans ce bois d’orangers, à cent pas d’ici. — Vous suivre, Seigneur dom César ? Mais, pour voir la senhora Dorothea, je vous suivrais jusqu’au cap des Tempêtes !
Cinq minutes après, les deux jeunes gens pénétraient sous un bosquet verdoyant, où deux ou trois dames et cinq ou six gentilshommes devisaient à l’abri des feux du jour.
— Mon ami le comte Gamboa, dit dom César en s’inclinant.
À ce titre de comte, dom Bartholomeo rougit de plaisir ; un regard de la senhora Dorothea, qui aurait donné de la vanité à de plus modestes, acheva de lui faire perdre la tête. On s’assit sur l’herbe autour d’un déjeuner exquis. Les vins d’Espagne et d’Italie, rafraîchis dans la neige, circulaient de toutes parts ; et, tandis que les coupes s’emplissaient, la main de dom Bartholomeo effleurait parfois la main de dona Dorothea.
— De par saint Jacques de Compostelle, mon

— Mais voudra-t-il s’y associer ? dit la senhora Dorothea en jetant au gentilhomme une œillade irrésistible.
— Refuser d’être où vous êtes ! répliqua dom Bartholomeo ; mais, madame, je ne vous ai pas donné le droit d’insulter mon cœur et mes yeux.
— Voici de quoi il s’agit, continua un gentilhomme en pourpoint de satin vert ; un de nos amis, le marquis de Belcazer…
— Ne le connaissez-vous pas ? demanda brusquement dom César à dom Bartholomeo ; il me semble que vous m’avez parlé d’une lettre à son adresse ?
— Je l’ai justement sur moi, s’écria Gamboa.
— Le marquis de Belcazer, reprit le cavalier au pourpoint vert, a parié que jamais il ne serait arrêté par les voleurs qui pullulent, dit-on, aux environs de Lisbonne ; mille écus d’or sont le prix de la gageure. Aujourd’hui même, il doit venir à son château ; ce château est si près de Lisbonne que le comte n’aura certainement pas pris la précaution de se faire suivre par des domestiques armés. Nous allons nous embusquer derrière un bouquet d’arbres, et, vers le soir, quand il sortira de ses jardins pour se promener en bateau sur le Tage, nous fondrons sur lui…
— Un bandeau tombera sur ses yeux, dit dom César.
— Mon carrosse le recevra, reprit dona Dorothea ; nous partirons au galop ; deux heures après, nous arriverons à ma villa…
— Et le marquis de Belcazer se trouvera à table au milieu de ses amis, sans bagues, sans bijoux, sans épée, s’écria le narrateur. Ne vous semble-t-il pas qu’il aura bien perdu ses mille écus ?
— Sans doute, et c’est charmant ! dit Gamboa.
— Il n’y a qu’une petite difficulté, ajouta la senhora Dorothea de Santa-Cruz ; tout est bien prévu, et nous sommes sûrs de nous emparer du marquis de Belcazer si nous pénétrons dans ses jardins ; mais quel moyen avons-nous de nous y introduire ?
— Vous oubliez ma lettre, Madame ! s’écria avec joie dom Bartholomeo ; c’est un talisman qui nous ouvrira toutes les portes. Partons !
— Partons ! répéta toute la troupe.
L’intendant du château avait jadis connu le seigneur Gamboa, père de dom Bartholomeo ; à la vue de ses armes imprimées dans la cire, il ne fit aucune difficulté de laisser passer le jeune gentilhomme et ses amis. Les dames, pour n’être pas reconnues, s’étaient couvert le visage de masques de velours noir ; les cavaliers avaient rabattu leurs chapeaux sur leurs yeux, et tous s’enfoncèrent dans les bosquets. Bientôt ils arrivèrent à l’endroit où la barque du marquis était amarrée. — C’est ici, dit dom César ; cachons-nous derrière ces buissons, et attendons.
On se blottit au milieu des haies ; dom Bartholomeo était à côté de dona Dorothea de Santa-Cruz, si près, si près, qu’une feuille de rose n’aurait pu se glisser entre elle et lui. Le soir vint avec ses ombres mystérieuses. On entendit marcher dans les allées ; le gravier craquait sous les pieds des promeneurs.
— C’est lui ! dit dona Dorothea. Voyons, seigneur Gamboa, comment vous jouerez votre rôle. Oserez-vous l’arrêter le premier ?
— J’arrêterais le vice-roi, si vous le vouliez.
Un soupir lui répondit ; le marquis de Belcazer arriva sur la plage, et dom Bartholomeo s’élança vers lui.
— Seigneur marquis, rendez-vous ! s’écria-t-il.
Le marquis n’avait avec lui que quatre laquais sans armes ; il voulut tirer son épée, mais dom César le désarma, tandis que ses amis terrassaient les valets ; un seul parvint à s’enfuir, grâce à la nuit.
— Vite, dépêchons, dit dom César à voix basse ; des quatre drôles qui accompagnaient Sa Seigneurie, je n’en vois que trois couchés sur le sable ; craignons que l’autre ne donne l’alarme au château.
En un tour de main, le marquis de Belcazer fut dépouillé, garrotté et bâillonné. On le transporta dans le bateau, et la compagnie s’apprêta à s’embarquer.
— Il me semble voir de la lumière briller du côté du château, dit dona Dorothea ; vite, informez-vous de ce que ça peut être, seigneur dom Bartholomeo.
Gamboa courut dans la direction que lui indiquait le doigt de la senhora. Il ne vit rien, et se hâta de retourner vers la plage. Tout avait disparu, la barque, les cavaliers, les captifs et dona Dorothea. Tandis que dom Bartholomeo cherchait du regard autour de lui, il entendit un grand tumulte dans les jardins ; vingt torches flamboyaient entre les arbres, où passaient les silhouettes noires de grands laquais armés de longues épées. Le seigneur Gamboa réfléchit qu’il était seul ; de là lui vint la pensée de fuir. Il se jeta au milieu des taillis qui bordaient le fleuve, et gagna, à la faveur de la nuit, les murs du parc, qu’il escalada en s’aidant des espaliers. En un quart d’heure, il arriva dans les faubourgs de Lisbonne, et se dirigea rapidement vers l’hôtellerie des Trois-Mages.
Le cheval qu’il avait prêté la veille au marquis de Torreal n’était pas rentré à l’écurie. Cette longue absence, jointe à la subite disparition de ses amis de fraîche date, ne laissa pas d’inquiéter le seigneur dom Bartholomeo. En se déshabillant, il s’aperçut que la bourse où reposaient les écus d’or, gagnés la nuit précédente chez la senhora Dorothea de Santa-Cruz, s’était envolée de sa poche. Cette découverte augmenta ses craintes, et l’héritier du seigneur Gamboa s’endormit l’esprit plein d’images lugubres.
Au petit jour, un domestique heurta à sa porte.
— Seigneur, lui dit-il, voici un billet qu’un inconnu m’a prié de vous remettre.
Dom Bartholomeo ouvrit la lettre, et lut ce qui suit :
« Je vous remercie, seigneur comte, de l’aimable secours que vous nous avez prêté. Sans votre aide, jamais nous n’aurions réussi à nous emparer du marquis de Belcazer, qui vient de nous payer une riche rançon. La senhora Dorothea de Santa-Cruz, qui porte aussi le nom de Saphira la Gitana, vous prie d’agréer ses plus gracieux compliments. Je désire que le ciel me ménage une occasion de renouveler connaissance avec vous, qui apprendriez en ma compagnie ce qu’on n’apprend pas à l’Université de Coïmbre. »
Dom Bartholomeo se dressa sur son séant.
— Christoval Galiera ! s’écria-t-il, le fameux voleur !
— Lui-même, répondit un estafier qui venait d’entrouvrir brusquement la porte ; et je vous arrête comme son complice.
— Moi ?
— Vous-même ; l’intendant du marquis de Belcazer nous a donné les renseignements les plus circonstanciés à votre égard. Au nom du roi ! suivez-nous.
— Oh ! l’étrange aventure ! reprit Gamboa.
— Honorable seigneur, elle n’est que trop simple au contraire : Lorsqu’on se couche avec des chiens…
— On se lève avec des puces, continua un autre alguazil.


CHAQUE POTIER
VANTE SON POT

 e 15 avril 1844, M. Deslongrais fit appeler dans son cabinet son neveu, Gabriel Maugis.
e 15 avril 1844, M. Deslongrais fit appeler dans son cabinet son neveu, Gabriel Maugis.
— Mon ami, dit-il au jeune homme en tirant sa montre, il est midi, et c’est aujourd’hui le 15 avril ; tu es majeur depuis un quart d’heure. Je t’aurais fait prier cinq minutes plus tôt de passer dans ce cabinet, s’il ne m’avait fallu ce temps pour liquider mes comptes de tutelle. Toutes les pièces sont réunies, là, sur ce bureau ; tu peux en prendre connaissance…
— Oh ! mon oncle !
— Bien, bien ; je sais que tu vas me prier de garder la direction de tes affaires, et me dire qu’elles ne sauraient être placées en meilleures mains.
— Vous m’avez deviné.
— Oui, mais je suis un vieil égoïste qui ne me fatigue pour les autres que lorsqu’il m’est impossible de faire autrement… Tu as trente mille livres de rente à toi, c’est dix mille de plus que je n’en ai reçu ; j’ai assez fait travailler tes fonds pour avoir le droit de me reposer. Mais avant de t’abandonner la direction suprême de tes affaires, je me permettrai seulement de t’adresser une seule question : As-tu lu l’Amour Médecin ?
— L’Amour Médecin de Molière ? Oui, mon oncle.
— N’oublie jamais la première scène du premier acte, mon ami, toute la science de la vie est là-dedans ; le monde est pavé de M. Josse. Je n’ai pas d’autres conseils à te donner ; mais pour que tu n’en perdes jamais le souvenir, je prétends mettre cette morale en action. Suis-moi.
Un quart d’heure après, M. Deslongrais et son neveu entraient chez un jeune banquier, rue du Houssaie.
— Mon cher Gambier, lui dit l’oncle, nous venons, mon neveu et moi, vous demander un service.
— Vous qui avez trente mille livres de rente ? Votre neveu qui en a autant ?
— Eh ! précisément, ce sont ces maudites trente mille livres de rente qui nous gênent ! Que faire du capital ? Vous qui êtes dans les affaires donnez-nous donc un bon conseil.
— Six cent mille francs ! s’écria le banquier. Eh ! mais, il n’en faut pas davantage pour soumissionner un joli tronçon de chemin de fer. Placez cet argent chez un capitaliste bien famé, il le fera valoir dans des entreprises sûres ; l’intérêt vous sera servi à quatre pour cent, vous aurez une part dans les bénéfices de la maison, et dans dix ans vos capitaux seront doublés. La banque règne et gouverne aujourd’hui.
— Nous y penserons, mon cher Gambier, dit M. Deslongrais ; et poussant Gabriel du coude, il murmura à son oreille ces mots : M. Josse !
Bientôt après tous les deux arrivèrent chez un notaire, d’âge mûr, qui faisait les contrats de la famille.
— Ah ! monsieur Dupuis, dans quel temps vivons-nous ! s’écria M. Deslongrais. Vous connaissez les affaires de mon neveu, le pauvre garçon ne sait à quel usage appliquer sa fortune ; nous venons vous consulter.
Le notaire parut réfléchir un instant.
— Ceci est très-délicat, Messieurs, dit-il enfin ; les opérations de bourse sont aléatoires, et les prêts sur hypothèques d’une liquidation pénible ; la propriété mobilière est accablée d’impôts, et les revenus n’en sont jamais certains. Je crois que le plus sage serait d’acheter une bonne charge à Paris. Une charge met le titulaire en position de faire un beau mariage ; elle lui assure un rang honorable dans la société et des bénéfices considérables ; les charges tiennent à présent le haut du pavé. Je connais une personne qui, pour des raisons de santé, a quelque désir de vendre la sienne. Voulez-vous que je lui en parle ?
— Parlez-lui-en ; reprit M. Deslongrais, et tout bas il

Comme ils quittaient la rue Saint-Marc où demeurait M. Dupuis, l’oncle et le neveu rencontrèrent une de leurs connaissances qui tournait le coin de la rue Vivienne.
— Eh ! ce cher Dervieu ! s’écria M. Deslongrais ; que je suis aise de le voir ! Voilà un homme de bon conseil, et il va tout de suite nous le prouver. Si vous aviez six cent mille francs comptants, qu’en feriez-vous ?
— J’en achèterais tout de suite une terre d’au moins un million.
— Est-ce un bon placement ?
— Merveilleux ! les terres bien cultivées rapportent de trois à trois et demi pour cent ; si l’on y applique les nouveaux procédés d’assolement, on arrive à quatre. Et puis la terre reste toujours ; il n’y a pas de banqueroute qui puisse emporter des prés !
— Vous avez peut-être raison. Sauriez-vous par hasard quelque beau domaine en vente ?
— Je n’en connais qu’un ; mais il est magnifique. La terre des Futaies, près de Meaux. Je l’ai achetée huit cent mille francs, et j’ai fait faire des réparations considérables aux bâtiments. Je suis obligé de m’en défaire, ma femme voulant se fixer à Toulouse auprès de sa famille. Quand vous voudrez voir ce domaine, écrivez-moi, et nous irons ensemble. Mais hâtez-vous ; les concurrents sont nombreux. La propriété est un quatrième pouvoir de l’état.
— C’est entendu, répondit M. Deslongrais.
— Ça fait en tout trois M. Josse, ajouta Gabriel en riant.
— Oh ! nous ne sommes pas au dernier.
En quittant le propriétaire, M. Deslongrais et Gabriel Maugis se dirigèrent vers le faubourg Saint-Antoine, où demeurait un certain M. Louis Ferrandin qui était de leurs parents. M. Louis Ferrandin avait élevé une fabrique de produits chimiques à laquelle il consacrait tout son temps. La visite de ses parents parut le charmer ; mais lorsqu’il en connut le motif, il ne put dissimuler sa joie.
— Vous ne sauriez mieux vous adresser, s’écria-t-il ; ma fabrique a des relations immenses ; je couvre de mes produits les cinq parties du monde et leurs îles ; mais, pour donner à mon industrie tout le développement qu’elle comporte, il me faudrait encore à peu près cinq cent mille francs. Versez vos fonds dans ma fabrique ; nous nous associons, et la signature Ferrandin, Maugis et Cie, ira jusqu’aux antipodes. L’industrie est la reine du monde.
— Nous examinerons cela, dit M. Deslongrais. À bientôt, mon cher Louis.
— Et lui aussi ! s’écria Gabriel. Trouver M. Josse sous l’habit d’un cousin !
Une invitation à laquelle ils avaient promis de se rendre conduisit M. Deslongrais et Gabriel chez un agent de change, rue Laffitte. Quand ils arrivèrent, cinq cents personnes circulaient dans des salons qui pouvaient bien en contenir deux cent cinquante ; on en attendait trois cents encore. Bientôt le bruit se répandit dans le bal qu’un jeune homme, majeur depuis quelques heures seulement, cherchait à placer sa fortune et sa personne : six à sept cent mille francs et un joli garçon, deux choses charmantes auxquelles l’association prête un attrait irrésistible.
— Il faut, mon cher, vous marier, disait un vieux rentier à Gabriel ; le ménage est un frein qui calmera votre jeunesse, et vous empêchera de gaspiller votre fortune ; si j’étais votre père, les bans seraient publiés demain.
— Il a trois filles à pourvoir, le bonhomme, murmura M. Deslongrais à l’oreille de Gabriel. M. Josse !!!
— Ce n’est point mon avis, continua un employé supérieur du ministère des finances ; avant de se marier, un jeune homme doit expérimenter la vie ; quand il aura vu le monde et ses écueils, et conquis la maturité du jugement par le travail, il sera temps alors qu’il se marie.
— Le bureaucrate a une fille, mais cette fille n’a que douze ans ; quand tu auras de l’expérience, elle aura dix-sept à dix-huit ans, le bon âge pour trouver un époux. Toujours M. Josse !!! dit encore M. Deslongrais.
— Bah ! interrompit l’agent de change, le mariage n’est pas l’affaire importante de la vie ; on ne doit aujourd’hui songer qu’à la richesse, et la richesse est à la Bourse. M. Maugis a une fortune honorable ; qu’il la réalise et se lance dans les spéculations. La spéculation est la fée du dix-neuvième siècle. Je veux, avant un an, que la coulisse tremble au nom de Maugis.
— Et l’agent de change aura gagné trente mille francs de courtages, si tu en as perdu deux ou trois cent mille sur les chemins de fer.
En achevant ces mots, M. Deslongrais passa son bras sous celui de Gabriel, et ils sortirent du bal pour souper.
— Nous avons justement une bécasse dodue à faire plaisir, dit un garçon du Café de Paris aux deux convives.
— Ah ! vous avez une bécasse ? Eh bien ! donnez-nous un perdreau ! s’écria M. Deslongrais.
Gabriel se mit à rire.
— Tu ris, toi ! Cette bécasse est au restaurateur ce que le domaine est au propriétaire, la fabrique à ton cousin, la charge au notaire, la jeune personne au rentier. Il veut s’en débarrasser ; laisse-la manger à d’autres.
— Quoi ! un M. Josse en maître-d’hôtel !
— M. Josse est partout, M. Josse est immortel ; M. Josse est un proverbe fait homme, et ce proverbe le voici :


MIEUX VAUT MARCHER
DEVANT UNE POULE QUE DERRIÈRE UN BŒUF.

 u village de Tchang-Yo, situé à deux lys de la porte orientale de Ping-Kiang, chef-lieu du département de Kiang-Nan, vivait un homme dont le nom de famille était Hou, et le petit nom Kong. Il descendait d’une lignée de cultivateurs ; mais il s’occupait de littérature, et il avait composé des vers de sept syllabes, qui auraient figuré avec honneur parmi les morceaux d’élite rassemblés par Fut-Zée dans le Chi-King, le troisième des Cinq Classiques. Vêtu d’habits très-simples, usant d’une nourriture frugale, mais toujours dans l’aisance et le contentement, il possédait encore du superflu, malgré la modicité de sa fortune, et savait venir au secours des pauvres du village. Aussi le comparait-on à un Printemps mâle pourvu de pieds.
u village de Tchang-Yo, situé à deux lys de la porte orientale de Ping-Kiang, chef-lieu du département de Kiang-Nan, vivait un homme dont le nom de famille était Hou, et le petit nom Kong. Il descendait d’une lignée de cultivateurs ; mais il s’occupait de littérature, et il avait composé des vers de sept syllabes, qui auraient figuré avec honneur parmi les morceaux d’élite rassemblés par Fut-Zée dans le Chi-King, le troisième des Cinq Classiques. Vêtu d’habits très-simples, usant d’une nourriture frugale, mais toujours dans l’aisance et le contentement, il possédait encore du superflu, malgré la modicité de sa fortune, et savait venir au secours des pauvres du village. Aussi le comparait-on à un Printemps mâle pourvu de pieds.
Il avait pour voisin un fermier, non des plus riches, et qui se distinguait seulement par son grand amour pour l’horticulture. Dans son vaste jardin, fermé par des treillages de bambous, il réunissait l’althœa, la balsamine, la ketmie aux fleurs changeantes, la pivoine en arbre, l’amaranthe, le lychnis couronné, le calycanthe, le corchorus, le bouton d’or, et beaucoup d’autres plantes non moins rares. Depuis longtemps, cet honnête homme, surnommé dans le pays le Fou des Fleurs (Hoa-Tchy), nourrissait le désir secret d’entendre réciter des vers par Hou-Kong.
On voit dans le livre des Dix mille Mots que :
|
Celui qui chante est une incarnation de Bouddha, |
En conséquence, un jour que l’occasion lui parut favorable, le Hoa-Tchy mit ses habits de nouvel an, et alla frapper à la porte de son voisin.
Celui-ci était sous ses arbres, occupé à chanter et à boire du vin de Niao-Tching dans une tasse d’or, présent du vice-roi de la province. Près de lui était une table portant un vase de porcelaine du milieu duquel s’élevait une branche de pêcher couverte de belles fleurs marbrées. À l’aspect de son voisin que lui amenait un serviteur, il ouvrit ses yeux appesantis par le vin, et lui récita ce vers avec un accent de joyeuse insouciance :
|
Je suis ivre, je veux dormir : ainsi, allez vous promener ! |
Mais le fermier ne se méprit pas à cet accueil si peu obligeant.
— Le Fou des Fleurs, dit-il, sait bien que telle fut la réponse du Nénuphar Bleu (du poëte Ly-Pe) quand le comédien Koueï-Nien allait le chercher de la part de l’empereur ; mais M. Hou-Kong, qui est un homme civil en même temps qu’un poëte distingué, ne voudra pas repousser l’humble demande de son plus indigne serviteur.
À ces paroles si convenables, Hou-Kong sentit qu’il avait affaire à un amateur de poésie ; et, se levant, il le salua d’un tchin-tchin empressé.
— Le vieux Chinois, dit-il ensuite, croit avoir aperçu Votre Seigneurie cultivant des fleurs dans un jardin fermé de bambous.
— Il est vrai, répondit Hoa-Tchy, que j’ai dans un misérable recoin de terre quelques pauvres plantes qui ne méritent pas d’arrêter les regards de Votre Seigneurie ; et pourtant, telle est l’idée que je me fais de ses bontés, que je la crois capable d’y venir passer une heure ou deux, en compagnie de quelques amis, qui, de temps en temps, boivent et composent des vers en écoutant chanter les loriots dans cette pauvre retraite.
— Rien de plus agréable qu’une aussi glorieuse invitation, répliqua Hou-Kong; mais quel jour, s’il vous plaît, permettrez-vous à votre humble serviteur d’assister en silence à cette fête de l’amitié ?
— Ce serait, sauf le bon plaisir de l’illustre poëte, le treizième jour de la lune et à l’heure du Mouton.
— J’éprouve un grand désespoir, dit Hou-Kong après avoir réfléchi quelques instants ; mais ce jour et à cette heure, je suis attendu chez les examinateurs qui siégent ce printemps pour la province. L’un d’eux, — ajouta-t-il en se rengorgeant, — est Son Excellence Yang-Koueï-Tchong, premier ministre et frère de l’impératrice ; l’autre est le duc Kao-Ly-Sse, commandant des gardes impériales. Vous comprenez…
— Je comprends, interrompit le Fou des Fleurs, que M. Hou-Kong ne saurait manquer à d’aussi éminents personnages pour un stupide et illettré paysan comme moi. J’insisterai pourtant, et lui demanderai de venir dans ma pauvre chaumière. Nous nous réunirions plutôt à l’heure du Cheval, et il serait libre de se rendre à Ping-Kiang aussitôt qu’il aurait vidé quelques tasses de mauvais vin.
Hou-Kong ne vit pas le moyen de refuser, sans une grave impolitesse, cette invitation qu’il dédaignait secrètement.
— Votre frère cadet accepte avec transport l’honneur de passer quelques instants en votre compagnie, répondit-il ; mais à condition que vous boirez avec lui un peu de cette insignifiante liqueur.
Ils burent ensemble plusieurs tasses de Niao-Tching, et se séparèrent après maintes civilités. Le Fou des Fleurs rentra chez lui fort joyeux ; et, le douzième jour, il ne manqua point de renouveler, parmi un titsee sur papier rouge, l’invitation déjà faite.
Hou-Kong, néanmoins, était fort contrarié ; le treizième

— Quel orgueil, disait-il, dans ces petites gens de village ! En voici un qui, me sachant invité par les plus grands personnages de l’empire, ne craint pas de m’obliger à me rendre chez lui pour y boire de la piquette, sans doute avec des manants ! Ah ! si je l’osais, je lui enverrais à ma place une pièce de vers où ses convives et ses loriots seraient tournés en ridicule.
Il se mit incontinent à rédiger cette satire en vers libres, et il en ruminait les derniers traits quand il arriva dans le jardin du Fou des Fleurs.
Le coup-d’œil qui s’offrit à lui était aussi charmant que celui du lac Sy-Hou. L’éclat de ce jardin, planté des fleurs les plus rares, était pareil à celui d’un paravent enrichi de mille couleurs. Par des allées de cyprès, on arrivait dans trois salles couvertes, il est vrai, en simple chaume, et meublées en bois uni, mais où tout resplendissait de propreté. On eût balayé le sol sans rencontrer un atome de poussière.
Quant aux fleurs, soignées par Hoa-Tchy comme autant de filles chéries, elles étaient d’une abondance et d’une richesse extraordinaires.
|
Le thé qui inspire de belles rimes, |
|
La rose panachée, la petite prune yo-Iy, |
y formaient des berceaux et des guirlandes, des pelouses émaillées et des buissons odorants. On ne saurait décrire la magnificence de cette ravissante perspective. Les loriots, sautillant légèrement au sein des grands arbres, et becquetant çà et là les baies parfumées des fleurs, chantaient d’une voix flexible et harmonieuse.
Les amis du Hoa-Tchy ressemblaient aux Sept Sages de la Forêt de Bambous. Ils étaient assis en demi-cercle sur un épais tapis, auprès d’un massif de pivoines épanouies, où l’on pouvait voir les cinq espèces les plus remarquables de cette fleur, qui est la reine des parterres : l’Étage d’or, le Papillon vert, la Richesse du melon d’eau, le Lion bleu scintillant, et l’Élégant génie doré. À côté de chacun d’eux était une assiette remplie de beaux fruits, et une cruche de sam-tsicou préparé avec le plus grand soin.
À l’aspect de M. Hou-Kong, tous se levèrent, et firent deux fois devant lui le ko-toou de cérémonie qu’on réserve aux plus grands personnages. On le contraignit, malgré sa résistance, à occuper la place d’honneur, marquée par des coussins de soie rouge ; puis, afin de lui témoigner leur admiration pour son talent, chacun des assistants récita tour à tour une des pièces de vers composées par lui. Le poëte souriait en s’inclinant à mesure qu’on lui rappelait ainsi les plus beaux ouvrages de sa jeunesse, et son cœur s’enflait de joie ; les fleurs lui semblaient les plus belles qu’il eût jamais vues, et dignes du paradis de l’Occident. Il estimait à la vérité que les oiseaux gazouillaient un peu trop fort, et gâtaient le plaisir de ceux qui écoutaient ses vers ; mais plusieurs tasses de sam-tsieou lui firent oublier ce léger chagrin, et il abandonna son cœur au plaisir.
Après l’avoir célébré sur tous les tons, son hôte lui demanda d’honorer la réunion par quelques couplets ; et Hou-Kong, se laissant fléchir après bien des prières, donna l’essora sa verve poétique. Les belles images, les nobles expressions lui venaient en foule, et il improvisa comme bien d’autres auraient voulu écrire. Le temps s’écoulait pourtant, trop rapide au gré des joyeux buveurs, et l’heure du Mouton était déjà sonnée, lorsque M. Hou-Kong songea que le frère de l’impératrice et le commandant des gardes l’attendaient à la ville. Le Fou des Fleurs et ses amis l’accompagnèrent jusqu’au delà de l’enceinte en le comblant de remerciements, et en exaltant le bonheur qu’ils lui devaient.
Tout étourdi de leurs éloges, et la tête un peu entreprise par la liqueur qu’il avait bue, Hou-Kong, cheminant sur sa mule, se serait pris volontiers pour Lao-Tse sur son buffle noir. Il fredonnait des chansons, et composa ces quatre vers :
|
Quand on a bu trois verres, on a l’intelligence de la Grande Voie ; |
Peu s’en fallut, qu’emporté par le flot de ses pensées, il ne passât sans s’arrêter devant la salle de la belle littérature, où les examinateurs lui avaient donné rendez-vous.
Ces messieurs étaient choqués au plus haut point de ce que le vieux poëte ne fût point encore venu, et qu’il les eût fait attendre au delà de l’heure indiquée. Aussi avaient-ils résolu de l’en faire repentir, et, d’après leurs ordres, on avait commencé la représentation d’une comédie jouée par d’excellents acteurs de Nan-King. Lorsque M. Hou-Kong parut à l’entrée de la salle, un seul domestique était là pour l’introduire sans aucune cérémonie. Les meilleurs siéges étaient occupés par Yang-Koueï-Tchong et Kao-Ly-Sse, qui n’en avaient réservé aucun à leur hôte retardataire. Celui-ci, plein de confiance, avança pourtant jusqu’aux premiers gradins ; mais il vit toutes les banquettes occupées par une foule de lettrés subalternes qui ne firent pas mine de l’apercevoir, et dont aucun ne se leva pour lui offrir une place.
Afin d’attirer les regards, M. Hou-Kong salua profondément et à plusieurs reprises le premier ministre, frère de l’impératrice, qui ne détourna pas seulement les yeux de la scène, et feignit de ne point prendre garde à l’arrivée du nouveau spectateur.
Découragé de ce côté, le poëte saisit un moment favorable, et, surprenant le duc Kao-Ly-Sse, qui le lorgnait en dessous, il lui adressa une magnifique révérence. Le duc ne riposta que par un léger signe de tête. Hou-Kong, déjà mécontent et le cœur serré, mais n’osant toutefois battre en retraite, chercha un asile sur les gradins les plus éloignés du théâtre ; mais la valetaille qui s’en était emparée, voyant un pauvre homme en l’honneur de qui pas un des lettrés n’avait voulu se déranger, ne prêta aucune attention à cette manœuvre. Le poëte allait réprimander un de ces marauds si peu polis, quand, aux premiers mots qu’il prononça, une rumeur s’éleva du côté des premiers gradins.
— Silence ! disait-on, ce bruit n’est pas tolérable !
— Que les valets se taisent ! ajouta le commissaire impérial en agitant son éventail avec un mouvement de colère.
Hou-Kong perdit en ce moment le peu d’assurance qui lui restât encore. Il demeura debout, appuyé contre une colonne, et sans souffler mot jusqu’à la fin de la représentation. Au moins alors, pensait-il, je serai dédommagé par des attentions empressées de ces rebuffades involontaires.
Mais le premier ministre, en passant devant lui, et sans s’arrêter autrement, dit à un petit chung-ya qui portait son ombrelle :
— N’est-ce point là ce Hou-Kong dont on chante les poésies dans tous les cabarets de Ping-Kiang ? Il n’a guère l’air d’un homme d’esprit.
Et le commissaire impérial, qui suivait, se crut obligé de renchérir sur l’incivilité de son collègue :
— On devrait, en compagnie honorable, se présenter à propos et ne point infecter la salle par l’odeur du vin, s’écria-t-il d’un ton fort emphatique, en regardant Hou-Kong par-dessus l’épaule.
Le malheureux, confondu de tant de dédains, sortit de la salle après tous les autres lettrés, et s’empressa de remonter sur sa mule pour retourner au village de Tchang-Yo.
— Hélas ! pensait-il, bien fou qui recherche la compagnie des grands et s’expose à leurs caprices plutôt que de hanter les petits et de recevoir leurs hommages. Dans le jardin du pauvre fermier, j’étais le plus habile et le plus honoré, j’y étais heureux ; mais dans la salle de la belle littérature, quels durs moments j’ai passés ! Les proverbes ont raison : les oiseaux de même plume doivent habiter même nid, et d’ailleurs
que derrière un bœuf.


À CHAQUE FOU
plait sa marotte.

 orsque la mille et deuxième nuit fut venue, le sultan, après avoir fait grâce à Schéhérazade, ne manqua pas de lui demander un de ces contes que M. Galland devait si bien raconter quelques siècles plus tard.
orsque la mille et deuxième nuit fut venue, le sultan, après avoir fait grâce à Schéhérazade, ne manqua pas de lui demander un de ces contes que M. Galland devait si bien raconter quelques siècles plus tard.
— Soleil de mes jours, lune de mes nuits, glaive de justice, trésor de puissance, lui répondit la sultane dans ce style que nous avons tous admiré, je n’ai plus rien à t’apprendre, j’ai vidé mon sac.
Le sultan, mécontent de cette réponse, regretta de n’avoir pas fait couper le cou à Scheherazade ; il eut même un moment la velléité de se livrer à cette fantaisie pour se distraire ; il résista néanmoins à ce désir, en se répétant ces mots mémorables : Un sultan n’a que sa parole. Cette victoire remportée sur ses passions mérite d’être signalée, surtout chez un monarque aussi absolu que l’était Schahriar.
Cependant le sultan maigrissait à vue d’œil, et restait plongé dans une mélancolie profonde ; son nain favori, son fou qu’il aimait tant, ne pouvait parvenir à le distraire ; le malheureux fut même exilé de la cour. Les courtisans, forcés de maigrir comme leur maître et de feindre une désolation immense, résolurent de tirer leur souverain d’un état qui pouvait compromettre leur tempérament et affecter leur intelligence. Les ministres et les grands de la cour se réunirent en conseil ; on y appela la sultane Scheherazade, qui avait déjà réussi une fois à dissiper l’humeur noire de son époux, et dont la réputation de sagesse commençait à se répandre dans tout l’Orient.
Quand le conseil fut réuni autour d’une table recouverte d’un tapis vert, selon l’étiquette orientale, le visir prit la parole en ces termes :
Ainsi qu’il convient à des sujets fidèles et dévoués, nous ne devons pas avoir de souci plus grand que le bonheur de notre maître. (Très-bien.) La santé, s’il faut en croire le poëte Ferdoussi, est la clef du bonheur ; (Assentiment.) l’ennui, dit le philosophe Al-Fharbi, est la pire des maladies.

Une voix. — C’est cela.
De tous côtés. — Très-bien ! très-bien !
Le visir. — Je ne vous dissimulerai point, Messieurs et chers collègues, que notre tâche est grave ; mais avec l’aide du Prophète, nous la remplirons courageusement, ne demandant d’autre récompense que celle d’avoir sauvé le prince et l’état. (Acclamations prolongées.)
Après ce speech, les membres du conseil prirent la parole à leur tour. L’un proposa d’engager Schahriar à apprendre à jouer aux échecs ; l’autre demanda qu’on lui achetât sept ou huit Circassiennes, et davantage s’il le fallait ; celui-ci voulait qu’on fît venir d’Europe des montreurs d’ours et des danseurs de polka ; celui-là offrait d’ouvrir un théâtre où l’on jouerait la comédie et le vaudeville ; aucun de ces moyens n’obtint la majorité.
Le visir, se tournant vers Scheherazade, lui dit alors :
— Madame, soyez assez bonne pour nous donner votre opinion.
— Volontiers, répondit la sultane, écoutez-moi avec la plus grande attention. Il y avait non loin de Bagdad une chaumière habitée par un pauvre bucheron. Un jour un calender vint frapper à la porte.
Nous supprimons le reste du conte, pour qu’on ne nous accuse pas d’avoir inventé une mille et deuxième nuit. Nous verrons bientôt quel fut le moyen de guérison que Scheherazade fit adopter grâces à son apologue.
Pendant que le conseil délibérait, Schahriar se disait, en lançant au ciel l’odorante fumée de son narghilé : J’ai promis à la sultane de respecter sa vie ; mais je n’ai fait aucune promesse de ce genre au visir, ni aux ministres, ni aux grands de la cour ; si je leur faisais trancher la tête pour me distraire ? Comme il ruminait en lui-même cette pensée, les ministres et les grands de la cour demandèrent à être admis auprès de Sa Hautesse. Schahriar les fit introduire. Le visir se prosterna la face contre terre, baisa six fois les babouches de son maître :
— Fils du Prophète, s’écria-t-il, cœur de lion, trône de splendeur, mer de magnificence…
— Assez ! assez ! interrompit Schahriar, que me voulez-vous ?
— Nous voulons, sublime sultan, chasser les nuages qui volent autour de ton front, ramener le sourire sur tes lèvres, et rendre la sérénité à ton auguste face. Nous avons découvert un moyen de te distraire.
— J’en ai trouvé un aussi ; si le vôtre n’est pas meilleur, je l’emploierai : je suis décidé à vous faire trancher la tête.
Un long frémissement parcourut l’assemblée. Le visir poursuivit son discours d’une voix entrecoupée. En supprimant les citations, les métaphores, les épithètes oiseuses, ce discours, qu’on a conservé dans les archives de la cour de Perse, remplirait encore cinq livraisons de cet ouvrage. Nous priverons nos lecteurs de ce morceau d’éloquence ; nous leur dirons seulement que Schahriar adopta le moyen de distraction qu’on lui proposait, ce qui valut à la Perse environ trente têtes de plus, sans compter celle du grand visir.
Ce moyen, dû à l’imagination fertile de Scheherazade, consistait à faire entreprendre un voyage au sultan dans le but de découvrir quel était l’homme le plus malheureux de son royaume ; la philanthropie, employée comme passe-temps, n’est pas une invention aussi moderne qu’on pourrait le croire.
Le premier jour de la lune de Cheval, Schahriar se mit en route déguisé en marchand arménien, n’emmenant avec lui que le grand-visir, également travesti en marchand. Vers la treizième heure du jour, qui correspond à celle où l’on dîne, le sultan, dont la marche et le grand air avaient aiguisé l’appétit, proposa à son compagnon de frapper à la première habitation et d’y demander l’hospitalité. Ils se trouvaient en face d’une chaumière d’assez mince apparence, et comme il n’y en avait pas d’autre dans tout le voisinage, ils furent obligés d’y entrer.
Assis sur un banc de bois, entouré d’alambics et de cornues, le maître de la maison s’aperçut à peine de la présence des voyageurs. Il attisait le feu d’un fourneau situé au milieu de la salle, et ne perdait pas de vue le récipient placé au-dessus du feu. Tout à coup les flammes s’éteignirent, un charbon noir remplaça le liquide qui bouillait ; l’homme poussa un grand cri, et se roula par terre en s’arrachant les cheveux.
— Qu’avez-vous, mon ami ? lui demanda Schahriar avec bonté.
— Seigneur marchand, répondit-il, vous voyez le plus malheureux des hommes. J’ai trouvé le moyen de faire de l’or. Pour me livrer aux expériences nécessaires, j’ai aliéné mon héritage, et ma femme est morte de chagrin. J’allais recueillir le prix de mes sacrifices ; mais l’argent me manquait pour entreprendre l’expérience décisive ; alors le démon m’a tenté, et j’ai vendu mon unique enfant à des marchands d’esclaves. Vous venez de voir échouer ma dernière espérance ; il ne me reste plus rien, pas même de quoi souper !
Schahriar ordonna au visir de prendre le nom du chercheur d’or, et, après l’avoir inscrit sur un calepin, ils sortirent. L’alchimiste se nommait Nadir.
— Voilà un homme bien malheureux ! dit le sultan.
— Très-malheureux ! répondit le visir.
En causant ainsi, ils rencontrèrent un vieillard qui venait de puiser de l’eau à la rivière ; il marchait péniblement, s’arrêtant à chaque instant pour déposer son vase et le reprendre ensuite. La vieillesse indigente excite la pitié des âmes généreuses : ce spectacle émut Schahriar, il voulut connaître l’histoire du vieillard.
— Je m’appelle Ghaour, dit l’homme à la cruche ; depuis cinquante ans je m’occupe de la nature des choses et de l’essence de l’âme. J’étais riche, et un incendie a dévoré tous mes biens ; je ne regrette ni mes palais, ni mes meubles, ni mon argenterie, mais seulement ma bibliothèque. La vérité est dans les livres, comme vous savez ; et pour en acheter je suis obligé de boire de l’eau, de manger des racines, et de me servir moi-même ; je ne puis m’empêcher parfois de me trouver bien malheureux.
Le visir nota le nom de Ghaour sur ses tablettes.
Des sanglots qui partaient d’un bois voisin guidèrent le sultan vers un pauvre paysan qui pleurait abondamment, assis au pied d’un arbre. Schahriar s’informa des causes de sa douleur.
— Hélas ! répondit le rustre, j’aimais Fathmé, la plus belle fille du village ; en l’épousant je lui ai fait donation de mes biens ; maintenant qu’elle n’a plus rien à attendre de moi, elle me bat, elle me chasse de la maison pour faire chère lie avec d’autres, et quand je veux me plaindre on me rit au nez ; tout le monde se moque du pauvre Ferruch !
Le nom de Ferruch prit place à côté de ceux de Nadir et de Ghaour. En sortant du bois, ils virent s’avancer vers eux un individu déguenillé qui marchait en tournoyant sur lui-même avec une rapidité effrayante ; on eût dit un tourbillon vivant. Schahriar l’appelait en vain depuis plusieurs minutes ; l’individu ne se serait point arrêté, si un obstacle qu’il n’apercevait pas au milieu du chemin ne lui eût fait faire une cabriole dans la poussière.
— Pourquoi tournez-vous ainsi sur vous-même d’une façon si bizarre ? lui demanda Schahriar, en l’aidant à se relever.
— C’est ma manière de voyager. Je suis le derviche Ahmet, et pour une faute que j’ai commise on m’a condamné à aller ainsi jusqu’à la grande mosquée d’Ispahan. J’ai encore quinze jours de marche ; laissez-moi partir, car si je n’arrive pas à l’époque fixée, je suis perdu !
Ahmet reprit sa course, en laissant le sultan et le visir aussi surpris qu’affligés d’une telle infortune.
Nous ne parlerons pas des autres malheureux que rencontrèrent nos voyageurs philanthropes. Schahriar, embarrassé pour décerner le prix du malheur, résolut de les réunir à sa cour, de les interroger séparément, afin de prononcer avec connaissance de cause. Le sultan rentra dans Bagdad, et son premier soin fut de donner des ordres pour faire arrêter Ahmet partout où il tourbillonnerait.
Au jour fixé pour l’épreuve, Schahriar, entouré de toute sa cour, ayant à son côté Scheherazade, ordonna qu’on fît entrer successivement les malheureux qu’il avait découverts dans sa tournée. Aucun d’eux ne répondit à l’appel. Nadir avait vendu sa cabane, et sûr de réussir avec cet argent, les plaisirs de la cour ne pouvaient tenter un homme qui allait faire de l’or. Ghaour, sur le point de découvrir l’essence de l’âme, n’avait pas le temps d’interrompre ses méditations. Ferruch avait pardonné à sa femme ; il l’aimait trop pour la quitter un seul instant. Ahmet, saisi au passage, s’était échappé des mains des gardes, disant qu’il aimait mieux mourir que de renoncer à un pélerinage qui devait lui assurer le ciel. Les autres malheureux mirent en avant des prétextes semblables pour ne pas renoncer à leur malheur.
Schahriar commençait à trouver que pour se distraire il aurait mieux valu faire couper la tête au visir, aux ministres et aux grands de la cour, lorsque Scheherazade se tourna vers lui, et lui dit avec cette voix douce que les poëtes lauréats de Bagdad comparaient au murmure d’une fontaine :
— Prince, que ceci vous serve de leçon ; il n’y a de malheureux que ceux qui n’ont pas de désirs : alchimie, philosophie, amour, dévotion, tout ce qui remplit le cœur contribue à la félicité.
— Ces gens-là ne se trouvent pas malheureux, reprit Schahriar au comble de l’étonnement ; mais ils sont fous !
— À CHAQUE FOU PLAIT SA MAROTTE ! s’écria un petit homme contrefait qui s’était glissé au milieu des courtisans ; rends-moi la mienne, si tu veux que je vive.
En même temps, le nain favori se jeta aux pieds du sultan. Schahriar réfléchit pendant quelques instants ; puis il daigna sourire à toute la cour. Il faut, dit-il, une passion à l’homme ; j’ai déjà choisi la mienne. Un témoin oculaire de cette histoire raconte qu’en prononçant ces mots, il regarda tendrement la sultane.


LES CONSEILS DE L’ENNUI
SONT LES CONSEILS DU DIABLE

 rémond est-il arrivé ? demandait un matin à une femme de chambre un monsieur chauve qui venait de monter au deuxième étage d’une maison de la rue Saint-Honoré.
rémond est-il arrivé ? demandait un matin à une femme de chambre un monsieur chauve qui venait de monter au deuxième étage d’une maison de la rue Saint-Honoré.
— Entre donc, monsieur Bruneau, repartit une voix de l’intérieur ; et, presque aussitôt, on vit paraître au milieu de l’antichambre un gros bonhomme au teint fleuri, qui tenait d’une main un rasoir et de l’autre un pinceau.
— Eh bien ! as-tu réussi dans tes projets ?

— Lorsque Alhanase-Désiré-Jacques Brémond se charge d’une affaire, est-il dans l’habitude de ne pas réussir ?
— Ainsi, ta fille est fiancée ? reprit M. Bruneau après s’être assis dans un fauteuil, sa canne entre ses genoux et son chapeau sur sa canne.
— Ma Lucile est fiancée, et mon futur gendre arrive aujourd’hui même avec son père, M. Christophe Deschamps, d’Elbeuf.
— Et ta fourniture ?
— Elle est certaine ; les fonds sont prêts ; ma femme est l’amie de madame Ducornet, dont le mari, chef de division au ministère de la guerre, a promis de présenter le traité à la signature de Son Excellence. Madame Brémond le portera à madame Ducornet, apostillé d’une pièce de satin de Chine, qui nous est arrivée de Pékin, et dont notre protectrice a la plus grande envie pour paraître au bal de la cour. Ainsi tout est arrangé : le ministre signe le traité ce soir ; ce soir, nous signons le contrat, et tu vas m’accompagner pour acheter la corbeille de noces.
— Justement, j’ai une citadine à ta porte.
— Alors partons.
— Partons !… Mais n’as-tu rien à dire à ta femme ?
— Bah ! elle est maussade ce matin.
— Qu’a-t-elle donc ?
— Elle s’ennuie.
— Hein ! que dis-tu là ? elle s’ennuie !
— Eh bien ! oui, elle s’ennuie ! De quel air me regardes-tu ?
— Mon ami, sais-tu bien ce que c’est que l’ennui ?
— Quelle question ! Parbleu, oui, je le sais. L’ennui… Eh bien ! c’est l’ennui.
— Tu te trompes, monsieur Brémond ; l’ennui, c’est le diable. Quand madame Bruneau s’ennuie, j’ai peur.
À ces mots, M. Brémond regarda M. Bruneau, haussa les épaules, prit son chapeau et sortit.
Or, tandis que les deux amis montaient en citadine, madame Brémond, à demi couchée sur un sofa, dans son boudoir, laissait flotter ses rêveries au hasard. À quoi pensait-elle ? Dire qu’elle ne pensait à rien, c’est dire qu’elle pensait à tout. Madame Brémond était une femme à qui ses amies donnaient trente-neuf ans ; elle en avait donc trente-deux ou trente-trois. Les molles clartés qui filtraient par les persiennes voilées de stores, noyaient les lignes charmantes de son visage, et teignaient d’une lueur rose les plans nacrés de ses épaules. Ce matin-là madame Brémond s’ennuyait. Pourquoi ? Sa camériste, tout au plus, aurait pu le deviner. Elle-même l’ignorait certainement.
Pour ouvrir le cœur d’une femme à l’ennui, il est mille raisons ; pour le fermer, il n’en est qu’une. Or, madame Brémond était mariée depuis dix-sept ans.
Au bout d’une heure, n’entendant pas la sonnette de sa maîtresse, la camériste entra.
— Il est bientôt midi, dit-elle, madame veut-elle que je la coiffe ?
— Comme vous voudrez, Suzette.
Tandis que Suzette présidait à ces mille détails où les femmes déploient plus de diplomatie que des ambassadeurs dans un congrès, un violent coup de sonnette retentit à la porte.
— Madame, dit presque aussitôt une femme de chambre en passant sa tête derrière une portière, il y a là un monsieur qui demande à vous parler.
— Mais je ne puis recevoir personne…
— Personne, excepté un beau-père, interrompit une grosse voix ; et presque aussitôt un monsieur, gras, grand, vermeil et joufflu, se présenta au seuil du boudoir.
— M. Christophe Deschamps, dit-il en s’annonçant lui-même.
Madame Brémond s’inclina en s’efforçant de sourire.
— Je vous surprends dans l’asile des Grâces, Madame ; mais bah ! un beau-père a ses petites entrées partout. Parbleu ! j’en ai vu bien d’autres à Elbeuf ! Une belle ville, ma foi ! Connaissez-vous Elbeuf ? Non ? Après le mariage de mon fils, je vous y conduirai. C’est moi qui suis l’adjoint de l’endroit ; vous verrez ma fabrique et mon Casimir. Par le chemin de fer, c’est une bagatelle que ce voyage ; une petite maîtresse fait ça entre son déjeuner et son dîner. C’est plus difficile à moi qui fais mes cinq repas par jour. Mais bah ! en voyage comme à la guerre !… Mais, Madame, ne vous gênez pas pour moi ; continuez ; voyez, j’en agis sans façon, moi ; je m’installe.
Cette tirade avait été débitée tout d’une haleine, et, avant que madame Brémond eût trouvé le temps de glisser un mot, M. Deschamps s’était assis carrément sur l’ottomane de satin. En toute autre circonstance, madame Brémond aurait ri de tout son cœur ; c’était une femme d’esprit qui s’amusait des ridicules plus qu’elle ne s’en offensait ; mais en ce moment elle s’ennuyait.
Ses sourcils se froncèrent, et une moue dédaigneuse se dessina sur sa bouche ; à ce flux de paroles, elle ne répondit que par un regard glacial.
Mais M. Deschamps n’était pas homme à se déconcerter pour si peu ; il se répondit à lui-même, et la conversation recommença sous forme de monologue.
— Parbleu ! s’écria-t-il encore, j’ai grand’faim ; le voyage et le grand air m’ont mis en appétit. Nous allons déjeuner ensemble ; ce sera fort gai ; quand M. Brémond rentrera, il nous trouvera à table à côté l’un de l’autre. Eh ! eh ! il verra que nous avons fait connaissance sans lui.
— Merci, Monsieur ; je ne déjeune jamais, répondit d’un ton sec madame Brémond.
— Jamais ! s’écria le Normand ébouriffé.
— Jamais à midi. Suzette, donnez ordre qu’on serve à monsieur un pâté, quelque poulet froid, deux ou trois biftecks ; la moindre des choses enfin.
— Au moins me tiendrez-vous compagnie ? reprit M. Deschamps.
Au moment où madame Brémond allait répondre, la femme de chambre vint annoncer que M. Alfred de Lespars attendait madame au salon.
— Veuillez m’excuser, Monsieur, dit vivement madame Brémond ; c’est pour une affaire importante qui ne souffre aucun retard.
M. Deschamps, un peu étourdi, passa dans la salle à manger, où le pâté et le poulet lui firent oublier la moitié de sa déconvenue.
Or, l’affaire qui ne souffrait aucun retard n’était rien moins que l’offre d’un billet pour le bal de la liste civile. M. Alfred de Lespars était éloquent ; mais madame Brémond était ennuyée.
— La valse vous distraira, disait le dandy.
— Mais je n’ai pas de robe, répondait la dame.
Les femmes, eussent-elles mille robes, n’en ont jamais une la veille d’un bal.
— Voilà justement une pièce de satin d’un dessin merveilleux ; je suis sûr que votre faiseuse de modes est femme à tailler une robe dans une nuit.
— C’est vrai, dit nonchalamment madame Brémond.
— Croyez-moi, Madame, reprit le dandy insinuant, il faut combattre l’ennui par le plaisir ; le spleen est dangereux pour une jolie femme.
Madame Brémond sourit, hésita un instant ; mais la main de M. de Lespars avait déjà saisi le cordon de la sonnette. Suzette entra, et reçut ordre de porter tout de suite le satin chez la couturière.
Madame Brémond avait tout à fait oublié son amie, madame Ducornet.
M. Deschamps parut à cet instant à la porte du salon ; sa présence acheva d’irriter les nerfs de madame Brémond.
— Je ne vous dérange pas, j’espère ? dit le fabricant.
— Oh ! mon Dieu, non ; mais voilà justement M. de Lespars qui me priait d’aller choisir des bracelets, pour sa sœur, chez Janisset. Me permettez-vous de l’accompagner ?
— Faites, Madame, répondit M. Deschamps, qui semblait avoir perdu toute sa loquacité et sa joyeuse humeur.
Dix minutes après, madame Brémond, emmaillotée dans un cachemire, montait en calèche avec M. de Lespars.
— Au bois de Boulogne ! cria le valet de pied au cocher ; et la calèche partit.
M. Christophe Deschamps entendit la voix sonore du laquais ; il tressaillit, frappa de sa canne sur le parquet, enfonça son chapeau sur sa tête, et sortit avec fracas.
Vers le soir, M. Brémond et son ami M. Bruneau revinrent à la maison de la rue Saint-Honoré. Dix commissionnaires les suivaient, chargés de caisses et de cartons.
— Madame Brémond ? demanda M. Brémond à la camériste.
— Madame n’est pas rentrée ; mais voici deux lettres pour vous.
— L’écriture de mon ami Deschamps ! À quelle heure est-il arrivé ?
— Monsieur, il est parti à quatre heures.
— Parti ! qu’est-ce à dire ?
— Lis, et tu le sauras, fit observer M. Bruneau. M. Brémond ouvrit précipitamment la lettre.
« Je retourne à Elbeuf. Votre femme est peut-être charmante, mais elle n’a pas voulu se donner la peine de me le prouver. Je ne veux pas être pour elle un sujet de contrariété ; et, pour lui épargner l’ennui d’une présence trop assidue, je renonce pour mon fils à l’honneur d’entrer dans votre famille. Comptez toujours néanmoins sur mon amitié et mon crédit. »
— À l’autre, dit M. Brémond ; et une seconde fois il rompit le cachet.
« Madame Ducornet a vainement attendu madame Brémond toute l’après-midi ; je regrette infiniment que son absence ne m’ait pas permis de faire pour vous ce dont j’avais cru pouvoir vous donner l’espérance ; mais, vous le savez, une lettre était indispensable, et cette lettre que je devais soumettre à M. le ministre, je ne l’ai pas reçue. Dans la pensée que peut-être vous aviez renoncé à solliciter la fourniture, j’ai dû présenter un autre soumissionnaire, et S. E. vient de signer le traité.
« Madame Ducornet se rappelle au souvenir de madame Brémond, et la remercie de son offre obligeante. Elle a trouvé pour le bal de la cour une étoffe propre à remplacer la pièce de satin dont madame Brémond lui avait parlé. »
— Que signifie tout cela ? s’écria M. Brémond en froissant les deux lettres. Un mariage rompu et une fourniture manquée !
— Mon ami, ta femme s’ennuyait ; elle a suivi les conseils du diable. La voilà justement qui rentre avec M. Alfred de Lespars. Tu n’as plus qu’à prier Dieu pour que son ennui s’en tienne maintenant à la fourniture manquée et au mariage rompu.


À COLOMBES SOULES
CERISES SONT AMÈRES.

 l y a quelques années, les journaux signalèrent l’existence d’un club des Suicides, établi, disaient-ils, dans une ville d’Allemagne.
l y a quelques années, les journaux signalèrent l’existence d’un club des Suicides, établi, disaient-ils, dans une ville d’Allemagne.

Pour se créer des difficultés il suffit d’appartenir à la classe, hélas ! si nombreuse, des gens d’esprit. Les trois quarts du temps, — comme feu Gribouille, qui, pour éviter la pluie, se jetait dans la rivière, — ces honnêtes dupes du scepticisme s’appliquent à ne rien croire de ce qui est vrai pour arriver à douter de ce qui est faux : — et à ceci, par parenthèse, elles ne réussissent pas toujours.
Donc, cette fois encore, les gens d’esprit se trompaient ; le club des Suicides a existé, ou, pour mieux dire, failli exister… un jour seulement, il est vrai ; mais enfin ce jour-là mérite qu’on en parle. Sur lettres de convocation, dûment scellées et distribuées, plusieurs individus, de tout pays et de tout âge, se réunirent certain jour de certain mois, dans certaine maison de certaine rue, à Berlin ou ailleurs, pour y former le club en question.
La compagnie n’était pas nombreuse ; en revanche, on n’en eût pas trouvé facilement de plus choisie. Presque tous les membres étaient venus en carrosse, et avaient laissé aux portes une livrée nombreuse. La plupart d’entre eux portaient les insignes de quelque chevalerie ; énervés par les joies sensuelles, presque tous exhalaient les parfums excitants du musc ; et les cinq sixièmes marchaient à grand’peine, attardés par la goutte, cette maladie des millionnaires.
Une telle assemblée ne pouvait se passer d’un président anglais. Le plus morose et le plus jaune des nababs, Frédéric-James Mordaunt, de Calcutta, ex-payeur général de la compagnie des Indes, fut porté au fauteuil par un vote unanime, et par quatre grands Lascars à face cuivrée.
Pour tout remerciement, il croisa ses bras sur sa poitrine à la manière des idoles de Jaggernaut, et un interprète habile, qui ne le quittait jamais, se chargea de traduire ce geste en bon français ; — on ne s’exprime jamais autrement dans une réunion cosmopolite.
« Messieurs, dit-il, l’honorable esquire vous remercie de lui avoir décerné les honneurs de la présidence, et vous offre à chacun, — pour vous témoigner sa gratitude, — deux onces du meilleur opium qui se récolte dans le Haut-Assam. Il désire seulement que la pensée qui vous réunit, et l’opération qui doit en être la conséquence… »
Cet euphémisme gracieux excita un murmure d’approbation.
« Qui doit en être la conséquence, répéta l’orateur, ne soient obscurcies par aucun nuage, ni marquées par aucun désordre. Tout doit se passer décemment, avec entière connaissance de cause, à loisir, comme il sied à des gentlemen à qui la vie est devenue assez indifférente pour qu’une heure ou deux de plus à passer dans ce bas monde leur semble une bagatelle tout à fait insignifiante.
« Et, comme les honorables membres du club glorieux que vous allez instituer acceptent une véritable solidarité de principes, il est bon que chacun d’eux fasse agréer à ses futurs collègues les motifs de sa résolution suprême. Le président invite donc les candidats qui réclament leur admission à expliquer sommairement, l’un après l’autre, en commençant par le plus jeune, les raisons qu’il a de renoncer à l’existence. On statuera par un scrutin séparé sur le mérite de chaque candidature. »
La motion du président fut accueillie avec faveur, et les clubistes aspirants s’entr’examinèrent pour savoir qui parlerait le premier. Ce fut un Français qui se leva. Jehan Marcotteau avait dix-neuf ans, de trop longs cheveux, et aussi peu de mollets qu’une élégie moderne en comporte.
« Je veux me tuer, dit-il, procédant en vrai romantique par petites phrases courtes et saccadées. J’ai vécu un siècle en quelques jours. Tout homme m’est antipathique. Aucune femme ne me réjouit plus. Sardanapale était un innocent, au prix de votre serviteur ; Alcibiade, un épicier ; don Juan et Lovelace, deux crétins. Puis j’ai fait un drame, Messieurs. Je vous le jure, une œuvre cyclopéenne ! On l’a fort goûté, par malheur. J’espérais une lutte, des orages, quelque chose de grand, enfin, sur quelque mont Sinaï, couronné d’éclairs et de tonnerres. Mais on m’a traité comme le premier vaudevilliste venu. J’ai dû subir les bravos furieux de plusieurs centaines de croquants. Fatal et méprisable triomphe ! Ils m’ont souffleté de leurs applaudissements. Ils m’ont craché mon succès à la face. Donc je fus médiocre, ou du moins on peut dire de moi : Il fut médiocre un tel jour. N’est-ce point assez pour en mourir ? Qu’en pensez-vous, Messeigneurs ? »
Les sages de l’assemblée se regardèrent sans mot dire à cette bizarre interpellation ; puis on alla au scrutin, et le candidat fut exclu par un vote significatif. Silvio, bel Italien aux cheveux noirs, prit alors la parole.
« Je supplie, dit-il, vos excellentissimes Seigneuries d’écouter en toute faveur leur humilissime esclave. Les femmes, — que j’aime passionnément, — ont toujours fait le tourment de ma vie. Jadis, c’était par leurs rigueurs ; le tyran de Paphos jetait ses flèches de plomb à toutes les beautés dont le regard faisait couler dans mes veines le poison subtil de l’amour. Aujourd’hui, les choses ont changé de face. Comment vous dire, Excellences, sans blesser la modestie, que je suis le trop heureux objet de trois préférences, dont la moindre est bien au-delà de mes faibles mérites, et suffirait à combler mes vœux ? Il en est pourtant ainsi : trois zentil donne, toutes trois accomplies en mérite et en vertus singulières, ont abaissé leurs yeux sur moi. Pareil aux captifs de Mézence, mon pauvre cœur, tiraillé à droite et à gauche, comme par des cavales indomptables, est chaque jour prêt à se rompre. Folles querelles, jalousies insensées, ardeurs inquiètes, de tous côtés me minent et m’assiègent. À une journée sans repos succède une nuit orageuse ; à la tempête nocturne, un jour rempli d’alarmes. Autrefois, j’avais trois ressources contre le désespoir d’amour : l’opéra, l’atelier, les dolci. Mais, hélas ! l’une de mes amantes est prima donna ; la seconde, modèle en renom, a ses libres entrées chez tous les peintres ; la troisième tient le seul magasin de mustacciuoli et de pain d’Espagne où un honnête homme puisse aller se distraire. Elle seule a le dépôt des raviuoli de Santa-Chiara et des struffoli de San-Gregorio-Armeno. Ce fut même là, s’il m’en souvient, ce qui lui valut mes imprudents hommages. À présent que faire, sinon aller chercher aux sombres bords le repos qui me fuit ici bas ? Ce que me refuse le fils de Cypris, Pluton me l’accordera peut-être. Qu’en pensezvous ? »
Pour toute réponse, le président fit un signe à son interprète, et celui-ci alla demander à Silvio, le plus discrètement qu’il sût le faire, s’il n’aurait point sur lui par hasard les portraits de ses trois persécutrices. Silvio portait l’un à l’épingle de sa cravate, le second en médaillon, et le troisième en bracelet. Le président, après les avoir examinés, crut devoir les faire passer sous les yeux des assistants. C’étaient trois têtes charmantes, celle de la pâtissière surtout. Elles décidèrent la question contre le malencontreux Silvio, que le vieux Frédéric-James Mordaunt foudroyait de sa muette indignation. Pour se consoler du vote spontané par lequel on le mettait au ban du suicide, le bel Italien se fit apporter un poncio spongato, et savoura lentement ce délicieux sorbet.
« Le non-moi finit presque toujours par tuer le moi, s’écria d’une voix creuse mynheer Ulrichs Kupferberg, professeur allemand, dont le tour était venu… Et même quand le subjectif s’exécute lui-même, il n’est que l’agent de l’objectif. Supposons un exemple : si la trois fois heureuse assemblée, à qui je fais l’honneur de m’expliquer devant elle, parvenait à me comprendre et m’admettait dans son sein ; si, ensuite, détruisant les conditions de mon être individuel, je rentrais dans les vagues domaines de l’infini, quelle serait la cause de cette dissolution, de ce divorce amiable, prononcé entre mon corps et mon âme ? Une cause seconde, une fortuité, pas autre chose ; un simple malentendu de ce πρόπρωτον mystérieux que le vulgaire appelle Providence. Pourquoi m’a-t-il placé, moi voyant, dans un milieu de ténèbres ? Pourquoi m’a-t-il donné, — j’établis à regret ce fait qui vous désobligera peut-être, — la perception interne de mon ineffable supériorité sur tous les êtres créés avant ou en même temps que moi ? Est-ce ma faute si je suis investi de facultés inouïes dont l’exercice m’est interdit ? Voici ce qui m’arrive. À force de travailler la raison pure et les idées innées, non-seulement j’ai constaté ce fait important que l’âme est un être multiple, mais je suis parvenu à dédoubler mon moi. Je puis le transmettre à un autre sans cesser pour cela de le posséder, et prouver par là même que l’âme humaine n’est pas identique, ainsi que l’enseignent les ânes bâtés de l’École française. J’ai donc tout simplement mis la main sur la pierre philosophale du monde métaphysique. J’ai en poche la plus nouvelle de toutes les vérités connues, et probablement la solution de tous les problèmes à venir. Ce n’est point, vous le pensez, un bonheur médiocre. Maintenant, depuis que je suis en possession de ce merveilleux dictame, je n’ai pu ni l’expérimenter pour moi-même, ni l’appliquer de manière à convaincre les autres. La faute en est à mon siècle, qui ne me fournit pas un être égal à moi. Or, le contenant ne peut pas être plus petit que le contenu. Mon âme ne saurait entrer dans un autre vase intellectuel, si ce vase n’a point la même capacité, les mêmes moyens d’abstraction, de généralisation, etc., etc., qui m’ont été trop généreusement départis ; et j’ai acquis à mes dépens la triste conviction que pas un être humain n’est assez vaste pour servir à mes projets. Un esprit où l’orgueil régnerait en maître serait particulièrement flatté de cette circonstance ; mais le vrai savant ne saurait supporter un isolement pareil. Donc, si bornés que le ciel vous ait faits, vous comprendrez que je ne puisse point habiter une sphère trop étroite, dont mon œil a dépassé les limites. Je pars, géant désolé de vivre parmi des nains, et vraiment malheureux d’avoir deux ou trois siècles d’avance sur ma déplorable époque. Vous ne voudriez pas, je pense, vous opposer à ce grand acte de justice distributive, à cet ostracisme nécessaire. »
Personne ne répondit ; et cela par une raison majeure, c’est que tout le monde était endormi. On eut grand’peine à réveiller assez de votants pour exclure l’ennuyeux pédant qui venait de parler. Il sortit de la salle en se frottant les mains, et on l’entendit se féliciter d’être inintelligible, malgré tous les efforts qu’il avait faits pour se mettre au niveau de son auditoire.
L’épreuve continua trois heures, absolument comme elle avait commencé. Ambitieux trop promptement satisfaits, ou bien désappointés par une victoire incomplète ; Crésus dégoûtés de la richesse par la satiété qu’elle entraîne ; voluptueux fatigués de l’amour par de trop faciles plaisirs, tous ces convives se plaignaient de la vie comme d’un banquet trop riche et trop abondant. Aussi, pas un d’eux ne trouva grâce devant ses juges, et le résultat final du scrutin laissa le président isolé dans son fauteuil, en face d’une quadruple rangée de banquettes vides.
Cette conclusion, tout à fait imprévue, le contraignit à s’examiner lui-même avec plus de sévérité qu’il n’avait fait jusque-là.
— Damn’ye s’écria-t-il, s’adressant à son interprète, je ne suis pas très-certain de n’être pas aussi absurde que ces impudents camarades. La seule bonne raison que j’aie de m’envoyer dans l’autre monde, c’est que je ne puis plus digérer l’excellent curry dont mon cuisinier parsis possède seul la recette, et que j’aime par-dessus toute chose. Peut-être n’est-il pas tout à fait raisonnable de se tuer parce qu’on a le meilleur cuisinier des cinq parties du monde.
— Si Votre Honneur me demande mon avis là-dessus, répliqua le docile truchement, je lui apprendrai que je connais cent cinquante millions d’hommes très-heureux de vivre, et qui jamais n’ont mangé autre chose que du riz bouilli sans sel ni poivre. Mais tout dépend des circonstances, et une trop grande prospérité gâte bien des choses. Comme l’a dit un sage derviche,



QUI M’AIME AIME MON CHIEN

 on ami Auvray est-il chez lui ?
on ami Auvray est-il chez lui ?
— Non, Monsieur, il est sorti ; mais Murph y est, et si vous désirez le voir…
— Comment ! si je le désire ? mais c’est un devoir, une obligation… Ce cher Murph ! trop heureux vraiment qu’il veuille bien me recevoir !…
Mon ami Auvray est fort élégamment meublé, comme tous les gens qui ont un tant soit peu de goût et beaucoup d’argent. Après avoir traversé une pièce dans le style renaissance, une autre dans le style Louis xv, j’arrivai dans une dernière pièce qui n’est d’aucun style, mais où l’on a réuni tout ce qui peut flatter les goûts d’un chien gastronome et blasé : coussins, oreillers, massepains, pâtes, confitures. Comme j’espérais trouver Murph au gîte, j’avais eu soin de me munir d’avance de pralines à l’ananas ; c’est un bonbon entièrement inédit, et dont je voulais lui offrir la première édition.
Je plaçai sur son oreiller deux ou trois pralines qu’il contempla pendant quelques instants d’un air pensif, en clignotant de la prunelle, avec une impertinence adorable. Enfin, il se décida à toucher une des pralines d’une langue mélancolique et languissante ; il finit par en croquer une, puis deux ; je m’aperçus que la praline à l’ananas était comprise, et, tandis qu’il achevait le sac, je me mis à considérer les portraits qui garnissaient le boudoir. Murph avait été représenté dans toutes les attitudes, à l’huile, au crayon, à la gouache, à l’aquarelle. Les glaces multipliaient son image.
Tandis que j’étais absorbé dans cette contemplation, mon ami Auvray rentra ; il m’indiqua d’un air d’abattement l’ottomane sur laquelle Murph était couché.
— Voici trois grands jours, me dit-il, qu’il n’a quitté ce coussin ; il ouvre à peine les yeux quand il me voit ; je ne sais même pas s’il me reconnaît… Il n’a absolument voulu prendre depuis ce matin qu’une tasse de café, une douzaine de biscuits de Reims, plusieurs tranches de baba au rhum, du gâteau de fleur d’orange, des meringues à la vanille, quelques verres de chocolat glacé, de la gelée de cédrat et des framboises de Bar…
— Et des pralines à l’ananas, ajoutai-je en poussant un profond soupir.
— Ah ! c’est vous qui les lui avez apportées, reprit Auvray ; et en a-t-il goûté ?
— Il vient d’achever la demi-livre.
— Merci, merci, me dit-il d’un ton pénétré en me serrant la main ; il n’y a que vous au monde avec moi qui le compreniez. Je l’ai quitté pendant quelque temps, car vous savez que je passe tous les jours trois ou quatre heures à la Bibliothèque du Roi, où je rassemble les documents qui me sont nécessaires pour dresser son arbre généalogique… J’ai découvert que Murph n’avait guère une origine moins ancienne que nous autres Français, qui descendons tous, comme vous le savez, de Francus, fils d’Hector. Nous descendons des Troyens ; mais Murph descend des Grecs par le chien d’Ulysse, qui vint mourir aux pieds du héros, à son retour dans l’île d’Ithaque… J’ai lu une dissertation insérée dans les Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans laquelle un savant archéologue prouve clairement que ce chien d’Ulysse ne pouvait être qu’une chienne ; il appuie son opinion sur des raisons au moins aussi solides que celles de Zadig quand on l’accuse d’avoir volé l’épagneule de la reine sur les bords de l’Euphrate. Cette chienne, avant de mourir, avait mis bas afin de ne point laisser périr sa race, et son rejeton a dû être un des ancêtres de Murph. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à jeter les yeux sur le quadrupède antique trouvé dans une niche d’Herculanum, et connu dans l’archéologie sous le nom du petit-fils de la chienne d’Ulysse ; c’est absolument le poil, le regard, le crâne, le museau de notre chère idole. J’enverrai une note à ce sujet à l’Annuaire historique.
Comme Auvray achevait sa dissertation, un domestique entra, et lui annonça que quelqu’un désirait lui parler.
— Je n’y suis pas ! dit-il brusquement en continuant à contempler Murph.
— Mais, Monsieur, il s’agit d’une affaire très-grave… Auvray fit un geste d’impatience et sortit brusquement, se promettant bien de congédier promptement l’importun qui venait ainsi l’arracher à la plus délicieuse des extases.
J’entendis aussitôt dans l’antichambre s’élever la voix d’Auvray, qui paraissait en proie à une émotion violente. Son accent s’abaissait par moments, mais pour s’élever bientôt de plus belle. Je ne pus m’empêcher d’être inquiet ; quant à Murph, sa tête, ses pattes, ses oreilles, ne témoignèrent pas la moindre émotion ; tout son corps conserva sa pose indolente et égoïste. Une telle froideur chez un être enveloppé de tant de sollicitude et de sucreries commençait à m’exaspérer, lorsque heureusement Auvray rentra dans le boudoir. Je ne pus me défendre d’un sentiment de compassion en jetant les yeux sur lui : il était pâle, haletant, aussi hérissé que Murph était lisse et calme.
— Voyez, me dit-il en me présentant un papier timbré, voyez ce qui m’arrive. Ah ! je n’y survivrai pas ; ils ont juré de me tuer !
Il se laissa tomber sur l’ottomane où reposait Murph au milieu d’un rempart de dragées. Je lus le papier ; c’était une assignation pour paraître devant le juge de paix, à l’effet de s’entendre avec une certaine marquise de Saint-Azor, qui réclamait un chien à elle appartenant, connu maintenant sous le pseudonyme de Murph, mais dont le vrai nom était Fortuné. Ce chien avait été dérobé par un domestique qui avait dû le vendre, sous un faux nom, à un marchand de chiens du boulevard Beaumarchais, dans la boutique duquel le maître actuel l’avait sans doute trouvé.
— Eh bien ! puisqu’elle le veut, nous plaiderons ! s’écria Auvray quand j’eus achevé de lire l’assignation ; mais ils m’arracheront l’âme plutôt que de m’arracher Murph !
— Oui, nous plaiderons ! m’écriai-je en m’associant à son transport ; et je ne pus m’empêcher de songer aux plaidoiries de Petit-Jean et de l’Intimé ; mais je me gardai bien de laisser paraître sur mes traits le moindre symptôme facétieux.
— Ce qu’il y a de pis, ajouta Auvray, c’est qu’on exigera sans doute que Murph paraisse en justice, et le médecin a expressément défendu qu’on l’exposât au grand air ; il est horriblement enrhumé du cerv…, du museau…
Pour calmer ses inquiétudes, je m’engageai à voir moi-même cette marquise de Saint-Azor, et à faire tous mes efforts pour arranger l’affaire à l’amiable. J’eus le bonheur de réussir dans ma négociation diplomatique, et je revins annoncer à Auvray que l’ancienne maîtresse, ou plutôt l’ancienne esclave de Murph dit Fortuné (c’était le langage de la marquise), consentait à couper le différend par la moitié.
— Couper Murph en deux ? interrompit Auvray ; mais c’est donc le jugement de Salomon !
— Non, lui dis-je, vous conserverez Murph tant qu’il voudra ; mais madame de Saint-Azor exige que, lorsque le chien ira visiter le royaume des ombres, vous lui remettiez son corps… Elle veut le faire gannaliser…
— Gannaliser ! reprit Auvray, Murph ! N’importe, j’y consens ; qu’on dresse l’acte, je le signerai puisqu’il faut que je me résigne à placer mes affections en viager, et à voir gannaliser un jour la plus chère moitié de moi-même !
Quelque temps après cette affaire, un mariage des plus avantageux s’offrit pour Auvray. Il n’avait guère que trente mille livres de rentes ; l’héritière qu’on lui proposait en avait plus de soixante, sans compter les oncles atteints d’hydropisie, les tantes asthmatiques, les grands parents paralytiques et goutteux, et beaucoup d’autres maladies que dans les familles on est convenu d’appeler des espérances.
Les amis d’Auvray comptaient sur cette union pour le détacher un peu de Murph ; mais cette liaison était de celles qui ne se dissolvent que par quelque événement plus miraculeux que ne l’est un mariage. Auvray se décida à aller faire sa cour, à condition toutefois que son chien ne le quitterait pas. Le médecin avait consenti pour cela à lever la consigne ; il répondait des influences atmosphériques, mais non pas des influences morales qui, chez les chiens impressionnables, sont indépendantes du baromètre.
Auvray se présenta chez sa future avec un bouquet de fleurs à la main droite, et son chien Murph sous le bras gauche. On voulut bien adresser au chien quelques compliments pour la forme, auxquels celui-ci ne répondit que par un grognement sourd et disgracieux. Auvray s’approcha de sa prétendue, et commença à lui adresser de ces douceurs officielles qui sont le prologue obligé de tout hymen intéressé ou non. Mais à peine eut-il commencé à prendre une attitude galante, que Murph, qui était d’une jalousie extrême, et ne pouvait comprendre que son maître adressât à un autre que lui ses attentions et ses prévenances, se mit à pousser des cris d’Othello si perçants, qu’il fit trembler les vitres, et rendit bientôt tout dialogue impossible. On chercha à l’apaiser, on lui fit respirer des sels anglais, on lui bassina les tempes avec du vinaigre de la reine Pomaré ; rien ne put calmer ses cris ni ses nerfs. Le coup était porté, et Auvray vit bien que le plus court parti était de l’emmener. Il fit approcher une chaise à porteurs jusque sous le vestibule, et placer sur la banquette de derrière l’infortuné Murph qui continuait ses gammes chromatiques.
Le soir même de cette scène, Murph fut pris d’une fièvre violente qui ne fit qu’augmenter d’heure en heure pendant la nuit ; et le lendemain, au point du jour, il se trouva si accablé, si affaibli, qu’on désespéra de le sauver. On eut beau lui prodiguer les remèdes les plus empressés et les plus tendres, on ne put parvenir à renouer la trame de ses destinées ; quelques heures après, Murph était devenu la proie de la Parque et de M. Gannal.
Je n’ai pu savoir en détail ce qui se passa dans la maison d’Auvray pendant les premiers jours qui suivirent la mort de son chien ; je sais seulement que sa porte fut fermée à tout le monde. J’étais de tous ses amis le seul qu’il eût conservé ; moi seul comprenais Murph ; moi seul avais su respecter cette étrange passion. Mais le désespoir d’Auvray était si profond, que ma vue seule eût irrité ses peines ; comme la Matrone d’Éphèse, il était résolu à se laisser mourir dans une solitude complète.
Murph était mort depuis trois mois, et je me croyais à jamais séparé du sensible et malheureux Auvray, que je regardais comme enseveli dans son deuil, lorsqu’un matin je reçus un billet de notre ami commun, l’illustre et spirituel docteur B…, qui m’invitait à me rendre chez Auvray sur-le-champ.
Je fus introduit dans le boudoir où Murph avait coulé jadis des jours filés de sucre et de vanille. Quel fut mon étonnement lorsqu’en entrant je m’aperçus que tous les portraits du chien avaient disparu, et se trouvaient remplacés par les armures orientales, les boucliers, les flèches et les pipes turques, qui garnissaient les murailles de cet asile avant que Murph n’eût remplacé tous les goûts dans le cœur de son maître, même le goût du tabac !
— Il est guéri, entièrement guéri, me dit le docteur B… du plus loin qu’il m’aperçut, et c’est surtout à vous que nous devons cette cure ; vous avez compris que cette monomanie si étrange, que dans la médecine moderne nous appelons la cynophilie, devait avoir son cours. Ce qui la rend si souvent incurable, c’est que, lorsqu’une personne idolâtre quelque caniche ou quelque épagneule, presque toujours on la heurte, on veut la railler, tandis qu’il faudrait au contraire entrer dans sa passion.
— Oui, je sais tout ! s’écria Auvray en sortant précipitamment d’une pièce voisine : C’est vous, ô le modèle des amis ! qui avez inventé toutes sortes de stratagèmes pour amuser à la fois et guérir ma faiblesse. J’aimais un chien, et vous m’aimiez encore !… Mais où donc avez-vous puisé tant de complaisance et d’abnégation ?
— Tout simplement, lui répondis-je en souriant, dans le Livre des Proverbes, où j’ai trouvé une vieille phrase qui m’a paru être une excellente recette contre votre folie.
— Quelle est cette phrase ?
— Eh ! vous la connaissez mieux que moi, mon cher Auvray ; ne m’avez-vous pas répété cent fois du vivant de Murph :


BREBIS COMPTÉES
LE LOUP LES MANGE

 ur les bords du Lignon, ce beau fleuve au cours tortueux et sentimental près duquel tant d’amants ont vécu de soupirs et de larmes, un jeune berger menait paître ses brebis. Il n’avait rien de commun avec les bergers de l’Astrèe ; il ne s’appelait ni Lindamor, ni Sylvandre, ni Alcidore, ni Artamène ; il s’appelait Guillot tout court, et ne portait ni rubans à sa houlette, ni rose à son chapeau. Il avait dix-huit ans, et ce bouquet-là en vaut bien un autre ; deux yeux noirs, brillants comme deux soleils, et au milieu de tout cela un air d’innocence et de naïveté qui ne nuisait pas à la beauté de son visage.
ur les bords du Lignon, ce beau fleuve au cours tortueux et sentimental près duquel tant d’amants ont vécu de soupirs et de larmes, un jeune berger menait paître ses brebis. Il n’avait rien de commun avec les bergers de l’Astrèe ; il ne s’appelait ni Lindamor, ni Sylvandre, ni Alcidore, ni Artamène ; il s’appelait Guillot tout court, et ne portait ni rubans à sa houlette, ni rose à son chapeau. Il avait dix-huit ans, et ce bouquet-là en vaut bien un autre ; deux yeux noirs, brillants comme deux soleils, et au milieu de tout cela un air d’innocence et de naïveté qui ne nuisait pas à la beauté de son visage.
Les jeunes bergères du voisinage, qui passaient leur temps à courir le long du fleuve en cueillant des fleurs et en récitant des vers, lui disaient sans cesse :
— Viens avec nous, Guillot, viens t’asseoir sous ces arbres touffus ; nous raconterons tour à tour quelque histoire d’amour, et quand nous aurons achevé nos récits, nous nous mettrons à danser, et tu nous joueras tes plus jolis airs sur ta musette.
— J’ai bien le temps vraiment, répondait Guillot, d’aller avec vous danser et me divertir ; et mes brebis, qui les gardera ? Savez-vous bien que si je m’écarte un seul instant le loup peut venir et m’emporter la plus belle ?
À peine avait-il prononcé ces mots qu’il aperçoit sur la crête de la montagne voisine une brebis noire qu’il reconnaît pour être une des siennes. Il veut la rappeler, la contraindre à rejoindre le troupeau ; mais il est déjà trop tard, le loup paraît, l’emporte et s’enfuit de l’autre côté de la montagne. Pauvre Guillot !
— Maudit loup ! que ne m’emportes-tu avec ma brebis ! s’écrie-t-il.
Le soir, il revint à la ferme abattu, consterné ; Robin le fermier ne plaisantait pas quand il s’agissait de son troupeau : Guillot eut beau se jeter à ses genoux en pleurant, lui jurer que, si le loup avait emporté une de ses brebis, ce n’était pas faute de les avoir comptées ; tout cela n’empêcha pas que Robin ne l’attachât à un arbre et ne lui donnât autant de coups de bâton qu’il y avait de brebis dans le troupeau. Le pauvre Guillot n’entendait rien au calcul ; mais il connut bien ce soir-là le nombre de ses brebis : ce fut là sa première leçon d’arithmétique.
Le lendemain, il était sur pieds avant le jour, non pas pour voir lever l’aurore, mais pour panser ses meurtrissures. Il se rendit tout boitant, tout perclus, le long du Lignon, à sa place ordinaire, à l’endroit où l’herbe était la plus épaisse et la plus touffue. Il marchait tristement derrière ses brebis ; mais quand les nymphes et les autres bergers, tous accoutumés aux mœurs de l’églogue, virent paraître Guillot avec un bras en écharpe, un bandeau sur l’œil et un emplâtre à la place du cœur, ils furent saisis d’indignation. Le fameux Céladon proposa de punir le fermier Robin en le traitant comme Virgile traita Mévius, c’est-à-dire en composant contre lui des vers satiriques que l’on graverait sur l’écorce de tous les hêtres d’alentour.
— Hélas ! dit Guillot, le mieux est encore, je crois, de bien compter mes brebis.
Il aperçut dans les environs une grotte profonde, et il imagina, à l’imitation d’un de ses confrères, le fameux berger Polyphème, dont il n’avait assurément jamais entendu parler, de faire entrer dans cette grotte ses brebis une à une, afin de les compter plus à l’aise et de les garder ensuite en se plaçant en sentinelle à la porte. Il en fit entrer une, puis deux ; mais comme il allait en faire entrer une troisième, le loup, qui se trouvait blotti dans le fond de la grotte, s’élança tout à coup en tenant la première brebis dans sa gueule.
Guillot voulait se précipiter dans le Lignon ; les autres bergers lui firent remarquer qu’il n’aurait de l’eau que jusqu’à mi-jambe, et qu’il serait à la fois plus doux et plus poétique de se laisser mourir de mélancolie et d’essayer de se noyer dans les larmes. Qui sait ? peut-être quelque divinité favorable fmirait-elle par le changer en fontaine.
En attendant cette métamorphose, Guillot regagna la ferme à la nuit tombante ; et Robin, qui la veille avait eu le soin de ne le fustiger que sur le côté droit afin de se réserver tout le côté gauche en cas de récidive, ne tarda pas à établir le plus juste équilibre entre les étrivières de la veille et celles du jour. Guillot passa la nuit à compter ses brebis sur ses cicatrices.
Le soleil levant lui suggéra un autre stratagème ; il emprunta à Hylas, un des bergers les plus tendres et les plus littéraires du Lignon, des tablettes sur lesquelles celui-ci avait l’habitude d’inscrire des devises et des madrigaux. Guillot, qui avait de bonnes raisons pour n’avoir pas la fibre poétique très-développée, employa ces tablettes à fabriquer des numéros qu’il attacha au cou de chacune de ses brebis, afin d’en rendre le dénombrement plus facile. Mais ces numéros furent pour le loup comme un point de mire.
Guillot achevait à peine de numéroter la dernière, et la tenait encore entre ses jambes, quand le loup, qui s’était mis en embuscade derrière un bouquet de bois, s’élança d’un bond. Guillot poussa un cri, mais trop tard ; le n° 13 était déjà dans la gueule du ravisseur, qui regagna la forêt après avoir donné cette autre leçon de soustraction au pauvre Guillot.
Le soleil se coucha sur les nouvelles contusions du jeune berger ; mais le lendemain, quand il conduisit son troupeau le long du fleuve, on eût cru voir en lui un tout autre berger. Lui d’ordinaire si triste, si grave, qui ne cessait d’avoir les yeux attachés sur ses brebis, les comptant et les recomptant sur ses doigts tout le long de la journée, semblait maintenant avoir livré aux zéphyrs du Lignon ses soucis et ses calculs ordinaires.
Il cueillit dans les bois voisins autant de fleurs sauvages qu’il en eût fallu pour illustrer plusieurs livres aussi gros que la fameuse Guirlande de Julie, qui était sous presse en ce moment : il mit à son chapeau, à son côté, à son front, à ses jarretières toutes sortes d’emblèmes odoriférants qui répandaient autour de lui les plus suaves haleines de l’aube et de la rosée. Il alla ensuite prendre place au milieu des bergers et des bergères qui se trouvaient autour d’une fontaine rangés en décaméron, et il raconta une histoire des plus longues et des plus langoureuses. Quand les danses se formèrent, il fut des premiers à y prendre part. Les nymphes, qui ne l’avaient vu jusqu’alors que sous les tristes couleurs de l’arithmétique pastorale, le félicitèrent sur sa métamorphose ; l’une d’elle lui proposa de visiter avec elle le village de Petits soins, l’autre de naviguer sur le fleuve du Tendre.
Quand Guillot eut ainsi passé la journée à danser et à se divertir, il ne douta pas qu’il ne dût lui manquer au moins trois ou quatre brebis, car il n’avait pas même jeté les yeux sur son troupeau ; mais il avait pris d’avance son parti.
— Puisqu’en comptant mes brebis, s’était-il dit, j’en trouve toujours quelqu’une de moins, je ne cours aucun risque à ne les pas compter ; et si je suis sûr d’être battu en rentrant à la ferme, autant vaut-il m’être diverti le long du jour.
Mais quelle fut sa surprise, lorsque le soir, en faisant son dénombrement, il s’aperçut que pas une ne manquait à l’appel ! Robin, le fermier, le complimenta de ce qu’il avait enfin appris à faire bonne garde.
Le lendemain, les choses allèrent de même ; Guillot résolut de ne s’occuper que de danses, de tendres propos et de chansons, sans même s’inquiéter si le loup venait ou non rendre visite à ses brebis. Cette nouvelle manière de garder son troupeau lui réussit également ; mais il comprit bientôt pourquoi le loup était devenu tout à coup si humain. Un jour qu’il jouait de la musette au milieu des autres bergers, s’étant retourné par hasard, il aperçut derrière un arbre voisin le loup qui se tenait les pattes croisées, la tête inclinée, dans une attitude d’extase et de dilettantisme, prêtant l’oreille aux jolis airs que jouait le jeune berger. La musette de Guillot le transportait dans le troisième ciel ; pouvait-il songer à croquer ses brebis ?
Guillot rentrait chaque soir à la ferme couronné de fleurs et de rubans que lui donnaient les nymphes du Lignon ; on l’eût pris pour un dieu, tant il était vif, aimable, brillant. Lui, naguère pauvre et triste compteur de brebis, gardait maintenant son troupeau comme Apollon avait autrefois gardé celui d’Admète, avec des vers et des chansons.
Robin le fermier avait une fille très-jeune et très-belle nommé Gillette, qui devint éperdument éprise de Guillot, et finit par déclarer à son père qu’elle n’aurait jamais que lui pour époux. Robin, qui avait depuis longtemps renoncé à donner des coups de bâton à Guillot et qui savait qu’il est impossible de contrarier les inclinations des filles du Lignon, n’essaya pas, suivant l’habitude des pères de s’opposer aux sentiments de Gillette. Il craignait d’ailleurs les madrigaux, les chansons, les devises tendres qui couraient le pays, et préféra envoyer Guillot et Gillette droit à l’église, afin de les soustraire à l’influence de l’églogue.
Peu de temps après ce mariage, le fermier Robin mourut ; il laissa sa ferme à Guillot, qui eut des bergers à son tour, mais qui leur recommanda surtout de ne jamais compter ses brebis, sachant par expérience ce qu’il en coûte pour faire ce compte. À force de passer son temps avec Astrée et Céladon, il avait fini par exprimer ses pensées sous une forme mythologique : — Le mieux, disait-il, est de recommander son troupeau à Pan, à Palès et aux autres divinités champêtres.
Guillot devint le plus riche fermier du Forest et en outre le plus heureux des époux ; Gillette effaçait toutes les autres fermières par sa beauté et sa fécondité : chaque année elle mettait au monde une fille, si gracieuse et si jolie qu’avant qu’elle eût atteint l’âge de sa première dent, les autres bergers lui avaient déjà adressé des sonnets, et toutes sortes de galanteries champêtres. Guillot eut ainsi successivement d’années en années jusqu’à neuf filles, qui furent comparées aux neuf Muses et baptisées sous des noms poétiques.
Mais, une année après avoir mis au monde la dernière, Gillette mourut, et Guillot se trouva seul, ayant à élever et à surveiller neuf merveilles, neuf astres, neuf divinités, dont une seule eût suffi pour devenir l’Hélène du Forest et bouleverser ces lieux fabuleux et enchanteurs que nous appelons aujourd’hui le département de la Loire.
Guillot laissa grandir ses filles, et parvint à un temps où la plus jeune avait treize ans à peine et où l’aînée n’en avait

Cependant, un des seigneurs du voisinage voulut, à la fête du pays, qu’on lui désignât la fille la plus sage pour lui décerner de ses mains la couronne de rosière. Ce fut à qui lui indiquerait les neuf filles du fermier Guillot, qui avaient eu le mérite d’être restées toujours pures et vertueuses au milieu des bergers les plus tendres.
Le seigneur regretta de n’avoir pas à distribuer neuf couronnes ; mais pour éviter que la jalousie se mît entre ces charmantes sœurs, il sépara la couronne en neuf parties égales et remit à chacune une rose blanche. Guillot était vieux alors, et comme il regardait avec attendrissement cette cérémonie, le seigneur, qui faisait des rosières pour se consoler d’avoir vu sa fille aînée s’échapper récemment d’un couvent très-austère sous la conduite d’un page d’Anne d’Autriche, dit au fermier :
— Maître Guillot, pour conserver ainsi vos neuf filles si pures, si sages, vous avez dû prendre de grands soins, les surveiller nuit et jour ?…
— Point du tout, Monseigneur, répondit Guillot avec naïveté ; je les ai au contraire laissées entièrement libres ; je me suis contenté d’invoquer un vieux proverbe dont j’ai reconnu la vérité quand j’étais berger, et qui m’a appris par expérience que :


À CHAQUE SAINT SON CIERGE

 e toutes les académies la plus illustre est sans contredit celle de Pékin ; elle fut fondée environ six mille ans avant la nôtre, ce qui ne l’empêche pas de travailler encore à un dictionnaire de la langue chinoise : nous aurions tort, on le voit, d’accuser la lenteur de nos académiciens. Cette académie se compose, du reste, de quarante membres qui prennent de leur vivant le titre d’immortels ; ils ont en outre le droit de porter des palmes vertes sur leur robe, et d’entrer sans passe-port dans les musées. Il n’est pas absolument nécessaire d’avoir du génie pour faire partie de l’académie de Pékin. En beaucoup de points, cette académie se rapproche de celle de Paris.
e toutes les académies la plus illustre est sans contredit celle de Pékin ; elle fut fondée environ six mille ans avant la nôtre, ce qui ne l’empêche pas de travailler encore à un dictionnaire de la langue chinoise : nous aurions tort, on le voit, d’accuser la lenteur de nos académiciens. Cette académie se compose, du reste, de quarante membres qui prennent de leur vivant le titre d’immortels ; ils ont en outre le droit de porter des palmes vertes sur leur robe, et d’entrer sans passe-port dans les musées. Il n’est pas absolument nécessaire d’avoir du génie pour faire partie de l’académie de Pékin. En beaucoup de points, cette académie se rapproche de celle de Paris.
L’immortel Hiu-Li venait de mourir. Ce Hiu-Li avait fait un bon mot à l’âge de quarante ans. Ce bon mot avait été raconté chez le gouverneur de la province, qui le répéta à une soirée du premier ministre, qui en parla à l’empereur. Sa Majesté ayant daigné rire, Hiu-Li fut proclamé un des hommes les plus spirituels de la Chine, et l’académie n’hésita pas à l’appeler dans son sein. Hiu-Li vécut sur ce bon mot, et mourut sans en avoir fait d’autre.
Quelques jours après la mort de Hiu-Li, un écrivain dont la réputation est sans doute venue jusqu’à vous, le célèbre Fi-Ki, rédacteur de la Revue de Pékin, s’adressa la harangue suivante :
« Voilà bientôt dix ans que tu tiens le sceptre de la critique dans un des recueils les plus estimés de la Chine, et par conséquent de l’univers. Tu as dit tour à tour du bien et du mal de toutes les écoles ; tu as su distribuer l’éloge avec une sage profusion ; il faut voir maintenant combien l’encens rapporte. Tu deviens vieux, le public commence à se lasser de tes articles ; le moment est venu de faire une fin ; tâche d’entrer à l’académie : une fois immortel, c’est bien le diable si l’on ne te nomme pas bibliothécaire ; tu achèveras ainsi ta vie au sein d’une médiocrité dorée, comme dit un de ces poètes de l’Occident dont je parle déjà, comme si j’étais académicien, sans les connaître. »
Fi-Ki trouva son raisonnement fort juste. Il se fit faire la queue, mit une plume neuve à son bonnet, endossa sa plus belle robe, et loua un palanquin à l’heure pour aller faire ses visites.
À Pékin, comme à Paris, les candidats à l’académie sont obligés de se présenter individuellement chez chacun de leurs futurs collègues, et de leur déclarer qu’ils sont les seuls dignes de leur choix. Fi-Ki se rendit d’abord chez l’académicien Fank-Hou. C’était un bonze, qui avait publié un recueil d’homélies et d’oraisons funèbres.
— Seigneur, lui dit-il, mon nom ne vous est peut-être pas inconnu. Je suis Fi-Ki, un des rédacteurs habituels de la Revue de Pékin, et je viens solliciter votre suffrage pour être de l’académie.
— Vous voulez remplacer le fameux Hiu-Li, l’homme le plus spirituel de la Chine ?
— Hélas ! j’ai bien peu de droits, je le sens, à un tel honneur ; mais je me consolerai de ma défaite si j’obtiens votre voix. L’éloquence de la chaire est selon moi la plus importante branche de la littérature, et, de l’avis de tout le monde, vous êtes le premier de nos orateurs religieux ; je sais que de soi-disant critiques contestent ce fait ; mais je ferai justice dans la Revue de Pékin de leurs sottes prétentions.
— Quand paraîtra votre article ? demanda Fank-Hou.
— Après l’élection, répondit Fi-Ki ; et il se retira en saluant humblement. Il se fit conduire chez Hang-Hong.
Hang-Hong, autrefois capitaine dans les Tigres de la garde impériale, était l’auteur d’une vingtaine de volumes de poésies fugitives ; il célébrait perpétuellement les jeux, l’amour et les ris, et sablait parfaitement l’opium, qui est le Champagne de la Chine.
— Salut, dit Fi-Ki en entrant, au plus grand poëte de l’Empire Céleste !
— Qui êtes-vous ? demanda Hang-Hong mécontent d’être dérangé au moment où il allait fumer sa pipe.
— Un sectateur ardent de la poésie fugitive, un de vos plus profonds admirateurs, un humble critique qui sait vos vers par cœur.
— Vous savez mes vers par cœur ? répondit Hang-Hong radouci.
— Qui ne retiendrait pas cet impromptu charmant que vous avez adressé à mademoiselle All-Mé, qui vous demandait son épitaphe ?
|
Sur l’écorce d’un noir cyprès, |
Et ces stances pleines d’une grâce si douce ?
|
L’amour vrai se plaît dans les larmes, |
— Ah ! je le vois, s’écria Hang-Hong attendri, vous comprenez la poésie fugitive. Hélas ! le nombre de ses fidèles décroît tous les jours !
— Je sais qu’il est des imbéciles qui se moquent du madrigal et du couplet ; mais leurs railleries ne prévaudront pas ; déjà une réaction se manifeste en faveur de la poésie fugitive ; l’académie devrait s’y associer en me nommant à la place de feu Hiu-Li ; à mes yeux, il n’y a pas d’autre poésie que la poésie fugitive.
— Votre nom ?
— Fi-Ki, rédacteur de la Revue de Pékin, qui deviendra l’organe de la réaction fugitive.
— C’est bien. Comptez sur ma voix.
Décidément, pensa Fi-Ki, ma manière de solliciter est la meilleure ; voilà ma candidature en bon chemin. Allons maintenant chez Nung-Po.
À cette époque, l’académie chinoise était divisée en deux camps bien distincts : les classiques et les romantiques.
Nung-Po représentait la tradition ; il avait fait jouer dans sa jeunesse une tragédie, et il mettait en ce moment la dernière main à un poëme en trente-quatre chants, intitulé la Kong-Fu-Tzéide. Il avait à cœur de répondre aux littérateurs étrangers qui reprochaient à la Chine de n’avoir pas de poëme épique. Nung-Po recommençait pour la vingtième fois l’indispensable invocation à la muse, lorsqu’on lui annonça que M. Fi-Ki, rédacteur de la Revue de Pékin, demandait à le voir.
C’est un journaliste, se dit Nung-Po, qui était prudent comme tous les tragiques ; qu’il entre.
— Que l’illustre Nung-Po me pardonne de troubler ses méditations ; mais les grands hommes sont indulgents.
— Que voulez-vous, jeune homme ?
— Vous demander un conseil.
— Parlez.
— J’ai l’intention de publier dans la Revue de Pékin une série d’articles sur les tendances de l’école dramatique moderne ; je voudrais remettre en lumière quelques gloires qu’on oublie depuis trop longtemps. Qui mieux que le célèbre Nung-Po peut m’être utile dans cette grande entreprise ? Je prétends terrasser le romantisme.
— Nos ennemis sont puissants, audacieux.
— On doit s’attendre à tout de la part de gens qui ont brisé la césure.
— Qui ne reculent devant aucune monstruosité, pas même devant l’enjambement.
— Qui violent toutes les unités.
— N’importe, illustre Nung-Po, avec votre appui je les combattrai, et j’espère les vaincre ; je crains seulement une chose.
— Laquelle ?
— C’est que cette polémique ne nuise à ma candidature à l’académie.
— Vous voulez remplacer Hiu-Li ?
— J’ai déjà la voix de votre ami Hang-Hong.
— Vous aurez la mienne, jeune homme ; il faut seconder ceux qui veulent mettre en lumière les gloires oubliées ; vous serez des nôtres. Venez me voir demain ; en attendant, je vous promets mon appui.
Fi-Ki remonta en palanquin, et se fit descendre devant la porte de Nou-Fou. Nou-Fou était le chef de l’école

— Comment se porte notre grand Nou-Fou ?
— Et le plus spirituel de nos critiques, répondit celui-ci, comment va-t-il ?
— Il est malade.
— Qu’a-t-il donc ?
— Une candidature à l’académie.
— Si jeune, et déjà vous songez à mourir !
— L’école moderne est menacée ; la tragédie relève la tête ; il faut payer de sa personne : voilà pourquoi je me présente. On m’a fait des propositions de la part de Nung-Po si je voulais passer aux classiques avec la Revue de Pékin.
— Qu’avez-vous répondu ?
— Que jamais je ne changerais de drapeau, et que mes amis sauraient bien me faire entrer à l’académie. Je veux rester fidèle aux idées et au drame modernes ; je mourrai sur la brèche du lyrisme dans l’art. Jugez si je pouvais consentir à voir la Revue de Pékin arborer sur sa bannière un autre nom que celui de notre grand, de notre gigantesque, de notre pyramidal, de notre formidable Nou-Fou ?
— Je n’attendais pas moins de vous, cher ami. À quand l’élection ?
— Au premier jour de la lune nouvelle.
— C’est bien. Vous serez immortel.
Fi-Ki visita successivement tous les académiciens, et employa auprès de chacun d’eux le procédé dont nous venons de voir quelques échantillons. Quoiqu’il eût pour concurrents le plus fameux romancier et le plus grand philosophe de son temps, il fut nommé au premier tour de scrutin. Comme un de ses amis lui adressait des félicitations quelque peu mêlées de surprise, Fi-Ki lui répondit par ce distique allégorique :
|
Min po have mi-li |
que M. Abel Rémusat traduit de la façon suivante :


HABILLE-TOI LENTEMENT
QUAND TU ES PRESSÉ

 l y avait à la cour de France, dans le siècle dernier, un homme qui faisait l’étonnement de tous ceux qui le fréquentaient, et cet homme connaissait beaucoup de monde. Dès sa plus tendre jeunesse, il avait montré une grande prudence unie à une extrême finesse. Dans les occasions les plus délicates, loin de se troubler, il déployait une présence d’esprit et une habileté incroyables. Aucune circonstance ne pouvait le prendre en défaut, ni même l’émouvoir : qu’on lui annonçât son déjeuner ou la perte d’une bataille, c’était du même air qu’il recevait la nouvelle.
l y avait à la cour de France, dans le siècle dernier, un homme qui faisait l’étonnement de tous ceux qui le fréquentaient, et cet homme connaissait beaucoup de monde. Dès sa plus tendre jeunesse, il avait montré une grande prudence unie à une extrême finesse. Dans les occasions les plus délicates, loin de se troubler, il déployait une présence d’esprit et une habileté incroyables. Aucune circonstance ne pouvait le prendre en défaut, ni même l’émouvoir : qu’on lui annonçât son déjeuner ou la perte d’une bataille, c’était du même air qu’il recevait la nouvelle.
Versailles était alors le lieu du monde où l’on se donnait le plus de mouvement pour réussir ; les courtisans étaient toujours sur pied, tout prêts à mouler leur physionomie sur le visage du maître, et se pressant le plus possible pour se devancer les uns les autres.
Le duc de P., ainsi s’appelait notre personnage, suivait une méthode contraire. Alors que toute la cour était bouleversée par le changement du ministère ou le renvoi de la favorite, on le voyait toujours calme et serein ; aux nouvelles les plus imprévues il gardait son sang-froid imperturbable ; et lorsque la foule des grands seigneurs se pressait autour du roi, à la veille d’un événement considérable, il s’étendait sur un sofa ou s’en allait dans son carrosse faire un tour à Paris.
Un vieux courtisan avait mal auguré de cette habitude. « Le pauvre duc n’ira pas loin, dit-il quelque temps après la présentation de M. de P. à Versailles ; le moindre cadet lui passera sur le corps. »
Mais au bout de peu d’années il se trouva que le duc de P. avait obtenu en honneurs, en dignités, en faveurs, plus que les plus habiles et les plus persévérants. Il ne demandait rien, et gagnait tout ; on ne le voyait pas solliciter, et il arrivait à des emplois que les plus ambitieux n’osaient espérer.
Cette fortune et cette conduite semblaient inexplicables. Comme on était au temps des Cagliostro et des Saint-Germain, quelques personnes s’avisèrent de croire que le duc de P. avait un anneau constellé ou quelque secret magique pour commander au sort. Quand on lui faisait part de ces soupçons, M. de P. haussait les épaules et répondait que son secret était à la portée de tout le monde.
On sait qu’il n’y a pas de terrain plus glissant que la cour. Là les destinées n’ont rien d’assuré, et quand on jouit de la faveur il faut se presser d’en profiter ; le lendemain est rarement semblable à la veille. M. de P… ne paraissait pas se douter de cette vérité ; il agissait en toute chose comme si sa fortune eût dû être éternelle. Le fait est que la constance de son bonheur faisait mentir l’axiome. Quand une débâcle suivait le renversement d’un cabinet, bien loin de perdre son emploi, le duc en gagnait un supérieur ; si la favorite succombait sous la beauté d’une rivale, M. de P. obtenait de la nouvelle maîtresse plus encore qu’il n’attendait de l’autre ; et ce qu’il y avait de plus merveilleux, c’est que tous ces miracles s’accomplissaient sans fatigue. M. de P. était fort gourmet et fort paresseux, et jamais, dans aucune circonstance, pour si grave qu’elle fût, on ne lui vit retarder l’heure de son souper ou avancer celle de son lever.
Le duc de P. avait un neveu, garçon alerte, intelligent, spirituel et ambitieux. M. de T. était fort jeune encore lorsque son oncle occupait déjà une position éminente à la cour. Il passait chez son parent la majeure partie de son temps, et se plaisait dans sa conversation, où il trouvait sans cesse mille sujets de méditations. Mais ce qui l’étonnait encore plus que l’esprit, le grand sens et le scepticisme élégant de son oncle, c’était l’apparente indolence de son caractère. Sur ce chapitre-là ses surprises étaient de tous les instants.
Un jour M. de T. apprit de la bouche même d’un duc et pair, qui avait toute la confiance du roi, une nouvelle assez importante pour changer toute la politique de la France ; on n’en pouvait prévoir les conséquences. M. de T…, qui comprenait à demi-mot le but de cette confidence, quitta Versailles en toute hâte et tomba chez M. de P. comme la foudre. M. de P. lisait un pamphlet dans son cabinet, un cabinet où il ne faisait jamais rien. M. de T. raconta bien vite ce qu’on lui avait soufflé tout bas.
— Mon carrosse est à la porte, ajouta-t-il ; dans deux heures la cour sera dans une confusion extrême ; courez.
— Nous aurons tout le temps de causer de cette affaire après souper ; va faire dételer tes pauvres chevaux que tu as failli crever, et repose-toi. Demain on verra.
Le lendemain M. de P. fut revêtu d’une charge plus importante qu’aucune de celles qu’il avait jamais occupées.
M. de P. se servait quelquefois de M. de T. comme de secrétaire, M. de T. ayant gagné sa confiance par la dextérité de son esprit ; M. de P. lui reprochait seulement de céder trop promptement aux impressions de son cœur ou de son jugement.
— Mais mon oncle, lui disait alors M. de T., le premier mouvement est comme une voix intérieure qui crie la vérité ; c’est une flamme qui éclaire.
— Ce sont là des phrases bonnes à mettre en vers, lui répondait le duc de. P. ; mais en simple prose je t’engage à te méfier du premier mouvement, non point tant parce qu’il est quelquefois bon que parce qu’il engage.
Après une bourrasque de cour devant laquelle le ministère succomba, au moment où chacun croyait M. de P. entraîné dans la chute d’un cabinet avec lequel on connaissait ses relations intimes, le duc fut chargé par le roi du poids des affaires. Il ne l’accepta que sur l’ordre impératif du souverain, et après s’en être longtemps défendu. M. de T. resta près de lui, et s’occupa de réunir quelques jeunes gens habiles et discrets pour le travail confidentiel du cabinet.
L’un d’eux montra bientôt une grande aptitude ; sa correspondance était irréprochable, et ses rapports témoignaient d’une rare intelligence des matières diplomatiques. Cependant un matin, M. de T. apprit que le jeune secrétaire avait été congédié la veille par M. de P.
— Avait-il commis quelque indiscrétion ? lui demandat-il.
— Non pas.
— S’était-il trompé dans un travail important ?
— Point.
— Avait-on quelque crainte sur sa moralité ?
— Aucunement.
— Mais qu’a-t-il donc fait ? s’écria entin M. de T.
— Il avait trop de zèle.
Avant le terme de sa carrière le duc de P. avait occupé les emplois les plus considérables et obtenu les dignités les plus enviées ; on l’avait vu tour à tour lieutenant de police, surintendant des finances, grand-écuyer, ministre, ambassadeur ; il était décoré des ordres de Sa Majesté, et tous les monarques de l’Europe se plaisaient à le couvrir de croix et de colliers.
Quand M. de P. paraissait à la cour, ses moindres paroles étaient recueillies avec un soin extrême et commentées de mille manières : il est vrai qu’il parlait fort peu. On lui supposait le don de prévoir les événements, et quand il lui arrivait d’éviter un homme en place, chacun tournait le dos au pauvre gentilhomme, bien convaincu qu’il allait être destitué ; le plus souvent l’avenir se chargeait de réaliser ces muettes prédictions.
— Comment donc vous y prenez-vous pour si bien prévoir les choses ? lui demandait un jour M. de T.
— J’attends et j’écoute.
Un jour M. de T. vantait très-fort l’habileté et l’ardeur d’un gentilhomme qui, voulant se pousser à la cour, ne mettait jamais qu’une heure à faire ce que d’autres ne pouvaient ébaucher qu’en trois. M. de P. sourit.
— Je ne me suis jamais pressé, dit-il, et je suis toujours arrivé à temps.
M. de T. se plaignait parfois de la rapidité avec laquelle les heures passent.
— Pour avoir le temps de tenir tête à tout, disait-il, il faudrait que les jours eussent quarante huit heures.
— Ce serait quatre fois trop, répliqua le duc ; réduits le jour à la moitié, et il en restera toujours assez pour que les neuf dixièmes des hommes trouvent encore le loisir de se casser le cou.
M. de P. était dans toute sa faveur quand la mort arriva ; mais elle ne put le surprendre : il était prêt. Avant d’expirer il fit approcher son neveu.
— Voilà, lui dit-il, l’instant de te prouver mon amitié. Tu es jeune et ambitieux ; dans le chemin de la politique on peut tomber si l’on n’a pas l’œil et le pied sûrs. Prends ce portefeuille ; j’ai eu le soin d’y tracer les conseils que

Quand M. de P. fut mort, M. de T. ouvrit le portefeuille. Sur la première feuille on lisait ce proverbe, écrit de la main du duc :
Toutes les autres feuilles étaient blanches. M. de T. suivit le conseil à la lettre, et sa fortune sous la révolution, le consulat, l’empire, la restauration et le gouvernement de juillet, lui prouvèrent que M. de P. avait raison.


DE MAIGRE POIL ÂPRE MORSURE
EXTRAITS DE MÉMOIRES INÉDITES

 avais gagné quelque argent au jeu. Il s’agissait de me meubler ; plusieurs de mes amis me conseillèrent de m’adresser à Niccolô Gritti, jeune tapissier qui venait de s’établir. J’en parlai à Casanova de Seingalt, le célèbre aventurier ; il haussa les épaules.
avais gagné quelque argent au jeu. Il s’agissait de me meubler ; plusieurs de mes amis me conseillèrent de m’adresser à Niccolô Gritti, jeune tapissier qui venait de s’établir. J’en parlai à Casanova de Seingalt, le célèbre aventurier ; il haussa les épaules.
— Je ne conseille personne, me dit-il ; mais le mois dernier j’ai garni un casino, et c’est au vieux Velo que je me suis adressé.
— Tout le monde assure que Velo est horriblement cher.
— Tout le monde a raison ; pourtant je gagerais bien que votre Gritti le sera davantage,
— Cent personnes m’ont dit le contraire, répondis-je, et volontiers j’en ferai l’épreuve.
Sur ce, je me fis donner en détail la description du casino en question, le nombre exact des glaces, des lustres en cristal de roche, des girandoles, des trumeaux peints, des lambris ciselés en or moulu, des paresseuses, des tentures de soie à fleurs, des tapis veloutés, des chambranles de marbre, etc., etc. Mons Gritti fut appelé, reçut mes ordres en toute joie et en toute humilité, me promit le plus grand luxe et la plus grande économie, m’assura que j’aurais toutes ces choses à un grand tiers de rabais sur le prix de son illustre confrère, et, peu de jours après la livraison des meubles, m’apporta une note dont le total était effrayant.
J’allai trouver dès le lendemain le spirituel chevalier. Il déjeunait seul par aventure, mais en homme comme il faut. Le chocolat préparé remplissait la chambre d’une forte odeur de vanille ; à côté de deux flacons vides, qui avaient contenu d’excellent scopolo, mon ami dépêchait les restes d’une salade de blancs d’œufs, assaisonnée à l’huile de Lucques et au vinaigre des Quatre Voleurs.
— Je sais ce qui vous amène, s’écria-t-il, comme si mes nombres me l’avaient dit ; et, en effet, il ne faut pas être grand cabaliste pour cela. Je vous ai donné un conseil ; vous ne l’avez pas suivi ; votre homme vous a volé ?
— Je le crains, répliquai-je.
— J’en suis sûr, reprit le chevalier, et je suis sûr aussi que vos sequins s’en vont rondement d’un autre côté. La Tonina était d’une gaieté folle hier soir au Ridotto.
— Eh bien ! demandai-je, non sans un peu de confusion tant bien que mal déguisée, qu’y a-t-il de commun ?…
— Je vais vous le dire, interrompit-il ; nous avons un proverbe infaillible : Donna che ride, borsa che piange. Vous avez gagné trois mille ducats la semaine dernière ; vous avez soupé deux fois avec cette petite danseuse ; elle rit au nez de tous ceux qui la regardent ; gageons que les deux tiers de votre gain sont déjà mangés.
— Voilà, répondis-je, une conjecture fort indiscrète. Pour en revenir à Gritti…
— N’achevez pas ; je vais encore vous dire comment vont les choses de ce côté. Vous avez sa note en poche ; j’ai celle de Velo dans ce secrétaire ; nous les comparerons si vous voulez, et je parie votre jabot de point d’Alençon contre cette bague en brillants, que la différence en moins du côté de Gritti ne va pas à plus de dix sequins. Je parie encore que, nonobstant cette différence en moins, il gagne six fois plus que son confrère, plus habile, plus riche et plus renommé que lui. Je parie, sans l’avoir vu, que tout ce qui est chez moi damas de Lyon, chez vous est taffetas de Vicence ; que vous avez des cristaux de pacotille aux pendeloques de vos lustres, des bronzes mal dorés à vos girandoles, des marbres défectueux sur vos cheminées. Maintenant, autre différence : vous espériez peut-être quelque rabais et quelque crédit. Velo prend mes billets à trois mois, et je lui ai fait subir, suivant l’usage du beau monde qu’il sert, une diminution notable ; votre maraud de Gritti veut, j’en suis sûr, être payé séance tenante, et, quand vous lui avez parlé d’une estimation, il vous a menacé d’un procès.
J’étais atterré ; car, de point en point, le chevalier avait deviné juste.
— Souffrez, reprit-il après avoir joui de mon embarras, souffrez qu’on instruise votre jeunesse. Laissons là votre tapissier, qui est un friponneau, et qu’il faudra rouer de coups de canne quand vous lui aurez jeté son argent à la figure ; puis dites-moi, s’il vous plaît, quel maladroit ami vous a guidé dans nos coulisses ? Autant aurait valu tout d’abord vous mener en pleine Calabre. Cependant, il y a danseuse et danseuse, comme il y a tapissier et tapissier, comme il y a bandit et bandit :
— par quels motifs avez-vous préféré la Tonina ?
— Eh ! mais, repris-je, a-t-on des motifs ?…
— Avoués ou secrets, on en a toujours. Comme je ne vous vois pas très-disposé à vous confesser, je vais continuer mon rôle de nécroman. Lorsque vous avez porté votre hommage à cette petite fille, brune et maigre comme un clou de girofle, vous n’avez cédé ni à l’attrait fort médiocre de sa danse effrontée, ni à celui de ses petits yeux noirs passablement dépareillés. Vous n’aviez pas l’ombre d’un penchant pour elle, et je n’en veux d’autre preuve que la belle ardeur dont vous brûliez naguère pour la véritable déesse de nos fêtes, cette veuve milanaise, bionda e grassotta, autour de laquelle vous avez rôdé tout bas pendant plus d’un an. Donc il a fallu que certains calculs, certaines considérations, dont vous-même n’avez pas conscience, vous fissent agir en sens inverse de votre instinct naturel. Vous vous êtes dit,… n’allez pas vous fâcher,… qu’une pauvre débutante, arrivée à Venise il y a deux mois, dédaignée jusqu’à présent, fort mal en point dans ses affaires, portant des robes fanées et des colliers de fausses pierres, devait être plus facilement abordable, et ( passezmoi le mot) d’un usage plus économique qu’aucune de ses compagnes gâtées par la prospérité, qui vous éblouissaient de leurs atours insolents. Le malheur de ce raisonnement, si juste en apparence, est d’être constamment démenti par les faits. Vous n’avez trouvé la Tonina ni moins vaniteuse, ni plus accommodante que ses camarades les plus à la mode. Du moment où elle vous a vu tenter fortune auprès d’elle, cette pécore a fait la renchérie, comme si elle n’était pas endettée jusqu’aux oreilles, couverte de mauvais haillons, et, faute de crédit, réduite les trois quarts du temps à dîner par cœur. Tous ces désavantages, elle les aura présentés avec adresse comme autant de mérites singuliers. Dieu sait si elle aura fait sonner haut son titre de débutante ! Dieu sait quels contes elle vous aura bâtis sur sa vie passée ! Et, quant aux dédains dont elle a été l’objet depuis son arrivée ici, elle n’a pas manqué sans doute de les attribuer à sa vertu farouche qui décourageait toute tentative. Voyons, carissimo, n’est-ce point cela ou à peu près ?
Il m’eût fallu plus d’à-plomb que je n’en avais alors pour contredire messer Casanova. Sa perspicacité n’avait omis aucun détail, et l’on eût dit qu’il avait prêté l’oreille à tous mes entretiens avec la Tonina.
Voyant que ses conjectures tombaient juste, il reprit sur un ton d’ironie encore plus marqué :
— Après que votre divinité s’est entourée ainsi de tous les prestiges qu’elle a pu réunir, trouvant en vous la noble crédulité d’un galant homme qui n’a pas encore été dupe, elle a profité largement d’une occasion qu’elle n’aurait osé attendre. Elle vous a vendu de simples espérances, — et quelles espérances, grands dieux ! — au prix des plus séduisantes réalités. — Convenez-en, la moitié de la somme que vous avez donnée à ce maraud de Gritti a été dépensée pour tirer de son galetas l’inflexible objet de vos vœux. Un sourire indulgent, ou tout au moins un chaste soupir, a payé ce généreux sacrifice. Il y a mieux : Tonina, cédant à vos instances, vous a permis de lui donner à souper, mais à condition que la hideuse matrone dont elle se dit la fille assisterait, pour empêcher la glose, à cet innocent festin. Je vous connais assez, et je vous vois rougir de trop bon cœur pour douter que les choses se soient passées comme elle l’a voulu. Grande chère, vins de choix, service magnifique, le tout assaisonné de mystère, et vous en avez eu pour vos cinquante ducats tout au moins. Peut-être commenciez-vous à vous repentir ; mais il était trop tard, et depuis lors, spéculateur aventureux, vous courez, comme on dit, après votre argent. Plus elle vous voit engagé, plus cette laideron vous tient la dragée haute, toute fière de vous trouver docile à ses moindres caprices. Je vous fais bien mon compliment du costume dans lequel nous l’avons vue au dernier bal masqué ; son habit de velours rose, brodé en paillettes d’or, était d’une richesse extrême ; le solitaire qu’elle avait au doigt vous coûte, je m’y connais, de cent trente à cent cinquante ducats. Sa haute de blonde noire était d’une beauté remarquable pour la finesse et le dessin. D’ailleurs n’a-t-elle pas pris grand soin de vider ses poches devant nous ? Tabatière d’or, étui d’or, bonbonnière entourée de perles fines, lorgnette superbe, breloques étincelantes de petits diamants, rien ne manquait à cet ajustement magnifique dont je ne veux pas vous rappeler la valeur, pour ne pas ajouter à vos déboires. Mais, si je ne vous dis pas ce qu’il vous a coûté, je puis au moins vous dire ce qu’il vous rapporte ; c’est le très-sincère mépris du petit monstre pour lequel vous vous ruinez. Tonina, maintenant que, grâce à vous, elle fait une espèce de figure, trouverait charmant de vous planter là sans vous avoir rien accordé, pour un homme qui n’attendît pas sa fortune d’un coup de dé ou d’un heureux paroli.
En revanche, — et c’est le plus piquant de votre histoire, — avec beaucoup moins de tourments et de dépenses, jeune et bien fait comme vous l’êtes, vous pouviez aspirer aux plus beaux succès. La comtesse, oui, la comtesse elle-même, — bien qu’elle ne soit pas à vendre, — eût accepté vos soupirs si, courageux à propos, vous eussiez fait pour elle, au carnaval dernier, la moitié des folies auxquelles vous a induit une créature qu’il ne faut pas même songer à lui comparer. Remarquez que je ne vous parle point de la Baletti, de la Ramon, de la Steffani, de la Papozze ; quels que soient leur vogue et leur renom, la plus huppée d’entre elles sait trop bien ce qu’elle vaut au fond pour imposer des conditions très-sévères. Avec une pluie d’or comme celle qui vous a ouvert les portes du grenier où végétait Tonina, je me serais fait fort de pénétrer chez toutes les Danaé du corps de ballet.
Casanova, se levant alors de son fauteuil, se promena par la chambre en agitant son mouchoir imprégné d’essence.
— Sachez, carino, continua-t-il d’un ton protecteur, qui me déplut horriblement, sachez une fois pour toutes que, dans la vie, on se trouve toujours bien d’avoir affaire aux marchands enrichis, danseuses ou non ; leur position



TIRER LE DIABLE PAR LA QUEUE
NE MÈNE LOIN JEUNES NI VIEUX.

 roverbe, que me veux-tu ? D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Qu’entend-on au juste par ces mots-là : « Tirer le diable par la queue ? » — Cherchons.
roverbe, que me veux-tu ? D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Qu’entend-on au juste par ces mots-là : « Tirer le diable par la queue ? » — Cherchons.
Ce proverbe voudrait-il dire qu’on est avec le diable sur un pied d’intimité ? A-t-on dit, par exemple, du fameux docteur Faust, qui était, comme chacun sait, à la fois le compère, l’hôte, l’ennemi intime et le séide de Méphistophélès, qu’il tirait le diable par la queue, pour exprimer qu’il était avec le diable comme les deux doigts de la main ? Mais cette étymologie nous semblerait bien tirée par les cheveux, pour ne pas dire plus.
Ou bien ce proverbe aurait-il été inventé à l’occasion de cet autre personnage fantastique de la chanson de Goëthe : l’Élève du sorcier ? L’élève d’un magicien a retenu certaines paroles cabalistiques à l’aide desquelles son maître se fait servir par le diable. En l’absence de son maître, l’élève imagine de faire paraître le diable devant lui, et lui ordonne d’aller lui chercher de l’eau ; malheureusement il a oublié les paroles à l’aide desquelles on l’arrête, et le diable lui apporte coup sur coup tant de seaux d’eau, que bientôt la maison est inondée. Au moment où le diable s’élance pour apporter encore de l’eau, l’élève se précipite sur ses pas, et l’arrête… Je pense que ce ne put être que par la queue ; car le diable ne se laisse guère saisir que par là.
Tirer le diable par la queue voudrait donc dire alors agir inconsidérément, sans réflexion, et risquer de tomber dans un abîme, ou de se voir submergé comme l’élève du sorcier ?
Cherchons encore.
— Rien de plus simple, nous dit un homme déjà sur le retour, et qui a connu intimement feu M. de la Mésangère : tirer le diable par la queue signifie tout bonnement vivre dans la gêne ; porter des culottes râpées, un parapluie rouge, des besicles en cuivre, des gants de peau de lapin, et des épingles sur sa manche ; — voilà ce qu’on appelle tirer le diable par la queue.
— Halte là, Monsieur, je vous arrête ; car votre définition est insuffisante… Et ce diable que vous oubliez, ce diable qui a fait le proverbe, qui en est, on peut le dire, le chef et l’âme, croyez-vous donc qu’on puisse l’omettre ?… Remarquez que le proverbe ne dit pas tirer l’existence par la queue ; tirer l’argent, la destinée, le crédit, la misère par la queue ; il dit le diable… le diable, Monsieur ; entendez-vous ? Comment ce diable ne vous a-t-il pas sauté aux yeux ?
Quoi ! une jeune fille travaille du matin au soir, et est citée comme un ange de résignation et de sagesse ! Il est vrai qu’elle est très-pauvre ; mais qu’importe, puisqu’elle ne doit son existence qu’au travail de ses doigts ; que son économie suffit à tout ?… Et vous osez dire de cette pauvre innocente qu’elle tire le diable par la queue, elle qui n’a même jamais vu ses cornes ?
On ne met généralement pas à la caisse d’épargne quand on tire le diable par la queue.
À plus forte raison n’obtient-on pas le prix Monthyon, attendu que le diable n’a pas reçu jusqu’à ce jour de prix de vertu.
Mais sans vouloir en aucune façon faire ici l’apologie du désordre ni du décousu dans la vie ordinaire, je soutiens que, pour tirer le diable par la queue, il faut ne point avoir les mœurs épicières ; il faut surtout comprendre l’imagination, l’imprévu, la fantaisie ; enfin la vie d’artiste.
Vous ne direz jamais d’un musicien qui a une fois par mois cinquante mille livres de rentes pendant vingt quatre heures, ou de la danseuse qui a un coupé et trois termes en souffrance, qu’ils sont au-dessous de leurs affaires, qu’ils sont sur le point de faire faillite, qu’une liquidation, une assemblée de créanciers, est nécessaire… Fi donc ! Ils tirent le diable par la queue ; c’est bien plus poétique. « Cher diable, toi qui as inspiré tant de grands génies ; toi qui as su ranger parmi tes apôtres Dante, Michel Ange, Callot, Hoffmann, Panurge, Scapin, Figaro, sans compter tous les poêtes qui se donnent à toi vingt fois par jour pour attraper la rime, et quelquefois le bon sens, inspire-moi donc quelque heureuse et nouvelle idée, pour adoucir la férocité de mes dettes ; rogneleur les griffes ; lime-leur les dents ; fais-leur faire, s’il se peut, patte de velours… » Mais le diable souvent reste sourd à de pareils appels que tant de personnes lui adressent de tous les côtés, et il faut bien qu’il se fasse un peu tirer… non pas seulement l’oreille, mais par ce que nous disions, et on conçoit enfin que, malgré toute sa bonne volonté, la queue du diable ne puisse répondre à tout le monde à la fois.
Écoutez, mon ami, vous êtes aujourd’hui un des riches notaires de Paris ; votre maison est des plus recherchées ; chaque soir votre table est garnie de convives ; le matin, votre étude est assiégée de clients de toute espèce.
Mais vous souvenez-vous du temps où nous étudiions, ou plutôt où nous n’étudiions pas ensemble ? Vous rappelez-vous la fameuse lettre que vous écrivîtes à votre oncle de Louviers, peu de temps après les journées de juillet, lettre colossale et patriotique, datée du Panthéon, que nous composâmes à quatre, et dans laquelle vous annonciez à votre oncle l’intention de figurer dans la garde citoyenne, et de prêter l’appui de votre bras à l’ordre public et à la charte ?
Vous comptiez sur l’envoi de bank-notes ; mais votre oncle, qui était la sagacité même, jugea à propos de vous envoyer seulement un énorme paquet contenant un équipement complet, qui permit à vos instincts patriotiques de ne plus battre sous l’enveloppe du péquin.
Vous m’avez souvent raconté qu’à une certaine faction, de minuit à deux heures, vous eûtes comme un vertige ; vos yeux se fermèrent à demi, et vous vîtes distinctement paraître devant votre guérite un personnage enveloppé d’un domino, et couvert d’un masque noir, que vous avez déclaré ne pouvoir être que le diable en personne. Ce personnage se mit, avec la main la plus mignonne et la plus blanche du monde, à détacher lestement, une à une, toutes les pièces de votre uniforme, vos épaulettes, votre sabre, votre ceinturon ; il cacha le tout dans sa robe, et s’enfuit à toutes jambes sans qu’il vous fût possible de le rejoindre.
Comment se fit-il que, le lendemain de cette singulière aventure, tout votre équipage se trouva chez un fripier du voisinage ? Adieu la gloire, tout était vendu ; et, de votre équipement, il ne vous resta absolument qu’un billet de garde !
Quel dîner nous fîmes à Montmorency avec votre habit, votre houpelande, votre bonnet à poil et votre plumet ! El vos buffleteries, votre fusil et le reste de votre fourniment, n’est-ce pas là ce qui vous permit d’assister à la première représentation de Napoléon ou les Cent Jours, toujours avec le diable de la guérite ?
Mais que devint votre oncle de Louviers, lorsque, arrivé à Paris à l’improviste, il voulut se procurer la satisfaction d’aller, sans vous prévenir, vous contempler à une des grandes revues ? Hélas ! il vit vainement défiler devant ses yeux les chasseurs, les artilleurs, les grenadiers ; il vous chercha, je crois, jusque parmi les sapeurs. Mais, quelle fut sa douloureuse consternation lorsque, en montant la rue Saint-Jacques, il aperçut à l’étalage d’une friperie un uniforme complet, que son coup d’œil d’habitant de Louviers lui fit aisément reconnaître ! L’uniforme, les buffleteries, le bonnet, le tout avait été placé sur un mannequin dont la figure de carton souriait à votre oncle de l’air du monde le plus bête. Votre oncle fut sur le point de prendre au collet son mannequin de neveu ; mais il se contint, et préféra quitter Paris le soir même, sans vouloir vous voir. Quelques jours après, une lettre datée de Louviers vous arriva, lettre fulminante, écrasante.
Mon ami, avouez que le diable était alors à peu près votre seul client ; que d’affaires n’avez-vous pas faites avec lui ! Il vous rendait souvent visite, et cependant ses visites n’avaient pour vous rien d’importun. Vous n’étiez pas obligé, comme maintenant, d’étouffer ces bâillements nerveux que produit en vous le récit de certaines affaires qu’on vous rebat périodiquement depuis plusieurs années.
Le diable était de toutes nos parties de plaisir. Dans le carnaval, ne pouvions-nous pas dire à la lettre, et sans nous offenser, que le diable nous emportait ?
Il arrivait souvent que nous avions reçu quelques jours avant la visite du tailleur du Havre ou de Taïti, qui s’était présenté à notre hôtel avec de grandes révérences, et une longue queue passant sous son justaucorps, mais que nos yeux inexpérimentés ne nous permettaient pas d’apercevoir. Ce tailleur nous faisait changer nos meilleurs vêtements contre des foulards tartares, des pipes turques, des camées du Vésuve, du vin de Tockay, des pantoufles des îles Marquises, etc…
Le même personnage reparaissait le lendemain, mais entièrement couvert de grelots ; et, pour réparer la perte de nos nippes, il nous apportait un choix unique de déguisements impayables.
Dites vous-même si le diable en personne n’avait pas mis la griffe à nos costumes de carnaval. Quels turbans ! quels casques ! et quelle danse ! La nuit, le bal, l’ivresse ; le quadrille ordinaire était bouleversé par nous de fond en comble ; les autres faisaient la queue du chat ; mais nous, c’était bien la queue du diable.
Proverbe, heureux proverbe ! que d’autres te haïssent ; que d’autres te prennent en mépris ; moi, je dis que, si l’on est homme, il faut savoir te goûter et te comprendre. Je te réhabilite, et je soutiens que, malgré les images de dénuement, et j’ose même dire de débine, que tu réveilles aux yeux du vulgaire, il y a malgré tout en toi quelque chose d’oriental et de délirant, qui suffit bien pour compenser les grandes ou petites misères que tu peux traîner derrière toi. Je te salue donc, ô proverbe ! car tu es de plus le roman pratique, réel, sans faux détours, sans symbole. N’est-ce pas toi qui nous as enseigné que le seul et vrai roman était celui qui, à l’exemple du diable, se laissait prendre par la queue ?
N’est-il pas vrai, mon cher notaire, vous à qui je dédie ce travail sur ce vieux proverbe, à qui nous avons autrefois tant sacrifié ensemble, qu’on ne doit pas, comme on le fait souvent, le regarder d’un mauvais œil, et que, pour ne pas éprouver l’ennui et la satiété au sein de l’abondance,



QUI QUITTE SA PLACE LA PERD

La scène se passe ou à Bertin, ou à Munich, ou à Stuttgard, ou à Francfort, ou à Cassel, ou à Dresde.
ACTE PREMIER.
 e Choeur. — Voici venir l’étudiant Stenn, plus amoureux que jamais de la belle Dorothée, la fille de Liebmann, le riche marchand de draps. C’est l’heure où ils causent ensemble au comptoir. N’est-ce point aussi l’étudiant Anselme qui se dirige du même côté ? Il marche en composant un sonnet pour la charmante Dorothée. Lequel des deux est le préféré ? Nous ne tarderons pas à l’apprendre, sans doute. Anselme a reconnu Stenn ; les deux rivaux se sont jeté un coup d’œil foudroyant. Anselme cependant ne s’est pas arrêté devant Dorothée. Il reviendra tout-à-l’heure, gardons-nous d’en douter. N’effarouchons point Stenn et Dorothée. (Le chœur se met à l’écart.)
e Choeur. — Voici venir l’étudiant Stenn, plus amoureux que jamais de la belle Dorothée, la fille de Liebmann, le riche marchand de draps. C’est l’heure où ils causent ensemble au comptoir. N’est-ce point aussi l’étudiant Anselme qui se dirige du même côté ? Il marche en composant un sonnet pour la charmante Dorothée. Lequel des deux est le préféré ? Nous ne tarderons pas à l’apprendre, sans doute. Anselme a reconnu Stenn ; les deux rivaux se sont jeté un coup d’œil foudroyant. Anselme cependant ne s’est pas arrêté devant Dorothée. Il reviendra tout-à-l’heure, gardons-nous d’en douter. N’effarouchons point Stenn et Dorothée. (Le chœur se met à l’écart.)
Stenn. — Bonjour, mademoiselle Dorothée.
Dorothée. — Bonjour, M. Stenn.
Stenn. — Comme ce bonjour est froid ! Je vois que vous ne m’aimez pas, mademoiselle Dorothée ; vous me préférez Anselme.
Dorothée. — M. Anselme est un bon garçon ; mais ce n’est pas à moi de décider si je le préfère. Je ferai ce que mon père ordonnera.
Stenn. — Jamais d’autre réponse. Quoi ! pas un mot d’amour ?
Dorothée. — Partez ! voici mon père. (Stenn sort ; survient Anselme.)
Anselme. — Bonjour, mademoiselle Dorothée.
Dorothée. — Bonjour, M. Anselme.
Anselme. — Votre père vient de sortir, et je profite du moment pour vous offrir ce sonnet, qui mieux que toutes mes paroles vous dépeindra les tourments que j’endure ; car je souffre pour vous, cruelle, et vous ne m’aimez pas. Sans doute vous me préférez Stenn ?
Dorothée. — M. Stenn est un bon garçon ; mais c’est mon père qui doit choisir entre vous deux. Le voici qui rentre ; fuyez.
Anselme. — Hélas ! hélas ! vous me désespérez. (Il sort.)
Le Chœur. — Stenn n’était pas content quand il a quitté Dorothée ; la figure d’Anselme n’exprimait pas non plus une grande satisfaction. Il est évident que l’éternelle réponse de la jeune fille commence à les fatiguer tous deux. De la résolution qu’ils vont prendre dépendra leur succès. Tâchons de savoir ce qu’ils méditent. (Stenn rentre.)
Stenn. — Décidément il faut en finir. Mon moyen est excellent. J’irai, s’il le faut, jusqu’au suicide.
Le Chœur. — Fichtre !
Stenn. — Qui me parle ?
Le Chœur. — C’est nous, ami Stenn, nous sommes le chœur antique ; notre emploi est de consoler, de raffermir le héros, et de lui donner d’excellents conseils.
Stenn. — C’est le ciel qui vous envoie. Figurez-vous que j’adore mademoiselle Dorothée, la fille de Liehmann, le riche marchand.
Le Chœur. — Connu.
Stenn. — J’ai un rival qui se nomme Anselme. La petite ne veut pas se prononcer entre nous ; j’ai trouvé une ruse qui l’y forcera.
Le Chœur. — Voyons.
Stenn. — Je quitte la ville dès ce soir, et je vais m’établir à une vingtaine de lieues d’ici. Chaque jour j’écrirai une lettre à Dorothée. Je commencerai par des plaintes tendres, je continuerai par des lamentations, et je terminerai par des menaces de mort. Il faut effrayer les jeunes filles pour en être aimé. Dorothée ne résistera pas à mon éloquence ; elle donnera en plein dans le roman ; sa tête s’exaltera, et je l’épouserai. Que pensez-vous de ce projet ?
Le Chœur. — Euh ! euh ! euh !
Stenn. — Merci de votre approbation. Je cours le mettre à exécution. (Il sort ; Anseltme entre.)
Anselme. — Cela ne peut durer davantage ; il faut absolument qu’avant huit jours je sache à quoi m’en tenir.
Le Chœur. — Eh ! parbleu, voilà l’étudiant Anselme.
Anselme. — Qui êtes-vous ?
Le Chœur. — Nous sommes le chœur antique ; notre emploi est…
Anselme. — De consoler, de raffermir le héros, et de lui donner d’excellents conseils ; mon professeur de rhétorique me l’a appris. Sachez donc, puisque vous m’offrez vos services, que je suis amoureux, à en perdre la rime, de mademoiselle Dorothée, la fille de Liebmann, le riche marchand. J’ai un rival qui se nomme Stenn. La friponne hésite entre nous deux ; j’ai découvert un moyen de forcer son choix.
Le Chœur. — Lequel ?
Anselme. — Je cultiverai la connaissance du vieux Liebmann ; une fois dans la maison, j’entourerai la fille de petits soins et de délicates attentions. On ne réussit que par la patience auprès des femmes. Je serai sans cesse auprès d’elle, elle s’habituera à moi, et je deviendrai son mari. Quel est votre avis là-dessus ?
Le Chœur. — Eh ! eh ! eh !
Anselme. — Je vous comprends parfaitement. Je cours me faire présenter chez le vieux Liebmann. (Il sort.)
Le Chœur. — Le projet de Stenn me paraît bon ; mais le moyen d’Anselme n’est pas mauvais. L’un s’adresse à l’imagination, l’autre à l’habitude ; lequel des deux triomphera ? Attendons ; les drôles commencent à devenir amusants.
ACTE DEUXIÈME.
Dorothée, seule. — Pauvre Stenn ! il passe sa journée dans les bois à gémir sur mes rigueurs. Sa lettre m’a vivement touchée. La voix du rossignol lui rappelle ma voix ; les fraises des bois n’ont pas, dit-il, un parfum plus doux que mon haleine ; et l’azur du lac sur les bords duquel il va rêver, est moins pur que mes yeux. Il m’aime bien, celui-là ; j’ai presque envie de lui écrire de revenir. Entre Anselme.
Anselme. — Ainsi que votre père me l’a permis, mademoiselle Dorothée, je viens vous chercher pour vous conduire à la fête.
Dorothée. — Déjà !
Anselme. — Craindriez-vous de vous ennuyer ?
Dorothée. — Non, partons. Ils partent.
Le Chœur. — La lettre de Stenn a eu beaucoup de succès. Nous avons vu des larmes tomber des yeux de Dorothée en la lisant. Anselme pourrait bien être enfoncé. Allons à la fête. Il sort.
Dorothée. — J’ai à peine la force de détacher les fleurs de mes cheveux, mes paupières se ferment presque malgré moi ; quelle fatigue ! Mais aussi comme je me suis amusée ! Anselme est charmant ; que de prévenances ! que d’attentions ! et puis comme il valse bien ! Il faut qu’il soit bien amoureux pour se montrer si dévoué. Comme il a bien répondu à cet officier qui soutenait m’avoir engagée ! La voix du rossignol !… la valse… le parfum des fraises… Stenn… Anselme… Je m’endors !
Le Chœur. — Anselme fait des progrès effrayants. Dorothée pendant la valse se pressait d’une façon très-tendre contre lui. Stenn pourrait bien perdre la partie.
ACTE TROISIÈME.
Dorothée. — Une nouvelle lettre ! c’est la huitième que je reçois. La dernière était pleine de reproches et de menaces. Il m’écrit qu’un feu intérieur le consume, et que la vie lui semble un désert. Il finit par me rendre triste à mon tour, si triste que je suis bien obligée de chercher des distractions quelque part. Un mot de moi le consolerait ; mais si ses lubies allaient le reprendre !… Quelle différence avec Anselme ! celui-là ne vous aborde jamais que le sourire sur les lèvres ; s’il ouvre la bouche, c’est pour raconter quelque histoire amusante ; il ne songe qu’aux plaisirs des autres. Certainement, comme le disait hier mon père, il serait le meilleur des maris… Lisons la lettre de Stenn.
À l’heure où vous recevrez cette lettre, mon âme se sera envolée vers les régions du bonheur éternel. Vos dédains m’avaient blessé, la balle d’un pistolet m’a guéri. Je n’ai plus que quelques jours à vivre ; plaignez-moi, car je meurs sans vous voir !
Stenn. Grands dieux ! il s’est tué pour moi ! je le sens bien, c’est lui que j’aime. Survient Anselme.
Anselme. — Qu’avez-vous, mademoiselle Dorothée ? je vous trouve bien pâle.
Dorothée. — Moi, je n’ai rien ; mais vous, pourquoi ce bras en écharpe ?
Anselme. — Une simple égratignure que j’ai reçue de cet officier qui voulait danser par force avec vous. Mais ce ne sera rien, et je viens vous offrir mon autre bras pour vous conduire au théâtre où jouent les acteurs français.
Dorothée, à part. — Que faire ? Si je reste à la maison pour regretter celui-là, celui-ci aura raison de se plaindre. En définitive, c’est pour son plaisir que Stenn s’est tué, tandis que c’est pour moi qu’Anselme a exposé sa vie. Haut Partons, M. Anselme.
ACTE QUATRIEME.
Stenn. — Me voilà de retour. J’étais fou de croire qu’elle allait accourir auprès de moi ; elle ne pouvait raisonnablement braver à ce point les convenances ; son père en serait mort de chagrin. N’importe ! le coup est porté ; j’ai enfoncé l’amour dans son cœur avec la douleur. Quel effet je vais produire tout à l’heure, lorsque je lui dirai : « Mon adorée, le désir de te revoir m’a fait vivre, c’est ta main qui m’a ramené des portes du tombeau ! » Elle me répondra : « Ô ciel ! n’est-ce point un songe ? C’est lui ! » Elle tombera dans mes bras, et dans huit jours elle sera madame Stenn. Pour se tirer d’affaire dans ce monde, il suffit d’un peu d’imagination. Une troupe de musiciens traverse la place en chantant. Où vont donc tous ces musiciens ?
Le Chœur. — Ils vont jouer une sérénade sous les fenêtres de la belle Dorothée, la fille du riche marchand Liebmann, qui se marie aujourd’hui.
Stenn. — Avec qui ?
Le CHŒUR. — Avec l’étudiant Anselme.

Stenn. — Elle n’a donc pas su que je m’étais brûlé la cervelle.
Le CHOEUR. — C’est au contraire ce qui l’a décidée.
Stenn. — Malheur sur moi ! il ne me reste plus qu’à me tuer pour tout de bon.
Le Choeur. — Nous t’empêcherons bien de commettre cette folie. Fais trêve un moment à tes lamentations, afin que nous puissions adresser quelques mots au public.
Le rôle du chœur antique, outre l’obligation de consoler, de raffermir le héros, et de lui donner d’excellents conseils, lui impose encore le soin de résumer la morale de la pièce. C’est pourquoi nous croyons devoir terminer par l’aphorisme de circonstance :


L’ÂNE DE PLUSIEURS
LES LOUPS LE MANGENT

 omme il est gentil Jacquot, comme il s’ébat joyeusement au milieu des prés ! Il va, il vient, il court, il saute. Le voilà qui s’arrête au bord du ruisseau ; son gros œil rond se fixe sur le courant d’un air curieux ; tout à coup ses oreilles se dressent droites et immobiles, il a vu son ombre, et il a peur. Mais bientôt il reprend courage ; il se met de plus belle à cabrioler, à se rouler sur l’herbe épaisse et tendre, dont il tond à chaque instant un peu plus que la largeur de sa langue. Les enfants du meunier le poursuivent ; et lui, cet autre enfant, il joue avec eux et mange dans leur main.
omme il est gentil Jacquot, comme il s’ébat joyeusement au milieu des prés ! Il va, il vient, il court, il saute. Le voilà qui s’arrête au bord du ruisseau ; son gros œil rond se fixe sur le courant d’un air curieux ; tout à coup ses oreilles se dressent droites et immobiles, il a vu son ombre, et il a peur. Mais bientôt il reprend courage ; il se met de plus belle à cabrioler, à se rouler sur l’herbe épaisse et tendre, dont il tond à chaque instant un peu plus que la largeur de sa langue. Les enfants du meunier le poursuivent ; et lui, cet autre enfant, il joue avec eux et mange dans leur main.
Vous auriez beau parcourir tous les moulins, toutes les fermes des environs, nulle part vous ne trouveriez un âne aussi joli, aussi gracieux que Jacquot. Sa robe est grise, le bout de son museau blanc comme le lait ; ses quatre jambes sont traversées par une raie noire, juste à l’endroit où la jeune meunière attache ses jarretières ; sa queue est terminée par une magnifique touffe de poils frisés et soyeux ; il a ce qu’il faut d’oreilles à un âne de bonne condition. Certainement l’âne qui inspira à M. de Buffon son fameux chapitre, n’était ni mieux fait, ni plus beau que notre Jacquot.
Jusqu’ici on l’a laissé libre, il a pu sans contrainte se livrer aux joies bruyantes de l’enfance ; mais le jour est arrivé où il doit faire son entrée dans le monde. Quelle belle journée ! comme les foins sentent bon ! quelle douce saveur ont les fleurs de la luzerne ! Jacquot n’a jamais été plus vif, plus espiègle, plus coquet ; on dirait, à voir sa légèreté, qu’il court après les papillons qui voltigent autour de lui. Sois heureux, Jacquot ; jouis une dernière fois des charmes de cette matinée de printemps. L’enfance, c’est la liberté, c’est l’insouciance, c’est le bonheur ; dans un moment tu diras adieu à tout cela. Le meunier s’avance, tenant la bride d’une main, de l’autre le bât ; Jacquot le laisse approcher sans défiance. L’éclat des pompons rouges le séduit ; voilà, pense-t-il, une parure qui ne me messiéra point, j’irai tantôt me mirer dans l’onde voisine. La bride est passée, le bât est sanglé ; Jacquot ne se possède pas de joie, il veut s’élancer du côté de la rivière ; mais un poids inconnu retient son élan, la pression du fer sur sa bouche lui fait pousser un cri de douleur. Voilà Jacquot bien étonné d’être obligé d’aller où il n’a nulle envie de se rendre, c’est-à-dire au moulin.
Le malheur donne une prompte expérience ; Jacquot ne tarda pas à comprendre la vanité de ses espérances. Déjà les maudits pompons qui l’avaient séduit ont perdu leur éclat ; porter le blé au moulin ou la farine chez les pratiques, se lever à l’aube, se coucher à la brune, rester enfermé le dimanche, ne plus aller au pré que pendant quelques jours de printemps, et encore n’y rester qu’à la condition d’être attaché à un vil poteau : tel est le sort de Jacquot. Cependant son excellent naturel ne s’est point altéré dans l’esclavage. Après tout, se dit-il, en comparant ma situation avec celle des autres ânes mes confrères, je ne dois pas me trouver trop malheureux ; ils travaillent comme des forçats, on les nourrit mal, et on les accable de coups. Je travaille tout âne honnête comme un homme doit le faire ; ma paille est tendre et ma litière fraîche ; les enfants de mon maître, qui ont été mes camarades d’enfance, m’aiment et m’apportent de temps en temps quelques friandises dont je me régale ; le meunier lui-même m’estime, et j’en suis quitte avec lui pour quelques bourrades qu’il m’administre lorsqu’en revenant de la ville il s’est arrêté un peu trop longtemps à la porte d’un cabaret.
Raisonnable comme nous le voyons, Jacquot aurait dû mourir au moulin, regretté de tous comme un membre de la famille. Le meunier, sa femme et ses enfants y comptaient bien ; mais tout à coup un grand changement s’est opéré dans le caractère de Jacquot. Lui, que nous avons vu si docile, si résigné, si bon garçon, il est devenu rétif, ombrageux ; il se met à braire à chaque instant, sans rime ni raison. S’il porte des sacs au moulin, il feint de faire un faux pas, et il laisse tomber sa charge ; si le meunier l’enfourche, il choisit à dessein l’endroit le plus raboteux pour se mettre à trotter ; si les enfants lui apportent une poignée d’avoine ou l’écorce fraîche et appétissante d’un melon, il dédaigne ces marques d’amitié qui lui étaient autrefois si précieuses, et répond par des ruades aux caresses de ses amis. Sans doute quelque vieux mendiant en haillons, jaloux d’entendre partout l’éloge de Jacquot, lui aura jeté un sort en passant le soir devant le moulin.
Ce n’est point un maléfice qui tourmente Jacquot ; ou plutôt c’est le plus grand, le plus terrible, le plus funeste de tous les maléfices : l’amour, puisqu’il faut l’appeler par son nom. Jacquot n’a pu se soustraire à l’universelle loi, une invisible flèche a percé son cœur, il est amoureux fou d’une jeune ânesse qui demeure à une lieue de chez lui, l’ànesse du curé. Elle est blanche, elle est grasse, elle est potelée ; quand elle monte au moulin, elle tient constamment les yeux baissés sans prendre garde aux ruades d’admiration, aux braiments d’enthousiasme que sa présence excite de tous côtés. Comment Jacquot pouvait-il résister à tant d’innocence et de candeur ?
Dans un état de civilisation où l’on tiendrait plus compte que dans le nôtre des intérêts du cœur, Jacquot serait devenu l’époux de Jacqueline (c’était le nom de l’ànesse) ; mais par un sot orgueil on la maria à un cheval. En apprenant cette nouvelle, Jacquot devint fou de désespoir ; quand on voulait lui mettre son bât, il se roulait par terre ; si on le conduisait à la ville, il quittait brusquement le grand chemin et courait comme un insensé dans la campagne, recherchant la solitude des forêts pour braire à l’écho le nom de son Amaryllis. Il en fit tant et tant que le meunier le vendit pour s’en débarrasser.
Son nouveau maître était un loueur d’ânes de Montmorency. Le temps et l’éloignement rendirent à Jacquot une partie de son ancien calme. La condition dans laquelle il se trouvait n’était pas trop mauvaise. On n’avait pas pour lui les mêmes soins ni les mêmes attentions que dans la famille du meunier ; le bourgeois était grossier, mal parlant, et très-prompt à se mettre en colère ; il n’entendait plus la meunière lui dire de sa douce voix : Allons, Jacquot, du courage. Mais quelquefois des grisettes de Paris caressaient sa crinière courte et épaisse ; elles tendaient leur tablier devant lui pour que sa grande bouche vînt y saisir quelque bon gros morceau de galette ou de pain d’épices ; puis elles montaient sur son dos et couraient dans les bois, riant, folâtrant, causant de leurs amours ; tout cela rappelait à Jacquot sa blanche Jacqueline, il songeait aux lieux qui l’avaient vu naître, au moulin, et il ne se trouvait plus aussi malheureux qu’il avait craint de l’être quand on l’amena pour la première fois à Montmorency.
Rien n’est durable sur cette terre, pas même ces semblants fallacieux qu’on est bien forcé, faute d’autre chose, de prendre pour le bonheur. L’été avait été pluvieux, les amoureux s’étaient vus forcés de rester à la ville ; quand vint l’hiver, le loueur d’ânes fut obligé de réduire son personnel.
Il céda Jacquot à un saltimbanque ; celui-ci désirait remplacer par un âne son chien savant qui venait de mourir.
Voilà Jacquot obligé d’étudier les sciences occultes, afin d’être un jour en état de prédire de bons mariages aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Jacquot était un âne fort intelligent, et il n’eut pas beaucoup de peine à se mettre au courant de sa profession. Le jour de ses débuts il obtint un succès colossal ; la place publique était trop étroite pour contenir la foule. — Jacquot, quelle heure est-il ? — Jacquot, quel est le plus laid de la société ? — Et les rires d’éclater, les gros sous de pleuvoir. Le saltimbanque encaisse une recette d’au moins 7 fr. 50 cent. Ma fortune est faite, se dit-il ; évidemment cet àne a du Munito dans l’esprit ; il jouera aux dominos comme un chien.
Malgré cela, notre ami Jacquot n’était pas dans une position trop brillante ; après avoir travaillé tout le jour, il ne trouvait au logis qu’une maigre prébende. En route, il portait le bagage de son maître, son costume de sauvage, ses cymbales, sa clarinette, ses gobelets, son épée pour arracher les dents, son tapis et sa boîte à onguents ; souvent il en était réduit à jeûner ou à brouter l’herbe coriace qui croît au bord des fossés ; quelquefois, en le voyant racler piteusement le sol, son maître partageait avec lui un morceau de pain noir.
En somme, Jacquot, avec sa philosophie accoutumée, se serait fait à sa situation. Je suis exilé de mon pays ; il me serait trop dur de voir Jacqueline aux bras d’un autre ; il n’y a plus assez de grisettes et d’amoureux pour faire vivre les loueurs de Montmorency ; il pouvait m’arriver pire que de tomber sur ce saltimbanque, qui n’est pas méchant au fond, et qui partage avec moi en frère ; d’ailleurs je mène la vie d’artiste, et j’avoue qu’elle n’est pas sans charme pour moi.
Voilà comment Jacquot se consolait. La vie d’artiste ! mot brillant qui cache une bien triste réalité. Celui qui, naguère, faisait des recettes de 7 fr. 50 cent., arrache à peine quelques sous à l’indifférence du public blasé. Jacquot n’a plus de succès, son maître le vend pour acheter des puces savantes et des serins artilleurs.
D’artiste qu’il était, Jacquot est devenu militaire ; c’est une vivandière qui en a fait l’acquisition. Le fifre qui crie, les tambours qui battent, les fusils qui résonnent, les étendards qui flottent, le canon qui gronde ; ce bruit, cet éclat ont ébloui Jacquot. Un autre se plaindrait d’être obligé sans cesse, par la pluie, par le froid, par la grêle, par l’orage, de suivre le régiment ; mais il est fier, lui, de marcher sous les drapeaux, d’affronter le péril, de porter sur son dos la gaie vivandière et ses provisions. Jacquot n’a pas toujours sa ration suffisante, sa maîtresse fait pourtant ce qu’elle peut ; mais bah ! à la guerre comme à la guerre, nous nous referons en pays conquis.
Les soldats aimaient trop la vivandière pour ne pas reporter un peu de leur affection sur son âne ; il était le bienvenu au bivouac, et les vieux troupiers, quand il passait, avaient toujours quelque bonne facétie à lui dire. Cela faisait sourire Jacquot, qui préférait ces gaudrioles aux galettes de Montmorency : la gloire militaire a fait tourner de bien plus fortes têtes.
Malheureusement pour notre héros la vivandière fut tuée dans une bataille. L’ennemi victorieux força à la retraite

Un soir on fit halte au milieu d’une forêt. Les feux du bivouac s’allumèrent ; les soldats se mirent à souper, puis les rondes circulèrent, les yeux se fermèrent, le camp se livra au repos. Jacquot, laissé libre, errait tristement autour du bivouac, la mine allongée, l’estomac creux : il commençait à sentir le néant de la gloire. Hélas ! se disait-il, tant que j’ai appartenu à un seul maître, j’ai été heureux ; un régiment m’a adopté, et rien n’égale ma misère. Le meunier, le loueur, le saltimbanque, la vivandière, s’inquiétaient de moi de temps en temps ; aujourd’hui personne ne s’aperçoit seulement que j’existe. Quand j’arrive au bivouac accablé de fatigue, chaque compagnie fait bouillir la marmite, on mange gaîment, et à moi l’on me dit : Jacquot, mon ami, arrange-toi comme tu voudras ; la route est libre, va brouter ; si l’ennemi se montre, viens nous avertir. Je serais un lâche si j’abandonnais les drapeaux ; mais dès que la paix sera signée, adieu le service militaire ; je rentrerai dans la vie privée, je me ferai de nouveau âne de moulin.
En se livrant à ces réflexions, Jacquot s’était avancé dans la forêt pour y découvrir un peu d’herbe fraîche ; la sentitinelle l’avait laissé franchir le camp sans l’avertir du danger qu’il allait courir. On était dans le cœur de l’hiver, et des bêtes sauvages infestaient la forêt ; Jacquot avait à peine fait cent pas dans la forêt, qu’un loup se précipita sur lui et le saisit à la gorge. Jacquot poussa un cri terrible pour appeler au secours ; les soldats dormaient, personne ne vint ; il essaya de lutter, mais il avait affaire à forte partie. Il vit qu’il était perdu, donna une dernière pensée à Jacqueline, et se rappela en mourant un mot qu’il avait entendu souvent répéter au meunier :


BON FAIT VOLER BAS
À CAUSE DES BRANCHES.

Gents de mainte manière, de mâle nacion,
Par le pays aloient prendre lor mansion.
Il ne demoroit beuf, ne vache, ne mouton,
Ne char, ne vin, ne pain, ne oie, ne chapon
Tuit pillart, murdier, traiteur et larron.
Ed. Charrière, v. 7118)

L’orateur véhément qui avait si bien devisé, parlé si voir et si haut, et, à vrai dire, déterminé l’insurrection, s’appelait tout simplement Guillaume Caillet. Il n’était ni plus ni moins malheureux que les autres paysans du Beauvoisis. Les routiers des grandes compagnies ne lui avaient point mangé plus de blé qu’au premier venu, ni plus ravagé son champ, ni mis à plus mal sa femme ou ses sœurs. Mais Guillaume Caillet avait toujours eu la tête plus près du bonnet qu’aucun des manants de sa paroisse.
Tout enfant, — qu’importe le titre de la chronique où nous puisons ces détails ? — il aspirait à dominer ses égaux ; à courir plus vite que les plus agiles ; à lutter contre les plus robustes ; à servir la messe du curé de préférence aux plus clercs ; à tenir l’étrier de Monseigneur, si par hasard les pages de Monseigneur n’y mettaient ordre.
Nombrer les tordions, les nasardes, les ruades, les étrivières, les gaulées, que lui valut son amour immodéré de la gloire, serait une opération arithmétique dont la patience de nos lecteurs ne nous permettrait pas de venir à bout ; nous la leur laissons à méditer.
Plus tard, Guillaume Caillet voulut être le héros des fêtes rustiques. Il lui fallait le prix de l’arbalète, le premier rôle dans toutes les cassades, la victoire à l’estoc volant, porter la bannière aux processions, être le plus renommé bouleur du pays, et aussi le plus vert galant et le meilleur joueur de vèze : encore volontiers se serait-il fait passer pour le plus noble, n’était que son père, — un simple tavernier, — portait en ses armes une écuellée de choux billetés de lard.
Aussi que de fois manqua-t-il d’être éreinté ! Que de fois joua-t-il à longue échine, balais, balais ! Que de fois fut-il vertueusement taboulé ! Sans compter les mépris que lui valait son outrecuidance ; les nuits passées en vain à l’huis de Margot — la-Halée, ou de Colichon-la-Jambue ; et les mauvais tours de tout genre que les copieux, les gausseurs, les fins fretés blasonneurs du village, ne se faisaient faute de lui jouer.
Malgré tout, Guillaume Caillet avait un ami ; et, par la raison qu’en amitié comme en bien d’autres choses, qui se ressemble ne s’assemble pas, Geoffroy Thibie était d’un naturel tout opposé : fort peu amoureux de l’éclat ou du bruit, faisant sa besogne, mauvaise ou bonne, par-dessous main, volontiers mystérieux, et, comme le chien de Nivelle, toujours prêt à s’en aller si on l’appelait.
Or, quand il voyait son cher Guillaume revenir à lui de quelque malaventure, tout grimaud, le mouchoir au nez, triste, biscarié, marmiteux, — Geoffroy ne faillait jamais, en le consolant, à lui rappeler une des plus sages maximes que nos anciens nous aient laissées :
Mais, l’heure passée, les sermons allaient au diable ; Caillet, de plus belle entraîné par les suasions de son humeur vaniteuse, rebrassait son chaperon, et s’en allait de côté et d’autre étalant sa grande brave.
Ce qui s’en suivit quand les vilains du Beauvoisis déclarèrent la guerre aux nobles, nous l’avons dit en commençant.
Seigneur de paille bat vassal d’acier, c’est le dicton de nos ajusteurs de procès ; et, dans cette occurrence, les seigneurs d’acier hachèrent menu les vassaux de paille ; mais non tout d’abord, néanmoins. Pendant quelques mois, les Jacques, — on les nommait ainsi, — prirent gaillardement leurs ébats aux dépens des hauts et puissants gentilshommes. Équipés de bons bâtons de pommier, fourches, vouges, leviers et tortouers, et d’aventure de quelque méchante pertuisane, ou de quelque forte arbalète de passe, Dieu sait comme s’en donnèrent ces mangeurs de fèves. En fait, ils se sentaient les prévôts aux trousses, et, au désespoir de leur salut, se démenaient comme les onze mille diables à la journée des sabots.
Brûler les grands bois, démolir les chàtellenies, occire et rôtir les chevaliers, efforcer les dames et damoiselles, c’était pain bénit pour ces honnêtes villageois, — à la vérité bien mal menés depuis les batailles de Poitiers et de Crécy. Parmi eux, — laissons encore parler messire Froissart, — « qui plus feroit de maux et de vilains faits, tels que créature humaine ne devroit et n’oseroit penser, celui étoit le plus prisé d’entre eux et le plus grand maître. »
Or, qui eût-ce été sinon Caillet ? Non point qu’au fond il eût plus de malice ou de vilenie en son escarcelle ; mais afin de se montrer le plus vaillant et le plus enragé. De même qu’il eût fait de son mieux pour courir après le loup, chanter : Allégez-moi, plaisant brunette, ou danser un branle sur les pelouses ; de même, — et plus en paroles qu’en actions, — mangeait-il les nobles et leurs petits ; — bragard et vantard qui semblait aux malavisés un vrai tigre d’Hyrcanie, un Satanas à quatre cornes, un ramasseur de gens abandonnés, plus terrible cinquante fois que le Romain Spartacus.
Geoffroy Thibie, tout au rebours, guerroyait tranquillement et sans tapage, esgorgillant à la doucette, ardant un manoir en tapinois, escoffiant un gendarme, sur toutes choses garnissant ses poches, et n’en disant mot ; tout honteux et changeant de brigade quand on menaçait, sur sa réputation malgré lui croissante, de l’élire pour capitaine.
Dans un carrefour de forêt, par une noire nuit, en face d’une rôtissoire où brûlait à petit feu le sire de Pecquigny, vingt mille truands et plus, brandillant leurs bâtons à deux bouts et leurs broches sanglantes, poussèrent une grande clameur qui fit un roi. Ce roi des Jacques — belle royauté, n’est-ce pas ? — fut Guillaume Caillet, couronné sous le nom de Jacques Bonhomme, premier et dernier de sa race. Il eut une marmite renversée pour trône, un caparaçon pour manteau royal, et pour sceptre une cognée de bûcheron. Des sujets à l’avenant, comme on peut penser.
Geoffroy Thibie regardait sans la moindre envie, et sans en être émerveillé, le sacre de son ami. Le nouveau roi le fit chercher pour boire avec lui quelques verres de cervoise, et peut-être avec l’intention de le nommer premier ministre ; mais l’autre était allé se cacher dans une grange en murmurant son refrain accoutumé :
Trois semaines après, il le répétait de plus belle et avec plus de raison.
Pendant ces trois semaines, en effet, le sort des armes avait changé. Aidés par deux compagnies de mille hommes que les Parisiens leur avaient envoyées, et d’intelligence avec une notable minorité des bourgeois de Meaux, les Jacques avaient pourtant échoué devant cette forteresse. Une seule défaite suffit pour dissiper avec leurs folles espérances le prestige de leurs victoires passées. De tous côtés les compagnies d’aventure, les bandes anglaises, les milices bourgeoises, traquèrent comme des bêtes féroces les armées de Jacques Bonhomme. Les plaines de la Champagne et de la Picardie furent rougies de leur sang, et s’engraissèrent de leurs cadavres. Le comte de Foix (Gaston Phœbus), le roi de Navarre et le captal de Buch les enveloppaient de tous côtés, et faisaient grande boucherie de ces croquants.
Enfin, — le soir dont nous parlions, — Guillaume Caillet, tombé dans les griffes de Charles-le-Mauvais, expiait le meurtre du sire de Pecquigny, grand ami de ce prince. On l’avait jugé fort sommairement, — condamné, cela va sans dire ; — et, coiffé d’un trépied brûlant, il dansait au bout des branches d’un chêne le seul branle durant lequel les pieds ne touchent jamais à terre. En bon français, on l’avait pendu haut et court.
Geoffroy Thibie, — dont nous avons rapporté plus haut la réflexion philosophique, — avait repris à temps l’extérieur d’un paysan soumis aux seigneurs ; — personne n’avait ouï parler de lui, — et il mourut obscurément de sa belle mort, quelque cinquante ans après ses glorieuses équipées.

On n’a jamais bien su comment il entendait an juste sa maxime favorite : Bon fait voler bas…, et si les branches en question n’étaient pas de celles où l’on avait accroché Guillaume Caillet.


LE MIEL EST DOUX
MAIS L’ABEILLE PIQUE

 rtémidore. — On m’a dit fort souvent, et y je ne suis pas éloigné de le croire, que le lever de l’aurore était favorable à l’inspiration. Les zéphyrs qui murmurent, les fleurs qui s’entrouvrent, les oiseaux qui chantent, tout cela donne des idées. Je crois qu’il m’en vient une. Écrivons.
rtémidore. — On m’a dit fort souvent, et y je ne suis pas éloigné de le croire, que le lever de l’aurore était favorable à l’inspiration. Les zéphyrs qui murmurent, les fleurs qui s’entrouvrent, les oiseaux qui chantent, tout cela donne des idées. Je crois qu’il m’en vient une. Écrivons.
L’aurore aux doigts de rose, à l’horizon vermeil… Décidément, c’est une idée ; continuons.
Le reste viendra bientôt… (il se gratte le front.) L’aurore aux
doigts de rose… (Il regarde le ciel.) à l’horizon vermeil
(Un bruit de pas se fait entendre.) La peste soit des fâcheux qui viennent m’interrompra ! Réfugions-nous derrière cette charmille ; j’y pourrai continuer en paix ce commencement de poëme épique.

Daphnis. — Pssst ! Pssst !
Chloé. — Qui m’appelle ?
Daphnis. — Ne me reconnaissez-vous pas ?
Chloé. — C’est vous, Daphnis ?
Daphnis. — Moi-même. L’épouse de Tithon vient à peine de quitter la couche de son vieil époux. Quel motif si important fait sortir si tôt la belle Chloé de sa demeure ?
Chloé. — Et vous-même, Daphnis, pourquoi courez-vous ainsi les champs à une pareille heure ?
Daphnis. — Hélas ! le sommeil a fui depuis longtemps mon chevet solitaire ; le soin de mes brebis ne me touche plus ; j’ai perdu l’appétit ; je suis malade.
Chloé. — Immolez un coq à Esculape.
Daphnis. — Esculape ne saurait me guérir.
Chloé. — Quelle est donc cette terrible maladie ?
Daphnis. — Il est un dieu, Chloé, un dieu malin qui prend plaisir à tourmenter les mortels infortunés ; il rôde sans cesse autour de nos demeures, et quand il aperçoit un gaillard frais, robuste, bien portant, il tire de son carquois une flèche empoisonnée et la lance contre lui. Aussitôt le malheureux ne dort plus, ne mange plus ; il s’étiole, il maigrit, il erre dans les champs comme un insensé, il est atteint de ce mal terrible qui fait souffrir plus que tous les autres maux.
Chloé. — Comment l’appelez-vous ?
Daphnis. — L’amour.
Chloé. — Vous voulez rire, mon cher ? l’amour faire souffrir ! c’est impossible. L’amour est un baume, un parfum, un philtre, tout ce qu’il y a de plus salutaire, de plus doux, de plus enivrant sur la terre. L’amour peuple le sommeil de rêves charmants ; au lieu de décocher des flèches empoisonnées, ce dieu que vous flétrissez de l’épithète de malin, voltige auprès de nous, rafraîchit notre visage avec ses ailes parfumées, et fait retentir une musique divine à nos côtés. On n’est jamais malade d’amour.
Daphnis. — Qui vous l’a dit ?Chloé. — Palémon.
Daphnis. — Le gredin ! Je m’en doutais…
Chloé. — Vous dites ?…
Daphnis. — Je dis que vous avez tort de parler avec Palémon.
Chloé. — Pourquoi ?
Daphnis. — Parce que c’est un farceur qui ne cherche qu’à tromper les jeunes bergères.
Chloé. — Ah ! bah !
Daphnis. — C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire.
Chloé. — Vraiment ?
Daphnis. — Laissons ce sujet, Chloé ; venez plutôt sous cet ombrage, et là, assis sur l’herbe tendre, je vous dirai ce que c’est que l’amour.
Chloé. — Vous me l’avez dit ; l’amour, selon vous, est quelque chose qui empêche de dormir et de manger, qui fait maigrir, et force les gens à se promener toute la journée dans les champs. J’aime mieux l’amour selon Palémon.
Daphnis. — Suivez-moi dans ce bosquet, et je cesserai de souffrir ?
Chloé. — Vous croyez ?
Daphnis. — J’en suis sûr.
Chloé. — Je ne vois pas pourquoi je ne vous rendrais pas ce petit service ; d’autant plus que je me sens très — fatiguée : asseyons-nous donc sur l’herbe. Êtes-vous mieux ?
Daphnis. — Bien mieux.
Chloé. — L’amour s’en va.
Daphnis. — Au contraire, il augmente.
Chloé. — Je ne vous comprends plus. L’amour est une maladie, et quand elle augmente, vous vous trouvez mieux ?
Daphnis. — Oui.
Chloé. — J’en suis charmée pour vous.
Daphnis. — Chloé !
Chloé. — Daphnis !
Daphnis. — Vos yeux sont doux.
Chloé. — Palémon me le disait hier.
Daphnis. — Votre bouche est divine.
Chloé. — Myrtil me le dira ce soir.
Daphnis. — Vos joues ont l’éclat de la rose et la blancheur du lait.
Chloé. — Chut !
Daphnis. — Quoi donc ?
Chloé. — N’entendez-vous pas du bruit derrière la charmille ?
Daphnis. — Sans doute quelque nymphe vous aura vue, et, pleine de dépit, elle agite les branches en s’enfuyant.
Chloé. — C’est possible.
Daphnis. — J’ai dans mon étable quatre chevreaux qui ont à peine brouté le cytise du mont Aliphère.
Chloé. — Ah !
Daphnis. — Cinq génisses blanches comme la neige errent dans mes prairies.
Chloé. — Tiens ! tiens ! tiens !
Daphnis. — Mon oncle, le vieux Anaximarque, a pas mal de fonds placés sur la banque d’Athènes.
Chloé. — Où voulez-vous en venir ?
Daphnis. — À vous offrir tout cela, si vous voulez me suivre.
Chloé. — Où donc ?
Daphnis. — À l’autel de l’hyménée. Crois-moi, Chloé, ni Palémon, ni Myrtil, ne t’aimeront autant que moi. Est-il dans la contrée un berger qui puisse m’être comparé ? Apollon oserait à peine me disputer la palme du chant. Aux derniers jeux, n’ai-je pas remporté le prix du bâton ? J’excelle à lancer au milieu des quilles un globe pesant, et les Nymphes elles-mêmes qui cancanent au clair de lune sur le mont Cythéron n’ont pas plus de grâce que moi lorsque je danse à la fête du village aux sons de la musette à pistons. Tu seras ma sultane, mon Andalouse, mon Albanaise au pied léger. Veux-tu me suivre ? de grâce, réponds-moi.
Chloé. — Adressez-vous à ma mère.
Daphnis, lui prenant la main. — Ah ! divine Chloé !
Chloé. — Eh bien, Monsieur !
Daphnis, voulant lui prendre la taille. — Oh ! délirante bergère !
Chloé. — À bas les pattes !
Daphnis. — Tu repousses ton époux ?
Chloé. — Vous ne l’êtes pas encore.
Daphnis. — Laisse-moi prendre sur tes lèvres un baiser.
Chloé, le repoussant. — J’entends du bruit…
Daphnis. — C’est ce bois qui murmure de joie.
Chloé, se débattant. — Berger, que faites-vous ?
Daphnis, l’embrassant. — Je cueille mon baiser ; que le miel en est doux !
Chloé, le souffletant. — Oui, mais l’abeille pique.
(La joue de Daphnis se gonfle ; la bergère s’enfuit derrière les saules. On les perd de vue tous deux. Artémidore sort de sa retraite.)

Artémidore. — Palsembleu ! Les Muses me gâtent. C’est évidemment pour moi qu’elles ont conduit ces deux individus vers ce bocage. Leur entretien m’a fort diverti ; j’en veux faire une pastorale sous ce titre :
Cela vaudra mieux que le poème épique dont j’avais écrit le commencement.



UN PIED VAUT MIEUX
QUE DEUX ÉCHASSES

 ans les derniers mois de 1788, à la fin d’un petit souper donné par le duc d’Orléans, il arriva une chose qui parut extraordinaire à tous les convives : le marquis de Genilhac prit la parole. Le marquis de Genilhac, dont peu de personnes ont entendu parler, était un homme maigre, noir et silencieux. Il passait pour sot dans une société où le babillage était à la mode ; partout ailleurs on lui eût reconnu un sens parfait.
ans les derniers mois de 1788, à la fin d’un petit souper donné par le duc d’Orléans, il arriva une chose qui parut extraordinaire à tous les convives : le marquis de Genilhac prit la parole. Le marquis de Genilhac, dont peu de personnes ont entendu parler, était un homme maigre, noir et silencieux. Il passait pour sot dans une société où le babillage était à la mode ; partout ailleurs on lui eût reconnu un sens parfait.
Ce soir-là, il défendit Rousseau, dont les convives avaient parlé avec le sans-façon de gens obligés par système à vanter tout haut le philosophe de Genève. On s’était moqué de l’Émile, et M. de Genilhac, sans repousser toutes les critiques dont ce livre avait été l’objet, soutint qu’il renfermait des conseils réellement bons à pratiquer.
— Vraiment ! — s’écria le marquis de Sillery, d’un ton léger ; — ne pensez-vous pas qu’il nous eût servi à quelque chose, en notre jeune âge, d’apprendre à manier la truelle ou le rabot ?
— À fabriquer des souliers ? ajouta M. de Montelar.
— Ou même à pétrir ces jolies choses, — dit encore M. de Valbenne, en montrant du bout des doigts à l’assemblée une de ces timbales de confitures, qu’on appelait alors des puits d’amour.
— Pourquoi pas ? — reprit Genilhac quand on lui laissa la parole ; — vous êtes tous, Messieurs, fort en règle du côté des parchemins ; vos familles sont riches, vos apparentages sont puissants ; rien ne vous manque de ce qui élève un homme au-dessus des autres ; il est naturel que vous vous jugiez dispensés de travailler comme eux et pour eux. Mais prenez garde : tout ce qui vous fait grands est en dehors de vous ; le sort, qui a détruit de plus hautes fortunes, peut mettre à bas et vos priviléges de caste, et votre richesse héréditaire, et votre crédit à la cour ; en un mot, toutes les conditions extérieures de votre élévation. Bien heureux alors celui d’entre vous qui aura pour les remplacer un de ces talents modestes dont vous rougiriez aujourd’hui.
Ces paroles, qui étaient très-banales pour le temps, et qui maintenant le sont plus encore, produisirent un certain effet, venant d’un homme aussi réservé que Genilhac ; mais ce fut bientôt à qui rirait le plus haut de craintes ainsi exprimées, et chacun se mit à prévoir de la manière la plus bouffonne ce qui pouvait advenir de lui, si la destinée le contraignait à faire œuvre de ses mains. Ils inventèrent des professions inouïes, des métiers que la Rome des Césars, toute corrompue qu’elle fut, ne connut jamais, et des enseignements qui eussent étonné Pétrone lui-même. Quand ce joli chapitre fut épuisé, ils revinrent à Genilhac.
— Çà, mon cher, lui dit Valbenne, — quel lot t’es-tu réservé dans ce commun désastre ? Quelle est la richesse intérieure que tu sauveras du naufrage, à l’instar du vieux philosophe grec ?
Ici Genilhac fut embarrassé : à sa rougeur, on put croire qu’il allait dire quelque chose de ridicule. Sa réponse fut pourtant simple et naturelle :
— Je sais, dit-il, un peu de géométrie…
À ce seul mot, et tout simplement parce qu’il était sérieux, le rire éclata de toutes parts. Nos jeunes écervelés recommencèrent à railler de plus belle, et Genilhac, effarouché, retomba pour longtemps dans le silence qu’il avait rompu si mal à propos.
Langen-Schwalbach n’était point en 1794 cette jolie petite ville où les baigneurs, que la mode n’appelle pas à Ems ou à Wiesbaden, vont retremper, et, pour ainsi dire, bronzer leurs muscles. Elle n’avait pas ces maisons jaunes, blanches et vert-clair ; ces grands hofs ou hôtels, aux fenêtres nombreuses abritées de jalousies, qui en ont depuis modifié l’aspect. C’était un village bâti à coups de hache dans un carrefour, avec les troncs d’arbres à peine équarris d’une forêt vingt fois centenaire.
Deux jeunes gens y arrivèrent un matin, vers l’époque que nous venons d’indiquer, et par un temps détestable. Leur uniforme vert et noir était celui des chasseurs de Condé ; mais à peine le distinguait-on sous une espèce d’enduit jaunâtre que la poussière et l’orage y avaient tour à tour déposé. Ils avaient une sorte de billet de logement, et allaient de porte en porte demander l’arpenteur de S. A. le duc de Nassau.
Les bons paysans allemands, que le séjour des baigneurs étrangers n’avait point encore formés aux calculs avares, leur offraient spontanément l’hospitalité des anciens jours. Mais nos voyageurs, tout en les remerciant, paraissaient tenir à rester dans les limites de leur droit ; car ils insistaient toujours afin d’être conduits chez « Monsieur l’arpenteur, » tenu de les héberger, nourrir, etc.
Ils arrivèrent ainsi devant un grand châlet de bois, qu’on leur dit être l’habitation de ce digne fonctionnaire, et ils furent frappés en y entrant par l’aspect de quelques meubles d’origine étrangère, qui réveillaient en eux des souvenirs d’une autre époque. C’était une cassette de Boulle, négligemment posée sur le grossier bahut de chêne enfumé ; c’était une épée de cour accrochée sous l’âtre à côté du fusil de chasse, et beaucoup plus rouillée que ce dernier ; c’était enfin un pastel de Latour entre deux grossières images mal encadrées. Bientôt l’énigme fut expliquée ; car ils retrouvèrent dans le propriétaire de la maison un de leurs compatriotes, noble comme eux, et avec lequel ils avaient partagé plus d’une fois les douceurs de l’ancien régime.
Pour ne point retarder plus inutilement une reconnaissance que nos lecteurs ont probablement anticipée, nous leur dirons le nom des trois bannis : MM. de Valbenne et de Montelar venaient d’arriver chez le ci-devant marquis de Genilhac.
On se doutera facilement qu’ils y furent bien accueillis. Un grand feu brilla dans la cheminée, une volaille appétissante, et qui avait encore plus d’un jour à vivre, fut sacrifiée sur l’autel de l’amitié. La cave de l’arpenteur n’était pas à beaucoup près aussi bien fournie que celle de l’ancien Palais-Royal (devenu Palais — Égalité) ; mais il y sut trouver encore une ou deux bouteilles de vin du Rhin, qui, vu les circonstances, furent amplement et joyeusement fêtées. Bref, quatre ou cinq heures après leur arrivée dans cette maison bénie, les deux soldats de Monsieur le Prince, à peu près remis de leurs fatigues, et remontant avec méthode le cours des ans, racontèrent à leur hôte les incidents périlleux de leurs dernières campagnes. Les misères, les souffrances, les déceptions de toutes sortes, rien ne fut oublié ; mais dans chacun de leurs récits, et surtout vers la fin, ils laissèrent percer une sorte d’amertume contre ceux des nobles français qui n’étaient point venus se ranger sous les drapeaux de l’émigration. À les entendre, il y avait dans une pareille conduite toutes les conditions d’une complète dérogeance, et Genilhac put prendre à son compte une partie de leurs réflexions plus ou moins malveillantes.
Sans leur répondre autrement, — car ils étaient chez lui, — ce digne homme leur raconta son histoire ; elle était moins compliquée que la leur :
— Je ne sais, leur dit-il, si vous vous rappelez certain souper d’il y a six ans, où, sans m’en douter, je fus ni plus ni moins prophète que M. Cazotte. On m’y trouva fort absurde à ce qu’il me parut, et cela ne m’a point empêché de régler ma conduite d’après les idées que j’avais émises en cette occasion. Une seule fois, — et je m’en repens, — elles ont cédé à un sentiment de fausse honte ; ce fut le jour où je me laissai persuader que je devais faire à mon rang le sacrifice de ma patrie. Quoi qu’il en soit, à peine eut-on fermé derrière moi les portes de la France, que le sang-froid et le bon sens me revinrent ; je cherchai s’il y avait en moi une autre étoffe que celle d’un chevalier errant toujours prêt à faire le coup de lance pour des causes perdues, et je découvris, à ma très-grande satisfaction, que mon respect pour Rousseau m’avait pourvu de facultés plus essentielles. Les employer ne fut pas difficile ; il ne fallait pour cela que renoncer aux chimères d’une vaine espérance, aux illusions d’un fol orgueil. Je l’ai fait en acceptant une situation, fort humble sans doute, mais dont votre visite m’a révélé tout le prix. Quant à ce que vous semblez penser des devoirs que la naissance impose, des positions incompatibles avec tel ou tel préjugé de caste, etc., j’avouerai naïvement que je le comprends à peine ; et, à ce sujet, je vous lirai volontiers quelques phrases d’un livre que je compose à bâtons rompus sur les marges de mon cahier d’arpentage.
Il prit, à ces mots, une espèce de volume recouvert en parchemin, et sur les pages duquel, parmi des plans de toutes sortes, on trouvait en effet quelques sentences de philosophie pratique.
L’une d’elles était ainsi conçue :
« Méfions-nous de tout ce qui grandit d’une grandeur factice ; méfions-nous des échasses sociales sans lesquelles les autres hommes seraient nos égaux.
« Une particule nobiliaire est une échasse ; échasse encore la protection d’un ministre. L’héritage d’un nom célèbre, une fortune que vous trouvez en naissant sous l’oreiller brodé de votre berceau, la préférence d’une jolie femme en crédit, l’amitié d’un grand seigneur, — si tant est qu’il y ait encore des grands seigneurs, — autant d’échasses que tout cela.
« La plupart sont bien fragiles, hélas ! et le sage doit toujours se tenir prêt au moment où elles se brisent. La moindre faculté personnelle, la moindre force inhérente à l’individu, est bien autrement solide, bien autrement désirable que les plus rares prodigalités du hasard. En d’autres termes, et comme dit le proverbe :
— De fait, Messieurs, continua Genilhac, vos échasses sont brisées… et mon pied me reste.
MM. de Valbenne et de Montelar, dominés par l’évidence de la démonstration, ne purent s’empêcher de trouver ce propos fort raisonnable, bien que, venant d’un arpenteur, il ressemblât quelque peu à un calembour.



LA BREBIS SUR LA MONTAGNE
est plus haute
QUE LE TAUREAU DANS LA PLAINE

 arlo, quels sont ces cris perçants que j’entends depuis quelques jours et qui me fendent la tête tous les matins à la même heure ?
arlo, quels sont ces cris perçants que j’entends depuis quelques jours et qui me fendent la tête tous les matins à la même heure ?
— Monseigneur, ce que vous appelez des cris perçants sont des trilles, des arpèges, des points d’orgue, qui partent du gosier novice encore de la signora Amalia Barati, choriste du théâtre Saint-Charles, qui demeure dans votre palais…
— Comment ! une choriste troubler le sommeil de l’un des plus puissants seigneurs de la cour de Naples, de l’unique et dernier rejeton de la famille Antivalomeni ! Carlo, monte chez cette choriste, et fais-lui savoir qu’elle ait à cesser ses cris à l’instant même, si elle ne veut encourir le ressentiment du prince Agnolo-Bernardo Antivalomeni.
Le domestique sortit et reparut au bout de quelques instants :
— Je viens d’exécuter les ordres de Votre Excellence ; mais la signora Barati, quand je lui ai parlé de garder le silence, m’a répondu : — Dites à l’unique et dernier rejeton de la famille Antivalomeni qu’il en parle bien à son aise, mais que si je cesse un seul jour de filer des sons et d’exercer mon gosier, ma voix se rouillera et mon imprésario me donnera mon congé. Ce que le prince a de mieux à faire est donc de s’apprivoiser avec mes cris, qui sont la seule ressource de sa très-humble servante.
En ce moment, une gamme chromatique partie du dernier étage de l’hôtel Antivalomeni vint confirmer les paroles de Carlo.
— Encore ! s’écria le prince. Ah ! c’est trop fort, et s’il y a une justice dans le royaume de Naples, j’aurai avant peu raison de cet insolent gosier.
Le fidèle Carlo apporta aussitôt au prince sa plus large perruque, sa plus longue canne, ses bas de soie les mieux brodés ; après quoi l’unique et dernier rejeton de la famille Antivalomeni s’élança de la rue de Tolède, où son hôtel était situé, sur la place du Palais-Royal. Il se fit introduire près du seigneur Caro Cecchi, intendant des menus-plaisirs du roi, son ami intime, auquel il raconta ses peines.
— Je ne dors plus, lui dit-il ; dès que l’aurore a posé ses doigts de roses sur le sommet de mon palais, une créature infernale commence à glapir et à roucouler ; toute la journée, je suis poursuivi par ses maudites notes. En ce moment même il me semble avoir des dièses et des bémols dans les oreilles. Ne pourriez-vous, par égard pour mon sommeil du matin, faire écrouer cette fauvette dans quelque forteresse ?…
— Y pensez-vous, mon cher Agnolo-Bernardo Antivalomeni ? reprit l’intendant des menus-plaisirs. Ne savez-vous pas que Sa Majesté est folle de musique et ne pardonnerait pas une pareille violation du droit des cantatrices ? Le roi veut que tous les chanteurs de son royaume puissent crier, s’il leur plaît, à tue-tête du matin au soir ;… malheur à qui essaierait de mettre une gamme ou une seule note à l’index !
Le prince sortit désespéré du palais, et rentra dans le sien en méditant quelque vengeance contre son harmonieuse ennemie. Mais, après avoir combiné plusieurs plans, il reconnut que le meilleur parti à prendre était celui de la résignation. En effet, comment atteindre ces notes aériennes ? Comment étouffer ces sons voisins du ciel qui s’échappaient tous les matins dans le limpide azur ?
— Eh ! quoi ! disait le prince d’un ton accablé, je puis tout ce que je veux dans le royaume de Naples ; après le roi, je jouis d’une puissance, pour ainsi dire, illimitée. Chacun m’honore, me respecte, s’incline devant moi quand je traverse les rues de Chiaja ; et je n’ai pas même le pouvoir de mettre une sourdine dans le gosier d’une choriste que le hasard a logée au-dessus de moi !… Une idée me vient, offrons-lui de l’or pour qu’elle se taise. Le prince sonna aussitôt son fidèle Carlo et lui dit : — Monte chez cette sirène maudite et offre-lui de ma part cent sequins si elle veut garder le silence.
Muni d’une bourse, Carlo grimpa aussitôt chez la Barati en se disant ce que son confrère Figaro devait chanter un siècle plus tard : All’idea di quel metallo… Il transmit à la choriste les offres du prince ; elles furent acceptées et le contrat passé à l’instant même. Cent sequins pour garder le silence ! certes la somme était faible, si l’on songe à ce qu’exigent certains orateurs politiques de nos jours pour ne pas prendre la parole.
Le lendemain la Barati, fidèle à sa promesse, n’ouvrit pas son piano ; pour se dédommager, elle se mit à compter ses sequins. Mais quand elle les eut comptés et recomptés plusieurs fois, elle reconnut que cette occupation était monotone et qu’il était plus agréable de lancer dans le ciel des pluies de notes et des fusées de gammes. Aussitôt, comme le savetier de notre bon La Fontaine, elle renvoya la bourse de sequins au prince, en lui annonçant qu’elle aimait mieux lui rendre son argent que de s’engager à ne plus chanter. À peine les sequins furent-ils partis, qu’elle entonna une de ses plus brillantes cavatines ; jamais sa voix n’avait été plus harmonieuse ni plus belle.
— Ces sons-là valent bien celui des sequins, s’écria-t-elle en battant des mains avec transport.
— Ah ! l’infâme me tuera ! disait le prince du fond de sa chambre à coucher.
Cependant, le lendemain du jour où la bourse lui avait été rendue par la virtuose, le prince s’étonna d’avoir dormi en dépit des gammes et des roulades qui s’élançaient plus énergiques et plus sonores que jamais. Le surlendemain, Morphée continua à répandre ses pavots les plus doux sur les paupières de l’unique et dernier rejeton de la famille des Antivalomeni. Le prince éprouva même une sensation voluptueuse que son sommeil du matin ne lui avait pas jusqu’alors procurée ; cette voix si fraîche et si pure le berça, et il dormit aux notes de la chanteuse, comme on dort au bruit des arbres, à l’écho d’une pluie d’été sur le feuillage ou aux mélodieux soupirs d’une fontaine.
Mais il arriva qu’un matin la choriste ne chanta plus, ni ce jour-là, ni les jours suivants. Le prince eut beau appeler le sommeil de toute l’énergie de ses prunelles, le sommeil lui tint rigueur ; et cependant ses vœux étaient satisfaits. La fauvette était muette dans son nid ; mais d’importune qu’elle était autrefois, elle était devenue insensiblement agréable, nécessaire même ; et le prince, qui ne craignait pas de passer pour le plus versatile des dormeurs, dit bientôt à Carlo :
— J’avais offert à cette jeune choriste cent sequins pour qu’elle cessât de chanter ; à présent j’en mets le double à sa disposition, si elle veut chanter, comme par le passé, dès le matin… Dis-lui que je suis un dilettante d’une espèce particulière. La plupart des gens n’aiment guère la musique que la nuit ; moi, c’est surtout au lever du jour qu’elle me plaît. Pars, et qu’avant ton retour le plus mélodieux ramage vienne m’annoncer que mes volontés sont remplies.
Carlo s’acquitta de sa commission, et fit savoir au prince qu’il devait renoncer désormais à entendre la choriste, attendu que depuis huit jours elle avait quitté la chambre qu’elle occupait dans les combles du palais pour se rendre à la foire de Sinigaglia, où elle allait figurer comme prima donna dans une troupe d’opéra fraîchement recrutée.
— Il est donc écrit là-haut, dit le prince d’un ton de dépit, qu’une simple choriste me contrariera dans toutes mes volontés ! Quoi ! je veux qu’elle se taise, et elle chante du matin au soir ! je veux qu’elle chante, et la voilà qui s’envole ! Décidément, il y a là quelque sortilége.
Cinq ou six années après cette aventure, le prince Agnolo-Bernardo Antivalomeni avait entièrement perdu le sommeil ; mais cette fois, ce n’était qu’à lui-même qu’il devait s’en prendre : malgré son âge, son embonpoint, sa perruque à quatre marteaux et la fierté de sa race, le prince s’était laissé prendre d’amour pour une chanteuse qui faisait les délices du théâtre San-Carlo.
On représentait alors un des premiers opéras du fameux Leo, ce compositeur par excellence, dont nos grands-mères écorchaient encore par tradition quelques refrains. La chanteuse, qui jouait le principal rôle, enlevait tous les suffrages ; elle rentrait chaque soir dans sa loge avec plusieurs volumes de sonnets que ses admirateurs avaient lancés à ses pieds. Quant aux bouquets, on les lui prodiguait avec tant d’abondance, qu’elle se trouvait comme retranchée dans une enceinte continue de lis, d’œillets, de jasmins et de roses.
Le prince était l’adorateur le plus passionné de la cantatrice en renom ; mais il avait en vain déclaré sa flamme par tous les moyens employés dans les annales de la séduction : ses madrigaux lui avaient été renvoyés cachetés, ses bouquets étaient consignés à la porte ; ses écrins eux-mêmes n’avaient pu obtenir audience.
Un soir, après le spectacle, le prince n’y tenait plus :
— J’aurai raison, dit-il, de cette beauté intraitable et farouche. N’est-ce pas un scandale qu’une princesse de théâtre ose rejeter les vœux d’un amant de ma qualité ?…
Transporté d’amour et de dépit, il se fait ouvrir la porte de communication du théâtre, et se rend à la loge de la prima donna, qu’il trouve heureusement seule et dans tout l’éclat de son costume :
— Savez-vous, ma reine, lui dit-il, qui vous refusez ? Savez-vous que celui qui vous recherche, qui a perdu le sommeil pour vous, n’est autre que l’unique et dernier rejeton ?…
— De la famille Antivalomeni, interrompit en riant la cantatrice. Eh ! mon prince, il y a longtemps que nous nous connaissons. N’avons-nous pas habité sous le même toit ? Vous souvenez-vous de cette pauvre choriste qui occupait, il y a quelques années, une petite chambre dans votre palais ?
— Quoi ! vous seriez ?…
— La signora Amalia Barati en personne, qui de choriste qu’elle était alors est devenue prima donna. Mais en changeant de condition, je n’ai pas changé de caractère, je vous jure ; j’ai conservé mon goût pour l’indépendance, et la preuve, c’est que j’épouse demain Pippo le ténor. Ah ! que de fois, mon prince, à l’époque où vous tempêtiez contre moi du fond de votre magnifique appartement, n’ai-je pas, dans ma mansarde, composé des variations sur ces paroles qui seront toujours de circonstance, tant qu’il y aura dans ce monde des rois et des bergères, des princes et des cantatrices :
est plus haute que le taureau dans la plaine.



DE PEU DE DRAP, COURTE CAPE

 l faut être un fort grand seigneur, ou tout à fait un manant, pour n’avoir pas appris quelque matin, par la voie des journaux, qu’un de vos amis, député plus ou moins éloquent, vient de gagner, au jeu de la politique, un portefeuille quelconque.
l faut être un fort grand seigneur, ou tout à fait un manant, pour n’avoir pas appris quelque matin, par la voie des journaux, qu’un de vos amis, député plus ou moins éloquent, vient de gagner, au jeu de la politique, un portefeuille quelconque.
Pour ma part, j’y suis fait, et je ne m’émeus guère plus d’une pareille nouvelle que de ces lettres banales par lesquelles une simple connaissance vous fait part de son mariage, part de l’accouchement de sa femme, ou part du baptème de son enfant ; toutes choses, soit dit en passant, assez difficiles à partager.
Mais la première fois que je vis un camarade de collége promu aux fonctions de Secrétaire d’État, je tressaillis comme le coursier de Job aux accents du clairon. L’honneur fait à mon ami, à ce brave Charles que je tutoyais depuis trente ans, me grandissait à mes propres yeux de quelques coudées ; et dès que je le jugeai installé, j’allai adorer à son zénith le soleil que j’avais vu se lever dans les humbles régions où je suis resté.
J’aime à croire que je ne dus pas à mon indépendance bien connue l’accueil obligeant que m’accorda le nouveau Colbert ; mais je dois dire qu’il me serra la main d’une façon beaucoup plus franche, lorsqu’après l’avoir félicité je lui déclarai hautement mon intention de ne le solliciter jamais, sous aucun prétexte, ni pour moi, ni pour les miens. Dès qu’il ne craignit pas d’avoir à m’être utile, je lui fus tout à fait agréable. Et je ne m’en étonnai point, car je connais les hommes.
Le ministre daigna m’initier à tous les petits arrangements de sa position nouvelle ; il m’expliqua le mécanisme de la maison qu’il allait tenir, et toutes les combinaisons de cette épargne fastueuse qu’il faut aux grands officiers du gouvernement à bon marché, pour soutenir, avec la moitié d’un traitement déjà mesquin, le train honorable qui leur est imposé par l’opinion ; — l’inconstance des temps et des portefeuilles oblige tout homme prudent à économiser l’autre moitié.
Si ingénieuses qu’elles fussent au premier coup d’œil, je n’approuvai pas, il s’en faut, toutes les inventions de mon ami ; j’entrevoyais très-bien les tristes lacunes du luxe menteur qu’il allait afficher, et je les lui signalais avec une impitoyable franchise. À la longue, ceci le mit de mauvaise humeur, et pour changer de conversation :
— J’ai renvoyé, — me dit-il, — mon valet de chambre, mon brave Joseph. Ce pauvre garçon est sans place ; tu devrais t’en accommoder.
— Merci, Excellence, — répondis-je en m’inclinant ; — mais, avant tout, je voudrais savoir pour quel motif tu t’es séparé de ce fidèle serviteur ?
— Je te le dirai très-volontiers, car cela ne peut lui faire aucun tort. Il avait trop d’esprit pour moi.
— Trop d’esprit !… m’écriai-je. —
— Ou, si tu le veux, trop de perspicacité. En ma qualité d’homme politique, je n’agis presque jamais qu’en vertu d’un système ; et l’une de mes théories les plus arrêtées, c’est que pour avoir des instruments commodes et dociles, il ne faut jamais s’entourer que de gens au moins médiocres. Ceux-là seuls pratiquent l’obéissance passive, et ne mêlent pas indiscrètement leurs inspirations aux vôtres ; ils sont souples, dépendants, facilement effrayés… Bref, pour qui le connaît, c’est un véritable trésor qu’un imbécile. Je ne veux m’entourer que de cela.
— Tu me permettras alors, — interrompis-je, — de ne pas venir voir trop souvent ton Excellence : je craindrais de passer pour un de ses favoris.
Nous bavardions encore sur ce texte plaisant, lorsque la porte du cabinet s’ouvrit. Un jeune homme entra, dont le front élevé, les yeux perçants, la bouche intelligente, m’inspirèrent une sorte d’attrait sympathique. C’était le secrétaire de l’homme d’état que mon ami remplaçait ; il venait proposer à la signature un travail pressé dont il avait été chargé, peu de jours auparavant, par son ancien patron. Charles y jeta un coup d’œil distrait, improvisa d’un ton péremptoire quelques objections superficielles, et annonça son intention de faire recommencer cet exposé de motifs sur un plan tout différent, et d’après d’autres idées.
Le jeune secrétaire rougit légèrement, — on n’est jamais disgracié sans quelque dépit ; — mais le sourire sardonique dont il accompagna l’offre de sa démission, m’apprit qu’il savait à quoi s’en tenir sur les dispositions méfiantes du nouveau ministre.
Cette démission fut acceptée immédiatement, et lorsque, après le départ du jeune homme, j’en témoignai ma surprise à Charles :
— As-tu donc oublié, — me dit-il, — les principes dont je t’ai fait part ? Le travail de ce jeune cadet révélait autant de talent que sa physionomie en promet ; c’est pour cela que je l’ai refusé sans hésiter. Avec un pareil acolyte, je perdrais bientôt la responsabilité de mes idées ; on dirait que j’ai un faiseur, et véritablement j’en aurais un, car sur bien des points, je ne pourrais faire adopter mes opinions à un petit entêté si sûr des siennes.
J’avais cru jusque-là que l’apologie des sots, dans la bouche de mon ami, n’était qu’un ingénieux paradoxe. Dès que je le lui vis prendre au sérieux, je m’en alarmai tout de bon, et ne négligeai rien pour lui ôter une idée aussi contraire au bon sens qu’à ses véritables intérêts. Mais j’avais affaire à trop forte partie, ou du moins à un homme trop convaincu de son infaillibilité, pour que mes paroles portassent coup.
— Ce que je te disais en riant, à propos de mon valet de chambre, — reprit Charles, — est une théorie très-démontrée pour moi, et à laquelle j’ai subordonné les principaux actes de ma vie politique. Dernièrement encore, appelé à donner mon avis sur la composition du ministère dont je fais partie, j’ai mis en pratique l’idée qui te semble si paradoxale. Au lieu de choisir mes collègues parmi les hommes les plus éminents de l’opinion parlementaire qui me portait au pouvoir, je n’ai appelé dans le cabinet que les notabilités secondaires, les talents d’un ordre inférieur. C’était le seul moyen de donner de l’unité à notre administration, de concentrer sa force et de…
— Et de t’assurer la prééminence, — ajoutai-je en souriant. — Tu es comme beaucoup d’honnêtes gens, qui ne voient d’autorité homogène que là où ils dominent sans contestation.
Cette remarque effaroucha mon ami, qui, d’un air très imposant, plaça son pouce dans l’entournure de son gilet. Après quoi il me déclara, dans les termes les plus polis du monde, que mon intelligence n’allait point jusqu’à saisir la portée de certaines vues, le mérite de certaines tactiques. Je le trouvai quelque peu impertinent, et, prenant tout aussitôt congé de lui :
— Au revoir, dans un an ! — lui dis-je. — Nous reprendrons notre discussion, le jour où les affaires publiques t’en laisseront le loisir.
Malheureusement c’était à coup sûr que je me donnais les gants d’une prophétie politique ; sept à huit mois après la conversation que j’ai racontée, les mêmes journaux qui m’avaient appris la nomination de Charles, m’apportèrent l’ordonnance royale qui le rendait aux douceurs de la vie privée. Ce jour-là même, j’allai le chercher dans la retraite où il fuyait les regards des hommes. Il me fallut assez de peines pour pénétrer jusqu’à lui ; son grand butor de valet de chambre ne voulait jamais comprendre que certaines consignes absolues ne concernent jamais la véritable amitié.
Je trouvai Charles, comme je m’y attendais, dans un accès de misanthropie fiévreuse. Il voulait affecter une parfaite résignation ; mais son désappointement éclatait malgré lui en traits amers lancés contre ses antagonistes et contre ses adhérents politiques.
— Tu as sans doute lu, — me dit-il, — le beau discours auquel je dois ma chute ; le grand homme d’état qui l’a prononcé n’en est pas même l’auteur ; il l’avait commandé un mois d’avance à un journaliste de l’opposition.
— Vraiment ! — m’écriai-je, — et le nom de cet habile écrivain ?
Charles satisfit à l’instant même ma curiosité. — Or je reconnus, — mais sans oser en faire semblant, — le petit secrétaire si dédaigneusement congédié dans le journaliste puissant et redoutable.
— Il faut avouer, — repris-je, — que si ce discours a du mérite, il était cependant bien facile à rétorquer.
— Certainement, — s’écria Charles ; — mais que veux-tu ? j’étais ce jour-là même retenu à la Chambre des pairs, et le ministère n’avait pour représentants, devant nos quatre cent cinquante-neuf souverains électifs, que cet ignorant de B***, ce bavard de C***, cette poule mouillée de D***. Comment voulais-tu qu’ils prévalussent contre une argumentation si captieuse et si serrée ?
J’aurais pu rappeler à Charles que M. B***, M. C***, M. D***, ne devaient pas à d’autre qu’à lui leur élévation au ministère, et que par conséquent il était responsable de leur incapacité : mais ceci n’eût fait qu’ajouter à son désespoir, et je gardai un respectueux silence. Lui, tout au contraire, revenait avec une espèce d’acharnement sur tous les incidents de sa défaite.
— Figures-toi, — me dit-il, — qu’après cet infernal discours, rien n’était encore compromis. Du Luxembourg où j’étais, et où l’on m’avait apporté la nouvelle de ce qui se passait à l’autre Chambre, j’avais écrit au président de celle-ci pour qu’il réservât jusqu’au lendemain le droit de répondre qui nous appartient toujours, comme tu le sais. Par malheur, — et tu concevras cette distraction dans l’état de trouble où j’étais, — je n’avais mis sur mon billet que le nom de M. S** *. Or, mon imbécile de valet de chambre a perdu deux heures à courir d’hôtel en hôtel après ce grave et bénévole personnage qui, durant ces deux heures, laissait se consommer le vote imprévu auquel nous devons notre ruine.
Hélas ! pensai-je, ceci ne serait point arrivé si l’adroit Joseph eût été chargé de la missive.
Mais je gardai encore cette réflexion à part moi, me réservant d’apprendre plus tard au ministre déchu combien les imbéciles sont de dangereux serviteurs, de mauvais amis, d’insuffisants et fragiles étais. Dans les orages de la vie on a souvent besoin d’un manteau ample et solide ; or, quelle que soit l’habileté du tailleur, jamais il ne pourra faire autre chose que :



ON A SOUVENT BESOIN
DE PLUS PETIT QUE SOI

 a porte principale de l’hôtel du prince de N., situé à l’entrée du faubourg Saint-Honoré, était ouverte à deux battants, et laissait voir facilement de la rue ce qui se passait dans l’intérieur. Les persiennes, exactement fermées, annonçaient que le maître devait être absent, ce qui assurait aux valets la faculté de mettre en action un de nos proverbes : « Absent le chat, les souris dansent. »
a porte principale de l’hôtel du prince de N., situé à l’entrée du faubourg Saint-Honoré, était ouverte à deux battants, et laissait voir facilement de la rue ce qui se passait dans l’intérieur. Les persiennes, exactement fermées, annonçaient que le maître devait être absent, ce qui assurait aux valets la faculté de mettre en action un de nos proverbes : « Absent le chat, les souris dansent. »
Les souris dansaient en effet dans la cour où se trouvaient rassemblés tous les domestiques mâles et femelles : cuisinier, cocher, valet de chambre, femme de chambre, palefrenier, tous, jusqu’au dernier aide de cuisine, poussaient des cris de joie, riaient aux éclats, et se tenaient rassemblés autour de la pompe, battant d’avance des mains dans l’attente du spectacle gratis qui se préparait.
L’acteur principal, ou pour mieux dire le patient de cette scène, était Jacquot le ramoneur, qu’on venait de trouver endormi dans le cabinet de Monseigneur, à la suite d’un pèlerinage de plus de deux heures dans les cheminées de l’hôtel où il avait failli tomber asphyxié. Être surpris en flagrant délit d’assoupissement, la tête toute barbouillée de suie et appuyée sur une magnifique ottomane en lampas jaune doré, voilà qui méritait un châtiment.
Les fidèles serviteurs du prince de N. avaient tenu conseil et décidé, à l’unanimité, qu’il serait divertissant de placer Jacquot sous la pompe, et de lui administrer une douche prolongée, comme leçon de savoir-vivre. Le pauvre ramoneur, plus mort que vif, était déjà placé sous le tuyau ; le signal de l’irrigation allait être donné, quand tout à coup, une voix de Stentor, partie du vestibule, fit entendre ces mots : — Le premier qui touche à cet enfant aura affaire à moi !
Cette menace était prononcée par l’illustre Belrose, le chasseur du prince de N. Titan de la livrée, Belrose était sans contredit le plus bel homme que l’on eût jamais vu planté derrière une voiture. Haut de deux mètres, il était en outre d’une force prodigieuse qui imprimait le respect à tous les gens de l’hôtel. Il se fit faire place du geste au milieu du cercle qui entourait la pompe, saisit d’une seule main le ramoneur, et l’emporta sous le vestibule, où il eut beaucoup de peine à le réchauffer, tant la peur l’avait glacé. À force de soins, Belrose parvint à ranimer Jacquot ; celui-ci commença à étendre les bras, à se frotter les yeux ; enfin, un sourire frais et rose se fit jour au milieu de la suie qui couvrait ses lèvres. Dès lors, le cœur de Belrose fut gagné : il fit débarbouiller le pauvre enfant qu’il avait si miraculeusement sauvé du déluge, et résolut de le prendre sous sa protection.
Quinze jours après cet événement, un petit groom, de la plus charmante espèce, livrée bleu de ciel, culotte courte, chapeau galonné légèrement incliné sur l’oreille, traversait la cour de l’hôtel. Reconnaîtriez-vous là notre ami Jacquot le ramoneur, maintenant métamorphosé en Frontin du petit format ? Vous dire comment il se fit que le prince de N. eut besoin d’un petit laquais ; comment son chasseur Belrose lui proposa Jacquot, qui plut aussitôt au prince par sa mine éveillée, sa petite taille, et surtout son joli sourire couleur de rose, serait entrer dans des détails superflus. Qu’il nous suffise de savoir que Jacquot est maintenant la perle des grooms, et que, de la main dont il raclait autrefois les cheminées, il porte des bouquets de camélias et de petits billets parfumés au réséda et au musc. Il s’appelait Jacquot, on l’appelle Jacques ; on a raccourci son nom, contrairement à la plupart des vilains qui allongent le leur en s’anoblissant.
Cependant Belrose avait beau être le chasseur le plus imposant de tout le faubourg Saint-Honoré, il perdait chaque jour de son crédit dans l’esprit du prince ; l’opinion même des gens de l’hôtel était qu’il ne conserverait pas longtemps sa place. Outre que le beau chasseur vieillissait, ce qui ôtait à son service beaucoup de sa promptitude et de son élasticité, il avait contracté la funeste habitude de boire le matin à jeun un grog, puis deux, puis trois, puis six ; puis les verres de rhum et d’absinthe offerts par occasion ; sa journée avait fini par ne plus être qu’un tissu de libations. Souvent, quand Belrose paraissait devant le prince, celui-ci s’était aperçu que le chasseur parlait avec incohérence et chancelait sur sa base ; des menaces de congé lui avaient été signifiées à plus d’une reprise. Ces menaces auraient même reçu leur exécution, si Belrose n’avait eu son bon ange dans la personne de Jacquot, qui veillait sur lui avec la fidélité d’un fils. Lorsqu’il s’agissait de monter le soir derrière la voiture du prince, et que le chasseur se trouvait avoir le cerveau plus alourdi qu’il ne convenait, Jacquot avait le soin de grimper sur le marche-pied où se tenait Belrose, et de lui pincer les jambes de temps en temps, de manière à le tenir éveillé jusqu’au moment où il devait ouvrir la portière.
Le prince avait-il à remettre au chasseur quelque lettre qui exigeait une prompte réponse, Belrose était à peine dans le vestibule que Jacques lui avait déjà arraché la lettre des mains, s’élançait dans la cour avec la vivacité de l’écureuil, et rapportait la réponse en moins de temps qu’il n’en avait souvent fallu pour l’écrire.
Charmé de cette promptitude vraiment atmosphérique, le prince se disait parfois en pensant à son chasseur : — Il a de grands défauts sans doute, négligent, paresseux, ivrogne ; mais il s’acquitte des messages que je lui confie avec une telle célérité, que je suis bien obligé de passer sur ses imperfections.
Jacquot était partout où il fallait que Belrose se trouvât ; il était devenu l’âme secrète, le ressort caché de cette machine gigantesque, qu’il faisait agir et mouvoir à son gré. Le chasseur, en voyant tout le mal que son protégé se donnait pour lui, disait parfois à Jacques d’un ton attendri :
— Je veux que le prince sache tout ce que tu vaux ; je veux lui apprendre que, depuis que tu es attaché à l’hôtel, tu fais presque tout mon service.
— Garde-t’en bien, s’écriait Jacques en caracolant autour du colossal valet à la manière des jeunes singes ; si tu dis un mot de cela au prince, je lui déclare, moi, que tu m’as pris dans ses cheminées pour me faire endosser sa livrée, et nous verrons alors s’il trouve surprenant que je t’aide un peu dans ton ouvrage.
Le prince était si content du service de son petit laquais qu’il ne put lui refuser d’aller passer deux ou trois mois dans un village situé près d’Aurillac, pour porter à sa mère quelques économies qu’il avait faites depuis qu’il travaillait à Paris. L’absence du groom fut fatale au chasseur ; dès que son protégé eut quitté l’hôtel, ses défauts reparurent dans toute leur nudité, et finirent par amener une catastrophe depuis longtemps imminente. Belrose fut remplacé par un autre géant de son espèce, et renvoyé par le prince vers ses dieux pénates.
Malheureusement le chasseur ne possédait pas de pénates ; il avait toujours vécu fort éloigné du chemin de la Caisse d’épargne. Il quitta l’hôtel sans la moindre ressource, et quand il eut dépouillé son habit vert, son baudrier et son chapeau à plumes, ses cheveux se trouvèrent si blancs, son dos si voûté, ses jarrets si engourdis, qu’il reconnut lui-même la nécessité de prendre ses Invalides.
Mais quelle fut la douleur de Jacques, lorsqu’à son retour il apprit que Belrose était exilé pour jamais ! Il l’aimait comme un père, et ne put s’empêcher de répandre des larmes lorsqu’il aperçut sous le vestibule un autre chasseur qui portait l’habit, le couteau de chasse, et jusqu’au plumet de Belrose.
Il résolut aussitôt de retrouver celui qu’il regardait comme son bienfaiteur, fût-il au bout du monde. Mais il se passa plusieurs mois avant qu’il pût le rejoindre ; car Belrose, par un reste d’orgueil, tenait à cacher sa destinée jadis si brillante, aujourd’hui si misérable. Jacques, à force d’informations, apprit qu’il habitait une mauvaise chambre garnie située dans le fond de la rue Mouffetard. Il le trouva couché sur un grabat où le retenaient des rhumatismes, un asthme, la goutte et toutes les maladies qui s’attachent à la vieillesse des grands seigneurs et des domestiques de grande maison. Belrose fut attendri jusqu’aux larmes lorsqu’il vit paraître dans sa mansarde Jacques, qui lui sauta au cou dès qu’il l’aperçut.
— Tu ne m’as donc pas oublié ? lui dit l’ex-chasseur ; je vois que j’ai bien fait autrefois de m’attacher à toi ; j’avais deviné ton bon cœur…
Jacques, le voyant dans un dénuement extrême, l’obligea d’accepter tout ce qu’il avait d’argent : le prince l’avait pris en affection, et lui donnait souvent de petites gratifications qu’il mettait de côté avec la scrupuleuse économie d’un enfant de l’Auvergne. Il ne se passait presque pas de jours où il ne fît le trajet du faubourg Saint-Honoré au quartier Saint-Marceau ; et comme il avait la jambe plus agile et plus légère que jamais, ces courses ne nuisaient en rien à son service.
Un jour qu’il arrivait comme à l’ordinaire chez Belrose, on lui annonça que le pauvre homme était au plus mal. Désespéré et voulant au moins l’embrasser une dernière fois, Jacques s’élance dans l’escalier, et, en entrant dans la chambre du malade, il est suffoqué par une forte odeur de fumée.
— D’où vient cela ? dit-il à Belrose.
— Hélas ! répond le vieux chasseur d’une voix languissante, la cheminée n’a pas été ramonée de tout l’hiver ; je me suis plaint ce matin ; mais mon hôtesse, à qui je dois plusieurs mois de loyer, a déclaré que, pour le peu de temps qui me restait à vivre, cette nouvelle dépense était superflue.
À peine Jacques a-t-il entendu ces paroles que, saisi d’indignation, il met de côté son habit bleu de ciel et sa cravate blanche, il s’arme d’un balai et d’un instrument tranchant qu’il trouve par hasard sous sa main, et, malgré les efforts de Belrose pour le retenir, il s’élance dans la cheminée en entonnant une chanson d’Auvergne. En descendant, il se place devant l’ex-chasseur, la face barbouillée, les cheveux remplis de suie :
— Me reconnais-tu maintenant, lui dit-il, mon vieil ami ? Me voici tel que j’étais quand tu me pris autrefois sous ta protection et me sauvas des mains de ces damnés domestiques qui voulaient me faire un mauvais parti. Je me suis toujours rappelé tes paroles : — Pourquoi, leur dis-tu, vouloir faire du mal à cet enfant ? Vous devriez au contraire le protéger, le secourir ; ne savez-vous pas que dans la vie


le Diable vient qui souffle.

QUI VA CHERCHER DE LA LAINE
REVIENT TONDU

 ous sommes dans une vallée agreste, située dans la partie la plus pittoresque du département de l’Indre ; une petite rivière court entre les saules, remplissant de bruits joyeux les roues babillardes d’un moulin ; de grands bœufs fauves ruminent couchés dans l’herbe ; la caille amoureuse glousse entre les sillons. Au loin l’aiguille dentelée d’un clocher s’effile sur le ciel d’un bleu nacré ; quelques chaumières blotties au pied de la colline comme des nids d’oiseaux sous un buisson, trahissent leur présence par de minces filets de fumée flottant entre les arbres. Le vent se joue dans les feuilles, le grillon sous la luzerne, l’eau sur les cailloux.
ous sommes dans une vallée agreste, située dans la partie la plus pittoresque du département de l’Indre ; une petite rivière court entre les saules, remplissant de bruits joyeux les roues babillardes d’un moulin ; de grands bœufs fauves ruminent couchés dans l’herbe ; la caille amoureuse glousse entre les sillons. Au loin l’aiguille dentelée d’un clocher s’effile sur le ciel d’un bleu nacré ; quelques chaumières blotties au pied de la colline comme des nids d’oiseaux sous un buisson, trahissent leur présence par de minces filets de fumée flottant entre les arbres. Le vent se joue dans les feuilles, le grillon sous la luzerne, l’eau sur les cailloux.
Trois hommes sont assis autour d’une table, dans une maisonnette dont les fenêtres curieuses s’ouvrent sur la vallée. Des fleurs s’épanouissent dans des vases de porcelaine blanche, le linge est parfumé de lavande et de romarin, les carreaux sont luisants ; tout est frais, propre, souriant dans ce réduit.
Les trois convives mangent de bon appétit ; l’un d’eux surtout ne refuse rien de ce qui lui est offert ; poisson, gibier, légume, tout est accepté avec le même empressement. Celui-ci est le plus jeune ; cependant la souffrance et la fatigue ont déjà flétri son visage ; les deux autres portent le costume aisé d’honnêtes campagnards, forts, dispos et gais. Ils regardent parfois leur camarade avec un sourire amical et doux.
— Veux-tu, frère, cette aile de perdreau ? dit l’un.
— Oui, mais je prendrai l’autre aussi. — Cette caille dodue te plairait-elle ?
— Elle me plaît avec sa voisine.
— Trouves-tu que cette omelette ait bonne mine ?
— Je croirais lui faire injure si je ne l’accueillais pas aussi bien que ce brochet.
Et le jeune convive ne laissait pas ses dents oisives.
Cependant au bout d’une heure son activité se ralentit. Il se renversa sur son fauteuil d’osier.
— Voilà, s’écria-t-il, le meilleur repas que j’aie fait depuis longtemps !
— Et pourtant tu en as fait d’excellents à Paris ?
— J’en ai pris beaucoup du moins, depuis Flicoteau jusqu’au Rocher de Cancale, depuis le père La Tuile jusqu’au Café de Paris, à dix-neuf sous et à cent francs.
— Cent francs ! s’écria le plus âgé des convives ; tu buvais donc le Pactole en bouteille ?
— Penh ! je buvais le crédit. J’étais alors directeur-gérant d’une société en commandite pour l’exploitation des forêts de cèdres de l’Atlas : superbe affaire sur le papier ! Dix millions de capital, cent pour cent de dividende ; maison à Medeah, comptoir à Bougie, agences à Bouffarick et à Coleab. Malheureusement la brouille avec le Maroc a fait peur aux actionnaires ; ils ne sont pas venus, et je suis parti.
— Et les dividendes ?
— Ils sont sur pied, au col du Teniah. Cette gérance devait me rapporter vingt mille écus de bénéfices annuels, qui se sont soldés par vingt mille francs de perte mangés en prospectus. Mais j’ai souvent et bien dîné : dix cèdres au déjeuner, cinquante au souper ; j’ai laissé une forêt chez Véfour.
— Tu as vendu le bois avant de l’avoir coupé ; qu’as-tu gagné à ce commerce-là ?
— L’expérience, mince capital que je vous apporte.
— Ce n’était pas la peine, nous l’avions déjà.
— Que voulez-vous ? on n’a pas deux fois vingt ans dans sa vie. Je m’étais mis en tête de faire fortune. Vous m’aviez compté en beaux écus ma part d’héritage, et je partis pour Paris. Nul n’est prophète en son pays, me disais-je ; cela est vrai dans le département de l’Indre comme ailleurs. Ce proverbe m’a conduit au boulevard des Italiens.
— Où sans doute tu fus bien accueilli ?
— Parbleu ! j’avais cent cinquante mille francs ! Et cependant cette somme, renfermée en bons billets de banque dans mon portefeuille, me semblait alors une misère ! Je voulais cinquante mille livres de rente, ou rien. Je les ai eus pendant trois ans ; maintenant je n’ai rien.
— Tous tes vœux ont été remplis, reprit en souriant l’aîné des trois frères.
— Trop remplis même. J’étais à peine arrivé depuis vingt-quatre heures que déjà j’avais un ami.
— Un ami ?
— C’est le synonyme parisien d’un substantif désobligeant. Cet ami me prit si fort en affection qu’il m’intéressa dans une affaire de pavage en fer creux ; c’était le moment de la fièvre aux pavés. Tout homme qui se respectait avait son petit système de pavage dans la poche ; pavage en bitume, pavage en grès, pavage en chêne, pavage en sapin, pavage en cailloutis ; sous prétexte de paver Paris, on le dépavait. Je remerciai mon ami avec effusion, et mis vingt mille francs dans son entreprise. Ma fortune allait, grâce à notre pavage en fer creux, courir comme une locomotive sur un rail. Mon ami avait l’adjudication de la rue Rambuteau, alors au berceau. Notre spéculation était superbe ; malheureusement elle péchait par la base ; le pavé nous coûtait quatre francs, et la ville nous le payait soixante et quinze centimes ; mon ami me conseilla de me rattraper sur la quantité ; je suivis son conseil.
— Et tu perdis le double ?
— Justement. À la suite de cette opération, mon ami changea d’air et partit pour Bruxelles.
À quelque temps de là, on me fit voir dans un café un monsieur qui buvait un grog.
— Voyez-vous ce monsieur ? me dit mon interlocuteur.
— Oui.
— Qu’en pensez-vous ?
— Je pense que c’est un monsieur qui a un gros ventre et une redingote marron.
— C’est un grand homme.
— Ah bah !
— Permettez que je vous le présente.
De cette présentation résulta un journal.
— Eh quoi ! de la littérature après de l’industrie ?
— Ce que je n’avais pas trouvé dans le pavé, je voulais le trouver dans le feuilleton. Notre journal fut fondé à la Maison d’Or, un soir d’été. Le lendemain la Foudre se leva sur Paris. Il nous fallait un titre fougueux, incandescent, terrible ; nous voulions porter la flamme de nos convictions dans les ténèbres de l’indifférence, illuminer, aux lueurs de nos principes, les abîmes où la société se plonge. La Foudre fut tout à la fois socialiste, humanitaire, progressive et rénovatrice ; elle sapa les abus et frappa de la cognée du premier-Paris l’arbre séculaire du privilége. Dix hommes d’état rédigeaient la partie politique ; dix de nos plus féconds romanciers versaient leurs élucubrations dans la partie littéraire. C’est la Foudre qui a inventé la question Valaco-Moldave et les romans en vingt-quatre volumes. Le roman est resté à son neuvième tome, et la question à sa cinquième phase.
— La Foudre mourut donc ?
— Elle passa comme un météore ; mais en passant elle laissa des traces brûlantes de sa polémique ; trois paradoxes de plus dans la presse, cinquante mille francs de moins dans mon portefeuille.
— Et le grand homme au gros ventre ? demanda l’un des frères.
— Il faillit devenir député. L’industrie et la littérature ne m’ayant pas réussi, je me lançai dans les spéculations. Dans cette carrière périlleuse, on ne peut espérer le succès que par le secours de l’audace. À moi et à mon associé…
— Ah ! tu avais un associé ?
— On a toujours un associé… À nous deux, esprits hardis, il fallait, dis-je, quelque chose de neuf, d’imprévu, d’osé. Nous spéculâmes sur les huîtres. L’accaparement détermina la hausse ; on faillit se révolter à la rue Montorgueil, où mille garçons de restaurants demandaient les cloyères qui n’arrivaient pas. Paris resta huit jours sans huîtres : la consternation était à son comble ; mais quand nous nous décidâmes à ouvrir nos parcs, les bivalves étaient morts. Mon capital s’en était allé en coquilles ; j’eus pour ma part un dividende de cent mille écailles. Les cèdres de l’Atlas mangèrent ce qui me restait. Quelque temps je battis le pavé de Paris ; mais c’est un pavé qu’on ne saurait battre longtemps quand on n’a rien dans la poche. C’est alors que, secouant toute mauvaise honte, je suis parti pour cet honnête département de l’Indre où vous avez vécu loin des orages et des passions. Et vous, mes frères, vous m’avez accueilli comme l’enfant prodigue, et vous avez eu même l’attention de supprimer le veau que je n’aime pas pour le remplacer par le gibier que j’aime beaucoup.
— Maintenant que tu as glané l’expérience, resteras-tu parmi nous qui avons moissonné le bonheur ?
— Oui, mes frères ; car j’ai ramassé dans vos gerbes un épi que la sagesse humaine a mûri. Cet épi est un proverbe, et ce proverbe le voici :


QUI VEUT ÊTRE RICHE EN UN AN
AU BOUT DE SIX MOIS EST PENDU.

 lusieurs jeunes gens buvaient du thé, mangeaient des sandwich et fumaient dans un salon élégant de la Chaussée-d’Antin. Au laisser-aller de leurs discours, à la désinvolture de leurs poses, à l’animation de leur visage, il était aisé de comprendre qu’ils venaient de dîner longtemps et bien. Quelques-uns d’entre eux effleuraient à peine leur majorité ; de blondes moustaches ombrageaient mollement leurs lèvres, et sur l’ivoire poli
lusieurs jeunes gens buvaient du thé, mangeaient des sandwich et fumaient dans un salon élégant de la Chaussée-d’Antin. Au laisser-aller de leurs discours, à la désinvolture de leurs poses, à l’animation de leur visage, il était aisé de comprendre qu’ils venaient de dîner longtemps et bien. Quelques-uns d’entre eux effleuraient à peine leur majorité ; de blondes moustaches ombrageaient mollement leurs lèvres, et sur l’ivoire poli

Le vent sifflait avec force dans la rue, la pluie fouettait les volets clos, un feu clair pétillait dans la cheminée ; l’heure, le lieu, le temps, tout était propice aux causeries intimes.
— Ma foi ! vive la joie ! s’écria un jeune homme nonchalamment couché sur une ottomane. Le matin je broche des vaudevilles avec les plumes du ministère, le soir je griffonne des feuilletons sur le papier du ministère, et le trente du mois j’émarge cinq cents livres au trésor public en qualité de chef de bureau : c’est doux et facile !
— Parbleu ! mes chers, reprit un autre, blotti au fond d’une ganache, on a calomnié l’existence. Parole d’honneur, elle est bonne personne. J’ai un entresol, dix mille livres de pension, trois mille écus de crédit et un cœur presque neuf ; si tout cela ne fait pas le bonheur, le bonheur est un malotru.
— Et toi, que fais-tu ? reprit un buveur de thé en s’adressant à un gros garçon rose et joufflu qui avalait méthodiquement des verres de punch.
— Moi ? J’attends.
— Quoi ?
— Une sinécure que m’a promise un mien cousin, député ministériel.
— Tu l’attends, et moi je l’ai, continua un petit monsieur blond qui portait un œillet blanc à sa boutonnière ; depuis hier j’inspecte les prisons au nom du gouvernement.
Mille propos suivaient ceux-ci ; mais, à tous ces discours inspirés par la joie ou l’espérance, un pâle jeune homme, étendu sur une pile de coussins, ne répondait que par les mouvements dédaigneux de sa bouche armée du bout ambré d’une pipe turque. Au plus fort de ses aspirations et de son dédain, il fut brusquement apostrophé par l’un de ses camarades.
— Eh ! beau ténébreux ! s’écria-t-il, depuis quand as-tu pris l’habitude de ce silence qui ferait honneur à l’obélisque ? Es-tu désillusionné, toi aussi ? C’est bien usé, mon cher.
— Et pourquoi voulez-vous que je parle ? répondit l’homme à la pipe. Est-il bien nécessaire que je verse un contingent de billevesées au fleuve de sornettes qui s’épanche de vos lèvres depuis deux heures ? Vous rayonnez de contentement, tant mieux ; votre bonheur à tous a un bonnet de coton sur les oreilles et des socques aux pieds ; gardez-le. L’un a mille écus de revenu, l’autre six mille francs ; Achille a une place, Gustave aussi, Paul de même ; Joseph attend un héritage, Charles mange le sien ; Henri va se marier. À ce prix-là il me serait très-facile d’être heureux ; mais cette joie ne m’amuserait guère. J’ai une centaine de mille livres qui, bien placées sur première hypothèque, me rapporteraient quatre à cinq mille francs de rente. Fi donc ! je veux faire fortune au galop.
— Bravo ! s’écria l’un des fumeurs. Tu as une pose d’ange déchu qui ferait envie à M. Bocage.
— Arrière votre bonheur ! il sent l’épicerie. Je jouerai ma fortune sur un coup de dé.
Un grand personnage silencieux, à l’œil noir et au teint bronzé, que l’un des convives avait conduit au festin, quitta la place où il fumait philosophiquement une chibouque, et s’approchant du discoureur lui toucha légèrement l’épaule :
— J’ai votre affaire, lui dit-il tout bas. Voulez-vous me confier vos cent mille francs ? Dans un an vous aurez un million, ou vous n’aurez rien.
Léopold de Brus, c’était le nom de notre jeune ambitieux, suivit l’étranger dans un coin du salon ; et tous les deux, assis sur un divan, causèrent un quart d’heure avec animation. Au bout de ce temps l’étranger serra la main de Léopold et sortit.
Léopold chercha du regard dans le salon, et voyant seul, au coin du feu, un jeune homme dont le front commençait à se dépouiller, il alla se placer à son côté.
— Vous êtes, mon cher Étienne, lui dit-il, un garçon aisé ; donnez-moi un bon conseil.
— Volontiers ; cela se donne toujours, et ne s’accepte jamais.
— L’individu avec qui vous m’avez vu causer est un fameux navigateur ; c’est une espèce de capitaine Ross ; s’il y avait un passage du nord-ouest, il l’aurait découvert. Or le Vasco de Gama français a conçu un projet auquel il m’a offert de m’associer.
— Pour rien ?
— Pour cent mille francs dont il a besoin.
— Voyons le projet.
Léopold se pencha et parla tout bas à l’oreille d’Étienne.
Étienne fronça le sourcil.
— C’est illégal, dit-il.
Léopold haussa les épaules.
— Et c’est dangereux, reprit-il.
— Qui ne risque rien n’a rien ! répondit Léopold.
— J’en étais sûr ! Vous m’avez demandé un conseil ; donc vous étiez décidé. Permettez-moi seulement une question.
— Faites.
— Avez-vous lu Don Quichotte ?
— Oui, sans doute.
— Alors souvenez-vous d’un proverbe qui, s’il n’y est pas, devrait y être : Qui veut être riche en un an, au bout de six mois est pendu.
— Bah ! on a supprimé le gibet ! s’écria Léopold en riant.
À quelque temps de là, un touriste qui parcourait les provinces basques rencontra sur le quai de Santander Léopold de Brus en habit de matelot.
— Eh ! mon cher ! s’écria le Parisien, que faites-vous dans cet équipage ?
— Je vais m’embarquer. Voyez-vous ce beau brick dont la vague caresse amoureusement les flancs noirs, il va m’emporter avec lui vers les côtes de la Sénégambie et du Congo ; peut-être même pousserai-je jusqu’au royaume de Zanguebar.
— Les lauriers du capitaine Marryal vous empêchaient donc de dormir ?
— Point ; mais j’ai fort envie de faire le commerce de la poudre d’or et des dents d’éléphants ; on le dit très-lucratif. Adieu ; on vient de tirer le canon, c’est le signal du départ, et la Marquesa d’Amaëgui n’attend plus que moi pour lever l’ancre.
Léopold s’élança dans un canot que dirigeait un marin de haute taille, gagna le brick, et une heure après la Marquesa d’Amaëgui disparaissait à l’horizon.
— C’est étrange, disait le touriste en regardant la blanche voilure du navire fuir comme l’aile d’un oiseau, il me semble avoir vu le capitaine du canot au dernier dîner où se trouvait Léopold, à Paris !
Sept à huit mois après, les journaux français contenaient, sous la rubrique de Londres, la traduction d’une nouvelle extraite du Times :
La corvette de S. M. Britannique le Basilic, est entrée hier dans notre port ; le lieutenant Thompson de la marine royale, qui la commande, vient d’adresser à l’amirauté un rapport fort intéressant. Il résulte de ce document que la corvette, naviguant au sud des îles du Cap Vert, reconnut un brick qui faisait route à l’ouest. Le brick, loin de répondre aux signaux de la corvette, changea de route et mit le cap au nord. Le lieutenant Thompson donna l’ordre d’appuyer le pavillon anglais d’un coup de canon et de poursuivre à toute voile le navire suspect qui cherchait à l’éviter ; la chasse dura quatre à cinq heures. Le brick était bon voilier ; mais le Basilic, étant d’une marche supérieure, atteignit enfin le fugitif et le menaça de le couler s’il n’amenait pas. Le brick, virant de bord, hissa pavillon espagnol et ouvrit le feu. Le combat fut vif, et durant une demi-heure il eût été impossible de prévoir, au milieu des nuages de fumées qui flottaient sur l’eau, auquel des deux navires resterait la victoire ; mais une bordée du Basilic ayant abattu le grand mât du brick, force fut à celui-ci de se rendre. On reconnut alors qu’on avait eu affaire à la Marquesa d’Amdëgui, du port de Santander ; trois cent quatre-vingt-dix nègres étaient à fond de cale ; le pont était couvert de morts et de mourants. Parmi les premiers on a relevé le cadavre d’un Français qui avait eu la tête brisée par un biscayen. On a trouvé dans sa ceinture un portefeuille sur lequel on lisait le nom de Léopold de Brus…
Le journal tomba des mains d’Étienne qui le lisait.
— Pauvre Léopold ! s’écria-t-il. Je le lui avais bien prédit ; quand on veut faire fortune en un an, au bout de six mois on est pendu !
— Où diable voyez-vous qu’il ait été pendu, mauvais prophète ? reprit l’un des auditeurs.
— C’est vrai ; il n’a pas été pendu, mais il a été tué.


À MARMITE QUI BOUT
MOUCHE NE S’ATTAQUE

 es états les plus florissants, les peuples les plus heureux sont encore exposés à tous les inconvénients des troubles civils ; le royaume d’Yvetot nous en offre un mémorable exemple. C’est vers l’année 1700 que se passèrent les événements que nous allons raconter. Cette date ne se trouve dans aucune chronologie ; mais nous ne la croyons pas moins exacte pour cela.
es états les plus florissants, les peuples les plus heureux sont encore exposés à tous les inconvénients des troubles civils ; le royaume d’Yvetot nous en offre un mémorable exemple. C’est vers l’année 1700 que se passèrent les événements que nous allons raconter. Cette date ne se trouve dans aucune chronologie ; mais nous ne la croyons pas moins exacte pour cela.
Les petites causes ont toujours engendré de grands effets. Si Hélène n’avait pas eu les cheveux rouges, couleur de prédilection du beau Paris, Troie n’aurait pas été saccagée ; si une pomme n’était pas tombée sur le nez de Newton pendant qu’il méditait sous un pommier, ce grand philosophe n’eût point résolu un des plus brillants problèmes de l’intelligence humaine. Nous pourrions poursuivre ces citations ; mais nous aimons mieux nous arrêter dans l’intérêt du lecteur qui doit brûler de connaître les événements qui se passèrent dans le royaume d’Yvetot et mirent la nation à deux doigts de sa perte.
La cause de tous les maux qui désolèrent pendant plus de quinze jours cette paisible contrée, fut une simple exclamation.
Un soir, maître Remy, un des plus riches fabricants de cidre d’Yvetot, vidait tranquillement, assis devant sa porte, quelques pots avec ses amis. Maître Remy était un fin connaisseur, un gourmet célèbre dont les opinions en matière de cidre faisaient loi à trois lieues à la ronde. Comme il déposait son verre sur la table en faisant claquer sa langue contre son palais d’un air de satisfaction joyeuse, maître Remy s’écria :
— Par Notre Dame ! on voit bien que c’est du cidre d’Ingeville, le meilleur de tous !
En ce moment passait maître Jean, un des fermiers les plus opulents de Montreville, village qui de tout temps a disputé la pomme du cidre à son voisin Ingeville.
Maître Jean n’entendit pas sans un certain sentiment d’amertume l’exclamation de maître Remy ; il était très chatouilleux sur le point d’honneur, et il ne pouvait souffrir qu’on portât la moindre atteinte à la réputation de son village ; d’ailleurs, il vit dans ce propos une flèche lancée à son adresse, et il n’en fut que plus irrité.

Maître Jean, le cœur ulcéré, s’arrêta devant la porte du Pot Éternel, la principale auberge d’Yvetot. Plusieurs personnes réunies autour d’une vaste table se livraient au plaisir de boire, qui est l’occupation la plus importante des habitants de cet heureux pays. Dès que maître Jean parut, on s’empressa de lui faire place, mais lui refusa de s’asseoir.
— Qu’avez-vous donc, maître Jean, vous si gai d’ordinaire, que vous refusiez de boire un verre de cidre avec nous ?
— Je n’ai pas soif, répondit maître Jean avec l’air du père de Rodrigue après le soufflet de don Gomès.
— Vous ne refuserez pas du moins de casser un morceau de cette excellente galette, préparée par la main inimitable de notre belle hôtesse.
— Je n’ai pas faim.
Maître Jean n’a ni soif ni faim, se dirent tous les spectateurs consternés ; il doit s’être passé quelque chose de bien extraordinaire. Voyons.
— Maître Jean, dirent-ils tous à la fois, quel grand malheur vous est donc arrivé ?
— La gelée a-t-elle brûlé les fleurs de vos pommiers ?
— Votre femme est-elle malade ?
— Quelque méchante fée a-t-elle fait tourner votre cidre de l’année dernière ?
Maître Jean, pour toute réponse, enfonça son large chapeau de feutre sur sa tête grise, et leur dit :
— Vous êtes tous des lâches.
— Comment ! des lâches ? s’écrient les buveurs.
— Que buvez-vous maintenant ? reprit maître Jean.
— Du cidre de Montreville, nous n’en voulons jamais d’autre.
— Eh bien ! pendant que vous êtes là à vous goberger avec ce nectar, on vous insulte, on vous outrage dans la réputation de votre boisson favorite. Maître Remy et ses amis soutiennent que le cidre d’Ingeville est le meilleur de tous. Souffrirez-vous un pareil affront ?
Les buveurs, déjà échauffés par des libations copieuses et entraînés par l’éloquence de maître Jean, répondirent qu’ils n’étaient pas d’humeur à tolérer de telles insolences, et qu’ils feraient bien voir à maître Remy et à ses amis que le cidre d’Ingeville n’était que de la petite bière à côté de celui de Montreville. Ils soutinrent en même temps qu’il fallait, tout de suite, se porter vers la demeure du blasphémateur et lui faire rétracter ses paroles. Maître Jean se mit à la tête de la bande.
Maître Remy sacrifiait au Bacchus d’Ingeville sans se douter de l’orage qui allait fondre sur sa tête, lorsque les partisans de Montreville se présentèrent devant lui, et le sommèrent de déclarer qu’il renonçait à l’hérésie qu’il avait soutenue.
Maître Remy refusa comme de raison ; ses amis l’imitèrent. La dispute s’envenima ; on en vint aux gros mots, puis aux menaces, puis aux coups. Maître Jean eut le nez en sang, et maître Remy laissa deux dents sur le terrain. La force armée essaya en vain de rétablir l’ordre. La ville tout entière prit part à la dispute, Yvetot fut partagé en deux camps ou plutôt en deux bouteilles : les uns tinrent pour Ingeville, les autres pour Montreville. Le ioyaume d’Yvetot fut en proie à toutes les horreurs de la guerre civile ; il ne lui manqua plus qu’un grand homme pour écrire l’histoire des factions qui le déchiraient.
Le roi, qui était alors Eustache troisième du nom, voulut mettre un terme à ces dissensions ; il ceignit le bonnet de coton royal, convoqua les états-généraux, et déclara dans un édit que ni le cidre d’Ingeville, ni le cidre de Montreville ne méritaient la prééminence, qu’elle appartenait au cidre de Ronenville, et que tout le monde eût à se conformer, dans ses paroles, dans ses actes et dans sa boisson, à la teneur de cet édit.
Il se forma alors en Yvetot un troisième parti, dit des politiques ; ceux-là tenaient pour le cidre en général et pour aucun cidre en particulier. Le roi, fort de l’appui de ce parti, crut avoir pour jamais assuré la tranquillité publique, et s’endormit comme un empereur qui n’a pas perdu sa journée.
Le roi Eustache iii, auquel les mémoires contemporains accordent un sens politique assez étendu, se trompa cependant dans cette circonstance. En croyant satisfaire les partis, il les indisposa tous. Comme il arrive toujours en pareil cas, les factions oublièrent l’objet de leurs disputes, elles se réunirent pour demander la révocation de l’édit de Ronenville. Les Ingevillistes et les Montrevillistes entourèrent en armes le Louvre d’Yvetot. Eustache iii fut chassé et déclaré incapable de régner, lui et ses descendants.
Le roi d’Yvetot se retira avec sa servante d’honneur, qui seule lui était restée fidèle, chez un seigneur du voisinage, le duc de Rochefort, qui lui promit d’armer ses valets et ses piqueurs pour le rétablir sur le trône de ses ancêtres.
Yvetot, privé de roi, chercha tout de suite les moyens de se gouverner. Les uns proposèrent d’établir une république sur le modèle de celle de Rome, avec deux consuls qui seraient maître Jean et maître Remy.
Les autres offrirent d’organiser le gouvernement d’après les lois de Salente, dont M. de Fénélon venait de tracer un modèle séduisant.
Les politiques voulaient qu’on maintînt la monarchie, mais en établissant un juste équilibre entre les pouvoirs, au moyen de deux chambres, l’une héréditaire, l’autre élective.
Pendant ce temps-là, le bruit des préparatifs faits par le duc de Rochefort était venu jusqu’à Yvetot. Les trois partis jurèrent de mourir en combattant l’ennemi commun. On réunit de grandes quantités d’armes et de munitions ; chaque jour, les recrues s’exerçaient sur la place publique. Tous les cidres étaient devenus égaux devant la loi. Les femmes brodaient des écharpes pour les remettre aux vainqueurs ; des orateurs enflammaient l’imagination du peuple en lui retraçant les grandes images de patrie et de liberté. Yvetot offrait un spectacle sublime ; c’était une république de la Grèce qui ressuscitait en Basse-Normandie.
Le duc de Rochefort, grâce à son or, entretenait des intelligences dans la ville : il y a des âmes vénales partout, même à Yvetot. Ces espions représentaient au duc l’état de la ville, divisée par les partisans des trois systèmes de gouvernement ; ils lui peignaient l’anarchie des idées et des hommes ; ils l’engageaient à profiter de cet état de crise qui augmentait la faiblesse des rebelles. Les espions agirent tellement sur le duc qu’il crut le moment favorable pour opérer une restauration.
Ce n’était point l’avis d’Eustache iii ; il avait trop d’expérience pour ne pas savoir que la colère rend redoutable l’homme le plus timide, et l’exemple récent de l’Angleterre lui montrait qu’un peuple n’est jamais plus à craindre que lorsqu’il est en révolution, parce que les révolutions font toujours surgir des hommes de génie. Pourquoi Yvetot n’aurait-il pas aussi son Cromwell ?
Le duc de Rochefort ne goûta que médiocrement ces raisons, il les fit rejeter par son conseil. L’armée, composée de vingt-quatre hommes, reçut ordre de se mettre en marche. Le duc partit pour en prendre le commandement ; il montrait sur sa route les chaînes dont il comptait charger maître Remy et maître Jean, les deux fauteurs de la rébellion.
On sait assez ce qui advint de cette formidable expédition. L’armée de Rochefort fut battue à plate couture ; lui-même, nouveau Xerxès, ne dut son salut qu’à la fuite.
Eustache iii apprit cette nouvelle en roi, et en subit les conséquences en philosophe. — Je n’attends plus rien des hommes, dit-il, mais tout de la Providence, qui choisit pour auxiliaire le temps.
Le roi d’Yvetot ne se trompait pas. Les partis ne purent parvenir à s’entendre dans son ancien royaume ; chaque jour on regrettait davantage la prospérité passée. Les politiques firent des ouvertures au roi, qui refusa d’accorder l’équilibre entre les pouvoirs, ne voulant pas, disait-il, changer l’antique constitution de l’État ; ce refus rompit les négociations entamées. La situation désespérée des affaires força les politiques à les renouer. Ils renoncèrent au gouvernement constitutionnel, qui devait succéder un siècle et demi plus tard à la monarchie pure et simple, telle qu’on la comprenait en France et en Yvetot. Eustache III, appelé par les uns, toléré par les autres, secrètement désiré par tous, reprit la couronne de ses pères. Le jour de son intronisation, il but de tous les cidres de son royaume, donnant en cela un mémorable exemple de tolérance et d’oubli. Avant de mourir, il fit appeler le dauphin : — Mon fils, lui dit-il, en politique, comme dans la vie ordinaire, l’homme sage est celui qui, lorsqu’il a affaire à un homme en colère ou à un peuple révolté, laisse passer le premier moment ; tout mon système est renfermé dans ces mots :


MOINEAU EN MAIN
VAUT MIEUX QUE PIGEON QUI VOLE

 l y a quinze ans environ, deux jeunes amis, Paul B. et Léon D prenaient congé l’un de l’autre sur la rive gauche de la Seine, en jurant, connue il arrive toujours lorsqu’on se sépare, de se revoir aussi souvent que possible. L’un d’eux, Léon, s’écriait en étendant la main avec un geste prophétique vers la rive droite de la Seine : — C’est là que ma vocation m’appelle ; là seulement je puis espérer de réaliser mes plans. À moi le monde, la gloire, l’éclat, tous les triomphes et les prestiges de la renommée !
l y a quinze ans environ, deux jeunes amis, Paul B. et Léon D prenaient congé l’un de l’autre sur la rive gauche de la Seine, en jurant, connue il arrive toujours lorsqu’on se sépare, de se revoir aussi souvent que possible. L’un d’eux, Léon, s’écriait en étendant la main avec un geste prophétique vers la rive droite de la Seine : — C’est là que ma vocation m’appelle ; là seulement je puis espérer de réaliser mes plans. À moi le monde, la gloire, l’éclat, tous les triomphes et les prestiges de la renommée !
Celui qui parlait ainsi était poète ; l’exaltation de ses gestes et de son langage l’indiquait assez.
L’autre, Paul, était poète aussi, mais d’un genre plus calme et plus modeste.
— Tu pars, disait-il à son ami d’une voix attendrie, tu quittes le quartier de nos études et de nos rêves ; puisses-tu ne le regretter jamais ! puisses-tu, dans la vie nouvelle où tu vas entrer, ne pas te reporter avec tristesse vers le temps où nous récitions ensemble des élégies, des sonnets et des ballades aux rossignols du Luxembourg !
— Pauvre esprit que tu es ! répondait l’autre, ne vois-tu pas que le pays où je vais entrer est celui de la fortune et de la célébrité : végète et rampe, si telle est ta volonté ; mais du moins n’empêche pas les aiglons de prendre leur essor.
L’aiglon qui parlait de la sorte franchit le Pont-des-Arts triomphalement, et laissa son ami regagner tristement le quartier Saint-Jacques qu’il habitait. Paul se trouvait ainsi logé dans le voisinage des institutions, où il exerçait les fonctions de répétiteur et employait ses loisirs à composer des vers et des travaux d’érudition, mêlant par une sage division de son temps l’utile du professorat au dulci des belles-lettres et des muses.
Paul resta près d’une année sans avoir de nouvelles de

Léon, qui était allé, suivant l’usage des étudiants émancipés, se loger sur les cimes de la Chaussée-d’Antin, le Mont-Parnasse des représentants des arts et de la littérature moderne.
Un jour, en jetant par hasard les yeux sur un journal de théâtre, Paul aperçut le nom de son ami Léon encadré avec le titre d’un drame nouveau dans une magnifique réclame qui promettait au jeune auteur la plus brillante réussite. Paul ne put retenir ses larmes en lisant cet article :
— Il est heureux, dit-il, et il m’a oublié ! Ne lui ai-je pas répété sans cesse que ses succès me seraient toujours plus chers que les miens ?
Cependant, la veille de la représentation du drame de son ami, Paul trouva chez lui deux stalles avec une lettre de Léon, qui s’excusait en quelques lignes d’avoir été si longtemps sans lui donner de ses nouvelles ; mais les travaux qui l’accablaient, les soins, les fatigues inséparables d’un drame nouveau, avaient absorbé tous ses instants ; enfin, il le reverrait le lendemain au foyer du théâtre, après la représentation.
Dans ce temps-là, tous les drames réussissaient, pourvu qu’ils eussent la couleur moyen-âge. La pièce de Léon se passait en plein quatorzième siècle, elle alla aux nues. Paul, tout classique qu’il était, avait applaudi les vers de son ami avec le fanatisme et l’exaltation d’un romantique. Ivre de bonheur, il se rendit au foyer après la représentation et trouva Léon entouré de toutes sortes de barbes et de chevelures qui voulaient le porter en triomphe et l’appelaient Goëthe, Shakspeare, Corneille et Calderon.
— Tu soupes avec nous, dit le dramaturge au citoyen de la rive gauche.
Léon avait résolu de réunir tous ses amis à table. Le rendez-vous était à minuit ; à huit heures du matin on entendait encore le bruit des toasts et les détonations du vin de Champagne. Le souper coûta douze cents francs. Léon traita ainsi huit jours de suite tous ses admirateurs.
Paul le rencontra six mois après son succès ; trois autres drames avaient pendant ce temps accaparé successivement l’enthousiasme du public.
— Combien t’a rapporté ta pièce ? dit Paul à son ami.
— Environ quinze mille francs.
— Il se pourrait ? Alors te voilà en fonds pour deux ou trois années au moins.
— Du tout ; avant ma pièce, je devais vingt-cinq mille francs, et j’en dois trente maintenant. Mais n’importe, j’ai deux autres drames en répétition ; puis j’ai plusieurs romans sous presse, des mémoires, des voyages… Et toi, mon pauvre Paul, toujours fidèle au quartier latin, que fais-tu maintenant ? où vas-tu de ce pas ?
— Je me rends dans la rue des Postes, où je dois donner une répétition de grec, et je passerai ensuite au Journal des Savants, où j’espère publier un article… J’ai sous presse plusieurs traductions, deux histoires à l’usage des classes, un programme pour les bacheliers…
— Et combien as-tu gagné avec ta plume depuis notre séparation ?
— Dix mille francs environ.
— Dix mille francs ! s’écria Léon en éclatant de rire.
Pauvre ami ! À peine le quart de ce que je gagne dans une année. À présent que me voilà tout à fait lancé, je puis avec le produit de mes pièces, de mes livres et de mes articles, me considérer comme ayant un revenu de quarante mille francs… À propos, as-tu cinq francs sur toi ? j’ai oublié ma bourse, et il faut absolument que je monte en voiture pour me trouver à la répétition.
Paul, heureux de rendre un si léger service à son poétique et brillant ami, s’empressa de lui remettre ce qu’il lui demandait. Leur conversation avait lieu devant le jardin des Tuileries ; Léon s’élança dans un cabriolet et lui cria : — Sois tranquille, je te lancerai, je ferai ta fortune malgré toi… Ah ! j’oubliais de te dire, je prends voiture le mois prochain ; tu verras mes chevaux, mon attelage est magnifique… À bientôt !
Paul regagna son quartier, le cœur moins serré que lorsque Léon avait pris congé de lui pour la première fois et mis la Seine entre leur affection. Il était d’ailleurs sur le point de conclure un mariage avec une jeune fille qu’il aimait depuis longtemps, et qui, sans être riche, devait cependant lui apporter une petite dot plus que suffisante pour faire face aux dépenses d’un jeune ménage habitué d’avance à vivre d’érudition et d’amour.
Léon adressa à Paul des reproches mêlés de railleries lorsqu’il apprit qu’il était déterminé à se marier : — T’enchaîner de la sorte, lui dit-il, toi qui pouvais aller si haut avec un peu plus de force et de confiance en toi-même ! J’aurais pu, si tu avais voulu, te faire conclure un mariage des plus brillants.
En dépit des observations de son ami, Paul se maria, et Léon continua à voyager dans les hautes régions de l’existence littéraire. Il avait pris voiture comme il l’avait annoncé, et habitait un appartement somptueux, réunissant autour de lui toutes les apparences de la richesse et du luxe.
Mais si le proverbe Ne vous fiez pas aux apparences a mérité de s’appliquer à quelqu’un, assurément c’était bien à lui. Le riche mobilier, la livrée, les chevaux de Léon, recouvraient un gouffre sans fond de papier timbré, de protêts, de saisies et de contraintes, que l’homme le plus intrépide n’eût pu entrevoir sans trembler. Chaque matin, la sonnette du poète, ébranlée par une suite de créanciers, formait une symphonie peu mélodieuse qui se prolongeait souvent jusqu’à l’heure du dîner.
Pendant un certain temps, son imagination infatigable fit face à tous. Les pièces qui se succédaient, les volumes qui s’accumulaient, lui permettaient d’amoindrir les dettes les plus menaçantes. Mais bientôt il fut, comme on dit, débordé de toutes parts. Tous ses manuscrits étaient saisis à l’avance, ses plans de pièces, ses ébauches de volumes, ses moindres velléités poétiques devenaient la proie des recors.
Alors, il n’y tint plus, sa tête se troubla, et un jour qu’il lui avait fallu donner audience à tous ses créanciers qu’il avait essayé d’amadouer avec plusieurs volumes inoctavo de promesses, d’excuses et de protestations, il s’avoua vaincu, et sortant précipitamment de son brillant intérieur qui était devenu pour lui un véritable enfer, il résolut de n’y plus rentrer.
Il se dirigea machinalement vers ce docte quartier Saint-Jacques qu’il avait dédaigné et dont la vue lui causa une impression de calme et de bonheur après tant d’émotions dramatiques et financières.
Au bout d’une heure de marche, il se trouva dans la rue de l’Ouest, devant une maison de modeste apparence, mais blanche, coquette, annonçant le bien-être. En ouvrant la porte d’entrée, il aperçut un jardin émaillé de roses ; les oiseaux chantaient autour des fenêtres, et les tilleuls du Luxembourg parfumaient le portique.
Cette maison était celle de Paul. Léon n’avait pas même vu l’habitation de son ami depuis qu’il avait traversé la Seine. Paul, sans lui faire un seul reproche, sans lui demander aucune explication, le promena dans tous les coins de sa maison, lui fit admirer le jardin, les fleurs, le salon, et le conduisit enfin dans un pavillon couvert de mousse, élégamment tapissé, et où l’on avait réuni tout ce qui peut faire le charme de l’intérieur : livres, tableaux, albums, vases chinois, précieuses futilités qui font partie du nécessaire pour les femmes et pour les poètes.
— Quelle ravissante habitation ! s’écriait Léon en examinant chaque détail. Que de goût et d’élégance ! Pour qui donc as-tu fait meubler cette adorable cellule ?…
— Pour toi, mon cher Léon, reprit Paul en lui serrant la main ; je savais bien, en voyant ton nouveau train de vie, que tu nous reviendrais tôt ou tard. Je t’ai fait préparer cette retraite ; tu y resteras deux ans, trois ans s’il le faut, occupé à travailler pour satisfaire tes créanciers que je me charge moi de recevoir ; tu n’auras plus à redouter ici les importunités, les poursuites, tu vivras avec nous. Mais permets-moi seulement, à moi qui n’ai jamais été que le plus humble des passereaux, de rappeler au plus poétique et au plus inconstant des ramiers, que :


IL NE FAUT PAS BADINER
AVEC LE FEU

 lle était devant sa toilette ; l’heure du bal masqué approchait ; la mantille, les gazes, les rubans, étaient encore répandus sur les fauteuils, et n’attendaient qu’un ordre de la magicienne pour se rassembler et composer un costume à faire tourner toutes les têtes. — C’était un samedi gras.
lle était devant sa toilette ; l’heure du bal masqué approchait ; la mantille, les gazes, les rubans, étaient encore répandus sur les fauteuils, et n’attendaient qu’un ordre de la magicienne pour se rassembler et composer un costume à faire tourner toutes les têtes. — C’était un samedi gras.
Elle sonna.
— Rosalie !
— Madame ?
— Mon mari est-il prêt ?
— Madame, M. le comte n’est pas encore rentré du club.
Elle haussa les épaules ; puis, après avoir dénoué ses cheveux qui tombèrent sur son cou en formant une magnifique cascade, elle reprit :
— Faites entrer le coiffeur.
— Madame, il n’est pas encore arrivé.
— Comment ? pas arrivé ! Le sot ! Le…
On sonna à la porte d’entrée.
— Ah ! c’est lui, sans doute.
Rosalie rentra.
— Eh bien ! est-ce enfin ce maudit coiffeur ?
— Non, Madame, c’est-à-dire si, Madame… C’est bien lui, ou plutôt ce n’est pas lui. M. Leblond fait dire à Madame qu’il ne pourra venir la coiffer ce soir, parce qu’il s’est foulé le poignet en tombant de son cabriolet. Mais il lui envoie à sa place son garçon.
— Un garçon pour me coiffer ! Mais c’est une indignité, une trahison. Ce bal sera, dit-on, magnifique, et je n’ai jamais eu plus d’envie d’être jolie… Neuf heures et demie passées !
Dans sa fureur, elle prit un mouchoir brodé qu’elle déchira à belles dents, et en jeta les lambeaux dans la cheminée ; cette action, fort simple en elle-même, apaisa un peu ses nerfs. Elle déboucha deux ou trois flacons, respira les bouchons, et se tournant vers la femme de chambre :
— Faites entrer ce garçon.
Quand il fut introduit :

— De province, Madame.
— Et vous venez pour me coiffer ?
— J’ai du moins cette ambition, Madame.
— C’est en effet une très-grande ambition, ajouta-t-elle sans pouvoir réprimer un imperceptible sourire que lui causa l’expression emphatique du coiffeur ; votre nom, je vous prie ?
— Mon nom de famille, Madame, était beaucoup trop vulgaire pour que je pusse le conserver ; j’ai pris celui de Télémaque Saint-Preux ; c’est sous ce nom-là que je suis connu dans la coiffure.
— Eh bien ! voyons, monsieur… Télémaque Saint-Preux, coiffez-moi, reprit-elle en affectant un très-grand sérieux.
Il commença à prendre les nattes qui tombaient sur ses épaules ; mais à peine eut-il essayé de les diviser qu’elle poussa un cri :
— Ah ! malheureux ! vous allez m’arracher la tête ! Me tirer les cheveux de la sorte ! Peut-on se mêler de coiffer, quand on est aussi maladroit que vous l’êtes !
Il resta stupéfait ; elle jeta les yeux sur lui. Il y avait une grande distinction dans sa figure. Elle se repentit de sa vivacité.
— Le mieux, se dit-elle, est de prendre mon mal en patience.
Elle se plaça devant sa toilette d’un air tout à fait résigné :
— Je vais essayer, reprit-elle, de me coiffer moi-même, vous n’aurez qu’à me tenir les fleurs et les épingles.
Elle commença à natter ses cheveux, et dit en se retournant à demi vers le garçon coiffeur :
— Savez-vous bien, monsieur Saint-Preux, que vous ne paraissez pas fort habile dans votre état ?
— Hélas ! Madame ; ce n’est peut-être pas absolument ma faute.
— Comment cela ?
— J’ai toujours eu en moi un obstacle qui a nui à mes progrès.
— Et quel est cet obstacle ?
— Madame, c’est le sentiment.
— Le sentiment ! s’écria-t-elle en éclatant de rire ; qu’entendez-vous par là ?
— J’entends, Madame, une émotion dont je ne suis pas le maître, lorsque j’aurais besoin de toute ma présence d’esprit ; car vous n’ignorez pas tout ce qu’il faut de sang-froid, quand on tient le fer à papillotes, pour ne pas brûler la personne que l’on coiffe, et souvent pour ne pas se brûler soi-même… Eh bien ! moi, Madame, alors ma main tremble, mon cœur bat, et il m’arrive ce qui m’est arrivé tout à l’heure avec vous ; on se fâche contre moi, et l’on me rend ainsi encore plus gauche que je ne le suis réellement. Cependant, je sens que si j’avais le bonheur d’être compris…
— Vous êtes donc incompris ? ajouta-t-elle toujours avec le même sérieux. Elle était décidée à s’amuser quelques instants du plaisant original que le hasard lui avait amené. D’ailleurs, n’était-ce pas le carnaval ?
— Riez tant qu’il vous plaira, Madame, de ma folie ; mais est-ce ma faute si mon cœur n’est pas ce que ma condition voudrait qu’il fût ? Puis-je m’empêcher d’éprouver des accès de tristesse quand je me trouve introduit, comme je le suis maintenant, dans un boudoir, et quand je me dis que rien de ce que je sens, de ce que j’aperçois ne m’appartient, que toutes mes impressions sont, pour ainsi dire, des vols ? En effet, quand même je sacrifierais ma vie, je n’aurais pas le droit de révéler rien de ce que renferme mon âme. Et tenez, Madame, tout à l’heure en vous regardant, en pensant à tout cela, il m’est venu dans l’esprit quelques vers qui exprimeraient peut-être mieux que tout ce que je pourrais vous dire ce qui se passe en moi.
— Comment ! monsieur Saint-Preux, vous faites des vers ?
— Oui, Madame, quelquefois je cherche des rimes, j’improvise, et c’est encore ce qui peut vous expliquer le peu de progrès que j’ai faits dans la coiffure.
— Voyons vos vers, récitez-les-moi ; je tiens beaucoup à connaître les idées que j’ai pu inspirer.
Il baissa la tête, parut se recueillir, et commença d’une voix expressive et tremblante :
|
Pendant qu’il récitait ces strophes, la figure de la comtesse avait changé d’expression ; de railleuse elle était devenue tout à coup pensive ; elle garda le silence quelques instants, puis se fit répéter la dernière stance : — Oh ! oui, certainement, reprit-elle d’un ton de douceur, vous rêviez. Pouvez-vous vous mettre de pareilles chimères dans l’esprit ? Vous êtes jeune, vous paraissez intelligent, vos vers annoncent de la sensibilité ; il faut vous défaire de ces idées extravagantes qui ne feront que troubler votre raison. — Qu’entends-je, Madame ? Quoi ! vous daigneriez me conseiller, me donner des avertissements, quand tout à l’heure vous ne songiez qu’à vous moquer de moi ! D’où vient ce changement ? Aurais-je eu le bonheur de vous toucher ! — De me… — De vous plaire, Madame ! Je veux mettre le comble à mon extravagance en vous faisant ma confession tout entière ; mais s’il était vrai qu’un pareil aveu pût ne pas exciter votre colère… — Qu’entendez-vous par là ? dit-elle en fronçant le sourcil et en jetant sur lui un regard où se peignaient à la fois la défiance et le dédain. Mais elle sentit aussitôt combien il serait ridicule, dans une pareille situation, de témoigner le moindre ressentiment. — Non, je ne vous en veux pas, ajouta-t-elle d’un ton sardonique ; au contraire, monsieur Télémaque Saint-Preux, vous me plaisez infiniment ; car je n’ai jamais vu de coiffeur plus divertissant que vous. — Qu’entends-je, Madame ! Est-ce ainsi que vous recevez l’aveu de mes sentiments les plus tendres ! Cependant, vous ne le nierez pas, j’ai eu le secret de vous émouvoir ; votre son de voix, votre maintien, tout annonçait… — Comment n’avez-vous pas vu que je me moquais de vous ? — Il se pourrait ! Et moi, qui croyais… que du moins… un peu de pitié… Adieu, Madame, adieu, je ne survivrai pas à une pareille déception ; dans un instant, je n’existerai plus. Sa figure était à la fois si belle et si désespérée lorsqu’il prononça ces derniers mots, que l’âme la plus froide n’eût pu s’empêcher de s’intéresser à lui. Il s’élança hors de la chambre, et par un mouvement dont elle ne fut pas la maîtresse, la comtesse lui cria : — Arrêtez, malheureux ! Revenez, je vous l’ordonne. Je veux vous calmer, vous avouer que… Mais il était déjà hors du salon, et bien qu’il eût certainement entendu sa voix, il ne voulut pas se retourner. Elle rentra dans sa chambre et se laissa tomber dans un fauteuil. Elle agita la sonnette, Rosalie parut : — Courez après ce garçon qui vient de sortir, dites-lui qu’il remonte sur-le-champ, que j’ai un ordre à lui donner. Rosalie sortit aussitôt, et lorsqu’elle reparut : — Madame, le coiffeur était déjà dans la rue, il s’est élancé dans un cabriolet qui l’attendait, il a fouetté le cheval sans vouloir me répondre. La comtesse fit un geste d’impatience et ordonna à Rosalie de se retirer ; elle voulait être seule pour songer à ce qui venait de se passer. La porte de la chambre se rouvrit au même instant, le comte parut : — Êtes-vous prête, ma chère ? dit-il à sa femme, sans remarquer son agitation. D’abord, que je vous fasse mon compliment sur votre coiffure, elle est ravissante ; Leblond s’est surpassé aujourd’hui. Elle ne répondit rien, et sortit avec lui. Au bal elle fut distraite, préoccupée ; longtemps même elle refusa de danser : tous les hommes qui se présentaient lui semblaient maussades, ridicules, sans grâce et sans physionomie. Elle n’osait s’avouer à elle-même à qui elle pensait. Enfin, vers deux heures, quelqu’un vint se placer devant elle pour l’engager à danser. — Madame la comtesse voudra-t-elle bien accepter pour cavalier l’infortuné Télémaque Saint-Preux ? Elle tressaillit et faillit laisser échapper un cri ; elle avait reconnu le garçon coiffeur, qui n’avait rien changé à son costume. — De grâce, Madame, dit-il ne grondez pas trop ce pauvre Leblond. Je lui ai promis vingt-cinq louis, s’il voulait me laisser prendre sa place auprès de vous ; nous sommes en carnaval, me pardonnerez-vous ?… — Oui, Monsieur, dit-elle d’un ton glacé, à condition que vous ne m’adresserez la parole de votre vie, si vous ne voulez que j’instruise mon mari de tout. — Que dites-vous, Madame ? Mais songez-vous que si je ne dois plus vous parler, j’en mourrai ? — Vous ne mourrez pas, Monsieur ; mais s’il est vrai que vous éprouviez quelques regrets, vous vous souviendrez que, même en carnaval,
Il ne faut pas badiner avec le feu.
  C’EST QUAND L’ENFANT EST BAPTISÉ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le théâtre de San-Carlino, essentiellement satirique, a autant besoin de pièces nouvelles qu’un petit journal français a besoin de nouveaux articles. Or, ce qui causait le désespoir du pauvre directeur Geronimo Passavanti était précisément le manque absolu de pièces.
Il était brouillé, par des raisons que l’histoire ne nous dit pas, avec tous les auteurs qui alimentaient ordinairement son théâtre. La société des auteurs dramatiques n’était cependant pas encore inventée de ce temps-là à Paris, et encore moins à Naples, ce qui prouve bien que les intrigues, les brouilles, les discordes et les coalitions, sont plus vieilles que toutes les sociétés du monde.
De désespoir l’infortuné directeur s’arrachait donc les cheveux ; il en était déjà à sa troisième poignée, quand sa femme, la vénérable Barbara, lui dit :
— D’où vient votre peine, cher époux ? Ces maudits barbouilleurs de papier ont formé un complot contre vous ; eh bien ! ne sauriez-vous vous passer d’eux ? Ce matin, en rangeant mes coiffes, j’ai trouvé dans le fond d’un tiroir ce rouleau de papier, qui m’a tout l’air d’une pièce de théâtre. Que ne la faites-vous représenter ? Elle aura l’avantage de ne pas vous coûter un denier, et c’est peut-être saint Janvier qui vous l’envoie.
Bien que Geronimo Passavanti eût reçu une certaine éducation, il faillit se laisser aller à quelque geste de pantomime napolitaine, très-inconvenant, envers sa chère épouse, lorsqu’il eut jeté les yeux sur le manuscrit couvert de poussière et de toiles d’araignée qu’elle lui présentait.
On lisait sur la couverture, en gros caractères : Le Triomphe Des Masques. Il était aisé de s’apercevoir que cette pièce remontait au moins au temps de la Comédie de l’Art, lorsque les comédies n’étaient autre chose que de simples canevas que les acteurs remplissaient à leur guise.
Cependant, le désespoir est inventif de sa nature, et, dès que Geronimo eut feuilleté pendant quelques instants le manuscrit du Triomphe des Masques, il se mit tout à coup à sourire à travers ses larmes, et se dit : — Pourquoi pas ?
Ce pourquoi pas voulait dire dans sa bouche : — Puisque je n’ai rien à jouer, pourquoi n’essaierais-je pas de représenter cette pièce que le hasard a remise entre mes mains ? Quand elle sera un peu rajeunie, rajustée, époussetée surtout, elle vaudra peut-être bien ce que je joue tous les soirs.
Consolé par l’idée qui lui était venue, Geronimo mit sous son bras le manuscrit du Triomphe des Masques, et se rendit à un petit café situé sur la place du marché, où se réunissaient habituellement les Quinault et les Métastase du théâtre San-Carlino.
Le premier poète auquel s’adressa le directeur était le fameux Burchiello, qui mangeait du macaroni du matin au soir, et en était déjà à son cinq cent soixante-dix-neuvième ouvrage dramatique, bien qu’il fût âgé de quarante ans à peine.
— Je ne vous demande pas de me remettre une de vos pièces, lui dit Geronimo d’un ton d’humilité, puisque vous avez, dites-vous, juré entre vous par le Styx de ne plus travailler pour moi ; mais permettez du moins que cette vieille farce, qui m’est par hasard tombée sous la main, paraisse sous votre nom. Ce ne sera pas violer votre promesse ; vous sauverez ainsi un pauvre homme qui est sur le bord du précipice, et je pense que le Styx ne s’en offensera pas.
— Quelle proposition venez-vous me faire là ? s’écria le poète en agitant avec fureur sa main qui soutenait un chapelet magnifique de macaroni. Qui ? moi, j’irais signer de mon nom une misérable rapsodie qu’il vous a plu de tirer de la poussière ! Que diraient le mont Parnasse, Apollon, le cheval Pégase, le Permesse et les Neuf Muses, envoyant s’avilir de la sorte le grand poète Burchiello, l’auteur de… de…
Il commençait à énumérer les titres de ses cinq cent soixante-dix-neuf pièces, ce qui eût beaucoup retardé le pauvre Geronimo Passavanti. Voyant qu’il n’y avait rien à espérer du côté de Burchiello, le directeur se tourna vers Pandolfo, Dottori, Binoccini, Cocodrillo, et beaucoup d’autres poètes qui se trouvaient réunis dans le café ; mais chaque fois qu’il déroulait son manuscrit du Triomphe des Masques, tous lui riaient au nez, et l’accablaient de railleries et de dédains.
Passavanti ne savait plus à quel saint vouer son théâtre ; sa peine était d’autant plus sensible que, dans ce temps-là, de même qu’aujourd’hui, l’usage voulait que l’on imprimât d’avance sur une affiche le nom de l’auteur d’une pièce nouvelle. Le public se porte à la représentation suivant le degré d’estime qu’il accorde au nom du poète. Contrairement aux coutumes de France, les chefs-d’œuvre dramatiques de Naples ne peuvent se permettre l’incognito.
— Eh bien ! se dit en rentrant chez lui Geronimo, puisqu’ils ne veulent pas endosser la responsabilité de la pièce, c’est moi qui la signerai, et il ne sera pas dit qu’un théâtre périra faute d’un poète de bonne volonté !
Il fit aussitôt fabriquer une immense affiche sur laquelle on lisait : « Dans trois jours, l’excellente, l’incomparable, la sublime, la divine farce du Triomphe des Masques, par le directeur du théâtre San-Carlino, Geronimo Passavanti. »
Cette affiche fut suspendue, à l’aide d’une corde, au milieu des rues les plus fréquentées qui avoisinent la rue de Tolède, forme de publicité qui rappelle un peu, par parenthèse, celle de nos réverbères. Mais, quand les poètes que Geronimo avait implorés vainement virent son affiche se balancer au gré des zéphyrs, ils triomphèrent et s’applaudirent de la réussite de leur complot.
— Un directeur de spectacle, dirent-ils, en être réduit à se donner comme le père de vieilleries ensevelies depuis un siècle ! Les habitués du théâtre ne peuvent manquer de s’éloigner tous de concert ; c’en est fait de San-Carlino, et nous aurons bientôt à composer une tragi-comédie sur sa ruine.
Geronimo, sans se laisser intimider par ces prédictions sinistres, avait distribué ses rôles aux acteurs ; mais, comme ils lui demandaient tous à la fois ce qu’ils auraient à dire et à faire :
— Mes enfants, leur répondait-il, jouez vos rôles comme si vous les saviez par cœur ; occupez-vous de rendre ce que vous avez tous les jours sous les yeux, de copier les gestes et la démarche de ceux que vous voudrez imiter : une fois en scène, les paroles ne vous manqueront pas. Nos aïeux et bisaïeux les Arlequin, les Pulcinella, les Pantalon, les Covielle et les Scaramouche, ne jouaient jamais la comédie autrement, et ils n’en étaient pas plus mauvais pour cela. La preuve, c’est que nous vivons encore aujourd’hui sur leur réputation et sur leurs masques.
À force de zèle et d’activité, la pièce fut prête au bout de trois jours. Les poètes de la conjuration prétendaient que personne ne se dérangerait pour assister à la première représentation du Triomphe des Masques. Mais ils purent se convaincre que les poètes ne sont pas toujours d’infaillibles oracles.
Chacun était curieux de voir une pièce que l’on disait avoir été composée par le directeur Geronimo Passavanti. L’affluence fut telle, qu’il ne fallait rien moins qu’une salle aussi solide que celle de San-Carlino, pour ne pas s’écrouler sous le poids des spectateurs.
Dès les premières scènes, les poètes qui occupaient toute une banquette du parterre furent fort étonnés de voir que les acteurs entraient, sortaient, parlaient absolument comme si leur rôle eût été tracé d’avance. Souvent même, les saillies naissaient avec tant d’à-propos, le dialogue se parsemait de lui-même de traits si comiques et si neufs, que la salle tout entière éclatait en applaudissements. La pièce avait trois actes ; le premier venait de finir, et l’auteur prétendu, Geronimo Passavanti, rappelé plusieurs fois sur la scène, avait déjà gagné une courbature à force de révérences.
Les deux derniers actes confirmèrent le succès du premier : jamais pièce plus singulière ni plus intéressante n’avait été offerte au public de San-Carlino. On voulait porter le directeur en triomphe ; mais il avait eu le soin de se blottir derrière la toile du fond, afin de se dérober aux démonstrations de l’assemblée délirante.
Ce fut là que le trouvèrent les poètes qui s’étaient empressés de franchir les banquettes pour se rendre sur le théâtre.
Burchiello prit le directeur à part, et lui dit :
— Vous savez que c’est moi qui suis l’auteur de la pièce ; c’est un ancien canevas que j’avais remis autrefois à votre prédécesseur. Je n’ai pas voulu vous l’avouer pour ne pas me séparer de mes confrères ; mais à partir de demain, je vous autorise à mettre mon nom sur l’affiche.
— Point du tout, interrompit Pandolfo, c’est mon nom qui doit être imprimé ; n’ai-je pas reconnu plusieurs scènes qui ne peuvent appartenir qu’à mon répertoire ?
— Voilà qui est un peu fort, criait de son côté le poète Dottori ; oser dire que la pièce n’est pas de moi quand tous les lazzis de Pulcinella et les bons mots de Casacciello sont de mon invention !
— Messieurs, Messieurs, dit Geronimo qui ne savait comment se débarrasser de cette nuée de poètes criant tous à la fois, je vais vous mettre d’accord en vous déclarant que la pièce appartient à vous tous, et que si mes pauvres acteurs ont eu le bonheur de réussir, c’est qu’ils se sont souvenus des mots charmants et des excellents traits dont vous avez rempli les rôles que vous avez bien voulu leur écrire. Faisons donc la paix, et, pour conclure le traité, j’imprimerai demain sur mon affiche que la pièce nouvelle est non pas de moi, mais des très-illustres poètes Burchiello, Pandolfo, Dottori, et de tous ceux qui voudront bien se présenter, à condition toutefois que vous me permettrez désormais d’intituler ainsi la pièce : le Triomphe des Masques, ou
qu’il arrive des parrains.


RIEN N’EST BON
COMME LE FRUIT DÉFENDU

 e comte de G. a près de soixante ans, et sa femme n’en a pas vingt-cinq. Cette disproportion d’âge n’a nullement nui au bonheur du ménage, attendu que M. de G., en considérant sa femme comme sa fille, lui épargne autant que possible les remontrances et les gronderies qui marchent trop souvent à la suite des vieux maris.
e comte de G. a près de soixante ans, et sa femme n’en a pas vingt-cinq. Cette disproportion d’âge n’a nullement nui au bonheur du ménage, attendu que M. de G., en considérant sa femme comme sa fille, lui épargne autant que possible les remontrances et les gronderies qui marchent trop souvent à la suite des vieux maris.
Cependant, il est des cas où un époux même à cheveux blancs ne peut guère se dispenser d’adresser à sa femme

— Vous savez, Juliette, disait un jour à sa femme le comte de G., qu’en vous épousant j’ai reçu de vous la promesse que vous cultiveriez vos talents avec autant d’assiduité qu’autrefois. Vous avez une voix charmante, il est des morceaux que vous rendez mieux que des cantatrices de profession ; pourquoi votre piano reste-t-il fermé quelquefois des mois entiers ?
— Mon ami, j’ai depuis quelque temps la musique en horreur ; la vue seule de mon piano m’agace horriblement les nerfs.
— Sacrifions donc la musique ; mais la peinture, que vous a-t-elle fait ? Je me souviens que dans votre pension vous faisiez des bouquets de roses presque aussi bien que Redouté, et si vos aquarelles eussent été signées Decamps ou Delacroix, je suis persuadé que Susse les eût couvertes d’or. Cependant, votre boîte à couleurs reste fermée et votre king Charles est couché toute la journée sur votre palette.
— Est-ce ma faute, si tout ce que je fais en dessin ou en peinture me semble au-dessous du médiocre ? Si vous voulez, mon ami, ne pas me désoler, ne me forcez pas à reprendre ces pinceaux auxquels je voudrais n’avoir jamais touché de ma vie.
— Je me souviens aussi que, dans les premiers temps de notre mariage, vous paraissiez vous plaire à un exercice qui ne peut, je crois, qu’être utile à votre santé ; vous montiez à cheval, et tout le monde admirait votre grâce et votre dextérité. À présent, je suis obligé d’aller galoper seul au Bois, et j’ai la douleur de penser qu’il me faudra bientôt vendre Thecla, cette jument arabe que j’avais achetée pour vous et qui reste quelquefois huit jours sans sortir de son écurie.
— Que voulez-vous ? l’équitation me déplaît comme tout le reste : j’aime mieux demeurer oisive que de m’abandonner à des exercices qui ne sont plus des distractions pour moi. Exigez-vous donc que je chante, que je peigne ou que je monte à cheval avec une âme chargée d’ennuis et de tristesse ?
— Non, sans doute, ma chère Juliette, reprit M. de G. en souriant, et mon vœu le plus cher aujourd’hui, comme au premier jour de notre union, est qu’avant toutes choses vous ne subordonniez vos actions qu’à votre seule volonté.
Peu de jours après cet entretien, la comtesse de G. se sentit atteinte de vapeurs, de frissons et de maux de nerfs qui lui donnèrent quelques inquiétudes sur sa santé. À peine avait-elle commencé à se plaindre, que le célèbre docteur L., en qui le comte avait pleine confiance, était déjà à ses côtés et l’interrogeait avec anxiété sur le genre de malaise qu’elle éprouvait.
Quand elle eut achevé de dérouler aux yeux du docteur le chapitre de ses souffrances, celui-ci lui dit du ton grave d’un homme sérieusement inquiété :
— J’espère, Madame, que vous ne chantez jamais : je remarque que vous devez avoir le larynx très-susceptible, et la musique vocale aurait pour vous des conséquences fâcheuses.
— J’ai chanté autrefois, mais depuis longtemps j’ai mis de côté les cavatines et les duos. Mes instincts me disaient que je serais forcée tôt ou tard de renoncer au chant par raison de santé.
— Avez-vous également renoncé à la peinture ? — Entièrement.
— À merveille. La position courbée que cet art exige fatiguerait votre poitrine, et augmenterait bientôt cette langueur mélancolique où vous êtes habituellement plongée. Vous ne faites jamais d’exercices de corps ?
— Depuis une semaine, je ne quitte pas cette causeuse.
— C’est Hippocrate lui-même qui vous a inspirée ; avec une complexion aussi frêle que la vôtre, vous devez vous interdire tout ce qui vous imposerait du mouvement, de la fatigue. Ainsi, point de danse, point de valse, jamais d’équitation surtout ; suivez mes prescriptions à la lettre, et je puis vous garantir une prompte convalescence.
Le comte de G. prit congé du médecin en lui assurant qu’il n’avait pas à redouter la moindre infraction à son ordonnance, attendu que, par une coïncidence heureuse, elle se trouvait entièrement d’accord avec les goûts de la malade.
Le lendemain de cette consultation, M. de G. fut obligé de quitter Paris pour quelques jours. Il revint plus tôt qu’on n’aurait cru ; et comme il traversait la cour de l’hôtel, il fut étonné d’entendre au premier étage une voix énergique et vibrante qui chantait la grande cavatine de Norma : Cas diva.
Le comte monta aussitôt dans le boudoir où se tenait habituellement la comtesse, et fit semblant de ne point s’apercevoir que le piano était ouvert et que plusieurs morceaux étaient accumulés sur le pupitre.
— Est-ce que vous chantiez ? dit-il d’un ton d’indifférence en s’adressant à sa femme.
— Point du tout ; je regardais cette musique, mais des yeux seulement, sans chanter.
— Songez à la défense du médecin.
— Je ne l’ai point oubliée, et si jamais je chantais à l’avenir, ce serait si bas, si bas, qu’à moins d’avoir l’oreille contre mon piano, personne ne pourrait m’entendre.
M. de G. avait quelques affaires à terminer, il revenait de visiter une terre considérable qu’il avait dans la Brie : du moins, tel fut le prétexte qu’il donna à sa femme pour s’absenter. Mais, au lieu de sortir, il se retira dans son cabinet et prêta de nouveau l’oreille.
Au bout de quelques instants, l’air de Casta diva recommença de plus belle, puis le beau finale du premier acte Ah ! se tu sei la vittima, puis le duo entre Norma et Adalgisa. Après Norma vint Parisina, puis Semirarmide, puis Maria di Rohan ; tout le répertoire de mademoiselle Grisi y passa.
M. de G. sortit de son cabinet, enchanté de voir si bien réussir l’idée que lui avait suggérée son médecin.
Il descendit dans la cour et donna l’ordre de seller un cheval, ayant l’habitude de faire tous les jours une promenade d’une heure ou deux avant le dîner.
Il alla rejoindre la comtesse, et feignit d’avoir employé à conférer avec son notaire et des hommes d’affaires les trois heures qu’il venait de passer dans son cabinet, applaudissant mentalement les sons de sa charmante voix.
— Vous sortez ? lui dit-elle dès qu’elle le vit.
— Oui, ma chère Juliette, j’essaie aujourd’hui le cheval que m’a vendu sir John A. Je vais au Bois, mais avec ennui, avec tristesse ; l’idée d’être seul à la promenade gâte d’avance tout le plaisir que je pourrais avoir.
— Si je vous accompagnais ?
— Y pensez-vous ? Et le médecin ?
— Il n’en saura rien, il visite ses malades en ce moment et nous ne le rencontrerons certainement pas au bois de Boulogne.
— Non, ce serait compromettre votre santé, je ne consentirai jamais…
— Vous voulez donc que je meure de tristesse et de dépit. Autant vaut, ce me semble, mourir en me divertissant. D’ailleurs, le docteur m’a défendu de galoper, et je vous promets d’aller si doucement, si doucement, que je ne serai certainement pas plus fatiguée que si je restais dans mon fauteuil.
M. de G. se laissa vaincre, et fit seller la jument Thecla que la comtesse montait ordinairement. À peine avait-elle fait quelques pas, que sa figure depuis longtemps froide et attristée rayonnait de plaisir. Son mari lui avait recommandé de n’aller qu’au petit pas ; mais dès qu’elle fut dans l’avenue de Neuilly, elle se mit à galoper si bien que le comte avait peine à la suivre.
En rentrant, elle était animée, joyeuse ; son front était couvert de ces teintes de la santé qu’un exercice salutaire ramène sur les visages les plus pâles.
— Que dirait le docteur s’il vous voyait dans cet état ? dit M. de G. en rentrant.
— Il dirait, répondit-elle, que j’ai un peu enfreint son ordonnance. Mais que nous importe ? nous ne le verrons pas ; ne partons-nous pas demain pour la campagne ?
On était alors au commencement du printemps, et le comte de G. avait l’habitude à cette époque-là d’aller s’établir dans un magnifique château qu’il possédait dans les environs de Compiègne.
Madame de G. parut plus heureuse encore que de coutume de quitter Paris. Mais elle était installée au château depuis deux jours à peine, qu’elle avait déjà pris l’habitude de ne descendre de sa chambre que vers deux heures de l’après-midi. Chaque matin, le jardinier lui montait en cachette un bouquet de fleurs les plus belles et les plus variées. Le comte ne tarda pas à découvrir que sa femme employait toutes ses matinées à peindre ; il rendit des actions de grâces au docteur.
La fête de M. de G. se trouvait être à la fin du mois de juillet. La veille de cet anniversaire, il vit paraître devant lui madame de G., qui lui offrit d’un air embarrassé un magnifique album qu’elle venait d’achever. M. de G. se mit aussitôt à le parcourir, et quel fut son bonheur en remarquant qu’il était rempli de fleurs peintes avec un goût charmant !
— Vous allez me gronder, dit-elle ; j’ai voulu remplir cet album malgré les ordres du médecin.
— Non, ma chère Juliette, s’écria M. de G. en l’embrassant au front, car vous saurez que cette prétendue défense de mon ami L. n’était qu’une ruse de sa part destinée à vous rendre à vos anciens passe-temps. Il a pensé que vous y reviendriez de vous-même du jour où on vous les interdirait. Pardonnez-moi de grâce en faveur de cette vérité, qui s’applique si bien aux goûts des jeunes femmes, et souvent aussi, hélas ! à la position des vieux maris :


LÀ OÙ SONT LES POUSSINS
LA POULE A LES YEUX

 l y avait, non pas autrefois, mais l’année dernière, à Grenade, deux orphelines très-belles et très-riches ; l’une s’appelait Soledad, l’autre Miranda. Elles étaient sous la garde d’une tante qui les aimait comme ses propres enfants ; de leur côté, les jeunes filles voyaient en elle une mère véritable. La famille demeurait dans une maison de noble apparence, vis-à-vis l’hôtel de El Rey Boabdil, situé rue du Saint-Sacrement.
l y avait, non pas autrefois, mais l’année dernière, à Grenade, deux orphelines très-belles et très-riches ; l’une s’appelait Soledad, l’autre Miranda. Elles étaient sous la garde d’une tante qui les aimait comme ses propres enfants ; de leur côté, les jeunes filles voyaient en elle une mère véritable. La famille demeurait dans une maison de noble apparence, vis-à-vis l’hôtel de El Rey Boabdil, situé rue du Saint-Sacrement.
Le hasard avait conduit à Grenade deux Français, jeunes

— Mon cher Ernest, tu as grand tort de soutenir la prééminence des femmes de Paris.
— Mais c’est toi, au contraire, qui prétends que le royaume des jolies femmes est borné au nord par le Café de Paris, et au sud par la rue Montmartre.
— Je n’ai jamais prétendu cela, reprit Eugène avec humeur.
— Je ne me suis jamais fait, ajouta Ernest avec une certaine vivacité, le champion exclusif de nos compatriotes.
— Les Espagnoles ont tant de lumière dans le regard ! Examine plutôt Soledad.
Et tant de finesse dans le pied ! Regarde plutôt Miranda.
— Ah çà ! qui t’a dit qu’elle s’appelait Miranda ?
— Qui t’a appris qu’elle se nommait Soledad ?
Les deux jeunes gens rougirent légèrement, puis ils échangèrent un sourire.
— Avoue, Eugène, que tu es amoureux.
— Conviens, Ernest, que ton cœur est pris.
— Cela est vrai, j’adore Soledad.
— Je le confesse, je meurs d’amour pour Miranda.
Plaçons-nous maintenant sous le balcon ; les deux jeunes filles jettent de temps en temps, en causant, un coup d’œil furtif vers la fenêtre.
— Sais-tu, Miranda, ce que j’ai rêvé cette nuit ?
— Et moi ?
— J’ai rêvé que j’étais à Paris.
— C’est justement ce que j’ai rêvé aussi.
— J’étais au bal, et je dansais avec un jeune homme qui ressemble
— À qui ?
— À l’un de ces jeunes gens, reprit Soledad en hésitant, que nous apercevons là-bas à la fenêtre.
— J’étais aussi au bal, continua Miranda ; je dansais comme toi avec
— Avec qui ?
— Avec un de ces voyageurs, répondit-elle avec autant d’hésitation que sa sœur, que nous voyons d’ici à la fenêtre.
— Si nous l’aimions toutes les deux ! s’écria Miranda incapable de se contenir. Quel est son nom ?
Soledad tira un petit billet de son sein, et elle en montra la signature à Miranda, qui lut : Eugène.
Miranda montra à Soledad un poulet soigneusement plié, et signé : Ernest.
Se regarder, s’aimer, s’écrire, il est impossible de mieux faire l’amour à l’espagnole. Voilà, nous direz-vous aussi, une tante par trop tutrice ; elle laisse ses nièces recevoir des billets doux sous son nez ; l’amour se glisse au logis sans qu’elle s’en aperçoive. Vous allez nous montrer quelque vieille femme au chef tremblant, au nez crochu, aux lunettes vertes, une duègne exhumée de Lesage, qui ne voit rien, n’entend rien, à demi aveugle, complétement sourde, aux trois quarts perdue. Eh bien ! vous vous trompez. Tous ceux qui connaissent la senora Montes vous diront que son œil est brillant, son oreille fine, sa jambe solide ; on ajoutera qu’elle est fort bien élevée, fort instruite, fort spirituelle.
Du reste, si vous tenez à faire connaissance avec la senora Montes, elle passe la soirée chez le gouverneur. Entrez dans le salon, vous y verrez trôner la tante de nos héroïnes ; on l’écoute, on fait cercle autour d’elle. Quel est l’objet de la conversation ? l’éducation des jeunes filles. La senora Montes soutient qu’il ne faut pas s’effrayer de l’amour, que c’est un sentiment naturel plus ou moins éprouvé par tout le monde, qu’il est toujours victorieux quand on l’attaque en face, et que la meilleure manière d’en venir à bout est de paraître l’ignorer ; si de cette façon l’on ne réussit pas à l’éteindre, on parvient à le diriger ; et que peut-on souhaiter de plus ?
Quelques jours après les divers entretiens que nous venons de rapporter, Eugène entra dans la chambre d’Ernest.
— Salue en moi, lui dit-il, le plus fortuné des hommes.
— Reconnais en ma personne, répondit son ami, le plus heureux des mortels.
— Elle m’accorde un rendez-vous.
— Elle consent à m’entendre.
— Où ?
— Dans les ruines, derrière l’Alhambra.
— À quelle heure ?
— Après la bénédiction.
— Eh bien ! partons, car moi aussi je suis attendu derrière les ruines de l’Alhambra, après la bénédiction. Les deux sœurs n’ont pas voulu se séparer ; nous ferons partie carrée.
On n’attend pas de nous la description d’un rendez-vous espagnol à l’Alhambra ; nous renvoyons le lecteur aux nombreux romans et aux non moins nombreuses nouvelles publiées sur l’Espagne. Qu’on se figure une nuit étoilée, des arbres agités par la brise, des soupirs, des serments, des mots entrecoupés, des baisers… Je me trompe, au moment où les deux couples allaient sceller par un baiser, suivant l’usage antique et solennel, l’inviolable promesse d’un amour éternel, une vieille femme sortit tout à coup des ruines, et s’assit sans façon sur une pierre à côté des amoureux.
— C’est sans doute une manière de demander l’aumône, pensa Ernest, et il jeta quelques réaux dans le tablier de la vieille.
Celle-ci remercia, mais sans bouger de place.
— Elle ne part pas ! murmura Ernest ; allons ailleurs reprendre cet entretien.
Ils se levèrent, la vieille en fit autant ; ils s’éloignèrent, mais elle les suivit en les accablant d’actions de grâces. Ce fut un déluge de « Dieu vous protège et vous accorde d’heureux jours ! » le tout accompagné de révérences à n’en plus finir. L’heure de rentrer étant arrivée, la vieille ne quitta les amoureux qu’aux portes de la ville.
— Maudits soient les mendiants et leur reconnaissance ! s’écrièrent les deux jeunes gens, quand ils eurent quitté, bien malgré eux, leurs maîtresses ; cette femme nous a fait perdre le bénéfice de notre rendez-vous.
Les amours vont vite en Espagne ; une fois l’habitude prise de se voir, on ne renonce pas facilement à ce plaisir. Miranda, Soledad, Ernest et Eugène multipliaient les rencontres préméditées ; la señora Montes paraissait ne se douter de rien ; aucun obstacle ne traversait le bonheur des amants, si ce n’est le hasard. Ordinairement le hasard se range du côté de l’amour ; il n’en fut rien cette fois : pas un rendez-vous qui ne fût troublé par la présence inattendue de quelque témoin importun. S’ils choisissaient une chapelle écartée, tout de suite une vieille dévote, la tête embéguinée, venait s’agenouiller à leur côté ; s’ils allaient à la campagne, une paysanne s’asseyait sur l’herbe à quelques pas d’eux et se mettait à tresser des espadrilles : pas moyen d’être seuls pendant cinq minutes.
Cependant toute la ville causait de la liaison des deux couples. — Voyez, disaient les Grenadines, à quoi sert l’esprit ? La señora Montes ne se doute pas seulement que ses nièces ont des amoureux ; elle ne l’apprendra que le jour où les Français les lui auront enlevées.
À cette époque on donna à Grenade un bal masqué pour célébrer une victoire remportée sur les factieux ; la señora Montes avait promis à ses nièces de les conduire à cette fête. Je vous laisse à penser si Eugène et Ernest en furent instruits. On convint d’un signal de ralliement ; Soledad et Miranda mettront une rose rouge dans leurs cheveux ; Ernest et Eugène arboreront un brin de bruyère blanche à leur domino.
Les deux jeunes filles sont charmantes, la rose ressort gracieusement au milieu de leurs cheveux noirs ; elles montent en voiture ; elles entrent dans la salle de bal ; je ne sais comment cela se fait, mais un flot de spectateurs les sépare de leur tante. N’avaient-elles pas compté là-dessus ? Ne mirent-elles pas un peu de bonne volonté dans cette séparation ? C’est à ceux qui connaissent mieux que nous le cœur des femmes qu’il appartient de décider.
Ernest et Eugène attendaient les roses rouges, adossés contre un pilier ; ils sentirent tous les deux au même instant une main qui froissait leur domino ; mais ils ne cherchèrent pas à deviner d’où venait cette pression. Que faisaient pendant ce temps-là les deux roses rouges ? Elles cherchaient la bruyère blanche. Mais pas la moindre bruyère qui fleurît à l’horizon.
— Où sont donc nos deux chères roses ? se demandaient les deux bruyères.
— Ernest, ne vois-tu rien venir ?
— Eugène, aperçois-tu quelque chose ?
Le bal touchait à sa fin ; les deux fleurs ne s’étaient pas rencontrées.
— Ce sont des infidèles, disait Soledad à sa sœur.
— Ce sont des coquettes, murmurait Eugène à Ernest. La senora Montes avait rejoint ses deux nièces.
— Malheureux coiffeur ! dit-elle quand elles furent en voiture, vos roses ne sont plus dans vos cheveux ; il les a si mal attachées qu’elles sont tombées, je parie, avant votre entrée au bal.
Soledad et Miranda ne répondirent rien.
— Pauvres amis ! pensèrent-elles, que vont-ils s’imaginer ?
En quittant leurs dominos, Eugène et Ernest s’aperçurent que la bruyère n’y était plus.
— Que vont-elles croire ? se dirent-ils ; attendons à demain pour nous excuser.
Chaque jour cependant l’amour s’accroissait de toutes ces contrariétés ; les amants avaient résolu de s’appartenir. Soledad et Miranda avaient l’imagination exaltée, Eugène et Ernest étaient jeunes et non moins ardents ; que devait-il résulter de tout cela ? un enlèvement.
L’ombre enveloppait Grenade, d’épais nuages couvraient le ciel ; c’était une nuit propice aux entreprises amoureuses. À minuit, deux jeunes filles, enveloppées dans leur mante, arrivèrent en un lieu écarté où les attendaient les deux jeunes gens et une chaise de poste.
Elles allaient monter en voiture, lorsqu’une vieille femme les tira par la robe.
— La charité, mes nobles demoiselles, s’il vous plaît !
— La mendiante de l’Alhambra ! s’écria Eugène avec emportement. Postillon, en avant ! route de France !
Les chevaux s’élancèrent ; mais la vieille sauta dans la voiture avec une légèreté qui n’était pas de son âge. Les jeunes filles poussèrent un cri d’effroi.
— Cette femme ici ! dit Ernest avec un geste de colère.
— N’est-ce point ma place ? répondit la séniora Montés en reprenant sa voix naturelle ; ne suis-je pas la mère de ces deux enfants ? Il est bien juste que je voyage avec mes gendres futurs ; le mariage aura lieu à Paris, j’en suis charmée.
Soledad et Miranda se jetèrent au cou de leur tante ; Ernest et Eugène restaient interdits.
— Messieurs, reprit la tante, je vous connais et je vous donne mes nièces avec plaisir ; je ne vous ai pas perdus de vue un seul instant, sans que vous vous en doutiez. Je lisais vos lettres, elles m’instruisaient de tout. Je vous rends l’argent que vous avez donné à la vieille de l’Alhambra ; mes nièces, voici les roses que je vous ai adroitement enlevées ; et vous, mes neveux, tâchez une autre fois de mieux veiller sur les bruyères, surtout quand elles doivent servir à vous faire reconnaître. Vous voyez que j’ai assez bien rempli mon rôle ; on peut tromper une duègne, mais une mère jamais, car, vous le savez :



MURAILLE BLANCHE
PAPIER DE FOU

 on Manrique, seul. — Dans quel temps vivons-nous, grand Dieu ! Jamais on n’a vu tant d’impôts et tant de supplices ! Non seulement le bas peuple, mais aussi la noblesse est appelée à porter le fardeau. Un roi cruel ne se contente plus de notre sang ; il a soif de nos trésors ; et me voilà forcé de dissimuler ma richesse, comme je cacherais un vice honteux. Glorieux ancêtres, me pardonnerez-vous ce mensonge nécessaire pour sauver l’héritage de ma famille ? Mais quel est ce bruit ?
on Manrique, seul. — Dans quel temps vivons-nous, grand Dieu ! Jamais on n’a vu tant d’impôts et tant de supplices ! Non seulement le bas peuple, mais aussi la noblesse est appelée à porter le fardeau. Un roi cruel ne se contente plus de notre sang ; il a soif de nos trésors ; et me voilà forcé de dissimuler ma richesse, comme je cacherais un vice honteux. Glorieux ancêtres, me pardonnerez-vous ce mensonge nécessaire pour sauver l’héritage de ma famille ? Mais quel est ce bruit ?
(Entre don Alvar de Benavidès.)
— Oui êtes-vous ?
Don Alvar. — Un malheureux qui n’a d’espoir qu’en vous.
Don Manrique. — Est-il courtois de s’introduire chez les gens par-dessus les murailles ?
Don Alvar. — Pardonnez-moi, noble seigneur, j’étais poursuivi… Mais d’abord, personne ne nous écoute ?
Don Manrique. — Personne. Vous pouvez parler.
Don Alvar. — Vous savez quelle est la rigueur des édits portés contre le duel ; et vous savez aussi ce que veulent les lois de l’honneur. L’honneur est un diamant, mais un souffle peut le consumer ; un souffle, c’est-à-dire un mot, peut ternir son éclat, plus pur que celui du soleil. Or, jugez de ma disgrâce. Je rendais quelques soins à une noble dame, qu’il est inutile de nommer ; j’eus bientôt la joie d’être distingué par elle. Cependant j’avais un rival présomptueux dans sa conduite et téméraire dans ses paroles. Tout à l’heure, sur le port où nous étions tous deux dans un groupe d’officiers, cette dame vint à passer. Sa démarche gracieuse attirant tous les regards et lui gagnant tous les cœurs, un capitaine dit :
— Voilà une belle femme.
— À quoi mon rival ajouta :
— Le caractère est à l’avenant.
— Serait-elle cruelle ? demanda l’autre.
— Non, répliqua-t-il ; mais les belles manquent en général de jugement, et celleci, plus belle que les autres, s’est montrée aussi plus mal avisée. Alors moi, saisissant l’allusion :
— Personne, dis-je, n’a obtenu ses faveurs, parce que personne ne les mérite ; mais si quelqu’un les méritait, à coup sûr ce serait moi.
— Vous mentez, dit-il.
À peine mon rival eut-il prononcé ce démenti que mon épée rapide passa du fourreau dans sa poitrine. On n’eut pas le temps de m’arrêter. Le châtiment suivit l’insulte, comme la foudre suit l’éclair. Commis en public et à la face du jour, ce crime, si c’en est un, ne pouvait un seul instant rester ignoré. J’avais pris la fuite aussitôt après ce coup fatal ; mais déjà les alguazils couraient sur mes traces. Après plusieurs détours, épuisé de fatigue, j’allais me rendre à eux, lorsque, la muraille de votre jardin m’offrant un endroit propice à l’escalade, je m’y suis jeté sans réflexion. Maintenant, Seigneur, vous savez tout ; ma vie est en vos mains. Vous pouvez, si vous craignez d’attirer sur vous la colère du roi, livrer don Alvar de Benavidès à ses bourreaux.
Don Manrique. — Vous ne pensez pas que je le fasse, don Alvar, et si vous le pensiez, ce serait pour moi une mortelle injure. Comment s’appelait votre rival ?
Don Alvar. — Don Manuel de Souza ; c’est le fils aîné du gouverneur de Lisbonne.
Don Manrique. — Son père est puissant, et je crains pour vous sa colère ; mais nous essaierons de vous y dérober. Vous n’êtes pas le seul proscrit que j’aie depuis un an soustrait à la rigueur des lois. Venez, s’il vous plaît, par ici.
(Ils sortent.)
Dona Séraphine. — Ainsi vous n’irez pas ce soir au sarao.
Don Manrique. — Vous y serez, astre de ma vie ?
Dona Séraphine. — Je n’y saurais manquer ; je l’ai promis à quelqu’un.
Don Manrique. — À quelqu’un ? malgré moi je tremble, et mon cœur souffre. À quelqu’un, dites-vous, dona Séraphine ? Et quelle est, s’il vous plaît, cette personne ?
Dona Séraphine. — Que vous importe ?… c’est mon secret.
Don Manrique. — Si je vous demande de me la nommer, me refuserez-vous donc, Séraphine ?
Dona Séraphine. — Me direz-vous, si je vous le demande, pourquoi vous n’allez pas ce soir au sarao ?
Don Manrique. — Je ne le puis sans manquer à l’honneur : c’est un secret qui n’est pas le mien.
Dona Séraphine. — À votre aise, Manrique ; ce n’est pas non plus mon secret que le nom de vos rivaux.
Don Manrique. — Vous l’avouez donc… Il serait vrai ?… Séraphine, je veux savoir le nom de cet homme.
Dona Séraphine. — Je veux, Manrique, savoir qui vous occupe cette nuit ?
Don Manrique. — Ô tyrannie sans bornes ! ô lâcheté d’un cœur esclave !… Eh bien ! sachez-le donc, despotique arbitre de mon sort. Ma nuit est consacrée à faire sortir de Lisbonne deux proscrits dont je veux sauver la vie. N’exigez pas que je les nomme ; non que je doute de vous, Madame, mais pour que ma conscience ne me reproche point une trop complète faiblesse. Qu’il vous suffise de savoir ceci : l’un de ces hommes a coupé l’unique branche d’un tronc illustre ; le second a porté ses regards sur un astre dont les rayons donnent la mort. Tous deux sont destinés à périr, si l’on sait que je leur ai donné asile. Et déjà, si je ne me trompe, le lieu de leur retraite est soupçonné. Vous le voyez, il faut qu’ils partent, et qu’ils partent sans retard.
Dona Séïuphine. — Je vois, mon noble cavalier, que vous êtes toujours le plus généreux des hommes.
Don Manrique. — Maintenant, Séraphine, à votre tour, dites-moi…
Dona Séraphine. — Je n’ai rien à vous dire, Manrique ; vous n’avez pas de rival, et je n’ai promis à personne d’aller au sarao. Dites un mot, je renonce à ce bal.
Don Manrique. — À Dieu ne plaise que j’exige un tel sacrifice ! Je le devrais pourtant… car vous m’avez fait bien du mal. Maintenant, ma belle idole, prouvez-moi que vous me regardez toujours comme votre futur époux en obéissant à mes ordres.
Dona Séraphine. — Parlez, ils seront exécutés.
Don Manrique. — Je veux d’abord qu’à ce bal vous soyez la plus belle.
Dona Séraphine. — Je ne désobéirai pas, si je le puis.
Don Manrique. — Je veux aussi que vous ayez la plus riche parure, et je vous ordonne, — écoutez bien ce mot, — je vous ordonne de placer sur votre front cet insigne de royauté.
Dona Séraphine. — Un diadème !… Quels magnifiques diamants ! Mais, Manrique, n’est-ce point une folie ? On dit partout, vous dites vous-même, que la fortune des Almeïda n’est plus ce qu’elle était jadis. Les terres que vous avez vendues, cette vie retirée que vous menez…
Don Manrique. — Rassurez-vous, Séraphine, l’étoile des Almeïda ne pâlit que pour un temps ; viennent des jours meilleurs, et vous verrez s’écarter les nuages dont elle s’entoure à présent. Jusqu’alors, n’ayez aucun scrupule à recevoir les présents dont j’ai tant de bonheur à vous combler. Et maintenant je pars. Adieu, ma reine et ma vie.
Dona Séraphine. — Adieu, mon amour et mon seigneur.
Don Luis De Souza. — Par ici, Garces : Tristan, par ici ! Carlos et Lisardo feront le guet dans l’autre hallier. Par Notre-Dame d’Atocha, ces hommes ne nous échapperont pas ! — Qu’on appelle le fiscal.
(Surviennent le fiscal et son escorte.)
Mes ordres sont-ils exécutés ?
Le Fiscal. — Toutes les issues de la forêt sont occupées à l’heure qu’il est. Les gardiens des ponts ont été avertis. Fussent-ils changés en lièvres, les fugitifs trouveraient fermées toutes les routes d’Espagne. Maintenant Votre Excellence daignera-t-elle me dire comment elle a su ?… Don Luis. — La chose est simple, Monsieur ; si vous aviez l’œil à tout, comme moi, les lois seraient mieux exécutées. Croiriez-vous bien qu’une couronne de diamants m’a mis sur la voie de tout ceci ? Cette couronne ornait le front de dona Séraphine Tellez. Lui voyant une parure si fort au-dessus de sa condition, je me mis en tête de savoir ce qui en était. Quelques louanges adroites, mêlées d’insinuations qu’elle devait avoir à cœur de repousser, me livrèrent bientôt ce secret… À propos, fiscal, je vous dénonce Almeïda comme un des plus riches gentilshommes du Portugal.
Le Fiscal. — Y pensez-vous, Monseigneur ? la ruine de cette famille…
Don Luis. — Est un conte forgé à plaisir pour éviter les confiscations et les taxes. Dès demain vous ferez fouiller la maison du marquis, et si vous n’y trouvez pas de quoi défrayer nos troupes pendant un mois, je consens à passer pour un visionnaire… Mais revenons : cet incident me fit remarquer l’absence du prodigue amoureux, et je m’étonnai qu’il ne vint pas jouir du triomphe de sa maîtresse. Mes questions d’ailleurs alarmèrent tellement dona Séraphine, que j’entrevis là dessous un mystère quelconque ; et, sans insister maladroitement, je m’arrangeai pour la faire interroger par quelques-unes de ses amies les plus intimes. À l’une, elle parla d’un homme qui avait « coupé l’unique branche d’un tronc illustre. » — Or, mon cousin, le fils unique du chef de ma maison avait été tué ce matin même, en duel, par don Alvar de Benavidès. Avec l’autre, il fut question d’un audacieux qui avait « porté ses regards sur un astre dont les rayons donnent la mort. » — Il ne fallait pas une rare pénétration pour deviner qu’il s’agissait de Fernand de Valor, l’imprudent amoureux de notre reine. Un demi-mot suffit au sage, et l’absence de don Manrique, la frayeur de dona Séraphine, les préoccupations qui la poursuivaient m’indiquèrent assez ce que j’avais à faire. Ce fut alors, que, sortant du sarao, je vous fis prévenir, pendant que par mon ordre on allait s’enquérir de don Manrique. Il était parti depuis un quart d’heure ; mais, grâce aux détours qu’il a dû faire pour éviter les chemins royaux, nous avions encore le temps de prendre l’avance. Je ne doute pas que nous ne mettions bientôt la main sur les deux criminels d’état, et sur leur imprudent complice… Pied à terre, Garcès, et l’oreille sur le sol N’entends-tu pas quelque bruit lointain ?
Le SOLDAT, après un silence. — J’entends au pied des rochers le trot des mules.
Don Luis. — À merveille !… préparez vos escopettes.
Don Alvar. — Taisez-vous, Manrique. N’ajoutez pas le mensonge à la trahison.
Don Fernand. — Un Ahneïda, vendre ses hôtes ! Qui aurait pu s’y attendre ?
Don Manrique. — Nobles seigneurs, écoutez-moi : par tout ce qu’il y a de plus saint et de plus sacré au monde, je n’ai point fait ce dont vous m’accusez. Je vous ai gardé

Don Alvar. — Et cette personne…
Don Manrique. — Cette personne est la plus tendre, la plus loyale et la plus candide des femmes, celle que je devais épouser, une âme pure et droite comme il n’en fut jamais.
Don Alvar. — Et par elle nous allons périr.
Don Fernand. — Par elle, nous sommes livrés à nos bourreaux.
Don Alvar. — Son innocence même et sa simplicité nous ont perdus.
Don Fernand. — Sa loyauté nous coûte la vie.
Don Alvar. — Fiez-vous donc à la candeur d’une femme.
Don Fernand. — Celles-là qui ne vous trompent pas à dessein, vous trahissent sans le vouloir.
Don Alvar. — Dans un cœur de boue, nos secrets sont à la merci des serpents.
Don Fernand. — Dans une âme de cristal sans tache, ils sont à la merci des espions.
Don Luis, paraissant au fond du cachot. — Sans doute, sans doute ; mais pourquoi tant de belles métaphores ? Dites plutôt avec le proverbe :
Et maintenant, Seigneurs, debout, s’il vous plaît ! Secouez vos chaînes, et saluons gracieusement la noble assemblée. Elle voudra bien, en faveur de ce beau dicton, excuser les fautes de l’auteur.

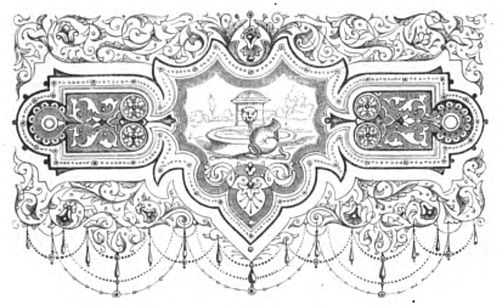
PEU DE LEVAIN
AIGRIT GRAND’PATE

 uiconque a été en Autriche sait que les auberges de Vienne ne valent pas grand’chose ; encore doit-on supposer qu’elles sont supérieures aux tavernes de cette même ville en l’année du Christ 1193. À cette époque, et dans un des plus humbles caravansérails qu’eût alors la capitale de l’Autriche, trois voyageurs arrivèrent un jour.
uiconque a été en Autriche sait que les auberges de Vienne ne valent pas grand’chose ; encore doit-on supposer qu’elles sont supérieures aux tavernes de cette même ville en l’année du Christ 1193. À cette époque, et dans un des plus humbles caravansérails qu’eût alors la capitale de l’Autriche, trois voyageurs arrivèrent un jour.
Tous les trois étaient pauvrement vêtus ; mais la noblesse de leur démarche, leur ton bref et résolu, leurs commandements brusques et hautains laissaient soupçonner en eux des hommes accoutumés à l’autorité. L’un d’eux surtout parlait à ses compagnons avec une impérieuse familiarité, dans une langue que ne comprenait point le hofmeisfer, déjà inquiet. Voyant toutefois qu’il avait affaire à des soldats fort habitués à se faire comprendre par gestes, il déploya pour les servir une activité remarquable.
Nonobstant ce bon vouloir forcé, les préparatifs du dîner qu’avaient commandé ses hôtes les effrayèrent quelque peu. L’impéritie culinaire du brave homme se révélait de reste à chacun de ses mouvements, et la propreté fort équivoque de ses mains ajoutait aux anxiétés des voyageurs.
— Par le ciel ! sir Foulk, — s’écria celui d’entre eux qui donnait le plus librement son avis, — le drôle que voici, avec ses doigts gras et sa rustique façon d’apprêter cette oie, va me faire prendre en grand respect, non pas la cuisine, mais la Diète allemande.
Sir Foulk salua d’un grand éclat de rire cette plaisanterie, qui avait une portée politique. Se tournant alors vers son autre compagnon :
— Sir Thomas, — reprit le joyeux voyageur, — vous qui savez l’allemand, ne pourriez-vous donner quelques conseils à notre hôte ? sa volaille ne sera pas mangeable.
Sir Thomas s’excusa de son mieux sur son ignorance profonde en ces matières.
— Par la sainte croix ! — reprit alors le compagnon de sir Foulk et de sir Thomas, — je vais donc moi-même lui donner une leçon, et le manant sera bien surpris si jamais il sait quelles mains ont touché sa lardoire.
Sur quoi, sans plus tarder, l’inconnu s’approcha du foyer, repoussa du coude l’inexpérimenté cuisinier, et avec une dextérité remarquable remania son travail incomplet. Sir Foulk, sir Thomas et l’hôte lui-même contemplaient cette scène avec un étonnement qui la rendait encore plus piquante.
Au plus vif de sa besogne, ce manipulateur impromptu fut dérangé par l’arrivée d’un nouveau témoin. Ce n’était rien moins qu’une Bohémienne errante, une Zingara, de quinze à seize ans au plus. Si jeune qu’elle fût, on voyait à son teint bruni, et surtout à son costume oriental, qu’elle n’avait pas quitté depuis longtemps la région brûlante où les rayons du soleil avaient doré son cou, ses épaules et ses mains.
— Au diable l’Égyptienne ! — s’écria le maître queux en fonctions, — vous voilà tous à la regarder comme une merveille, et ma leçon sera perdue si elle reste.
Il croyait sans doute que ces dures paroles ne seraient pas entendues de la jeune fille ; mais elle s’avança vers lui d’un air moins intimidé qu’on ne l’eût pu croire, et dans la même langue dont il s’était servi :
— Un brave d’Angleterre, — lui dit-elle, — n’empêchera pas sans doute une pauvre fille de gagner sa vie.
À ces mots, le voyageur parut plus contrarié que jamais.
— Qui es-tu ? — demanda-t-il rudement à l’Égyptienne ; — d’où es-tu ? que nous veux-tu ? Va-t’en !
Ces interpellations furent faites d’une voix terrible, et avec un regard qui eût fait pâlir les plus braves. La jeune fille pâlit en effet, mais l’assurance de son regard ne se démentit point ; il demeura fixé sur la figure de l’homme brutal qui la chassait ainsi. On eût dit, ou qu’elle cherchait à le reconnaître, ou qu’en véritable sorcière elle lui jetait le Mauvais Œil.
— Je viens, — lui dit-elle, — de la Terre-Sainte ; je viens de Saint-Jean-d’Acre et d’Ascalon, mon hardi soldat ; mais, vous qui parlez, ne fûtes-vous jamais en Palestine ?
— Que t’importe ? — répondit plus irrité que jamais le voyageur inconnu ; — me crois-tu fait pour deviser avec toi ou avec tes pareilles ? Hors d’ici, maudite païenne !
— Et vous, Thomas, — et vous, Foulk, — reprit-il, s’adressant à ses compagnons, — à quoi songez-vous de laisser ici cette mendiante ? Jetez-lui quelque argent, et qu’elle parte !
L’ordre ainsi donné fut exécuté sur-le-champ ; mais la Bohémienne repoussa l’aumône qu’on lui faisait avec tant de dédain, et, sans attendre les violences dont elle était menacée, elle sortit, l’œil fixé sur le discourtois soudard qui l’avait si mal accueillie.
Deux heures après, tandis que les trois voyageurs savouraient avec un appétit remarquable le dîner préparé par l’un d’eux, cinquante hallebardiers vinrent investir l’auberge où ils tenaient table. Le secrétaire du duc d’Autriche et un capitaine des gardes avaient pris le commandement de cette escouade. Quand ils entrèrent dans la salle, les trois convives, par un seul et même mouvement, se levèrent pour saisir leurs armes accrochées à la muraille ; mais le secrétaire, ôtant sa barette et s’inclinant avec un respect profond :
— Sire, — dit-il, — vous êtes reconnu. Messeigneurs, ne tentez point une défense inutile ; nos ordres sont précis. Morts ou vifs, le duc mon maître vous veut avoir.
Un coup d’œil aux fenêtres convainquit en effet les voyageurs que toute résistance serait superflue. Sir Foulk d’Oyley, sir Thomas Multon et Richard Cœur-de-Lion rendirent en frémissant leurs épées.
En sortant de l’auberge ils virent, derrière la triple rangée de soldats qui allait les envelopper, la petite Égyptienne aux yeux méchants, dont leur capture était l’ouvrage. Cœur-de-Lion, toujours violent, étendit vers elle sa main gantée de fer ; mais la Zingara, conservant sur ses lèvres un sourire vindicatif :
— Souviens-toi, — lui cria-t-elle en anglais, — du drapeau de Saint-Jean-d’Acre !
Elle faisait allusion à l’ordre insolent donné par Richard de jeter dans un égout la bannière allemande, plantée sur une tour dont le duc Léopold s’était emparé.
Pour ces deux insultes, — toutes deux d’assez peu d’importance, — Richard passa quatorze mois dans la forteresse de Worms. Il fut cité devant la Diète Germanique, et obligé de répondre à des accusations de meurtre. Son royaume tout entier s’épuisa pour fournir les cent mille marcs de la rançon exigée. Entin la couronne d’Angleterre fut doublement humiliée devant le sceptre impérial et devant Philippe-Auguste ; — Cœur-de-Lion d’une part, et Jean sans-Terre de l’autre, s’étant soumis à une déclaration de vasselage[2].
N’est-ce pas le cas de reconnaître que :



UN BARBIER RASE L’AUTRE

Le théâtre représente une rue de Séville ; — une boutique peinte en bleu, — vitrage en plomb, — trois palettes en l’air, — l’œil dans la main. — Sur l’enseigne Ces mots : (Consilio manuque. Figaro, barbier.)
 IGARO, continuant un monologue commencé…
IGARO, continuant un monologue commencé…
Le grand jour est venu, mon enfant. Si tu réussis, tu plantes là ta trousse et ton cuir anglais ; tu deviens le valet d’un grand d’Espagne, son valet favori, autant vaut dire son maître. Si tu échoues, tu n’es qu’un pauvre sot, et tu restes barbier comme devant. Le caprice d’un amoureux, la fantaisie d’une petite fille prisonnière, la surveillance plus ou moins active de son vieux geôlier, toutes choses auxquelles tu ne peux rien, décideront aujourd’hui de ton sort… J’oubliais le bon vouloir de la police, qui, nonobstant sa paresse ordinaire, ne laisse pas quelquefois d’être gênante… Récapitulons ! Il me faut, ce soir, un homme dévoué pour tenir l’échelle, un alcade aveugle et des serenos[3] discrets. Il me faut encore un asile sûr, où, près d’une femme de bon renom, Rosine puisse attendre le notaire et le prêtre, si par hasard ceux-ci ne se trouvaient pas sous la main. La moindre de ces choses demanderait trois jours de recherches, et j’ai à peine trois heures devant moi ! Je le donne en vingt au plus matois des ambassadeurs… Eh ! mais, qu’est-ce donc que j’aperçois entassé contre la borne ?… Ce manteau brun, ce bâton, cette plaque… Jour de Dieu ! c’est Barcino, le plus adroit corchete[4] de la place San-Francisco… Eh ! Barcino, dors-tu, veilles-tu, maraud ?
BARCINO, se réveillant à demi.
Où va Juanica, la brune,
Lorsqu’elle sort du couvent ?
Elle ne craint pas le vent,
Mais si fait le clair de lune…
Elle ne craint pas le vent,
Mais… si… fait…
(Il se rendort)
Figaro. — Le drôle est plus ivre qu’un frère de la Capacha… Lève-toi, bête brute.
(Il le pousse du pied.)
Barcino. — Jifero[5], je te méprise… va chercher tes puces ailleurs.
(Il se rendort.)
Figaro. — Je ne le réveillerai jamais, et le pauvre diable me fait pitié. Bien qu’il ne soit pas mon père, jetons, comme la fille de Loth, un voile sur sa faiblesse.
(Il l’emporte dans son arrière-boutique.)
L’alcade, arrivant à grands pas. — Barcino ! Barcino !… Où diable se cache ce maudit sereno ?… Huit heures du matin, et pas de rapport encore !… Le corrégidor, que va-t-il dire ? à qui demander ?… Justement voici mon affaire. Seigneur Figaro ! seigneur Figaro ! je cherche le sereno du quartier ; ne l’auriez-vous point vu, par hasard ?
Figaro. — Nullement. Mais, toute la nuit durant, je l’ai bien assez entendu pour mes péchés. (Parodiant la voix de Barcino.) « Le temps est beau !… la nuit est belle !… » Pensez que j’avais un bon mal de dents, et que je donnais de bon cœur au diable votre importun crieur de nuit !
L’alcade. — Ainsi donc, après tout, le drôle n’a pas manqué à ses devoirs… Mais ce matin, ce matin, seigneur Figaro, où diable pensez-vous qu’il soit ?
Figaro. — Je l’ignore, illustre alcade ; mais je gagerais fort qu’il s’occupe de la sécurité publique. Quel brave corchete vous avez là ! Personne ne s’entend comme lui à dépister nos drôlesses, et je l’ai vu un jour, à la porte de Xerez, désarmer à lui seul six fameux rufians, dont les épées passaient la longueur voulue par les ordonnances. Je restai stupéfait devant son audace, sa résolution et sa dextérité. C’était merveille que les coups qu’il portait d’estoc et de taille, ses revers, ses parades et son œil toujours au guet pour qu’on ne le prît point par derrière. Bref, ce nouveau Rodomont mena ses ennemis tambour battant, depuis la porte en question jusques au collége de maître Rodrigo, à plus de cent pas de là. Quel homme ! seigneur, quel homme !
L’alcade, avec orgueil. — Maître Figaro, tous mes alguazils sont de la même trempe ; je me flatte d’avoir l’escouade la plus aguerrie de tout Séville. Si vous voyez Barcino, dépêchez-le-moi, je vous en prie.
Figaro. — Comptez sur moi, noble magistrat.
(L’alcade sort.)
BARCINO, passant la tête à travers la porte entrebâillée de l’arrière boutique. — Est-il parti ?
Figaro. — Sans doute, gros animal. Sa voix t’a dégrisé, ce me semble ?
Barcino. — Quelle peur j’ai eue ! et quel cierge ne vous dois-je pas ? Disposez de moi, seigneur Figaro ; la nuit comme le jour, et le jour comme la nuit, je suis à vos ordres.
Figaro. — J’y compte bien, et je t’attends ce soir au coin de la Costanilla, près de la maison du docteur Bartholo. Ne demande ni pour qui, ni pour quoi tu y dois être ; sois-y seulement, et je te tiens quitte. J’entends quelqu’un : sauve-toi.
Barcino, s’enfuyant. — J’y serai, n’en doutez pas. (Entre la Colindrès.)
La Colindrès. — Vous voyez une femme au désespoir.
Figaro. — Qui peut donc, gracieuse dame, vous troubler à ce point ?
La Colindrès. — Mon mari est un monstre, seigneur Figaro.
Figaro. — Qui cela ? l’honorable alcade ?
La Colindrès. — L’honorable alcade a passé la nuit hors de chez lui. Il trompe sa pauvre femme ; cela est certain.
Figaro. — Vraiment !… Une pauvre femme si fidèle !
La Colindrès. — Vous pouvez bien le dire. Et pour qui ?… Sans doute pour quelqu’une de ces nymphes qui vont étaler leurs grâces à la Sauceda, quelqu’une de ces loueuses de lit qu’il est chargé de surveiller.
Figaro. — Mais êtes-vous sûre, au moins, de ce que vous dites là ?
La Colindrès. — Comment voulez-vous que j’en doute ? Qui aurait pu le retenir toute la nuit hors de chez nous ?
Figaro. — Étrange jalousie des femmes !… Et si je vous disais que nous avons passé la nuit ensemble, non pas, comme vous le soupçonnez, chez quelque nymphe ou quelque loueuse en garni, mais chez le corrégidor de Séville, où nous servions l’un et l’autre de témoins ?
La Colindrès. — De témoins ? à quoi ?
Figaro, gravement. — Ceci, Madame, est un secret d’état ;… et je me repens déjà d’en avoir trop dit. Mais croyez-moi, votre mari n’est pas coupable… Qu’avez-vous donc à pâlir et à regarder ainsi du côté de la rue ?
La Colindrès. — Seigneur Figaro, défendez — moi… cachez-moi, seigneur Figaro ! Je suis une femme morte.
(Elle se jette dans l’arrière-boutique.)
(Entre la Chicharona.)
La Chicharona. — Elle est ici ; on m’a dit qu’elle était ici. Par le ciel, ne m’arrêtez pas ! Je veux lui arracher les yeux, lui déchirer le visage ; de ce couteau, je veux la marquer au front.
Figaro. — Malepeste, quelle fureur ! Charmante gitana, qui donc cherchez-vous ainsi ?
La Chicharona. — Tu le sais bien, maudit barbier ; c’est madame l’alcade, c’est cette Colindrès de malheur. Où se cache-t-elle ? Je la veux anéantir !
Figaro. — Tout doux, tout doux, ma belle amazone ; prenez garde à mes carreaux, et ne gesticulez point de la sorte. Je n’ai jamais, que je sache, logé madame Colindrès. Mais, pour Dieu, que vous a-t-elle fait ?
La Chicharona. — Ce qu’elle m’a fait ! Elle veut me prendre ce que j’ai de plus cher. Elle écrit des billets doux à mon brave toréador. Jour de Dieu ! Don Ramon n’est pas pour elle. Mais c’est assez qu’elle y ait songé ; je l’arrangerai de la belle sorte. Encore une fois, où est cette femme ?
Figaro. — Je n’en sais, ma foi, rien… Cependant vous m’étonnez fort, Chicharona, et j’aurais soupçonné quelque autre belle d’en conter à Don Ramon.
La Chicharona. — Une autre ! dites-vous. Et qui cela, s’il vous plaît ?
Figaro. — J’ai là-dessus mes petites idées… (Feignant de se raviser.) Ce billet dont vous parlez, l’avez-vous encore ?
La Chicharona. — Sans doute. Je l’ai gardé pour le faire avaler à celle qui l’a écrit.
Figaro.— Voyons-le, par grâce. (Elle le lui donne. — Après l’avoir parcouru :) Justement… Je ne m’étais pas trompé.
La Chicharona, étonnée. — Quoi ? comment ?… Cette femme… ce n’est pas ?…
Figaro. — Au contraire : c’est celle que je pensais… Prenez garde, Chicharona, la colère vous aveugle, ma bonne amie.
La Chicharona, indécise. — Mais Don Ramon lui même avait l’air de dire…
Figaro. — Ah ! Don Ramon avait cet air-là… Je vous plains, Chicharona. Don Ramon trame quelque perfidie : il cherche à détourner vos soupçons.
La Chicharona. — Vraiment ! si je le croyais !… Au surplus, je le saurai bientôt.
(Elle sort en courant.)
Figaro, riant aux éclats. — Gare à toi, Don Ramon, et pare cette botte. (À la Colindrès) : Vous pouvez sortir, Madame, la tempête est déjà loin.
La Colindrès, encore toute émue. — Seigneur Figaro, je vous dois l’honneur, et peut-être la vie… Un esclandre public… une marque ignominieuse… Oh ! dites-moi, ne puis-je rien pour m’acquitter ?
Figaro. — Si fait, certes. (À voix basse) : Cette nuit, chez vous…
La Colindrès, offensée. — Que signifie…
Figaro, souriant. — Non, vous vous trompez ; je sais fort bien que je ne suis pas Don Ramon… Cette nuit, chez vous, disais-je, il faudra donner asile, pour quelques heures seulement, et dans le plus grand secret, à une jeune fugitive que je protége.
La Colindrès, étonnée. — Mais vraiment, Figaro, j’ignore… si…
Figaro. — Vous oubliez que sans moi, tout à l’heure…
La Colindrès, vivement. — Non, non… Je veux, je dois me montrer reconnaissante… À cette nuit donc.
Figaro. — Jusque là, motus !
(Elle sort. — Après un instant l’alcade parait au bout de la rue.) Figaro. — Et de deux ! Maintenant faisons savoir à l’alcade… Oh ! justement, voici ce majestueux personnage… Seigneur alcade, deux mots.
L’alcade. — Que me voulez-vous, seigneur barbier ?
Figaro. — Où passâtes-vous la nuit dernière ?
L’alcade. — Plaisante question ! Et de quel droit ?…
Figaro. — Vous avez raison, et peu m’importe. Que ce soit chez Dolorès ou chez Loaïsa, chez Mari-Alonzo ou chez Léonor, cela ne me regarde en rien ; mais ce qui m’importe, et à vous aussi, c’est de n’être pas démenti dans un petit conte que je viens de faire à madame votre épouse.
L’alcade, troublé. — Ma femme !…
Figaro. — Elle vous cherchait tout à l’heure. Votre absence nocturne lui avait mis la puce à l’oreille, et sans le soin que j’ai pris de la rassurer…
L’alcade. — Ah ! seigneur Figaro, quel signalé service !
Figaro. — Comment donc, seigneur alcade, il se faut bien entr’aider quelque peu. Sachez, pour votre gouverne, que nous avons passé la nuit entière chez le corrégidor. Nos motifs doivent rester secrets. Tenez-vous-en à cette explication, que j’ai donnée sous la foi du serment. Maintenant, seigneur, si cette nuit, à l’heure des sérénades, vous aperceviez votre dévoué serviteur en bonne fortune… si vous le trouviez, par exemple, sous les fenêtres du docteur Bartholo, prêt à monter chez… chez la duègne Marceline… J’espère…
L’alcade, souriant. — Il suffit. Nous nous comprenons à merveille. Vous m’avez fait la barbe…

Figaro. — Et vous me ferez le toupet. C’est exactement cela. Il est entendu dans ce bas monde que qui se sent en faute, trouve intérêt à excuser les péchés de son voisin, et que, suivant le proverbe,


À L’AMOUR ET AU FEU
ON S’HABITUE.

— Fais comme moi, imbécile !
— J’ai trop peur.
— Peur d’une fillette de seize ans ! Je rougis d’être ton cousin, Alain.
— Mais, mon cher Léveillé…
Habit de futaine grise et cœur sensible, bas chinés et vingt ans, guêtres nankin, chapeau rond placé en arrière, yeux bleus, cheveux blonds ; au-dessus de la lèvre supérieure un petit signe qui indique qu’il est amoureux de mademoiselle Annette : voilà Alain.
Rappelez-vous les pièces de Favart, si vous tenez à vous faire une idée de Léveillé, de mons Léveillé, comme on disait au xviiie siècle. Voix sonore, gestes gracieux, visage empourpré, œil émerillonné, jarret solide ; vous le reconnaîtriez entre mille. Saluez en sa personne le gars, le bon drille, le coq de village. Quel Don Juan que ce Léveillé ! N’est-ce pas de lui que M. le bailli disait l’autre jour : « Comment voulez-vous qu’il y ait des rosières dans le canton ? il cueille toutes mes roses ! » Cependant M. le bailli tiendrait beaucoup à couronner des rosières ; c’est le faible de tous les baillis.
Alain est amoureux fou de mademoiselle Annette ; il n’a plus le cœur à rien, ni à servir la messe à M. le curé, ni à chanter au lutrin, ni à écouter les contes du soir à la veillée ; il passe et repasse sans cesse devant la fenêtre d’Annette ; en levant la tête, il rougit ; si elle est sur sa porte, il s’enfuit.
L’autre jour il l’a rencontrée comme elle entrait dans l’église ; c’est à peine s’il a eu la force de lui dire : Bonjour, mademoiselle Annette. Elle, pourtant, lui a répondu d’un ton fort encourageant : Bonjour, monsieur Alain ! — Ah ! si l’on vendait des philtres pour se faire aimer ! À quels moyens ont-ils eu recours ceux qui jouissent de ce bonheur ? Parbleu ! il faut que je le demande à mon cousin Léveillé.
Ce matin même, Alain est allé trouver Léveillé, et ils ont eu ensemble une conversation dont nous venons d’entendre les dernières phrases. Léveillé a développé devant son cousin tout son système de séduction. Quand on veut faire la cour à une femme, on commence par la regarder bien tendrement, puis on essaie de lui parler ; si elle répond, on lui serre la main, et on soupire. Si le lendemain est un dimanche, on lui présente des fleurs et on l’invite à la danse. Le matin, quand elle conduit ses moutons au pâturage, on se trouve comme par hasard dans la prairie, on entame l’entretien par quelque flatterie adroite ; on s’asseoit auprès d’elle, on lui dit : Je vous aime, et on lui prend un baiser.
C’est à cet endroit de la leçon qu’Alain s’est écrié : Je n’oserai jamais !
Ne jamais oser ! Charmante conviction de la jeunesse, naïveté, candeur, timidité de l’adolescence, les premiers feux de l’aurore ont moins de grâce que vous ! Léveillé, lui aussi, a cru qu’il n’oserait jamais ; il a eu peur, il a reculé devant un premier baiser ; mais depuis… Pourquoi Alain ne serait-il pas comme lui ? pourquoi ne s’habituerait-il pas à l’amour ? Il n’en sait rien lui-même. Le fait est qu’Annette vient de passer tenant son fuseau à la main ; ses brebis la suivent ; elle se dirige vers le petit bois qui borde la rivière. L’occasion est belle, Léveillé ne manquerait pas d’en profiter ; mais Alain se souvient que c’est l’heure où M. le curé l’attend ; il s’enfuit, il plante là son professeur. Essayez après cela d’apprendre l’amour aux jeunes gens.
M. le bailli s’est rendu de grand matin chez la mère d’Annette ; il roule une grande pensée sous sa perruque à marteaux ; sa figure est soucieuse, sa démarche solennelle ; il se drape majestueusement dans son manteau de serge noire ; il médite deux choses importantes, une rosière et un discours pour l’arrivée du seigneur. Le discours aura son tour ; il a bien trouvé la rosière.
— Bonjour, mère Simonne, dit-il en entrant.
— Dieu vous garde ! monsieur le bailli.
— Je viens vous apporter une bonne nouvelle. Le seigneur arrive dans un mois ; il nous faut à tout prix une rosière : j’ai choisi votre fille.
— C’est beaucoup d’honneur pour nous, monsieur le bailli.
— Dites-moi, mère Simonne, n’avez-vous jamais vu personne rôder autour de votre fille ? c’est que, voyez-vous, je suis très-sévère en fait de rosières, et si…
La mère Simonne allait répondre, lorsque tout-à-coup un bruit de tambour se fait entendre : Plan, ran, plan, plan, ran, plan. C’est le sergent Latulipe qui arrive à la tête de son escouade ; de beaux grenadiers, ma foi ! habits et pantalons blancs, revers bleus, le tricorne fièrement posé, la queue bien faite et les cheveux soigneusement poudrés. Tout le village s’est levé pour les voir passer.
Latulipe donne le mot d’ordre au bailli ; il vient dans le pays pour le recrutement. Le roi a besoin de beaucoup de grenadiers ; on se bat dans le Palatinat ; qui ne brûlerait de partager les dangers des défenseurs de la patrie ? Latulipe compte sur la bonne volonté de la jeunesse et sur l’assistance des cavaliers de la maréchaussée.
Le bailli a remis des billets de logement à la troupe ; Latulipe tiendra garnison pour le moment chez la mère Simonne. Imprudent bailli, qui va loger le plus galant des sergents chez la plus jolie des rosières ! Qui ne connaît le fameux Latulipe ? l’histoire est pleine de ses exploits militaires et galants ; une chanson les a transmis à la postérité, chanson touchante dont le dernier couplet arrache des larmes. Lalulipe s’adresse à son amante :
|
Tiens, serre ma pipe, |
À cette époque Latulipe ne songeait nullement à faire le noir trajet, et tout porte à croire qu’il ne connaissait pas encore cette Manon qui lui inspira plus tard de si éloquents adieux.
Le sergent n’a que trois jours à passer dans le village ; mais aussi comme il les emploie ! Ce sont sans cesse de nouveaux compliments, de nouvelles galanteries à Annette ; il lui donne le bras, il l’accompagne aux champs, il danse avec elle. Pauvre Alain ! il souffre, il est jaloux ! On dirait qu’Annette prend plaisir à se montrer à ses yeux en compagnie du sergent. Alain souffre tant, qu’il oublie qu’il est forcé de partir, que la loi l’oblige sous peine des galères à devenir un héros.
— Puisque tu pars, lui disait Léveillé, c’est le moment de te déclarer.
Alain répondait par son refrain ordinaire : Je n’oserai jamais.
Cependant le jour du départ est venu. Les grenadiers sont rangés en bataille sur la grande place ; derrière eux se tiennent les recrues. Les mères, les sœurs, les fiancées se désolent : encore un baiser, un dernier serrement de main ; le signal est donné, le tambour bat ; en avant, marche ! Latulipe, en passant devant la maison d’Annette, lui porte les armes. La jeune fille pleure, le sergent croit que ces pleurs sont pour lui ; mais elle a regardé Alain. En ce moment celui-ci se serait senti le courage de risquer un aveu ; mais il est trop tard, le clocher du village disparaît, les conscrits lui disent un dernier adieu du haut de la colline. Qui sait s’ils reviendront ? Voilà la triste réflexion qu’ils font tous en ce moment. Quant au sergent Latulipe, il n’a qu’un seul regret, c’est de quitter si tôt Annette ; mais bah ! n’aurait-il pas été obligé de la respecter ? le bailli ne l’avait-il pas averti qu’en sa qualité de rosière la jeune fille était propriété du gouvernement ?
Quelques mois après le départ d’Alain, Léveillé reçut de lui une lettre ainsi conçue :
Depuis mon arrivée au régiment, je n’ai pas trop à me plaindre ; nous sommes en Alsace ; le pays est bon, et les femmes jolies ; nous avons des vivres et de l’amour à discrétion : je serais presque heureux, si je pouvais oublier Annette. Après elle une chose m’inquiète, c’est de savoir l’effet que fera sur moi ta première grande bataille. J’ai vu le feu une fois, et je n’étais pas très-rassuré. Le sergent Latulipe, qui me protège, prétend que je m’y habituerai, et que je finirai par obtenir les galons comme lui. C’est égal, si mon oncle voulait me faire remplacer, j’en serais charmé. Adieu, mon cher cousin, donne-moi de tes nouvelles et de celles d’Annette ; il me semble que maintenant j’oserais lui prendre un baiser.
Ton cousin pour la vie,
Chantons ! dansons ! la paix est signée ; c’est fête au village ; le seigneur va arriver. Le bailli a terminé sa harangue, la rosière est prête. Ne vous étonnez pas qu’Annette soit restée sage si longtemps ; grâce à Léveillé, elle a connu l’amour d’Alain, elle lui a fait écrire qu’elle l’attendrait, qu’elle ne serait jamais qu’à lui. Quelle joie, pensait Annette, s’il pouvait assister à la cérémonie ! Ô surprise ! ô bonheur ! le voilà, c’est lui ! son oncle lui a acheté un homme. Comme l’habit militaire lui va bien ! Il tombe aux genoux d’Annette, il veut l’embrasser ; heureusement le bailli survient : Attendez au moins, lui dit-il, qu’elle ne soit plus rosière.
Un nuage de poussière s’élève sur la route ; on entend le galop d’un cheval : C’est monseigneur ! s’écrie le bailli, et il s’élance pour le recevoir.
C’était un courrier qui venait annoncer que, monseigneur ayant été mis à la Bastille pour avoir fait un calembour contre madame de Pompadour, ses vassaux seraient privés de sa présence.
Le lendemain Annette épousa Alain. Le pauvre bailli se trouva sans rosière : heureusement monseigneur était en prison.
La chaumière d’Alain devint la maison à la mode ; c’est chez lui que les notables allaient passer les longues soirées d’hiver ; son esprit s’était singulièrement développé au



COMME ON FAIT SON LIT
ON SE COUCHE

 ette maxime ne tend à rien moins qu’à nous faire envisager l’humanité comme un vaste dortoir en désordre. Pour une couchette bien entendue, dont les oreillers sont à leur place, dont la couverture est chaude et moelleuse, dont les rideaux, artistement fermés, arrêtent l’éclat du jour, sans gêner la circulation de l’air, combien de coussins disposés à contre-sens, et mettant le corps à la gêne ! Combien de matelas inégaux et qui semblent rembourrés d’épines ! Combien de lits mal faits, en un mot, et combien de gens dorment fort mal !
ette maxime ne tend à rien moins qu’à nous faire envisager l’humanité comme un vaste dortoir en désordre. Pour une couchette bien entendue, dont les oreillers sont à leur place, dont la couverture est chaude et moelleuse, dont les rideaux, artistement fermés, arrêtent l’éclat du jour, sans gêner la circulation de l’air, combien de coussins disposés à contre-sens, et mettant le corps à la gêne ! Combien de matelas inégaux et qui semblent rembourrés d’épines ! Combien de lits mal faits, en un mot, et combien de gens dorment fort mal !
Damis, — brave et digne garçon d’ailleurs, — est remarquable par son excessive paresse. Le sort l’avait doué d’un patrimoine borné, mais suffisant aux besoins d’une existence comme la sienne, aux exigences d’une imagination tranquille et inerte. Damis pouvait vivre heureux en province, entre un carré de tulipes et une volière, raclant à loisir quelques mélodies sur la guitare, et rimant des madrigaux pour les Cydalises de l’endroit. Mais point du tout. Damis est venu à Paris ; il a voulu s’assurer les moyens d’y vivre sans profession ; il s’est jeté à l’étourdie dans la carrière des spéculations industrielles, celle-là même qui réclame les soins les plus assidus, et où son indolente nature, aux prises avec des luttes quotidiennes, devait lui valoir des revers quotidiens. Qu’est-il arrivé ? Sa modique fortune s’est perdue. Le petit avoir, qu’il devait, avant tout, s’appliquer à conserver, il l’a détruit en voulant l’accroître. Ce qu’il a fait dans l’intérêt de sa paresse, a tourné contre elle. Aujourd’hui Damis est soldat. Il se lève bien avant le soleil, travaille plus que l’ouvrier le plus laborieux, et pour quel salaire, et avec quelle espérance ! Damis reconnaît trop tard aujourd’hui qu’il s’est trompé sur son aptitude et sa vocation. Cette erreur lui coûtera le bonheur de toute sa vie ; — il a mal fait son lit ; il est mal couché.
Voyez au contraire l’impétueux Cléon. À celui-là convenait l’air parisien. Cléon ne dort jamais ; son imagination, fiévreuse et créatrice, enfante chaque jour de nouveaux projets. Rien qu’à voir son regard si vif, rien qu’à suivre sa parole si animée, vous reconnaissez l’homme énergique, fait pour vivre à son aise au sein des plus terribles agitations. Cléon serait à sa place sur le tillac d’un navire, commandant la manœuvre par un gros temps. Cléon serait encore à sa place dans la tribune parlementaire, un jour de crise politique. Jetez Cléon sur la voie des grandes spéculations ; il n’en est pas une dont la conception lui échappe, ou qui, par la multiplicité des travaux qu’elle exige, dépasse les forces de ce courageux athlète. Mais Cléon, mal inspiré certain jour, s’est persuadé qu’il pouvait vivre heureux dans un pauvre bourg du Finistère. Il s’y est laissé clouer par un sot mariage et par l’achat d’une misérable étude. Le sort en est jeté ; à moins de prendre une de ces résolutions héroïques, dont la responsabilité glace les plus entreprenants, il faudra que Cléon dévore jusqu’au bout sa noble ardeur, qu’il ronge son frein en silence, et qu’il restreigne son génie aux proportions mesquines de quelques menus procès, de quelques transactions vulgaires. Il se sent déplacé dans cette sphère étroite ; il s’y désole, il s’y tourmente ; il dépense en caprices et en accès d’humeur le superflu de sa force ; il fatigue les autres et lui-même de sa vitalité surabondante. Il faudrait raccourcir ce géant, pour qu’il tînt à l’aise dans son lit de Procuste.
Un lit mal fait, c’est encore celui où notre grand Molière étend l’infortuné Georges Dandin. Qu’avait besoin ce brave bourgeois de prendre pour femme une Sotenville ? La famille des Dandin, — cette honnête famille, — méritait-elle une pareille disgrâce ? Mais tu l’as voulu, pauvre sot ! Dans une folle envie de blasonner ton lignage et d’anoblir, — par le ventre, — ta postérité, ta cervelle s’est fourvoyée. Ce qui s’ensuit, vous le savez tous : les dédains du beau-père, les sottes prétentions de la belle-mère, — une La Prudoterie, — et le tendre penchant de la belle Angélique pour monsieur le vicomte de Clitandre. Bref, tous les détails de cette farce immortelle sont encore présents à votre esprit. Or, vous le savez aussi, Dandin, tout malheureux qu’il est, ne fait grand’peine à personne. Personne, il est vrai, ne voudrait de son lit… Mais, après tout, pourquoi l’a-t-il si mal fait ? c’est-à-dire si mal meublé ? — Georges Dandin, tu l’as voulu, ne t’en prends à d’autres qu’à toi-même.
Or, n’avons-nous pas de nos jours quelques Georges Dandin femelles ? En cherchant bien, ne trouverions-nous pas quelque fille de banquier dont l’immense dot ait servi à fumer les terres obérées d’un patricien déconfit ? Demandez lui, à celle-là, dans quels beaux draps elle s’est mise ? Peut-être la surprendrez-vous dans un de ces rares moments où débordent les cœurs abreuvés d’outrages, et vous verrez alors par quelles humiliations elle expie le droit de se montrer au Bois, dans une calèche armoriée. Elle vous racontera de quel air on lui fait place dans les salons exclusifs où elle a voulu pénétrer ; elle vous dira les froides impertinences des vieilles douairières et des jeunes marquises, les grands airs de son noble époux, et jusqu’aux mépris de ses gens, très forts sur les distinctions héraldiques. Elle vous les dira, et vous ne trouverez pas en vous plus de compassion pour cette frêle victime que pour le gros Dandin de Molière : « Cela fait pitié », dit-on quelquefois de la vanité punie ; mais ne vous y trompez pas, et ne prenez jamais au pied de la lettre cette locution méprisante.
Revenons à notre proverbe qui parfois change aussi d’acception. Faire son lit, s’entend aussi bien de « veiller à ses intérêts » que « d’arranger sa vie. »
Si votre nom a du crédit, et si vous en décorez les prospectus séduisants d’une commandite, vous faites votre lit en vous assurant un bon nombre d’actions à bas prix ; vous vous coucherez ensuite sur des bénéfices, plus ou moins douillets, suivant qu’ils sont plus ou moins gros.
De même encore, cinquième auteur d’un vaudeville productif, vous en ferez un lit excellent si, par quelque ingénieux stratagème, vous savez évincer de leurs droits vos quatre collaborateurs moins bien avisés que vous. Comptez en pareil cas sur leur rancune ; mais comptez aussi sur leur estime : — Il sait son pain manger, dira l’un : — C’est un fin compère, ajoutera l’autre ; il a toujours la part du lion : — Personne ne tire mieux la couverture à soi, reprendra le troisième. Et, tout en se promettant d’être mieux sur ses gardes à l’avenir, le dernier déduira de sa mésaventure quelque morale proverbiale dans le goût de celle-ci :


LA PELLE
NE DOIT PAS SE MOQUER DU FOURGON

 e sentais que cette mission était délicate ; mais enfin je l’avais acceptée, et il fallait m’exécuter de bonne grâce. Je fis donc atteler, l’autre matin, et je commençai mon voyage dans le domaine de la critique.
e sentais que cette mission était délicate ; mais enfin je l’avais acceptée, et il fallait m’exécuter de bonne grâce. Je fis donc atteler, l’autre matin, et je commençai mon voyage dans le domaine de la critique.
Le début de ce voyage fut marqué par un accès d’impatience, lorsque, tiré tout à coup d’une distraction profonde, je m’aperçus que nous faisions fausse route. Mon cocher, que je dirigeais vers la rue de la Victoire, n’avait pas voulu paraître ignorer le gisement topographique de cette rue, et, du quartier de la Madeleine, m’avait déjà égaré jusqu’à la place de la Bourse.
Une explication s’ensuivit, que ma brusquerie rendit sans doute fort désagréable pour mon vieux Thibaut ; car il se renferma aussitôt dans cette stupidité obstinée qui est la dernière ressource des domestiques poussés à bout, l'ultima ratio de la servitude humiliée.
— Comment pouvais-je savoir, me demanda-t-il en ouvrant de grands yeux, que Monsieur voulait aller rue Chantereine ?
— Vous l’auriez su, nigaud, si vous saviez…
… J’allais ajouter : l’histoire de France, — pensant à Napoléon, à son retour d’Égypte et au 18 brumaire ; mais je me repris à temps pour ne pas lâcher la bévue qui, déjà commise dans mon esprit, errait au bord de mes lèvres :
— Si vous saviez, repris-je… tout ce que vous devez savoir.
Thibaut ne répliqua rien, tourna bride, et nous arrêtâmes bientôt devant la porte que j’avais désignée. Une fois là, au lieu d’ouvrir la portière de droite qui donnait sur le trottoir, j’ouvris celle de gauche, donnant sur la rue, et le résultat de cette fausse manœuvre fut assez déplorable. Un cabriolet, qui arrivait au grand trot derrière nous, vint donner en plein dans le battant poussé si mal à propos, et du choc, le mit en capilotade. Fort heureusement pour moi, je n’étais point encore sorti du coupé, ce qui m’épargna une assez triste aventure. En revanche, il fallut subir une bordée de reproches et d’injures que m’envoya le conduc

La destinée a ses retours. Lorsque cet Automédon malencontreux, la discussion épuisée, voulut reprendre sa route du même train qu’auparavant, son cheval vint à manquer des pieds de devant, et s’agenouilla brusquement sur le pavé. Le cocher fut lancé, comme une bombe, par-dessus sa bête, et s’il n’avait rencontré fort heureusement, à l’extrémité de sa périlleuse parabole, deux ou trois bottes de paille, placées là par une divinité favorable, il se fût infailliblement brisé les membres.
En le relevant, je ne résistai pas à la tentation de lui restituer la semonce qu’il m’adressait trois minutes auparavant, et je pérorai fort longuement sur l’imprudence qu’on met à ne pas fermer les crochets qui retiennent le tablier d’un cabriolet, quand on n’est pas sûr du cheval qui le mène.
Tandis que je développais ce texte avec une remarquable éloquence, je crus surprendre un sourire sur les lèvres de mon cocher, lequel, en ce moment, se livrait, je le soupçonne, à des rapprochements satiriques. Il lui semblait plaisant que j’eusse commis une grave étourderie, immédiatement après l’avoir si vertement tancé sur son ignorance, et qu’à mon tour, vivement repris par un orgueilleux censeur, j’eusse pu rendre à ce dernier, séance tenante, son aigre homélie.
Si je devinai juste en interprétant ainsi le sourire narquois de mon vieux Thibaut, c’est ce que mes lecteurs décideront dans leur sagesse. Quant à moi, sans m’en informer autrement, je montai chez le magistrat littéraire à qui j’allais rendre visite.
En attendant qu’il congédiât un visiteur matinal, qui, me dit-on, m’avait prévenu, son valet de chambre me remit un faix de journaux dont machinalement je rompis les bandes. L’un d’eux renfermait une critique des plus excessives, justement dirigée contre l’aristarque dont j’attendais le loisir. À propos d’un roman qu’il venait de mettre au jour, certain auteur rancunier, jadis fustigé par lui, s’évertuait à démontrer — la critique de nos jours est passablement envahissante — que mon ami n’avait ni invention, ni style, ni esprit, ni bon sens, ni cœur, ni conscience. Bref, l’attaque était de telle nature que je me promis bien de ne l’avoir jamais lue, et par un sentiment de charité irréfléchie, je la glissai lestement dans la poche de mon paletot.
Au même instant, l’aristarque apparut, dans toute la sérénité de sa puissance :
— Ah ! vous voilà, très-cher ! Je devine ce qui vous amène. Vous venez m’implorer pour vos Trois Tètes et pour leurs Proverbes… À merveille ; vous savez que je suis bon prince… Mais, entre nous, convenez que c’est là une plaisante idée… Des proverbes ?… qui se soucie maintenant de proverbes ?… Cent Proverbes… pourquoi cent Proverbes ? Cent et un, je ne dis pas… Et ces Trois Têtes… on dira qu’elles n’ont pas de l’esprit comme quatre… Quant à Grandville, à la bonne heure… Encore nos Athéniens se lassent-ils de ses succès, comme cet autre se lassait de la probité d’Aristide… Allons, soyons francs… Nous n’en dirons rien mais le livre est manqué… Les auteurs, gens d’esprit, prendront leur revanche… Embrassons-nous et qu’il n’en soit plus question… si ce n’est pour les accabler d’éloges…
Ce flux de paroles dédaigneuses ne m’avait pas laissé le temps de placer un seul mot. Tout à coup, vers la fin de la désobligeante apostrophe, il me vint une idée lumineuse : je tirai de ma poche la critique dont j’ai parlé ; puis, sans autre explication, je la plaçai sous les yeux de l’aristarque.
Dès les premières lignes, son visage changea d’expression : sa bouche souriait encore, il est vrai ; mais son regard démentait ce sourire sardonique, et, bien que décochés par une main malveillante, tous les traits de cette boutade injuste arrivaient droit à leur but. Il avait commencé par saluer d’un bravo désintéressé les épigrammes les plus mordantes, les plus amères attaques : mais peu à peu ce faux sang-froid disparut, et fut remplacé par un dépit plus sincère. Mon homme balbutia quelques plaintes inintelligibles contre l’injustice des hommes, la malveillance de parti pris, etc… mais s’apercevant qu’il frisait le ridicule :
— N’en parlons plus, s’écria-t-il, et revenons à vos Proverbes. Je vous promets de les lire…
— Vous ne les avez donc pas lus ?
— Non vraiment. Cela vous étonne ?
— Votre opinion si bien arrêtée me faisait croire…
— Ah bah !… Propos en l’air. Pures fadaises. N’y faites pas attention.
Bref, l’aristarque se montra tout à coup plus modeste et plus consolant. Je le quittai, très-certain qu’il apporterait à sa besogne beaucoup plus de modération et d’équité qu’il ne l’aurait fait sans la mortification imméritée qu’on lui avait infligée.
Le soir même, au théâtre de ***, on jouait un vaudeville de l’écrivain rancunier. Je le rencontrai sur le boulevard, tout rayonnant encore de sa malice du matin. Il jouissait de son triomphe, il chantait son article aux échos, il dansait en idée sur le corps de sa victime, avec une férocité de cannibale. On aurait perdu sa peine à lui prêcher en ce moment la concorde et la charité chrétienne : aussi me gardai-je bien de lui adresser le plus léger reproche.
Mais deux heures après, sur ce même boulevard, ce cannibale était devenu la plus douce brebis de l’univers. Il était tout oreilles à mes conseils, tout humilité devant mes reproches. Si je l’eusse exigé de lui, j’aurais obtenu telle amende honorable qu’il m’eût plu de prescrire… Le vaudeville nouveau venait d’être sifflé à plate couture.
Je me contentai d’un petit sermon, aussi indulgent que possible, dans lequel je m’efforçai de faire comprendre à l’auteur sifflé, combien, dans ce monde où chacun tombe à son tour, la morale évangélique est salutaire et bonne. À ce sujet je lui racontai les divers incidents de ma course du matin, tels à peu près qu’on vient de les lire.
Il sourit autant que son malheur lui permettait de sourire, et avec sa sagacité de littérateur à l’affût :
— Ne pensez-vous pas, me dit-il, que notre journée a pour moralité un de ces Proverbes dont vous parlez ?
— Bah ! m’écriai-je ; en ce cas, vous le ferez, n’est-il pas vrai ?
— Merci, répondit-il. Faites-le vous-même, donnez-lui pour titre :
Et puissent tous vos lecteurs tenir compte de cette recommandation bénigne.
Son conseil me parut bon ; il a été mis à profit. Avis à toutes les pelles du royaume.


LA FIN
COURONNE L’ŒUVRE

 près avoir fraternellement vécu pendant un an sous le même bonnettes Trois Têtes que le crayon de Grandville a représentées sur le frontispice de ce volume, se dirent l’une à l’autre :
près avoir fraternellement vécu pendant un an sous le même bonnettes Trois Têtes que le crayon de Grandville a représentées sur le frontispice de ce volume, se dirent l’une à l’autre :
— Le moment est venu d’abandonner le logis commun, et de reprendre chacune notre chapeau. Nous allons nous séparer ; mais avant de nous dire adieu, il convient de méditer ensemble le couplet final que nous adresserons au public. Il nous faut quelque chose de neuf, d’éblouissant, enfin un bouquet digne de ce feu d’artifice d’esprit en cinquante livraisons que nous venons de tirer pour le plus grand amusement des lecteurs. Que pensez-vous d’un compliment en vers ?
— C’est bien usé, répondit la seconde Tête ; d’ailleurs les compliments en vers ne se font que pour les inaugurations.
— Si nous écrivions une post-face ! « Ce livre que vous venez de lire, Messieurs et Mesdames, est l’histoire abrégée de l’humanité. Qu’est-ce que le proverbe, sinon l’expression la plus élevée de la philosophie ? La philosophie elle-même n’est-elle pas la connaissance de l’homme ? Or, le proverbe c’est l’humanité. Remarquez en effet comme dans ce volume tout prend une voix, une forme, un sens : financiers, bourgeois, oiseaux, quadrupèdes, Chinois, Français, Italiens, Grecs, Allemands, gens de tous les pays, de toutes les nations, de toutes les époques, tout le monde vit à la fois de la même vie et parle la même langue, celle du bon sens. Ce livre manquait à l’univers, l’univers ne manquera pas à ce livre ; mais qu’on nous permette de développer notre pensée… »
— Assez de développements comme cela, dit à son tour la troisième Tête ; je ne connais rien de plus ennuyeux qu’une préface, si ce n’est une post-face : personne ne la lit.
— Bornons-nous alors à solliciter l’indulgence du public…
— Daignez excuser les fautes de l’auteur ? c’est trop rococo. Paix aux vieilles formules, ne faisons pas la palingénésie des théâtres forains.
— Il me vient une idée, s’écria la première Tête.
— Voyons, dirent les deux autres.
— Il y a une lacune dans notre livre.
— Laquelle ?
— Récapitulez tous les proverbes ; ne voyez-vous pas ce qui leur manque ?
— Quoi donc ?
— Un proverbe sanscrit.
— Parbleu, vous avez raison ; mais vous n’apercevez pas une lacune bien plus importante encore ?
— Ma foi, non.
— Relisez la liste des proverbes. Outre le proverbe sanscrit, que leur manque-t-il ?
— Je l’ignore.
— Un proverbe persan.
— Le proverbe sanscrit est bien plus important ; regardez comme celui-ci est joli : « La simplicité plaît à la grandeur ; la paille attire le diamant. »
— Pour la grâce et la fraîcheur rien ne vaut le proverbe persan ; tenez, que pensez-vous de celui-là : « Pour chaque rose, une abeille et un frelon ? »
— Il faut consacrer les dernières pages qui nous restent au proverbe sanscrit ; cela donnera du poids à notre livre.
— Présentons au lecteur en finissant l’odorant bouquet de la sagesse persane ; elle laissera son parfum dans tous les esprits.
— Je tiens pour le sanscrit.
— Je ne démordrai pas du persan.
— Messieurs, reprit la Tête qui avait parlé la troisième, il me semble, sauf meilleur avis, que votre prétention est

Qui chacun assomme et tue.
Mais la seule vertu qui fait leur différence.
Chaque proverbe est prophète en son pays. Vous parlez de lacunes, mais à quoi bon chausser les bottes de sept lieues pour en trouver ? ne prenez pas la peine de franchir l’océan ; restez chez vous ; jetez les yeux sur ces feuilles éparses ; votre collection est-elle complète ? aucune gerbe ne manque-t-elle à votre moisson ? Je ne vous parle ni de la Perse, ni de l’Indostan, ni de l’Afrique, ni de l’Amérique, mais de la France seulement. Pensez-vous avoir épuisé toutes les maximes de la sagesse populaire ? Que de recoins inexplorés ! que de proverbes oubliés !
« Couche-toi sans souper, tu te lèveras sans dettes : » précepte d’Harpagon prêchant l’économie.
« Vie sans amis, mort sans témoins : » condamnation de l’égoïsme.
« Qui mange la vache du roi maigre, la paie grasse : » raillerie hardie de Jacques Bonhomme contre les exactions seigneuriales.
« L’ami par intérêt est une hirondelle sur les toits : » charmant symbole des relations du monde.
« Vin maudit vaut mieux qu’eau bénite : » aphorisme rabelaisien.
« Fais-moi la barbe, et je te ferai le toupet : » devise qui pourrait servir à la littérature contemporaine.
« Qui trébuche et ne tombe pas, ajoute à son pas : » adage prudent qui a dû prendre naissance au temps de Louis XI.
« La gouttière creuse la pierre. » Aujourd’hui l’on dit : « La patience c’est le génie : » traduction qui ne vaut pas le texte.
« Qui répond ne parle pas : » qu’on pourrait appliquer à bien des ministres.
« Le hareng qui saute de la poêle tombe sur le charbon ; » « au gueux la besace : » témoignages de la fatalité qui pèse sur le faible.
« Eau répandue ne se ramasse pas toute : » amer regret de la stérilité du repentir après certaines fautes.
« Au fer la rouille, à l’homme l’ennui : » métaphore qu’on dirait sortie du cerveau de René ou d’Obermann ; antithèse qui prouve que le désenchantement, que nous croyons avoir inventé, est vieux comme le monde.
« À l’ennemi mort, un coup de lance : » le courage du fanfaron ; coup de patte à l’homme du lendemain.
« Qui bien aime, tard oublie : » attestation touchante donnée à l’amour par un cœur malheureux.
« Là où le fleuve est plus profond, il fait moins de bruit : » symbole des grands desseins et des grandes passions.
« Loin des yeux, loin du cœur : » vérité contre laquelle on proteste quand on aime.
« De poltron à poltron, qui attaque bat. » — « Donne-moi pour m’asseoir, et je prendrai bien pour me coucher. »
— « Qui mesure l’huile, se graisse les mains. » — « La femme est comme la botte, la meilleure est celle qui se tait. » — « Qui se garde de l’occasion, Dieu le garde du péché. » — « Si ta femme est mauvaise, méfie-toi d’elle ; si elle est bonne, ne lui confie rien. » — « Chaque cheveu fait son ombre. » — « Il n’y a pas de mauvaise route quand elle finit. » — « Si Dieu ne veut, les saints ne peuvent. » — « Celui qui glane ne choisit pas. » — « À main dévote ongles de chat. » — « La gloire vaine ne porte graine. » — « Mauvais serment sur pierre tombe. » — « Mieux vaut ployer que rompre. » Et mille autres que je pourrais citer.
Où sont-ils tous ces proverbes qui remuent tant de sentiments, tant d’idées ? vous les avez dédaignés ; ils manquent à votre répertoire. Baissez la tête, soyez humbles, et avant de songer au sanscrit et au persan, rougissez d’avoir oublié les proverbes fondamentaux de la sagesse des nations, ceux que j’appellerai les pères nobles des proverbes, les adages dans le genre de ceux-ci :
« Aide-toi, dieu t’aidera. »
« Trop parler nuit, trop gratter cuit. »
« Moins vaut rage que courage. »
« Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. »
« Qui a bu boira. »
« L’oiseau ne doit point salir son nid. »
« Bien commencé est à moitié fait. »
« Petite pluie abat grand vent. »
« Bon chien chasse de race. »
« Ventre affamé n’a point d’oreilles. »
« Qui refuse muse. »
« À bon vin point d’enseigne. »
« Qui tient le fil tient le peloton. »
Comment s’étonner après cela que vous ayez passé sous silence cette élégie en cinq mots : « Pour un plaisir mille douleurs ; » ces pensées profondes ou ingénieuses : « La faute est grande comme celui qui la commet ; » — « la même fleur fait le miel de l’abeille, et le venin du frelon ? »
Il y avait là cependant matière à des histoires piquantes, à des rapprochements spirituels, enfin à de véritables enseignements. Venez encore me parler du persan et du sanscrit, vous qui avez tiré si bon parti du français !
Ce discours était trop vrai pour soulever des objections de la part des deux autres Têtes ; elles se baissèrent ; puis, après quelques minutes de silence, l’une d’elles prit la parole :
— Mais tout cela ne nous apprend pas comment nous allons finir notre volume.
— Le finir ? reprit l’autre ; il s’agit bien de cela. Rentrons bien vite sous notre bonnet, et continuons la besogne ; réparons les omissions que vient de signaler notre confrère ; ce livre sera augmenté du double, mais il sera parfait.
— Rien n’est parfait en ce monde, reprit un quatrième interlocuteur arrivé à la fin du débat ; mes commères les plumes, ne comptez plus sur le crayon ; la sagesse lui a appris qu’il ne fallait abuser de rien, pas même des proverbes. Vous cherchez un moyen de finir ; le voici. Vous n’aurez qu’à mettre au bas du dessin suivant le mot sacramentel :


TABLE
- ↑ Proverbe créole : Les affaires des Cabris ne sont pas les affaires des Moutons.
- ↑ Pierre d’Elrilo et Ollo de Saint-Blaize, ainsi que presque tous les ménestrels du xvii et du xiiie siècle, font allusion à l’anecdote que nous venons de nous approprier. Aucun historien n’a paru la regarder comme authentique.
- ↑ Sereno, crieur de nuit.
- ↑ Corchete, officier de police, inférieur aux alguazils
- ↑ Jifero, nom de mépris donné aux bouchers.





