Les Aventures de Huck Finn/Texte entier

L’ami de Tom, c’est moi, Huckleberry Finn. Si vous n’avez pas lu les Aventures de Tom Sawyer, vous ne me connaissez pas.

Cela ne fait rien : nous aurons vite lié connaissance. M. Mark Twain vous a raconté l’histoire de Tom, et il y a mis un peu du sien, même en parlant de moi. Cela ne fait rien non plus, puisqu’on m’assure qu’il n’a ennuyé personne. La tante Polly, Mary Sawyer et la veuve Douglas ne disaient jamais que la vérité, et elles n’étaient pas toujours amusantes. Je parle de la tante de Tom, de sa cousine, et de la veuve qui m’avait adopté.
Au fond, sauf quelques enjolivements, M. Mark Twain a rapporté les faits tels qu’ils se sont passés. Pour ma part, je n’ai pas assez d’esprit pour inventer, je raconterai donc simplement la suite de mes aventures.
Or voici comment finit le livre de M. Mark Twain :
Tom et moi, nous avions découvert un trésor caché dans une caverne, et nous étions devenus riches. Six mille dollars chacun — une jolie fortune pour des orphelins de douze à treize ans ! Tom avait sa tante qui ne le laissait manquer de rien, si elle le tarabustait un peu. J’étais moins orphelin et plus libre que lui. Mon père vivait encore ; mais il avait disparu depuis longtemps. Je ne tenais pas à le voir revenir, parce qu’il me battait quand il avait bu, c’est-à-dire tous les jours. J’aurais mieux aimé n’avoir qu’une tante.
Du reste, on se montrait bon pour moi, et je ne me rappelle pas avoir jamais eu trop faim. L’été, je dormais dans un tonneau vide ; l’hiver, je couchais dans une grange. Mon genre de vie me convenait. Personne ne s’occupait de moi, parce que j’étais pauvre. Je plaignais Tom, qui ne pouvait pas monter en bateau, se baigner ou pêcher à la ligne plus de deux ou trois fois par semaine. Par malheur, mon argent vint tout gâter, et je me trouvai dans le même cas. L’avocat Thatcher plaça mes six mille dollars à intérêt, de façon à leur faire rapporter un dollar par jour. La veuve Douglas, à qui j’avais rendu un grand service, m’adopta, comme je l’ai dit, et déclara qu’elle voulait essayer de me civiliser. J’étais habitué à vivre à ma guise et ça ne m’allait pas du tout de rester enfermé dans une maison, de me lever, de manger, de me coucher à heure fixe. Et puis, mes habits neufs me gênaient. À la fin, je n’y tins plus et je décampai, après avoir repris mes vieilles nippes. Pour la première fois depuis longtemps je me sentis à l’aise, libre et content. J’avais retrouvé le tonneau où je dormais sans me donner la peine de me déshabiller. Personne ne m’empêchait de flâner dans les bois, de m’allonger sur l’herbe ou au bord de l’eau, et de dégringoler le long des berges. Je pouvais fumer sans avoir besoin de me cacher.
Une seule chose me tracassait. Les provisions dont mes poches étaient pleines ne dureraient pas toujours, et on remettrait le grappin sur moi, si je reparaissais dans les rues. Je n’eus pas le temps de m’inquiéter. Tom me relança au bout du second jour et me gronda plus fort que ne l’avait jamais fait la veuve.
— Tu as beau crier après moi, lui dis-je, j’aime mieux vivre comme autrefois, au lieu de me laisser civiliser.
— Vivre comme autrefois ? Allons donc ! Aujourd’hui personne ne te donnera à dîner en échange de ta pêche.

— Tu crois ?
— J’en suis sûr. Maintenant que tu es riche, tu ne dois pêcher à la ligne que pour t’amuser. Si tu te présentes avec un beau poisson, on l’acceptera et grand merci ! On te permettra peut-être de conduire les chevaux à l’abreuvoir ou de mener paître les vaches ; on n’aura pas l’idée de t’offrir une bouchée de pain. On te réclamera plutôt de l’argent, parce qu’on se figurera que cela t’ennuyait de te promener seul.
— Je ne suis pas fier ; je dirai simplement : j’ai faim.
— On te rira au nez et on te demandera ce que sont devenus tes six mille dollars.
— Un individu ne peut donc pas faire ce qu’il veut quand il est riche ?
— Non ; du moins, pas avant d’avoir vingt et un ans.
Comme je ne paraissais pas convaincu, Tom trouva un autre moyen pour me décider. Il me raconta que la bande de voleurs dans laquelle il avait promis de m’admettre serait bientôt organisée. Les autres m’avaient déjà accepté pour lieutenant ; mais ils ne voudraient plus de moi, si je m’obstinais à m’habiller aussi mal et à coucher dans un tonneau.
Je retournai donc chez Mme Douglas, qui me reçut à bras ouverts et ne m’adressa pas trop de reproches, de sorte que je fus fâché de lui avoir causé de la peine. Elle me fit endosser mes habits neufs. La vieille histoire recommença. La cloche sonnait pour annoncer le déjeuner, le dîner ou le souper. Que l’on eût faim ou non, on était tenu d’arriver à l’appel et de rester à table jusqu’à ce que le dernier plat eût été servi. Au bout de dix minutes, j’en avais toujours assez, et je ne demandais qu’à m’en aller. Ah ! bien oui. Chez les gens civilisés, les choses ne se passent pas ainsi. Pour peu que l’on mange vite, il faut regarder manger les autres, et sans bâiller encore ! J’eus beau me plaindre, la veuve tint bon.
— Mon pauvre Huck, me dit-elle, c’est là une affaire d’habitude ; tu apprendras bientôt à demeurer assis sans te sentir des fourmis dans les jambes.
Elle se trompait joliment ; les fourmis s’acharnaient contre moi avant que le repas fût à moitié fini. Alors la sœur de la veuve, miss Watson — une vieille fille qui n’était pas méchante au fond — se mettait de la partie. « Huck, ne pose pas les coudes sur la nappe ; Huck, tiens-toi droit ». Puis elle me faisait rire en imitant mes bâillements, et les fourmis décampaient pour le moment. Miss Watson avait été maîtresse d’école. C’est sans doute pour cela qu’elle me reprenait à tout propos. Avec elle pourtant, pas moyen de se fâcher.
Ma mère m’avait un peu appris à lire et à écrire ; mais, comme mon père refusa plus tard de me laisser aller à l’école, c’était presque à recommencer ; grâce à miss Watson, je me rattrapai vite. Les leçons s’allongeaient et ne m’ennuyaient plus autant.
— Est-ce que j’arriverai jamais à écrire aussi bien que Tom ? lui demandai-je un jour.
— D’ici à un mois tu écriras beaucoup mieux et tu feras moins de fautes d’orthographe que lui, si tu veux te donner un peu de peine. Je n’ai jamais eu un meilleur élève que toi, Huck.
Pour le coup je me sentis fier et je pensai moins au tonneau, que je regrettais cependant parfois. Un beau matin, Tom fut très étonné quand Jim, le nègre de miss Watson, lui remit une lettre où je l’engageais à venir dîner chez la veuve.
Même durant les vacances, la veuve me tint la bride serrée. J’étais bien plus heureux lorsqu’on ne songeait pas à me civiliser. S’il n’y avait eu que Mme Douglas et sa sœur, la vie que je menais ne m’aurait pas semblé trop dure, malgré les leçons. Avec elles je ne me sentais plus gêné ; mais elles invitaient souvent du monde à dîner, et elles se moquaient de moi, parce que je voulais aller manger dans la cuisine. Sans Tom, je me serais encore sauvé. Je le voyais une ou deux fois par semaine et nous prenions rendez-vous pour courir les bois le soir, lorsqu’on nous croyait couchés. L’hiver, un bon lit vaut peut-être mieux qu’un tonneau ; l’été, c’est une autre histoire !
Une nuit, je venais de gagner ma chambre. Je n’étais pas de bonne humeur, car il m’avait fallu demeurer depuis six heures en compagnie de gens que je ne connaissais pas et qui s’obstinaient à me faire causer — pas pendant le dîner, par exemple ; à table, ils étaient trop occupés pour penser à moi. Plus tard, dans le salon, ils ne m’avaient pas laissé aussi tranquille.
— Huck, maintenant que tes moyens te permettent de choisir une profession, n’as-tu pas envie de devenir médecin ? me demanda un vieux monsieur.
— Oh ! non, répliquai-je. Mon père disait toujours que les médecins ne servent qu’à tuer plus vite un malade.

— Docteur, cela vous apprendra à interroger un gaillard bien portant, s’écria un jeune homme, qui ajouta, en s’adressant à moi : Vous préférez sans doute être avocat ? Votre père ne vous a pas prévenu contre les avocats ?
— Si. Ils vendraient leur langue au diable.
Alors le docteur salua le monsieur qui venait de me parler et, à mon grand étonnement, tout le monde se mit à rire.
— Il faudra pourtant que tu choisisses un état, Huck, dit la veuve.
— Tom et moi nous en avons déjà choisi un.
— Je parie que vous songez tous deux à redevenir pirates ?
— Plus tard, c’est possible, lorsque nous pourrons acheter un beau
navire.

J’eus la bêtise de lui donner une chiquenaude.
— Et en attendant ?
— C’est un secret.
Là-dessus, chacun se mit à m’accabler de questions, cherchant à me tirer les vers du nez. Les dames surtout se montraient curieuses. Je crus qu’elles ne s’en iraient jamais. Voilà pourquoi j’étais si tracassé. Après avoir mis ma chandelle sur la table, je m’assis près de la fenêtre et j’essayai en vain de penser à quelque chose de gai. Le souvenir d’une salière que j’avais renversée à dîner me trottait dans la tête. Cela n’annonçait rien de bon. Tandis que je me reprochais de n’avoir pas jeté une pincée de sel par-dessus mon épaule gauche, j’aperçus une petite araignée qui grimpait le long d’une de mes manches. J’eus la bêtise de lui donner une chiquenaude qui l’envoya au beau milieu de la flamme de la chandelle. Tuer une araignée du soir, fût-ce par hasard, porte malheur, tout le monde le sait. Je me levai et je tournai trois fois sur moi-même en faisant le signe de la croix, puis j’attachai une mèche de mes cheveux avec un bout de fil. Ces moyens-là servent à chasser le mauvais sort quand on perd un fer à cheval que l’on a eu la chance de ramasser ; mais suffisaient-ils dans le cas actuel ? J’en étais rien moins que sûr. Aussi fus-je presque tenté de descendre en tapinois à la cuisine afin de consulter le grand nègre de miss Watson.
Jim était plus à même que personne de me renseigner là-dessus. Tout à coup je me souvins que Tom Sawyer m’avait prévenu que notre bande de voleurs était presque organisée et qu’il fallait me tenir sur le qui-vive les derniers jours, ou plutôt les dernières nuits de la semaine. Or la semaine touchait à sa fin. J’oubliai aussitôt l’araignée, la salière, et j’allumai ma pipe. Rien ne bougeait dans la maison ; je ne risquais pas d’être surpris et grondé par la veuve. Ding, ding, ding ! L’horloge de l’église voisine sonna enfin douze coups, et tout retomba dans le silence.
Au bout de quelque temps, j’entendis comme un bruit de branches brisées au-dessous de la croisée. Je me tins coi et j’écoutai. Bientôt un mi…â…oû discret résonna à peu de distance. C’était le signal convenu. Je répondis mi… â… oû aussi doucement que possible. Je soufflai la lumière, je sortis par la fenêtre et, me laissant glisser le long du toit d’un hangar, j’eus bien vite rejoint Tom qui m’attendait
sous les arbres.
Nous avançâmes sur la pointe des pieds le long d’une allée qui menait à une des sorties du jardin. Au moment où nous passions devant la cuisine, mon pied s’embarrassa dans une racine d’arbre, je tombai à la renverse et ma chute causa un léger bruit. Tom s’accroupit par terre et nous demeurâmes immobiles. Jim se tenait assis à la porte de la cuisine. Nous le voyions très bien, parce qu’il y avait une lumière derrière lui. Il se leva et avança la tête en prêtant l’oreille.
— Qui est là ? demanda-t-il au bout d’une minute.
Après avoir encore écouté un instant, il s’avança de notre côté et s’arrêta entre Tom et moi. Nous aurions presque pu le toucher ; mais nous nous gardions bien de bouger. Une de mes chevilles se mit à me démanger et je n’osai pas me gratter ; ensuite ce fut mon oreille gauche, puis mon dos, juste entre les deux épaules. Il me semblait que je mourrais, si je ne me grattais pas. J’ai souvent remarqué depuis que ces sortes de démangeaisons vous prennent toujours mal à propos, lorsque vous êtes à table, à l’école, ou quand vous essayez de vous endormir. Bientôt Jim dit :
— Ah çà ! qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? Pour sûr, j’ai entendu quelque chose… Bon, je sais ce que je vais faire. Je ne bougerai pas d’ici, et de cette façon je verrai bien si je me suis trompé.
Et le voilà qui s’assoit par terre, s’adosse à un arbre et allonge les jambes de mon côté.
Alors ce fut le nez qui commença à me démanger au point que les larmes me vinrent aux yeux. Cela dura six ou sept minutes ; mais le temps me parut beaucoup plus long — j’avais une peur atroce d’éternuer. Heureusement la respiration de Jim annonça qu’il s’endormait, et en effet il ne tarda pas à ronfler.
— Filons, Huck, dit Tom à voix basse.
Je le suivis en rampant. À peine nous fûmes-nous relevés, à une dizaine de pieds plus loin, que Tom me proposa de revenir en arrière et d’attacher Jim à l’arbre. Moi, je ne voulais pas risquer de réveiller le nègre ; il aurait donné l’alarme et on se serait aperçu que je manquais à l’appel.
— Tu as raison, dit Tom. Tant pis, car la farce était bonne. Seulement il faut revenir tout de même. J’ai laissé la bande au bas de la colline. Nous devons visiter notre caverne ce soir, et je n’ai pas assez de chandelles. Tu la connais, la caverne ; elle n’est pas gaie, et si elle ne se trouvait pas bien éclairée, surtout la première fois, on ne voudrait plus revenir. Puisque Jim dort, profitons-en pour nous glisser dans la cuisine et augmenter notre provision.
Je ne trouvai rien à répondre. Nous regagnâmes donc à pas de loup la cuisine, où Tom prit une demi-douzaine de chandelles, laissant cinq cents sur la table en guise de payement. Dès que nous fûmes dehors, je voulus prendre mes jambes à mon cou ; mais Tom tenait à jouer un tour au nègre, et je dus l’attendre tandis qu’il rampait sur les genoux jusqu’à l’arbre.
Lorsqu’il m’eut rejoint, nous courûmes le long de l’allée. Arrivés au bout du jardin, la haie franchie, nous fîmes halte au haut d’une colline, derrière la maison de la veuve. Tom me raconta qu’il s’était contenté d’enlever le chapeau du nègre et de l’accrocher à une branche d’arbre, juste au-dessus de la tête du dormeur. Le lendemain, Jim affirma que les fées l’avaient plongé dans un profond sommeil pour le transporter aux quatre coins de la ville et l’avaient ensuite ramené en face de la cuisine, sous le gros chêne, à une branche duquel elles avaient suspendu son chapeau afin de montrer d’où venait le coup. Le surlendemain, Jim se rappela fort bien avoir passé au moins une heure à la Nouvelle-Orléans, et plus tard il se vanta d’avoir fait le tour du monde à cheval sur un manche à balai. Cette aventure, dont il n’entretenait que ses camarades, le rendit très fier. Les nègres, entre eux, ne se lassent jamais de parler des exploits des fées ou des sorcières, et Jim se montrait trop convaincu pour ne pas rencontrer beaucoup d’auditeurs crédules.

Du haut de la colline au sommet de laquelle Tom s’était arrêté pour reprendre haleine, nous dominions la petite ville de Saint-Pétersbourg (État de Mississipi), où quelques rares lumières brillaient encore çà et là, éclairant sans doute quelque chambre de malade. Au bas de la ville coulait le Mississipi, large d’au moins un mille, calme et resplendissant à la lueur des étoiles. Nous dégringolâmes le long de la pente, et dans la vieille tannerie abandonnée nous trouvâmes Joe Harper, Ben Rogers et plusieurs autres camarades qui s’étaient cachés sous le hangar. Quelques minutes plus tard, nous détachions un canot, et la bande montait à bord pour débarquer à deux milles plus bas, en face d’un point de la côte que Tom et moi connaissions fort bien.
Après avoir amarré le bateau et gagné la berge, on s’arrêta devant le buisson qui cachait une des entrées de la grotte où Tom avait failli périr de faim. Le capitaine — il n’était pas permis de lui donner un autre nom durant une expédition — fit jurer à chacun de garder le secret, ordonna d’allumer les chandelles et montra le chemin. Pour entrer, il fallut se traîner à quatre pattes. Peu à peu l’ouverture s’agrandit et forma un couloir où chacun pouvait marcher debout et voir plus clair. Il n’était que temps, car la moitié des recrues semblait déjà prête à déserter. Enfin, toujours guidé par Tom, on arriva, en se faufilant à travers une autre fente que personne n’avait remarquée, dans la grande cave où nous avions découvert le trésor.
— C’est ici le repaire où nous établirons notre quartier général, dit Tom.
La vue du repaire, dont les murs étaient humides et où les sièges manquaient, n’excita pas autant d’enthousiasme que je m’y attendais. Tom s’en aperçut sans doute, car il reprit aussitôt :
— On ne se réunira ici que dans les grandes occasions ; l’été, nous camperons dans le bois voisin.
— Tant mieux, dit Joe Harper ; la cachette est bonne ; mais il faut s’écorcher les genoux et les coudes pour y arriver. Mon pantalon est tout déchiré.
— Bah ! répliqua Tom, on croira que tu as grimpé à un arbre. Du reste, s’il y a des capons parmi nous, ils sont libres de s’en aller, puisqu’ils n’ont pas encore prêté serment. Que les capons lèvent la main.
Aucune main ne se leva.
— À la bonne heure ! s’écria Tom. Je vois que j’ai bien choisi mes hommes et que je puis compter sur eux. Maintenant, je vais vous lire le serment, et vous le signerez de votre sang.
Il tira de sa poche une feuille de papier sur laquelle il avait écrit le serment. Les membres de la bande juraient d’obéir aux ordres du capitaine et de se soutenir les uns les autres. Si quelqu’un révélait les secrets de la bande, on tirerait au sort pour savoir qui le tuerait, et le justicier désigné s’engageait à ne pas manger ou dormir jusqu’à ce qu’il eût plongé son poignard dans le cœur du coupable et tracé une croix sur sa poitrine. Cette croix était la marque de la bande de Tom Sawyer, qui, seule, avait le droit de s’en servir. Si un des affiliés se révoltait contre le capitaine, il passerait devant un conseil de guerre et on lui brûlerait la cervelle séance tenante. Il y en avait beaucoup plus long ; mais je ne me rappelle pas le reste.
Ben Rogers déclara que c’était un très beau serment et demanda si Tom l’avait inventé d’un bout à l’autre. Tom reconnut avoir presque tout copié dans des histoires de chefs de voleurs ou de pirates, qui savaient mieux que lui ce qu’il fallait faire jurer à leurs hommes.
Quelqu’un opina qu’il serait peut-être bon de tuer aussi les familles de ceux qui trahiraient les secrets de la bande. Tom, ayant approuvé cette idée, prit son crayon et griffonna une ligne sur le papier qu’il venait de lire.
— C’est fort bien, dit alors Ben Rogers ; mais voilà Huck Finn, qui n’a pas de famille.
— Est-ce qu’il n’a pas son père ? demanda Tom.
— Oui, un père que nous ne saurons jamais où trouver ; il y a plus d’un an qu’on ne l’a pas revu. Ça ne serait pas juste envers les autres, qui ont des familles à tuer.
Le cas était embarrassant ; mais, grâce à Tom, on finit par consentir à ne pas rayer mon nom de la liste. En somme, chacun de nous se piqua le doigt avec une épingle et signa le serment avec son sang.
— À présent, dit Tom, il est bien entendu que notre bande est une bande de voleurs de grand chemin, pas autre chose. Nous nous mettrons en embuscade pour arrêter les voitures ou les voyageurs.
— Et s’ils ne veulent pas s’arrêter ? demanda un sceptique.
— Oh ! dans les livres ils ne manquent jamais de s’arrêter lorsque des gens masqués leur crient : « La bourse ou la vie ! » Les chevaliers du grand chemin portent toujours un masque — autrement ils ne pourraient pas aller dans le monde sans être reconnus.
— Nous n’avons pas de masques !
Tom paraissait avoir prévu l’objection. Il jeta à terre sa casquette, tira de sa poche un foulard de sa tante Polly — un beau foulard tout neuf dans lequel il avait taillé deux trous ronds à l’aide d’une paire de ciseaux, et dont il se coiffa en un clin d’œil.
— La bourse ou la vie ! cria-t-il… Que penses-tu de ce masque-là, Jack ?
— C’est vrai que ça doit effrayer les gens, dit Jack, qui venait de faire un bond en arrière.
— Rien de plus facile à fabriquer, reprit Tom en retirant son masque. Il n’y a qu’à bien marquer la place des yeux.
Très facile, en effet ! ainsi que l’apprirent bientôt douze ou quinze

ménagères de Saint-Pétersbourg, qui ne connurent que beaucoup plus tard l’utilité des mouchoirs troués. En attendant, le coup de théâtre imaginé par Tom lui valut un plein succès, et son plan de campagne fut adopté sans hésitation ni nouvelle discussion. Il fut nommé capitaine à l’unanimité des voix, et on m’accepta pour lieutenant. Lorsque je regagnai ma chambre, au point du jour, j’étais aussi heureux que fatigué.
Le lendemain, j’osai à peine descendre à l’heure du déjeuner, tant l’expédition de la veille avait bien arrangé mes habits. J’eus beau gratter les gouttes de suif avec mon canif et brosser, ils n’avaient plus l’air neufs, tant s’en faut. La veuve se douta bien de quelque chose ; mais elle ne me gronda pas. Au contraire, elle empêcha sa sœur de me gronder en lui disant doucement : « Laisse-le tranquille, nous finirons par l’apprivoiser. » J’avais presque envie de lui tout raconter.
Pendant six semaines, la bande fut convoquée de loin en loin. Elle ne se trouvait presque jamais au grand complet, bien que Tom eût menacé de brûler la cervelle à quiconque s’absenterait deux fois de suite. Beaucoup de ses hommes n’étaient libres que le dimanche, et pour rien au monde ils n’auraient consenti à être des voleurs ce jour-là. Au fond ce n’était pas très amusant. Nous n’avions arrêté personne. Nous nous contentions de sortir à l’improviste du bois pour effrayer les gens qui apportaient des légumes ou conduisaient des porcs au marché. Tom appelait les cochons des lingots et les carottes des rubis. Je ne vois pas ce que nous y gagnions, excepté un coup de fouet de temps à autre. Ensuite nous courions nous cacher dans notre caverne, où le capitaine se vantait d’avoir remporté une nouvelle victoire. Un matin, il nous fit avertir par le second lieutenant, Joe Harper, qu’il venait d’apprendre par ses espions qu’une caravane de riches marchands espagnols et arabes devait passer le lendemain à peu de distance de la grotte avec deux cents éléphants, cinq cents mules et six cents chameaux chargés de diamants. L’escorte ne se composait que d’une centaine de soldats. Il s’agissait de nous mettre en embuscade pour tomber au bon moment sur la caravane, disperser l’escorte et emporter les diamants dans notre repaire. Il fallait donc fourbir nos armes et nous trouver au lieu du rendez-vous dès huit heures du matin. Le capitaine nous ordonnait sans cesse de tenir nos armes en bon état, parce que dans ses livres les bandits passaient la moitié de leur temps à fourbir leurs arquebuses. Il savait pourtant très bien que nous ne possédions que des sabres fabriqués avec des lattes et des fusils représentés par des manches à balai.
Je ne croyais pas du tout que nous pourrions effrayer un si grand tas d’Espagnols et d’Arabes ; mais je tenais trop à voir les éléphants et les dromadaires pour laisser échapper l’occasion. Les autres éprouvèrent sans doute la même curiosité, car Tom n’eut pas à se plaindre de leur manque d’exactitude.

Cachés derrière les arbres, nous attendîmes le signal convenu, et lorsque le capitaine cria : En avant ! nous nous lançâmes le long de la colline. Je n’aperçus ni Espagnols, ni Arabes, ni chameaux, ni éléphants ; mais une classe de l’école du dimanche que l’on menait en pique-nique dans le bois — et une classe de petites filles encore ! Elles eurent joliment peur et se sauvèrent à la débandade. Notre butin ne fut pas lourd : quelques biscuits, un pot de confitures, un livre de cantiques et une poupée. La vieille sous-maîtresse nous fit tout lâcher ; elle tomba sur nous à coups de parapluie et nous n’en fûmes pas quittes à trop bon marché.
— Avec tout ça, dis-je à Tom, je n’ai pas vu un seul diamant.
— Il y en avait des masses, répliqua-t-il, et des Arabes et des dromadaires aussi.
— Pourquoi ne les avons-nous pas vus alors ?
— Si tu avais lu les Aventures de Don Quichotte, tu saurais pourquoi. C’est la faute des enchanteurs. Les soldats, les mules et le reste étaient là ; mais les magiciens ont transformé la caravane en école du dimanche, par pure méchanceté.
— Il fallait nous en prendre à eux, au lieu d’effrayer les filles.
— Allons donc ! me répondit Tom. Ils auraient appelé à leur aide des génies qui nous écrabouilleraient rien qu’en levant le doigt. Si nous avions pu faire venir d’autres génies pour rosser les premiers, je ne dis pas.
— Comment les magiciens les font-ils venir ? demandai-je.
— Dans les Mille et une Nuits, quand vous avez besoin d’un génie, vous frottez une vieille lampe d’étain ou une bague de fer. Alors le génie arrive au milieu d’un nuage de fumée, et se met à vos ordres. Si vous lui commandez de bâtir avec des diamants un palais de quarante milles de long, de le remplir de bonnes choses et d’y amener la fille de l’empereur de Chine, parce que vous voulez vous marier avec elle, il faut qu’il le fasse avant le coucher du soleil. Bien plus, il est obligé de transporter le palais d’un bout du pays à l’autre, si vous lui en donnez l’ordre.
— Eh bien, je le trouve bête de ne pas garder le palais pour lui. Je ne serais pas assez sot pour planter là ma besogne et courir après un individu, tout bonnement parce qu’il a frotté une vieille lampe ou un anneau de fer.
— Tu serais obligé de venir dès qu’il aurait assez frotté ; c’est dans le livre.
— Allons, ne te fâche pas. Je viendrais, puisqu’il n’y aurait pas moyen de faire autrement ; mais je te parie que l’individu serait écrabouillé avant d’entrer dans son palais.
— Il n’y a pas moyen de raisonner avec toi, Huck ; tu as la tête trop dure.
Je pensai à tout cela pendant deux ou trois jours ; puis je me décidai à en avoir le cœur net. Après m’être procuré une vieille lampe d’étain et un anneau de fer, je les frottai jusqu’à me casser presque les bras. Mon idée était de bâtir un beau palais que j’aurais donné à la veuve, à la condition qu’elle renoncerait à me civiliser. Cela ne me servit à rien. Aucun génie ne se montra. Je restai persuadé que Tom croyait aux Arabes et aux éléphants, mais que sa caravane était bien une école du dimanche.
À la suite de cette mémorable aventure, la plupart des voleurs de grand chemin, honteux d’avoir été dispersés par une vieille dame armée d’un simple parapluie, donnèrent leur démission, et, en dépit
des remontrances du capitaine, je suivis leur exemple.
Deux ou trois mois s’écoulèrent. Dès la rentrée des classes, on m’avait envoyé à l’école et peu à peu je m’y étais habitué. Par degrés aussi, je m’accoutumais aux façons de la veuve. L’hiver, d’ailleurs, il me paraissait moins dur de vivre dans une maison et de coucher dans un lit.
Un matin — j’ai de bonnes raisons pour me rappeler ce matin-là — je fus encore assez malencontreux pour répandre sur la nappe tout le contenu de la salière. Je me dépêchai d’avancer la main afin de lancer une pincée de sel par-dessus mon épaule gauche. Miss Watson ne m’en laissa pas le temps ; elle ramassa le tout avec son couteau et me traita de maladroit. Lorsque je sortis après déjeuner, je me sentais donc fort inquiet, car je me demandais ce qui allait m’arriver de fâcheux.
Je descendis jusqu’au bout du jardin, qui s’étendait derrière la maison, et je sortis par la petite porte de service. Une légère couche de neige, tombée le matin même, couvrait le sol et je vis des traces de pas. Quelqu’un était monté par un sentier aboutissant à une carrière abandonnée. On s’était arrêté devant la porte, puis on avait longé la clôture. Pourquoi donc n’était-on pas entré ? Tom ne prenait jamais ce chemin-là, sans quoi je me serais figuré qu’il était venu en cachette me rappeler que, depuis longtemps, nous n’avions pas fait l’école buissonnière. Mais non ; son pied n’aurait pas laissé des empreintes aussi longues. Au lieu de suivre la piste, je me baissai pour l’examiner. La neige reproduisait très nettement la marque d’une croix tracée sous le talon gauche du promeneur à l’aide de gros clous. Cela me suffit. Je savais fort bien qui dessinait ainsi une croix sur sa chaussure.
En un clin d’œil, je me redressai et je descendis la colline au pas de course. Je ne m’arrêtai qu’en arrivant chez M. Thatcher, qui se tenait dans son bureau, où l’on me fit entrer.
— Tu viens à propos, Huck, me dit-il en riant. Te voilà tout essoufflé. Est-ce que tu as couru si vite parce que j’ai de l’argent à te remettre ?
— Comment ! de l’argent à me remettre ?
— Oui. J’ai touché hier le premier semestre de tes intérêts, plus de cent cinquante dollars. Seulement, il est convenu avec la veuve que nous placerons ces fonds avec le reste.
— Oui, oui, j’ai bien assez de ce qu’elle me donne. Gardez-les, et les six mille dollars aussi, comme s’ils étaient à vous.
M. Thatcher parut surpris.
— Hum ! dit-il ; il y a une anguille sous roche. Voyons, mon garçon, explique-toi.
— Ne me demandez pas d’explication, s’il vous plaît. Vous garderez tout, n’est-ce pas ?
— Sais-tu que tes airs mystérieux m’intriguent ? Tu me caches quelque chose.
— Je tiens à ce que vous gardiez l’argent, voilà tout, répliquai-je. Est-ce que je n’ai pas le droit de vous le donner ? Je suis venu exprès pour cela. Ne m’en demandez pas davantage.
— Oh ! oh ! dit-il après m’avoir regardé un instant, je crois deviner, et je vais tâcher de te tirer d’embarras… Non, tu n’as pas le droit de me donner ton bien à titre gratuit ; mais la loi te permet de me le vendre.
Il griffonna une ligne ou deux sur une feuille de papier, qu’il me fit signer, et, après m’avoir lu ce qu’il venait d’écrire, il ajouta :
— Vois-tu, c’est là un acte de vente. Un simple don ne serait pas valable. Voilà un dollar qui représente le prix d’achat. Mets-le dans ta poche. Maintenant, tu peux affirmer que tu as cédé les sommes placées en ton nom, que tu as reçu un équivalent en échange et que tu ne possèdes plus rien. Un homme de loi te répondrait que tu n’es pas majeur et que ta signature n’a aucune valeur ; mais tu n’as pas affaire à un homme de loi, hein ? Cela te suffira pour le moment, je pense ? Si quelqu’un cherche à mettre la main sur tes fonds, tu me l’enverras et nous verrons.

— Merci, monsieur Thatcher ; vous m’enlevez une grosse épine du pied. J’ai eu raison de m’adresser à vous.
— Eh bien, puisque tu as confiance en moi, pourquoi ces cachotteries ? Ton père est de retour ?
— Je n’en suis pas sûr ; mais il plante toujours des clous dans le talon de sa botte gauche, de façon à former une croix pour tenir le diable à distance, et j’ai vu sa marque sur la neige.
— Bah ! ton père n’est certes pas le seul citoyen de Saint-Pétersbourg dont la botte gauche porte un ornement pareil. C’est égal, Huck, nous finirons par te civiliser. Tu es un malin.
Il était plus malin que moi, car il avait tout compris dès le premier mot. Cependant, pour peu qu’il eût continué son interrogatoire, je serais resté fort embarrassé. Je craignais mon père, dont je n’avais jamais eu à me louer, et, d’un autre côté, l’idée de travailler du matin au soir, comme les gens civilisés dont on me citait sans cesse l’exemple, ne me souriait guère. Bref, j’étais fort tracassé. La veuve, qui me trouva en train de broyer du noir, me fit causer, et elle crut me rassurer en me disant :
— Ne t’inquiète pas. Je ne t’abandonnerai pas, lors même que M. Thatcher garderait pour lui tes six mille dollars.
— Il ne les gardera pas pour lui, répliquai-je ; ce serait trop de chance. On ne me laissera jamais tranquille. J’avais raison de ne pas vouloir être riche.
— Tu changeras d’avis un de ces jours, me dit la veuve en riant.
— En tout cas, mon père ne gagnerait rien à devenir riche, et j’aimerais mieux donner l’argent à un autre — à M. Thatcher ou à vous, par exemple.
— Comment ! tu ne veux pas que ton père profite de la fortune que tu dois au hasard ?
— Non. Avec de l’argent plein les poches, il ne travaillerait plus du tout, et alors…
— Ah ! c’est vrai, mon pauvre Huck, j’oubliais. Sans lui, tu ne serais pas le petit sauvage que nous avons tant de peine à apprivoiser. Enfin, il faut espérer que M. Thatcher a raison et que tu en seras quitte pour la peur.
Moi, je savais mieux qu’elle que M. Thatcher se trompait. Ce n’est pas pour rien qu’on renverse une salière. Lorsque je montai ce soir-là dans ma chambre, j’y trouvai mon père. Je m’étais retourné en entrant afin de fermer la porte, et à peine me fus-je retourné de nouveau, que je l’aperçus. Je ne m’attendais pas à le rencontrer si tôt et je me sentis d’abord effrayé.
Il avait près de cinquante ans et on les lui aurait donnés. Ses cheveux, longs, emmêlés, graisseux, retombaient autour de sa tête comme les rameaux d’un arbre à travers lesquels on voyait briller ses yeux. Ils étaient encore tout noirs, aussi noirs que sa barbe et ses favoris ébouriffés. Son visage, ou ce que l’on pouvait voir de son visage, n’avait pas de couleur ; il était blanc, mais d’un blanc à vous donner la chair de poule — le blanc d’un ventre de poisson. Quant à ses vêtements, c’étaient des loques, rien de plus. Il se tenait assis, le pied gauche appuyé sur le genou droit. La botte de ce pied était crevée et deux des doigts, qui passaient à travers la crevasse, remuaient de temps à autre. Son chapeau de feutre noir, un vieux chapeau à moitié défoncé, gisait par terre.
Je restai à le regarder, tandis qu’il me regardait de son côté, sa chaise un peu renversée en arrière, puis je posai la chandelle sur la table. Je vis que le châssis de la fenêtre était levé et je devinai qu’il avait dû entrer par là en se glissant le long du toit de l’appentis. Après m’avoir examiné des pieds à la tête, il dit enfin :
— Bien nippé, très bien nippé ! Tu te figures que c’est le beau plumage qui fait le bel oiseau ?
— Peut-être que oui, peut-être que non, répliquai-je.
— Oh ! oh ! tu n’as plus ta langue dans ta poche. Tu as pris de l’aplomb depuis mon départ. Je te descendrai de quelques crans avant d’en avoir fini avec toi. Tu es éduqué aussi, à ce qu’on m’a dit. Est-ce vrai que tu sais lire, et même écrire ? Je ne veux pas de ça ! Qui t’a permis de donner dans ces bêtises-là ?
— Mme Douglas.
— La veuve, hein ? Je lui apprendrai à se mêler de ce qui ne la regarde pas. Tu lâcheras cette école, entends-tu ? Élever un enfant pour qu’il rougisse de son père ! Tu crois peut-être que tu vaux mieux que moi, parce que je n’ai jamais mis le nez dans un livre ? Allons, laisse-moi t’entendre lire.
Je pris un livre sur la table et je lui lus une dizaine de lignes à propos du général Washington et de la guerre de l’Indépendance. Il m’écouta pendant deux ou trois minutes ; puis, d’un coup de poing, il envoya le livre à l’autre bout de la chambre.
— C’est vrai ! dit-il. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas cesser de faire jabot, mon garçon. Je te surveillerai. Si je t’attrape près de l’école, gare à ton dos !
Tout en parlant, il allongea le bras pour ramasser sur la table une petite image où il y avait trois vaches rouges et un bonhomme bleu.
— Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda-t-il.
— Un bon point qu’on m’a donné parce que j’ai bien récité mes leçons.
Il déchira l’image en morceaux.
— Un bon point ! répéta-t-il. Une bonne raclée, voilà ce que je te donnerai, moi, si tu retournes là-bas.
Après avoir un peu grommelé et regardé autour de lui, il reprit :
— Un lit, et des couvertures, et une glace et un tapis, quand ton père a eu à dormir avec les porcs sous le hangar de la vieille tannerie ! Je n’ai jamais vu un fils pareil ! Tu rentreras dans ta coquille avant peu, je t’en réponds. Est-ce à l’école qu’on t’apprend à te donner ces airs-là ? Et on dit que tu es riche. Comment ça se fait-il, hein ?
— On a menti, voilà comment ça se fait.
— Prends garde, mon gaillard. Je te passe bien des choses, mais je perdrais patience à la fin. Depuis deux jours je n’entends parler que de ta chance. On en parlait aussi là-bas, de l’autre côté du Mississipi, et c’est pour ça que je suis revenu. Tu iras chercher ton argent demain et tu me le remettras ; j’en ai besoin.
— Je n’ai pas d’argent.
— Possible. C’est l’avocat Thatcher qui a tes fonds. Tu les lui reprendras ; j’en ai besoin.
— Je n’ai plus rien. Demandez à M. Thatcher, il vous dira la même chose.
— C’est bon. Je lui demanderai. Combien as-tu dans ta poche ?
— Je n’ai qu’un dollar et je ne voudrais pas…
— Peu m’importe ce que tu voudrais. Aboule et vivement !
Il parlait d’un ton si menaçant que je n’osai pas refuser. Il prit le dollar, le mordit pour voir si la pièce était bonne, se leva et déclara qu’il allait donner un coup de pied jusqu’à la taverne la plus proche, car il n’avait pas bu une goutte de whisky depuis la veille. Je crois qu’il ne mentait pas, sans cela il n’aurait guère manqué de me battre. Après s’être glissé sur le toit de l’appentis, il rentra la tête dans la chambre et me dit :
— Tu me laisses oublier mon casque… Je n’ai jamais vu un fils pareil !
Je lui apportai son chapeau, qui me rappelait celui dont je me coiffais autrefois. Il se l’enfonça sur la tête jusqu’aux oreilles et le voilà parti. Je le croyais déjà loin, quand il reparut de nouveau pour ajouter :
— Gare à toi si tu ne m’obéis pas ; je monterai la garde autour de l’école à dater de demain.
Le lendemain, grâce au dollar qu’il avait accaparé, il songeait à autre chose. Sa première visite fut pour M. Thatcher, qu’il voulait obliger « à rendre gorge », comme il disait. L’avocat refusa très carrément de se dessaisir des six mille dollars. Alors mon père éclata en injures, le traita d’escroc, de voleur, et menaça de lui intenter un procès. Il ne réussit qu’à se faire jeter à la porte.
M. Thatcher et la veuve prirent les devants. Ils s’adressèrent au juge de paix du district, afin qu’il leur confiât ma tutelle. Or, ce juge était un nouveau venu, qui ne connaissait pas mon père. Il déclara qu’à son avis on devait éviter de semer la division dans les familles. Enlever aux parents la garde de leurs enfants, c’était là une grave responsabilité. Le père s’enivrait ? Mais avait-on jamais essayé de le ramener dans les voies de la tempérance ? Tous les ivrognes ne sont pas incorrigibles.
— Sans me flatter d’être éloquent, ajouta-t-il, je puis me vanter d’en avoir guéri plus d’un. Je m’informerai… Nous verrons. En principe, je suis opposé à votre demande et je reviens rarement sur une première décision.
Ce résultat négatif enchanta mon père, et surtout l’homme de loi qui le conseillait. Il s’agissait de six mille dollars, et la cause eût-elle été plus mauvaise, les avocats ne lui auraient pas manqué, même à Saint-Pétersbourg. Il menaça de m’assommer si je ne lui procurais pas de l’argent. Je dus, bien à contre-cœur, demander trois dollars à M. Thatcher, qui, sachant à quoi s’en tenir, me les prêta volontiers. Je ne fus pas battu ; mais mon emprunt forcé causa un fameux vacarme dans la ville à l’heure de la fermeture des cabarets, et on dut arrêter le tapageur qui s’obstinait à empêcher les gens de dormir en poussant des cris d’Indien sauvage, accompagnés de coups de tamtam sur une vieille casserole. Le lendemain, il se voyait condamné à passer en prison le reste de la semaine.
— Voilà où mène l’ivresse, lui dit le juge. Malgré mon respect pour les droits de la famille, votre présence sur ce banc ne m’engage pas à vous confier la tutelle de votre fils. Quand on a trop peu d’empire sur soi pour ne pas commettre des excès, le seul moyen de salut consiste à ne plus boire du tout.
— Faut mourir de soif alors ?
— Je me suis mal expliqué. Il faut se décider à ne boire que de l’eau. Auriez-vous ce courage ?
— À moins d’avoir les poches vides ou d’être coffré, je n’ai jamais essayé.
— Votre franchise parle en votre faveur et je vous aiderai à essayer.
En effet, le juge essaya. Récemment converti lui-même à la tempérance, il cherchait à ramener les ivrognes dans la bonne voie, et tout buveur qu’il se voyait obligé de condamner devenait l’objet de ses louables efforts. On se moquait un peu de son innocente manie, qui avait parfois produit de bons résultats, et c’eût été un véritable triomphe pour lui d’opérer la guérison du « vieux Finn ». Aussi, à peine mon père fut-il sorti de prison, que le digne philanthrope le fît venir, l’habilla des pieds à la tête et lui donna une place à sa table.

— Voyez-vous, lui dit-il, il n’y a que le premier pas qui coûte, et, pour éviter les rechutes, je vous engage à passer une semaine sous mon toit, où vous serez à l’abri des tentations. Lorsque vous vous sentirez assez fort, je vous trouverai un emploi régulier. Certaines personnes, dont je ne récuse pas la compétence, sont d’avis que l’on doit se déshabituer peu à peu de l’usage des liqueurs fortes ; mais l’expérience m’a démontré la nécessité de couper brusquement le mal dans sa racine.
Bref, le juge et sa femme parlèrent en termes si éloquents des avantages de la tempérance, que leur auditeur finit par s’attendrir. Il ne s’était jamais entendu traiter de frère, même par les cabaretiers dont il contribuait de son mieux à faire la fortune ; et d’ailleurs, il se trouvait dans un des cas où il ne pouvait boire que de l’eau, ses poches étant vides.
— Tenez, s’écria-t-il, je crois que, s’il y avait devant moi une bouteille de whisky, je n’y toucherais pas. Je veux être pendu si…
— N’allons pas si vite, interrompit le juge. Ne vous engagez à rien avant d’être sûr de vous.
Le nouveau converti était-il sincère ? Lui seul le sait. En tout cas, le juge eut de graves raisons pour en douter. Au milieu de la nuit, mon père eut très soif. L’eau ne manquait pas dans la chambre où ses hôtes l’avaient hébergé, mais cette boisson ne le tentait pas le moins du monde. Il descendit par la fenêtre, échangea son habit neuf contre une cruche de rhum, rentra au gîte et se donna du bon temps. Vers l’aube, bien que la cruche fût vide, il avait plus soif que jamais. Cette fois, il descendit si maladroitement qu’il se cassa le bras gauche en deux endroits et fut ramassé le lendemain matin à moitié mort de froid.
Lorsqu’on visita la chambre d’ami, on la trouva dans un tel état que la femme du juge conseilla à son mari de se montrer moins philanthrope à l’avenir. Quant à ce dernier, il déclara que l’on parviendrait peut-être à corriger son ex-protégé à coups de revolver, mais qu’il ne
voyait pas d’autre moyen.
Mon père, bien soigné à l’hôpital, se rétablit plus tôt qu’on ne pouvait s’y attendre. À peine debout, il poursuivit M. Thatcher devant les tribunaux afin de se faire remettre mes six mille dollars. Il me poursuivit d’une autre façon parce que je m’obstinais à me rendre à l’école. Deux fois il parvint à m’attraper, et je n’en fus pas quitte à bon marché. Cela ne m’empêcha pas de me montrer si assidu que le maître m’adressa des félicitations.
Le procès semblait devoir durer longtemps, ou plutôt il semblait ne devoir jamais commencer. Je soupçonne l’homme de loi de mon père de s’être entendu avec M. Thatcher pour laisser les choses traîner en longueur. En tout cas, son client se procurait d’une manière ou d’une autre assez d’argent pour se griser ; alors il troublait le repos de la ville ; on le réintégrait dans la geôle et, à la sortie, personne n’offrait de le convertir.
Enfin, après avoir surveillé pendant un mois les abords de l’école sans parvenir à mettre la main sur moi, il commença à rôder autour de la maison de Mme Douglas. La veuve le prévint qu’elle le signalerait à l’attention de la police s’il continuait à l’inquiéter.
— Ah ! ah ! s’écria-t-il ; vous voudriez me faire passer pour un malfaiteur. Il ne manquait plus que cela ! Je vous montrerai, à vous et à M. Thatcher, que je suis le tuteur naturel de mon fils. Mon avocat vous le prouvera aussi.
— C’est là une question qui regarde les tribunaux, répliqua la veuve.
— Je me moque de vos tribunaux. J’en ai assez ! J’ai un domicile légal ; je possède une maison à moi. Vous ne vous en doutiez pas, hein ? C’est vrai, tout de même. Eh bien, j’emmènerai Huck ; après, nous verrons.
On fut quelque temps sans le revoir et la veuve demeura convaincue qu’il avait parlé en l’air ou renoncé à son projet. Mais un beau jour, tandis que je revenais seul d’une partie de pêche, il tomba sur moi à l’improviste, m’entraîna malgré moi et me fit monter dans un canot qui aborda, à trois milles de distance environ, sur la rive opposée du Mississipi, c’est-à-dire sur la côte de l’Illinois. Sa maison — car il n’avait pas menti — était un log-house construit à l’entrée d’un bois où personne ne se serait avisé de chercher une habitation.
Mon père me surveilla de si près que je n’eus aucune occasion de m’enfuir. Le soir, il fermait à double tour la porte de la cabane et mettait la clef sous sa tête. Il avait un fusil et nous vivions du produit de notre chasse ou de notre pêche. De temps en temps, il m’enfermait pour aller à la ville vendre du gibier et du poisson. Il rapportait invariablement, entre autres provisions, une bonne quantité de whisky, et, quand il avait trop bu, il tapait dur. Mme Douglas finit par découvrir où j’étais et envoya un de ses domestiques pour tâcher de me reprendre. Mon père ne voulut pas entendre parler de compromis ; il jura de loger une balle dans la tête de l’ambassadeur, si on cherchait à me délivrer.
Sauf les coups, je ne me trouvais pas à plaindre. Ce n’était pas amusant de rester prisonnier, même pendant une demi-journée ; mais il n’y avait pas de leçons à apprendre et les heures que je passais à dormir ou à fumer ne me paraissaient pas longues. Au bout de deux mois, mes habits n’étaient plus que des guenilles. Je me demandais comment j’avais pu me faire aux coutumes des gens de la ville. Le changement me plaisait. Lorsque Mme Douglas et sa sœur me tracassaient par trop, j’avais souvent pensé qu’il vaudrait mieux vivre seul au milieu d’un bois.
Par malheur, je n’étais pas seul, et mon père ne se contentait pas de m’adresser des reproches. Sans provocation aucune de ma part, il me rouait de coups. Ses absences, dont je me félicitais tout d’abord, devinrent de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues. Une fois je demeurai enfermé pendant trois jours. Je ne risquais pas de mourir de faim, car il me restait un sac de biscuits. Néanmoins, j’eus peur. Si mon père s’était noyé en traversant le fleuve ? J’avais essayé, à bien des reprises, de sortir de la cabane, mais toujours en vain.

Les fenêtres et la cheminée n’auraient pas livré passage à un gros chat. La porte se composait d’épaisses planches de chêne, solidement ajustées. Mon père, avant de s’éloigner, ne manquait jamais d’enlever la hache et les autres outils qui m’auraient permis de m’échapper. J’avais fouillé partout inutilement une centaine de fois. Je n’avais rien à faire et cela m’aidait à passer le temps. Enfin, à force de chercher, je trouvai au fond d’un coffre à bois une vieille scie rouillée. Je la graissai et je me mis aussitôt à l’œuvre. Derrière la table, contre un des murs, on avait cloué un bout de tapis pour empêcher le vent d’éteindre la chandelle. Les bûches qui formaient les murs du log-house ne tenaient que trop bien ; mais on ne s’était pas donné la peine de boucher les interstices. Je me glissai sous la table, je relevai le tapis et je commençai à scier le bas d’un des plus gros troncs. La besogne ne marchait pas très vite ; mais elle était à moitié terminée lorsqu’un coup de fusil résonna au dehors. Je fis disparaître les traces de mon travail ; j’abaissai le tapis, je cachai la scie, et bientôt mon père entra.
— Allons, me dit-il, ils ont assez bien fait les choses aujourd’hui ; je rapporte un tas de provisions.
Il semblait pourtant de mauvaise humeur, ce qui ne le changeait guère. Il déclara que tout marchait de travers. M. Thatcher, un malin, savait s’y prendre pour éterniser un procès. Mon absence prolongée lui fournissait un excellent prétexte. Il demandait que l’affaire fût remise jusqu’à ce que l’on m’eût ramené chez la veuve.
— Pas si bête ! ajouta mon père. Mme Douglas t’empêcherait de bouger de la maison, et alors je n’obtiendrai plus rien ni d’elle ni de maître Thatcher. Non, non, je ne te lâche pas. S’ils essayent de te reprendre, je connais, à six ou sept milles d’ici, un endroit où ils ne te trouveront pas.
Comme je n’avais aucune envie d’être enfermé chez Mme Douglas ou ailleurs, cette menace m’inquiéta. Je ne tardai toutefois pas à me rassurer, car je me décidai à profiter de la première occasion pour m’enfuir.
Mon père, après avoir envoyé au diable son homme de loi, M. Thatcher, la veuve, les tribunaux, et tout le monde en général, éprouva le besoin de se désaltérer. Nous allâmes donc chercher les provisions qu’il s’était procurées à la ville. Il y avait une lourde charge de farine, du lard, du whisky et des munitions, y compris un vieux livre pour servir de bourre. Lorsque j’eus jeté le sac de farine dans un coin de la cabane, je m’assis afin de me reposer et je songeai à ce que j’avais de mieux à faire. Ma résolution fut bientôt arrêtée. Je prendrais le fusil, les munitions, les lignes à pêche, les biscuits, et je me sauverais dans les bois. Mon idée était de doubler les étapes la nuit, de ne pas m’arrêter longtemps au même endroit et de vivre de ma chasse ou de ma pêche. De cette façon, je comptais arriver vite assez loin pour ne plus craindre d’être repris. Il ne s’agissait que de sortir. Pour rien au monde, je n’aurais risqué de réveiller mon père en essayant de m’emparer de la clef qu’il aurait sans doute soin de retirer, selon son habitude. Mais je pensai que, grâce au whisky et à ma scie, je pouvais m’échapper le soir même et gagner ainsi une bonne avance. J’étais si plein de mon projet que j’oubliai que le temps s’écoulait.
— Ah çà ! est-ce que tu dors ? me cria mon père. Voilà une heure que je t’attends.
Je courus le rejoindre, et il faisait déjà presque nuit quand les provisions furent rentrées. Tandis que je préparais le souper, mon père avala coup sur coup quelques gorgées d’eau-de-vie. Dès que le whisky lui montait à la tête, il me battait ou s’en prenait au gouvernement. Je fus enchanté de voir que, cette fois, il ne me donnait pas la préférence.
— Ça s’appelle un gouvernement ! dit-il. Eh bien, c’est du propre ! Enlever à un père son fils unique, qu’il a élevé sans demander un cent à personne, et cela juste au moment où ce fils se trouve à même d’aider son père ! Ce n’est pas tout non plus ; la loi a l’air de favoriser ce gredin de Thatcher, qui veut me dépouiller de mon bien. La loi oblige un homme qui vaut six mille dollars et davantage à se cacher dans une bicoque comme celle-ci, à porter des habits comme ceux-ci ! Et ça s’appelle un gouvernement. Je lui ai dit, à ce Thatcher : « Regardez ce chapeau ; le fond ne tient seulement pas. Je n’ai qu’à tirer pour qu’il me tombe sous le menton. Est-ce là un chapeau pour un des citoyens les plus riches de la ville ? »
Tout en grommelant, il se promenait à grands pas, sans regarder devant lui. Mal lui en prit, car il tomba, la tête la première, par-dessus le tonneau où nous gardions le lard et s’écorcha les chevilles. Il n’en continua pas moins à adresser des injures au gouvernement. Je l’aidai à se relever, et il se mit à sautiller à travers la cabane, tantôt sur une jambe, tantôt sur l’autre, en se frottant les chevilles. Enfin, il lança un formidable coup de pied au tonneau et poussa un hurlement à faire dresser les cheveux sur la tête. Il avait oublié que sa botte gauche laissait passer deux de ses doigts qui venaient de donner en plein contre une douve. Après s’être roulé sur le sol, il se calma un peu et eut recours au whisky pour se consoler.
Le souper terminé, il se remit à boire et remplit si souvent la timbale, que je me figurai qu’en moins d’une heure il serait trop bien endormi pour se réveiller avant le jour. Mais ce ne fut pas lui qui vida la cruche ; elle se vida toute seule, car il la laissa tomber sur le sol, où elle se brisa en morceaux. Au lieu de s’en prendre à moi, selon son habitude, il se jeta sur la couverture étendue devant la porte et m’ordonna de souffler la chandelle. Je m’allongeai dans mon coin, sans me désoler de ce contretemps. Je savais très bien que mon père ne tarderait pas à s’absenter de nouveau, puisqu’il n’avait plus de quoi boire. Une seule chose me préoccupait : oublierait-il d’emporter le fusil, comme cela lui arrivait souvent ? Ce fut en m’adressant cette question que je m’endormis.
Lorsque je me réveillai, il faisait déjà grand jour. Mon père, dont un rude coup de pied venait de me tirer de mon sommeil, se tenait à côté de moi, le fusil à la main, et d’abord je crus que c’était la suite de mon rêve.
— Debout, paresseux ! me dit-il. Auras-tu bientôt fini de te frotter les yeux ? C’est toi qui as rechargé le fusil, hein ?
— Non ; vous l’avez posé sur la table et je ne savais pas s’il était chargé ou non.
— Eh bien, une autre fois, tu passeras la baguette dans le canon et tu le mettras à ma portée. Faudra veiller. Une bande de voleurs travaille le long de la côte et assassine les gens.
— Je parie que c’est M. Thatcher qui vous a raconté des histoires pour vous effrayer. Les voleurs ne ramasseraient pas grand’chose ici.
— Possible ; mais, pas plus tard que la nuit dernière, ils ont tué un individu, rien que pour avoir son fusil… Allons, assez causé ; cours voir s’il y a du poisson sur les lignes pour notre déjeuner ; je te rejoindrai dans une minute.

Il ouvrit la porte et j’arrivai bientôt à l’endroit où notre barque était amarrée. L’eau commençait à monter, car je vis beaucoup d’épaves qui s’en allaient à la dérive. Je regrettai de ne pas me trouver à Saint-Pétersbourg. La crue du Mississipi faisait ma joie ; elle entraînait souvent des arbres entiers et des enfilades de bûches détachées d’un radeau. Il n’y avait qu’à les arrêter au passage et à les vendre au propriétaire d’un chantier ou d’une scierie. Je parle du bon temps où personne ne s’occupait de moi, où j’étais libre comme l’air, où Tom et ses camarades enviaient mon sort.
Voilà qu’au moment où je me baissais pour tirer une des lignes, je vois arriver un canot, un joli canot de treize à quatorze pieds de long et qui suivait le courant avec la légèreté d’un canard. Je piquai aussitôt une tête, tout habillé, et je nageai vers le canot. Je craignais de trouver quelqu’un au fond. C’est là un tour que l’on aime à jouer aux chercheurs d’épaves. Quand ils vont grimper dans une barque ou qu’ils l’ont presque amenée jusqu’à terre, le canotier se lève et se moque d’eux. Il n’en fut pas ainsi cette fois. La barque était vide. Je me hissai à bord et je revins vers la rive en pagayant.
— Elle vaut au moins dix dollars, me dis-je ; mon père sera content lorsqu’il verra ce que j’ai pêché.
Tandis que je gagnais une petite crique bordée de vignes et de saules, une autre pensée me vint. Je songeai que si je laissais le canot dans cette cachette, je pourrais descendre le fleuve à une distance de quarante ou cinquante milles, me mettre à l’abri de toute poursuite, et camper dans un bon endroit sans m’être fatigué par de longues marches.
La crique n’était pas très éloignée de la cabane et à chaque instant je crus m’entendre appeler. Après avoir fait glisser le canot sous le feuillage, je sautai à terre, je regardai à travers les branches et je me rassurai. Mon père n’avait rien vu. Quand il me rejoignit, il me trouva en train de lever les lignes et me traita de lambin. Comme il se serait bien aperçu à mes habits mouillés que j’avais pris un bain, je lui montrai du doigt la perche, puis je me secouai à la façon des barbets au sortir de l’eau. Cette explication lui suffit ; il se contenta de grommeler :
— Vaut mieux que ça t’arrive à toi qu’à moi. Si je tombais de là-haut tout habillé, je ne m’en tirerais pas. Seulement, tâche de ne pas recommencer et de prendre le sentier. Tu vaux six mille dollars.
Nous rapportâmes un gros poisson, qui nous fournit un bon déjeuner. Ensuite, je voulus me coucher sur l’herbe afin de me sécher au soleil.
— Bah ! dit mon père, tu te sécheras plus vite en ramant. Le fleuve monte et charrie de quoi remplir un chantier ; en moins d’une heure, nous raflerons assez de bois pour…
— Oui, assez de bois pour acheter du whisky à la ville, et je sais ce qui m’attend à votre retour.
Je venais de m’asseoir et d’allumer ma pipe ; mais il fallut s’exécuter. Au fond, je n’étais pas fâché de le voir si pressé. Plus tôt il s’en irait, plus tôt je serais libre.
Nous longeâmes d’abord le fleuve, car le courant ne portait pas de notre côté. Enfin, nous montâmes dans le canot. Le métier de ravageur n’est pas commode sur le Mississipi. À diverses reprises, nous faillîmes chavirer sans rien attraper. Au bout d’une demi-heure, la chance nous favorisa ; elle nous envoya une dizaine de troncs détachés d’un radeau et qui tenaient encore ensemble. Nous parvînmes à les conduire à terre, puis nous rentrâmes pour nous reposer en dînant. Ce bout de radeau promettait une bonne journée. Un autre que mon père ne s’en serait pas tenu là. Mais ce n’était pas son genre, surtout quand il avait soif. Il m’enferma donc vers trois heures et partit, son radeau à la remorque. Je me mis aussitôt à l’œuvre avec ma scie, et lorsque je sortis de ma prison, il n’était pas encore arrivé au bord opposé. Son canot ne formait plus qu’un point noir à peine visible sur l’eau.
Tout en ramant, j’avais songé à un moyen d’empêcher les gens de courir après moi. Je voulais faire croire que l’on m’avait jeté à l’eau. Les histoires de voleurs dont mon père s’était effrayé m’avaient donné cette idée.
Mon premier soin fut de courir au bûcher, où je trouvai la hache, et d’enfoncer la porte, démolissant le bois autour de la serrure. Alors je commençai à déménager. J’enlevai la farine, le lard, le café, la cafetière, le sucre, les biscuits, la gourde, le baquet, la scie, les couvertures, les tasses d’étain, les lignes à pêche, les allumettes, tout ce qui valait un cent. Je nettoyai la cabine. Il fallut plus d’un voyage pour transporter les provisions et le reste jusqu’au canot.
Je fis disparaître la sciure de bois, et pour combler le trou par lequel je m’étais échappé, je n’eus qu’à rajuster la bûche enlevée, que je calai avec des pierres, car elle se recourbait un peu en bas et ne touchait pas le sol. Je remis si bien les choses en ordre que vous ne vous seriez jamais douté que quelqu’un avait passé par là. D’ailleurs, comme la porte était ouverte, on ne s’aviserait pas de chercher une autre issue.
Mes préparatifs terminés, je décrochai le fusil que mon père, dans sa hâte, avait oublié et je m’enfonçai sous les arbres. J’aperçus bientôt un jeune amateur de glands qui se régalait et qui détala à mon approche. Les messieurs habillés de soie échappés des fermes voisines devenaient vite sauvages dans la forêt. J’abattis ce monsieur-là d’un coup de fusil et je le rapportai au camp, où je le posai à terre afin de le laisser saigner un peu. Je dis à terre, car c’était de la terre battue et non un parquet. Il s’agissait maintenant de faire disparaître maître habillé de soie. Je le mis dans un vieux sac que je traînai jusqu’à la porte, puis jusqu’au petit promontoire du haut duquel j’avais sauté le matin même et d’où il fit à son tour un beau plouf ! On n’aurait qu’à ouvrir l’œil pour reconnaître la route suivie par la victime. Ah ! comme je souhaitais que Tom se fût trouvé là !
Je songeai alors à un autre moyen de dérouter les curieux. Je retournai à mon canot reprendre le sac de farine et la scie. Je remis le sac à la place qu’il occupait ordinairement ; j’ouvris un trou au fond de la toile à l’aide de la scie et je le portai entre mes bras à une centaine de yards de la cabane. Cette fois, je me dirigeai vers une espèce de lac, situé derrière la cabane, peu profond et plein de roseaux — de canards aussi, dans la bonne saison. À l’extrémité la plus éloignée de la hutte, à quelques milles de distance, s’ouvrait un petit canal qui s’en allait je ne sais où. Naturellement, le trou laissa échapper un peu de farine et forma une piste tout le long du chemin. Pour revenir, je retournai le sac, dont l’ouverture était bien ficelée. Autrefois, mon père allait chercher au bord du lac des brassées d’osier qu’il vendait aux fabricants de paniers, de sorte qu’il y avait un sentier tout tracé. Je piétinai et je renversai les roseaux à l’endroit où il aboutissait, afin de donner à croire que les voleurs avaient passé par là.

Il faisait presque nuit et je commençais à me sentir fatigué. Après avoir regagné le canot avec ma farine et ma scie, je le laissai filer le long de la côte, pas très loin. Je l’arrêtai sous des saules et je l’amarrai à une branche qui s’avançait au-dessus de l’eau. L’appétit aussi était venu. Je mangeai un morceau, puis je me couchai au fond de la barque pour fumer et arrêter un plan. Je me dis :
— Ils suivront la piste du sac de pierres jusqu’au bord de l’eau et ils dragueront le fleuve. Ils suivront ensuite la piste de la farine et iront jusqu’au petit canal qui conduit hors du lac pour tâcher de découvrir les voleurs. Comme ils ne trouveront rien, ils se lasseront bientôt et cesseront de chercher. On me croira mort et si mon père touche les six mille dollars, il n’en demandera pas davantage. Me voilà donc libre de camper où il me plaira. L’île Jackson me paraît un bon endroit pour le moment ; je la connais assez bien et personne n’y vient. Le gibier et le poisson n’y manquent pas ; et puis ce n’est pas trop loin de Saint-Pétersbourg. Avec mon canot, je pourrais traverser la nuit jusqu’à la ville, si j’ai besoin de quelque chose, et faire mi-a-ou sous la croisée de Tom. Ce sera une fière surprise pour lui ! Oui, l’île Jackson me va.
Je finis par m’endormir. Lorsque je me réveillai, je me demandai où j’étais. Je me redressai et regardai autour de moi, un peu effrayé. Au bout d’une minute, je me rappelai tout. Le fleuve me semblait avoir plusieurs milles de largeur. La lune répandait une telle clarté que j’aurais pu compter, à des centaines de yards de distance, les troncs d’arbres que le courant emportait. Aucun bruit ne se faisait entendre et la fraîcheur de l’air annonçait qu’il était tard.
Je bâillai et m’étirai les bras. J’allais démarrer pour me mettre en route lorsque le silence fut troublé par un son qui m’arrivait comme en flottant sur l’eau. Je prêtai l’oreille ; il me sembla saisir le son sourd et régulier que produisent les avirons la nuit en grinçant contre les plats-bords. J’écartai les branches. C’était bien cela ; une barque se montrait au loin. La distance m’empêcha d’abord de distinguer le nombre des rameurs, car je pensais qu’il devait y en avoir plus d’un. Quand elle se rapprocha, je vis qu’elle ne portait qu’un seul homme. Avant d’être parvenue en face de ma cachette, elle quitta le milieu du fleuve pour longer la côte, où le courant est moins rapide. Elle passa si près de moi que j’aurais presque pu la toucher avec ma gaffe, et je reconnus mon père. Il n’avait pas trop entamé sa provision de whisky, à en juger par la façon dont il maniait les avirons. Je ne l’attendais pas si tôt et j’eus joliment peur.
Je ne perdis pas de temps. Cinq minutes plus tard, je filais rapidement à l’ombre des bords. Je fis ainsi deux milles et demi, puis je m’avançai vers le milieu du fleuve. Je ne voulais pas passer trop près de l’embarcadère du bac, d’où l’on aurait pu me voir et me héler. Je me recouchai au fond du canot et le laissai suivre le courant. C’est étonnant comme le ciel paraît profond quand on le contemple, étendu sur le dos, par un beau clair de lune. Et comme on entend de loin sur l’eau par une nuit pareille ! J’entendis très bien parler et rire sur l’embarcadère. Peu à peu le bruit des voix devint moins distinct. J’avais dépassé le bac. Lorsque je me relevai, je me trouvais à deux milles et demi de l’île Jackson, que Tom appelait toujours l’île des pirates depuis le séjour que nous y avions fait. Couverte d’arbres, elle se dressait presque au milieu du fleuve comme un grand steamer dont on aurait éteint les lumières. La plage de sable de la pointe était complètement submergée. Grâce à la force du courant, le trajet fut vite accompli. Je manœuvrai de façon à tourner l’île pour aborder sur la rive qui s’étend en face de la côte de l’Illinois. J’amarrai le canot dans une anse profonde que je connaissais bien et où il serait invisible, même en plein jour.
Je n’avais pas beaucoup ramé et pourtant je tombais de fatigue, ou plutôt de sommeil. J’entrai dans le bois ; je m’étendis sur l’herbe et
je ne tardai pas à m’endormir, heureux d’avoir reconquis ma liberté.
Quand je me réveillai, je jugeai à la hauteur du soleil qu’il devait déjà être plus de huit heures. Couché à l’ombre, au pied d’un chêne, je voyais le ciel à travers deux ou trois échappées du feuillage ; mais, plus loin, les arbres étaient touffus et rendaient l’endroit obscur. Il y avait des places où la lumière tamisée par les branches dansait sur le sol, et la danse des feuilles montrait qu’il y avait un peu de brise là-haut. Deux écureuils, installés juste au-dessus de moi, me regardaient d’un air amical, ce qui ne les empêcha pas de s’enfuir dès que je bougeai.
Je n’avais pas la moindre envie de me lever pour préparer mon déjeuner. Je commençais à m’endormir de nouveau, lorsque je crus entendre du côté du fleuve le son d’un boum, qui me tira le sable des yeux. Je m’accoude et je prête l’oreille. Bientôt le même son se reproduit. Pour le coup, me voilà bien réveillé. Je cours vers la pointe de l’île, j’écarte un peu les branches d’un buisson et je vois un nuage de fumée qui flotte sur l’eau, à la hauteur de l’embarcadère. Derrière le nuage, j’aperçois le petit steamer qui sert de bac entre la côte de l’Illinois et Saint-Pétersbourg ; le pont couvert de passagers, il descendait le courant. Boum ! Je savais ce que cela voulait dire. On tirait le canon afin de faire remonter mon cadavre sur l’eau.
J’avais faim ; mais ce n’était pas le moment d’allumer du feu ; la fumée m’aurait trahi. Je me tins donc coi, écoutant les détonations et regardant venir le steamer. Le Mississipi a un mille de largeur sur ce parcours et on ne se lasse pas de l’admirer par une matinée d’été. Aussi me serais-je joliment amusé à voir chercher mes restes, si j’avais eu un morceau à me mettre sous la dent. Je me rappelai qu’en pareille occasion les malins fourrent une goutte de vif-argent dans des pains qu’ils laissent flotter sur l’eau, parce que, selon eux, les pains ne manquent jamais de s’arrêter juste au-dessus du cadavre du noyé. S’il passe un pain près de mon île, pensai-je, le noyé lui dira deux mots. Je crus que j’aurais plus de chance sur l’autre bord, du côté de l’Illinois, à cause du courant. Je ne me trompais pas. Je vis arriver un pain, et, à l’aide d’une longue branche, je faillis l’amener à moi ; mais mon pied glissa et il m’échappa. Par bonheur, je ne perdis rien à attendre ; le courant m’apporta bientôt une nouvelle aubaine, et, cette fois, je ne tendis pas en vain ma perche. Après avoir enlevé la cheville qui servait de bouchon, je fis tomber la petite boule de vif-argent et je me régalai. C’était du bon pain de boulanger, qui me sembla d’autant meilleur qu’il y avait longtemps que je n’en avais mangé.
Installé derrière un buisson, je continuai, tout en grignotant, à surveiller la marche du steamer. J’espérais qu’il prendrait la même direction que le pain et que je pourrais reconnaître ceux qui le montaient. En effet, le vapeur fila si près de la côte que l’on aurait pu aborder en glissant la planche jusqu’à terre. Mon père, M. Thatcher, Tom Sawyer, sa vieille tante Polly, Joe Harper, étaient à bord, avec bien d’autres figures de connaissance. Tout le monde parlait du meurtre ; mais le capitaine interrompit les conversations en criant :
— Attention ! le courant porte de ce côté ; le cadavre a pu être poussé parmi ces broussailles et s’y empêtrer.
Les passagers se pressèrent du côté de l’île, et, penchés sur la lisse d’appui, regardèrent de tous leurs yeux sans rien découvrir. Soudain, au moment où je m’y attendais le moins, le canon partit juste en face de moi, si bien que le bruit m’assourdit et que je fus presque aveuglé par la fumée. Si la charge eût contenu une balle ou deux, ils auraient trouvé le cadavre qu’ils cherchaient. Grâce au ciel, j’en fus quitte pour la peur. Le steamer disparut complètement derrière une langue de terre et continua sa route. J’entendais de temps à autre les détonations qui m’arrivaient de plus en plus lointaines. Au bout d’une heure, je n’entendis plus rien. L’île Jackson a trois milles de long. Je crus qu’ils étaient arrivés au pied de l’île et qu’ils abandonnaient la partie ; mais non ; ils ne se décourageaient pas encore. Ils voulurent explorer l’autre bord, du côté du Missouri. Les voilà donc repartis, à toute vapeur, tirant de dix minutes en dix minutes un coup de canon. Arrivés à la tête de l’île, ils cessèrent leur feu et reprirent la direction de la ville.

Je n’avais plus rien à craindre maintenant. Personne ne viendrait me déranger. Je sortis mes provisions du canot et j’établis mon bivouac dans une des parties les plus épaisses du bois. Je formai une sorte de tente avec une de mes couvertures afin de mettre mes affaires à l’abri de la pluie. Un gros poisson ne tarda pas à gober mon hameçon, et, un peu avant le coucher du soleil, j’allumai mon feu de camp.
Mon souper fut vite expédié ; puis, je posai une ligne avec la certitude de la trouver bien garnie à ma prochaine visite.
La nuit venue, je m’allongeai près du feu et je bourrai ma pipe. Je me sentis d’abord fort satisfait ; mais peu à peu le silence qui régnait autour de moi me sembla lugubre. J’allai donc m’asseoir au bord du fleuve, où je m’amusai à écouter le clapotis de l’eau, à compter les radeaux qui passaient, ou à regarder les étoiles. Cela ne m’empêcha pas de continuer à broyer du noir.
— Décidément, me dis-je, j’aimerais mieux une île moins déserte… Bah ! je m’y habituerai. Allons me coucher ; il n’y a pas de meilleur moyen de tuer le temps.
Je regagnai mon camp et je m’endormis. Le lendemain, quand j’ouvris les yeux, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les feuilles dansaient ; il n’en fallait pas tant pour mettre en fuite mes idées de la veille. Après avoir déjeuné, je me décidai à explorer mon domaine. Je le connaissais comme ma poche ; mais aujourd’hui qu’il m’appartenait, je m’y intéressais davantage. Je me dirigeai en flânant vers la pointe de l’île, mon fusil sur l’épaule ; je l’avais emporté pour me protéger plutôt qu’avec l’intention de chasser, car le gibier abondait dans le voisinage de mon camp. Chemin faisant, je vis beaucoup de fraises mûres ; il y avait un tas d’autres fruits qui, par malheur, étaient encore verts. Tout à coup, je faillis poser le pied sur un assez gros serpent qui fila en rampant dans l’herbe et me voilà parti après lui. Au moment où je m’apprêtais à tirer, je me trouvai en face d’un feu de camp qui fumait encore.
On n’est jamais content ! Évidemment, mon île était moins déserte que je ne l’avais cru, et, au lieu de sauter de joie, je bondis en arrière ; sans même regarder autour de moi, je détalai au plus vite. De temps à autre, je m’arrêtais une seconde dans un taillis et j’écoutais. Si une branche sèche se brisait sur mon passage, il me semblait que quelqu’un me coupait l’haleine en deux pour ne m’en laisser que la moitié — et la plus petite moitié encore ! À distance, les troncs d’arbres, les branches mortes avaient l’air d’hommes accroupis et de bras allongés pour m’empoigner.
Revenu à mon camp, je ne me sentais pas très alerte ; mais ce n’était pas le moment de se croiser les bras. Je me dépêchai de replacer tout mon bagage dans la barque afin de le mettre hors de vue ; j’éteignis le feu, dont j’éparpillai les cendres, et je grimpai dans un arbre. J’y restai longtemps — deux heures au moins, je crois — sans rien voir ni entendre de suspect. On s’ennuie à demeurer éternellement assis sur une fourche, même quand elle est tapissée de mousse. Je finis par descendre. Après avoir mangé ce qui restait de mon déjeuner, une nouvelle marche me dégourdit les jambes. J’avais soin, bien entendu, d’éviter les clairières. Le seul résultat de ma promenade fut de me démontrer que celui que je guettais se promenait d’un autre côté.
La tombée de la nuit me ramena à mon canot. Avant le lever de la lune, j’étais à un quart de mille de mon premier bivouac, sur la côte de l’Illinois. Je venais de dire un dernier mot à un bon souper préparé dans le bois quand le bruit d’un galop lointain, bientôt suivi d’un bruit de voix, m’arriva. J’avais presque résolu de passer la nuit sur la lisière de la forêt. Cette alerte dérangea mes projets. Les cavaliers ne devaient certes pas songer à moi ; mais mon fusil et ma couverture pourraient les tenter si par hasard la faible lueur de mon feu attirait leur attention. Je rapportai mon attirail dans le canot ; je poussai au large et j’attachai mon amarre à l’endroit d’où j’étais parti. Je comptais dormir à poings fermés dans ma barque ; mais chaque fois que je commençais à m’assoupir, je me réveillais en sursaut, convaincu que quelqu’un me saisissait par la gorge. Enfin, je me dis :
— Pas moyen de vivre ainsi. Il faut que je découvre qui est avec moi sur l’île.
J’empoignai ma pagaie, et, m’éloignant un peu de la rive, je laissai glisser le canot sans sortir de l’ombre, car la lune éclairait encore le milieu du fleuve. Au bout d’une heure, j’eus presque atteint l’extrémité nord de l’île, et une légère brise, qui commençait à rider la surface du fleuve, annonça que la nuit touchait à sa fin. D’un coup d’aviron, j’amenai la barque à terre et je m’assis sur l’herbe. La lune avait achevé sa faction et maintenant il faisait noir comme dans un four. Mais bientôt une pâle clarté grise se refléta sur l’eau : c’était l’aube. Après avoir attendu un peu, je pris mon fusil et je me dirigeai du côté où j’avais vu le feu de camp. J’espérais bien qu’on l’aurait ranimé. Quand on se croit seul dans un bois, on ne se donne guère la peine de changer de bivouac. Une lueur qui brillait à travers les arbres me prouva que je ne me trompais pas. Arrivé assez près pour jeter un coup d’œil sur la petite clairière, la première chose que je vis fut un homme couché à deux ou trois pas du feu. Il venait de se réveiller et se frottait les yeux. Il bâilla et se tira les bras. C’était Jim, le nègre de miss Watson ! Je ne songeai plus à me cacher, je vous en réponds.
— Holà, Jim ! m’écriai-je en courant à lui.
Il fut vite debout ; mais, au lieu de paraître heureux de me voir, il tomba à genoux et me contempla d’un air effaré.
— Ne me faites pas de mal, massa Huck, dit-il enfin. Je n’ai jamais fait de mal à personne, moi. Il fallait rester au fond de l’eau ; c’est la vraie place d’un noyé. Le vieux Jim a toujours été votre ami ; laissez-le tranquille.
J’eus assez de peine à le rassurer. Mes gambades auraient pourtant dû lui prouver qu’il ne se trouvait pas en face d’un noyé. Je lui racontai comment je m’étais échappé de la cabane. Je lui dis que la vue de son foyer m’avait joliment effrayé ; mais que l’idée de ne pas être seul sur l’île ne me faisait plus peur. Je ne craignais pas d’être trahi par lui. J’étais si ravi d’avoir quelqu’un avec qui causer que je jacassai comme une pie borgne. Jim, cependant, demeurait agenouillé ; il me regardait, bouche bée, sans répondre un mot.
— Dis donc, Jim, lui demandai-je, as-tu jamais vu manger un noyé ?
— Jamais, répliqua Jim,
— Eh bien, dépêche-toi de jeter une brassée de bois sur ton feu et tu me verras remuer les dents. Le jour arrive au grand galop, il s’agit de déjeuner.

— Vous ne vous moquez pas de moi ? demanda le nègre qui s’était levé. Le bois ne manque pas, mais le feu ne me sert qu’à m’empêcher de grelotter la nuit. On n’en a pas besoin pour faire la cuisine. Il n’y a que des fraises ici.
— Quoi ! tu te nourris de fraises ?
— Je n’ai pas trouvé autre chose.
— Depuis combien de temps es-tu dans l’île ?
— Depuis le jour où vous avez été jeté à l’eau.
— Alors tu dois être affamé ?
— Je crois que je mangerais un cheval ! Et de quoi vous êtes-vous nourri, massa Huck ?… Ah ! je vois que vous avez un fusil. Voilà qui est bon. Tâchez de tuer quelque chose.
— Viens avec moi, lui dis-je, et je te promets un déjeuner solide.
Je l’emmenai du côté où j’avais laissé le canot, et, tandis qu’il allumait le feu, j’allai chercher le lard, la farine, la poêle à frire, le café, la cafetière, les timbales, le sucre et tout le bataclan. Je rapportai aussi un brochet qu’il déclara être le meilleur poisson qu’il eût jamais mangé. Il dévora ensuite plusieurs tranches de lard et une bonne ration de biscuits. Enfin, lorsqu’il fut rassasié, nous nous allongeâmes sur l’herbe.
— Voyons, me dit Jim, qui donc a été tué dans cette cabane, si ce n’est pas vous ?
Je lui racontai l’histoire de ma fuite ; puis je lui demandai par quel hasard il se trouvait dans l’île. Il parut inquiet et hésitant.
— Je ferais peut-être mieux de ne pas le dire… Mais vous ne me trahirez pas, Huck ?
— Jamais de la vie !
— Eh bien, je me suis sauvé.
— Jim… je ne me serais pas attendu à ça de ta part.
— Oui ; mais vous avez promis de ne pas me dénoncer.
— Si l’on apprend que je t’ai gardé le secret, on me traitera de canaille d’abolitionniste et on me montrera au doigt. N’importe, j’ai promis, je tiendrai…
— Vous vous êtes sauvé aussi, massa Huck.
— Oh ! ce n’est pas la même chose ; je n’appartiens à personne ; on ne m’a pas acheté.
— Et on ne peut pas vous vendre, non plus. Je n’aurais pas mieux demandé que de rester ; seulement, dans les derniers temps, les allées et venues d’un planteur de coton m’ont mis la puce à l’oreille. J’ai des raisons pour ne pas aimer les planteurs. Enfin, un soir, à force d’écouter aux portes, j’ai entendu miss Watson dire à la veuve qu’on lui offrait huit cents dollars de Jim ; que c’était une grosse somme ; que l’on voulait une réponse le lendemain même et qu’elle hésitait. Je n’attendis pas pour en savoir plus long et me voilà en route pour emprunter un canot un peu au-dessus de la ville, à distance des maisons. Pas de chance : il passait trop de monde. Alors, je me suis caché sous le vieux hangar du charpentier…
— L’endroit est bon ; j’y ai souvent dormi et personne ne m’a dérangé.
— Vous n’auriez pas beaucoup dormi ce soir-là, massa Huck ; mais pour sûr, personne ne voulait me déranger. C’était un incendie, un combat de coqs, une danse, un éboulement ou quelque chose de ce genre qui attirait les curieux. Je n’osais pas bouger. Bien avant six heures du matin, ce fut le tour des trains de bois. Vers huit ou neuf heures, toutes les barques étaient démarrées ; seulement, elles remontaient le courant au lieu de le descendre. Je n’y comprenais rien. Enfin, je sus à quoi m’en tenir. Des rameurs fatigués s’arrêtèrent en face du hangar, et j’ai des oreilles. Votre père venait de mettre la ville sens dessus dessous et on allait voir la cabane où vous aviez été assassiné.
— Et voilà pourquoi tu m’as pris pour un revenant ?
— Oui.
— Bêta ! allons, finis ton histoire.
— Eh bien, je me suis glissé sous les copeaux. Il ne me restait plus rien des provisions que j’avais fourrées dans ma poche en passant par la cuisine ; mais je n’étais pas effrayé. Les vieilles devaient aller au grand jour à un camp meeting[1] pour ne rentrer que le soir. Le matin, elles me croiraient aux champs, et, à leur retour, j’espérais être déjà loin. Il n’y avait qu’un moyen de m’échapper. Si j’essayais de me sauver à travers bois, on mettrait les chiens à mes trousses. Si je prenais un canot pour traverser l’eau, on verrait d’où j’étais parti ; on n’aurait pas beaucoup de peine à trouver l’endroit où j’avais abordé et on me donnerait la chasse.
— Mais tu n’as pas pu arriver ici à la nage ? Tu te serais noyé dix fois.

— Et puis je voulais aller plus loin. La nuit venue, je m’embusque au bord du fleuve pour attendre un radeau. Les radeaux ne laissent pas de piste. Bientôt, je vois arriver une lumière. J’entre dans l’eau, je pousse un tronc d’arbre devant moi, je nage contre le courant, je m’accroche au train de bois et je grimpe à l’arrière. Les débardeurs se tenaient au milieu, autour de la lanterne. L’eau montait et le courant était rapide, de sorte que je comptais que, vers quatre heures du matin, je serais à vingt-cinq milles de la ville, et, qu’avant l’aube, je pourrais gagner les bois sur la côte de l’Illinois. Mais le diable s’en mêla. Nous n’avions pas encore dépassé la tête de l’île Jackson, quand un gaillard se dirige à l’arrière avec la lanterne. Je n’avais rien à lui dire, pas la peine de l’attendre. Je me laisse glisser dans l’eau et j’atteins l’île en un clin d’œil. Je croyais pouvoir aborder n’importe où. Pas du tout. La crue avait couvert la grève et la côte était trop escarpée. J’arrivai presque au pied de l’île avant de trouver un bon endroit. Une fois à terre, je me traitai d’imbécile ; j’aurais dû me rappeler que, d’heure en heure, on promène ainsi la lanterne d’un bout à l’autre des radeaux. Par bonheur, ma pipe, mes allumettes et mon tabac, que j’avais dans mon chapeau, n’étaient pas mouillés. Je m’enfonçai sous les arbres ; j’allumai un feu de camp et je me séchai. Il ne me manquait qu’un bon souper.
— Pourquoi n’as-tu pas cherché des œufs de tortue ?
— Les œufs de tortue se trouvent dans le sable et le sable était sous l’eau ; avec ça qu’ils sont faciles à dénicher la nuit.
— C’est vrai. Et le jour, tu ne pouvais pas te risquer au bord de l’eau. Tu as entendu tirer le canon, hein ?
— Je crois bien. J’ai deviné tout de suite que c’était pour vous.
En ce moment, cinq ou six oiseaux arrivèrent près de nous ; ils volaient, ou plutôt ils voletaient en rasant le sol, s’arrêtant à de courts intervalles pour repartir presque aussitôt. Jim me dit que c’était là un signe de pluie. Quand les oisillons volent de cette façon, gare l’averse ! Je voulus en attraper un ; mais Jim m’arrêta.
— Ça nous porterait malheur, s’écria-t-il. Un jour que mon père était très malade, j’ai pris une grive qui voletait à ras de terre. Eh bien, ma grand’mère m’a déclaré qu’il mourrait, et il est mort le soir même.
Il me parla ensuite d’une foule d’autres choses qu’on doit éviter de faire, sous peine de s’attirer une mésaventure plus ou moins sérieuse. Il ne faut jamais secouer une nappe après le coucher du soleil. Quand on prépare un plat, il ne faut jamais compter ce qu’on met dedans — les œufs d’une omelette, par exemple. Si le propriétaire d’une ruche vient à trépasser, il faut avertir les abeilles dès l’aube, sans quoi elles cesseraient de travailler et crèveraient.
Les nègres sont très forts pour reconnaître les mauvais présages. Une fois lancé sur ce terrain-là, Jim eut l’air de ne plus pouvoir s’arrêter et la plupart de ses histoires n’avaient rien de neuf pour moi.
— Ah çà ! Jim, lui demandai-je enfin, est-ce qu’il n’y a pas de signes qui annoncent qu’on aura de la chance ?
— Pas beaucoup, Huck. À quoi serviraient-ils ? On n’a pas besoin de se garer contre la bonne chance. Pourtant, il y en a. Si vous avez les bras longs, c’est signe que vous deviendrez riche.
— Tu as les bras longs, hein, Jim ?
— Pourquoi me demandez-vous ça ? Vous avez des yeux.
— Eh bien, es-tu riche ?
— Je l’ai été et je le serai encore. Dans le temps, j’ai eu quatorze dollars à moi ; mais ils sont partis plus vite qu’ils n’étaient venus.
— Tu as joué ?
— Pas si bête. J’ai acheté une vache dix dollars, et elle est morte le lendemain.
— De sorte que tu as perdu ce qu’elle t’avait coûté ?
— Pas tout. J’ai vendu la peau et la graisse un dollar et dix cents.
— Il te restait cinq dollars et dix cents. Qu’en as-tu fait ?
— Vous connaissez le nègre à jambe de bois de massa Bradish ? Il avait ouvert une banque et promis quatre dollars à la fin de l’année à ceux qui mettraient un dollar dans l’affaire. Tous mes camarades lui ont apporté leur argent ; mais comme j’en avais plus qu’eux, j’ai demandé davantage. Alors, il a fini par offrir de me rembourser trente-cinq dollars au bout de l’année et il a empoché mes cinq dollars. Je ne les ai jamais revus et ils ne m’ont pas rapporté un liard. La jambe de bois était tout simplement un filou. J’ai eu beau le rosser, pas moyen de lui faire rendre gorge.
— Allons, Jim, ne t’arrache pas les cheveux. Puisque tu es sûr de redevenir riche tôt ou tard, tu as tort de te désoler.
— Oui, c’est vrai ; et, à présent que j’y pense, je suis déjà riche. Je suis mon maître et je vaux huit cents dollars. Si je les avais, je n’en
demanderais pas davantage.
Je voulais explorer un endroit que j’avais remarqué au beau milieu de mon île durant ma promenade de la veille. Jim se décida à me suivre, et nous fûmes bientôt arrivés, car l’île Jackson n’a que trois milles de long. L’endroit en question était une crête qui s’élevait à une hauteur de quarante pieds environ. Nous eûmes de la peine à grimper. La pente devenait de plus en plus raide à mesure que nous montions et les buissons épineux nous barraient parfois la route. Parvenus au sommet, nous nous trouvâmes en face d’une caverne creusée dans le roc et qui s’ouvrait du côté du Missouri. Elle n’était pas très grande ; mais Jim pouvait s’y tenir debout et on n’y avait pas trop chaud. Mon compagnon parut ravi de cette découverte. Il me proposa de repartir aussitôt pour emménager nos provisions et nous installer dans la grotte.
— Il n’y a qu’à amarrer le canot juste en face de l’endroit où nous sommes, me dit-il. D’ici, je verrai arriver les curieux de loin, s’il en vient, et nous serons sur la côte de l’Illinois avant qu’ils aient abordé. Et puis les oiseaux nous ont avertis qu’il va pleuvoir. Quand la pluie tombe dans cette saison, elle tombe bien ; les provisions seront perdues.
Je n’avais pas besoin de l’avis des oiseaux pour deviner que le temps allait changer, et je savais aussi que les gens qui se mettraient en quête de Jim partiraient de Saint-Pétersbourg, c’est-à-dire du côté du Missouri. Je me laissai donc convaincre. La barque, amenée jusqu’au milieu de l’île, fut cachée sous les saules. Jim se chargea de ce qu’elle contenait et regagna la caverne, où je ne tardai pas à le rejoindre avec deux poissons qui avaient mordu à nos lignes.
L’entrée de notre grotte était si large que nous ne manquions ni d’air ni de jour.

D’un côté de la porte — il n’y avait pas de porte, mais ça ne fait rien — un bout de rocher plat s’avançait au dehors, comme pour nous servir de cuisine. Jim alluma son feu sur cette dalle, que les buissons protégeaient contre le vent, et notre dîner fut vite préparé. Les provisions installées au fond de la caverne, nous avions étendu les couvertures à l’intérieur, près du foyer, car le sol semblait un peu humide. Nous mangeâmes d’aussi bon appétit que si nous avions été dans le plus beau salon de la veuve. Lorsqu’on a faim, on se passe fort bien de table. Une table nous aurait même gênés, attendu que les chaises manquaient.
Peu à peu, le ciel s’assombrit, puis ce furent des coups de tonnerre à vous assourdir, des éclairs à vous aveugler. Enfin, la pluie se mit à tomber à torrents. Les oiseaux ne s’étaient pas trompés. Je n’ai jamais entendu le vent souffler si fort. Tantôt, au-dessous de nous, les branches des arbres se courbaient sous l’averse ; tantôt une rafale les relevait et les tordait. Un moment on ne voyait presque rien ; le moment d’après, frst ! tout avait l’air de flamber et j’apercevais au loin les arbres qui agitaient leurs branches. Une seconde plus tard, c’était la bouteille à l’encre, même à vingt pas de la caverne. Alors le tonnerre recommençait à gronder ; on aurait dit un tas de barriques vides roulant du haut en bas d’un escalier.
— Eh bien, Jim, dis-je à mon compagnon, qui ne se montrait pas trop rassuré, est-ce que l’orage t’a coupé l’appétit ? Est-ce que tu ne te crois pas à l’abri ?
— Ah ! répliqua-t-il, vous ne seriez pas à l’abri sans Jim. Nous serions tous les deux dans le bois et à moitié noyés.
Après l’orage, le fleuve continua à monter pendant dix ou douze jours, et une bonne partie de l’île fut inondée. Je ne parle pas seulement des berges ; même à l’intérieur, la pluie avait laissé dans les bas-fonds une foule de petits lacs de trois ou quatre pieds de profondeur. Les rives de l’Illinois étaient complètement submergées, et, de ce côté, le Mississipi avait maintenant plusieurs milles de large ; mais la distance qui nous séparait du Missouri restait à peu près la même, parce que le terrain formait dans cette direction une sorte de mur qui empêchait l’eau de s’étendre.
Le jour, nous nous promenions en canot sur notre île. Il faisait très frais dans le bois, même lorsque le soleil desséchait les endroits découverts. Le canot se faufilait entre les arbres et quelquefois les lianes devenaient si pressées qu’il fallait reculer pour s’ouvrir un passage ailleurs. Sur les tertres ou sur les troncs d’arbres abattus qui sortaient de l’eau, on voyait des lapins et d’autres bêtes ; la faim les apprivoisait joliment, et je crois qu’ils ne demandaient qu’à se laisser prendre. Il y avait aussi des tortues ; mais elles glissaient dans l’eau à notre approche. Les serpents ne manquaient pas non plus ; nous en rencontrions jusque sur le plateau où se trouvait la caverne.
Un soir — nous évitions autant que possible de sortir du bois en plein jour — Jim poussa un cri de joie à la vue d’un radeau échoué sur la rive. Quand je dis un radeau, je me trompe ; ce n’était que la moitié d’un grand train de bois qui avait dû se détraquer pendant l’orage et qui venait sans doute d’une des grandes scieries établies au-dessus de Saint-Pétersbourg. En effet, il se composait de planches de sapin très unies et assez solidement attachées. Il mesurait bien douze pieds de large sur quinze ou seize de long, avec une petite plate-forme très commode pour ceux qui tenaient à rester les pieds secs.
— Il n’y a pas de quoi se frotter les mains, dis-je à Jim. Les planches ne se mangent pas. Elles rapporteraient gros dans un chantier ; par malheur, il faudrait aller loin pour les vendre.
— Justement, massa Huck ! J’espère que nous irons assez loin quand l’eau baissera un peu, et, sur le Mississipi, il vaut mieux voyager sur un bon radeau que dans une coquille de noix. Et puis, l’île Jackson est trop près de la ville. Je voudrais déjà être parti. Personne ne viendra vous chercher ici, parce qu’on vous croit mort ; moi, c’est une autre histoire.
— Pas du tout, Jim. Comme je ne suis pas mort, on nous prendrait du même coup et on me ramènerait là-bas. Sois tranquille, je ne tiens pas plus que toi à être pris. En attendant, ton idée n’est pas mauvaise ; fixons le radeau de façon à ce qu’il ne s’envole pas.
Le lendemain, vers l’aube, nous allâmes lever nos lignes. Devinez un peu ce que nous vîmes arriver le long de la côte de l’Illinois ? Une maison ! ou du moins le haut d’une maison en bois qui suivait lentement le courant. Dieu sait comment elle avait été entraînée et comment elle se soutenait sur l’eau. Sans doute, elle s’appuyait sur des troncs d’arbres accrochés en route et qui ralentissaient sa marche. Elle était à deux étages et penchait en avant. Nous l’atteignîmes en pagayant, et, à défaut de porte, Jim entra par une croisée qu’il enfonça avec son aviron. Il ne faisait pas encore assez clair pour bien voir à l’intérieur ; nous attachâmes le canot à l’arrière de l’épave et nous nous assîmes. Le jour vint avant que nous eussions atteint la pointe de l’île. Alors, en regardant par la fenêtre, nous distinguâmes un lit, une table, des chaises renversées et une foule d’objets qu’on semblait avoir jetés au hasard sur le parquet. Quelque chose gisait dans le coin le plus éloigné de la croisée ; ça avait l’air d’un homme endormi.
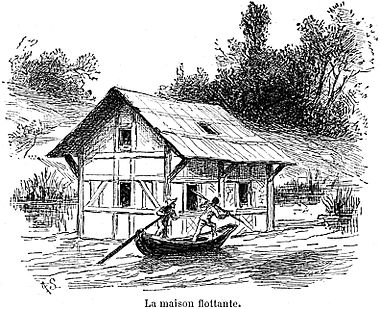
— Holà ! hé ! cria Jim.
Rien ne bougea. Je criai à mon tour ; puis Jim sauta dans la chambre.
— Il ne dort pas, me dit-il au bout d’un instant. Non, ma foi. Il a reçu une balle dans la poitrine et il doit être mort depuis deux ou trois jours. Je vais vous aider à grimper ; mais ne le regardez pas, Huck.
Il s’était dépêché de jeter un bout de tapis sur le corps ; il aurait pu s’en dispenser ; je n’éprouvais pas la moindre envie de regarder.
— Tiens, lui dis-je en lui montrant un masque de drap noir que je venais de ramasser, c’est la bande dont mon père a parlé qui a fait le coup.
— Tant pis, répliqua Jim ; ces gredins ne laissent derrière que ce qui ne vaut pas la peine d’être emporté.
Les gredins paraissaient avoir tout bousculé ; mais ils n’avaient pas tout emporté. Accrochés aux murs, il y avait des robes, des jupes et quelques habits d’homme à ma taille. Ils arrivaient à propos, car mes vêtements tombaient en loques. Nous ramassâmes aussi une hachette, des livres, un couteau de poche, un paquet de chandelles, un chandelier de cuivre, une gourde, deux tasses d’étain, un couvrepied rapiécé, un marteau, des clous, un collier de chien, une ligne à pêche aussi épaisse que mon petit doigt, un fer à cheval, une cruche à moitié pleine de whisky ; tout cela pouvait servir. Notre dernière trouvaille fut une jambe de bois ; elle était trop courte pour Jim, trop longue pour moi, et les courroies manquaient ; à part ce défaut, c’était une très belle jambe. J’eus beau chercher, je ne parvins pas à mettre la main sur l’autre.
Quand nous fûmes prêts à pousser au large, nous nous trouvions à un quart de mille du pied de l’île et il faisait déjà grand jour. J’obligeai Jim à se coucher au fond du canot, parce que, s’il était resté assis, on aurait reconnu un nègre d’assez loin. J’avais traversé le fleuve des centaines de fois et j’étais bon rameur ; sans quoi, je ne serais peut-être jamais parvenu à me rapprocher des côtes de l’Illinois. Je finis par regagner l’eau dormante au bord de l’île ; mais je me sentais joliment fatigué. Jim prit à son tour les avirons et nous arrivâmes sains et saufs à notre point de départ.
Après déjeuner, j’adressai une foule de questions à Jim au sujet du mort que le courant emportait au loin. Je cherchais à deviner si c’était un des voleurs ou s’il avait été tué par eux. Le nègre détourna la conversation.
Je me mis à examiner une espèce de houppelande qui semblait avoir été taillée dans une vieille couverture de laine. Après l’avoir décrochée avec d’autres vêtements pendus aux murs de la maison flottante, je l’avais jetée de côté ; mais Jim s’était obstiné à l’emporter. Je découvris, cousus dans la doublure du collet, huit dollars en argent.
— Eh bien, demandai-je au nègre, soutiendras-tu encore qu’il ne faut jamais toucher à une peau de serpent ? Je t’ai raconté avant-hier que j’ai trouvé une peau de serpent sur le plateau, à l’entrée de la caverne, et que je l’ai écrasée entre mes doigts. Tu as prétendu que rien ne portait malheur comme de manier ces machines-là. Tu vois que c’est tout le contraire.
— Attendez un peu, Huck, ça viendra ; rappelez-vous que je vous l’ai dit, ça viendra.
Il ne se trompait pas et je n’eus pas le temps d’oublier sa prédiction. Il me l’avait faite un mercredi. Le vendredi suivant, comme nous étions assis sur l’herbe à l’entrée de la grotte, je me levai pour aller chercher du tabac. La première chose que j’aperçus fut un serpent à sonnettes. C’était peut-être celui qui avait changé de peau quelques jours auparavant. En tout cas, il m’aurait certes porté malheur, si je ne l’avais pas tué. Je le plaçai à côté de la couverture de Jim. Roulée sur elle-même, sa tête plate en l’air, la vilaine bête paraissait prête à s’élancer, et je ne pus m’empêcher de rire d’avance de la peur qu’elle causerait au nègre.
Une heure après, je n’y songeai plus. Quand Jim se jeta sur sa couverture, il y avait là un second serpent qui le piqua. Jim se redressa en hurlant, et, dès que j’eus allumé la chandelle, je vis le crotale se tortiller autour de sa jambe, tout prêt à le mordre de nouveau. En un clin d’œil, je passai un bâton sous un des replis, un coup de couteau fit le reste. Jim empoigna la cruche de whisky et avala gorgée sur gorgée, ne s’arrêtant que lorsque la respiration allait lui manquer.
— Prends garde, Jim, lui dis-je. Tu n’es pas habitué à boire. Si tu continues, tu tomberas bientôt ivre mort.

— Tant mieux, répliqua-t-il, c’est le meilleur remède. Vous me roulerez dans ma couverture et vous me laisserez transpirer. En attendant, coupez un petit bout de la bête qui m’a mordu, ôtez la peau et faites-le rôtir. Je le mangerai, ça aidera aussi. Et puis vous enlèverez les crochets pour me les attacher autour du poignet.
Mon pauvre Jim avait toujours, à juste titre, passé pour un modèle de sobriété. Ce soir-là, tout en m’adressant ses recommandations, il s’interrompait sans cesse pour porter à ses lèvres le goulot de la cruche. Il s’arrêtait de temps à autre, se mettait à hurler et à danser, puis recommençait à boire. Il était nu-pieds et avait été mordu au talon. Heureusement, sa jambe n’était pas trop enflée, et je lui dis que c’était bon signe.
— Oui, murmura-t-il ; mais j’ai beau me brûler le gosier, la tête ne me tourne pas, et c’est mauvais signe.
Enfin le whisky finit par produire son effet habituel et j’enveloppai Jim dans sa couverture. Il demeura couché pendant trois jours, puis le gonflement disparut. Il attribua sa guérison au rôti que je lui avais servi ; mais je crois que le whisky y fut pour quelque chose.
Au bout d’une semaine, le fleuve rentra dans son lit. Nos provisions diminuaient ou se gâtaient ; cependant, le poisson et les œufs de tortue ne manquaient pas. Un matin, j’eus l’idée d’accrocher un morceau de lard rance à un des hameçons de notre grosse ligne. Nous prîmes un énorme poisson nommé chat marin, qui mesurait au moins six pieds de long et qui faisait des bonds à nous envoyer sur la côte de l’Illinois. Nous le regardâmes se débattre jusqu’à ce qu’il se fût noyé, et nous eûmes de la peine à l’amener à terre, tant il était lourd. Il aurait valu beaucoup d’argent à Saint-Pétersbourg, car sa chair, blanche comme la neige, fait de fameuses grillades.
Le lendemain, il n’y avait qu’un brochet sur nos lignes, et, le surlendemain, un second brochet. Le temps commençait à me paraître long. Je ne m’ennuyais guère davantage dans la cabane de mon père. Jim débitait sans cesse les mêmes histoires.
Je me félicitai d’avoir été à l’école ; sans les livres que nous avions emportés, je me serais démonté la mâchoire à force de bâiller. Ils étaient presque tous amusants, excepté un, où l’on racontait comment on a coupé la tête à Louis XVI, je ne sais pas pourquoi. Jim aimait mieux l’histoire de Robinson Crusoé.
— Et tout cela est vrai ? me demanda le nègre.
— Parbleu ! puisque c’est imprimé.
— Alors Robinson a choisi un mauvais nom pour ce bon Vendredi.
— C’est vrai ; mais tu peux être sûr que Robinson n’a pas voulu lui porter malheur ; il l’aurait appelé Dimanche, s’il l’avait rencontré pour la première fois ce jour-là. Je parie aussi, qu’en dépit de ses chèvres et de son perroquet, il ne serait pas resté huit jours dans son île s’il avait eu un canot et s’il avait aperçu Saint-Pétersbourg du haut de sa caverne. Tom Sawyer non plus, je t’en réponds. Il aurait tenu à savoir ce qui se passe là-bas, et j’ai bien envie de traverser le fleuve un de ces soirs.
Jim désirait autant que moi savoir ce qui se passait de l’autre côté du Mississipi ; cependant l’idée ne parut guère lui sourire.
— On n’a pas eu le temps de vous oublier, me dit-il, et, pour découvrir quelque chose, il faudra parler aux gens.
— Tu penses bien que je ne m’adresserai pas au premier venu. D’ailleurs, j’ai de bonnes jambes ; il n’y a pas de canots au bas de la ville, et le nôtre sera là.
— Alors, il faudra que je vous attende au bas de la ville ?
— Pas du tout, répliquai-je. Tu m’attendras ici, et tu fileras sur le radeau, si je ne suis pas revenu avant qu’il fasse grand jour. Tu emporteras ce qui reste de provisions, les huit dollars, le fusil, et tu tâcheras de gagner les États libres.
— Oh ! je sais conduire un radeau et je me tirerai bien d’affaire tout seul. C’est pour vous que je crains, massa Huck. Vous voilà presque aussi bien habillé que chez la veuve et ça ne vous change pas assez… Au fait, il y aurait un moyen… Si vous mettiez une des robes qui sont là ?
— Décidément, Jim, tu n’es pas bête, m’écriai-je, Tom Sawyer lui-même n’aurait pas trouvé mieux.
Jim, comme beaucoup de nègres, savait coudre. Il se mit aussitôt à l’œuvre et eut bientôt arrangé à ma taille une robe de calicot et un jupon ramassés dans la maison flottante. Je ramenai le bas de mon pantalon jusqu’aux genoux ; les vêtements de contrebande furent passés par-dessus ma tête et Jim agrafa la robe derrière mon dos.

Elle paraissait avoir été faite pour moi. Un grand chapeau de campagne, dont j’attachai les rubans sous mon menton, compléta mon costume. Jim déclara que personne ne me reconnaîtrait, même en plein jour ; seulement, il m’engagea à ne pas tenir les coudes en l’air et à sautiller un peu au lieu de faire de longues enjambées. Il me recommanda aussi de ne pas relever ma robe pour tirer mon couteau ou mon tabac de ma poche.
Cela n’est pas commode de marcher avec des jupes qui vous battent les mollets. Je me sentis d’abord très gêné ; mais, après m’être exercé pendant quelque temps en m’aidant des conseils de Jim, je m’y habituai si bien, qu’il me sembla que je pourrais regarder les gens en face sans trahir le moindre embarras.
Vers la tombée de la nuit, je partis dans le canot en longeant la côte de l’Illinois. Je traversai le fleuve un peu au-dessous de l’embarcadère du bac et le courant m’amena au bas de la ville. J’amarrai la barque dans une anse où j’avais souvent pêché, puis je gravis la berge. Une lumière brillait à la croisée d’une petite maison qui, lors de mon départ, se trouvait depuis longtemps sans locataire. Je m’approchai à pas de loup et, regardant par la fenêtre, j’aperçus une femme d’une quarantaine d’années qui tricotait à la lueur d’une chandelle. Je ne l’avais jamais rencontrée. C’était donc une étrangère, car je connaissais au moins de vue tous les habitants de Saint-Pétersbourg.
Le hasard me favorisait. En m’adressant à cette femme, je ne courais aucun risque, et, si court qu’eût été son séjour dans la petite ville elle pourrait sans doute m’apprendre ce que je voulais savoir. Aussi frappai-je sans hésiter à la porte, bien décidé à ne pas oublier que
j’étais une fille.
— Entrez, cria la femme.
J’entrai, et, après m’avoir regardé un instant, elle me dit de prendre une chaise.
— Comment t’appelles-tu ? me demanda-t-elle.
— Sarah Williamson.
— Tu demeures dans la ville ?
— Non, madame. Je suis de Hookerdale, à sept milles plus bas. J’ai fait le chemin à pied et je tombe de fatigue.
— Et tu as faim, je parie ? Heureusement, le garde-manger n’est pas vide.
— Merci, madame ; ce n’est pas la peine de vous déranger. J’avais si faim que j’ai dû m’arrêter dans une ferme à deux milles d’ici. Voilà pourquoi j’arrive si tard. Ma mère est malade ; elle n’a plus d’argent, et je viens trouver mon oncle Abner Moore. Il demeure tout en haut de la ville, à ce qu’elle m’a dit. C’est la première fois que je lui rends visite. Vous devez le connaître ?
— Abner Moore ? Non. Il n’y a pas deux semaines qu’il a fallu quitter notre belle ferme de l’Ohio pour venir habiter cette bicoque, de sorte que je ne suis pas à même de te renseigner. Le plus simple, c’est de passer la nuit ici. Là, ôte ton chapeau.
— Non, non ; merci, madame. Laissez-moi seulement me reposer un instant.
— Eh bien, mon mari sera de retour dans une heure ou une heure et demie. Il en sait peut-être plus que moi, et il t’accompagnera un bout de chemin.
Cela lui laissait le temps de causer et je n’en demandais pas davantage. Elle se mit à parler de sa belle ferme, de son mari et de ses affaires, qui ne m’intéressaient pas le moins du monde. J’étais très embarrassé, car je n’osais pas l’interroger, de peur de lui donner l’éveil. Enfin, au moment où je désespérais d’obtenir d’elle un renseignement quelconque, la voilà qui commence, je ne me souviens plus à propos de quoi, à me raconter — avec beaucoup d’enjolivements — ma propre histoire. J’appris que j’avais trouvé vingt mille dollars, que j’étais un mauvais garnement, et que mon père ne valait guère mieux. Lorsqu’elle arriva à l’assassinat, je lui dis :
— Là-bas, à Hookerdale, un colporteur nous a parlé de ça ; mais il ne savait pas qui a tué ce pauvre garçon.
— Je crois bien, personne ne le sait. Pas l’ombre d’une piste ! J’ai une voisine qui pense que c’est un nègre évadé du nom de Jim.
— Jim ! m’écriai-je.
J’allais protester. Je jugeai prudent de m’abstenir, et elle continua :
— Oui, un nègre nommé Jim, qui s’est sauvé la nuit même de l’assassinat. On l’a soupçonné tout d’abord. Bientôt, le vent a tourné et on le soupçonne moins, parce que la police a reconnu qu’il devait y avoir plusieurs complices.
— Et le père de Huck est revenu ?
— Certainement. C’est lui qui a mis la ville sens dessus dessous en annonçant le meurtre, comme je te l’ai dit ; mais il est reparti au bout de deux jours, après avoir extorqué de l’argent au tuteur de son fils. On s’étonne de ne pas le revoir, car il entend hériter, et le procès pourrait bien tourner en sa faveur. Quant à Jim, on finira par le prendre.
— On le cherche donc toujours ?
— Innocente, va ! Un nègre évadé ! On offre une récompense de trois cents dollars à qui le ramènera. Il y a des gens qui s’imaginent qu’il n’est pas loin, et j’en suis, quoique je garde mon opinion pour moi. L’autre jour, je causais avec une vieille qui me vend quelquefois du poisson et je lui ai parlé par hasard de l’île Jackson, une petite île que tu pourrais apercevoir d’ici, s’il faisait plus clair. Elle m’a dit que personne n’y demeurait. Je n’ai rien répondu ; mais ça m’a donné à penser. J’étais sûre d’avoir vu de la fumée s’élever au dessus des arbres un jour ou deux auparavant. L’idée m’est venue que le nègre se cache là-bas. Je n’ai pas vu de fumée depuis, et il a peut-être filé. Par malheur, mon mari se trouvait absent ; ce matin, à son retour, je l’ai prévenu et nous en aurons bientôt le cœur net.
Cette confidence me causa une telle inquiétude que je me sentis tout décontenancé. Je ne savais que faire de mes mains. Je pris une aiguille sur la table et je voulus l’enfiler. Mes doigts tremblaient trop ; je n’y parvins pas. Quand mon hôtesse cessa de parler, je levai les yeux et je vis qu’elle m’examinait curieusement, en souriant un peu. Je remis l’aiguille sur la table et je dis, d’un ton que je cherchai à rendre indifférent :
— Trois cents dollars, c’est une grosse somme. Je voudrais en rapporter autant à ma mère. Est-ce que votre mari partira ce soir ?
— Je l’espère bien. Il est allé à la ville, avec l’ami dont je t’ai parlé, pour louer un canot et tâcher d’emprunter un second fusil.
— S’ils attendaient le jour, ils verraient mieux.
— Oui, et le nègre verrait mieux aussi. Après minuit, il sera sans doute endormi ; dans l’obscurité, ils pourront se glisser à travers les arbres et découvrir son feu de camp sans lui donner l’éveil.
— C’est vrai ; je ne songeais pas à ça.
Elle continuait à me regarder d’un air intrigué, ce qui augmenta mon embarras. Tout à coup elle me demanda :
— Comment m’as-tu dit que tu t’appelles ?
— Mary Williamson.
— Mary ? Je croyais que tu avais dit Sarah quand tu es entrée ?
— Oui, madame. Sarah-Mary Williamson. Sarah est mon premier nom. Quelquefois on m’appelle Sarah, quelquefois Mary.
— Ah ! très bien ; je comprends.

Sa réponse me remit à mon aise, mais je n’osai pas encore la regarder en face. J’aurais bien voulu m’en aller. Mon embarras fut de courte durée. L’instant d’après, elle me parla d’autre chose. Elle se plaignit de son mari, qui n’avait pourtant qu’un seul défaut : la passion du jeu. C’est pour cela qu’elle était réduite à habiter une maison où les rats semblaient se regarder comme chez eux. J’ignore si elle avait raison de blâmer son mari. Pour les rats, je ne pouvais pas lui donner tort. La chandelle n’éclairait pas assez pour leur faire peur et à chaque instant on les voyait se montrer à l’entrée de leurs trous.
— Une voisine m’a donné un beau chat, reprit mon hôtesse, et il s’est sauvé au bout d’une heure. Il aura eu peur d’être mangé. Je suis obligée d’avoir sans cesse sous la main quelque chose à leur lancer, sans quoi ils ne me laisseraient pas tranquille. Voilà ce que j’ai trouvé de mieux, ajouta-t-elle en me montrant une lame de plomb roulée en boule. Je vise assez bien, lorsque mon rhumatisme ne me gêne pas.
Là-dessus, elle attendit une occasion ; mais elle manqua le but et cria : ouche ! tant son bras lui faisait mal.
Je ne pus m’empêcher de rire.
— Essaye un peu, dit-elle ; tu verras que ça n’est pas trop facile, rhumatisme à part.
Je tenais à déguerpir avant que son mari revînt ; mais je n’osai pas refuser. Je pris le morceau de plomb, et le premier rat qui s’aventura hors de son trou serait rentré chez lui assez malade s’il avait attendu une seconde ou deux de plus.
— À la bonne heure, dit mon hôtesse, tu as mieux visé que moi. Ils n’en seront pas tous quittes pour la peur, je le parierais.
Là-dessus, elle va ramasser le morceau de plomb et rapporte en même temps un écheveau de fil qu’elle me prie de l’aider à dévider. Je tends les bras et elle se remet à causer de ses affaires, puis elle s’interrompt pour me dire :
— Attention aux rats !… Mais il faut avoir son arme sous la main.
Tout en parlant, elle laisse tomber le plomb sur mes genoux. Naturellement, je serre les jambes et elle continue à jacasser. Au bout d’une minute, elle s’arrête de nouveau, enlève l’écheveau, me regarde entre les deux yeux et me demande d’un ton amical :
— Voyons, quel est ton vrai nom ?
— Plaît-il, madame ?
— Oh ! tu me comprends très bien. Quel est ton vrai nom ? T’appelles-tu Jacques, ou Pierre, ou Jean ?
Je me figure que je dus trembler un peu et je ne savais que répondre ; enfin, je dis en me levant :
— Ne vous moquez pas d’une pauvre fille, madame ; si je vous gêne, je…
— Non, tu ne t’en iras pas comme ça. Assois-toi et reste où tu es. Tu n’as rien à craindre de moi ; je garderai ton secret ; je te viendrai même en aide, et mon mari aussi, s’il peut t’être utile. Je vois bien que tu es un apprenti et que tu as pris la clef des champs. Tu as planté là ton maître, hein ? J’ai eu un fils qui aurait ton âge, s’il vivait encore, et il en a fait autant. Le mal n’est pas grand. On t’a maltraité et tu es parti sans dire au revoir ? Allons, raconte-moi tout ; ce n’est pas moi qui te dénoncerai.
Je n’étais plus embarrassé. L’histoire qu’elle venait de me suggérer arrivait fort à propos.
— Eh bien, je vais tout vous raconter, répliquai-je, car je suis sûr que vous me tiendrez parole et que vous ne me trahirez pas. Ma mère est morte, mon père a disparu, et on m’a mis en apprentissage chez un fermier, à une trentaine de milles d’ici. Cela m’ennuyait d’être battu et je n’y tenais plus. Il est parti pour un voyage de trois ou quatre jours ; j’ai profité de l’occasion pour prendre ces vieilles nippes que sa fille laissait traîner au fond d’une malle, et…
— Tu n’as jamais pu agrafer cette robe tout seul. Qui t’a aidé ?
— Un nègre qui m’a conseillé de me déguiser. Je crois que mon oncle Abner Moore me recevra volontiers chez lui. Il m’a reproché de n’être jamais venu le voir depuis qu’il habite Goschen.
— Goschen, mon pauvre garçon ? Tu es à Saint-Pétersbourg, à dix milles de Goschen. Qui donc t’a si mal renseigné ?
— Un homme que j’ai rencontré ce matin. Je ne craignais pas de me tromper de route, car je sais qu’il n’y a qu’à suivre le fleuve. Je lui ai seulement demandé si j’avais encore loin à aller et il m’a dit…
— Enfin, il s’est trompé ou bien il avait bu.
— Je crois plutôt que c’est moi qui ai mal compris. En tout cas, il faut me remettre en route ; mon oncle serait inquiet.
— Inquiet ? Il ne t’attend pas.
— Oh ! si, madame ; du moins, je lui ai écrit avant de partir.
— Bien sûr ? Alors, tu peux me laisser son adresse ? Nous allons voir.
J’écrivis tant bien que mal l’adresse de mon oncle sur un bout de papier : Abner Moore, charron, à Goschen (Missouri). Cette épreuve ne suffit pas pour convaincre mon hôtesse.
— Il doit y avoir des vaches sur la ferme d’où tu viens ? me demanda-t-elle brusquement.
— Certainement, madame ; des vaches, des moutons, des chevaux, des poules, des…
— Alors, réponds vite, sans prendre le temps de réfléchir. Lorsqu’une vache est couchée, comment se remet-elle debout ?
— Sur ses jambes de derrière, madame.
— Et un cheval ?
— Sur ses jambes de devant, parbleu !
— De quel côté des arbres pousse-t-il le plus de mousse ?
— Du côté du nord.
— Bon ; je vois que tu as vécu à la campagne. Je croyais que tu cherchais de nouveau à me tromper. Maintenant, dis-moi ton nom.
— Georges Peters.
— Tâche de ne pas l’oublier. Tu ne te tirerais plus d’affaire en soutenant que tu t’appelles Georges-Alexandre, lorsque je te surprendrai à mentir. Encore un conseil. Avant de vouloir passer pour une fille, apprends à enfiler une aiguille. Approche le fil de l’aiguille et non pas l’aiguille du fil. Et, quand tu viseras un rat ou autre chose, ne te contente pas de rejeter le bras en arrière et de jouer du coude et du poignet. Dresse-toi sur la pointe des pieds, lève la main au-dessus de la tête aussi maladroitement que possible, abaisse le bras tout d’une pièce, comme s’il tournait sur un pivot, et manque ton rat de cinq ou six pieds. Et rappelle-toi surtout que, quand une femme est assise, elle n’a pas besoin de serrer les genoux pour retenir un bout de plomb qu’on jette sur sa jupe. Vois-tu, j’ai su à quoi m’en tenir dès que tu t’es mis à enfiler cette aiguille ; mais je tenais à être sûre de ne pas me tromper. À présent, Sarah-Mary Williamson, Georges-Alexandre Peters, tu peux profiter du clair de lune pour partir et rejoindre ton oncle. Je te souhaite un bon accueil. Si tu te retrouves dans l’embarras, envoie un mot à Mme Judith Loftus — c’est mon nom — et nous tâcherons de t’en tirer. En attendant, la faim vient vite à ton âge ; j’ai là des sandwiches toutes faites que tu vas emporter.

Je me sentais si honteux d’avoir débité tant d’histoires à cette brave dame, que je voulus refuser. Je n’avais vraiment pas faim. Mais elle me fourra le paquet de sandwiches dans la main et je me laissai faire, car je craignais de voir arriver son mari. Elle me retint encore quelques minutes afin de me renseigner d’une façon très précise sur la route à suivre pour arriver en droite ligne au but de mon voyage. Je ne pouvais pas lui dire que je connaissais le chemin beaucoup mieux qu’elle et que d’ailleurs j’avais l’intention d’en prendre un autre. Après l’avoir remerciée, je suivis la berge pendant une cinquantaine de yards, puis je revins sur mes pas jusqu’au canot, qui se trouvait à peu de distance de la maison, et je partis en toute hâte. Je ramai contre le courant assez loin pour qu’il me ramenât à la tête de l’île. Je jetai au loin mon chapeau — je n’avais pas besoin d’œillères. Parvenu vers le milieu du fleuve, je crus entendre tinter une horloge et je m’arrêtai pour écouter… Un, deux, trois… Onze heures !… Il n’y avait pas de temps à perdre. Lorsque j’eus atteint la pointe de l’île, je ne m’attardai pas pour reprendre haleine, bien que je fusse presque essoufflé. Je poussai jusqu’à mon ancien camp, je me débarrassai en un clin d’œil de ma robe, et j’allumai un grand feu. Dès qu’il commença à flamber, je sautai dans la barque. L’endroit où nous avions amarré le traîneau était à un mille et demi plus bas. Il ne me fallut pas longtemps pour accomplir le trajet en pagayant le long de la rive. Là, je débarquai, je filai à travers les arbres et je grimpai la colline au pas de course. Jim, enveloppé dans sa couverture, dormait à poings fermés. Je le réveillai en criant :
— Debout, Jim ! J’ai bien fait d’aller là-bas. Il s’agit de déménager au plus vite. On est à nos trousses.
Jim ne m’adressa pas une seule question ; il ne dit pas un mot ; mais la façon dont il travailla durant la demi-heure qui suivit me prouva qu’il m’avait bien compris et qu’il ne voulait pas se laisser surprendre. Au bout de trois quarts d’heure tout ce que nous possédions se trouvait à bord de notre radeau, que nous avions mis à flot sous les saules, prêt à être lancé au bon moment. Mon premier soin avait été d’éteindre le feu à l’entrée de la grotte et l’on ne pouvait pas voir notre chandelle du dehors.
Je m’éloignai un peu de la côte dans le canot et je me tins aux aguets. Rien ne bougeait. Ma vue ne portait pas à une très grande distance à cause d’un léger brouillard qui commençait à se lever ; mais le brouillard n’empêche pas d’entendre. Du reste, je comptais bien que M. Loftus, s’il mettait son projet à exécution, ne s’amuserait pas à faire le tour de l’île. Il débarquerait certainement de l’autre côté, en face de Saint-Pétersbourg. La voie était donc libre. Jim détacha le traîneau et nous glissâmes à l’ombre des arbres, le canot à la remorque,
sans prononcer une parole jusqu’à ce que nous eussions dépassé l’île.
Il devait être près d’une heure du matin lorsque nous arrivâmes enfin au bas de l’île. Le radeau nous paraissait marcher très lentement. Il était convenu qu’en cas d’alerte nous sauterions dans le canot afin de gagner la côte de l’Illinois et nous cacher dans les bois. Aucune embarcation ne se montra — fort heureusement pour nous, car le fusil, les lignes, les provisions, les couvertures et le reste se trouvaient sur le radeau. On ne songe jamais à tout quand on se presse trop.
Ceux dont j’avais annoncé la visite à Jim mirent-ils le pied dans l’île ce soir-là ? Je ne l’ai jamais su. En somme, s’ils ont découvert mon feu de bivouac et passé une partie de la nuit à veiller en guettant le retour du nègre, ce n’est pas ma faute ; ils n’avaient qu’à rester chez eux. Je ne regrette qu’une seule chose — la déception que leur déconvenue aura causée à ma bonne hôtesse ; mais je suis sûr que si elle avait connu Jim, elle ne m’aurait pas gardé rancune.
Dès que le jour commença à paraître, nous amarrâmes notre radeau dans un petit renfoncement de la côte de l’Illinois. Jim abattit avec la hache assez de branches de cotonniers pour en recouvrir le train de bois et les arrangea si bien qu’à vingt pas vous auriez juré que les arbres avaient été renversés par un éboulement. Des montagnes se dressaient sur la rive qui nous faisait face ; derrière nous s’étendait une forêt non exploitée ; les vapeurs filaient le long de la côte du Missouri, de sorte qu’aucune surprise ne semblait à craindre. Nous passâmes toute la matinée à regarder les radeaux et les steamers descendre ou remonter le Mississipi. Tandis que nous nous reposions, je racontai à Jim, avec plus de détails, les incidents de ma visite à Mme Loftus. Quant aux soupçons qui planaient peut-être encore sur lui, je jugeai inutile d’en parler, bien qu’ils fussent pour beaucoup dans la hâte que j’avais mise à l’éloigner de Saint-Pétersbourg. Lorsqu’on soupçonne un nègre, on commence souvent par le pendre, quitte à reconnaître plus tard que ceux qu’il a tués se portent à merveille.
— Vois-tu, dis-je en terminant, elle se croit très fine parce qu’elle a deviné qu’elle n’avait pas affaire à une fille ; mais sans l’histoire de l’aiguille elle ne se serait doutée de rien.
— Je n’en répondrai pas, Huck. C’est une fine mouche que cette femme-là. Si elle avait eu l’idée de venir elle-même me relancer dans l’île, elle n’aurait pas perdu son temps à monter la garde autour de votre feu de bivouac ; non, elle aurait emmené un chien.
— Alors, pourquoi n’a-t-elle pas conseillé à son mari d’en prendre un avec lui ? Elle ne m’a pas parlé de chien.
— Je parie qu’elle y a songé ensuite, lorsque son mari allait partir. Voilà ce qui a causé du retard ; autrement, au lieu d’être ici, à seize ou dix-sept milles de la ville, je me trouverais entre les mains du shérif et j’entendrais un fouet siffler sur mes épaules.
— Bah ! Je ne me soucie pas de savoir pourquoi ils sont arrivés trop tard. Nous sommes libres, c’est l’essentiel.
Quand il ne fit plus très clair, je sortis des buissons de cotonniers pour jeter un coup d’œil sur le fleuve. Aucune embarcation n’était en vue. Jim enleva à l’une des extrémités du radeau quelques planches à l’aide desquelles il dressa un petit wigwam assez commode, où nous pourrions braver la pluie. Nous avions un marteau, une scie, et les clous ne manquaient pas. Il établit un plancher à un peu plus d’un pied au-dessus du niveau du radeau, de manière à mettre nos couvertures et nos provisions à l’abri des vagues soulevées par les grands steamers. Au milieu, une couche de terre de cinq à six pouces de profondeur et maintenue par un cadre de bois devait nous permettre d’allumer du feu, car Jim trouvait les nuits fraîches et d’ailleurs il ne renonçait pas à faire la cuisine. Nous possédions deux de ces longs avirons que l’on emploie sur le Mississipi, en guise de gouvernail, pour diriger les radeaux, et nous en fabriquâmes un troisième, parce que les rames se brisent souvent contre un tronc d’arbre ou une autre épave. Nous fixâmes un bâton fourchu pour y accrocher notre lanterne quand nous verrions un vapeur descendre le courant.

Nous continuâmes ainsi notre voyage, nous reposant le jour pour nous remettre en route dès l’aube. Le radeau faisait au moins quatre milles à l’heure et cela pendant sept ou huit heures, sans que nous fussions obligés de ramer. Il suffisait que l’un de nous tînt l’aviron qui servait de gouvernail. Le poisson ne semblait demander qu’à se laisser prendre. Nous mangions, nous causions, et, de temps en temps, nous nagions un peu pour chasser le sommeil.
Chaque nuit, nous passions devant des villes dont quelques-unes s’étageaient sur des collines où l’on voyait étinceler des lumières sans distinguer une seule maison. La cinquième nuit, je devinai que nous avions atteint Saint-Louis. J’avais entendu dire que Saint-Louis comptait au moins trente mille habitants ; mais cela m’avait semblé incroyable. Je n’en doutai plus à la vue des innombrables lumières qui brillaient à une heure où tout le monde devait dormir.
Nous commencions à nous sentir plus rassurés. Quand l’occasion se présentait, je descendais à terre à l’entrée d’un village pour acheter du lard, des légumes ou des fruits. Naturellement on me demandait d’où je venais, où j’allais, qui j’étais, et cœtera. Je répondais que je venais de l’île Jackson, que je conduisais un train de bois au Caire, près de l’embouchure du Mississipi. Il va sans dire que Jim ne se montrait pas. De temps à autre, nous abattions une poule d’eau qui se levait un peu trop tôt ou se couchait un peu trop tard. Bref, nous vivions comme des coqs en pâte.
La sixième nuit, au-dessous de Saint-Louis, un orage éclata. Le tonnerre grondait, les éclairs se suivaient presque sans interruption et la pluie se mit à tomber à torrents. Réfugiés dans le wigwam, nous laissions le radeau obéir au courant, tout en surveillant sa marche. À chaque minute, un éclair illuminait l’horizon, nous montrant l’immense nappe du fleuve et les côtes rocheuses entre lesquelles il coule. Soudain je m’écriai :
— Regarde donc là-bas, Jim !
— Oh ! j’ai bien vu, répliqua-t-il.
C’était un steamer qui avait échoué sur un rocher vers lequel le radeau se dirigeait en droite ligne. Les éclairs nous montraient fort distinctement le vapeur qui avait une bonne moitié de sa quille hors de l’eau. Aux lueurs de l’orage vous auriez pu distinguer les cordages, et, à côté de la grosse cloche, une chaise au dos de laquelle restait accroché un caban de pilote.
— Décidément, nous avons de la chance, repris-je. Un navire abandonné ! Nous allons voir ce qu’il y a là dedans. Abordons.
Jim, qui venait justement de saisir la gaffe afin d’éviter un abordage, refusa net.
— Non, non, dit-il. Nous nous en sommes bien tirés jusqu’ici ; à quoi bon courir des risques ? Il y a probablement un veilleur à bord.
— Bah ! un veilleur ! sur un steamer qui peut couler à fond d’une heure à l’autre ? Tu n’y songes pas.
Il n’y avait rien à répondre à cela ; aussi Jim s’abstint-il de répondre.
— Et puis, continuai-je, une épave abandonnée appartient à tout le monde. Nous trouverons peut-être dans la cabine quelque chose valant la peine d’être emporté. Mets une chandelle et des allumettes dans ta poche. Vois-tu, je ne dormirais pas tranquille si nous ne jetions pas un coup d’œil par là. Crois-tu que Tom Sawyer laisserait échapper une si belle occasion ? Quel dommage qu’il ne soit pas là !
Jim grommela un peu, mais il céda, à la condition que nous parlerions le moins possible et sans élever la voix. Un éclair nous montra de nouveau, juste à temps, le vapeur naufragé. Le radeau glissa à tribord, Jim l’amarra, et nous grimpâmes sans peine sur le pont qui penchait beaucoup. Nous suivîmes avec lenteur la pente dans la direction de l’entrée de la cabine, tâtant le terrain avec nos pieds, les mains étendues pour éviter les cordages.
Quelques pas de plus nous amenèrent en face de la porte qui était ouverte ; au loin, nous vîmes briller une lumière — une seconde après il m’arriva comme un bruit de voix.
— Vous ne voulez jamais m’écouter, Huck, me dit Jim à l’oreille. Il y a un veilleur, il y en a même plus d’un. Filons. Ils commenceraient par nous envoyer une balle, et alors il serait peut-être trop tard pour s’expliquer.
— Tu as raison, Jim, répliquai-je.
Au moment où je me disposais à le suivre, j’entendis une voix qui disait :
— Au nom du ciel, épargnez-moi ! Je jure de garder le secret. Une autre voix, beaucoup plus distincte, répondit :
— Ce n’est pas la première fois que tu agis de la sorte. Tu veux toujours plus que ta part du butin et tu l’as toujours eue, parce que tu menaçais de nous dénoncer. Cette fois nous te tenons.
Jim était déjà en route pour regagner le radeau, et la prudence m’ordonnait de faire comme lui ; mais la curiosité l’emporta.
— Non, pensai-je, Tom Sawyer ne se serait pas éloigné sans savoir à quoi s’en tenir. Jim ne me plantera pas là, et je veux apprendre ce qui se passe.

Je me glissai donc à quatre pattes dans le couloir des cabines et je rampai dans l’obscurité jusqu’à ce qu’il n’y eût plus qu’une chambre entre moi et le salon. Alors, au fond, je vis un homme étendu sur le parquet, pieds et poings liés. Près de lui se tenaient deux individus dont l’un avait une lanterne sourde à la main, tandis que l’autre appuyait le canon d’un pistolet sur le front du prisonnier.
— Si je lâchais la détente, dit l’homme au pistolet, tu n’aurais que ce que tu mérites.
— Non, je t’en supplie, Bill ! s’écria celui qu’on menaçait. Je ne vous trahirai pas.
L’homme à la lanterne se mit à ricaner et répliqua :
— Je te crois. Tu n’as jamais rien dit d’aussi vrai. Poltron, tu nous supplies maintenant, et tu nous aurais tués tous les deux, si nous n’avions pas été les plus forts. Et pourquoi ? Parce que nous insistions sur nos droits, tout bonnement. Tu ne trahiras plus personne… Allons, remets ton pistolet dans ta poche, Bill.
— Pas avant de m’en être servi, Jack. N’a-t-il pas essayé de nous tuer ?
— Oui, mais je ne tiens pas à le tuer, lui, et j’ai mes raisons.
— Merci de ces bonnes paroles, Jack, s’écria le malheureux que l’on venait de menacer. Je ne les oublierai pas, tant que je vivrai.
Cette promesse ne parut pas toucher Jack ; il se dirigea vers le couloir où je me tenais et fit signe à son compagnon de le suivre. Le steamer penchait au point qu’il n’y avait pas moyen de courir. Je m’éloignai en rampant et je gagnai une des petites cabines. J’avais à peine eu le temps d’y pénétrer, que j’entendis Jack dire à son ami :
— Entrons ici et causons.
Il entra, suivi de Bill. Je m’étais déjà glissé dans le cadre d’en haut, très fâché d’avoir cherché une aventure. Ils s’arrêtèrent à quelques pas de moi. J’avais beau ne pas les voir, une forte odeur de whisky m’annonçait leur voisinage. Je me félicitai de mon horreur de l’eau-de-vie ; après tout, cela ne m’aurait pas trahi, car je respirais à peine, j’avais tant peur.
— Il a juré de nous dénoncer, dit Bill, et il n’y manquera pas après la façon dont nous l’avons traité. Il en sait trop long sur notre compte. Nous devons nous débarrasser de lui. Voilà mon opinion.
— C’est aussi la mienne, répliqua Jack.
— Tant mieux ; je me charge de l’expédier.
— Attends un peu. Une balle ferait l’affaire ; mais à quoi bon le tuer quand il est si facile d’arriver au même résultat sans nous en mêler ?
— Facile ? Comment cela ?
— C’est simple comme bonjour. Après avoir fouillé les cabines que nous n’avons pas encore visitées, nous irons à terre avec notre butin. Dans une heure ou deux, le steamer sera emporté par le courant. Il y aura un noyé de plus dans le Mississipi, voilà tout. Viens.
Dès qu’ils se furent éloignés, je me glissai hors de ma cachette et je regagnai le pont, heureux d’en être quitte à si bon marché. J’appelai Jim à voix basse. Il était revenu à ma rencontre, ou bien il m’avait attendu, car il me répondit par une sorte de gémissement.
— Jim, murmurai-je à son oreille, il y a là deux chenapans qui vont arriver avec leur lanterne. Il ne faut pas qu’ils nous trouvent ici. Vite, au radeau.
— Le radeau ? Il n’y a plus de radeau, massa Huck.
L’haleine me manqua et je faillis me trouver mal. Emprisonné sur un navire qui, s’il ne se disloquait pas, coulerait dès que le courant l’entraînerait ! Ce n’était pas le moment de geindre. Il fallait nous emparer du canot de ces bandits et partir au plus vite. Nous longeâmes le steamer et il me sembla que j’avais mis une semaine à gagner la poupe.

— Pas l’ombre d’un canot, me dit Jim.
— Alors nous serions dans une mauvaise passe ; mais je sais qu’il y en a un, puisqu’on a parlé de retourner à terre. Il ne peut être que de ce côté ; cherchons encore.
Nous penchant au-dessus du bord, nous aperçûmes une petite barque dans laquelle je me laissai glisser et où Jim s’empressa de me rejoindre. Je pris mon couteau, je coupai l’amarre et en route. Quelques minutes après, sans avoir touché un aviron ni prononcé une parole, nous nagions à cent yards du navire échoué. Grâce au courant, nous étions déjà loin quand une lanterne brilla sur le pont. Jack et son ami s’apercevaient de la disparition de leur canot et se demandaient sans doute qui avait pu couper l’amarre.
Alors seulement je commençai à me préoccuper du sort de ceux que nous laissions derrière nous.
— Jim, dis-je au nègre, qui avait déjà saisi les rames, l’idée qu’ils vont se noyer par notre faute me tracasse. Dès que nous verrons une lumière sur la côte, nous aborderons à un endroit où tu pourras te cacher avec le canot, et j’irai donner l’alerte. J’inventerai une histoire pour envoyer quelqu’un à leur secours.
Jim ne voulait la mort de personne ; il approuva donc mon idée. Par malheur l’orage, qui s’était calmé un instant, éclata de nouveau et rien n’indiquait le voisinage d’une ville ou d’un village. Au bout d’un certain temps, la pluie cessa ; mais il y avait toujours des nuages et bientôt un éclair nous montra un point noir qui flottait devant nous.
C’était notre radeau et nous fûmes ravis de pouvoir nous y rembarquer. À peine installés, nous vîmes une lumière à notre droite et Jim se dirigea aussitôt vers la rive. Le canot était plein d’objets que nos deux chenapans avaient pris à bord du vapeur. Nous entassâmes ce butin à bord du radeau ; puis je dis à Jim de suivre le courant, d’allumer sa lanterne quand il croirait avoir fait un mille ou deux, et de la laisser à l’arrière jusqu’à mon retour.
Ensuite je saisis les avirons et je ramai vers la côte. La lumière dont j’ai parlé provenait d’un fanal suspendu au mâtereau d’un grand bateau de passeur. Je montai à bord, cherchant le veilleur. Je le trouvai sur le pont, à moitié endormi. Je n’eus pas beaucoup de peine à le réveiller et alors je me mis à pleurer.
— Holà ! qu’est-ce qu’il y a, petit ? me demanda-t-il en bâillant. Pourquoi pleures-tu ?
— Il y a bien de quoi, allez !… Papa, maman, et ma sœur…
Et je me remis à sangloter de plus belle.
— Voyons, ne te désole pas. Ils ne sont pas morts, hein ?
— Il ne s’en faut guère… Êtes-vous le veilleur du bac ?
— Oui, répliqua-t-il en se rengorgeant, je suis le capitaine, le propriétaire, le pilote et le veilleur. Trop souvent même je représente tous les passagers et tout le fret. Ah ! je ne suis pas aussi riche que mon ami Tom Hornback, qui distribue des pièces de 5 dollars sans se gêner. N’empêche pas que je ne changerais pas de place avec Tom Hornback. D’abord il ne boit que de l’eau, et…
Je crus qu’il n’en finirait jamais et je l’interrompis en disant :
— Ce n’est pas le moment de causer. Mon père, ma mère, ma sœur… et miss Hooker sont là-bas et si on ne va pas à leur secours, ils seront perdus.
— Là-bas ? Où ça ?
— À bord du steamer naufragé.
— Je le croyais coulé depuis longtemps. Bonté du ciel, que font-ils là ?
— Ils y sont contre leur gré, je vous en réponds. Au commencement de la soirée, miss Hooker est partie de… je ne me rappelle pas le nom… un endroit qui se trouve de l’autre côté du fleuve, presque en face du rocher.
— Bon, elle est partie de Bosh-Landing — continue.
— Justement. Eh bien, le conducteur du bac a perdu sa rame, le bac est allé se cogner contre le steamer échoué. Tout le monde a été noyé, excepté miss Hooker, qui s’est sauvée en s’accrochant à un cordage. Une heure plus tard, nous avons descendu le courant à notre tour ; il nous a entraînés vers le rocher et notre radeau s’est effondré ; mais nous avons réussi à grimper à bord.
— C’est bien le cas de dire : À quelque chose malheur est bon. Sans le steamer aucun de vous n’aurait pu tenir debout sur ce rocher à pic.
— Le steamer ne s’y tient pas d’aplomb non plus, il penche joliment… Nous nous sommes d’abord mis à pleurer et à crier, comme si on pouvait nous entendre ! Mon père, qui ne pleurait pas, me dit : « Nous sommes perdus si personne ne vient à notre secours ; l’orage est presque passé, tu vas gagner la côte dans ce canot… »
— Comment, ils ont laissé un de leurs canots ?
— Oh ! une petite barque où nous n’aurions pas pu monter tous. Alors je suis parti et me voilà. Votre bac est plus solide que mon canot et vous m’avez l’air d’un brave…
— Quant à ça, tu as raison. Le Mississipi ne m’a jamais fait peur.
— Et puis, vous n’y perdrez rien. Miss Hooker m’a dit que son oncle Hornback…
— Tonnerre ! c’est sa nièce ? Elle ne devait arriver que dans huit jours. Je serais déjà en route, si tu avais parlé plus tôt… Tu vois cette lumière, là-bas, à gauche ?
— Oui.
— Cours-y aussi vite que tes jambes te porteront. C’est la taverne, et elle est toujours pleine le soir. Raconte-leur ce qui arrive et prie-les de ma part d’aller prévenir le vieux Hornback… Qu’attends-tu ? Ah ! bon ! Ton père et les autres, n’est-ce pas ? Sois tranquille, je les emmènerai par-dessus le marché, la place ne manque pas. Dépêche-toi. Il faut que j’aille réveiller mon chauffeur.
Je partis en courant dans la direction qu’il venait de m’indiquer ; mais, dès qu’il eut le dos tourné, je regagnai le canot, je longeai la côte et je me faufilai parmi les bateaux amarrés devant un chantier. Je tenais à assister au départ du bac. En somme, j’étais assez content de moi. Il y a beaucoup de gens qui ne se seraient pas donné autant de peine pour empêcher trois mauvais garnements de se noyer.
Enfin je vis le petit steamer filer à toute vapeur et je ne songeai plus qu’à rejoindre Jim. Je crus que sa lanterne ne se montrerait jamais. Lorsque je l’aperçus, il me sembla qu’elle se trouvait à cent lieues de moi. Quand j’atteignis le radeau, le ciel commençait déjà à blanchir. Jim tombait de sommeil et moi aussi ; aussi ne tardâmes-nous pas à
nous endormir sous les arbres, dans une île où nous avions abordé.
Une fois debout, j’examinai ce que nous avions ramassé dans le canot. Il y avait des couvertures, des vêtements, une demi-douzaine de livres et une boîte de cigares — des cigares comme je n’en avais jamais fumé. Nous restâmes une bonne partie de la matinée couchés sur l’herbe et je racontai à Jim ce qui s’était passé à partir de mon entrée dans la cabine.
— Voilà ce qui s’appelle une aventure, lui dis-je, et je m’en suis bien tiré.
— Il n’y a pas de quoi se vanter, massa Huck, répliqua-t-il. Si toutes les aventures ressemblent à celle-là, j’espère que ce sera la dernière. Quand j’ai voulu descendre sur le radeau et que je ne l’ai plus trouvé, je n’aurais pas donné un cent de ma peau. Je me voyais perdu. Si personne ne venait à mon secours, je ne pouvais manquer d’être noyé. Si quelqu’un arrivait à temps pour nous sauver, on me ramènerait à terre pour me livrer au shérif et alors, pour sûr, miss Watson me vendrait au planteur. Autant valait être noyé. Ne me parlez pas de vos aventures, j’en ai assez.
Jim n’avait pas eu tort de s’effrayer. Noyé ou vendu, il n’y aurait guère eu d’autre alternative pour lui, si les choses avaient moins bien tourné.
Comme il se montrait encore préoccupé, je pris un des livres et, pour le distraire, je lui lus une histoire où il était question de rois, de ducs, de comtes, de gens à qui on ne disait pas « Monsieur », mais « Votre Majesté », « Votre Grâce », « Monseigneur », qui portaient des habits de velours et avaient au côté une épée qu’ils tiraient à tout propos.
Jim ouvrait de grands yeux et m’interrompait à chaque instant pour me demander des explications que je lui donnais de mon mieux.
— Je n’ai pas beaucoup entendu parler de rois, me dit-il, à moins de compter ceux qu’on voit sur les jeux de cartes. Combien gagne un roi ?

— Combien il gagne ? Rien du tout. Il prend ce qu’il veut — mille dollars par mois et même davantage, si cela ne lui suffit pas.
— Bah ! il aurait de la peine à dépenser mille dollars par mois. Et qu’a-t-il à faire, massa Huck ?
— En voilà une question ! Est-ce que tu te figures qu’il est obligé de travailler ?
— C’est un métier qui m’irait assez.
— Tu n’es pas dégoûté. Seulement, en temps de guerre, il faut qu’il monte à cheval et se batte comme les autres. Quelquefois, il se dispute avec son parlement et coupe la tête des gens qui ne lui obéissent pas.
— Ça ne m’étonne pas. Le roi Salomon — celui-là, j’en ai entendu parler — a fait bien pis.
— Mais non, mais non, Jim. Il n’y a jamais eu un roi plus sage ; miss Watson me l’a dit.
— Elle peut dire ce qui lui plaira. Vous ne connaissez donc pas l’histoire du bébé qu’il voulait couper en deux ?
— Si, je la connais, et elle prouve justement combien Salomon était sage.
— Allons donc ! C’est comme si un juge déchirait un billet de banque en deux, parce que deux individus le réclament. Voilà comment le roi Salomon a agi. Je vous demande un peu à quoi sert une moitié d’enfant ? Je ne donnerais pas un liard d’un million d’enfants coupés en deux, ni vous non plus.
— Tu n’as rien compris à cette histoire, Jim.
— Qui ? Moi ? Je ne suis pas plus bête qu’un autre et je comprends qu’il n’y a pas l’ombre de bon sens dans l’affaire du roi Salomon. Personne ne demandait une moitié d’enfant. On voulait l’enfant tout entier, et un juge qui croit arranger la dispute en coupant l’enfant en deux n’en sait pas assez pour ouvrir son parapluie afin de se garer d’une averse.
— Je te répète que tu n’y as rien compris.
J’eus beau chercher à lui expliquer que Salomon n’avait pas la moindre intention de tuer l’enfant et qu’il tenait seulement à découvrir la vraie mère, je n’y pus réussir. Lorsque Jim se fourrait une idée dans la tête, impossible de l’en faire démordre.
— Et vous, Huck, voudriez-vous être roi ? me demanda-t-il tout à coup.
— Non, ma foi. On me traiterait peut-être comme on a traité le roi Louis XVI. Je t’ai lu son histoire là-haut, dans la grotte de l’île Jackson.
— C’est vrai ; je me rappelle maintenant, et le métier me paraît moins bon. Et on a laissé mourir en prison le pauvre petit dauphin qui aurait dû être roi !
— Il y a des gens qui croient qu’il s’est sauvé en Amérique.
— Tant mieux ; mais nous n’avons pas de rois chez nous ; que veux-tu qu’il fasse ici ?
— Je n’en sais rien. Il doit être assez vieux aujourd’hui ; mais il pourra toujours apprendre aux Américains à parler français.
— Est-ce que les Français ne parlent pas comme nous ?
— Non, Jim, ni les Allemands non plus. Tu ne comprendrais pas un mot de ce qu’ils te diraient, pas un seul.
— Par exemple, voilà qui est fort.
— Oui, mais c’est comme ça. Moi, je connais un mot ou deux de leur baragouin, parce que miss Watson a voulu m’apprendre. Merci, c’est trop difficile ! Si un colporteur se campait devant toi et te disait : Sprechen sie Deutsch ? que répondrais-tu ?
— Je ne lui répondrais pas ; je lui flanquerais un coup de poing. Je croirais qu’il se moque de moi.
— Nigaud ! Il te demanderait tout bonnement si tu parles allemand.
— Alors pourquoi ne le demande-t-il pas ?
— Mais il te le demande — c’est sa façon de le demander.
— C’est une bête de façon qui n’a pas le sens commun.
— Voyons, Jim, les chats parlent-ils comme nous ?
— Non, les chats ne parlent pas comme nous.
— Et les vaches ?
— Les vaches non plus.
— Est-ce qu’un chat parle comme une vache ou une vache comme un chat ?
— Non.
— Et tu trouves tout simple que les vaches et les chats parlent d’une manière différente, pas vrai ?
— Oui, pour sûr.
— Alors n’est-il pas tout simple que des hommes d’un autre pays parlent autrement que nous ? Réponds à ça.
— Un chat est-il un homme, Huck ?
— Non.
— Il n’y a donc pas de raison pour qu’il parle comme nous. Une vache est-elle un homme ? Une vache est-elle un chat ?

— Non, non, et non ! Elle n’est ni l’un ni l’autre.
— Eh bien, alors, elle ne doit parler ni comme l’un ni comme l’autre ; mais un Français est-il un homme ?
— Oui.
— Eh bien alors, pourquoi diantre ne parle-t-il pas comme un homme ? Répondez à ça.
Je vis que ce serait perdre mon temps que de vouloir discuter avec
Jim. On ne peut pas apprendre à un nègre à raisonner.
Jim pensait que trois ou quatre nuits de plus nous amèneraient au Caire, à l’embouchure de l’Ohio. C’est là que nous avions hâte d’arriver afin de vendre le radeau et de prendre passage sur un vapeur pour remonter jusqu’aux États libres.
La seconde nuit, notre voyage fut interrompu par un brouillard qui n’était pas encore assez épais pour nous empêcher de distinguer la côte, mais au milieu duquel il serait peut-être bientôt dangereux de poursuivre notre route. Je filai donc à bord du canot avec une amarre que j’enroulai autour d’un arbre. Par malheur le courant était fort ; le radeau fut entraîné avec tant de violence qu’il arracha l’arbre et le voilà parti, emportant Jim.
Je sautai dans la barque et je donnai un bon coup d’aviron. Elle ne bougea pas ; j’avais oublié qu’elle était attachée à un autre arbre. Au lieu de perdre du temps en retournant à terre, je coupai la corde qui la retenait, je saisis les rames et me mis à la poursuite du radeau. Cela marcha fort bien tant que j’entrevis la rive ; mais elle ne tarda pas à se perdre dans le brouillard.
— À quoi bon me fatiguer ? me dis-je. Ne vaut-il pas mieux suivre le courant ? De cette façon, je serais à peu près certain de prendre le même chemin que Jim.
Toutefois on ne reste pas volontiers les bras croisés dans un pareil moment. Je fis un porte-voix de mes mains, je lançai un cri d’appel et j’écoutai. Une sorte d’écho m’arriva de loin. Le courage me revint et j’empoignai de nouveau les avirons. On me répondit à diverses reprises, tantôt à droite, tantôt à gauche, sans que le bruit se rapprochât. Au fond, je n’étais sûr que d’une seule chose, c’est que l’on criait en avant de moi.
J’aurais joliment voulu que Jim songeât à tambouriner sur une casserole, sans s’arrêter. Il ne s’en avisa pas, et les intervalles de silence me déroutaient. Au bout de quelque temps, j’entendis crier derrière moi. Pour le coup, ça se compliquait. Était-ce Jim ou le conducteur d’une autre embarcation qui me répondait ? Je ne pouvais distinguer sa voix dans le brouillard, qui dénature tout, le son aussi bien que les objets.
Enfin le holà ! hé ! résonna de nouveau devant moi, à ma droite. Une minute après, je passai comme une flèche le long d’une berge où se dressaient de grands arbres. Tout s’expliquait. Cette berge était celle d’une île, et Jim avait passé de l’autre côté. L’île avait peut-être cinq ou six milles de long et un demi-mille de large. Le radeau avait marché plus lentement que le canot, voilà tout.
Je n’étais plus aussi inquiet et je laissai la barque suivre le courant. Elle allait bon train — quatre ou cinq milles à l’heure au moins — mais vous ne vous en seriez jamais douté. Non ; on croit flotter sur l’eau sans avancer, et si l’on entrevoit quelque chose qui disparaît en un clin d’œil, on ne se dit pas : « Faudrait enrayer ; » on retient son haleine et on se dit : « Comme cette épave ou cet arbre file vite ! » Si vous vous figurez que c’est gai de naviguer ainsi tout seul en plein brouillard, essayez un peu et vous ne serez pas tenté de recommencer.
Pendant une demi-heure encore, je poussai de temps à autre un cri d’appel. Enfin une voix me répondit à une grande distance et j’essayai de ramer du côté d’où elle semblait venir. Autant aurait valu courir après un feu follet, car le son changeait constamment de direction.
Bientôt je jugeai que je me trouvais dans un nid d’îlots. J’apercevais par moments la terre de chaque côté, et deux ou trois fois je dus me servir de ma gaffe. Je cessai de crier, parce qu’aucune réponse ne m’arrivait. Ce silence, du reste, me laissait espérer que le radeau n’avait pas suivi le même chemin que moi. Il n’aurait pas manqué de s’accrocher, et alors Jim se serait dépêché de me donner de ses nouvelles. S’il se taisait, c’est qu’il était déjà loin. Je courais plus de risques que lui ; un canot se défonce là où un radeau tient bon.
Enfin, il me sembla que la route restait libre. J’étais tellement fatigué que je m’allongeai au fond de la barque sans autre intention que de me reposer un peu. Je ne tardai pas à m’endormir. Lorsque je me réveillai, les étoiles brillaient et le courant entraînait le canot au milieu d’une grande courbe du fleuve. D’abord je ne me rappelai plus où j’étais, et, quand la mémoire me revint, il me sembla que mes souvenirs dataient de la semaine passée.

À l’endroit où je me trouvais le Mississipi avait une largeur effrayante. Vus à la lueur des étoiles, les arbres qui le bordaient paraissaient former un mur impénétrable.
Droit devant moi, je distinguai sur l’eau un point noir vers lequel je me dirigeai à force de rames. C’était le radeau !
Jim, profondément endormi, se tenait assis, la tête sur les genoux, la main droite sur l’aviron qui servait de gouvernail. La seconde rame avait été brisée en deux. L’embarcation était semée de feuilles mortes, de branches pourries et d’autres débris qui montraient qu’elle avait passé de mauvais quarts d’heure.
J’amarrai, je me couchai sur le radeau sous le nez de Jim ; puis je me mis à bâiller et à m’étirer les bras de façon à donner un coup de coude dans les côtes du nègre.
— Ah çà, Jim, est-ce que j’ai dormi ? Pourquoi ne m’as-tu pas réveillé ? lui demandai-je, dès qu’il eut ouvert les yeux.
— Bonté du ciel ! s’écria-t-il. C’est bien vous ? Vous voilà revenu, mon vieux Huck ?
— Qu’est-ce qui te prend, Jim ? Tu as donc bu ?
— Bu ? Ai-je eu l’occasion de boire ?
— Alors pourquoi bats-tu la campagne ? Tu parles de mon retour comme si j’étais parti.
— Huck, Huck Finn, regardez-moi bien en face et répondez-moi. Est-ce que vous n’êtes pas parti ?
— Mais non ! mais non !
— Vous plaisantez, massa Huck. Ne vous ai-je pas vu monter dans le canot pour amarrer le radeau à un arbre ?
— Moi !
— Et le radeau n’a-t-il pas filé tandis que vous restiez en arrière dans le brouillard ?
— Quel brouillard ?
— Eh ! ce brouillard du diable qui a duré toute la nuit. N’avez-vous pas crié : « Ohé, Jim, ohé ! », et ne vous ai-je pas répondu ? N’ai-je pas manqué de me noyer vingt fois au milieu de ces îles ?
— Je n’y suis plus, Jim. Où vois-tu du brouillard ? Où vois-tu des îles ? Je suis resté ici à causer avec toi, tu as fini par t’endormir et j’en ai fait autant. Tu as rêvé. Nous causions encore il y a dix minutes.
— Je n’ai pas pu rêver tout ça en dix minutes.
— Mais si, puisque rien de tout ça n’est arrivé.
Jim se tut ; il cherchait à se débrouiller.
— Allons, dit-il enfin, je suppose que j’ai rêvé, Huck ; mais, je veux être pendu si j’ai jamais fait un rêve aussi fatigant.
— Oui, il y a des rêves qui vous cassent bras et jambes.
Alors, sur ma demande, Jim me raconta tout au long ce qui lui était arrivé et je ne m’étonnai pas qu’il se sentît fatigué. Ensuite il se mit martel en tête pour expliquer son rêve.
L’endroit où il avait cru me voir amarrer le radeau représentait un homme qui nous voulait du bien et le courant un ennemi qui nous donnerait peut-être du fil à retordre. Les cris d’appel étaient des avertissements qui nous arriveraient de loin en loin, et gare à nous si nous n’en tenions pas compte. Les îles et le brouillard annonçaient des ennuis que nous causeraient des gens querelleurs ; mais si nous nous mêlions de nos propres affaires au lieu de leur répondre, nous gagnerions les États libres, où il n’y aurait plus rien à craindre.
— Ton rêve me semble assez bien expliqué, dis-je à Jim. Seulement, tu n’es pas allé jusqu’au bout. Que signifient ces branches cassées, cette rame brisée, ces feuilles mortes, et toutes ces ordures ?
Jim regarda les débris épars autour de nous — on les voyait très clairement à présent — puis il me regarda et contempla de nouveau le radeau. L’idée du rêve lui était si bien entrée dans la tête, qu’il avait de la peine à rétablir les faits. Dès qu’il y fut parvenu, il fixa les yeux sur moi et répliqua d’une voix qui ne ressemblait pas à sa voix ordinaire :
— Je vais vous le dire, massa Huck. Tout à l’heure, quand je me suis endormi de fatigue, j’avais le cœur gros, parce que je vous croyais perdu. Je ne m’inquiétais plus de ce qui pourrait m’arriver, au radeau ou à moi. Lorsque je vous ai revu là, sans une égratignure, les larmes me sont montées aux yeux. J’étais si content que j’avais envie de me jeter à vos pieds et de les embrasser. Vous, vous n’avez pensé qu’à vous moquer du vieux Jim et à lui faire honte de sa bêtise avec vos menteries. Oui, il y a un tas de saletés sur le radeau, et ces saletés, ce sont les gens qui font des avanies à leurs amis.
Là-dessus Jim me tourna le dos et se glissa dans le wigwam sans dire un mot de plus. Il en avait dit assez. Je me sentais si honteux que j’aurais presque pu me jeter à ses pieds pour lui demander pardon.

Ce ne fut qu’au bout d’un quart d’heure que je me décidai à m’humilier devant le nègre ; mais je le fis. Je ne le regrette pas et je n’en ai jamais rougi depuis. Je ne lui aurais certes pas joué ce tour-là si je
m’étais douté qu’il prendrait la chose à cœur.
Après avoir dormi pendant presque toute la journée, nous nous remîmes en route vers la tombée de la nuit. Notre départ fut retardé par le passage d’un radeau qui n’en finissait pas et qui mit autant de temps qu’une procession à défiler. Quatre rameurs se tenaient à chaque bout et il devait porter au moins trente hommes. Les tentes d’abri ne manquaient pas. Au milieu, un feu de camp ; aux deux extrémités, un long mât à banderoles destiné à accrocher les lanternes. Ah ! on était fier de faire partie de l’équipe d’un pareil radeau.
Nous descendîmes au gré du courant une grande courbe du fleuve, qui était très large en cet endroit, avec des rives boisées où aucune lumière n’annonçait la présence d’un habitant. Jim se mit à parler du Caire et il me demanda si je reconnaîtrais l’endroit, une fois que nous y serions.
— Pour ça, non, répliquai-je, surtout la nuit. Il n’y a pas beaucoup de maisons au Caire, et si elles ne sont pas éclairées, nous ne devinerons même pas que nous passons devant une ville.
Jim dit que puisque deux fleuves se rejoignent là, nous saurions bien que nous n’étions plus loin des États libres.
— Oui, mais nous filerons peut-être dans l’Ohio sans nous douter que nous sommes sortis du Mississipi.
— Que faire alors, Huck ?
— J’irai à terre dans le canot dès qu’une lumière se montrera ; je raconterai que mon patron conduit un radeau au Caire et qu’il craint d’avoir dépassé la ville.
— L’idée me paraît bonne, répondit Jim. Il n’y a plus qu’à bourrer nos pipes et à veiller. Soyez tranquille, Huck, j’aurai l’œil ouvert.
En effet, il le tint si bien ouvert qu’il se levait à chaque minute en criant :
— Voilà le Caire ! Je serai bientôt libre !
Pas du tout. C’étaient des feux follets ou des vers luisants. Alors il se rasseyait et se remettait à veiller, ce qui ne l’empêchait pas de bavarder. L’idée d’être si près de la liberté lui donnait la fièvre. Je ne me sentais pas non plus à mon aise, parce que je commençais à m’imaginer qu’il était déjà libre. Et à qui pouvait-on s’en prendre ? À moi seul. Je n’y avais pas encore songé et cela me troublait. Mon père se serait dépêché d’arrêter un esclave fugitif, même sans l’espoir d’une récompense ; il aurait rougi de tendre la main à un noir. Je n’avais pas conseillé à Jim de s’évader ; mais sachant à quoi m’en tenir, n’aurais-je pas dû donner l’éveil ? Un nègre qui s’enfuit est un voleur, et je l’aidais à dépouiller cette pauvre miss Watson, qui ne me voulait que du bien.
Voilà ce que me disait ma conscience, et plus je l’écoutais, plus je me trouvais méprisable. C’est pour le coup que j’avais des fourmis dans les jambes ! Chaque fois que Jim gambadait autour de moi en s’écriant : « Voilà le Caire », j’aurais voulu être loin.
Il parlait tout haut tandis que je m’adressais tout bas des reproches. Bientôt il se mit à marcher à côté de moi en me racontant ce qu’il comptait faire une fois qu’il serait dans les États libres. Il travaillerait ferme et ne dépenserait pas un cent afin d’amasser de quoi racheter sa femme, qui se trouvait sur une ferme près de Saint-Pétersbourg. Ensuite, ils travailleraient ensemble pour affranchir leurs deux enfants, et si le maître refusait de les vendre, on demanderait à quelque abolitionniste de les enlever en cachette.
Sans le voisinage du Caire, Jim n’aurait jamais osé parler ainsi. À peine se croyait-il libre, qu’il brûlait de mettre les autres en liberté. Il me déclarait sans se gêner qu’il voulait voler ses enfants — ses enfants qui appartenaient à un homme dont je n’avais pas à me plaindre, que je ne connaissais même pas. On a pendu des nègres pour moins et des gueux d’abolitionnistes aussi.
J’avais meilleure opinion de lui ; mais c’était ma faute, en somme. Ma conscience se remit à me picoter si fort que je finis par lui dire : « Bon ! tape sur moi. Il n’est pas encore trop tard. Dès que je verrai une lumière, j’irai à terre et je raconterai tout. » Aussitôt mes remords s’envolèrent et je me sentis léger comme une plume.

— Nous sommes sauvés, Huck ! s’écria tout à coup Jim. Voilà le Caire, j’en mettrais la main au feu. Sautez dans le canot.
— Soit, puisque tu le veux, répliquai-je ; mais tu te trompes peut-être. Il ne faut pas crier avant d’être sorti du bois.
Il courut au canot, défit l’amarre, ôta son habit pour l’étendre sur un banc afin que je fusse mieux assis et me passa les rames.
— Ah ! dit-il, au moment où je m’éloignais, je pourrai bientôt crier tout à mon aise, et je crierai que je suis un homme libre. C’est à vous que je le devrai, massa Huck. Sans vous, je serais encore esclave. Jim ne l’oubliera pas, Huck. Vous êtes le seul ami que Jim ait jamais eu.
Je partais avec l’intention de calmer mes remords en le dénonçant. Il avait bien besoin de me remercier. Ma résolution parut s’évanouir ; je m’éloignai lentement et je me demandai si je ne ferais pas mieux de revenir en arrière. Au même instant, je vis arriver un esquif monté par deux hommes armés de fusils. Ils me hélèrent et je dus m’arrêter.
— D’où viens-tu ? me demanda l’un d’eux. Qu’as-tu laissé là-bas ?
— Un bout de radeau, répliquai-je.
— C’est toi qui le conduis ?
— Oui, monsieur.
— Il y a du monde à bord ?
— Un seul homme, monsieur.
— Bien sûr ? Cinq nègres se sont enfuis ce soir, à peu de distance d’ici. Ton homme est-il un blanc ou un noir ?
Je ne répondis pas tout de suite. Les paroles s’arrêtaient dans mon gosier.
— C’est un blanc, répliquai-je enfin.
— Pourquoi as-tu hésité ? Nous allons voir.
— Oui, venez, je vous en prie. C’est mon père qui est là, trop malade pour ramer, et vous m’aiderez peut-être à remorquer le radeau.
— Diable ! je suis pressé, mon garçon. N’importe, nous ne te laisserons pas en plan. Reprends ton aviron, nous te suivons.
Je me dépêchai d’obéir et ils ramèrent de leur côté. Tout en pagayant, je leur dis :
— Mon père vous sera joliment obligé, je vous en réponds. Personne n’a voulu m’aider et je ne suis pas assez fort pour remorquer le radeau.
— Alors, tu as eu affaire à de fiers pleutres… Dis donc, mon garçon, qu’est-ce qu’il a, ton père ?
— Oh ! pas grand’ chose. Il n’y a pas de quoi s’effrayer comme on le fait.
Nous n’étions plus très loin du radeau ; ils cessèrent d’avancer.
— Tu mens, s’écria celui qui m’avait parlé le premier. Dis-nous la vérité, tu n’y perdras rien.
— Eh bien, je vous la dirai. Il a la… Bah ! ça ne s’attrape que quand on a peur… D’ailleurs, je vous jetterai l’amarre et vous n’aurez pas besoin d’approcher trop près.
— Nage à culer, John ! Et toi, passe au large, et tâche de te tenir sous le vent. Ton père a la petite vérole, et tu le sais fort bien. Pourquoi ne l’avoir pas dit tout de suite ?
— On m’a planté là lorsque je l’ai dit, répliquai-je en pleurnichant.
— Parbleu, on n’a pas envie d’attraper la petite vérole ! Il faudrait trouver un médecin. Descends le fleuve pendant une vingtaine de milles et tu arriveras à une ville. Il fera grand jour alors et tu la verras à ta gauche. Ne t’avise pas de laisser deviner quelle maladie tu apportes. Je te plains ; mais que veux-tu que nous y fassions ? Maintenant, file. Tu es pauvre, sans doute ? Tiens, je vais mettre une pièce d’or de vingt dollars sur cette planche — arrête-la au passage.
— Attends une minute, Parker, dit l’autre, voilà une autre pièce de vingt dollars. Adieu, mon garçon, et bonne chance.
Ils s’éloignèrent à la hâte, tandis que je me dirigeais sans me presser vers le radeau, étonné de me sentir aussi tranquille que si j’avais livré le nègre et rempli mon devoir d’homme blanc. Lorsque j’entrai dans le wigwam, je le trouvai vide. Jim ne se montrait nulle part.
— Jim ! Jim !
— Me voici, Huck, dit une voix qui venait je ne savais trop d’où. Sont-ils hors de vue ? Ne parlez pas si haut.
Il était dans l’eau, à l’arrière du radeau.
— Ne crains rien, répondis-je ; ils sont déjà loin.
Alors Jim remonta, se secoua et me dit :
— J’ai tout entendu ; la peur m’a pris et je me suis glissé dans l’eau. S’ils étaient venus à bord, j’aurais gagné la côte à la nage pour attendre leur départ. Mais comme vous les avez roulés ! Vous avez encore une fois sauvé le vieux Jim, et il s’en souviendra, Huck ! Et ils vous ont donné de l’argent par-dessus le marché.
— Oui, vingt dollars pour chacun de nous.
— Avec cela nous pourrons prendre passage sur un vapeur et il nous restera de quoi vivre jusqu’à ce que nous soyons dans les États libres. Je voudrais déjà y être.
Lorsque le jour se montra, nous gagnâmes la côte. Jim eut soin de bien cacher notre embarcation, puis il travailla à tout empaqueter, de façon à être prêt à quitter le radeau.
La nuit suivante, vers dix heures, à un endroit où le fleuve faisait un coude, nous aperçûmes un assez grand nombre de lumières qui annonçaient une ville. Je partis dans le canot pour aller aux informations. Bientôt je vis un bateau monté par un pêcheur qui posait ses filets.
— Maître, est-ce là le Caire ? lui demandai-je poliment.
— Le Caire ? Non.
— Quelle ville est-ce donc ?
— Puisque tu tiens à en savoir davantage, je te conseille de ne pas m’empêcher de jeter mes lignes ou gare à toi ! Va te renseigner là-bas, tu y trouveras assez de bavards.
Ce n’était pas le Caire, cela me suffisait. Je regagnai donc le radeau. Jim, ainsi que je le prévoyais, fut terriblement désappointé.
— Ne te désole pas, lui dis-je. Encore une étape et nous y serons. Deux ou trois heures plus tard, nous passâmes devant une petite ville entourée de collines et je me disposai à aller à terre. Jim me retint. J’avais oublié qu’autour du Caire le pays est très plat. Bientôt l’approche du jour, jointe à la fatigue, nous engagea à faire une nouvelle halte, et nous nous arrêtâmes au bord d’un îlot, près de la rive gauche du fleuve. Je commençais à soupçonner quelque chose et Jim aussi se montrait inquiet.
— Nous avons peut-être dépassé le Caire et débouché dans l’Ohio au milieu du brouillard de l’autre soir, lui dis-je.
Quand le jour vint, la couleur de l’eau, claire sur les bords du fleuve et boueuse au milieu, me montra que mes craintes étaient fondées. Nous étions entrés dans l’Ohio, laissant derrière nous le Mississipi.
Nous tînmes conseil. Il ne fallait pas songer à débarquer ni à remonter le courant avec le radeau. Notre seule alternative était d’attendre le lever du soleil et de rebrousser chemin dans le canot. Nous nous reposâmes pendant toute la journée, car nous avions une rude besogne en perspective. Lorsque nous retournâmes au radeau vers la tombée de la nuit, le canot avait disparu.
— Allons, dis-je à Jim, il ne s’agit pas de se décourager. Ce que nous avons de mieux à faire, c’est de descendre le courant, puisqu’il n’y a plus moyen de le remonter. Le canot doit être loin ; mais l’occasion d’en acheter un autre se présentera, et alors nous rattraperons le temps perdu.
Ceux qui s’imaginent encore, après ce que je viens de raconter, que l’on peut manier impunément une peau de serpent, se rangeront à l’avis de Jim, s’ils ont la patience de lire ce chapitre jusqu’au bout.
Les propriétaires de chantiers et les conducteurs de radeaux refusent rarement de céder un de leurs canots, si on en offre un bon prix. Par malheur, il n’y avait ni chantiers ni radeaux le long des rives. Au bout de trois heures environ, le ciel s’obscurcit peu à peu et une buée grise cacha presque les étoiles. C’était une brume plutôt qu’un brouillard ; néanmoins on ne voyait pas très loin devant soi. Tout à coup, bouf, bouf ! broum, broum ! Un steamer remontait le fleuve. Il choisissait bien son moment !
Nous allumâmes notre lanterne, persuadés que les gens du bord la verraient, puisqu’une lueur rougeâtre nous annonçait leur approche. Nous entendions bien le vapeur ; mais nous ne le vîmes distinctement que lorsqu’il fut à peu de distance. Il marchait droit sur nous. D’abord cela ne m’effraya pas trop. Les pilotes s’amusent souvent à frôler une barque sans la faire chavirer. Parfois la roue enlève une rame ; alors ils se mettent à rire et se croient fort habiles. Je me figurai que celui-là voulait seulement essayer de nous raser de près, car il devait savoir que nous ne pouvions rien pour l’éviter. Pas du tout. Il n’avait sans doute pas vu notre lanterne. Soudain, il arriva sur nous ; on aurait dit un gros nuage noir entouré d’une rangée de vers luisants. Un craquement, un tintement de cloche pour renverser la vapeur, un brouhaha de cris, de jurons, un sifflement à vous casser les oreilles ; puis, tandis que Jim sautait à l’eau d’un côté et moi de l’autre, le steamer passa par-dessus le radeau.

Je plongeai avec la meilleure envie du monde de toucher le fond. Les roues du steamer devaient mesurer trente pieds, et je tenais à leur laisser assez de place. J’ai toujours pu rester une minute sous l’eau. Cette fois, je crois que j’y restai une minute et demie ; ensuite, je remontai en toute hâte, car il me semblait que j’allais éclater, je sortis de l’eau jusqu’aux aisselles et soufflai comme après une longue course.
Naturellement, le steamer s’était remis en marche dix secondes après avoir renversé la vapeur. En général, on ne s’aventure pas sur un train de bois à moins d’être bon nageur, et s’il fallait s’arrêter à chaque accident de ce genre, cela n’en finirait pas. Le steamer était donc déjà hors de vue, bien que je l’entendisse encore.
J’appelai Jim une douzaine de fois, aucune réponse ne m’arriva. Je saisis une planche qui m’avait touché au moment où je remontais sur l’eau et je la poussai devant moi. Je changeai bientôt de direction pour suivre le courant qui portait vers la rive gauche. C’était un de ces courants obliques comme on en rencontre dans les grands fleuves. Grâce à la planche, je pus gagner la côte et je grimpai le long de la berge. Il faisait un peu plus clair ; mais la fatigue m’avait engourdi les jambes et je n’avançai que lentement sur un sol raboteux. Enfin, après avoir cheminé pendant un quart de mille environ, j’aperçus une grande maison, un log house tel qu’en construisent encore les fermiers de l’Arkansas.
Au même instant, trois ou quatre chiens se mirent à tourner autour
de moi en aboyant, et je me gardai bien de faire un pas de plus.
Au bout d’une minute, qui me parut longue, on cria par la fenêtre, et les chiens cessèrent d’aboyer.
— Qui est là ? demanda une voix.
— C’est moi, Huck Finn, répondis-je.
— Connaissez-vous les Shepherdson ?
— Non, monsieur.
— Pourquoi rôdez-vous par ici à cette heure ?
— Je ne rôde pas ; ce sont vos chiens qui m’ont arrêté. Je ne suis qu’un gamin. Un steamer a coulé mon radeau et je viens de gagner la côte à la nage.
— Si vous dites la vérité, vous n’avez rien à craindre… Réveillez Thomas et Robert, vous autres.
J’entendis qu’on remuait dans la maison, puis je vis briller à une croisée ouverte une lumière qui ne tarda pas à disparaître.
— À quoi songez-vous, Brigitte ? reprit la voix qui m’avait interpellé. Posez la lampe par terre. Si nous avions affaire à un Shepherdson, vous lui auriez donné beau jeu… Vous êtes seul, Huck Finn ?
— Oui, monsieur.
— Allons, il ne sera pas dit que la crainte d’un guet-apens m’ait fait refuser l’hospitalité à un enfant. Si quelqu’un vous accompagne, il aura tort de se montrer, car nous voilà prêts à recevoir une douzaine de Shepherdson. On va vous ouvrir, vous pousserez vous-même la porte juste assez pour passer et sans trop vous presser.
Je ne me pressai pas trop. Je n’aurais pas pu, quand même j’en aurais eu envie. C’était à peine si j’osais poser un pied devant l’autre. Sans les chiens, je me serais sauvé. Ils demeuraient aussi silencieux que leurs maîtres ; mais ils me serraient de près. Je posai la main sur la porte et je la poussai tout doucement.
— C’est assez, cria une voix. Avancez la tête et ne bougez plus, jusqu’à nouvel ordre.
J’avançai la tête, et à ma mine, on dut me prendre pour un fier poltron. Dame, à ma place, vous ne vous seriez pas senti plus rassuré. Je ne pouvais pas reculer — les chiens m’auraient sauté à la gorge — et j’avais en face de moi trois grands gaillards qui me tenaient en joue. Le plus âgé avait une soixantaine d’années ; les deux autres ne dépassaient guère la trentaine. C’étaient de beaux hommes, solidement bâtis, et malgré les fusils qu’ils braquaient sur moi, je ne leur trouvai pas l’air méchant. Ils n’étaient pas seuls ; il y avait là une vieille dame qui paraissait bonne comme du bon pain, et, derrière elle, deux jeunes femmes que je ne voyais pas très bien.
— Là, tu peux entrer, me dit le vieux.
Dès que je fus entré, il referma la porte, l’assujettit à l’aide d’une barre de fer, tira les verrous et remit son fusil à un de ses fils. Ensuite, ils m’emmenèrent dans un salon très bien meublé et ils se réunirent dans un coin où il était impossible de les voir du dehors. On promena une chandelle autour de moi et chacun convint que je ne ressemblais en rien à un Shepherdson.
— Tu vois bien, Saül, que ce garçon n’a pas menti ; ses vêtements sont trempés, et il a peut-être faim, dit la vieille dame. Brigitte, ajouta-t-elle en s’adressant à une négresse qui venait de se montrer, préparez-lui vite de quoi manger, et que l’on appelle Georges pour qu’il… Bon, le voilà qui arrive à propos… Georges, emmène ce petit étranger et aide-le à changer d’habits, les tiens lui iront.
Georges semblait avoir mon âge — treize ou quatorze ans — bien qu’il fût un peu plus grand que moi. Il ne portait d’autre vêtement qu’une chemise et ses cheveux étaient tout ébouriffés. Il paraissait encore à moitié endormi, car il bâillait à se décrocher la mâchoire et il se frottait les yeux d’une main, tandis que de l’autre il traînait derrière lui un fusil.
— Il y a donc des Shepherdson qui rôdent autour de la maison ? demanda-t-il.
— Non, c’est une fausse alerte.
— Tant pis, j’en aurais peut-être abattu un.
On se mit à rire et l’un des grands frères dit au nouveau venu :
— Tu serais arrivé trop tard, Georges ; ils auraient eu le temps de nous scalper tous.
— À qui la faute ? On ne me prévient jamais assez tôt ; ce n’est pas bien.
— Ne te désole pas, répliqua le père ; les Shepherdson savent déjà qu’il faut compter avec toi et les occasions ne te manqueront pas. En attendant, obéis à ta mère.
Georges me conduisit dans sa chambre, au premier étage. Là, il m’eut bientôt trouvé une chemise, un pantalon et une jaquette. Pendant que je m’habillais, il me demanda comment je m’appelais ; mais, au lieu de me laisser le temps de répondre, il se mit à faire l’éloge d’un geai bleu qu’il avait attrapé la veille dans les bois ; puis, il me dit tout à coup :
— Où se trouvait Moïse quand il éteignit la chandelle ?
— Je connais l’histoire de Moïse ; mais on ne m’a jamais parlé de ça.
— Cherche un peu.
— Quelle chandelle ?
— N’importe laquelle… Tu ne devines pas ?
— Non.
— Eh bien, il se trouvait dans l’obscurité.
— Si tu avais ri plus tôt, j’aurais deviné.
— Tu crois ? … J’espère que tu vas demeurer avec nous… J’ai un fusil et des lignes à pêche. Je te les prêterai… Tu dois avoir eu peur de te noyer ? Moi, je nage comme un poisson, mais je n’aimerais pas tomber à l’eau la nuit… Tiens, passe cette jaquette ; on dirait qu’elle a été faite pour toi… Allons, te voilà prêt, descendons.
Tout en parlant, il s’était habillé de son côté, et je ne demandai pas mieux que de le suivre, car j’avais faim. Il me ramena dans le salon où je trouvai mon couvert mis en face d’un tas de bonnes choses. Je ne regrettais plus d’avoir été arrêté par les chiens.

Pendant que je soupais, Georges et les autres, excepté la vieille dame et les deux demoiselles, fumaient dans des pipes en bois. Les questions pleuvaient dru comme grêle. Ils m’interrogeaient tous à la fois, ce qui me permit de répondre à tort et à travers. On ne dut pas comprendre grand’chose à mon histoire, si ce n’est que je venais de loin, que ma mère était morte, que mon père avait disparu, et que j’avais failli me noyer. Bref, la vieille dame dit que je n’avais pas besoin de chercher un autre toit tant que je me conduirais bien, et on alla se coucher.
Georges, dont j’avais partagé le lit, me réveilla plus tôt que je n’aurais voulu. Il tenait à me montrer sa maison. C’était une très belle maison. Il n’y en avait pas de plus belle à Saint-Pétersbourg, ou du moins de plus grande ni de mieux meublée.
Sur la cheminée du salon on voyait une pendule que Georges n’aurait pas donnée pour tout l’argent du monde. Il me raconta que depuis qu’un horloger ambulant l’avait nettoyée et réglée, elle se mettait souvent à sonner cinquante fois de suite sans être fatiguée.
À droite et à gauche de la pendule s’étalaient deux grands perroquets qui ne ressemblaient pas à des oiseaux ordinaires. Je crois qu’ils étaient en craie peinte. À côté d’un des perroquets il y avait un chat, et à côté de l’autre un chien en faïence ; quand on pressait la main dessus, ils miaulaient — le chien surtout. Seulement, ils n’ouvraient pas la bouche — ils miaulaient en dessous.
Sur la table du salon, recouverte d’une belle toile cirée, il y avait une superbe corbeille en faïence remplies de pommes, d’oranges, de pêches et de raisins plus rouges et plus verts que de vrais fruits. Aussi n’étaient-ils pas vrais, et on s’en apercevait tout de suite, parce que les couleurs s’étaient écaillées par endroits.
Les gravures accrochées aux murs ne me semblèrent pas très neuves, bien qu’on les eût mises sous verre pour les empêcher de jaunir. C’étaient, pour la plupart, des Washington, des La Fayette et des batailles, comme on en voit partout. Mais il y avait trois autres images que Georges admirait beaucoup plus et qu’il appelait des pastels. Une de ses sœurs, morte depuis longtemps, les avait dessinés elle-même quand elle n’avait pas encore quinze ans. Pour ma part, je me passerais bien de pastels, car ça manque de gaieté.
L’un d’eux représentait une femme en grand deuil qui se penchait sous un saule pleureur, à deux pas d’une pierre tombale, les bras ballants, un mouchoir bordé de noir dans une main et un joli sac à ouvrage dans l’autre. De grosses larmes lui roulaient le long des joues et au bas on lisait : je ne te verrai plus, hélas !
Le second pastel représentait une dame qui contemplait un serin mort, et le troisième, une autre dame — c’était peut-être la même, je n’en suis pas sûr — qui levait en l’air une lettre cachetée de noir. C’étaient de très belles images ; seulement, cela me rendait triste de les regarder, surtout lorsque je songeais à ce pauvre Jim.
Si je possédais le talent d’Emmeline Grangerford, je ne me contenterais pas de ne dessiner que des pastels, où il y a toujours une femme qui pleure. Que voulez-vous ? c’était son genre et elle y réussissait trop bien pour en sortir. Elle travaillait à ce qu’on appelait son grand ouvrage lorsqu’elle tomba malade. Elle ne demandait qu’à vivre assez longtemps pour l’achever ; mais cette consolation lui fut refusée.
Figurez-vous une dame emmitouflée dans un long peignoir blanc, debout sur le garde-fou d’un pont, prête à sauter dans l’eau, avec les cheveux qui lui tombent sur les épaules. Par exemple, je ne sais pas pourquoi celle-là versait des larmes, car elle regardait une pleine lune qui ressemblait à une orange. Elle avait deux bras croisés sur la poitrine, deux bras étendus droit devant elle et deux bras levés au ciel. Ça lui donnait un peu l’air d’une araignée ; mais Georges m’expliqua que l’idée d’Emmeline était de laisser la paire de bras qui produirait le meilleur effet, et d’effacer les autres. Par malheur, le choix était si difficile qu’elle mourut avant d’avoir pris une résolution. Son dernier ouvrage resta donc accroché, tel quel, au chevet de son lit, et à l’anniversaire de sa naissance on l’entourait de fleurs.

Le colonel Grangerford, le père de Georges, servait dans la milice et se tenait aussi raide que s’il marchait à la tête de son régiment. Grand et sec, il avait un teint basané, des lèvres et des narines très minces. Sous ses épais sourcils et son front bombé, ses yeux semblaient étinceler comme au fond d’une caverne. Ses cheveux, encore noirs, lui descendaient tout droit sur les épaules. Il se rasait tous les matins, ne laissant pas l’ombre d’une barbiche. Son costume — je ne l’ai jamais vu en uniforme — faisait mal aux yeux, tant il était blanc, et il le changeait chaque jour. Il élevait rarement la voix ; mais, des fois, quand il vous regardait d’un certain air, on aurait voulu être loin. Si, par hasard, quelque chose allait de travers, il fronçait les sourcils et tout rentrait dans l’ordre pour longtemps.
Le matin, lorsque M. et Mme Grangerford descendaient au salon, chacun se levait et personne ne reprenait son siège avant qu’ils fussent assis. Alors, Robert allait à un buffet où se trouvaient les carafes, préparait un verre de bitter et le présentait à son père. Le colonel tenait son verre à la main jusqu’à ce que les deux jeunes gens eussent rempli le leur ; alors ceux-ci saluaient en disant : « Monsieur, madame, nos respects. » Les vieillards répondaient par un léger signe de tête et un « merci », puis on buvait.
Robert et Thomas, les deux aînés, étaient de beaux garçons, aussi grands que leur père, plus larges d’épaules et beaucoup moins raides. Vêtus, comme le colonel, d’un costume de toile blanche et coiffés d’un panama, ils passaient leur temps à dompter les chevaux, à chasser et à surveiller les travailleurs, qui leur obéissaient au doigt et à l’œil.

Miss Charlotte, la moins jeune des deux filles, avait vingt-cinq ans. Très grande, très belle, très fière, elle se montrait aussi très bonne, pourvu qu’on ne la contrariât pas. Mais elle avait de qui tenir, et quand elle se fâchait, son regard rappelait celui du colonel.
Miss Sophie n’avait que vingt ans. Malgré sa taille moins imposante, elle était très belle aussi ; seulement elle n’avait pas l’air de s’en douter.
En comptant Georges, c’était tout ce qui restait de la famille. Elle avait été plus nombreuse ; mais trois des fils étaient morts, et j’ai déjà parlé d’Emmeline.
M. Grangerford possédait au moins une centaine d’esclaves. Nous avions tous un domestique à notre service. Mon négrillon et celui de Georges se donnaient du bon temps. Nous n’avions pas souvent besoin d’eux et ils s’aidaient à ne rien faire.

Le colonel et ses fils sortaient rarement le soir et ils ne s’aventuraient guère dehors sans être armés, même en plein jour. Ils avaient des parents qui venaient les voir de temps à autre, de dix à quinze milles à la ronde, et ceux-là avaient aussi un fusil sur l’épaule. Je devais bientôt apprendre pourquoi.
Il y avait dans nos environs plusieurs propriétaires du nom de Shepherdson, aussi fiers que les Grangerford, et les deux familles étaient à couteaux tirés.
Un jour que Georges et moi revenions d’une plantation, nous entendîmes derrière nous un bruit de galop. Nous traversions une route et mon compagnon me cria :
— Vite, regagne le bois.
Il fila devant moi sans me laisser le temps de l’interroger, et je me dépêchai de le suivre.
Une fois à l’abri sous les arbres, il écarta les branches et nous regardâmes du côté d’où venait le bruit. Bientôt un cavalier de fort bonne mine se montra sur la route. Il n’avait pas l’air de s’occuper de son cheval, qui pourtant ne paraissait pas commode, et il tenait son fusil en travers du pommeau de sa selle. Je l’avais déjà vu. C’était le jeune Harry Shepherdson. Le fusil de Georges partit à un pas de moi et une balle enleva le chapeau de Harry. Ce dernier saisit sa carabine et se dirigea sans hésiter vers l’endroit où nous étions cachés.
Nous ne l’attendîmes pas. Nous partîmes au pas de course. Le bois n’était pas trop épais, de sorte que je regardais par-dessus mon épaule afin d’éviter la balle. Deux fois je vis Harry viser Georges ; mais il ne tira pas et remonta la route par laquelle il était venu. Nous ne reprîmes haleine qu’en arrivant à la maison. Georges était tout essoufflé quand il raconta l’aventure à son père. Le vieux gentleman ne témoigna aucune surprise, aucun mécontentement ; au contraire, son visage s’éclaira pendant une seconde ou deux, puis il dit très doucement :
— Je n’aime pas que l’on s’embusque derrière une haie pour tirer. Pourquoi n’es-tu pas resté sur la route, mon garçon ?
— Les Shepherdson ne le font pas, père, répliqua Georges ; ils nous prennent toujours en traîtres et je me suis montré avant de tirer.
Miss Charlotte redressa la tête comme une reine tandis que Georges racontait l’histoire ; ses narines se dilataient et ses yeux lançaient des éclairs. Miss Sophie devint très pâle jusqu’à ce qu’elle eût appris que personne n’avait été blessé.
Dès que je me trouvai seul avec Georges, je lui demandai :
— Est-ce que tu voulais le tuer ?
— Parbleu !
— Qu’est-ce qu’il t’a fait ?
— Lui ? Il ne m’a jamais rien fait.
— Alors pourquoi as-tu tiré sur lui ?
— Parce que c’est un Shepherdson.
— Drôle de raison !
— Très bonne, au contraire. Les Shepherdson ont tué trois de mes frères ; ils nous tueraient tous, s’ils le pouvaient, et on leur rend la pareille. Où donc as-tu été élevé ? Tu ne sais pas ce que c’est qu’une guerre de faction ?
— Non, et je ne serais pas fâché de le savoir.
— Eh bien, répliqua Georges, ces guerres-là commencent toujours de la même manière. Un homme a une dispute avec un voisin et il le tue. Alors un oncle ou un frère du voisin le venge, puis les parents des deux morts se mettent de la partie. On s’arrête quand une des familles a disparu ; mais cela demande du temps.
— Et ton affaire à toi dure depuis longtemps ?
— Je crois bien. Depuis plus de vingt ans.
— À quel propos s’est-on disputé ?
— Il y a eu procès, je crois, et celui qui l’a gagné a reçu une balle.
— Et qui a tiré le premier ? Un Grangerford ou un Shepherdson ?
— Comment veux-tu que je le sache ? je n’étais pas né.
— Et a-t-on tué beaucoup de monde ?
— Oui, il y a eu assez d’enterrements et assez de chances d’enterrements. Mon père, Thomas et Robert ont été blessés plusieurs fois — ils ne s’en portent pas plus mal. Cette année, les Shepherdson ont eu un mort et nous en avons eu un. Il y a trois mois, mon cousin Bud, qui avait quatorze ans à peine, traversait à cheval la forêt, de l’autre côté du fleuve. Il n’était pas armé — une fière bêtise de sa part. Arrivé dans un sentier, il entend derrière lui le pas d’un cheval et voit le vieux Baldy Shepherdson lancé au galop, son fusil à la main, ses cheveux blancs flottant au vent. Au lieu de mettre pied à terre pour se réfugier dans le bois, Bud crut qu’il pourrait lutter de vitesse. La course dura pendant cinq milles et plus ; mais le vieux gagnait peu à peu du terrain. Enfin, Bud, dont la bête s’essoufflait, vit que ce n’était pas la peine de s’entêter. Il s’arrêta donc et fit volte-face — il ne voulait pas recevoir une balle dans le dos, tu comprends. Alors le vieux s’avança et le tua raide. Mais il n’eut guère le temps de se vanter de son exploit, car, huit jours plus tard, un des nôtres lui a mis du plomb dans la tête.
— À mon avis, ce vieux n’était qu’un lâche.
— Tu te trompes joliment ! Il n’y a pas de lâches parmi les Shepherdson — non, pas un seul, pas plus qu’il n’y en a chez les Grangerford. Un jour, ce vieux-là a tenu bon contre trois Grangerford pendant je ne sais combien de temps, et il a eu le dessus. Son cheval et lui rentrèrent clopin-clopant, la peau considérablement trouée ; mais il fallut porter tous les Grangerford chez eux. L’un était mort, l’autre mourut dans la nuit et le troisième boite encore. Non, ce n’était pas un lâche !
Le lendemain — c’était un dimanche — je partis avec la famille pour l’église, qui se trouvait à six milles environ de la maison. Les hommes emportèrent leurs fusils, qu’ils posèrent à côté d’eux en gagnant leur banc. Les Shepherdson en firent autant. Le sermon me parut long, peut-être parce qu’il était trop savant pour moi. Le colonel déclara pourtant que c’était un très beau sermon, et au retour on ne parla guère d’autre chose.
Le dimanche, on ne chasse pas et il n’y a pas de travailleurs à surveiller. Une heure après le dîner, on bâillait à qui mieux mieux dans le salon. Ceux qui ne s’étaient pas assoupis à force de bâiller finirent par disparaître un à un. Je m’esquivai à mon tour et me mis à la recherche de Georges. Je le trouvai endormi sur l’herbe en compagnie de son chien, qui savait probablement aussi que c’était dimanche. Alors je me décidai à rentrer pour dormir de mon côté en attendant l’heure du souper. En haut de l’escalier, je rencontrai miss Sophie qui se tenait sur le seuil de sa chambre où elle me fit entrer.

— Huck, me dit-elle, j’ai un petit service à te demander. Je viens de recevoir un billet de mon oncle, lequel, tu le sais, est pasteur du village que nous voyons là-bas, de l’autre côté de la rivière. Mon oncle me demande de venir causer avec lui, en secret, d’affaires importantes. Il s’agit, me dit sa lettre, de mon bonheur futur et d’une réconciliation possible de notre famille avec celle de nos ennemis, réconciliation que je souhaite depuis longtemps très fort.
— Comment puis-je vous être utile, miss ? demandai-je.
— En m’accompagnant jusqu’au bord de la rivière, en m’aidant à la traverser.
— N’est-ce que cela ? Vous êtes si bonne, miss Sophie, que je ferais beaucoup plus, si je le pouvais, pour vous obliger.
— Tu feras plus que tu n’imagines, Huck, en me secondant, et voici pourquoi. C’est près du village dont mon oncle est pasteur qu’habitent les Shepherdson. Or, si l’un des miens me voit me diriger de ce côté, ou il voudra s’opposer à mon départ, ou il insistera pour m’accompagner, ce qui pourrait amener d’affreux malheurs.
— Mais que dirons-nous, si l’un d’eux nous rencontre ? s’il nous voit nous embarquer ?
— Ils font tous leur sieste, Huck, et ce contretemps est peu à craindre.
Nous voilà en route, feignant de nous promener. Nous descendons jusqu’à l’endroit où la rivière décrit une courbe sans avoir rencontré âme qui vive. Miss Sophie saute dans un canot, je saisis les rames et le bateau file si vite que bientôt nous approchons de la rive qu’il s’agit d’atteindre.
— Je ne vois personne, me dit miss Sophie ; nous pouvons aborder, et j’en suis heureuse.
— Redoutez-vous donc quelque chose ? lui demandai-je.
— Pour moi, rien, mon brave garçon ; mais j’étais un peu inquiète pour toi. Tu es presque de la famille maintenant, et si un Shepherdson t’apercevait, peut-être serait-il tenté de te saluer d’une des balles de sa carabine.
Je secoue la tête ; il me semble entendre siffler à mes oreilles la balle dont parle miss Sophie.
— Mais vous ? lui dis-je en cessant de ramer.
— Moi ? Je n’ai rien à craindre. Si implacable que soit la haine qui sépare les deux familles, les femmes sont respectées.
Je me remets à ramer, avec plus de lenteur néanmoins, et j’examine avec soin le point où je compte aborder et qui me paraît désert. Tout à coup, je vois, près d’un buisson, un homme armé d’un fusil et je le désigne à miss Sophie. Elle part d’un petit éclat de rire.
— L’homme qui te fait peur, dit-elle, est un paisible pêcheur, et son fusil une simple ligne au bout de laquelle frétille un poisson.
Miss Sophie a raison. Je reconnais, une fois de plus, que la frayeur dénature facilement les objets. Nous abordons, et miss Sophie saute sur le rivage.
— Dois-je vous attendre, miss ?
— Non, Huck, ne t’inquiète plus de moi ; mon oncle me ramènera. Tu peux retourner à la maison.
Je me hâte de gagner le large, car un cavalier vient de paraître dans la plaine, et j’aborde avec soulagement la rive d’où je suis parti. Mon canot est à peine amarré, que je suis accosté par mon négrillon.
— Ah ! me dit-il d’un air mystérieux, il y a longtemps que je vous cherche, massa.
— Que me veux-tu ?
Mon interlocuteur regarde autour de lui avec méfiance, puis reprend à mi-voix :
— Massa, si vous voulez venir du côté du marais, je vous montrerai une belle gerbe de souliers de Notre-Dame.
— Laisse-moi tranquille, répliquai-je ; les souliers de Notre-Dame ne sont pas assez rares pour qu’on s’amuse à courir après.
— Tout de même, il y en a un que vous ne serez pas fâché de voir.

Je me rappelai que, la veille, il avait déjà proposé de m’emmener du côté du marais ; son air mystérieux m’intriguait.
— Eh bien, montre-moi le chemin, lui dis-je.
Je le suivis à travers bois pendant un demi-mille, puis il s’engagea dans un marais où l’on enfonçait jusqu’aux chevilles. De temps à autre il se retournait pour cligner de l’œil. Évidemment, cela signifiait : la route n’est pas bonne, mais ce que vous verrez vaut la peine d’être vu. Enfin, nous arrivâmes en face d’une petite butte où le terrain desséché était couvert d’arbres, de buissons et de vignes.
— Voilà l’endroit, massa. Vous n’avez plus besoin de moi.
Sur ce, il me tourna le dos. Je m’avançai dans le fourré, et, au fond d’un bosquet, j’aperçus un homme endormi. C’était mon vieux Jim.
Je le réveillai, comptant que ce serait une fière surprise pour lui de me revoir. Je me trompais joliment. Il pleura presque de joie, mais ne parut pas surpris. Il me raconta que le soir où le vapeur nous avait coulés, il s’était mis à nager derrière moi. Il entendait très bien mes cris d’appel ; seulement il n’osait pas me répondre, parce qu’il ne voulait pas être repêché et ramené à Saint-Pétersbourg.
— J’étais un peu meurtri, continua-t-il, de sorte que je suis resté en arrière. Je pensais qu’une fois à terre, je n’aurais pas de peine à vous rattraper ; mais quand les chiens ont commencé à aboyer, je n’ai plus eu envie de me presser. Lorsqu’ils ont cessé, j’ai deviné qu’on vous avait ouvert la porte et j’ai filé pour attendre le jour dans les bois. Le lendemain, de grand matin, des nègres qui allaient aux champs m’ont conduit dans cet endroit, où les chiens perdraient ma piste ; tous les soirs ils m’ont apporté des vivres et donné de vos nouvelles. Jack venait même quelquefois en plein jour.
— Pourquoi ne m’as-tu pas fait prévenir plus tôt ?
— Cela n’aurait servi à rien, massa Huck. Nous ne pouvions pas songer à repartir. Aujourd’hui, c’est différent. Chaque fois que l’occasion se présentait, j’ai acheté des provisions, des couvertures, tout ce qui nous manquait, et j’ai passé des nuits à rafistoler le radeau…
— Quel radeau, Jim ?
— Notre vieux radeau, parbleu !
— Quoi, il n’a pas été mis en miettes ?
— Non, il a été pas mal endommagé, mais il n’y a pas eu grand mal, en somme. Si la nuit avait été moins noire, nous aurions vu le radeau remonter sur l’eau. Ça n’en vaut que mieux peut-être, car le voilà remis à neuf et bien ravitaillé.
— Où donc l’as-tu repêché, Jim ?
— Comment voulez-vous que je le repêche ? J’étais obligé de me tenir caché. Les nègres l’ont trouvé accroché près d’ici, à l’endroit où le fleuve fait un coude, et ils l’ont amarré dans une crique. Votre Jack m’a raconté qu’ils se chamaillaient pour savoir à qui il appartenait. Alors j’ai mis le holà en disant que le radeau n’était à aucun d’eux, mais à vous, et qu’on leur tannerait le cuir s’ils osaient vendre la propriété d’un blanc. J’ai donné dix cents à chacun et tout le monde a été satisfait. Jack n’a rien voulu accepter.
— Oh ! Jack est un malin. Il ne m’a jamais dit que tu étais ici et m’a emmené sous prétexte de me montrer des souliers de Notre-Dame. Si l’on découvre quelque chose, il pourra jurer qu’il ne nous a pas vus ensemble.
Je quittai Jim et je retournai vers la maison où régnait un silence inusité. Je me mis à rôder à l’aventure, avec l’espoir de rencontrer Georges. Près de l’écurie, j’aperçus Jack.
— On dirait que la maison est vide ? lui criai-je.
Il leva les bras vers le ciel et me regarda d’un air effrayé.
— Quoi, massa, vous ne savez pas ce qui est arrivé ?
— Qu’est-il arrivé ? parle !
— Les Shepherdson sont en campagne. Ils se sont emparés de miss Sophie. On croit qu’ils l’ont tuée et tout le monde est à cheval pour la venger. Nous allons entendre le bruit de la bataille, massa Huck, et elle sera terrible.
Les paroles de Jack me serrent le cœur, les oreilles me tintent, j’ai des larmes plein les yeux. Hélas, miss Sophie, si bonne — morte, noyée ! Et c’est moi qui, pour lui obéir, l’ai livrée à ses bourreaux ! Une détonation retentit. Je m’élance vers la rivière. Pour le coup, moi aussi, je voudrais frapper un Shepherdson. Je rencontre Georges. Il est écarlate et semble hors de lui.
— Comment, tu n’as pas de fusil ! me dit-il. Tu ignores donc ce qui se passe ? Les Shepherdson ont emmené Sophie.
— Qui dit cela ? m’écriai-je.
— Un pêcheur qui est aussitôt venu prévenir mon père.
Ah ! ce pêcheur, j’avais raison de me méfier de lui. Il appartenait à cette race de gens qui racontent de travers tout ce qu’ils voient. Je crois bon d’instruire Georges de la vérité ; mais il m’écoute avec impatience, car il voit un de ses frères prêt à échanger une balle avec un Shepherdson. Il m’écoute jusqu’au bout cependant et m’entraîne vers son père. Je raconte de nouveau que c’est moi qui, sur sa demande, ai conduit miss Sophie de l’autre côté de la rivière, qu’elle se rendait volontairement chez son oncle, lequel l’avait appelée. Comme pour confirmer mon assertion, on voit paraître au loin le pasteur. À sa droite marche miss Sophie — ce qui fait pousser des cris de joie aux Grangerford — et à sa gauche se tient Harry Shepherdson, ce qui les fait rugir. Que va-t-il se passer ? Je suis tenté d’aller rejoindre Jim et de m’enfuir sur l’heure avec lui.

Le pasteur s’embarque à bord d’un canot avec les deux jeunes gens dont il est escorté, et les voilà sur le rivage. Le pasteur s’avance, tandis que le jeune Harry lève les bras pour montrer qu’il n’est pas armé. Les deux frères causent longtemps ensemble avec animation. Le pasteur fait alors un signe et miss Sophie s’approche avec son compagnon, dont le colonel serre la main. Je n’y comprends rien ; mais bientôt tout s’explique. Grangerford et Shepherdson se dirigent vers la maison, conduits par le vieux pasteur, radieux de son œuvre de paix. Oui, la paix était faite et j’y avais un peu contribué, sans m’en douter. Miss Sophie et Harry Shepherdson s’aimaient depuis longtemps. Le digne pasteur, qu’ils avaient pris pour confident, venait de mettre fin à la vendetta en unissant les deux jeunes gens[2].
On gagnait l’habitation et je demeurais immobile à la place où je me trouvais.
— Ne viens-tu pas ? me demanda Georges au passage.
— Oui, répondis-je, je te suis.
Au lieu de le suivre, je restai à réfléchir. Je songeais à partir ; cependant j’aurais voulu, sans révéler mon dessein, prendre au moins congé de ceux qui m’avaient si cordialement accueilli. Mais parler de la présence de Jim, me poser en abolitionniste, je ne pouvais pas y songer. Il fallait, profitant du désordre causé par la réconciliation, me mettre au plus vite en route. Je me dirigeai donc en droite ligne vers le marais. Jim n’était pas dans son gîte. Je me dépêchai de gagner la crique où le radeau se trouvait amarré la veille. Il n’était plus là. Je me mis à appeler le nègre. Une voix me répondit.
Je courus le long de la berge, je sautai à bord et Jim me serra dans ses bras. Il était enchanté de quitter son marais et déclara que nulle part on ne respire aussi librement qu’à bord d’un radeau. Le fait est qu’on n’y étouffe pas comme dans les maisons et on s’y sentirait plus à l’aise qu’ailleurs sans la crainte d’être coulé par un vapeur.
Deux ou trois jours, deux ou trois nuits s’écoulèrent. La vieille histoire recommençait. La nuit, nous descendions le fleuve qui, dans ces parages, atteignait parfois une largeur d’un mille et demi. Dès l’aube, le radeau, amarré dans une anse, disparaissait sous des branches de cotonnier. Après avoir posé nos lignes, nous nagions pour nous dégourdir, puis nous nous allongions sur le sable afin d’attendre la venue du jour. Sans le coassement des grenouilles, on aurait cru le monde endormi. La première chose que l’on apercevait, en regardant de l’autre côté du fleuve, était une ligne sombre qui annonçait la lisière d’un bois dont les arbres demeuraient encore invisibles. Peu à peu l’horizon s’éclairait ; au loin la surface de l’eau prenait une teinte grise, on voyait des points noirs — sans doute des bateaux marchands — et de longues raies noires qui ne pouvaient être que des radeaux. Parfois on entendait le clapotement d’une rame ou un bruit de voix confus. Au milieu d’un silence aussi profond, les sons nous arrivaient de très loin. Par degrés la brume disparaissait comme en s’enroulant sur elle-même et on distinguait vaguement sur la rive opposée un village ou un chantier.
Enfin il fait jour, tout sourit au soleil, et les oiseaux s’en donnent à cœur joie. Il est encore de trop bonne heure pour qu’un peu de fumée attire l’attention. Nous relevons nos lignes et Jim prépare un bon déjeuner.
Le repas terminé, nous regardions couler l’eau. Comme ce spectacle manquait de nouveauté, nos yeux se fermaient bientôt, mais ils ne tardaient guère à se rouvrir et nous apercevions un vapeur qui s’éloignait en toussant. Puis il n’y avait rien à voir, rien à entendre. Au bout d’une heure peut-être un radeau se montrait. Une hache brillait en l’air et s’abattait, car ils sont presque toujours en train de fendre du bois sur les radeaux. Aucun bruit. La hache se levait de nouveau, et quand elle était au-dessus de la tête du bûcheron, nous entendions un tcheunk ! Il avait fallu tout ce temps pour que le son du premier coup parvînt jusqu’à nous.

Un matin, par un épais brouillard, chaque radeau qui passait nous donnait un véritable charivari ; on battait la grosse caisse sur des casseroles pour prévenir les steamers. Une embarcation arriva si près de nous que nous entendions rire des gens que nous ne voyions pas.
Dès que la nuit venait, nous passions au large et, arrivés au milieu du fleuve, nous laissions le radeau suivre le courant. Nos pipes allumées, les jambes dans l’eau, nous causions. Nous restions à peu près nus, quand les moustiques ne nous tourmentaient pas. Les habits que la famille de Georges, m’avait fait faire étaient encore trop neufs pour ne pas me gêner et rien ne m’empêchait de me mettre à mon aise.
À minuit, tout le monde était couché le long de la côte ; les faibles lueurs qui trahissaient la présence d’une cabane s’éteignaient. Ces lueurs nous servaient d’horloge ; dès qu’elles reparaissaient, elles nous annonçaient qu’il ferait bientôt jour et qu’il fallait chercher un endroit pour cacher le radeau.
Un matin, vers l’aube, je partis à bord d’un canot que nous avions arrêté au passage et je remontai, en pagayant, une crique boisée où j’espérais récolter du fruit. Après m’être avancé d’un mille environ, j’arrivai en face d’une sorte de sentier de vaches, et j’aperçus deux hommes qui couraient de mon côté. Lorsque je voyais quelqu’un jouer des jambes, je m’imaginais toujours que l’on courait après moi ou après Jim. Ma première idée fut donc de déguerpir au plus vite ; mais avant que j’eusse dégagé mon aviron, empêtré dans les roseaux, ils étaient déjà à portée de voix. Ils me crièrent que des gens à cheval les poursuivaient avec une meute de chiens et ils me suppliaient de leur sauver la vie. Arrivés au bout du sentier, ils voulurent sauter dans le canot.
— Pas de ça, s’il vous plaît, dis-je en donnant un coup de rame. Rien ne presse — les chiens et les chevaux m’ont l’air d’être encore loin. Filez à travers les buissons et quand je serai sûr qu’on est à vos trousses, je vous laisserai monter de façon à ne pas risquer de chavirer. En marchant dans l’eau, vous dépisterez la meute.
Ils ne se le firent pas dire deux fois, et me voilà en route de mon côté. Ils n’avaient pas menti. Une dizaine de minutes plus tard j’entendis aboyer au loin ; un quart d’heure après, les fugitifs respiraient à l’aise dans un bois de cotonniers où Jim avait établi sa cuisine.
Le plus âgé des deux ne devait guère avoir moins de soixante et dix ans. Il était chauve ; en revanche, il avait une barbe blanche qui lui donnait un air respectable. Un chapeau mou, une chemise de laine bleue, un pantalon de toile dont le bas disparaissait dans la tige de ses bottes et des bretelles en tricot composaient son costume — non, pas des bretelles, car il lui en manquait une. Il portait sur le bras un habit de drap noir un peu râpé, mais dont les boutons de cuivre semblaient tout neufs. De même que son compagnon, il tenait à la main un vieux sac de voyage bien rembourré. Ledit compagnon avait trente ans environ et n’était pas beaucoup mieux mis.
Ils s’assirent pour déjeuner avec nous, comme si c’eût été une affaire entendue, et se mirent à causer. J’appris bien vite qu’ils ne se connaissaient pas.
— Pourquoi vous êtes-vous sauvé, vous ? demanda la tête chauve à l’autre.
— J’ai inventé une poudre qui enlève le tartre des dents et j’en ai vendu pas mal là-bas. Seulement ma poudre enlève aussi l’émail au bout d’un certain temps, et je suis resté dans la ville un jour de trop. C’est pour cela que je m’en allais sans avertir mes clients lorsque je vous ai rencontré. Vous m’avez dit que l’on croyait avoir à se plaindre de vous et vous m’avez prié de vous aider à filer. Comme je me trouvais dans le même cas, j’ai offert de vous tenir compagnie. Voilà mon histoire — à votre tour.
— Moi, j’avais entrepris là-bas une petite campagne contre l’ivrognerie. Cela marchait très bien. Pendant huit jours, j’ai été la coqueluche de toutes les femmes de la ville, jeunes ou vieilles, car je tombais à bras raccourci sur ces gredins qui empoisonnent les gens avec
leurs boissons frelatées. Chaque conférence me rapportait jusqu’à cinq
ou six dollars. Mais le bruit s’est répandu que je ne prêchais pas
d’exemple et que je buvais en cachette autre chose que de l’eau. Un
bon nègre m’a averti ce matin que les mécontents organisaient une
chasse à mon intention, qu’ils rassemblaient leurs chiens et qu’ils me
donneraient une demi-heure d’avance. Je n’ai pas attendu l’heure du
déjeuner — je n’avais pas faim.
— Vous m’avez l’air d’un vieux malin, dit le jeune homme. Il me semble que nous pourrions nous atteler à la même voiture.
— Je ne demande pas mieux. Quelle est votre spécialité, sans indiscrétion ?
— Typographe, par état ; phrénologue, artiste dramatique, dentiste, magnétiseur, conférencier, maître de danse ou de géographie, débitant de médecines plus ou moins brevetées, selon l’occasion. Il n’y a pas de sot métier, pourvu qu’il n’exige pas trop de travail. Et vous ?
— J’ai fait un peu de tout cela dans mon temps. La bonne aventure et le magnétisme étaient mon fort, quand je trouvais un compère habile. Aujourd’hui, je m’en tiens aux conférences sur l’abus des liqueurs fortes. Si les ivrognes — on en rencontre partout — ne se dérangent guère pour venir m’entendre, leurs femmes accourent et d’assez grosses recettes récompensent mes faibles efforts.
Il y eut un moment de silence ; enfin, le jeune poussa un profond soupir et s’écria :
— Hélas ! hélas !
— Qu’est-ce qui vous prend ? demanda le vieux.
— Ah ! lorsque je songe que je suis réduit à voyager sur un radeau, en compagnie de gens dont…
Il s’arrêta pour tirer un mouchoir de sa poche et s’essuya le coin de l’œil.
— Dites donc, riposta la tête chauve d’un ton revêche, notre société en vaut bien une autre !
— Certes, et je ne vous adresse aucun reproche. Loin de là. Ce n’est pas vous qui m’avez tout enlevé : nom, honneurs, fortune, famille. Par bonheur, il est une chose que le monde ne peut m’enlever : la tombe où mon pauvre cœur brisé goûtera enfin le repos éternel !
Et il porta de nouveau son mouchoir à ses yeux.
— Le diable emporte votre pauvre cœur brisé ! s’écria le vieux monsieur. Pourquoi nous le jetez-vous à la tête ? Nous n’y sommes pour rien.
— Je le sais. Encore une fois, je ne vous adresse aucun reproche. Je ne maudis que ceux qui m’ont fait tomber de si haut.
— Tomber de si haut ? De quel étage êtes-vous tombé ?
— Ah ! vous ne me croiriez pas… Pleurez, pleurez, mes yeux, et fondez-vous en larmes… Que vous importe, d’ailleurs, le secret de ma naissance ?… Cependant, je vous le confierai, ce secret, et vous joindrez vos larmes aux miennes… Vous avez devant vous un duc dont on a méconnu les droits.
Les yeux de Jim s’écarquillèrent et les miens aussi. Nous savions, pour l’avoir entendu dire à Tom Sawyer, qu’il y a en Angleterre des ducs qui se regardent comme de si grands personnages qu’ils ne donneraient pas une poignée de main au président de notre république. Le vieux parut un peu surpris ; mais il se contenta de répondre :
— Ah bah ?
— Oui. Mon grand-père, fils aîné du duc de Bridgewater, s’est enfui en Amérique à la fin du siècle dernier afin de respirer l’air pur de la liberté. Il s’y est marié et il y est mort, laissant un fils. La même année, son propre père mourut. Le second fils du duc s’empara du titre et des propriétés. Le véritable héritier réclama en vain ses droits. Je suis le descendant légitime de cet héritier. Je suis le vrai duc de Bridgewater, réduit à errer sans escorte sur la terre étrangère, pauvre, méprisé, alors que chacun devrait s’incliner devant lui. Triste, triste, ô triste !
— Voyons, massa, dit Jim, ça ne sert à rien de se désoler.
Le duc comprit à notre mine que nous le plaignions.
— Braves cœurs, reprit-il, vous voudriez me consoler ? Eh bien, vous n’avez qu’à me traiter avec les égards dus à mon rang. Il faut me saluer en m’adressant la parole et m’appeler « Votre Grâce » ou « Votre Seigneurie ». Vous pouvez même m’appeler Bridgewater tout court, car ce nom est à lui seul un titre de noblesse. Quant aux repas, je ne demande pas à faire table à part ; seulement, je vous rappellerai qu’un duc…
— Soyez tranquille, répondis-je. Jim a servi chez des gens civilisés et il vous soignera.
En effet, durant le dîner, le nègre se tint derrière Bridgewater, auquel il passa les meilleurs morceaux. On voyait que ces attentions faisaient grand plaisir au duc ; mais le vieux, tout en s’empiffrant, sembla fort contrarié. Il n’ouvrit guère la bouche que pour manger. Je crus d’abord qu’il était fâché de n’avoir que de l’eau à boire. Son appétit satisfait, il alla se promener à l’écart. Au bout d’une demi-heure, il revint vers nous et dit :
— Bridgewater, vous n’êtes pas le seul qui ayez à vous plaindre de l’injustice des hommes.
— Non ?
— Non. D’autres sont tombés de plus haut.
— De plus haut ? Hélas ! ça me paraît difficile.
— D’autres pourraient attendrir le monde en révélant le secret de leur naissance…
Et le vieux se mit à pleurer à son tour.
— Hein ? Qu’entendez-vous par là ?
— Mon cher duc, continua le vieux en sanglotant, je puis me fier à vous ?
— À la vie, à la mort ! répliqua le duc en serrant la main qu’on lui tendait. Le secret de votre naissance — parlez !
— Eh bien, Bridgewater, je suis feu le Dauphin ! Pour le coup, Jim ouvrit de grands yeux.
— Feu qui ? demanda le duc.
— Mes amis, ce n’est que trop vrai. Vous contemplez l’infortuné Dauphin Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
— Vous ? à votre âge ? Feu Charlemagne, je ne dis pas.
— Le chagrin a tout fait, Bridgewater. Le chagrin a blanchi cette barbe avant l’heure et causé cette calvitie précoce. Vous avez dû beaucoup souffrir ; mais que sont vos souffrances à côté des miennes ? Si vous connaissiez l’histoire du malheureux Dauphin…
— Je la connais, dis-je, et Jim aussi — du moins, je lui ai lu un livre où on parle de vous et qui fait un joli éloge de votre geôlier Simon.
— Simon ? répéta le vieux d’un air étonné… Oui, je lui dois beaucoup à mon brave geôlier.
— Comment ! Ce gueux de savetier qui vous donnait des coups d’étrivières et vous appelait Capet ?

— Oh ! on s’est trompé sur son compte, comme on s’est trompé en croyant à ma mort. Devant le monde, il feignait de me maltraiter ; mais dès que nous étions seuls il se jetait à mes genoux, et… C’est grâce à lui que j’ai pu gagner l’Amérique… Pauvre Simon, on a refusé de reconnaître ton maître et on te calomnie… Bridgewater, convenez que le roi de France a aussi le droit de dire : « Coulez, coulez, mes pleurs ! »
De grosses larmes mouillaient ses joues. Aussi ce bon Jim le plaignait-il encore plus qu’il n’avait plaint le duc. Pour ma part, je me reprochais d’avoir traité de gueux le fidèle Simon, et en même temps j’étais fier de voyager avec un Dauphin. Nous essayâmes donc de le consoler, comme nous avions cherché à consoler l’autre.
— Merci, dit-il. Le duc a raison, vous êtes de braves cœurs. Vous voudriez me voir oublier mes chagrins ? Eh bien, apppelez-moi « Votre Majesté » ou « Votre Altesse », et servez-moi toujours le premier. Je ne vous demande pas de vous tenir tête découverte devant moi, parce que ce serait vous exposer à attraper un coup de soleil ; seulement sachez qu’on ne s’assoit pas en présence du roi sans qu’il vous y ait invité… C’est là un privilège qui n’appartient qu’aux princes et aux ducs, ajouta-t-il en se tournant vers Bridgewater qui semblait sur le point de se rebiffer.
Après avoir ainsi établi ses droits, sa majesté retrouva sa bonne humeur, bien que Jim s’obstinât à l’appeler massa ; mais le duc devint fort grincheux. Cependant le roi lui parla très amicalement ; il déclara qu’il se souvenait que son père estimait beaucoup les Bridgewater et les invitait à dîner deux ou trois fois par semaine. Le duc, toutefois, conservait son air grognon. Enfin, un matin, j’entendis le roi qui lui disait :
— Voyons, Bridgewater, il est probable que nous serons obligés de passer quelque temps sur ce radeau. À quoi bon vous faire de la bile ? Ce n’est pas ma faute si je ne suis pas né duc et ce n’est pas la vôtre si vous n’êtes pas né roi. Il faut prendre les choses comme elles viennent, en attendant mieux. Voilà ma devise. Nous aurions pu tomber plus mal. Les vivres ne manquent pas et nous n’avons qu’à nous croiser les bras. Nous ne gagnerions rien à nous quereller. Allons, votre main, duc, et soyons amis.
À ma grande joie, le duc y consentit ; je dis à ma grande joie, parce que des fois ils se regardaient d’un air si méchant que Jim avait peur de les voir se jeter l’un sur l’autre.
Il ne me fallut pas beaucoup de temps pour deviner que ces deux fourbes se gaussaient de nous, qu’ils n’étaient pas plus duc ou dauphin que Jim. Mais je gardai mon opinion pour moi ; Jim se serait fâché et nous n’aurions peut-être pas été les plus forts. Si je n’ai pas appris grand’chose de mon père, j’ai tout de même appris de lui que le meilleur moyen de se tirer d’affaire avec des gens de cette espèce, c’est d’avoir l’air de les croire jusqu’à ce que l’on trouve l’occasion de leur
brûler la politesse.
Bridgewater se mit bientôt à m’adresser une foule de questions. Pourquoi ne voyagions-nous que la nuit ? Jim était-il un esclave fugitif ?
— Allons donc ! lui dis-je. Un nègre ne serait pas assez bête pour se sauver du côté du sud.
— C’est vrai, répliqua-t-il, et vous ne seriez pas assez bête pour l’aider… à moins qu’il n’y ait une récompense à toucher. Alors pourquoi vous cacher ?
— Ah ! voilà ! Mes parents sont morts de la fièvre dans le Missouri, où ils avaient des dettes. Tout payé, il m’est resté 16 dollars et notre Jim, que je ne voulais pas vendre. On me conseilla d’aller chez mon oncle, qui a une ferme au-dessous de la Nouvelle-Orléans. Une distance de 1 400 milles avec 16 dollars en poche ! Cela ne nous aurait pas menés loin à bord d’un steamer. Par bonheur la chance s’en est mêlée. Dans la dernière crue, j’ai mis le grappin sur ce radeau. Seulement nous rencontrions des gens qui refusaient de croire que Jim est à moi. Il y a plus de danger peut-être à voyager la nuit ; mais au moins on ne nous tracasse pas.
— Je comprends, dit le duc. Une centaine ou deux de dollars à empocher, cela tente toujours. Laissez-moi faire. Je trouverai un moyen qui nous permettra de naviguer sans craindre les curieux. Pour le moment, inutile de se creuser la cervelle. Il serait malsain de nous montrer aujourd’hui dans le voisinage de cette ville.
L’après-midi était déjà avancé lorsque les feuilles commencèrent à frissonner et des éclairs de chaleur partirent de tous les côtés. On n’avait pas de peine à deviner que le temps ne tarderait pas à se gâter. Le duc et le roi allèrent inspecter le wigwam pour voir à quoi nos lits ressemblaient. Le mien se composait d’un matelas acheté à mon intention par Jim, qui se contentait d’un tas de paille. On ne dort jamais très bien sur la paille — elle vous pique et vous réveille, avec son froufrou de feuilles mortes, quand on se retourne. Le duc déclara qu’il prendrait le matelas. Le roi n’entendait pas de cette oreille-là.

— Il me semble, dit-il d’un ton grincheux, que la différence des rangs aurait dû vous suggérer que le choix m’appartient. Un tas de paille n’est pas un lit convenable pour moi. Votre Grâce voudra bien me laisser le matelas.
Je craignis un instant une nouvelle dispute ; aussi fus-je enchanté lorsque le duc répondit sans se fâcher :
— Hélas ! les deux lits se valent. Pourvu que je sois à l’abri, je n’en demande pas davantage.
Nous attendîmes, pour partir, le coucher du soleil. Le roi et le duc s’étaient glissés dans le wigwam, après m’avoir recommandé de n’allumer notre lanterne que quand le radeau se trouverait assez loin de la ville.
Ce ne fut que vers dix heures que l’orage éclata. Non, je n’ai jamais entendu le vent hurler de la sorte ; à chaque minute partait un éclair qui embrasait tout le ciel et montrait les crêtes blanches des vagues à un demi-mille de distance. À travers la pluie on voyait la côte comme à travers un nuage de poussière. Les arbres semblaient se tordre sous l’effort de la rafale ; puis venait un h-wack — broum, broum, boum… oum, qui s’éloignait en grondant, suivi d’un autre éclair et d’un autre coup de tonnerre. Lors même que le wigwam eût été vide, je n’aurais pas songé à me coucher. On ne voit pas tous les jours un orage comme celui-là.
Plus d’une fois les vagues faillirent m’enlever. Peu m’importait. Je ne serais guère remonté à bord plus mouillé que je ne l’étais déjà.
Peu à peu l’orage se calma. Jim pouvait se passer de moi maintenant, et je me dirigeai vers le wigwam ; mais pour y entrer il aurait fallu marcher sur les jambes du roi ou sur celles du duc. Je m’allongeai donc en plein air. Il ne pleuvait presque plus et je me moquais de la pluie, parce qu’elle n’était pas froide. Jim finit par me réveiller ; je pris sa place et il ne tarda pas à ronfler.
Au point du jour, je le réveillai à son tour et, selon notre coutume, nous remisâmes le radeau dans une bonne cachette.
Nos voyageurs avaient-ils bien dormi ? Je n’en sais rien. En tout cas, ils ne nous remercièrent seulement pas d’avoir veillé pour eux.
Après déjeuner, le roi tira de sa poche un paquet de cartes et proposa au duc une partie de seven-up, à 5 cents la partie, pour passer le temps. Ils en eurent bientôt assez.
— Bah ! dit le duc en riant, nous jouerions jusqu’à demain sans nous faire de mal — nous sommes de même force, et au besoin cela nous servira peut-être. En attendant, arrangeons un plan de campagne. J’ai plus d’une corde à mon arc.
Là-dessus il fouilla dans son sac de voyage, où il prit plusieurs liasses de prospectus imprimés qu’il lut à haute voix. Un de ces imprimés disait : « Le célèbre phrénologue, le docteur Armand de Montalban, de Paris, donnera demain une conférence sur l’art de reconnaître le caractère des gens à la conformation de leur crâne. Il fournira à ceux qui lui en feront la demande un diplôme signé où seront énumérés leurs défauts et leurs qualités. Prix d’entrée, 10 cents. Prix du diplôme, 25 cents. »
Un second prospectus annonçait l’arrivée de l’incomparable tragédien Garrick jeune, des théâtres royaux de Londres et de Paris. Dans d’autres il changeait de nom et promettait des choses merveilleuses. Il se vantait, par exemple, de posséder la fameuse baguette magique à l’aide de laquelle on découvre les sources d’eau ou les trésors cachés.
— Tout cela m’a souvent réussi, dit-il en serrant ses papiers. Il ne s’agit que de sonder le terrain. J’avoue cependant que j’ai un faible pour le théâtre. Êtes-vous jamais monté sur les planches, Royauté ?
— Non, jamais.
— Eh bien, d’ici à peu, vous chausserez le cothurne, grandeur déchue. À la première occasion, nous louerons une salle où nous représenterons le combat de Richard III et la scène du balcon dans Roméo et Juliette. Que pensez-vous de mon idée ?
— Pour tout ce qui promet de rapporter quelques dollars, je suis votre homme, Bridgewater. Croyez-vous pouvoir m’apprendre à jouer la comédie ?
— Avez-vous une bonne mémoire ?
— Oui.
— Bon, je me charge du reste. Commençons tout de suite, cela nous aidera à tuer le temps.
Alors il raconta l’histoire de Roméo et Juliette. Il termina en disant qu’il avait l’habitude de remplir le rôle de Roméo et que le roi remplirait celui de Juliette.
— Mais Juliette est une jeune fille, répliqua le roi.
— Ne vous inquiétez pas. Grâce au costume, on ne verra pas votre tête chauve. D’ailleurs la scène sera faiblement éclairée. Juliette est perchée sur son balcon, où elle vient soupirer au clair de la lune avant de se coucher. Elle a déjà mis son peignoir et son bonnet de nuit. Je vais vous montrer sa toilette.

Il prit dans sa valise plusieurs vêtements de toile peinte qu’il dit être les armures moyen âge de Richard III et de Gloster, un long peignoir de coton blanc et une coiffe de la même étoffe garnie de ruches. Comme le roi ne paraissait qu’à moitié satisfait, le duc lui expliqua que l’on doit tenir compte de l’illusion scénique. Il ouvrit ensuite un livre où il lut les rôles en levant tour à tour chaque bras, en roulant les yeux et en piaffant.
— Cela suffit pour la première leçon, dit-il enfin ; nous répéterons quand vous saurez votre rôle par cœur.
Il y avait une petite ville à 3 milles environ de l’endroit où nous nous étions arrêtés. Après dîner, le duc annonça qu’il avait trouvé le moyen de voyager en plein jour sans danger pour Jim et qu’il désirait se rendre à la ville afin de réaliser son projet. Le roi offrit de l’accompagner. Naturellement, ils comptaient sur moi pour manier les rames, et le canot fut vite lancé.
Dans la ville, personne ne bougeait. Les rues restaient presque désertes, comme un dimanche. Nous rencontrâmes enfin, se chauffant au soleil dans une cour, un nègre malade. Tout le monde, sauf les infirmes, était parti pour une prédication en plein air qui se tenait dans un bois, à 2 milles environ de la ville. Le roi se renseigna sur le chemin à suivre ; il déclara qu’il avait rarement assisté sans profit à un camp-meeting et qu’il assisterait à celui-là.
Quant au duc, il cherchait une imprimerie. Nous ne tardâmes pas à découvrir un atelier établi au-dessus d’une boutique de menuisier. Typographes et menuisiers avaient disparu, laissant les clefs aux portes. L’atelier était en même temps un bureau de journal, et je ne me rappelle pas avoir vu un endroit aussi sale. On y marchait sur une litière de paperasses et de poussière — des murs barbouillés de taches d’encre ou couverts d’affiches maculées dont quelques-unes donnaient le portrait d’un cheval volé ou d’un nègre fugitif. Bridgewater, après avoir fureté partout, ôta son habit.
— Là, dit-il, je me sens chez moi ; j’ai ce qu’il me faut pour composer une petite affiche dans l’intérêt de Jim et de l’équipe du radeau. Je n’ai pas besoin de vous.
Moi et le roi nous nous mîmes donc en route pour le camp-meeting. Nous y arrivâmes au bout d’une demi-heure, tout en nage, car il faisait joliment chaud. Le bois était rempli de chevaux et de charrettes. La prédication en plein vent avait attiré au moins un millier de personnes. Les chevaux frappaient du pied pour chasser les mouches et mangeaient dans les augets fixés derrière les voitures. Çà et là, sous des hangars construits à l’aide de perches et de branches d’arbres, on vendait de la limonade, du pain d’épice, des melons d’eau et d’autres provisions.
Les missionnaires se tenaient sous des hangars du même genre, mais plus grands. Deux ou trois rangées de bancs (des troncs d’arbres à peu près équarris où l’on avait percé des trous pour enfoncer les bâtons qui servaient de pieds) se trouvaient au fond du hangar, en face de la plate-forme réservée aux prédicateurs.
Les femmes, assez pauvrement mises du reste, étaient coiffées de robinsons qui les garantissaient contre les coups de soleil. Les vieilles tricotaient, les jeunes ne se gênaient guère pour rire. Bon nombre de jeunes gens étaient nu-pieds et quelques-uns des enfants ne portaient qu’une chemise de grosse toile.
Sous le premier berceau que nous rencontrâmes, celui qui occupait la plate-forme lisait un cantique. Il entonnait deux vers, puis les auditeurs les chantaient en chœur.
Ensuite le missionnaire commença à prêcher. Il se promenait le long de l’estrade, s’arrêtant parfois pour se pencher en avant ; tantôt il levait au-dessus de sa tête la Bible qu’il avait à la main, tantôt il la tenait à bras tendu, comme pour nous l’offrir, en criant de toute la force de ses poumons :
— Contemplez ce livre et vivez ! Abreuvez-vous à la source de la vérité. Frappez, et la porte vous sera ouverte. Venez, pécheurs endurcis ! Venez, âmes contristées et brisées ! Venez vous asseoir sur le banc du repentir…
Et ainsi de suite. On n’entendait presque plus ce qu’il disait, à cause des sanglots, des amens et des alleluias qui partaient de tous les côtés. Des gens se levaient, les yeux pleins de larmes et gagnaient, à travers la foule, les bancs placés près de l’estrade.
Eh bien, le roi s’était d’abord tenu si tranquille que je ne faisais pas attention à lui. Jugez de ma surprise lorsque je le vis arriver, tout essoufflé, au pied de l’estrade, où le prédicateur le fit bientôt monter. Il y eut entre eux une sorte de discussion qui ne dura pas longtemps.
— Non, non, s’écria le nouveau venu ; je conviens avec vous que l’on ne doit pas cacher sa lumière sous le boisseau ; mais je ne suis pas habitué à parler en public.
Le calme s’était rétabli peu à peu, car il n’en avait pas fallu davantage pour exciter une vive curiosité.
— Si, si, parlez !
Alors le roi ne se fit plus prier. Il se campa au milieu de la plateforme. Il raconta que, pendant trente ans, il avait exercé le métier de pirate dans l’océan Indien et commis ou fait commettre des atrocités dont il se repentait maintenant. Au printemps dernier, plus d’une moitié de son équipage avait péri dans un combat, et il était revenu aux États-Unis pour trouver des recrues. Grâce au ciel, la veille même, il avait été dépouillé de tout ce qu’il possédait et les voleurs l’avaient jeté sur la côte sans un cent. Oui, grâce au ciel ! grâce au hasard providentiel qui avait dirigé ses pas, car il avait de son côté dépouillé le vieil homme et il se sentait heureux pour la première fois de sa vie. Si pauvre qu’il fût, il était décidé à se remettre en route, à regagner l’océan Indien et à racheter son passé en s’efforçant de ramener les pirates dans la voie du salut. Ah ! il ne connaissait que trop bien ces flibustiers, et si quelqu’un pouvait les convertir, c’était lui. Certes, sans argent, il lui faudrait beaucoup de temps pour les rejoindre ; mais sa résolution était prise. Chaque fois qu’il aurait la joie de convertir un pirate, il lui dirait : « Ne me remerciez pas — tout le mérite revient à ces braves gens du camp-meeting de Pokeville et à l’éloquent prédicateur dont la parole… »
Il fondit en larmes et s’arrêta. Alors quelqu’un cria : « Faisons une quête pour lui ! » et aussitôt une demi-douzaine d’individus se mirent en avant. Mais un autre dit : « Non, qu’il passe le chapeau lui-même. »
Le roi traversa donc la foule, son chapeau à la main, en s’essuyant les yeux et en remerciant les gens qui se montraient si bons pour les pauvres pirates. On l’engagea à passer au moins une semaine à Pokeville. Tout le monde voulait l’avoir. Mais il dit qu’il avait hâte de regagner l’océan Indien afin de se mettre à l’œuvre.
Quand nous remontâmes à bord du radeau, il s’empressa de compter le produit de sa collecte et reconnut qu’il avait empoché 87 dollars et 75 cents. En outre il rapportait une cruche pleine de whisky, qu’il avait trouvée sous une voiture en traversant le bois.

Le duc, qui s’était flatté d’avoir fait une bonne journée, avoua que le roi lui damait le pion. Il avait composé, à la demande d’un fermier dont on venait de voler les chevaux, deux petites affiches — bénéfice net, 4 dollars. Il avait reçu 4 dollars d’annonces à insérer dans le journal, en réduisant le prix de moitié, à la condition qu’il le toucherait d’avance. L’abonnement coûtait 2 dollars par an ; mais il avait donné quittance, contre un demi-dollar en espèces, à trois abonnés qui offraient, selon leur habitude, de payer en bois de chauffage ou en légumes. Il venait d’acheter le journal, leur dit-il, et renonçait à l’ancien système.
Enfin il nous montra une autre feuille volante dont il avait tiré gratis un seul exemplaire, à notre intention. On y voyait, comme en-tête, l’image d’un nègre qui se sauvait à toutes jambes, portant sur l’épaule un paquet attaché à un bâton. Sous l’image on lisait en grosses lettres : 200 dollars de récompense. Quant au texte, il concernait Jim, dont il donnait un portrait bien plus ressemblant que le vieux cliché trouvé dans l’imprimerie. À la suite du signalement on lisait : « Ledit Jim s’est évadé de la plantation de Saint-Jacques, à 40 milles au-dessous de la Nouvelle-Orléans. Quiconque le ramènera recevra la récompense promise. »
— Là, dit le duc, l’affaire est dans le sac. Les curieux peuvent venir ; nous les verrons arriver de loin et ils trouveront Jim couché pieds et poings liés dans le wigwam. Nous montrerons cet avis et nous dirons que nous avons attrapé le fugitif au bord du fleuve. Comme nous ne sommes pas riches, nous avons acheté ce bout de radeau pour aller toucher la récompense. Des menottes feraient bon effet, mais elles contrediraient l’histoire de notre pauvreté. Les chaînes ressembleraient trop à de la bijouterie, il faut nous contenter de cordes.
Le roi adressa des compliments au duc et je fus obligé de convenir que nous n’aurions plus besoin de nous arrêter à cause de Jim. Toutefois ce jour-là on jugea prudent de ne pas se montrer en plein jour, parce que l’affaire de l’imprimerie ne manquerait pas de causer un beau tapage.
Nous nous tînmes cois jusqu’à la tombée de la nuit ; alors nous filâmes et la lanterne ne fut hissée qu’à une bonne distance de la ville. Le lendemain matin, lorsque Jim me réveilla vers quatre heures, il me demanda :
— Massa Huck, pensez-vous que nous tomberons sur beaucoup de rois pendant ce voyage ?
— Non, je ne crois pas, Jim.
— Tant mieux, un passe encore ; mais c’est assez. Celui-là est
presque ivre mort, et le duc ne vaut guère mieux.
Le soleil était levé et nous ne songions plus à nous cacher. Le roi et le duc vinrent nous rejoindre. Ils avaient l’air assez engourdis, mais un bain les tira de leur torpeur. Après déjeuner, le roi ôta ses bottes, releva son pantalon et s’assit au bord du radeau afin d’apprendre par cœur son Roméo et Juliette. Ce fut vite fait. Ensuite le duc, après lui avoir montré vingt fois comment il devait dire chaque phrase, en lui indiquant les endroits où il fallait soupirer ou poser la main sur son cœur, se déclara satisfait.
— Rappelez-vous, dit-il, que Juliette est une jeune fille douce et langoureuse ; elle ne doit pas mugir comme un taureau, ou braire comme un âne ; elle doit roucouler le nom de Ro…o…méo d’une voix de tourterelle.
Le même jour, ils s’armèrent de deux épées, que le duc avait fabriquées avec des lattes, et répétèrent la scène du combat, qui me parut bien plus amusante que celle du balcon. Le duc s’appelait Richard III, et le roi Richmond. Ils n’y allaient pas de main morte ; la façon dont ils s’escrimaient et s’injuriaient vous coupait la respiration. Sa Majesté finit par faire un pas de trop en arrière et tomba dans l’eau ; puis ils se reposèrent en causant de leurs aventures dans ces parages.
— Capet, dit le duc après dîner, nous donnerons une représentation de premier ordre dès qu’une bonne occasion s’offrira. Seulement, il me semble nécessaire d’allonger un peu la sauce. Vous réciterez le fameux monologue d’Hamlet…
— Le fameux quoi ?
— Comment, le fameux quoi ? Shakespeare n’a rien écrit de plus sublime. Un acteur est sûr d’être applaudi à tout rompre dans ce morceau-là, pourvu qu’il sache lever les yeux au ciel, froncer les sourcils, porter la main à son front, se croiser les bras, grincer des dents et prendre des airs de saule pleureur au moment convenable. Quant au costume, on le trouve partout. Il n’y a qu’à emprunter un manteau de deuil et un panache noir à l’entrepreneur des pompes funèbres.
— J’aime mieux ce costume de croque-mort que celui de Juliette.
— Eh bien, apprenez le discours par cœur. Vous vous en tirerez à merveille.

On ne s’ennuyait pas sur le radeau. Ce n’étaient que combats et répétitions. On s’arrêtait parfois pour acheter des provisions dans les petites villes que nous apercevions le long de la côte. J’emmenai le duc dans le canot ; mais il revenait en s’écriant : « Rien à faire ! » Cependant il ne s’était pas dérangé en pure perte, il avait fait imprimer son programme afin d’être prêt à tout événement.
Enfin la chance le favorisa. Nous arrivâmes, au bout de deux ou trois jours, en face d’un bourg assez peuplé. Le radeau fut amarré un demi-mille plus loin, dans une crique que les cyprès transformaient en une sorte de tunnel, et, sauf Jim, nous montâmes tous à bord du canot.
Un cirque ambulant devait donner une représentation dans l’après-midi et repartir le soir même. Or, les cirques attirent toujours beaucoup de monde, de sorte que nous tombions bien. Le duc loua la salle des réunions publiques et nous allâmes coller notre affiche dont voici la copie :
GRANDE ATTRACTION !!
POUR UN SOIR SEULEMENT !!
L’ILLUSTRE TRAGÉDIEN
DAVID GARRICK JEUNE
Du théâtre royal de Drury-Lane (Londres)
ET
EDMOND KEAN L’AÎNÉ
Du théâtre royal de Haymarket
ET DE TOUS LES THÉÂTRES IMPÉRIAUX DU CONTINENT
PARAÎTRONT DANS LEUR SUBLIME
SPECTACLE SHAKESPEARIEN INTITULÉ
LA SCÈNE DU BALCON
DE
ROMÉO ET JULIETTE
Roméo............................. M. GARRICK.
Juliette............................ M. KEAN.
Nouveaux décors, nouveaux costumes, nouveaux accessoires.
SUIVIE
DE L’ÉMOUVANT ET TRAGIQUE COMBAT
DE RICHARD III
Richard III............................. M. GARRICK.
Richemond............................. M. KEAN.
LE SPECTACLE
(À la demande générale)
SE TERMINERA PAR l’IMMORTEL MONOLOGUE DE
HAMLET !!!
OÙ L’ILLUSTRE KEAN
S’EST FAIT APPLAUDIR PENDANT 300 NUITS CONSÉCUTIVES
À PARIS
D’impérieux engagements européens rendent impossible une seconde représentation.
Les affiches posées, nous nous mîmes à flâner à travers la ville. Presque toutes les maisons étaient entourées de petits jardins où il ne poussait que de mauvaises herbes, des tessons de bouteille, des souliers éculés, des chiffons et des boîtes de fer-blanc défoncées. Les clôtures formées de planches disparates, les unes couvertes de mousse, les autres fraîchement rabotées, se penchaient en avant ou en arrière. Plusieurs de ces clôtures semblaient avoir été blanchies à la chaux à une époque quelconque — du temps de Christophe Colomb, disait le duc. Dans la plupart des jardins on voyait des porcs et des gens qui cherchaient à les chasser.

Les boutiques s’ouvraient sur la grande rue, avec des auvents soutenus par des poteaux auxquels les visiteurs attachaient leurs chevaux.
Le long des murs, des caisses d’emballage, des tonneaux vides où un tas de lambins se tenaient perchés, fumant, bâillant, déchiquetant leur siège avec un couteau de poche. Ils portaient tous des chapeaux de paille aussi larges qu’un parapluie ; mais les habits et les gilets étaient rares.
Dans toutes les rues on enfonçait dans une boue noire qui nulle part n’avait moins de deux ou trois pouces de profondeur. De temps en temps une truie arrivait avec sa famille ; elle se vautrait au beau milieu de la chaussée, fermait les yeux, agitait les oreilles, se laissait traire, et avait l’air aussi heureux que si le gouvernement la payait pour ça. Tout à coup quelqu’un se mettait à crier : « Chou-là, chou-là, Turc ! » et la truie détalait en grognant avec ses petits et avec un chien ou deux à chaque oreille. Alors les badauds se levaient et restaient debout jusqu’à ce qu’elle eût disparu ; mais, pour les réveiller complètement, il aurait fallu un combat de chiens.
Plus l’heure s’avançait, plus il arrivait de monde. Lorsqu’on commença à se diriger du côté du cirque, dressé sur la grande place, je fis comme les autres. Je profitai du moment où celui qui montait la garde venait de s’éloigner pour me glisser sous la toile. J’avais toujours ma pièce d’or de 20 dollars et quelque menue monnaie ; mais à quoi bon gaspiller son argent sans nécessité, surtout lorsqu’on ne sait pas ce qu’on recevra en échange ?
Eh bien, vrai, je n’aurais pas regretté le prix de ma place quand je vis entrer les écuyers et les écuyères qui arrivaient deux à deux, un monsieur à côté d’une dame. Il y en avait au moins vingt. Les dames étaient très belles, avec un teint plus rose et plus blanc que celui d’un enfant qu’on vient de débarbouiller. Leurs costumes devaient avoir coûté des millions de dollars, car ils paraissaient couverts de diamants. Ceux des hommes valaient beaucoup moins, je crois ; mais ils avaient l’air si fier que personne n’aurait osé le leur demander. C’était magnifique.
Après avoir fait une ou deux fois le tour de la piste, les voilà qui se lèvent et se tiennent debout sur leurs selles. Le maître du cirque — un monsieur très raide — tournait autour du poteau qui soutenait le milieu de la tente en faisant claquer sa chambrière et en criant houp ! houp ! Le clown marchait sur ses talons et imitait ses gestes. Bientôt les brides furent lâchées ; les dames se posèrent les poings sur les hanches ; les messieurs se croisèrent les bras et les chevaux partirent à fond de train. Enfin la musique endiablée cessa et le galop s’arrêta brusquement. Hommes et femmes sautèrent l’un après l’autre dans l’arène, firent les plus jolis saluts qu’il soit possible de voir et disparurent au pas de course au milieu des bravos.
Et ce n’était que le commencement. Mais vous m’accuseriez de mentir si je vous racontais tous les merveilleux tours de force que ces gens-là accomplirent quand ils revinrent un à un dans des costumes différents. Le clown, qui essayait de les imiter, finissait presque toujours par tomber à plat ventre, le nez dans la sciure de bois. Cela n’empêchait pas les imbéciles de l’applaudir tout comme s’il avait réussi. Par exemple, il avait la langue bien pendue. Le maître du cirque ne pouvait pas lui dire un mot sans s’attirer une riposte des plus drôles. Je ne sais pas où le clown allait chercher ces réponses-là ; il m’aurait fallu au moins un an pour en trouver la moitié. À un moment, un gros lourdaud, que ses voisins s’efforçaient de retenir, enjamba la balustrade et sauta, ou plutôt roula dans l’arène, en déclarant qu’il voulait monter à cheval. On voyait bien qu’il était ivre, car il trébuchait à chaque pas. Les gens du cirque essayèrent en vain de raisonner avec lui et de le ramener à sa place. Il n’écoutait personne, de sorte que la représentation fut interrompue. Les spectateurs commençaient à se fâcher, quand le maître du cirque intervint.
— Messieurs, pas de tapage, je vous en prie, dit-il. Puisque cet homme veut absolument nous amuser, laissons-le faire. Je crois qu’il en aura bientôt assez, quoique le cheval qu’on vient d’amener ne soit pas trop méchant.
Tout le monde battit des mains. On aida donc le gros paysan à monter en selle. Dès qu’il y fut, le cheval, qui n’était pas habitué à se sentir deux bras autour du cou, se mit à lancer des ruades et à se cabrer. Le clown, qui tenait la bride, dut la lâcher. Alors le cheval partit au grand galop, avec cet individu couché sur son dos et menaçant à chaque minute de tomber à droite ou à gauche, la tête en avant. On avait beau rire, ça ne me paraissait pas drôle, à cause du danger. Au bout du premier tour, il réussit à saisir la bride et à se mettre à califourchon, chancelant tantôt d’un côté, tantôt de l’autre. Tout à coup il lâcha la bride, sauta d’un bond sur la selle et s’y tint debout, aussi à l’aise que s’il n’avait jamais été ivre, bien que son cheval allât bon train, je vous le garantis. Puis il commença à ôter ses habits et à les lancer au milieu du cirque. Les vestes, les pantalons, les cravates, les perruques pleuvaient ; il y en avait de toutes les couleurs et on ne voyait presque plus clair. Il se déshabilla si vite que l’on eut à peine le temps d’admirer ses dix-huit déguisements. Enfin il resta dans son vrai costume, un superbe costume collant qui resplendissait de paillettes d’or ou d’argent. Il ne ressemblait plus au lourdaud qu’on avait voulu mettre à la porte. Il cingla son cheval avec sa cravache, fit encore une fois le tour de la piste, sauta à terre, salua, et courut en sautillant du côté de l’écurie, tandis qu’on poussait des cris de surprise.
L’individu qu’on avait pris pour un ivrogne était tout bonnement le meilleur écuyer de la troupe, qui avait imaginé cette frime sans prévenir personne. Le directeur paraissait furieux, et je n’aurais pas voulu être dans la peau de celui qui venait de lui jouer ce tour — non, pas pour 1 000 dollars. Mes voisins soutenaient que la chose avait été arrangée d’avance et qu’il savait à quoi s’en tenir ; mais je n’en crois rien. En tout cas, ce cirque-là aura ma pratique chaque fois que je le rencontrerai.
Notre représentation à nous n’obtint pas le même succès, tant s’en faut. Elle n’attira qu’une trentaine de spectateurs. Ils pouffèrent de rire tout le temps et n’attendirent pas la fin du spectacle. Leur bonne humeur semblait avoir exaspéré le duc.
— Pas l’ombre d’un applaudissement ! s’écria-t-il. Bah ! avec ces gens-là, Garrick et Kean eux-mêmes auraient raté les plus beaux effets. Ils sont incapables d’apprécier Shakespeare. Il leur faut des farces de bateleur et je leur en servirai une.
Le lendemain matin, il se procura quelques feuilles de papier d’emballage, une bouteille d’encre, un pinceau et composa ce nouveau programme, dont plusieurs exemplaires furent vite collés sur les murs de la ville :
───
TROIS REPRÉSENTATIONS SEULEMENT !
LE CÉLÈBRE TRAGEDIEN
EDMOND KEAN L’AÎNÉ
DE TOUS LES THÉÂTRES ROYAUX DU CONTINENT
JOUERA SEUL
Sous la direction du fameux
DAVID GARRICK JEUNE
L’INIMITABLE INTERMÈDE DU
CAMÉLÉOPARD
OU
L’HOMME À QUATRE PATTES !!!
Puis au bas de l’affiche, en très grosses lettres, on lisait :
— Là, dit le duc, si cette dernière ligne ne les amène pas, c’est que je ne connais pas les gens de l’Arkansas.
On avait déjà presque entièrement démoli notre estrade. Nous passâmes une bonne partie de la journée à la remonter, à disposer un rideau et à couper des chandelles pour éclairer la rampe. Ce soir-là, la salle fut remplie en un clin d’œil. Quand il n’y eut plus de place, le duc, qui avait veillé lui-même à l’entrée de la salle, fila par une porte de derrière, monta sur les tréteaux et passa devant le rideau. Après avoir distribué trois beaux saluts, à droite, à gauche, au milieu, il prononça un petit discours. L’intermède auquel on allait assister était le spectacle le plus merveilleux que l’on eût jamais vu. Le célèbre Edmond Kean s’y montrait sous un jour nouveau. Sans l’aide des journalistes — car il dédaignait les éloges payés — il y avait obtenu des succès qui dépassaient toutes ses espérances, etc., etc. Enfin, comme le public s’impatientait, le duc se glissa derrière la toile, qui ne tarda pas à se lever.

Alors le roi arriva à quatre pattes en imitant un cheval qui se cabre. En fait de costume, il ne portait qu’un bout de caleçon ; mais sa peau, tatouée et rayée, brillait de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Il n’y a pas à dire, c’était très drôle. On crevait de rire. Quand il fut fatigué de caracoler, de grimacer, d’aboyer, de miauler, il tourna le dos et disparut en sautillant dans la coulisse. On le rappela, il dut recommencer jusqu’à trois fois et on n’en avait pas encore assez.
À la fin, le duc fit baisser le rideau et s’avança en posant la main sur son cœur. Il annonça qu’à son vif regret la tragédie du Caméléopard ne serait jouée que deux fois encore, parce qu’un engagement le rappelait à Londres, où toutes les places étaient retenues d’avance au Théâtre royal de Drury-Lane. Puis il salua et ajouta que, flatté d’avoir réussi à charmer un public aussi intelligent, il espérait que ces messieurs engageraient leurs amis à assister aux deux dernières représentations.
— Comment, c’est déjà fini ? s’écria-t-on.
— Oui, messieurs, répondit le duc. L’affiche ne promet qu’un intermède, et, vous ne devez pas l’ignorer, un intermède ne dure jamais longtemps.
Alors il y eut un beau vacarme.
— C’est une attrape ! On nous a mis dedans !
Tout le monde s’était levé ; on allait escalader la scène et empoigner ces tragédiens lorsqu’un grand monsieur, très bien habillé, sauta sur un banc et cria :
— Un moment, messieurs. Je n’ai qu’un mot à dire. On s’arrêta pour l’écouter et il reprit :
— Nous sommes atrocement floués, j’en conviens ; mais vous ne tenez pas à devenir la risée de nos concitoyens, je pense ? Si la chose s’ébruite trop tôt, nous n’en entendrons jamais la fin, tant que nous vivrons. Donc, ce qu’il y a de mieux à faire, c’est de sortir d’ici tranquillement et de porter le spectacle aux nues. De cette façon le reste de la ville se laissera mettre dedans et n’aura pas le droit de se moquer de nous.
— Oui, oui, cria-t-on. Le juge a raison.
— Eh bien, c’est convenu. Pas de tapage — pas un mot qui puisse donner l’éveil. Rentrez chez vous et conseillez à ceux qui n’ont pas donné dans le panneau de venir voir cet intermède.
Le jour suivant toute la ville parlait de ce curieux spectacle, si bien que le soir la salle fut encore comble. Le public vit que le juge et les autres s’étaient moqués de lui ; mais il ne se fâcha pas trop. Cela ne parut pas étonner le duc.
Nous avions apporté un tas de provisions à bord, et quand nous eûmes soupé, le duc dit à Jim de démarrer. On s’arrêta à 2 milles environ au-dessous de la ville et on établit le radeau dans un endroit où il aurait fallu de bons yeux pour le découvrir.
La troisième représentation attira encore plus de monde que les deux premières. Cette fois, ce n’étaient pas des nouveaux venus. Je remarquai que chaque spectateur arrivait les poches gonflées ou chargé d’un paquet bien enveloppé qu’il cherchait à cacher. Je devinai vite que ces paquets ne sortaient pas d’une boutique de parfumeur. Ils sentaient les œufs malades et les légumes pourris. Si je sais distinguer un chat mort à son odeur — et je m’y connais — j’en comptai soixante-quatre qui passèrent sans payer leur place. Je me faufilai un instant dans la salle ; mais je n’y restai pas longtemps. Je rejoignis le duc qui touchait lui-même le prix d’entrée.
— On étouffe, il n’y a plus de place, lui dis-je.
— Arrivez donc, me cria-t-il de façon à être entendu. Le spectacle commence dans dix minutes, et on a besoin de vous là-haut.
Je le suivis ; seulement je n’avais pas la moindre envie de monter sur la scène — je n’aime pas les œufs pourris. Il s’éloigna sans se presser ; mais il ne m’invita pas à monter. Dès qu’il eut tourné le coin, il allongea le pas et me dit :
— Maintenant, il s’agit de courir comme si le diable était à nos trousses. Au radeau !
Nous sautâmes à bord en même temps, aussi essoufflés l’un que l’autre, et deux secondes plus tard nous filions au milieu du fleuve, sans lanterne et sans avoir échangé une parole avec Jim qui se tenait prêt à partir. Je pensais au pauvre vieux roi, et je me demandais comment il parviendrait à se tirer d’embarras. J’aurais pu me dispenser de le plaindre, car il ne tarda pas à se glisser hors du wigwam.
— Eh bien, duc, demanda-t-il, avons-nous fait une bonne recette ?
Il n’avait pas mis le pied dans la ville ce jour-là !
Nous n’allumâmes notre lanterne qu’à deux ou trois milles plus loin. Durant le souper, les tragédiens se montrèrent très gais.
— Les imbéciles ! dit le duc. Je savais bien que notre premier public ne se vanterait pas d’avoir donné dans le panneau et qu’il nous enverrait les autres gobe-mouches de la ville. Je savais aussi qu’ils voudraient tous prendre leur revanche à la troisième représentation. En effet, c’était leur tour, et j’espère qu’ils ont profité de l’occasion pour se régaler. Les provisions ne leur manquaient pas. Les trois séances
avaient rapporté 465 dollars à ces deux fourbes, et on rirait à moins.
Le jour commençait à baisser lorsque nous amarrâmes notre radeau au bord d’une île située presque au milieu du fleuve. De chaque côté on voyait une petite ville où Bridgewater pensa qu’il y avait peut-être quelque chose à tenter. Sa première idée fut de donner de nouvelles représentations du Caméléopard ; mais le roi déclara qu’il ne serait pas prudent de recommencer trop tôt.
— Avez-vous un meilleur projet en tête ? demanda le duc.
— À quoi bon former un projet sans avoir sondé le terrain ? Pour le moment, il s’agit de souper et de dormir. Demain, j’irai jeter un coup d’œil là-bas et nous verrons si cela vaut la peine de nous arrêter.
J’ai oublié de dire qu’ils s’étaient habillés à neuf aux dépens des spectateurs dont ils avaient empoché l’argent. Je ne me serais jamais figuré à quel point les habits changent un homme. Vous les auriez pris pour de vrais gentlemen. Le roi surtout paraissait si respectable, si bon, si doux, que personne ne l’aurait soupçonné d’avoir rempli le rôle d’un caméléopard. Son costume noir lui donnait l’air d’un clergyman ; mais je ne m’y fiais pas et j’avais encore plus peur de lui que du duc.
Le lendemain, le roi, après avoir déjeuné d’un aussi bon appétit que s’il n’avait pas soupé comme un ogre, m’ordonna de préparer le canot, puis continua à causer avec son ami ; quand je revins, j’entendis la fin de leur conversation.
— C’est entendu, Bridgewater ; si je ne lève pas un lièvre, vous vous mettrez en chasse du côté de l’Arkansas.
— Pourquoi choisissez-vous la rive la plus éloignée ?
— Vous voyez ce vapeur à l’ancre, qui prend du fret un peu au-dessus de la ville que je veux explorer ? Je monterai à bord et on croira, en me voyant descendre, que j’arrive de Saint-Louis, de Cincinnati, ou d’une autre grande cité. Cela inspirera plus de confiance… Tout est prêt, Huck ? En route et nage vers le steamer.

Il n’eut pas besoin de me le dire deux fois. Quelle chance ! une promenade à bord d’un steamer ! Je me rapprochai de la rive, puis je filai le long de la côte, où le courant n’était pas fort. Bientôt nous aperçûmes, assis au bord de l’eau, entre deux valises, un jeune homme qui n’avait pas l’air d’avoir inventé la poudre et qui nous regardait en s’épongeant le front.
— Aborde là, Huck, me dit le roi, qui ajouta, en s’adressant au jeune homme : Pouvez-vous m’apprendre le nom de cette ville que nous venons de dépasser ?
— Parbleu, puisque j’y suis né. C’est Nantuck.
— Et où allez-vous, mon ami ?
— Au steamer, monsieur, et je voudrais déjà y être, car je suis si fatigué que j’ai dû m’arrêter pour me reposer.
— Je m’en doutais. Montez dans le canot alors. Là, ne vous occupez pas de vos valises, mon domestique s’en chargera… Adolphe, sautez à terre et aidez ce gentleman.
Adolphe, c’était moi, je le vis bien, et je sautai à terre. Quelques minutes après, nous nous remettions tous les trois en route. Le jeune homme se montra très reconnaissant de la corvée qu’on lui évitait.
— Quand je vous ai vu, dit-il au roi, après nous avoir remerciés, j’ai d’abord pensé : « C’est peut-être M. Wilks, et je suis fâché qu’il arrive trop tard. » J’ai vite reconnu que je me trompais, parce que vous remontiez le fleuve au lieu de descendre à Nantuck.
— En effet, je ne suis pas M. Wilks. Je m’appelle Blodjet, le révérend Alexandre Blodjet. N’importe, je n’en suis pas moins fâché que M. Wilks ne soit pas arrivé à temps.
— Oh ! il n’y perdra pas grand’chose en somme, attendu que l’héritage lui revient ; mais le vieux Pierre Wilks aurait donné jusqu’à sa tannerie pour voir ses frères avant de mourir.
Au mot d’héritage le roi avait dressé l’oreille, et il fit causer le jeune homme. Il apprit ainsi que feu Pierre Wilks avait en Angleterre deux frères qui n’étaient jamais venus aux États-Unis. Harvey Wilks était le plus vieux de la famille ; William n’avait que trente ou trente-cinq ans. Le quatrième frère, John, était mort l’année précédente à Nantuck, laissant trois orphelines sans ressources, car ses affaires à lui n’avaient pas prospéré.
— Mais elles hériteront aussi, je suppose, dit le roi.
— On ne sait pas. Pierre Wilks a tout légué à Harvey et à William dans une lettre où il leur recommande ses nièces.
— Pauvre homme, c’est triste de penser qu’il n’a pas vécu assez longtemps pour revoir ses frères. Les avait-on prévenus de sa maladie ?
— Oui, et comme on n’a pas reçu de réponse, cela prouve peut-être qu’ils sont en route.
— Où demeurent-ils ?
— À Sheffield, en Angleterre.
— Que font-ils ?
— William ne fait rien, parce qu’il est sourd-muet. Le vieux Harvey Wilks est pasteur d’une église presbytérienne.
— Est-ce que vous allez loin à bord du steamer ?
— Jusqu’à la Nouvelle-Orléans. Mais ce n’est là qu’une partie du voyage. Je dois m’embarquer mercredi prochain sur un navire à voiles, et je ne m’arrêterai qu’à Rio-Janeiro.
— Un joli voyage ; je vous envierais, si j’étais plus jeune… Comment se nomment les trois filles de John Wilks ? Quel âge ont-elles ?
— Marie-Jeanne, la rousse, a dix-neuf ans, Susanne quinze et Joana quatorze. Joana a un bec-de-lièvre, ce qui ne l’empêche pas d’être aussi bonne que ses sœurs.
— Pauvres enfants, les voilà seules au monde !
— Soyez tranquille, elles ne sont pas trop à plaindre. Les amis de leur oncle sont là, et il n’en manquait pas. Il y a M. Hobson, le prédicateur baptiste ; et le diacre Lot Hovey, et Ben Racker, et Abner Shackelford, et Levi Bell, l’avocat ; et le docteur Robinson, et leurs femmes, et la veuve Bartley et… Il y en a d’autres ; mais, ce sont là les principaux.
Le roi ne cessa d’adresser des questions au bavard que lorsqu’il l’eut complètement vidé. Il finit par connaître Nantuck et les affaires des Wilks comme s’il avait été de la ville. Enfin il lui demanda :
— Pourquoi n’avez-vous pas attendu le steamer au passage, au lieu de faire une longue course à pied par une chaleur pareille ?
— Parce que les bateaux ne se donnent guère la peine de ramasser un voyageur isolé. Les steamers de Cincinnati s’arrêtent quelquefois ; mais celui-là vient de Saint-Louis.
— Et Pierre Wilks était à son aise ?
— À son aise ? Je crois bien : des terres, des maisons, des esclaves, sans compter la tannerie qui, à elle seule, vaut au moins dix mille dollars.
— Quand est-il mort ?
— Hier au soir.
— Alors l’enterrement aura sans doute lieu demain ?
— Oui, vers le milieu de la journée.
Lorsque nous arrivâmes au vapeur, il avait presque fini de charger et ne tarda pas à lever l’ancre. Le roi ne parlait plus de monter à bord, de sorte que je perdis ma promenade. Dès que le steamer se fut éloigné, il me fit remonter le courant en pagayant, puis il débarqua à un mille plus haut et se coucha sur l’herbe.
— Maintenant, me dit-il, repars bien vite et amène-moi le duc avec les sacs de voyage neufs. Préviens-le de ma part que le caméléopard est enfoncé, que nous sommes attendus à Nantuck, et que je lui recommande de se mettre en grande tenue.
Je commençais à deviner de quoi il retournait ; mais je me gardai de dire un mot, naturellement. Quand je revins avec le duc, nous cachâmes le canot. Le roi s’assit sur un tronc d’arbre à côté de son associé et lui répéta tout ce que notre jeune passager lui avait raconté. En parlant il cherchait à imiter l’accent anglais et Bridgewater lui dit qu’il s’en tirait assez bien.
— Et vous, demanda le roi, saurez-vous faire le sourd-muet ?
— J’ai vu causer des sourds-muets, répliqua Bridgewater, et je serai moins embarrassé que vous. Il faut que je vous donne une leçon pour que nous paraissions habitués à parler par signes. L’essentiel, c’est d’aller très vite, comme si on avait l’alphabet au bout des doigts.
La leçon dura une demi-heure tout au plus. Il ne s’agissait plus que d’attendre le passage d’un steamer. Nous en vîmes défiler trois ; mais le duc eut beau les hêler, ils firent la sourde oreille. Enfin il en parut un quatrième qui nous envoya sa yole. Nous grimpâmes à bord et nous apprîmes qu’il venait de Cincinnati. Quand le capitaine sut que nous voulions descendre à Nantuck, c’est-à-dire à une distance de quelques milles, il se mit à jurer et déclara qu’il ne se dérangerait pas pour nous mettre à terre. Le roi conserva son calme.

— Voyons, dit-il, si des gentlemen sont disposés à débourser chacun un dollar par mille, un steamer peut bien s’arrêter un instant pour les débarquer, je pense.
Le capitaine cessa alors de tempêter, et quand nous eûmes atteint Nantuck, il nous envoya à terre dans la yole. Une douzaine d’individus descendirent sur la berge en voyant arriver un canot. Le roi fut le premier à s’approcher du groupe.
— Mes amis, quelqu’un de vous serait-il assez bon pour m’indiquer la demeure de M. Pierre Wilks ? demanda-t-il.
Aussitôt les flâneurs échangèrent des regards et des clignements d’yeux qui signifiaient clairement : « Là, je vous l’avais bien dit », tandis que l’un d’eux répliquait d’un ton compatissant :
— J’en suis très fâché, monsieur ; mais nous pouvons seulement vous indiquer la maison où il vivait hier au soir.
Alors le vieux parut sur le point de se trouver mal. Le menton appuyé sur l’épaule de l’individu qui venait de répondre, il lui inonda le dos de ses larmes.
— Hélas ! hélas ! s’écria-t-il, notre pauvre frère… Nous espérions tant le revoir… Je me résigne ; mais c’est dur, c’est trop dur !
Au bout d’une minute ou deux, il se redressa, se retourna, s’essuya les yeux et fit des signes au duc avec ses doigts. Le diable n’y aurait rien compris. Le duc lâcha le sac de voyage qu’il tenait à la main et se mit à pleurer à son tour. On se groupa autour d’eux, leur prodiguant des paroles de sympathie. Ce fut à qui porterait leurs valises. Chemin faisant, on donna au nouveau venu une foule de détails sur les derniers moments de son frère. Le roi s’arrêtait, la larme à l’œil, pour les communiquer au sourd-muet dont la mine désolée vous aurait touché.
Il va sans dire que, pour ma part, je ne les plaignais ni l’un ni
l’autre ; sans la frayeur qu’ils m’inspiraient, je les aurais dénoncés.
En moins de deux minutes la grande nouvelle s’était répandue. Les curieux arrivaient de tous les côtés. Beaucoup étaient si pressés, qu’ils n’avaient pas pris le temps de passer leur habit et ils l’endossaient en courant. Bientôt nous fûmes entourés d’une foule qui allait grossissant. Le bruit des pas ressemblait à celui d’un régiment en marche. Du monde à toutes les portes, à toutes les fenêtres. À chaque instant un visage se montrait au-dessus d’une palissade et une voix demandait :
— Ce sont eux ?
— Vous pouvez le parier ! répondait sans s’arrêter un de ceux qui suivaient les voyageurs.
Quand nous arrivâmes à la maison du défunt, il fallut jouer du coude pour y entrer. Les trois nièces avaient déjà été prévenues et elles se tenaient à la porte de la chambre mortuaire.
— Ah ! Marie-Jeanne, s’écria le vieux caméléopard, je t’aurais reconnue entre mille, rien qu’au portrait que mon pauvre Pierre a fait de toi dans ses lettres !
Il la reconnaissait tout bonnement à la couleur de ses cheveux, Marie-Jeanne en effet était rousse, ce qui ne l’empêchait pas d’être une très jolie fille. Ses yeux brillaient, son visage rayonnait, tant l’arrivée de ses oncles la rendait heureuse. Le roi ouvrit les bras et elle s’y jeta, tandis que le bec-de-lièvre tombait dans ceux du duc. Tout le monde se retenait pour ne pas pleurer, et les femmes ne se retinrent pas longtemps.
Enfin, comme par hasard, le roi donna un coup de coude au duc. Ils regardèrent autour d’eux et virent un cercueil posé sur des chaises, dans un coin de la chambre. Alors les deux frères… je veux dire les deux gredins, dont l’un avait passé le bras autour du cou de l’autre, se dirigèrent de ce côté, le visage caché dans leur mouchoir. On s’écarta pour leur laisser le passage libre et toute conversation cessa ; vous auriez entendu tomber une épingle.
Une fois agenouillés près du cercueil, ils firent semblant de sangloter. Non, je n’ai jamais vu des gens fondre en eau aussi facilement. Cela ne dura que deux ou trois minutes, heureusement pour eux, car ils commençaient à me dégoûter. Si Jim avait été là, je crois qu’ils seraient restés à genoux moins longtemps et le roi n’aurait pas eu l’occasion de faire le petit discours qu’il débita en pleurnichant dès qu’il se fut relevé.
Il répéta que c’était une cruelle épreuve pour lui et pour son frère William. Sans l’affreuse tempête pendant laquelle leur navire avait failli périr, ils seraient arrivés à temps… Mais l’épreuve était adoucie par toutes ces démonstrations de sympathie, par ces larmes versées en commun, par la vue de ces jeunes orphelines dont sa présence contribuerait à alléger le chagrin. Elles ne manquaient pas d’amis, il le voyait, et ces amis, il les remerciait du fond du cœur, en son nom et au nom de son frère William, à qui la Providence avait refusé le don de la parole.
Ah ! je lui aurais volontiers coupé la parole, à lui, quitte à me faire écharper par les sottes qui pleuraient en l’écoutant.
Enfin, après avoir marmotté une demi-douzaine de phrases qui avaient l’air d’une prière, il leva les yeux au plafond et lança un Amen ! Aussitôt quelqu’un dans la foule entonna le premier vers d’un cantique et on se mit à chanter. On se serait cru à l’église. La musique a du bon, elle me fit presque oublier les pleurnicheries de ce vieil imposteur. Mais il n’était pas encore au bout de son rouleau. Lorsqu’on fut arrivé à la fin du cantique, il s’avança de nouveau et dit d’un ton beaucoup moins larmoyant :
— Nous serons très heureux, mes nièces, mon frère et moi, si les principaux amis de la famille veulent bien souper ici et nous tenir compagnie durant cette triste veillée. Si le défunt pouvait parler, je sais qui il nommerait, car il y a des noms qui lui étaient chers et il les citait souvent dans ses lettres. Si je ne me les rappelle pas tous, vous me pardonnerez mon défaut de mémoire. Ceux dont les noms revenaient le plus fréquemment sont le révérend Hobson, le diacre Lot Hovey, Ben Rucker, Abner Shakelford, l’avocat Levi Bell, le docteur Robinson, leurs femmes, et la veuve Bartley.
Le révérend Hobson et le docteur venaient d’être appelés par le même malade ; l’avocat était allé à Louisville pour affaires ; mais les autres se trouvaient là ; ils s’approchèrent pour remercier le roi, lui serrer la main et causer avec lui. Ils serrèrent aussi la main du duc sans rien dire ; ils se contentaient de hocher la tête en souriant bêtement, tandis que le faux sourd-muet faisait des signes sur ses doigts et poussait des gou, gou, gou, comme un baby qui ne peut pas parler.
Le roi ne garda pas sa langue dans sa poche et ne se boucha pas les oreilles non plus. Tout en s’arrangeant de façon à se renseigner sur les gens qui l’entouraient, il rappelait une foule de petits incidents arrivés dans la famille Wilks ou dans la ville. Il mettait à profit les renseignements qu’il tenait du jeune imbécile que nous avions piloté jusqu’au steamer, se gardant bien de faire la moindre allusion à cette rencontre. Tout semblait donc marcher sur des roulettes.
Enfin Marie-Jeanne apporta une lettre adressée à Harvey Wilks. Le roi s’empressa de l’ouvrir et après y avoir jeté un coup d’œil, il la lut à haute voix. Pierre laissait la maison d’habitation et 3 000 dollars à ses nièces. La tannerie, les autres immeubles et les esclaves, plus une somme de 3 000 dollars, revenaient à ses deux frères qui le remplaceraient comme tuteurs auprès des orphelines. La lettre indiquait l’endroit où ils trouveraient les 6 000 dollars qui étaient cachés dans une cave.
— Sans être un homme d’affaires, dit le vieux caméléopard, je sais que cette lettre vaut un testament, malgré l’absence de témoins, car elle est écrite d’un bout à l’autre de la main de Pierre. Toutefois je ne m’explique pas qu’il ait jugé à propos de cacher cet argent.
— Il n’y a pas trop de quoi s’étonner, interrompit la veuve Bartley. Depuis la faillite d’une maison où il avait placé des fonds, il se défiait des banquiers, et il traitait ses nièces de gamines. D’ailleurs, dans ces derniers temps, il ne pensait qu’à amasser pour agrandir la tannerie qui lui rapportait gros.
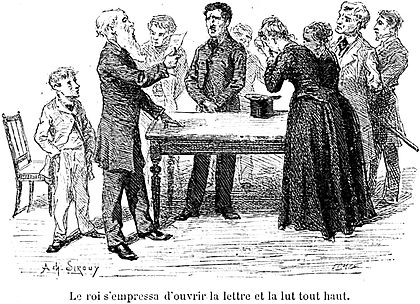
Le sourd-muet paraissait n’avoir rien entendu ; le roi feignit de causer avec lui par signes, puis il dit :
— William convient avec moi qu’en notre qualité de tuteurs, nous devons visiter sans retard la cave. La cachette est connue et demain la maison restera vide pendant une partie de la journée. L’argent est là, nous n’aurons pas de peine à le trouver et nous le compterons devant vous. Il faut que les choses se passent ouvertement. Ce ne sera pas long. Prenez une chandelle, Adolphe, et éclairez-nous.
Les pauvres orphelines auraient volontiers attendu jusqu’au lendemain ; mais les curieux leur donnèrent tort.
Nous descendîmes dans la cave dont le duc referma la porte derrière nous. En effet, l’argent était là, dans un sac, à l’endroit indiqué. Les deux oncles ne tardèrent pas à le découvrir. Après avoir fait ruisseler les écus entre leurs doigts, ils se mirent à les compter. Les yeux du duc brillaient ; mais bientôt son visage cessa de rayonner.
— Il manque 415 dollars, dit-il.
— Peu nous importe, répliqua le roi. Je sais déjà ce que vaut notre part, et elle est assez belle pour nous permettre de sacrifier 415 dollars.
— Vous oubliez une chose, riposta le duc. Le compte n’y est pas et cela paraîtra louche. Mauvais début.
— Eh bien, comblons le déficit.
— Vous avez une bonne tête, mon vieux caméléopard, et votre idée m’en suggère une autre qui vaut encore mieux. Nous allons compléter la somme et donner le tout à nos chères nièces.
— Laissez-moi vous embrasser, Bridgewater, s’écria le roi. Si l’on se méfie de nous après cette preuve de désintéressement !…
Ils tirèrent tous deux de l’argent de leurs poches et complétèrent la somme.
— Nous voilà presque à sec, dit le duc ; mais c’est de l’argent bien placé.
— Oui, certes, répliqua le roi, d’autant plus que nous trouverons peut-être l’occasion de le reprendre avant de quitter le pays.
Lorsque nous remontâmes, les curieux se pressèrent autour de la table sur laquelle le roi versa les 6 000 dollars, dont il forma vingt jolis petits tas qu’il remit l’un après l’autre dans le sac.
— Mes amis, dit-il alors, mon frère s’est montré généreux envers les seuls parents qu’il laisse dans cette vallée de larmes. Oui, et il se serait montré plus généreux envers ces trois orphelines, n’était une promesse qui date de loin. Eh bien — c’est entendu entre William et moi — nous le remplacerons. En attendant, nous cédons à ces pauvres petites notre part des 6 000 dollars. Marie-Jeanne, Susanne, Joana, prenez cet argent, prenez le tout. Ne nous remerciez pas — c’est un don de celui qui n’est plus.
Malgré cette recommandation, Marie-Jeanne lui sauta au cou, tandis que Susanne et Joana tombaient sur le duc, puis chacun voulut serrer la main des deux oncles.
Enfin on se remit à causer du défunt. Le roi, qui aimait à s’entendre parler, ne tarissait pas. Au bout de quelque temps un vieux monsieur, très bien mis, se faufila parmi les auditeurs, regardant et écoutant sans ouvrir la bouche. On ne lui disait rien non plus, parce qu’on ne s’occupait que des deux frères. Je crois que le roi jouait mal son rôle, car le nouveau venu, qui s’était approché en se caressant la mâchoire, finit par l’interrompre au milieu d’une belle phrase en lui riant au nez.
— Docteur, docteur ! s’écria Abner Shakelford, à quoi songez-vous donc ? Vous ne savez donc pas la nouvelle ? C’est Harvey Wilks.
— Ah ! dit le roi avec un sourire des plus aimables et en allongeant la patte, je m’étonnais de n’avoir pas encore vu le docteur Robinson, le meilleur ami de mon pauvre frère.
— Vous, le frère de Pierre Wilks ! dit le docteur en écartant du geste la main qu’on lui tendait. Allons donc ! Voilà cinq minutes que je vous écoute ; votre accent et votre langage suffisent pour me convaincre que vous n’êtes pas plus Anglais que moi. Vous êtes un imposteur !
Le roi parut interloqué ; mais il retrouva bientôt son sang-froid.
— Monsieur, dit-il sans se fâcher, vous oubliez que vous vous adressez à un homme à qui sa profession ordonne l’oubli des injures. Il y a ici des gens qui me jugent d’après mes actes, cela me suffit, à moi.
— Eh bien, ces gens-là sont des niais. Je…
Les niais entourèrent le docteur et cherchèrent à le calmer en lui démontrant que l’identité de Harvey était bien constatée. Est-ce qu’un étranger connaîtrait les principaux habitants de la ville, l’âge exact des trois orphelines et jusqu’aux noms des chiens de la maison ? On eut beau raisonner avec lui, rien n’y fit.
— J’étais l’ami de votre père, dit-il à Marie-Jeanne, qui s’accrochait à son oncle, et je suis le vôtre, un ami désintéressé qui voudrait vous protéger. C’est pour cela que je vous engage à mettre ces deux individus à la porte. Ils ont obtenu, je ne sais où, quelques renseignements dont ils se servent pour vous jeter de la poudre aux yeux. Écoutez-moi, Marie-Jeanne, et mettez-les à la porte, ou vous regretterez de n’avoir pas suivi mon conseil. Si Lévi Bell était ici, il aurait commencé par demander leurs papiers… En vérité, il faut être bien niais pour…
— Voici ma réponse, répliqua fièrement Marie-Jeanne, qui se dirigea vers la table, saisit le sac aux écus et le remit entre les mains du roi en ajoutant : Prenez ces 6 000 dollars, mon oncle, et placez-les comme vous l’entendrez à mon nom et à celui de ma sœur.
Puis elle embrassa le roi sur une joue, tandis que Susanne et Joana l’embrassaient sur l’autre. Tous les niais applaudirent.
— Fort bien, dit le docteur, je m’en lave les mains ; mais le jour viendra où vous vous sentirez un peu malades en songeant aux paroles de votre vieil ami.
Et il s’éloigna sans prononcer un mot de plus.
— Fort bien, répéta le roi d’un ton patelin ; je vous pardonne vos soupçons injurieux. Si elles tombent malades, je les déciderai à vous
envoyer chercher.
Quand tout le monde fut parti, le roi demanda à Marie-Jeanne si on pouvait le loger. Elle lui dit qu’il y avait une chambre d’ami dont l’oncle William se contenterait peut-être et qu’elle céderait sa propre chambre, qui était un peu plus grande, à l’oncle Harvey. Elle coucherait avec une de ses sœurs, de sorte que cela ne la gênerait en rien. Il y avait aussi dans le grenier un petit cabinet qui ferait mon affaire.
Là-dessus elle nous emmena en haut pour nous montrer les chambres qui étaient assez bien meublées et très propres. Elle voulut enlever ses robes et un tas d’autres objets, parce qu’elle craignait que l’oncle Harvey se sentît moins chez lui si elle les laissait là ; mais l’oncle Harvey déclara qu’il se sentirait bien plus à l’aise si on ne dérangeait rien à cause de lui. Les robes étaient accrochées le long du mur, protégées contre la poussière par un rideau de calicot qui retombait jusqu’au plancher. Il y avait une vieille malle dans un coin, une boîte à guitare dans un autre, et une masse de ces bibelots dont les femmes aiment à s’encombrer. La chambre du duc était moins grande, mais assez confortable en somme. Quant à mon cabinet, le roi affirma que j’y serais très bien et ne demanda pas mon avis.
Cette nuit, nous eûmes un grand souper. Je me tins tout le temps derrière le roi et le duc. Les autres invités avaient des nègres pour les servir. Les plats disparurent en un clin d’œil, car chacun semblait avoir réservé son appétit pour le repas du soir. Marie-Jeanne et Susanne occupaient un des bouts de la table, en face de leurs oncles. Lorsqu’on eut fini, j’allai souper dans la cuisine avec Joana, tandis que les nègres lavaient la vaisselle. Le bec-de-lièvre se mit à me questionner à propos de l’Angleterre, et à plusieurs reprises je me trouvai embarrassé.
— Avez-vous jamais vu le roi d’Angleterre ? me demanda-t-elle.
— Je crois bien ! Il venait tous les dimanches à notre église.
— Je me figurais qu’il demeurait à Londres.
— Certainement. Où voulez-vous qu’il demeure ?

— Alors, comment avez-vous pu le voir, puisque vous habitiez Sheffield ?
Je me mis à tousser, comme si j’avais avalé de travers, afin de me donner le temps de réfléchir, puis je répliquai :
— Le roi ne reste pas toujours à Londres ; il vient chaque été à Sheffield prendre des bains de mer.
— Des bains de mer à Sheffield ! Sheffield n’est pas un port de mer.
— Qui vous dit le contraire ?
— Vous.
— Moi ? J’ai seulement dit que le roi vient là pour prendre des bains de mer… Est-ce qu’on est obligé d’aller à la Jamaïque pour avoir du rhum ?
— Non.
— Eh bien, le roi n’a pas besoin d’aller si loin non plus. Il se fait envoyer son eau dans des barriques. Il n’aime pas les bains froids et dans le palais de Sheffield il y a des chaudières aussi grandes que cette cuisine. Au bord de la mer on ne trouve pas ce qu’il faut pour chauffer assez d’eau.
— Bon, je comprends ; vous auriez pu m’expliquer cela tout de suite.
Je me crus hors du bois et je me sentis plus à l’aise ; mais elle revint bientôt à la charge.
— Vous alliez donc aussi à l’église ? Où vous mettiez-vous ?
— Sur le banc de votre oncle, parbleu.
— Ici, le pasteur, à moins d’avoir une nombreuse famille, ne se réserve pas un banc, attendu qu’il est en chaire tout le temps.
Je venais de commettre une nouvelle bévue, oubliant que Harvey Wilks était pasteur et célibataire. Je m’en tirai pourtant, non sans tousser un peu.
— Oh ! il ne monte pas en chaire chaque semaine. Dans notre église il y a dix-sept prédicateurs, parce que le roi s’ennuierait d’entendre toujours le même.
— Hum ! Et traite-t-on bien les domestiques chez vous ? Leur donne-t-on congé, comme ici, le jour de Noël, le jour de l’an et à la fête du 4 juillet ?
— On voit bien que vous ne connaissez pas l’Angleterre. Ils ont à peine une heure de congé d’un bout de l’année à l’autre.
— Pas même le dimanche ?
— Pas même le dimanche.
— Alors comment trouviez-vous le temps de vous rendre à l’église ?
— J’étais forcé de trouver le temps bon gré, mal gré. Je n’appelle pas ça un congé. Tous les Anglais sont obligés de se montrer à l’église, le dimanche. C’est la loi.
Joana ne semblait pas convaincue.
— Je vois bien, me dit-elle, que vous vous êtes amusé à me débiter des histoires. Ce n’est pas bien de mentir, même pour s’amuser. Mon oncle se fâcherait, s’il le savait.
— Vous pouvez tout lui répéter, il ne se fâchera pas.
— Je suis sûre du contraire et je ne veux pas vous faire gronder. Une moitié de ce que vous m’avez dit peut être vraie ; mais je ne crois pas un mot du reste.
— Qu’est-ce que tu ne veux pas croire, Joana ? demanda Marie-Jeanne qui venait d’arriver avec Susanne. Ce qui n’est pas bien, c’est de parler ainsi à un étranger qui se trouve si loin de sa famille et de ses amis.
— Je te reconnais là, Marie-Jeanne. Toujours prête à panser les gens avant qu’ils soient blessés. Il m’a raconté des bourdes, et je lui disais que je ne pouvais pas les avaler, rien de plus.
— C’est déjà trop. À sa place tu te serais sentie froissée ; il est sous notre toit et personne n’a le droit de froisser son hôte.
— Mais il m’a dit que…
— Peu m’importe ce qu’il a dit. Notre devoir est de faire oublier à ce pauvre garçon qu’il n’est plus parmi les siens. Tu vois, il a l’air tout triste.
Je ne sais pas si j’avais l’air triste, je sais seulement que je me disais : Et voilà la fille dont le vieux caméléopard veut empocher l’argent !
Alors Susanne se mit de la partie, si bien que je fus tenté de prendre la défense de Joana, et je me dis : Voilà une bonne fille dont Tom Sawyer ne laisserait pas voler l’argent, s’il pouvait l’empêcher.
Ensuite Marie-Jeanne recommença ; elle parla très doucement, comme la première fois ; mais quand elle eut fini, la pauvre Joana avait des larmes dans les yeux.
— Puisque tu reconnais tes torts, reprit Susanne, demande-lui pardon.
Eh bien, elle me demanda pardon si gentiment, que je ne sus que répondre, et je me dis : Et voilà une de celles dont tu voulais laisser voler l’argent !
Elles crurent que j’étais fâché d’avoir été accusé de mensonge et elles s’efforcèrent de me mettre à mon aise. Mais je me sentis encore plus honteux, sachant que je ne méritais pas d’être traité en ami par ces pauvres orphelines. Cela ne dura pas longtemps. Ma résolution fut vite prise. J’étais décidé à leur rendre les 6 000 dollars.
Mon souper achevé, je demandai à aller me coucher, sous prétexte que j’étais fatigué. Dès que je fus seul, je me creusai la cervelle. Irais-je trouver le docteur pour le mettre au courant ? Non. Ce moyen ne valait rien. Les deux fourbes se douteraient que je les avais dénoncés, et j’avais peur d’eux. Irais-je avertir Marie-Jeanne ? Non. Elle aurait beau se taire, son visage parlerait, ses oncles partiraient avec l’argent, et leurs soupçons tomberaient encore sur moi. Le plus simple, puisque je voulais seulement les empêcher d’être volées, était de prendre moi-même le sac, de le cacher et d’écrire plus tard à Marie-Jeanne où elle le trouverait.
Le moment me parut bon pour exécuter mon projet. J’avais laissé tout le monde au rez-de-chaussée et personne n’aurait pu remonter sans me donner l’éveil. Je descendis donc de mon grenier et je me dirigeai vers la chambre du roi, qui n’était pas homme à confier l’argent à son associé. J’avais à peine eu le temps de regarder autour de moi lorsque j’entendis un bruit de pas sur l’escalier. Je soufflai ma chandelle et je me glissai sous le rideau de calicot, derrière les robes de Marie-Jeanne.
Le roi et le duc entrèrent.
— Si j’ai compris vos signes, dit le premier, vous avez quelque chose à me proposer ?
— Oui, répliqua l’autre. Je ne suis pas tranquille. Ce docteur m’inquiète. Contentons-nous des 6 000 dollars, réveillons Huck, sautons dans un canot et regagnons le radeau.
— Vous n’y songez pas ! Nous contenter de 6 000 dollars quand dans un jour ou deux nous pourrons en toucher 12 000 ou 15 000 ! Ce serait par trop bête.

— Il me semble encore plus bête de nous exposer à perdre ce que nous tenons. Et puis, j’ai des scrupules — enlever tout ce qu’elles possèdent à ces orphelines, qui m’ont embrassé de si bon cœur !
— Avouez que vous avez peur, répondit le roi ; je ne crois pas à vos scrupules. D’ailleurs les orphelines ne perdront que 3 000 dollars. La maison leur appartient, et elles ne seront pas trop à plaindre. Ce sont ceux qui achèteront la tannerie et le reste qui y perdront le plus. Dès qu’on saura que nous ne sommes pas les vrais héritiers, la vente sera annulée ; mais nous serons loin avant qu’on le sache.
— Le docteur pourrait bien mettre des bâtons dans les roues.
— Je me moque du docteur. Nous avons pour nous tous les niais de la ville et dans n’importe quelle ville les niais représentent une assez jolie majorité.
— Allons, soit ; mais je maintiens que c’est jouer un jeu dangereux. En attendant, l’argent me paraît mal caché. Marie-Jeanne et ses sœurs sont en deuil, et les nègres recevront bientôt l’ordre de serrer ces robes dans une malle ou ailleurs.
— Oui, et quand un nègre rencontre un sac d’écus, il ne se gêne guère pour l’alléger. Vous avez raison ; cachons-le dans ma paillasse.
Il se mit aussitôt à fouiller sous le rideau, à deux ou trois pieds de l’endroit où je me tenais. Je me collai contre le mur, me demandant ce que je pourrais bien lui dire s’il me découvrait. Il rencontra ce qu’il cherchait avant que j’eusse eu le temps de trouver la moitié de ma réponse et ne se douta pas que j’étais là.
Enfin, après avoir soulevé le lit de plume, ils enfouirent le sac dans la paillasse.
— Les nègres ne retourneront que le lit de plume, dit le roi ; ils sont trop paresseux pour se donner la peine de remuer la paillasse plus d’une ou deux fois par an. Voilà notre argent à l’abri des voleurs.
J’aurais pu lui apprendre qu’il se trompait. Il n’était pas encore au bas de l’escalier, que j’avais déjà mis la main sur le sac. Je remontai dans mon grenier et je fourrai l’argent dans ma paillasse à moi. Mon intention était de le cacher en dehors de la maison, parce que je pensais que l’on furèterait dans toutes les chambres à la première alerte. En attendant, je me couchai sans me déshabiller ; mais je n’aurais pu dormir lors même que j’eusse essayé, tant j’étais tracassé. Au bout de deux ou trois heures — je ne sais pas au juste — j’entendis le roi et le duc qui remontaient. Je me glissai à bas de mon lit et, le menton appuyé sur le haut de l’échelle qui conduisait au grenier, j’écoutai jusqu’à ce que tout bruit eût cessé, puis je descendis après avoir eu soin de
retirer mes souliers.
Je m’approchai à pas de loup de leurs chambres et je prêtai l’oreille. Ils ronflaient. J’arrivai sans encombre au bas de l’escalier. Au rez-de-chaussée rien ne bougeait. Je regardai à travers une fente de la porte de la salle à manger et j’aperçus tous les veilleurs endormis sur leurs chaises. Le salon, où se trouvait le cercueil, était faiblement éclairé ; mais je n’y vis personne. Je pus donc gagner l’entrée de la maison sans avoir rencontré une âme. Par malheur, la grille était fermée à double tour et on avait retiré la clef. Au même instant, j’entendis quelqu’un qui descendait l’escalier, juste derrière moi. Je courus me réfugier dans le salon et, après avoir jeté autour de moi un rapide coup d’œil, je ne vis d’autre endroit que le cercueil pour cacher mon sac. Le couvercle avait été repoussé en arrière, de façon à laisser à découvert le visage du mort. Je soulevai ledit couvercle et je glissai le sac dans le cercueil, puis je me faufilai derrière la porte.
La personne qui venait de descendre était Marie-Jeanne. Elle se dirigea tout droit vers la bière, s’agenouilla, et comme elle me tournait le dos, je pus m’éloigner sans être forcé de lui expliquer le motif de ma présence.
Je regagnai mon grenier, assez mécontent du résultat de mon expédition. Après tout, me dis-je, si par hasard on découvre le sac, on n’y comprendra rien, et je ne serai pas compromis. Dans le cas contraire, j’écrirai au docteur quand nous serons à une bonne distance de Nantuck et il rendra l’argent aux orphelines. Je m’endormis en songeant à la joie qu’il éprouverait, ce qui ne m’empêcha pas de rêver que le duc m’étranglait.
Lorsque je descendis, au grand jour, le salon était fermé et les veilleurs avaient disparu. Il ne restait dans la maison que les gens de la famille et Mme Bartley. Je devinai, à l’expression des visages, que je n’avais aucune raison pour m’alarmer ; évidemment on n’avait rien découvert.
L’enterrement eut lieu vers onze heures et il ne s’y passa rien d’extraordinaire. Tous les enterrements se ressemblant, je n’ai donc pas besoin de parler de celui-là. Dans l’après-midi, les Wilks reçurent beaucoup de visites durant lesquelles on vida un bon nombre de bouteilles. Le roi se montra plus mielleux que jamais. Comme on l’engageait à s’établir à Nantuck, il déclara que le climat des États-Unis ne lui convenait pas — son médecin le lui avait dit — et d’ailleurs son troupeau aurait de la peine à se passer de lui. Il le regrettait, mais il lui faudrait régler ses affaires temporelles au plus vite et abréger autant que possible son séjour. Naturellement, son frère et lui désiraient ramener leurs chères nièces à Sheffield, où elles se retrouveraient au milieu de leur famille. Cette idée plut surtout aux nièces, au point qu’elles en oublièrent leur chagrin. Elles engagèrent même le vieux caméléopard à tout vendre sans perdre de temps. Elles semblaient si heureuses que cela me serrait le cœur de les voir se laisser duper ainsi ; mais comment les mettre sur leurs gardes sans m’exposer à être étranglé ?
Le roi était si pressé qu’il fit poser dès le lendemain des affiches annonçant la vente aux enchères de la maison, des nègres, de la tannerie et du reste de l’héritage. Cette vente devait avoir lieu deux jours après l’enterrement ; mais on se réservait le droit de traiter à l’amiable s’il se présentait des acheteurs.
Il s’en présenta, et le roi céda à un prix très raisonnable les trois esclaves du défunt. Cela porta un premier coup à la joie des orphelines, qui se désolèrent en apprenant que leur ancienne servante allait partir pour Memphis, tandis que ses deux fils s’en iraient à la Nouvelle-Orléans. L’idée ne leur était pas venue que ces gens qu’elles aimaient pussent être ainsi séparés. Le roi s’excusa de son mieux.
— Soyez sans inquiétude, dit-il à ses nièces ; je les ai donnés plutôt que je ne les ai vendus, et j’ai mis pour condition qu’ils seraient bien traités.
Cela ne parut pas consoler Marie-Jeanne.
Le lendemain, il faisait à peine jour lorsque les deux oncles vinrent me réveiller dans mon grenier et je vis à leur mine que quelque chose allait de travers.

— Êtes-vous entré dans ma chambre ? me demanda le roi à brûle-pourpoint.
— Oui, Votre Majesté, répondis-je en me frottant les yeux.
Je lui donnais toujours son titre lorsqu’il n’y avait aucun étranger présent.
— Ah ! ah ! Quand y êtes-vous entré ?
— Mais vous le savez bien — le jour où miss Marie-Jeanne vous l’a montrée. Vous n’avez pas eu besoin de moi depuis.
— Là, vous voyez ! dit le duc, qui, après avoir regardé son compagnon en haussant les épaules, me demanda à son tour : Y avez-vous vu entrer quelqu’un ?
— Non, Votre Grâce ; mais j’en ai vu sortir les deux nègres.
— Tous les deux ? Ensemble ?
— Oui.
— Quel jour ?
— Le jour de l’enterrement.
— Vous ont-ils parlé ?
— Non ; ils ne m’ont pas même vu ; j’étais en haut de l’échelle.
— Avaient-ils l’air content ?
— Je ne me suis pas trop occupé d’eux ; j’ai pensé qu’ils venaient de faire votre chambre.
— Ils n’auraient pas eu besoin de se mettre deux pour la faire.
— C’est vrai, je n’y songeais pas… Ce sont de bons nègres, allez ! Vous ne les auriez pas entendus marcher. Ils avaient ôté leurs souliers, parce qu’ils savaient que l’on n’aime pas le bruit dans une maison où il y a un mort.
— Voilà qui me paraît assez clair, s’écria le roi.
— Oui, ce n’est que trop clair, dit le duc. Et ces bons nègres qui semblaient prêts à s’arracher les cheveux, tant ils regrettaient de quitter le pays ! Nous avons donné dans le panneau comme les autres. Et on prétend qu’un nègre n’apprendra jamais à jouer la comédie ! Ces mauricauds-là sont des acteurs de premier ordre. Si j’avais un bailleur de fonds, je louerais une salle, je les engagerais, et ma fortune serait faite. Et vous les avez vendus pour quelques centaines de dollars que nous ne tenons pas encore ! Où sont les billets à trois jours qu’on vous a remis ?
— Dans mon portefeuille — nous toucherons les fonds demain.
— À la bonne heure ! mais je voudrais les avoir déjà touchés.
Je crus qu’ils allaient se mordre.
— Est-ce que vous êtes fâchés que les nègres soient partis ? demandai-je d’un air innocent. Est-ce qu’ils vous ont pris quelque chose ?
— Mêle-toi de ce qui te regarde, me dit le duc d’un ton rageur. Si tu ouvres trop la bouche pendant que nous serons dans cette ville, gare à toi.
— Oh ! reprit le roi d’une voix doucereuse qui m’effraya presque autant que la menace du duc, il nous connaît et on peut compter sur sa discrétion. Quant à nous, ajouta-t-il en s’adressant à son associé, comme nous ne savons pas au juste quel chemin ont suivi nos nègres, le mieux est de nous taire et de réaliser au plus vite.
— Si vous m’aviez écouté, riposta le duc, nous aurions déjà réalisé une jolie somme, les nègres seraient encore ici et nous n’y serions plus. Enfin, puisque le mal est fait, je ne tiens pas à partir les poches vides. Naturellement, vous n’avez jamais songé à emmener ces trois filles ?
— Parbleu ! nous les laisserons derrière nous à la première étape. La proposition a produit un bon effet, c’est tout ce que je voulais.
— À la bonne heure ! Mais il s’agit de nous entendre et d’arrêter nos plans.
Là-dessus, ils s’éloignèrent sans plus s’occuper de moi que si je
n’existais pas.
Deux ou trois heures plus tard, je sentis que le moment du déjeuner approchait et je descendis. En passant, devant la chambre des orphelines je vis la porte ouverte. Marie-Jeanne se tenait assise près d’une vieille malle où elle venait de ranger des effets ; elle s’était arrêtée au milieu de son emballage et elle pleurait. Mon premier mouvement fut d’entrer pour essayer de la consoler.
Je me figurais qu’elle se désolait encore de la mort de son oncle. Pas du tout ; elle ne pensait qu’aux nègres et à leur mère.
— Ah ! comment ne pas pleurer en songeant à ces pauvres gens qui ne se reverront plus ! dit-elle.
Je fus sur le point de m’écrier que les nègres reviendraient bientôt, comme s’ils n’avaient jamais été vendus. Mais alors il aurait fallu lui tout raconter. Marie-Jeanne, pour me remercier du service que je lui rendais, me ferait peut-être écharper. Elle ameuterait toute la ville. À force de réfléchir, j’avais compris que maintenant je courais deux dangers au lieu d’un. On m’avait vu arriver avec ces faux oncles et on croirait que j’appartenais à la bande. Mon intention était donc d’emprunter un canot à la tombée de la nuit et de rejoindre Jim sur le radeau. Quant au reste, rien ne pressait. Le roi et son ami ne voulaient pas partir les poches vides et ils ne toucheraient le prix de la vente que le lendemain au plus tôt. Je comptais laisser pour le docteur une lettre où je lui dirais : « Écrivez au juge de Bricksville : Nous tenons le caméléopard et son associé. Vous verrez bientôt arriver des témoins qui vous donneront des renseignements sur M. Harvey et son frère. En attendant, faites-les coffrer. » De cette façon, je ne risquerais pas d’être étranglé par le duc ou écharpé par les gens de la ville. Aussi jugeai-je prudent de ne pas consoler trop tôt Marie-Jeanne et me contentai-je de lui dire :
— J’ai rêvé hier au soir que vous n’iriez pas en Angleterre et que vous reverriez vos nègres.
La vente eut lieu sur la place publique, assez tard dans l’après-midi. Le commissaire-priseur avait en vain conseillé aux héritiers de ne pas tant se hâter ; le révérend Harvey Wilks était trop pressé. Il aimait mieux, disait-il, sacrifier quelques centaines de livres sterling que de retarder son départ pour Sheffield, où sa chaire restait vide.
Enfin, tout fut vendu, sauf un champ situé près du cimetière, et on se dirigea de ce côté. À peine y fut-on, que la moitié de la bande — il y avait là plus de badauds que d’enchérisseurs — retourna sur ses pas. Un steamer qui s’était arrêté en face de la ville attirait les curieux. Au bout de cinq à six minutes nous les vîmes revenir, accompagnés de beaucoup d’autres, riant, gesticulant, poussant des cris confus. À mesure qu’ils se rapprochaient, on distinguait ce qu’ils disaient.
— Vive la concurrence !… Voilà un autre révérend Harvey Wilks et un autre sourd-muet !… Les paris sont ouverts, faites votre choix !
Tout en criant, ils entraînaient, sans trop les bousculer, un vieux monsieur que l’on aurait plutôt pris pour un riche fermier que pour un clergyman, et un jeune homme, également bien mis, qui portait un bras en écharpe. Ils paraissaient ahuris, mais j’aurais parié pour eux et je n’avais pas envie de rire, car leur arrivée dérangeait mon plan. À voir le duc, vous auriez juré qu’il n’avait rien entendu. Quant au roi, il ne perdit pas non plus son sang-froid. Il contemplait les vrais héritiers d’un air attristé. Son visage disait clairement : « Se peut-il qu’il y ait au monde de tels fourbes ! » Ah ! il jouait bien son rôle. Les gens qu’il avait réussi à enjôler se groupèrent autour de lui pour montrer qu’ils prenaient son parti. Le vieux gentleman ne sembla pas s’inquiéter de cette démonstration.
— Messieurs, dit-il — et je vis tout de suite qu’il ne parlait pas comme un Yankee — j’étais loin de m’attendre à un pareil accueil. Je ne vous ai pas trompés, et je le prouverai demain ou après-demain, dès que j’aurai reçu mes bagages qui ont été mis à terre par erreur à quelques milles de Nantuck. D’ici là, il est inutile de discuter. Mon frère William, qui s’est cassé le bras durant ce triste voyage, et moi, qui ai été fort secoué, nous avons grand besoin de repos. Veuillez nous indiquer un hôtel où vous nous garderez à vue, si cela vous plaît.

Ils partirent avec une escorte qui ne savait trop que penser de la mine hébétée du second sourd-muet, mais que l’allure pleine de franchise du second Harvey Wilks semblait disposer en sa faveur. Tandis qu’ils s’éloignaient, le roi, qui aurait bien voulu s’éloigner aussi — sans escorte — se mit à ricaner.
— Un clergyman qui consent à se laisser garder à vue, qui ne pleure même pas la mort de son frère !… Et ils ont perdu leurs bagages !… C’est très commode et très ingénieux…
Il se tut en apercevant le docteur, qui venait d’arriver et qui l’écoutait tout en causant avec deux autres messieurs que je voyais pour la première fois.
— Quand êtes-vous débarqué à Nantuck ? demanda un de ces derniers au roi.
— Le jour de l’enterrement, monsieur.
— Je le sais ; mais à quelle heure ?
— Dans la soirée — une heure ou deux avant le coucher du soleil.
— Comment êtes-vous arrivé ici ? Par quelle voie ?
— À bord du Franklin qui venait de Cincinnati.
— Alors comment vous trouviez-vous à la pointe le matin, dans un canot ?
— Je n’étais pas à la pointe. Vous vous trompez.
— Oh ! j’ai de bons yeux. C’est bien vous que j’ai vu passer dans un canot avec Tim Collins et un gamin.
— Reconnaîtriez-vous ce gamin, Hines ? demanda le docteur.
— Je crois que oui… Justement le voilà !
C’est moi qu’il désignait.
— Mes amis, dit le docteur, il se peut que les derniers venus soient les vrais héritiers ; mais si ces deux gaillards-là ne sont pas des fourbes, je consens à passer pour un idiot. Il est de notre devoir de les empêcher de s’échapper. Emmenons-les à l’hôtel. Une confrontation suffira peut-être pour tout éclaircir.
La révélation de M. Hines avait produit son effet ; les amis du roi commençaient à penser que l’on n’avait pas eu trop tort de les traiter de niais. On ne se contenta pas de garder à vue les deux frères, on les saisit au collet. Le jour baissait et maintenant que j’étais à peu près sûr qu’ils seraient coffrés, je n’aurais pas mieux demandé que de leur fausser compagnie afin de mettre mon projet à exécution. Pas moyen. Le docteur me tenait par la main et il ne me lâcha pas. Tout le monde entra pêle-mêle dans le grand salon de l’hôtel. On alluma des chandelles et l’on fit venir les nouveaux prétendants à l’héritage.
— Je dois songer avant tout, dit le docteur, aux intérêts de ces orphelines que je connais depuis leur enfance. Si cet homme (il désignait du geste le roi) n’est pas un fourbe, il ne refusera pas de remettre en mains sûres les 6 000 dollars qu’on lui a confiés.
— Hélas ! répliqua le roi d’un ton vraiment navré, je regrette plus que personne que mes nièces n’aient pas gardé cet argent dont mon frère et moi leur avions cédé notre part. Cet argent, je ne l’ai plus — il a disparu.
— Disparu ? Allons donc !
— Oui ; je l’avais caché dans ma paillasse, jugeant inutile de le déposer dans une banque pendant les quelques jours que nous avions à rester ici. On nous l’a volé.
— Qui donc l’a volé ?
— Les nègres.
— Quels nègres ?
— Ceux que j’ai vendus. Je ne me suis aperçu du vol que le lendemain de leur départ. Mon domestique est là, vous pouvez l’interroger.
Le docteur haussa les épaules.
— Vous avez vu les nègres emporter cet argent ? me demanda-t-il.
— Non, répliquai-je. J’ai seulement dit à M. Harvey qu’ils sont sortis de sa chambre en ayant l’air de se cacher. Je n’en sais pas davantage.
— Et vous, reprit le docteur en s’adressant au roi, vous n’avez pas songé tout d’abord à prévenir vos nièces, à porter plainte contre ceux que vous soupçonniez ?
— Si, j’y ai si bien songé que j’ai écrit au shérif ; mais vous n’ignorez sans doute pas qu’il est absent. À quoi bon, du reste ? Ceux qui ont acheté les nègres devaient déjà être loin, chacun de leur côté, et mon intention était de dédommager amplement mes nièces.
On avait beau lui adresser question sur question, il trouvait réponse à tout. Quant à l’autre Harvey Wilks, il prenait la chose très tranquillement. Il déclara qu’il ne refuserait pas de répondre à un magistrat, mais qu’il regardait comme au-dessous de sa dignité de subir un interrogatoire extra-judiciaire — d’autant plus que l’on pourrait se dispenser de l’interroger ; dès que le messager auquel il avait donné des instructions reviendrait avec ses bagages tout s’éclaircirait.
— Soit, dit le docteur ; mon opinion est déjà à peu près faite, et nous en serons quittes pour patienter jusqu’à… Ah ! mon cher Bell, vous voilà enfin ! Pourquoi nous avez-vous plantés là ? Nous avions grand besoin de vous.
— Et moi, j’avais faim, répliqua M. Levi Bell, qui avait l’air plus éveillé qu’une potée de souris.
Le roi se rappelait ce nom-là ; aussi recommença-t-il le manège qui lui avait réussi tout d’abord.
— Quoi ! vous êtes M. Levi Bell, l’éminent avocat dont mon pauvre frère se plaisait, dans ses lettres, à vanter l’éloquence et qu’il regrettait de ne pas voir siéger sur les bancs du Sénat ? Permettez-moi de vous serrer la main.
L’avocat parut flatté et pressa avec effusion la main qu’on lui tendait.
— Bell, s’écria le docteur, je vous croyais assez de bon sens pour ne pas vous laisser prendre à ces flagorneries ! Ce vieil intrigant a appris par Tim Collins les noms et les professions de la moitié des gens de la ville.
— C’est possible, répliqua M. Levi Bell ; mais il n’a pu apprendre de Tim que Pierre Wilks me reprochait d’être trop modeste pour me lancer dans la politique.
Là-dessus il se mit à causer à voix basse et d’un ton amical avec le roi.
— Oui, dit-il enfin, tout le monde admettra que la façon généreuse dont vous avez agi prouve que vous n’aviez aucun intérêt à faire disparaître les 6 000 dollars. Néanmoins, en votre qualité d’exécuteur testamentaire, vous auriez dû… Il faut retrouver ces nègres, et je me flatte que ce ne sera pas long, si je m’en mêle. M’autorisez-vous à prendre les mesures nécessaires ?
— Très volontiers, répliqua le roi, enchanté de trouver un défenseur.
— Eh bien, asseyez-vous là et donnez-moi une autorisation écrite qui me permettra au besoin de réclamer…
— Vos honoraires ? Oh ! rien de plus juste !
Et il s’empressa de tracer quelques lignes que lui dicta M. Bell.
— Vous voyez, reprit l’avocat, que cela ne vous engage à rien. Veuillez prier votre frère d’ajouter simplement : « Approuvé l’écriture ci-dessus », et de signer.

Le duc, qui avait tout entendu, ne semblait pas trop à son aise, mais il n’osa pas feindre de ne pas comprendre les signes de son frère. M. Bell s’empara de la feuille de papier, puis il dit, en s’adressant au second Harvey Wilks :
— Maintenant, je voudrais une ligne ou deux de votre écriture. Peut-être n’en faudra-t-il pas davantage pour nous éclairer.
— Donnez ! répondit d’un ton impatienté le vieux gentleman, qui prit la plume à son tour.
— Allons, c’est la bouteille à l’encre, s’écria l’avocat après avoir examiné des lettres qu’il venait de tirer de sa poche. Ces lettres portent le timbre de Sheffield, et tout le monde reconnaîtra au premier coup d’œil qu’elles ne viennent pas de ces messieurs-là (il désignait le roi et le duc qui, je vous en réponds, étaient dans leurs petits souliers). Je m’y attendais et j’espérais que le troisième autographe donnerait raison au nouveau venu ; mais non, son griffonnage illisible ne ressemble en rien à l’écriture de Harvey Wilks.
— L’explication est des plus simples, dit le vieux gentleman. Personne ne peut lire mon écriture, excepté mon frère William, et c’est lui qui a copié mes lettres.
— Voyons un peu, fit l’avocat. J’ai là des lettres de William Wilks. Priez donc votre frère d’écrire quelques lignes et nous verrons bien.
— Il ne peut pas écrire avec sa main gauche ; mais vous n’avez qu’à comparer ses lettres avec les miennes, l’écriture est la même.
— Le fait est qu’il y a une grande ressemblance, répliqua M. Bell après un court examen. N’importe, je ne tiens pas encore ma solution. Une seule chose est prouvée. Ceux qui m’ont remis cette autorisation sont des faussaires, et je leur conseille de ne pas chercher à s’évader, car ils n’en seraient pas quittes pour être logés pendant une année ou deux aux frais de l’État.
Le duc devint blême ; mais le roi fit bonne contenance.
— Ah ! monsieur, dit-il en levant les yeux au plafond, voilà des paroles que vous regretterez d’avoir prononcées. Puisse le ciel vous les pardonner comme je vous les pardonne !
— C’est trop d’hypocrisie ! s’écria le vieux gentleman qui se leva tout à coup. Vous auriez dû comprendre que, par charité, je voulais vous laisser l’occasion de vous repentir ailleurs qu’en prison. Ma patience est à bout… Y a-t-il ici quelqu’un qui ait aidé à ensevelir mon frère ?
— Oui, répliqua un ouvrier de la tannerie, il y a Ab Turner et moi. Alors le vieux monsieur se tourna vers le roi et lui dit :
— Puisque vous êtes le frère aîné de Pierre Wilks, vous savez sans doute quel genre de tatouage il portait sur la poitrine ?
Si vous vous figurez que le roi s’avoua battu, c’est que vous ne le connaissez pas. Je crois qu’il voulait simplement gagner du temps afin de profiter de la première éclaircie pour prendre ses jambes à son cou. Toujours est-il qu’après avoir pâli un peu, il ébaucha un sourire et répliqua effrontément :
— Oui, monsieur, je le sais. Mon frère, avant son départ pour l’Amérique, s’était tatoué une petite flèche sur la poitrine.
— Vous entendez ? dit le vieux gentleman à Ab Turner. Avez-vous vu cette flèche ?
Ab Turner et son camarade secouèrent la tête.
— Non, n’est-ce pas ? Mais vous avez dû voir les initiales de son nom, un P et un W ?
Les deux témoins déclarèrent qu’ils n’avaient pas remarqué la moindre initiale sur la poitrine du défunt. On commençait à se fâcher et à crier : « Ce sont tous des voleurs ! Ils ne valent pas mieux les uns que les autres ! Jetons-les à l’eau », lorsque l’avocat sauta sur la table.
— Messieurs, messieurs, dit-il de façon à se faire entendre au-dessus du vacarme, veuillez m’écouter un instant, s’il vous plaît. Il y a un moyen fort simple de tirer la chose au clair. Au cimetière !
— C’est cela ! hourra ! en avant !
— Pas si vite, mes amis, dit le docteur. Emmenons ces hommes.
— Oui, oui, et nous lyncherons toute la bande, s’il n’y a pas de tatouage.
— En attendant, contentez-vous de les surveiller de près, sans les maltraiter. Je me charge du gamin.
On se dirigea tout droit vers le cimetière, qui se trouvait à un mille de l’hôtel. Il était neuf heures du soir et le temps tournait à l’orage, ce qui n’empêcha pas la foule de grossir à mesure que nous avancions. Je tremblais dans ma peau. Évidemment, on verrait que le roi avait menti et je passerais pour son complice. Je n’aimais pas à songer à ces tatouages et pourtant je ne pouvais penser qu’à cela. Le ciel s’assombrissait, c’eût été un bon moment pour m’éclipser, si le docteur ne m’avait pas tenu par le poignet.
Arrivée dans le cimetière, la foule cessa un peu de crier. Quand on eut atteint la tombe de Pierre Wilks, on s’aperçut que l’on avait plus de pelles qu’il n’en fallait ; mais personne ne s’était avisé d’apporter une lanterne. Cependant on voyait assez clair pour creuser et on se mit à l’œuvre, tandis que Ab Turner courait chercher un falot.
Les fossoyeurs improvisés n’y allèrent point de main morte, car avant son retour ils avaient tiré le cercueil de la fosse, autour de laquelle les curieux se pressaient. Le docteur, craignant peut-être de me perdre dans la foule, restait un peu à l’écart, de sorte que, sans les exclamations que j’entendais, je n’aurais pas su ce qui se passait.
— Il nous faudrait un tourne-vis, dit quelqu’un.
— Bah ! répliqua un autre, un levier suffira et nous avons des pioches.
Un léger craquement m’apprit que l’on faisait sauter le couvercle du cercueil. Au même instant un formidable éclair illumina le ciel et l’avocat, dont je reconnus la voix, s’écria :
— En voici bien d’une autre ! On a enterré son sac d’or avec lui !
Alors ce fut une bousculade comme vous n’en avez jamais vu. Le docteur poussa à son tour un cri de surprise, me lâcha le poignet, et pendant qu’il cherchait à percer la foule, je profitai de l’occasion pour lui fausser compagnie. Deux minutes plus tard, j’étais hors du cimetière et je descendais au galop la colline qui conduisait à la ville. Il pleuvait maintenant et les éclairs se suivaient à de courts intervalles. Je ne m’en plaignis pas, car les rues étaient désertes. Je pus donc gagner sans encombre un canot que j’avais choisi d’avance, parce qu’il n’était retenu que par une corde, et aussi parce qu’il se trouvait juste en face de l’île où Jim devait fièrement s’ennuyer. Seulement les propriétaires de la barque avaient enlevé les rames, ils oubliaient qu’il y a souvent des gens pressés et leur oubli me fit perdre un bon quart d’heure. Lorsque j’arrivai enfin au radeau, Jim accourut vers moi, les bras ouverts.
— Pas maintenant, Jim, pas maintenant. Garde les embrassades pour demain. Nous sommes débarrassés du vieux caméléopard et de son ami ; mais si on me rattrapait, on serait capable de me traiter comme eux. Filons !
Bon gré, mal gré, je dus donner quelques explications au nègre avant de sortir le radeau de la petite anse où nous l’avions caché. Lorsque tout fut prêt pour le départ, j’entendis un bruit qui me coupa la respiration. Je prêtai l’oreille. Oui, c’était bien un bruit de rames. Le prochain éclair me montra le roi et le duc qui avaient aussi emprunté un canot, plus léger que le mien, et qui maniaient leurs avirons comme
s’ils n’avaient jamais fait autre chose de leur vie.
Les deux amis montèrent à bord. Le roi, qui était de très mauvaise humeur, s’en prit à moi ; il me saisit par le collet et me secoua rudement.
— Tu voulais partir sans nous ? s’écria-t-il. Notre société te déplaît, hein ?

— Non, non, Votre Majesté… Ne m’étranglez pas !
— Alors, pourquoi ces préparatifs ? Réponds sans hésiter ou je te tordrai le cou.
— Eh bien, laissez-moi au moins parler et vous saurez tout… Le monsieur qui me tenait par la main…
— Le docteur ? Ah ! si nous le tenions, lui !
— Il m’a dit qu’il a perdu l’année dernière un fils de mon âge et qu’il regrettait de me voir dans une si vilaine passe. Quand quelqu’un a crié qu’il y avait de l’or dans le cercueil et qu’on a couru pour voir, il m’a soufflé à l’oreille : « Sauve-toi, ou pour sûr on te pendra. » Dame, je n’ai pas eu envie de rester pour être pendu. Alors j’ai couru jusqu’à l’endroit où sont les canots, et en arrivant ici j’ai dit à Jim de se dépêcher, parce qu’on me prenait pour un voleur. Il a été joliment fâché d’apprendre que je vous croyais déjà pendu, et il a été aussi content que moi quand nous vous avons vu arriver. Demandez-lui.
— Oh ! je n’en doute pas, répliqua le roi, qui me secoua de nouveau et menaça de me jeter à l’eau.
— Lâchez donc ce garçon, vieil idiot, dit le duc. Auriez-vous agi autrement, vous ? Vous êtes-vous inquiété de ce qu’il était devenu avant de décamper ?
Le roi me lâcha ; puis il se mit à cribler d’injures la ville de Nantuck et tous ceux qui l’habitaient. Le duc l’interrompit encore.
— Il serait plus juste de vous adresser tous ces compliments à vous-même, dit-il. Vous n’avez rien fait, dès le début, qui ait le sens commun, sauf dans l’affaire du tatouage. Si vous n’aviez pas répondu sans hésiter, nous étions coffrés jusqu’à l’arrivée des bagages de maître Harvey, et alors, un an ou dix-huit mois de détention ! J’ai admiré votre crânerie ; mais, en somme, ce n’est pas là ce qui nous a sauvés. Si les badauds avaient été moins pressés de voir nos 6 000 dollars, nous porterions ce soir une cravate économique qui nous aurait dispensés d’en jamais acheter une autre.
— Hum ! dit le vieux, après une minute ou deux de réflexion. Et nous avons cru que les nègres avaient volé cet argent.
Pour le coup, j’eus peur.
— Oui, nous l’avons cru, répéta le duc d’un ton railleur.
— Ou plutôt j’ai été assez bête pour le croire, répliqua le roi sur le même ton.
— Au contraire, c’est moi qui ai donné dans le panneau.
— Bridgewater, à quoi bon nous disputer ? Vous m’avez joué là un vilain tour ; mais…
— Comment, vous osez m’accuser ?
— J’ai tort, n’est-ce pas ? Vous êtes peut-être somnambule et vous aurez mis le sac dans le cercueil sans vous douter de ce que vous faisiez.
— Je vous conseille de ne pas me pousser à bout. Me prenez-vous pour un imbécile ? Est-ce que je ne sais pas qui a caché les 6 000 dollars ?
— Oui, parbleu, vous devez le savoir, puisque c’est vous !
— Moi ? Voilà qui est trop fort ! s’écria le duc qui saisit son associé par la gorge.

— Vous m’étouffez… Lâchez donc !
— Pas avant que vous vous soyez rétracté.
— Je me rétracte… Ouf !
— Cela ne suffit pas. Avouez que vous avez caché le sac avec l’intention de me planter là après l’avoir déterré.
— Franchement, je pensais que c’était vous. Si je me suis trompé, dites-le et n’en parlons plus.
— Non, ce n’est pas moi, et vous le savez mieux que personne !
— Je vous crois, là ! Ne me serrez pas tant, et répondez à une autre question, sans vous fâcher. N’avez-vous pas songé à empocher cet argent ?
— Que j’y aie songé ou non, peu importe. Vous y avez non seulement songé, vous avez soustrait le magot.
— Je veux être pendu si j’y ai touché depuis le soir où nous l’avons fourré dans ma paillasse. L’idée m’est venue de tirer la couverture à moi, j’en conviens ; mais vous… je veux dire que quelqu’un m’a devancé.
— Vous mentez ! s’écria Bridgewater qui empoigna de nouveau son associé par la gorge. Avouez que vous vouliez me voler ou bien…
— Assez, assez ! dit le roi d’une voix haletante. J’avoue !
Cet aveu me mit à mon aise, car j’avais craint de me trouver mêlé à la dispute. Le duc, quoique sa colère ne fût pas encore calmée, laissa respirer le roi.
— Pleurnichez tant que vous voudrez, dit-il ; mais ne vous avisez plus de nier, ou je vous enverrai jouer la comédie dans l’autre monde. Quand je pense que je m’y suis laissé prendre, lorsque vous avez feint de soupçonner les pauvres nègres ! Je vois maintenant pourquoi vous teniez tant à combler le déficit et pourquoi vous m’avez proposé de tout donner à nos chères nièces.
— Pardon, pardon, répliqua le roi, ce n’est pas moi qui ai eu l’idée de leur céder notre part des 6 000 dollars, c’est vous.
— Et je ne vous ai peut-être pas conseillé de filer avec, hein ? Mais non ; vous étiez trop goulu ! Vous voyez ce que cela nous rapporte. Ces petites bécasses empochent leur argent et le nôtre par-dessus le marché, car il nous reste à peine quelques dollars. Allez vous coucher et ne me parlez plus de déficit tant que vous vivrez.
Le roi, qui reconnaissait trop tard ses torts, n’osa pas souffler mot ; il se glissa dans le wigwam où il chercha des consolations dans une cruche de whisky. Le duc ne tarda pas à suivre ce bon exemple. Au bout d’une heure, ils étaient redevenus les meilleurs amis du monde et s’entendaient comme larrons en foire. J’espérais qu’ils finiraient par s’endormir à force de se consoler et alors j’aurais essayé de décider Jim à les déposer doucement dans l’île. Par malheur, il n’en fut rien,
de sorte que nous dûmes nous remettre en route avec eux.
Pendant quelques jours, comme les deux associés n’osaient pas se montrer trop près de Nantuck, nous filâmes le long du fleuve. Lorsqu’ils se crurent hors de danger, ils visitèrent plusieurs petites villes. Ils m’emmenaient avec eux, parce que les gens qui se font suivre d’un domestique inspirent toujours de la confiance. Ce n’était là qu’un prétexte, je crois. Ils devinaient sans doute que je n’aurais rien de plus pressé que de disparaître avec le radeau dès que le champ serait libre.
En dépit de leur air respectable, rien ne leur réussit. Un beau sermon sur la tempérance ne leur rapporta pas de quoi se griser tous les deux. Une conférence sur la phrénologie n’attira qu’une dizaine d’auditeurs. Le roi offrit en vain sa poudre dentifrice, le duc ne trouva aucun chaland pour ses pilules brevetées, et nos provisions s’épuisaient. Le poisson abondait ; seulement Jim s’arrangeait de façon à n’en jamais découvrir au bout de nos lignes.
— Lorsqu’il n’y aura plus rien à manger ici, me dit-il, ils déguerpiront, et bon débarras !
En effet, ils paraissaient déjà découragés. Après avoir rôdé inutilement dans une demi-douzaine de petites villes, ils passèrent leur temps à rêvasser et à regarder couler l’eau, sans échanger une parole. Mais ils n’étaient pas au bout de leur rouleau. Un jour, le roi, qui se tenait assis à l’entrée du wigwam, finit par se lever pour aller rejoindre son associé, et ils se mirent à causer à voix basse. Cela m’inquiéta un peu, parce qu’ils ne se gênaient guère en général pour s’expliquer devant moi. J’eus beau prêter l’oreille, je n’entendis pas un mot de leur entretien.
Le lendemain matin, nous étions à environ deux milles d’une petite ville nommée Pikesburgh, quand le roi m’ordonna de gagner la côte et d’amarrer le radeau.
— Je vais débarquer seul, me dit-il au moment où je m’apprêtais à sauter à terre. Si je ne suis pas de retour à midi, Bridgewater doit venir me rejoindre et vous l’accompagnerez.
Je restai donc sur le radeau. À midi, le roi ne s’était pas montré et le duc m’emmena, laissant Jim dans le wigwam. Je n’osai pas refuser de partir avec lui ; mais cette fois j’étais décidé à retirer mon épingle du jeu et à battre en retraite dès qu’on n’aurait plus l’œil sur moi. À mi-chemin, nous rencontrâmes des gens qui venaient de la ville et avec lesquels mon compagnon, contre son habitude, évita de lier conversation.
Arrivés à Pikesburgh, nous cherchâmes en vain le roi. Nous finîmes par le trouver dans une buvette, entouré d’une foule de badauds qui se moquaient de lui. Il était trop ivre pour tenir sur ses jambes et ses menaces ne servaient qu’à mettre les rieurs en verve. Le duc, bouffi de rage, éclata en injures et son associé lui lança à la figure un paquet de cartes. Quand la querelle fut bien engagée, je gagnai la porte sans me presser et une fois dehors je partis comme un trait. Bien que je fusse tout essoufflé, je criai d’une voix joyeuse en sautant à bord du radeau :
— Ohé, Jim, nous sommes sauvés !
Pas de réponse. Le wigwam était vide. Je parcourus le petit bois en face duquel nous étions amarrés, pensant que Jim, pour un motif ou un autre, avait jugé bon de s’y cacher. J’eus beau lancer de nouveaux cris d’appel, mon vieux Jim avait disparu. Alors je m’assis sur l’herbe et je pleurai. Je me relevai bientôt, ne sachant que penser de cette disparition ni à quoi me résoudre. Je venais de déboucher sur la route, quand je vis arriver un garçon de mon âge qui s’avançait les mains dans les poches. Je lui demandai s’il n’avait pas rencontré un nègre habillé de telle et telle façon.
Mon père disait toujours qu’il ne faut pas avoir l’air trop pressé quand on a besoin d’un renseignement, parce qu’on vous le fera payer. Il avait raison, car on répondit à ma question par cette autre question : « Pouvez-vous me donner de quoi bourrer ma pipe ? » et ce ne fut qu’après avoir empoché une poignée de tabac que mon interlocuteur reprit :
— Le nègre évadé ? Oui, je l’ai vu. On l’emmenait chez Silas Phelps, à 2 milles plus bas. Bonne affaire ! 200 dollars de récompense, ça ne se trouve pas tous les jours.
— Et c’est moi qui l’ai vu le premier ! Qui donc l’a fait empoigner ?

— Il paraît que c’est un vieux monsieur à barbe blanche. Il n’avait pas le temps d’aller à la Nouvelle-Orléans et il a vendu sa chance 40 dollars. À sa place, moi, j’aurais trouvé le temps d’aller toucher la récompense entière.
— Peut-être sa chance ne vaut-elle pas un cent, puisqu’il l’a cédée pour si peu.
— Allons donc ! J’ai lu l’affiche. C’est imprimé en lettres longues comme ça. Récompense de 200 dollars, avec le signalement du nègre, le nom de la plantation et le reste.
Il s’éloigna en sifflant. Je regagnai le radeau et je me glissai dans le wigwam afin de réfléchir. Mes réflexions ne furent pas gaies. Non, je n’aurais pas cru ces deux gredins capables de nous jouer un pareil tour après tout ce que nous avions fait pour eux. Je pouvais me vanter d’avoir rendu un mauvais service à ce pauvre Jim. S’il devait rester esclave, il aurait été cent fois plus heureux à Saint-Pétersbourg, où personne ne le maltraitait. Ma première idée fut d’écrire à miss Watson afin qu’elle le réclamât. Deux raisons me retinrent. Elle ignorait pourquoi il s’était sauvé ; elle lui reprocherait son ingratitude et serait plus disposée que jamais à le vendre. Et puis, je songeai à moi. On saurait que Huck Finn avait aidé un nègre à prendre la clef des champs, et si, un jour ou l’autre, je regagnais ma ville natale, je n’oserais plus regarder les gens en face. Tom Sawyer lui-même refuserait de me serrer la main.
Plus j’y songeais, plus ma conscience m’adressait des reproches et plus je me sentais coupable. D’un autre côté, je pensai à ce long voyage durant lequel Jim avait si souvent tenu le gouvernail à ma place plutôt que de me réveiller. Je le voyais sautant de joie le matin où nous avions failli nous perdre dans le brouillard. Je me rappelai le soir où mes remords m’avaient presque décidé à le livrer et où je l’avais sauvé en empêchant les deux poltrons qui craignaient la petite vérole de visiter le radeau. Je ne pouvais pas oublier qu’il m’avait dit que j’étais le seul ami qu’il eût au monde.
Je me sentais toujours honteux d’être l’ami d’un nègre — néanmoins je résolus de ne pas abandonner Jim. Je savais qu’on l’avait emmené chez M. Silas Phelps, à 2 milles plus bas. Dès que le jour commença à baisser, je détachai mon radeau et je gagnai une île boisée où je passai la nuit. Je me levai de grand matin ; puis, après avoir déjeuné, je mis mes meilleurs habits, je fis un paquet de mes vieux vêtements, je sautai dans le canot et je suivis le courant, m’arrêtant à un quart de mille d’un endroit où j’avais aperçu une petite scierie à vapeur. Alors je cachai ma barque et je remontai la côte à pied. Je n’avais pas fait fausse route et je ne regrettai pas la poignée de tabac qui m’avait mis sur la bonne voie. En passant devant l’usine dont j’ai parlé, je vis une enseigne qui m’apprit que c’était la Scierie de Silas Phelps. Rien n’y bougeait et on ne pouvait la prendre pour une maison d’habitation. À deux ou trois cents yards plus loin, je rencontrai une espèce de ferme ; mais personne ne se montrait, bien qu’il fût déjà jour. Je me dirigeai donc vers la ville afin de sonder un peu le terrain. Cette ferme n’appartenait peut-être pas au propriétaire de la scierie et je ne voulais pas être surpris rôdant autour des bâtiments.
Eh bien, devinez sur qui je tombai en tournant le premier coin de rue ? Sur le duc ! Il était en train de coller une affiche qui annonçait au public que le célèbre Kean donnerait le soir même et les deux soirs suivants une représentation du Caméléopard ! Il sembla d’abord très étonné, puis très satisfait de me retrouver.
— Je te croyais déjà loin, dit-il. Où est le radeau ? L’as-tu caché dans un bon endroit ?
— C’est justement ce que j’allais vous demander, répliquai-je d’un ton de mauvaise humeur.
Alors il sembla moins content.
— À moi ! s’écria-t-il.
— À qui voulez-vous que je le demande ? Hier, lorsque j’ai vu le roi dans ce cabaret, je me suis dit : Le duc ne pourra pas l’emmener de sitôt. Alors, pour passer le temps, je me suis mis à flâner. Un homme m’a offert 40 cents pour l’aider à emballer du coton. Naturellement, j’ai accepté. Après, je suis allé me reposer dans le petit bois en vous attendant. Jim devait m’appeler à votre retour. Le sommeil m’a pris et quand je me suis réveillé, plus de Jim, plus de radeau ! Qu’est devenu Jim ? Qu’est devenu le radeau ?
— Je n’en sais rien, du moins pour ce qui concerne le radeau. Ce vieil ivrogne a fait là-haut un marché qui a rapporté 40 dollars, et à mon arrivée, il les avait déjà reperdus au jeu. Lorsque j’ai pu le reconduire jusqu’à l’endroit où devait se trouver le radeau, nous nous sommes dit : Ce petit drôle nous l’a volé et nous a plantés là.
— Est-ce que j’aurais planté là mon nègre, le seul nègre que je possède au monde ?
— En somme, tu n’y as rien perdu ; sans papiers, tu ne serais jamais parvenu à le vendre. Le fait est que nous avions fini par le regarder comme notre propriété. Me voilà bien récompensé de la peine que je me suis donnée pour lui… Bah ! il y a des badauds partout et le caméléopard les attirera encore. N’importe, je n’aurais pas été fâché d’avoir le radeau à ma disposition. Ton nègre pourrait jaser.
— Comment voulez-vous qu’il jase ? Il ne s’est donc pas sauvé ?
Je me doutais bien qu’il s’était entendu avec le roi pour vendre Jim ; mais je tenais à le mettre au pied du mur. Si je l’amenais à m’avouer que Jim était sous clef dans la ville où il comptait passer trois jours, ma présence le gênerait beaucoup plus que celle du nègre et il se résignerait peut-être à donner ses représentations ailleurs.
— Eh ! non, il ne s’est pas sauvé, répliqua-t-il. Je croyais que tu avais tout compris. Nous l’avons cédé, ou plutôt nous avons cédé pour 40 dollars nos droits à la récompense. Tu aurais eu ta part, si…
— Vous l’avez cédé ! m’écriai-je. Mais Jim était à moi ! Où est-il ?
Et je me mis à sangloter. Ainsi que j’y comptais, le duc parut très ennuyé. Les regards qu’il lançait à droite et à gauche me rassuraient. C’est lui maintenant qui désirait me lâcher. Il n’avait plus besoin de moi — il croyait mes poches vides, le radeau disparu, et j’en savais trop sur son compte.
— Je veux mon nègre ! Où est-il ? répétai-je en frappant du pied.
— Mille tonnerres ! prends garde à toi, ou je…
Mais, après avoir froncé les sourcils et levé son pinceau à colle d’un air menaçant, il se décida à me prendre par la douceur.
— Mon pauvre garçon, reprit-il au bout d’une minute, je suis aussi fâché que toi de la façon dont la chose a tourné. Tout ce que je puis te dire, c’est que Jim a été emmené par un planteur du nom de Foster… Abraham G. Foster… dont la ferme se trouve à une trentaine de milles plus haut sur la route de La Fayette, celle que tu as dû suivre pour venir ici. Je ne vois pas ce que tu gagneras à courir après lui. Dans trois jours nous serons à flot et tu ferais mieux de ne pas nous quitter.
— Non, je veux mon Jim !
— Allons, je n’ai pas le droit de t’obliger à rester ; je n’y tiens pas non plus : il me faudrait te surveiller pour t’empêcher de bavarder. À présent que tu sais ce que tu voulais savoir, file sans perdre de temps. Ils ont de l’avance sur toi ; mais tu as de bonnes jambes et tu les rejoindras sans doute avant d’arriver à La Fayette.
Oui, j’en savais assez. Il cherchait à m’éloigner de la ville, parce que Jim y était et que M. Silas Phelps aurait pu apprendre trop tôt à qui il avait eu affaire.

— Bon, dis-je, je partirai dans une heure ou deux, après avoir déjeuné.
— Tu partiras tout de suite, et je vais te montrer le chemin, repliqua-t-il en contenant sa colère, mais d’un ton qui me rappela le jour où il avait menacé de m’étrangler.
Cela m’amusait de lui donner du tintouin tout en le forçant de faire ce que je voulais ; mais il avait dans le regard quelque chose qui me conseillait de ne pas aller trop loin. Aussi me décidai-je à l’accompagner et je vis qu’il avait déjà posé un certain nombre d’affiches. Il n’en fallut pas davantage pour me convaincre qu’il ne serait pas disposé à me céder la place.
— Tu étais bien pressé tout à l’heure de courir après Jim. Pourquoi as-tu changé d’avis ? me demanda-t-il, tandis que nous gagnions la grande route. Encore une fois, tu ferais mieux de rester avec nous.
— Merci, je préfère m’en aller. Je n’ai pas envie d’être pendu.
— Bon voyage ! dit-il. Je t’engage — dans ton propre intérêt, tu entends ? — à garder ta langue dans ta poche au sujet de l’affaire de Nantuck, et surtout au sujet du caméléopard. Tu me le promets ?
— Je le jure, si vous voulez ; je n’ai pas non plus envie d’être étranglé.
— Bien, ta parole me suffit, puisque tu sais qu’une indiscrétion te coûterait cher. Un dernier conseil. Retourne chez toi. J’ai bien deviné que tu fais l’école buissonnière et que tu as aidé Jim à s’évader. Tu joues là un jeu dangereux qui ne te rapportera rien.
— C’est possible ; mais Jim est mon ami et je l’aiderai si je le puis.
— Allons, bonne chance ! Tu es un brave garçon, donne-moi la main et adieu.
— Jamais de la vie ! répliquai-je.
Me voilà donc parti. Je ne regardai pas en arrière ; mais je sentais que le duc me suivait des yeux. Comme je ne songeais nullement à me mettre à la recherche de M. Abraham G. Foster, je m’arrêtai à la première pierre milliaire, puis je retournai sur mes pas à travers bois pour
regagner la ferme de Silas Phelps.
Quand j’arrivai à la ferme, tout semblait encore aussi tranquille que si c’eût été un dimanche. La chaleur retenait sans doute les maîtres chez eux et les travailleurs devaient être aux champs.
La propriété qui avoisinait la scierie de Silas Phelps était une de ces petites plantations de coton comme on en rencontre tant dans le pays. Les bâtiments n’occupaient qu’une partie d’une cour de deux arpents, fermée par une palissade et plaquée par endroits de touffes d’herbe ; pour les blancs, une vaste maison construite avec des bûches équarries à coups de hache et blanchies à la chaux ; une cuisine en forme de rotonde communiquant avec la maison par un large passage couvert ; derrière la cuisine, une buanderie ; des cabanes alignées servant d’habitation aux nègres ; une petite hutte isolée au fond de la cour ; sur un banc, à l’entrée de la cuisine, un chien qui faisait la sieste ; d’autres chiens endormis çà et là au soleil ; dans un coin, trois ou quatre arbres et quelques groseilliers le long de la palissade ; en dehors de la clôture, le jardin et les champs de cotonniers, puis venaient les bois.
J’entrai dans l’enclos en escaladant la barrière qui donnait sur le jardin et je me dirigeai en droite ligne vers la cuisine. Pour commencer, je voulais m’assurer si j’étais bien chez M. Silas Phelps.
J’avais eu tort d’oublier que les chiens ne dorment que d’un œil. À mon approche, ils se levèrent l’un après l’autre et vinrent à ma rencontre. Naturellement, je m’arrêtai et je me tins coi. Ah ! quel vacarme ! En un quart de minute, je ressemblais au moyeu d’une roue dont une quinzaine de chiens représentaient les rayons. Ils aboyaient à qui mieux mieux, allongeant le cou et le museau. Et il en arrivait d’autres !
Par bonheur, une négresse sortit à temps de la cuisine, un rouleau de pâtissier à la main.
— Veux-tu te taire, Tige ! Veux-tu te sauver, Spot !
Aussitôt toute la meute détala. Une minute après, elle revint, remuant la queue et prête à me lécher les mains. Au même instant, une dame de quarante à quarante-cinq ans se montra sur le seuil de la maison, suivie de deux enfants qui se cachaient derrière ses jupes et me regardaient d’un air intimidé.
— Que signifie ce tapage ? demanda la dame.
Mais, dès qu’elle me vit, son visage s’épanouit et elle accourut en s’écriant :
— C’est donc toi, enfin !
— Oui, madame, c’est moi, répliquai-je machinalement.
Alors la voilà qui me prend dans ses bras et me serre à m’étouffer. Quand elle eut fini de m’embrasser, elle me lâcha et s’éloigna un peu pour me mieux regarder.
— Tu ne ressembles pas trop à ta mère, dit-elle après m’avoir dévisagé. N’importe, je suis bien heureuse de te revoir. Mes enfants, c’est votre cousin Tom, dites-lui bonjour.
Les enfants, au lieu de me souhaiter la bienvenue, se fourrèrent un doigt dans la bouche et se firent un rempart de la robe de leur maman.
— Lise, continua celle-ci, dépêchez-vous de lui apprêter un déjeuner chaud. Il doit avoir faim, s’il n’a pas déjeuné à bord.
— Ce n’est pas la peine, dis-je, j’ai déjeuné.
Là-dessus, elle m’emmena dans la maison, tandis que les enfants s’accrochaient à ses jupes. Lorsque nous fûmes dans le parloir, elle m’installa sur un fauteuil et s’assit en face de moi sur un tabouret, me tenant par les deux mains.
— Là, que je te regarde à mon aise ! Je crois que je te mangerais, tant je suis heureuse de te revoir. Nous t’attendons depuis trois jours. Qu’est-ce qui t’a retardé ? Le steamer a donc échoué ?
— Oui, madame.
— Ne m’appelle pas madame ; appelle-moi tante Sally. Où a-t-il échoué ?
Je ne savais que répondre, parce que je ne pouvais pas deviner si mon steamer descendait ou remontait le fleuve ; mais il me vint une bonne idée.
— Ce n’est pas l’échouage qui nous aurait beaucoup retardés, si le cylindre n’avait pas éclaté.
— Bonté du ciel ! pas de blessés, j’espère ?
— Non ; il y a seulement eu un nègre tué.
— C’est heureux, car ces accidents-là estropient souvent beaucoup de monde. L’année dernière, ton oncle Silas revenait de la Nouvelle-Orléans ; une chaudière, un cylindre, ou quelque chose, a sauté et on n’en a pas été quitte à si bon compte. À propos, ton oncle est parti pour la ville, il n’y a pas une heure, espérant te ramener, et il ne peut tarder à rentrer. Tu as dû le croiser en route.
— Je n’ai rencontré personne, tante Sally. Il faisait à peine jour quand j’ai débarqué. On m’a indiqué mon chemin ; mais, comme tout le monde avait l’air de dormir par ici, j’ai un peu flâné.
— À qui as-tu remis tes bagages ?
— Mes bagages ?… Oh ! je sais où les retrouver, et, d’ailleurs, il n’y aura pas grand’chose de perdu.
— Comment as-tu fait pour déjeuner de si bonne heure à bord ?
— Il me restait des provisions.
Je devenais si inquiet que j’écoutais à peine Mme Phelps. Les enfants étaient toujours là. Ils commençaient à s’habituer à moi, et, si j’avais pu les prendre à part, j’aurais bien vite découvert qui j’étais. Mais ma tante n’en finissait pas. J’eus froid dans le dos lorsqu’elle s’écria :
— Voyons, c’est à ton tour de parler. Tu vas me donner des nouvelles de tout le monde. Comment vont-ils ? Que font-ils ? Quelles commissions t’a-t-on données pour la tante Sally ? Tâche de ne rien oublier.
Pour le coup, j’étais embourbé jusqu’au menton. Je ne voyais aucun moyen de me tirer d’affaire sans lui avouer qu’elle se trompait. Ce fut tante Sally elle-même qui me ferma la bouche.

— Voilà ton oncle qui revient, dit-elle en me poussant dans un coin. Reste derrière ce fauteuil et ne bouge pas. Nous allons lui faire une surprise… Vous, mes enfants, n’ouvrez pas la bouche.
Tout en me demandant ce que je gagnerais à me cacher, j’obéis. Avant de disparaître, j’entrevis la tête d’un vieux monsieur qui s’avançait en maugréant.
— Ouf ! encore une course que j’aurais pu m’épargner, dit-il.
— Il n’est pas arrivé ? demanda Mme Phelps.
— Non, puisque je ne le ramène pas. J’avoue que cela commence à m’inquiéter.
— Quelque chose me dit qu’il est arrivé. Tu es bien sûr ?
— Je suis sûr que personne n’a débarqué depuis hier.
— Et il y a tant d’accidents ! Que dira ma sœur ? Je n’ose pas y penser… Mais regarde donc, Silas, là-bas, au tournant de la route. C’est peut-être lui.
M. Phelps se pencha en dehors de la croisée, ce qui permit à mon hôtesse de préparer sa surprise. Elle me tira de ma cachette, et, lorsque son mari se retourna, elle se tenait à côté de moi, le visage rayonnant. L’oncle Silas n’était pas fort, car il ne comprit pas tout de suite qu’on lui jouait un tour.
— Tiens ! d’où sort ce garçon-là ? demanda-t-il.
— Tu ne devines pas ? C’est lui ; c’est Tom Sawyer !
Je crus que le parquet allait s’écrouler sous mes pieds ; mais je ne tardai pas à me remettre. Le vieux monsieur me prodigua des poignées de main et des paroles affectueuses ; puis il fallut répondre à une véritable averse de questions à propos de tante Polly, de Marie, de Sid et de toute la tribu des Sawyer.
Si mes hôtes se réjouissaient de me voir, je ne me réjouissais pas moins d’avoir enfin appris qui j’étais. Je leur eus bientôt fourni sur ma famille — c’est-à-dire sur la famille de Tom — beaucoup plus de renseignements que tous les Sawyer du monde n’auraient pu leur en donner. Cela marchait comme sur des roulettes. Rien de plus facile que de remplir le rôle que l’on m’assignait. Aussi me sentis-je à mon aise jusqu’au moment où j’entendis le bruit d’un vapeur qui descendait le fleuve en toussant. Si ce steamer avait déposé au débarcadère de la ville celui qu’on attendait ? Si Tom allait se montrer et me nommer ? Cela gâterait tout. D’un autre côté, quel prétexte employer pour me poster sur la route afin d’arrêter Tom au passage ?
M. Phelps me vint de nouveau en aide.
— Encore un vapeur, dit-il. Heureusement, je n’ai plus besoin de remonter dans ma carriole, je vais la faire dételer.
Je saisis la balle au bond.
— Puisqu’elle est encore attelée, laissez-moi m’en servir pour aller chercher mes effets à la ville. Le paquet n’est pas lourd, mais je suis un peu las.
Il voulut m’accompagner.
— Non, non, lui dis-je, vous vous êtes déjà trop dérangé pour moi.
Soyez tranquille, je sais conduire.
Je partis donc dans la carriole de M. Phelps. Arrivé à mi-chemin de la ville, je me félicitai d’avoir si bien pris mes précautions. Clic, clac ! j’entendis venir une voiture de louage conduite par un nègre, et à côté du cocher, j’aperçus Tom Sawyer. Je m’arrêtai jusqu’à ce qu’ils m’eussent rejoint, puis je criai :
— Halte-là !
Le nègre retint son attelage et Tom demeura bouche bée.
— Pas possible ! C’est toi, Huck ? Les bras m’en tombent !
— Tu vois bien que c’est moi.
— Ah ! tu peux te vanter de m’avoir fait peur. On te croyait mort. Tu n’as donc pas été noyé ? Comment te trouves-tu ici ?
— Je t’expliquerai ça plus tard. Pour le quart d’heure, nous avons d’autres chats à fouetter. Si j’avais quelqu’un pour tenir mes rênes, je serais déjà près de toi. Dis à ton cocher de t’attendre une minute et grimpe dans ma carriole.
Dès qu’il fut monté, dès que nous eûmes échangé une cordiale poignée de main, je m’éloignai un peu de l’autre voiture, et sans lui donner le temps de m’interroger, je lui racontai l’erreur de tante Sally.
— La bonne histoire ! s’écria-t-il. Je l’aime mieux que celle de ta noyade. Comment as-tu pu nous laisser croire à ta mort ?
— Pour le moment il ne s’agit pas de ma noyade, répliquai-je. Allons au plus pressé. Pour ma part, je ne trouve pas ma position si drôle ; ton arrivée me met dans un fier embarras.
— Bah ! lorsque tante Sally apprendra que tu es mon ami, elle t’ouvrira encore les bras.
— Je n’en suis pas trop sûr. Elle se fâchera quand elle verra un second Tom lui tomber des nues.
— Eh bien, non, dit Tom, après avoir réfléchi. J’ai une idée ; elle ne se fâchera pas. Sois sans inquiétude. Prends mon sac de voyage dans ta voiture et retourne à la ferme sans te presser, de façon à paraître revenir de la ville. J’arriverai un quart d’heure ou une demi-heure après toi et je me charge du reste. Ce sera drôle, tu verras. Seulement, il ne faudra pas avoir l’air de me connaître tout d’abord.
— Bon, je m’en rapporte à toi… Attends un peu, j’ai un secret à te confier. Il y a là-bas un nègre que je cherche à faire évader — Jim, le nègre de miss Watson.
— Jim ? répéta Tom. Tu n’as pas besoin de t’occuper de lui. Il a eu plus de chance qu’il n’en mérite ; sa maîtresse…
— Je devine ce que tu vas me dire, et je me le suis déjà dit, interrompis-je. Un blanc devrait rougir d’être l’ami d’un nègre ; mais moi, je n’en rougis pas. Jim est prisonnier chez ton oncle — je ne sais pas encore où, par exemple — et je veux le délivrer. Tu me garderas le secret ?
— Certainement, je te garderai le secret, et je t’aiderai par-dessus le marché.
Je tombai de mon haut.
— Tu plaisantes, lui dis-je. Tu passeras aussi pour un abolitionniste.
— Peu importe. On ne trouve pas tous les jours un prisonnier à délivrer.
Tom mit son sac dans ma carriole et avança au pas, tandis que je me dirigeais vers la ferme. J’étais si content que j’oubliai de lambiner en route, de sorte que j’arrivai à la maison plus tôt qu’il n’aurait fallu. Justement M. Phelps se tenait sur le pas de la porte ; il se frotta les yeux en m’apercevant.
— C’est étonnant ! s’écria-t-il. Qui aurait jamais cru cette jument capable de faire le trajet en si peu de temps ? Et pas un poil mouillé. Oui, c’est étonnant. Je ne la donnerais pas pour 100 dollars, et hier je l’aurais volontiers cédée pour la moitié de cette somme.
Au bout d’une demi-heure, la voiture de Tom s’arrêta devant la palissade, à une cinquantaine de yards de la maison. Tante Sally, qui l’entendit arriver, regarda par la fenêtre.
— Une visite ? dit-elle. Qui donc cela peut-il être ? Un étranger… Johnny, va dire à Lise de mettre un couvert de plus.
Les étrangers étaient rares dans ces parages : aussi tout le monde courut-il à la porte d’entrée. Tom avait déjà dépassé la barrière de l’enclos ; il s’avançait à pas comptés, et sa voiture s’éloignait au grand trot. Il semblait assez fier de ses habits neufs et portait le nez au vent. Arrivé à quelques pas de nous, il souleva son chapeau comme si c’eût été le couvercle d’une boîte contenant des papillons dont il ne voulait pas troubler le sommeil.
— Monsieur Archibald Nichols, je présume ? dit-il.
— Non, mon garçon, répliqua M. Phelps. Votre cocher s’est trompé. Nichols demeure à trois milles plus bas. Mais entrez vous reposer.
Tom regarda par-dessus son épaule.
— Trop tard, dit-il : la voiture est hors de vue.
— Raison de plus pour entrer. Vous dînerez avec nous et je me charge de vous conduire chez Nichols.
— Oh ! je serais désolé de vous donner tant de peine. J’achèverai bien la route à pied.
— Nous ne le souffrirons pas ; la vieille hospitalité du Sud s’y oppose.
— Entrez, répéta tante Sally. Vous ne pouvez pas refuser, car votre couvert est déjà mis.
Tom la remercia par un beau salut et se laissa persuader. Une fois dans le parloir, il se campa dans le meilleur fauteuil avant qu’on l’eût invité à s’asseoir ; puis il raconta, sans attendre qu’on l’interrogeât, qu’il s’appelait William Thompson et qu’il venait d’une grande ville dont j’oublie le nom, mais sur laquelle il débita un tas d’histoires. Il allait, il allait, et je commençais à me demander si c’était avec ces histoires-là qu’il espérait me tirer d’affaire. Tout à coup, il se pencha vers tante Sally, qui s’était assise à côté de lui, l’embrassa sur les deux joues, se rejeta tranquillement au fond de son fauteuil et se remit à jacasser.
— Où avez-vous appris ces manières-là ? s’écria tante Sally, d’un ton indigné.
— Comment, je vous ai fâchée ? Ah ! si c’est là votre vieille hospitalité du Sud, je m’en vais, répliqua Tom.
— En vérité, je crois que ce gamin est toqué, dit Mme Phelps.

— Non, je ne suis pas toqué, riposta Tom d’un air froissé. Soyez tranquille, je ne recommencerai pas… du moins jusqu’à ce que vous me l’ayez demandé. Je vous ai embrassée de bon cœur, parce qu’on m’avait dit là-bas : Embrasse-la bien fort, ça lui fera plaisir.
— Quel est le sot qui vous a dit ça ?
— Tout le monde me l’a dit, et il me semble que tout le monde l’aurait cru, répondit Tom. Voyons, ajouta-t-il en s’adressant à M. Phelps, est-ce que vous ne pensiez pas qu’elle serait enchantée de voir Sid ?
— Sid ! s’écria tante Sally. Ah ! mauvais garnement ! est-il permis de se moquer ainsi du monde !
Et elle s’avançait pour l’embrasser, quand Tom la repoussa.
— Non, dit-il, je ne vous embrasserai pas avant que vous me l’ayez demandé.
Elle l’embrassa tout de même, puis elle le passa à M. Phelps, qui ne ménagea pas les poignées de main. La première surprise passée, elle entama le chapitre des explications.
— Nous n’attendions que Tom, dit-elle ; ma sœur n’a pas soufflé mot de ta visite.
— C’est que Tom seul devait venir ; mais au dernier moment je l’ai tant priée qu’elle m’a laissé partir avec lui. Ce matin, pendant que nous descendions le fleuve, Tom a pensé que ce serait une bonne plaisanterie d’arriver tout seul et de feindre de ne pas me connaître. Nous avons eu tort, car vous ne recevez pas trop bien les étrangers, tante Sally.
— Pas quand ils se donnent des airs comme tu le faisais tout à l’heure, Sid. Vrai, là, j’avais envie de te souffleter. N’importe, je te pardonne ; embrasse-moi encore.
Nous dînâmes dans le grand passage couvert, entre la maison et la cuisine. On se nourrit bien dans le Sud. Il y avait sur la table de quoi rassasier sept familles — un tas de bons plats chauds, auxquels Tom et moi fîmes honneur, je vous en réponds. Ce fut l’oncle Silas qui récita le bénédicité ; mais rien n’eut le temps de se refroidir, ainsi que cela arrivait souvent chez la veuve Douglas.
Je me sentais à mon aise et l’après-midi se passa fort gaiement. Nous ouvrîmes en vain l’oreille ; il ne fut pas question de Jim et nous n’osions pas essayer d’amener la conversation sur ce terrain. Dans ma joie de retrouver Tom, j’avais presque oublié le caméléopard. Vers la fin du souper, un de nos petits cousins, avec qui nous avions vite lié connaissance, se chargea de me le rappeler.
— Papa, demanda-t-il, ne me laisseras-tu pas aller voir, avec Tom et Sid, le spectacle dont tout le monde parle ?
— Non, répondit M. Phelps d’un ton qui n’admettait pas de réplique.

C’est un attrape-nigauds et je suis tenté de plaindre ceux qui l’ont organisé, car on menace de les jeter à l’eau. Burton les a reconnus et, pour peu que la moitié de ce qu’il a raconté soit vraie, ils n’auront que ce qu’ils méritent, si on se contente de les chasser de la ville à coups de trique.
Ma conscience ne m’adressait aucun reproche. J’avais tenu ma promesse de ne pas les dénoncer. Toutefois, j’étais trop curieux pour ne pas désirer savoir comment ils s’en tireraient. Aussi, dès que le souper fut terminé, me déclarai-je très fatigué, afin que tante Sally m’engageât à aller me reposer. Tom et moi, nous devions coucher dans la même chambre. Au lieu de me déshabiller, je mis Tom au courant et nous sortîmes par la croisée, en nous glissant le long du conducteur du paratonnerre. Tandis que nous gagnions la ville, je racontai à Tom les dangers que j’avais courus pendant mon voyage. Loin de me plaindre, il répétait sans cesse : « Ah ! comme je regrette de n’avoir pas été de la partie ! »
Il était près de huit heures et demie lorsque nous atteignîmes l’entrée de la ville. À peine avions-nous dépassé les premières rues que nous vîmes arriver une foule de gens, dont la plupart brandissaient des torches et faisaient un vacarme à réveiller les morts. On hurlait, on chantait, on grognait, on soufflait dans des cornets à bouquin, on battait le rappel sur des casseroles. Quel charivari ! Nous dûmes nous jeter de côté, pour ne pas être renversés par cette avalanche. Pendant le défilé, je vis que la bande emportait le roi et le duc, qui, tant bien que mal, se tenaient à califourchon sur une barre de bois. Du moins, je devinai que c’étaient eux que l’on escortait ainsi, car ils ressemblaient plutôt à de monstrueux panaches de corbillard qu’à des êtres humains. On leur avait barbouillé le corps d’une couche de goudron à laquelle adhérait le contenu d’un lit de plume.
Certes, si la punition était rude, les deux associés ne l’avaient pas volée ; cependant, je ne pus m’empêcher de la trouver cruelle. J’interrogeai un traînard, qui nous raconta comment les choses s’étaient passées. Les spectateurs n’avaient pas laissé au duc le temps d’annoncer une seconde représentation du fameux intermède. Au moment où le caméléopard commençait ses gambades, M. Burton avait donné le signal, et… vous savez le reste.
— On va les jeter à l’eau, dis-je à Tom.
— Pas de danger, répliqua-t-il. Où as-tu vu habiller ainsi des gens que l’on songe à pendre ou à noyer ? Ce serait du luxe. On ignore que ce sont des voleurs ; on croit n’avoir affaire qu’à des vagabonds auxquels cette promenade ôtera l’envie de revenir. Pour ma part, je ne leur en veux pas, puisqu’ils nous laissent un prisonnier à délivrer.
C’est là ce qui m’intéresse le plus.
Tout le long du chemin, nous ne parlions plus que de Jim, nous demandant où on avait pu l’enfermer. Enfin, Tom s’écria :
— Que nous sommes bêtes de n’avoir pas deviné plus tôt ! Je parie que je sais où il est.
— Vrai ? Où est-il ?
— Dans cette hutte isolée qui se trouve au fond de la cour. Pendant que nous dînions, n’as-tu pas vu un nègre y entrer avec des provisions ?
— Oui ; les chiens ont aboyé, et j’ai pensé qu’il leur apportait à manger.
— Je l’ai cru aussi ; mais les provisions n’étaient pas destinées aux chiens.
— Comment le sais-tu ?
— Parce que je me rappelle maintenant qu’il y avait là une grosse tranche de melon d’eau. Est-ce que les chiens aiment le melon ? En outre, le nègre a remis une clef à mon oncle au moment où nous sortions de table. La tranche de melon indique un homme, la clef indique un prisonnier. Jim est là.
Ah ! ce Tom, quelle tête, pour un garçon de son âge ! Si j’avais la tête de Tom Sawyer, je ne la troquerais pas contre celle d’un duc, ni même contre celle d’un clown ou d’un membre du Congrès.
— À présent, reprit Tom, il y a trente-six moyens de faire évader un captif ; il s’agit de choisir le meilleur.
— Il n’y a pas besoin de tant chercher. J’ai mon idée.
— Voyons-la.
— Demain, nous commencerons par monter à bord de mon canot pour amener le radeau de l’île et nous le cacherons dans un bon endroit. Après, nous prendrons la clef dans la poche de l’oncle Silas, pendant qu’il dormira ; nous ouvrirons la porte, puis…
— Peuh ! fit Tom, le premier venu aurait trouvé ça. Oui, la chose marcherait comme sur des roulettes, mais elle ne ressemblerait guère à une aventure. À quoi bon un plan qui ne donnerait pas plus de peine et n’étonnerait personne ? Une évasion où l’on s’en va sans courir le moindre danger n’est pas une véritable évasion.
Je ne cherchai pas à défendre mon idée ; je devinai que le programme de Tom serait supérieur au mien.
— Que comptes-tu faire ? lui demandai-je.
— Je n’en sais rien encore, répondit-il. J’ai plus d’une idée en tête, moi.
Il voulut bien entrer dans quelques détails, dont je me dispense de parler, car il se réservait d’agir selon les circonstances, et il n’y manqua pas. Je reconnus volontiers qu’il se montrait cent fois plus inventif que moi, tout en restant convaincu que Jim aurait trouvé mon projet plus pratique.
Une chose semblait certaine. Tom était fermement décidé à m’aider dans mon entreprise et à partir avec le fugitif. Je n’en revenais pas. Voilà un garçon bien élevé, ayant une réputation à perdre, dont la famille avait toujours manifesté un profond mépris pour les abolitionnistes et qui n’hésitait pas à se couvrir de honte, lui et les siens, en protégeant un nègre évadé ! Non, je n’y comprenais rien. Moi, c’était différent. Jim était mon ami, je tenais à le sauver et je me moquais du qu’en dira-t-on. N’était-il pas de mon devoir d’engager Tom à me laisser agir seul, à se borner à me garder le secret ? Au premier mot que je lui en touchai, il me demanda d’un ton froissé :
— Est-ce que Tom Sawyer ne passe pas pour savoir ce qu’il fait, en général ?
— D’accord.
— Et ne t’a-t-il pas dit qu’il t’aiderait à délivrer Jim ?
— Oui.
— Eh bien alors ?
Ce fut tout. Je jugeai inutile d’insister. Quand Tom avait déclaré qu’il ferait une chose, il n’écoutait pas ceux qui voulaient l’en empêcher. À notre retour, aucune lumière ne brillait aux fenêtres et tout le monde dormait, sauf les chiens, qui nous connaissaient déjà assez pour ne pas donner l’alarme. Nous pûmes donc avancer jusqu’à la petite hutte isolée et l’examiner de près à la lueur des étoiles.
— J’aurais préféré des pierres ou des briques, dit Tom. On ne parle de murs en bois dans aucun des livres que j’ai lus. C’est égal, ces bûches sont solides et je ne serais pas étonné si cette porte était doublée en fer.
— Peu nous importe, puisque la clef nous permettra de l’ouvrir.
— Laisse-moi donc tranquille avec ta clef ! Tu veux tout simplifier.
— Eh bien, même sans la clef, ce sera plus facile que tu ne crois. Regarde les planches que l’on a clouées là-haut, sans doute pour boucher une lucarne ; il suffirait de grimper sur une échelle pour les enlever.
— C’est possible, répondit Tom, et on a eu joliment raison de boucher la lucarne ; car un cachot ne doit jamais être éclairé. En tout cas, quand même elle serait assez grande pour livrer passage à dix captifs, je me garderais d’arracher les planches. J’espère bien trouver un moyen plus compliqué.
— Nous pourrions scier quelques-unes de ces bûches et les remettre ensuite en place, comme je l’ai fait la dernière fois que mon père m’a enfermé.
— Oui, ce serait plus mystérieux ; mais on ne scie que des barreaux de fer dans les histoires que je connais.
— Et puis, nous n’avons pas de scie.
— Bah ! on en fabrique avec un ressort de montre. Ton idée me plaît assez, quoique tu ne l’aies pas empruntée à un livre.
Derrière la hutte et tout contre la palissade, se dressait un appentis en planches qui n’avait pas plus de six pieds de large. Nous n’eûmes qu’à pousser la porte pour entrer. Tom tira des allumettes de sa poche et nous vîmes quelques pioches rouillées, quelques pelles et une vieille charrue hors d’usage. Cette espèce de hangar ne communiquait pas avec la hutte que Tom appelait un cachot.
— Nous voilà bien avancés, lui dis-je. Le mur est tout aussi solide de ce côté.
— Je me moque pas mal du mur, répliqua-t-il. Nous creuserons un tunnel de façon à arriver juste sous le lit de Jim. C’est une affaire de huit jours tout au plus.
— Sais-tu seulement où est le lit de Jim ?
— Si je ne le sais pas, je le saurai bientôt. Ce qui m’embarrasse, c’est que ce sont les prisonniers eux-mêmes qui doivent percer les murs ou creuser le tunnel.
Notre inspection terminée, nous retournâmes à la maison, où j’entrai par la porte de derrière, dont je n’eus qu’à soulever le loquet. Cette façon de gagner son lit n’était pas assez romanesque pour Tom, qui préféra remonter dans notre chambre à l’aide du paratonnerre. Il aurait mieux fait de suivre mon exemple, car il ne me rejoignit qu’après être tombé deux fois. Avant de s’endormir, il me raconta l’histoire de plusieurs prisonniers qui avaient réussi à s’échapper en creusant une galerie sous une des dalles de leur cachot.
— Par bonheur, nous serons moins embarrassés qu’eux, lui dis-je. Nous n’aurons pas à faire disparaître la terre à mesure que nous l’enlèverons ; j’ai déjà choisi ma pioche.
— Ah çà ! te figures-tu que nous allons employer les outils que nous venons de voir ? Ce serait par trop commode de se servir de ce qu’on a sous la main. Sois tranquille, je trouverai mieux.
Il ne trouva pas tout de suite ; car, au moment où le sommeil s’empara de moi, il m’expliquait comment on s’y prend pour prévenir un captif que des amis veillent sur lui.
Le lendemain, nous fûmes debout au point du jour. Tom voulait lier connaissance avec le nègre chargé de nourrir Jim. Les travailleurs avaient déjà achevé de déjeuner et partaient pour les champs. Celui que nous cherchions était en train d’empiler des provisions dans un panier, et, tandis que les autres s’éloignaient, on lui apporta une clef. Il paraissait encore moins intelligent que ses camarades. Ses cheveux crépus étaient attachés çà et là en petites mèches laineuses avec des bouts de fil. Tom et moi, nous savions fort bien que les noirs emploient ce moyen-là pour se garantir contre les sorcières, auxquelles la plupart d’entre eux ont la niaiserie de croire.

— Ah ! ah ! Sambo ! lui dit Tom, c’est toi qui donnes à manger aux chiens, je crois ?
— Un drôle de chien et qui a bon appétit, massa Sid ! Voulez-vous le voir ?
— Oui, montre-nous-le.
Je lui donnai un coup de coude.
— En plein jour ? Tu n’y songes pas ! lui dis-je à l’oreille, ça ne rentre pas dans ton plan.
— Mon plan est changé, répliqua-t-il. Viens et ne crains rien.
J’avoue que je ne me sentais pas rassuré ; toutefois la curiosité l’emporta. Je me rappelai d’ailleurs que la hutte — ou le cachot, pour parler comme Tom — manquait de fenêtre. Mais les yeux du prisonnier étaient habitués aux ténèbres, et, dès que nous eûmes franchi le seuil, il s’écria :
— Vous voilà, Huck ! Je ne comptais plus vous revoir… et, bonté du ciel ! est-ce bien vous, massa Tom ?
Je savais ce qu’il en serait, je m’y attendais.
— Il vous connaît ! s’écria Sambo, qui était entré derrière nous.
Tom fit aussitôt volte-face et lui demanda d’un ton surpris :
— Qui est-ce qui nous connaît ?
— Parbleu, le nègre évadé.
— Lui ? En voilà une idée !
— Ne vient-il pas de crier qu’il vous connaît ?
— Par exemple, c’est curieux ! répliqua Tom d’un air intrigué. Qui donc a crié ? Quand a-t-on crié ? Qu’a-t-on crié ?… As-tu entendu quelque chose ? ajouta-t-il en s’adressant à moi.
Naturellement, je répondis :
— Non, je n’ai rien entendu.
Alors Tom se tourna vers Jim, le contempla comme s’il ne l’avait jamais vu de sa vie et lui demanda :
— As-tu crié, toi ?
— Moi, massa ? Non, je n’ai pas dit un mot.
— Pas un mot ?
— Non, massa, pas un seul.
— Nous connais-tu ?
— Non, massa ; pas plus que vous ne connaissez le vieux Jim. Là-dessus Tom regarda d’un air sévère le vieux Sambo, qui semblait ahuri.
— Qu’est-ce que cela signifie ? dit-il. As-tu vraiment supposé que quelqu’un avait crié ?
— Pour sûr, j’ai entendu dire : « Bonté du ciel ! est-ce vous, massa Tom ? »
— Tu vois bien que personne n’a ouvert la bouche. Tu as cru entendre, cela arrive à tout le monde.
— Non, cela n’arrive qu’à moi. C’est un tour des sorcières.
— Comment, Sambo, tu donnes dans ces bêtises ? Si je t’offrais un demi-dollar, croirais-tu qu’on t’a jeté un sort ?
— Non, répliqua le nègre dont les yeux brillèrent, ou, du moins, je trouverais qu’on ne m’a pas jeté un mauvais sort.
— Eh bien, voilà de quoi acheter du fil pour t’attacher les cheveux. Puis, tandis que Sambo se dirigeait vers la porte et mordait la pièce qu’il venait de recevoir, afin de s’assurer si elle était bonne, Tom se pencha sur Jim et lui dit :
— Rappelle-toi que tu ne nous connais pas. Si tu entends un bruit de pioches, ne t’inquiète pas. Nous sommes là pour te délivrer.
Jim n’eut que le temps de me serrer la main, et nous nous éloignâmes
après avoir engagé Sambo à ne pas parler de ce qu’il avait cru entendre, parce qu’on se moquerait de lui.
Bien que l’heure de notre déjeuner fût encore assez éloignée, je voulus rentrer ; mais Tom m’emmena bon gré, mal gré, dans le bois voisin. Il déclara que nous aurions besoin de lumière dans l’appentis pour creuser notre tunnel et qu’une lanterne en donnerait trop. Ce qu’il fallait, c’était un tas de ces bouts de bois pourris qui émettent une faible lueur. Nous finîmes par en ramasser quelques brassées que nous cachâmes dans un buisson, puis nous nous assîmes sur l’herbe pour nous reposer. Tom paraissait mécontent.
— Qu’as-tu donc ? lui demandai-je.
— J’ai qu’on nous fait la partie trop belle, répliqua-t-il. Il nous a
suffi de vouloir pour pénétrer dans le cachot. Au lieu d’un porte-clefs
farouche, nous sommes tombés sur ce Sambo. Est-ce là un vrai geôlier ? Pas même un chien de garde à endormir en lui jetant une boulette
empoisonnée ! Et puis Jim n’est enchaîné que par une seule jambe. Il
suffirait de soulever un des pieds de son lit pour le débloquer. Il se
serait sans doute évadé par la fenêtre dès le premier jour, s’il n’avait
pas compris qu’on ne va pas loin en traînant une chaîne. L’oncle Silas
ne prend aucune précaution. Il nous oblige à inventer toutes les difficultés… Enfin, ce n’est pas notre faute. Ce qui me console, c’est qu’il y
a du mérite à créer des obstacles et des dangers quand ceux qui devraient se mettre en travers vous mâchent la besogne. Vois un peu
cette affaire de la lanterne, par exemple. Nous pourrions allumer cent
torches dans l’appentis sans courir grand risque ; mais nous sommes
forcés de feindre d’avoir peur d’être dérangés. Maintenant, il va falloir
trouver quelque chose pour fabriquer une scie.
— Pourquoi faire ?
— Pour scier le pied du lit de Jim.
— Tu viens de dire qu’il n’y avait qu’à soulever le lit.
— Je te reconnais bien là, Huck ! Tu n’as donc rien lu ? Si tu connaissais l’histoire du baron Trenck, de Benvenuto Cellini, de Latude et d’une foule d’autres héros, tu saurais qu’on ne s’y prend pas de cette façon. Soulever un pied de lit, la belle malice ! As-tu jamais vu un prisonnier se tirer d’embarras en soulevant son lit ? Non ; il doit scier le bois en deux, avaler la sciure de bois, remplir la fente avec de la graisse ou n’importe quoi, et tout arranger de manière à tromper le geôlier le plus vigilant. Alors, la nuit où tu es prêt à partir, tu donnes un coup de poing, le pied tombe ; tu décroches la chaîne, et te voilà libre. Il ne reste plus qu’à attacher ton échelle de corde aux créneaux, à descendre, et à te casser une jambe ou un bras dans le fossé, parce que la corde est trop courte de 19 pieds. Ton cheval et tes fidèles serviteurs sont en bas qui t’attendent ; ton écuyer te ramasse, t’aide à te mettre en selle et tu pars au galop. Ça vaut la peine d’être prisonnier pour avoir de ces histoires-là ! Je suis fâché que notre cachot ne soit pas entouré d’un fossé. Si nous avons le temps, le soir de notre évasion, nous en creuserons un.
— À quoi bon un fossé, puisque Jim sortira par l’appentis ?
Tom ne m’écoutait pas ; il ne songeait plus au tunnel et réfléchissait, le menton dans la main ; bientôt il soupira et secoua la tête.
— Non, dit-il, sans s’occuper de moi ; il n’y a pas de précédent. Dans les livres, c’est le prisonnier qui agit en pareil cas, et nous serions obligés de la scier nous-mêmes.
— Qu’est-ce que nous serions obligés de scier ?
— La jambe de Jim.
— Hein !
— Il y a eu des gens qui, ne pouvant briser leur chaîne, se sont décidés à se couper le poignet. Une jambe vaudrait mieux ; seulement, Jim ne consentirait pas à observer les règles. Il faut y renoncer.
— J’y renonce très volontiers.
Tom haussa les épaules.
— Ça ne m’étonne pas de ta part. Tu renoncerais sans doute aussi à lui fournir une corde à nœuds ? Heureusement, je suis là. Nous n’aurons pas de peine à lui en fabriquer une avec un de nos draps de lit.
— Jim peut se passer d’une échelle.
— Avoue, Huck, que tu ne sais rien de rien. Est-ce que tous les prisonniers n’ont pas une corde à nœuds ? En général, ils ont assez de loisir pour la fabriquer eux-mêmes, et quelquefois on la leur envoie dans un pâté ou dans…
— Mais puisque Jim n’aura pas l’occasion de s’en servir ?
— Tu m’impatientes avec tes puisque. Mettons qu’il ne s’en serve pas, il pourra la cacher dans son lit, comme font les autres prisonniers. Tu cherches sans cesse à inventer des nouveautés ; moi, je tiens à ce qu’un prisonnier se conduise en prisonnier.
— Ne te fâche pas, répliquai-je ; si le règlement veut qu’il ait une échelle, je ne m’y oppose pas. Je respecte les règlements. Mais, pour sûr, si nos draps de lit manquent à l’appel, nous aurons du grabuge avec la tante Sally. J’ai notre affaire. Je vais te montrer des arbres avec l’écorce desquels mon père m’a appris à tresser des amarres. Ça vaut du chanvre ; ça sera plus solide que nos vieux chiffons de toile ; ça prendra moins de place dans le lit et les matériaux ne nous coûteront rien. Quant à Jim, il n’y regardera pas de si près.
— Huck, si j’étais aussi ignorant que toi, je garderais ma langue dans ma poche. Où as-tu jamais vu un prisonnier d’État s’évader avec une corde de cette espèce ? Est-ce qu’un prisonnier trouve des arbres dans son cachot ?
— Eh bien, Tom, arrange la chose comme tu l’entendras. Tout de même, si tu m’écoutais, tu me laisserais emprunter un des draps de lit qui sont en train de sécher là-bas derrière la buanderie.
— À la bonne heure, c’est une idée ; et il m’en vient une autre : tu prendras en même temps une des chemises de mon oncle.
— Il n’y en a qu’une.
— Alors tu prendras celle-là.
— À quoi nous servira-t-elle, Tom ?
— Elle servira à Jim pour écrire ses impressions.
— Mais Jim ne sait pas écrire !
— Je ne te demande pas s’il sait écrire ou non. Il en sait assez pour tracer des marques sur la chemise, n’est-ce pas ? Nous lui fabriquerons une plume avec une cuiller d’étain ou un bout de fer.
— Laisse donc ! Les oies ne manquent pas ici et j’ai un canif.

— On croirait vraiment, à t’entendre, que les prisonniers n’ont qu’à allonger le bras pour empoigner une oie et lui arracher une plume ! Nigaud ! Ceux qui ont le plus de chance écrivent avec un clou ; mais, des fois, ils ne parviennent à se procurer qu’un vieux morceau de cuivre qu’il faut frotter contre le mur pendant des semaines pour le rendre assez pointu. Ils ne ramasseraient pas une plume, s’ils en voyaient une sous leur main, ce ne serait pas régulier.
— Et où trouvent-ils de l’encre ?
— On en fait tant qu’on veut avec de la rouille et des larmes ; mais c’est là l’encre des prisonniers ordinaires et des femmes. Les meilleures autorités écrivent avec leur propre sang ; tu prêteras ton canif à Jim et il se piquera avec. Quand il voudra apprendre à ses amis où il est enfermé, il n’aura qu’à griffonner avec sa fourchette sur un plat d’étain qu’il jettera par la fenêtre. Le Masque de fer a employé ce moyen, et ses plats étaient en argent.
— On ne donne pas de fourchette à Jim et je n’ai pas vu l’ombre d’une assiette, même en étain, dans le panier.
— Bah ! il y en a assez dans les cabanes des nègres.
— Oui, mais Jim aura beau les couvrir de marques, on n’y comprendra rien.
— Tu sors de la question, Huck. Tout ce qu’on réclame de lui, c’est de gratter les assiettes et de les jeter dehors. La moitié du temps on ne peut pas lire ce qu’un prisonnier a griffonné.
— Alors, pourquoi gaspille-t-il ses assiettes ?
— Ça lui est bien égal ; elles ne sont pas à lui.
— Elles sont à quelqu’un, je suppose ?
— Voyons, te figures-tu que le Masque de fer s’inquiétait de savoir à qui appartenaient les plats d’argent qu’il jetait par la fenêtre ?
Notre entretien fut interrompu par un négrillon qui annonçait l’heure du déjeuner en soufflant dans un cornet à bouquin et nous courûmes nous mettre à table. Ce matin-là, j’empruntai le drap de lit et la chemise dont nous avions besoin. Tom les fourra dans un vieux sac avec les débris de bois phosphorescents qui devaient remplacer la lanterne.
J’appelai cela emprunter, parce que mon père se servait de ce mot ; mais Tom me dit que nous aurions bel et bien commis un vol, si nous n’avions pas représenté des prisonniers. Il est permis à un prisonnier de prendre ce qu’il faut pour s’évader. Nous avions donc le droit de tout rafler, puisque nous agissions pour le compte de Jim. Cela n’empêcha pourtant pas Tom de me gronder deux ou trois jours plus tard, parce que j’avais pris un melon dans le jardin d’un nègre et que je m’en étais régalé.
— Il est convenu que nous pouvons prendre ce dont nous avons besoin, lui dis-je, et j’avais besoin du melon.
— Tu n’en avais pas besoin pour sortir de prison, répliqua-t-il, et cela change la thèse. S’il nous avait fallu un melon afin d’y cacher un poignard et de le faire parvenir à Jim pour tuer son geôlier, personne n’y trouverait à redire.
— Eh bien, je ne vois pas ce qu’on gagne à représenter un prisonnier, si on ne peut seulement pas manger une tranche de melon à sa place.
La dispute ne dura guère et ce ne fut pas moi qui eus le dernier mot.
Ce jour-là, nous commençâmes nos préparatifs d’évasion. Tom profita d’un moment où la cour était déserte pour porter le sac dans l’appentis, pendant que je montais la garde. Il ne tarda pas à me rejoindre, puis nous allâmes nous asseoir sous les arbres pour causer à notre aise.
— Tout a bien marché jusqu’à présent, me dit Tom ; il ne nous reste plus qu’à trouver des outils convenables.
— Il me semble qu’il y a là-bas plus de pioches qu’il n’en faut. Pourquoi ne pas s’en servir ?
Tom me regarda d’un air de pitié.
— Huck Finn, me demanda-t-il, depuis quand fournit-on des pelles et des pioches à un prisonnier ? Autant vaudrait lui remettre tout de suite la clef de son cachot ! Quel mérite aurait-il à s’évader, alors ? Non, non, ce sont là des outils qu’on ne fournirait pas même à un roi.
— Si tu ne veux pas des pioches, que te faut-il ?
— Deux couteaux de table.
— Pour creuser un trou sous la hutte ? C’est bête.
— Non, ce n’est pas bête, c’est le vrai moyen, le moyen le plus usité ; il n’y en a guère d’autre, du moins dans les histoires que je connais. Les prisonniers creusent toujours avec un couteau, et pas dans la terre encore ! En général, ils ont à percer un mur de pierre et je te laisse à penser si c’est facile. Sais-tu combien le fameux prisonnier du château d’If, dans le port de Marseille, a mis de temps à creuser une galerie dans le roc ? Devine un peu.
— Un mois ? Deux mois ?
— Trente-sept ans, Huck ! Je voudrais que Jim fût enfermé dans une forteresse comme celle-là !
— Moi, pas. Jim est trop vieux… pense donc ! Il ne durera pas trente-sept ans !
— Jim durera assez. Nous serons obligés d’aller plus vite que je ne voudrais. Pour bien faire, nous devrions y mettre au moins deux ans ; mais il n’y a pas moyen. L’oncle Silas a écrit à la Nouvelle-Orléans ; il ne tardera pas à apprendre que l’offre de 200 dollars est une attrape, et alors il lâchera Jim, ou fera une annonce dans les journaux. Nous n’avons donc qu’à creuser le tunnel le plus tôt possible et à délivrer notre prisonnier à la première alerte. Rien ne nous empêchera ensuite de supposer qu’il a passé trente-sept ans dans son cachot.
— À la bonne heure, Tom ! Nous voilà d’accord. Nous supposerons tout ce que tu voudras. Pour peu que tu y tiennes, je supposerai qu’il y est resté cent ans. Maintenant, tu peux compter sur moi pour escamoter les deux couteaux.
— Prends-en trois, pendant que tu y seras. Il m’en faut un pour faire une scie.
— C’est inutile, répliquai-je. Tu oublies donc qu’on a laissé dans notre chambre une petite scie toute faite ?
Tom haussa de nouveau les épaules d’un air découragé.
— Une scie toute faite ? répéta-t-il. Pour un prisonnier ? C’est perdre
son temps que d’essayer de t’apprendre quelque chose… Enfin, va toujours emprunter les couteaux — trois couteaux, entends-tu ?
Ce soir-là, lorsque tout le monde fut endormi, nous descendîmes dans la cour en prenant encore pour escalier le conducteur du paratonnerre. Cinq minutes plus tard, enfermés dans l’appentis, nous nous mettions à l’œuvre à la faible lueur du bois phosphorescent que nous avions tiré du sac. Notre premier soin fut de déblayer un espace de cinq à six pieds vers le milieu du mur de bûches.
— En creusant là, me dit Tom, nous arriverons juste sous le lit de Jim, et personne ne se doutera que le cachot est miné ; la couverture du prisonnier traîne à terre et j’espère qu’on ne s’avisera pas de la soulever.
— Quand même il n’y aurait pas de couverture, répliquai-je, on ne verrait pas le trou ; il fait trop noir dans la hutte.
— S’il n’y avait aucun risque à courir, je ne m’en mêlerais pas, riposta Tom en frappant du pied. Tu m’impatientes, à la fin !
Comme je ne voulais pas l’impatienter, je me tus. Nous travaillâmes jusqu’à près de minuit. Il n’y a rien de fatigant comme de creuser la terre avec un couteau ; les paumes de nos mains étaient semées d’ampoules et le tunnel n’avançait guère.
— Ce n’est pas une besogne de trente-sept ans, Tom, dis-je enfin. À ce train-là, il nous en faudra bien trente-huit.
Il cessa à son tour de creuser.
— Tu as raison, Huck, répliqua-t-il au bout d’un instant, après avoir poussé un gros soupir. Nous n’en viendrons jamais à bout de cette façon. J’ai oublié une chose. Un prisonnier a toujours assez de temps devant lui ; il creuse avec n’importe quoi sans s’abîmer les doigts, parce qu’il se repose toutes les dix minutes. Par malheur, nous sommes trop pressés ; si nous creusions deux heures de plus avec ces outils-là, nous serions forcés d’attendre huit jours avant de pouvoir recommencer. Regarde un peu mes mains.
— Et les miennes donc ! Que proposes-tu alors ?
— Je vais te le dire. Ce n’est pas correct, c’est sauter à pieds joints par-dessus toutes les règles ; mais, que veux-tu ? Prenons une pioche et faisons semblant de croire que c’est un couteau. Dans un cas comme le nôtre, l’emploi d’une pioche est excusable… Allons, passe-moi un couteau.

Il en avait déjà un, ce qui ne m’empêcha pas de lui offrir le mien. Il le jeta au loin et répéta :
— Passe-moi un couteau !
Cette fois, je compris. Je ramassai une pioche dans le tas, je la lui donnai et il se remit aussitôt à la besogne sans ajouter un mot. Moi, je m’armai d’une bêche et nous fîmes voler la terre. Au bout d’une demi-heure, nous en avions assez, bien que nos couteaux de rechange fussent beaucoup plus faciles à manier ; mais, au moins, nous avions creusé un trou assez profond.
Lorsque j’eus regagné notre chambre à coucher en prenant le chemin le plus court — c’est-à-dire l’escalier — je regardai par la fenêtre et je vis Tom qui s’efforçait de grimper le long du paratonnerre. Il avait trop mal aux mains et il dut y renoncer.
— Remonte donc par l’escalier, lui dis-je ; tu t’imagineras que tu es rentré par la fenêtre.
C’est ce qu’il fît.
Le lendemain, Tom emprunta dans la maison une cuiller d’étain et un chandelier de cuivre afin de fabriquer des plumes pour Jim. Il escamota aussi une demi-douzaine de chandelles. De mon côté, je rôdai autour des cabanes des nègres et je finis par mettre la main sur trois assiettes d’étain. Tom trouva que ce n’était pas assez.
— Bah ! lui dis-je, personne ne les verra. Elles tomberont dans les hautes herbes quand Jim les glissera entre les planches qui bouchent la lucarne. Nous n’aurons qu’à les ramasser et à les lui rendre.
— Soit, répliqua Tom d’un ton peu satisfait. À présent, il s’agit de chercher comment nous ferons parvenir au prisonnier la corde à nœuds, les plumes et le reste.
— Il n’y a pas besoin de chercher, Tom ; nous lui remettrons tout lorsque le tunnel sera fini.
— Non, par exemple ! s’écria Tom, qui me regarda d’un air dédaigneux. Jamais de la vie ! Nous avons le choix d’une foule d’autres moyens plus ingénieux. Tu verras. Mais il faut d’abord que Jim soit prévenu.
Cette nuit-là, nous descendîmes par le conducteur du paratonnerre un peu après dix heures. Tom avait emporté une des chandelles. En arrivant en face du cachot, il grimpa sur mes épaules, juste au-dessous de la lucarne, et laissa tomber sa chandelle dans la hutte. Puis nous nous remîmes au travail dans l’appentis avec tant d’ardeur, qu’au bout de deux heures la besogne était terminée. Nous nous glissâmes dans le cachot en passant sous le lit du prisonnier. À force de chercher à tâtons, nous retrouvâmes la chandelle, qui fut vite allumée. Jim ronflait ; mais nous n’eûmes pas de peine à le réveiller. Bien qu’il n’eût rien entendu, notre visite ne sembla pas trop l’étonner. Du reste, nous avions eu soin de le réveiller assez doucement pour ne pas l’effrayer. Ce fut en pleurant presque de joie qu’il s’écria :
— Je savais bien, Huck ; je savais bien, massa Tom, que vous me tiendriez parole. Vous venez me délivrer, pas vrai ? Cette chaîne n’est pas très épaisse. Où est votre lime ?
Tom répondit qu’il ne donnerait pas un rat mort pour délivrer un prisonnier à l’aide d’un procédé aussi commode ; puis il s’assit au bord du lit et expliqua nos plans à Jim.
— Ce sera plus long, ajouta-t-il ; mais tu n’as pas à t’inquiéter. À la première alerte, nous brusquerons l’aventure, et en route !
Jim ne se résigna qu’à contre-cœur, tout en reconnaissant que nous savions mieux que lui comment on doit s’y prendre. Il avoua d’ailleurs qu’il n’était pas à plaindre, parce que l’oncle Silas et la tante Sally venaient tous les deux jours s’assurer qu’il ne manquait de rien.
— J’ai trouvé mon joint ! s’écria Tom. C’est par eux que nous t’enverrons une partie des objets dont un prisonnier a besoin.
— Tu bats la campagne, Tom, lui dis-je ; autant vaudrait leur montrer tout de suite notre tunnel.
Selon sa coutume, il ne tint aucun compte de mon objection et continua :
— Lorsqu’ils te rendront visite, empoigne ce que tu trouveras dans les poches de mon oncle ou attaché aux cordons du tablier de ma tante. Il te faudra une chemise blanche, une corde à nœuds et d’autres choses qui tiennent trop de place pour que nous en chargions un geôlier sans qu’il s’en aperçoive. Nous te les ferons passer dans un pain ou dans un pâté, ainsi que ça se pratique généralement. Tu auras soin de ne pas te mettre à manger avant que Sambo ait emporté le panier.
Le prisonnier ouvrait de grands yeux. Quand Tom lui eut expliqué comment il devait tracer des gribouillages sur la chemise avec son sang, cacher l’échelle de corde sous sa couverture, et cœtera, il parut encore plus étonné. Néanmoins, après avoir répété dix fois qu’il ne voyait pas à quoi tout cela servait, il promit de faire ce qu’on lui demandait.
Nous sortîmes à quatre pattes par le tunnel et nous regagnâmes notre lit. Bien que nos mains fussent dans un piteux état, Tom jubilait. Il déclara que rien n’était aussi amusant que de s’échapper d’une forteresse.
— Je ne regrette qu’une chose, me dit-il. Quel dommage de ne pas pouvoir garder le prisonnier dans son cachot pendant les trente-sept ans ! Il s’y habituerait si bien qu’il ne voudrait plus s’en aller et son histoire nous rendrait tous fameux.
Il s’endormit en parlant de son Masque de fer, de Latude et de je ne sais qui encore. Le lendemain, il ne songeait plus qu’à Jim. Son premier soin fut de se rendre au bûcher, où il brisa à coups de hache le chandelier dont il mit les morceaux dans sa poche avec la cuiller. Ensuite nous allâmes du côté des cabanes des nègres, et, tandis que je détournais l’attention de Sambo, Tom fourra un des fragments du chandelier dans un pain destiné au prisonnier.
Nous accompagnâmes Sambo jusqu’au cachot afin d’assister au déballage du panier. Eh bien, les livres ont beau conseiller ce moyen-là, il n’est pas toujours bon, même quand le prisonnier est prévenu, surtout s’il a trop faim. Du moins, il ne réussit pas dans le cas de Jim, qui, oubliant les recommandations de la veille, mordit dans le pain juste au mauvais endroit et faillit se casser plusieurs dents.
C’était sa faute, et Tom le lui fit avouer plus tard en l’engageant à ne plus rien manger désormais sans avoir sondé ses provisions de bouche à coups de canif. Par bonheur, il n’eut pas le temps de se plaindre. Au même instant deux chiens débouchèrent de dessous le lit du prisonnier, bientôt suivis de neuf autres. Nous avions oublié de fermer l’entrée du tunnel ! Les intrus gambadaient autour de Sambo, qui ne comprenait pas d’où ils venaient. Le pauvre nègre cria : « Encore ces sorcières ! » et se roula sur le sol au milieu de ses amis que la peur et l’obscurité l’empêchaient de reconnaître. Tom ne perdit pas la tête. Il se dépêcha de pousser la porte, sortit et lança au loin un morceau de viande qui attira dehors toute la meute. Il me rejoignit au bout d’une minute ou deux et je devinai que les chiens ne rentreraient pas par le tunnel, quoiqu’il ne se donnât pas la peine de me rassurer sur ce point. Il ne s’occupa que du geôlier.
— Sambo, dit-il d’un ton de reproche, en voilà assez de ces histoires. Est-ce que tu te figures encore avoir entendu parler ?
Sambo se releva et regarda autour de lui d’un air effrayé.
— Massa Sid, répliqua-t-il, non seulement j’ai cru entendre aboyer un million de chiens, mais ils m’ont léché la figure ; je les ai sentis, massa Sid… Ah ! je voudrais mettre la main sur ces sorcières, rien qu’une minute ! Elles y regarderaient à deux fois, après, avant de me tourmenter.
— Eh bien, je vais te dire ce que j’en pense. Pourquoi arrivent-elles ici juste à l’heure du déjeuner de Jim ? Parce qu’elles ont faim. Pour qu’elles te laissent tranquille, il faudrait leur préparer un de ces pâtés qu’elles aiment.
— Me voilà bien avancé, massa Sid ! Est-ce que je sais préparer un plat pour les sorcières ?
— Non, parbleu ! Ce n’est pas une cuisine de nègre. Je le préparerai moi-même. Seulement, je te conseille de tourner le dos quand nous mettrons quelque chose dans ton panier et surtout quand Jim le déballera. Ne touche à rien ; ça pourrait rompre le charme et te porter malheur.
— Je m’en garderai bien, massa Sid ; je n’y toucherais pas du bout
du doigt — non, pas pour 1 000 dollars.

Cette affaire ayant été arrangée à la grande satisfaction de Tom et de Sambo, nous sortîmes du cachot pour opérer des fouilles dans un coin de la cour où l’on jetait les vieilles chaussures, les bouteilles cassées, les chiffons et d’autres non-valeurs. Tom finit par découvrir ce qu’il cherchait, une vieille casserole, dont nous bouchâmes tant bien que mal les trous afin d’y cuire notre pâté, ou plutôt la croûte du pâté qui devait contenir la corde à nœuds. Une demi-heure après, nous avions emprunté dans l’office plus de farine qu’il ne nous en fallait. Tom ramassa aussi deux gros clous.
— C’est très commode pour graver son nom sur les murs d’un cachot et pour leur confier le secret de ses chagrins. Il y a des prisonniers qui auraient payé cher ces machines-là ; nous les enverrons à Jim aujourd’hui même.
Il en déposa un dans la poche d’un tablier que tante Sally avait accroché au dos d’une chaise, et fourra l’autre sous le galon du chapeau de son oncle. Il savait par les enfants que Jim recevrait une visite cet après-midi. Lorsque le cornet à bouquin sonna l’heure du déjeuner, nous étions déjà dans la salle à manger. Tante Sally se fit un peu attendre et Tom profita de l’occasion pour glisser la cuiller dans une des poches de son oncle. La maîtresse de la maison arriva en proie à un accès de mauvaise humeur qu’elle eut de la peine à contenir, jusqu’à ce que son mari eût récité le bénédicité. Alors, tout en versant le café, elle laissa éclater sa colère.
— C’est inconcevable ! s’écria-t-elle. Les chiens font trop bonne garde pour qu’un étranger ait pu s’introduire dans le séchoir, et pourtant ta chemise de toile a disparu. Je l’ai cherchée partout. Envolée !
Je ne savais quelle contenance garder et Tom ne devait pas se sentir à l’aise non plus. Si tante Sally nous avait regardés en ce moment, elle aurait soupçonné que les voleurs n’étaient pas loin. Elle songea d’autant moins à nous, que son mari jugea à propos de se disculper.
— Je t’assure, Sally, que je n’y ai pas touché, dit-il.
— Oh ! je ne t’accuse pas. Tu es assez distrait pour te laisser prendre la chemise que tu as sur le dos, mais pas assez pour te dévaliser toi-même. D’ailleurs, ce n’est pas tout.
— Comment ! il manque encore quelque chose ?
— Oui ; il manque six chandelles et une cuiller. Les rats ont peut-être avalé les chandelles ; pour sûr, ils n’ont pas avalé la cuiller. Je m’étonne qu’ils n’emportent pas la maison ; ils se nicheraient dans tes cheveux que tu ne t’en apercevrais seulement pas. Voilà six mois que tu promets de boucher leurs trous.
— Ne te fâche pas ; je les boucherai demain.
— Ne te presse pas. Attends jusqu’à l’année prochaine… Eh bien ! Mathilde !
Mathilde reçut un bon coup de dé sur la tête et retira ses doigts du sucrier sans se faire prier. Au même instant, Lise se montra à la porte.
— Je viens de ramasser le linge sur les cordes, dit-elle, et il me manque un drap de lit ; il ne m’en reste que trois.
— Un drap de lit ? répéta tante Sally. C’est trop fort !
— Je boucherai les trous aujourd’hui même, dit l’oncle Silas.
— Tais-toi donc ; les rats ne sont pas en cause… Une chemise, six chandelles, un drap de lit et une cuiller.
— Massa Silas, dit un négrillon dont la tête apparut derrière la jupe de sa mère, Sambo ne retrouve pas le chandelier que vous lui aviez donné à nettoyer.
— Emmène-le vite, Lise, s’écria tante Sally, ou je serai tentée de lui casser la tête… En voilà assez pour aujourd’hui !
Elle était à bout de patience, et vous conviendrez qu’il y avait de quoi.
— Tu as raison, répliqua l’oncle Silas, qui, comme nous, achevait tranquillement son déjeuner. À chaque jour suffit sa peine. Ce qu’on croyait perdu se retrouve souvent à l’heure où l’on y songe le moins.
Tout en parlant, il mit la main dans sa poche, où il cherchait sans doute son mouchoir, et il en tira la cuiller destinée au prisonnier. Tante Sally, les mains levées, demeura bouche bée. Tom se mit à tousser afin de cacher son envie de rire. Pour ma part, j’aurais voulu être à Jéricho ou plus loin. Mon inquiétude ne dura guère.
— Avec toi, il ne faut jamais s’étonner de rien, dit tante Sally. Tu l’avais dans ta poche tout le temps !
— J’ignore comment elle est venue là, répondit le coupable d’un air penaud. Ce matin, j’ai marqué dans mon Nouveau Testament le chapitre que je voulais lire au nègre évadé. Cette cuiller me sera tombée sous la main et je l’aurai mise dans ma poche au lieu du livre. Si le livre est toujours dans ma chambre, cela prouvera que…
— Au nom du ciel, laisse-moi un peu de repos ! Allez-vous-en tous !
L’oncle Silas s’empressa d’obéir et nous suivîmes son exemple. Comme nous traversions le parloir, il prit son chapeau sur la table et le clou tomba par terre. Il le ramassa, le posa sur la cheminée et sortit comme s’il eût été habitué à trouver tous les jours des clous dans son chapeau.
— Tu vois, me dit Tom, on ne peut seulement pas compter sur lui pour remettre un simple clou à un prisonnier. C’est égal, l’histoire de la cuiller a bien tourné. Il nous a tirés d’un mauvais pas sans s’en douter, et il mérite que nous fassions quelque chose pour lui. Nous lui éviterons la peine de boucher les trous de rat.
Les trous ne manquaient pas dans le cellier. Il nous fallut près d’une heure pour calfeutrer toutes les issues ; mais la besogne fut bien faite. À peine étions-nous remontés, que l’oncle Silas arriva, une chandelle dans une main, un petit baquet dans l’autre. J’allais le prévenir, quand Tom me saisit par le bras et me dit tout bas :
— Il ne nous a pas vus. Laissons-lui le plaisir de la surprise ; il ne nous en remerciera que davantage.
L’oncle Silas ne nous remercia pas du tout. Il remonta au bout d’une dizaine de minutes, et, cette fois, il nous aperçut en atteignant le haut de l’escalier.
— D’où venez-vous, mes enfants ? nous demanda-t-il. Je vous ai cherchés partout ; mais je n’ai plus besoin de vous. Les trous sont bouchés. Par exemple, je ne me rappelle pas quel jour je suis descendu dans le cellier.
Et il s’éloigna en grommelant.
Tom aussi était de mauvaise humeur. Il regrettait sa cuiller, dont il prétendait ne pouvoir se passer. Après avoir réfléchi, il m’expliqua comment il voulait réparer la bévue de l’oncle Silas. Son plan me parut trop compliqué.
— À quoi bon ces manigances ? lui demandai-je. Il serait beaucoup plus simple de…
— De faire comme tout le monde, n’est-ce pas ? Tu oublies qu’un prisonnier ne peut pas faire comme tout le monde.
— Il me semble pourtant que tu t’es contenté de prendre la cuiller dans le panier, et tu vas recommencer.
— Cette fois, ce ne sera pas la même chose, puisque nous risquons d’être découverts. Viens donc !
Nous allâmes rejoindre tante Sally dans la salle à manger, où elle était en train de ranger la vaisselle dans le buffet. Lorsqu’elle se retourna, j’avais déjà glissé une des cuillers dans ma manche et Tom étalait les autres sur la table.
— C’est drôle, ma tante, dit-il, je croyais que l’on avait retrouvé cette cuiller, et il n’y en a que neuf.
— Ne me tracassez pas ; je l’ai mise moi-même dans le panier et il doit y en avoir dix.
— Nous les avons comptées et il en manque toujours une.
Naturellement, tante Sally se fâcha ; mais elle se mit à compter à son tour, comme vous l’auriez fait à sa place.
— C’est vrai, s’écria-t-elle, il n’y en a que neuf… Je suis cependant bien sûre… Elle n’est pas tombée sous la table ?
Non ; elle n’était point tombée sous la table, mais dans la poche de son tablier, d’où Jim la retira une heure plus tard, en même temps que le clou. Tante Sally, après avoir secoué le panier, avoua tout bonnement qu’elle avait pu se tromper et nous pria de déguerpir, menaçant de nous frotter les oreilles si nous reparaissions avant l’heure du dîner.
Tom ne se montra pas satisfait de ce dénouement. Selon lui, la seconde disparition de la cuiller n’avait pas causé assez de surprise. Il parla même, afin de se rattraper, de remettre le drap de lit en place et d’en choisir un plus beau dans l’armoire au linge.
— Sais-tu où est l’armoire au linge ? me demanda-t-il.
— Non, répliquai-je.
— Oh ! tu ne sais jamais rien, toi. Alors, occupons-nous du pâté qui doit contenir l’échelle de Jim.
Ce pâté-là nous donna beaucoup de peine. Nous allâmes le préparer dans le bois. Le beurre et la farine ne manquaient pas ; mais il ne fut pas fini ce jour-là. Nous gaspillâmes trois casseroles de farine sans obtenir un bon résultat. Nous n’avions besoin que d’une croûte, et, comme il n’y avait rien dessous, le haut s’effondrait toujours. Ce ne fut qu’après nous être brûlé les doigts et avoir été presque aveuglés par la fumée, que nous songeâmes au vrai moyen, c’est-à-dire à placer la corde à nœuds dans la casserole, avant de faire cuire la pâte. Or, l’échelle n’était pas encore prête. Vers dix heures, nous portâmes le drap de lit dans le cachot, où Jim nous aida à le déchirer en petites bandes et à fabriquer une belle corde à nœuds, assez longue pour pendre dix nègres. Il fut convenu entre nous que nous y avions travaillé pendant plus de neuf mois.

Le lendemain, nous nous aperçûmes que la corde ne tiendrait pas dans la casserole ; il y en avait de quoi remplir cent pâtés. Par bonheur, l’oncle Silas possédait une superbe bassinoire, à laquelle il attachait un grand prix, attendu qu’elle avait été apportée d’Angleterre par un de ses ancêtres. Il ne s’en servait jamais ; elle faisait justement notre affaire, parce que la longueur du manche permettait de la retirer du feu sans se rôtir les mains. Après l’avoir garnie à l’intérieur, nous la remplîmes avec la corde, ou plutôt avec un quart de la corde, dont Tom se résigna, à son grand regret, à jeter le reste dans un buisson, en disant :
— C’est dommage qu’elle ne soit pas plus longue ; mais on verra bien à quoi elle devait servir.
Ce sacrifice accompli, l’échelle fut recouverte d’une double couche de pâte, la bassinoire fermée et entourée de braise. Au bout d’une quinzaine de minutes, le plat était cuit à point.
Sambo tourna le dos tandis que nous placions au fond du panier le produit de notre cuisine et trois assiettes d’étain. Jim était prévenu.
Dès qu’il se trouva seul, il brisa la croûte, fourra la corde dans son traversin et cacha les assiettes.
À notre prochaine entrevue, pendant que Jim et moi aiguisions nos plumes sur un morceau de brique, Tom renouvela ses instructions. Lorsqu’il eut expliqué au nègre qu’un prisonnier doit se désennuyer en couvrant d’inscriptions les murs de son cachot, Jim se rebéqua. Il déclara qu’il aimait mieux dormir. C’était très facile de gribouiller des ronds ou des croix sur la chemise et sur les assiettes ; mais il ne voulait pas passer ses jours à gratter des bûches.
Tom insista.
— Voyons, dit-il, tu ne peux pas sortir d’ici sans laisser la moindre trace de ton passage ; ça ne serait pas dans les règles. Je connais une masse de très belles inscriptions. Je vais tâcher de me souvenir de quelques-unes, qui suffiront pour commencer.
Il prit son crayon, griffonna sur un bout de papier, puis il lut :
1o Ici, une victime de l’injustice des hommes a poussé son dernier soupir.
2o Dans ce sombre donjon, un infortuné captif, abandonné par tous ses amis, a terminé sa misérable existence.
3o Ici, après une lente agonie, qui a duré trente-sept ans, le visage caché sous un masque de fer, a péri le fils de Louis XIV.
La voix de Tom tremblait comme s’il eût été sur le point de pleurer ; mais Jim s’attendrit d’autant moins qu’il n’y comprenait rien. Il s’insurgea de nouveau et je plaidai sa cause.
— Il a raison, dis-je. Il n’a jamais appris à écrire.
— Je le sais bien, répliqua Tom. Ce n’est pas là ce qui m’embarrasse, car je pourrais tracer les lettres moi-même et il n’aurait qu’à suivre les lignes. Mais, en général, les murs d’un cachot ne sont pas en bois. Il nous faudrait un rocher.
Jim opina que la pierre, étant plus dure que le bois, exigerait beaucoup plus de temps et qu’il ne sortirait jamais de la hutte.
— Au contraire, riposta Tom, nous n’aurions pas besoin de tant creuser et nous irions plus vite.
— Pas avec ces outils-là, massa Tom.
— Que veux-tu, Jim ? Un prisonnier n’a pas le droit d’employer des outils ordinaires ; sans cela, nous en aurions emprunté ou acheté.
Le nègre ne trouva rien à répondre et Jim se mit à examiner ce qu’il appelait « nos plumes ». Nous avions beau frotter la cuiller et le chandelier sur la brique, nous n’arrivions pas à les affiler.
— C’est la faute de la brique, reprit Tom au bout d’un instant. J’ai lu quelque part que Latude, ou un autre, avait remplacé une lime par une brique ; mais celle-là me semble trop molle. Je me souviens maintenant qu’il y a, près de la scierie abandonnée, une vieille meule. Je tiens mon rocher ! Nous l’amènerons ici et nous ferons d’une pierre trois coups — elle nous servira à aiguiser nos plumes, à transformer en scie un de nos couteaux, et il nous sera facile d’y graver nos inscriptions.
Il n’était pas encore minuit et nous partîmes à la recherche de notre rocher. Quoique la meule ne demandât qu’à rouler, elle nous donna assez de mal. Nous nous tenions de chaque côté pour l’empêcher de tomber ; mais elle menaça plusieurs fois de nous écraser en inclinant trop à droite ou à gauche. Elle courait souvent plus vite que nous n’aurions voulu et, lorsque le terrain montait, il fallait un rude coup d’épaule pour la remettre en marche. À mi-chemin — plouf ! — elle s’étala par terre. Nous n’en pouvions plus de fatigue et l’aide du prisonnier devenait indispensable. Tom lui-même finit par en convenir.
Nous n’eûmes qu’à soulever le pied du lit pour dégager la chaîne, que nous enroulâmes autour du cou du captif, puis nous sortîmes, en rampant, par le tunnel. Jim releva la meule en un clin d’œil. Nous nous y attelâmes tous les trois et elle roula bon train jusqu’à l’appentis.
La galerie souterraine n’était ni assez large ni assez élevée pour livrer passage à notre rocher ; mais le nègre vint encore à notre secours ; il saisit une des pioches et nous tira vite d’embarras. Sans lui, je crois que la meule ne serait jamais arrivée dans la hutte.
Cette besogne accomplie, Tom, au lieu de se reposer, se mit aussitôt à l’œuvre et traça légèrement la plus belle de ses inscriptions sur ce qu’il appelait « le mur du cachot ».

— Maintenant, dit-il au nègre, passe-moi ton clou pour que je te montre de quelle façon tu dois t’y prendre pour bien graver les lettres. Tu vois, ce clou fait un excellent ciseau, et cette petite barre de fer que j’ai ramassée dans l’appentis, te servira de marteau. Tu travailleras à ta première inscription tant que ta chandelle durera ; ensuite tu pourras te coucher, après avoir caché la meule sous ta paillasse. Demain, nous t’apporterons d’autres chandelles. Bonne nuit, et dors bien.
Au moment où nous allions nous glisser sous le lit, il s’arrêta et demanda :
— As-tu des araignées ici, Jim ?
— Non, massa Tom, je ne crois pas.
— Un cachot sans araignées ! J’ai bien fait d’y penser. Nous t’en apporterons.
— Je n’ai pas besoin d’araignées, massa Tom. Je ne peux pas les souffrir. Autant vaudrait m’apporter un serpent à sonnettes. Tom réfléchit un instant.
— C’est une fameuse idée ! dit-il. Je parie que plus d’un prisonnier a eu un serpent à sonnettes pour compagnon d’infortune, bien que les livres n’en parlent pas. Où le garderais-tu ?
— Où garderais-je quoi, massa Tom ?
— Ton serpent à sonnettes.
— Miséricorde ! Huck vous dira que je suis payé pour ne pas aimer ces bêtes-là.
— Je connais l’histoire. Ici, ce ne serait pas la même chose ; tu aurais le temps de les apprivoiser.
— Les apprivoiser !
— Oui, et c’est très facile. Tous les animaux sont reconnaissants, lorsqu’on est bon pour eux et qu’on les dorlote. Ils ne font jamais de mal aux gens qui les traitent bien. Essaye — je ne te demande que ça — essaye, et bientôt les serpents ne voudront plus te quitter. Ils dormiront entortillés autour de ton bras ou de ta jambe et te laisseront mettre leur tête dans ta bouche.
— Brrr… Essayez vous-même, massa Tom. Moi, j’aurais trop peur.
— Tu es plus obstiné qu’une mule, Jim. Les prisonniers sont toujours enchantés d’avoir une bête à apprivoiser, et ils rencontrent rarement un serpent à sonnettes. Tu serais peut-être le premier, et tu peux être sûr qu’on parlerait de toi. Huck et moi, nous finirions bien par t’en trouver un.
— Vous le garderez pour vous, alors ; je n’en veux pas.
— Puisque tu es aussi têtu, j’y renonce. Nous t’apporterons des couleuvres. Nous leur coudrons des boutons à la queue et nous croirons que ce sont des crotales. Là, es-tu satisfait ?
— Eh bien, non, massa Tom. Je puis supporter les couleuvres ; mais je m’en passerais volontiers. Je m’en passais très bien avant votre arrivée.
— Tu avais tort, parce que tu dois avoir l’air d’un vrai prisonnier, si tu veux que nous te délivrions. Y a-t-il des rats ici ?
— Je n’en ai pas vu un seul.
— Sois tranquille, nous t’en procurerons.
— Je n’ai pas besoin de rats non plus, massa Tom. Ils me grignoteraient les pieds et m’empêcheraient de dormir. C’est bien assez des couleuvres.
— Allons donc ! Dans un cachot, les rats sont encore plus nécessaires que les serpents. Si Huck n’était pas à moitié endormi, il te l’aurait déjà dit. Tu ne peux pas t’en passer. Presque tous les prisonniers en ont — du moins ceux dont l’histoire vaut la peine d’être lue. Tu les nourriras, tu leur apprendras des tours et ils s’attacheront à toi. Il n’y a rien d’aussi facile à dresser que les serpents et les rats, excepté les chevaux. Par exemple, il faudrait… As-tu quelque chose pour leur faire de la musique ?
— Je n’ai que ma guimbarde ; ça ne les amuserait pas.
— Tu te trompes joliment. Tous les animaux aiment la musique — dans un cachot, ils en raffolent, quand elle n’est pas trop gaie. La guimbarde est justement ce qui leur convient. Tu n’auras qu’à leur jouer un air un peu triste, le soir avant de t’endormir ou le matin de bonne heure ; au bout de cinq minutes, les araignées, les couleuvres, les rats commenceront à s’inquiéter ; ils croiront que tu es malade et fourmilleront autour de toi pour avoir de tes nouvelles.
— Et si je ne joue pas de la guimbarde ?
— Dame, il y a gros à parier que tu ne les apprivoiseras pas, et ce sera dommage, car alors on ne parlera jamais de toi dans un livre… Bon ! j’allais oublier une chose importante. Crois-tu qu’une plante prendrait racine ici et donnerait des fleurs ?
— Pas probable, massa Tom.
— Tu pourras toujours essayer. D’autres prisonniers ont fait pousser une plante entre deux pavés, ce qui me semble bien plus difficile.
— Un bouillon-blanc viendrait peut-être ici, mais il ne vaudrait pas l’eau qu’il boirait.
— Tu ne sais pas ce que tu dis, Jim. Nous t’en apporterons un pied ; tu le planteras dans ce coin et tu le soigneras comme la prunelle de tes yeux. Nous ne l’appellerons pas bouillon-blanc mais Picciola — c’est là le vrai nom d’une fleur dans une prison. Tu l’arroseras…
— Oh ! ce n’est pas l’eau qui me manquera, j’ai ma cruche.
— Laisse-moi tranquille avec ta cruche. Tu arroseras le bouillon-blanc avec tes larmes, autrement, nous ne pourrions pas l’appeler Picciola.
— Alors, le bouillon-blanc mourra de soif, massa Tom. Demandez à Huck s’il m’a jamais vu pleurer.
Tom parut un moment embarrassé ; mais il tenait à son idée et n’y renonça pas pour si peu.
— Eh bien, dit-il, nous nous en tirerons tout de même. Je mettrai une botte d’oignons dans le panier de Sambo et tu les couperas quand Picciola aura besoin d’être arrosée. Te voilà content, j’espère ?
Jim répondit qu’il aimerait mieux du tabac ; puis il envoya aux cinq cents diables Picciola, les araignées, les inscriptions et le reste. Cette fois, Tom perdit patience.
— Quoi ! s’écria-t-il, on te fournit les meilleures occasions qu’un prisonnier ait jamais eues de devenir célèbre, et c’est ainsi que tu nous remercies ? Tu ne mérites pas que l’on se donne tant de peine pour toi. Est-ce que nous ne savons pas mieux qu’un nègre comment il faut sortir d’un cachot ? Tiens, je suis presque tenté de boucher notre tunnel avant d’aller me coucher.
Bref, il se fâcha si bien, que Jim eut peur de se voir abandonné et
promit de ne plus se plaindre.

Le lendemain, à peine réveillé, Tom s’habilla à la hâte et courut à la ville où il acheta une grande ratière. Cette trappe-là valait l’argent qu’elle lui coûtait. À son retour, j’avais déjà débouché les meilleurs trous du cellier et une heure après nous tenions quinze ou seize beaux rats que nous comptions porter chez Jim dans l’après-midi. En attendant, nous les cachâmes sous le lit de tante Sally. L’endroit était mal choisi. Pendant que nous cherchions des araignées dans le grenier, le petit Franklin Jefferson Phelps aperçut par hasard la cage et l’ouvrit pour voir si les rats sortiraient. Ils ne demandaient qu’à déménager — un bébé d’un an aurait dû le deviner rien qu’à la façon dont ils grignotaient les barreaux de leur prison. Lorsque nous revînmes, tante Sally était perchée sur une chaise, criant comme si on l’écorchait et effrayant les pauvres bêtes, qui se sauvaient de tous les côtés, excepté du côté de la cage. Il nous fallut au moins deux heures pour les remplacer, et, pour l’entrain ou la vivacité, les nouveaux venus ne méritaient pas d’être comparés aux premiers. Tante Sally s’en prit à nous, au lieu de graisser les épaules du nigaud qui venait d’effaroucher la fleur du troupeau !
Quant aux chenilles et aux araignées, notre collection ne laissait rien à désirer, Tom aurait voulu y ajouter un nid de guêpes ; mais la famille faisait bonne garde, et nous dûmes lever le siège après avoir reçu des piqûres qui nous ôtèrent l’envie de les apprivoiser. En fait de serpents, il n’y avait guère que des couleuvres dans le bois voisin. Nous en fourrâmes deux douzaines dans un sac que je portai dans notre chambre. L’heure du souper avait sonné et nous avions assez travaillé pour nous sentir en appétit.
Eh bien, lorsque nous remontâmes, nos serpents s’étaient éclipsés. Tom avait bien ficelé l’ouverture du sac, la ficelle tenait toujours, et pourtant le sac se trouvait vide. Comment les couleuvres avaient-elles fait pour sortir sans dénouer la corde ? Si je le savais, je vous le dirais. Après tout, elles avaient beau se cacher, elles ne pouvaient être bien loin, et nous espérions les rattraper sans avoir à battre les buissons. En effet, si elles ne se montrèrent pas ce soir-là, elles se promenèrent du haut en bas de la maison le lendemain et les jours suivants. Elles étaient très jolies et pas plus méchantes qu’une mouche ; mais tante Sally ne les aimait pas, qu’elles fussent vertes, jaunes ou grises, rayées ou mouchetées. Elle ne les aurait pas touchées avec des pincettes.
À la vue d’une seule de ces petites bêtes, elle se sauvait en criant comme si le feu avait pris à ses jupes. Même lorsque la dernière couleuvre eut disparu — il ne nous en manquait que deux ou trois — il n’y avait qu’à chatouiller la nuque de tante Sally avec un brin de duvet pour la faire sauter jusqu’au plafond. C’était très curieux ; mais Tom me dit que toutes les femmes sont comme ça. Heureusement Sambo affirma qu’il suffit qu’un serpent se faufile dans une maison pour en attirer des centaines, de sorte que nous ne fûmes pas mis en cause.
Jim eut bientôt assez de compagnons de captivité pour contenter le prisonnier le plus exigeant, ce qui ne l’empêcha pas de bougonner. Du reste, il ne se plaignait pas des serpents ou des araignées, qui le laissaient tranquille ; mais il trouvait que les rats s’apprivoisaient trop, et plus ils s’habituaient à lui, moins il s’habituait à eux.
Au bout de trois semaines, tout était prêt ou peu s’en fallait. La chemise avait été expédiée par l’entremise du geôlier, dans un second pâté. Chaque fois qu’un rat mordait Jim, il se levait et traçait des gribouillages sur la toile pendant que son encre rouge était fraîche. La meule était presque couverte d’inscriptions. Le pied du lit fut scié en deux, et nous avalâmes la sciure qui nous donna des coliques atroces. Tom déclara qu’aucun prisonnier ne pouvait se vanter d’avoir rien avalé d’aussi indigeste et que j’avais grand tort de faire la grimace.
Enfin, ainsi que je l’ai dit, nos préparatifs étaient presque terminés et nous eûmes lieu de nous féliciter de n’avoir pas trop lambiné. M. Phelps avait adressé deux lettres à la plantation dont le nom figurait sur la fausse affiche imprimée par le duc. Naturellement, les lettres restèrent sans réponse. Il parla alors de mettre une annonce dans les journaux de Saint-Louis et de la Nouvelle-Orléans pour engager le propriétaire à venir chercher Jim et à payer les 200 dollars de récompense. Nous n’avions plus de temps à perdre.
— Jim commence à en avoir assez, me dit Tom, et, en somme, il a fait à peu près tout ce que doit faire un prisonnier. Le moment est venu de frapper le grand coup. En avant les lettres anonymes !
— Qu’est-ce que c’est que ça ? demandai-je.
— Un avis pour prévenir le gouverneur du château qu’il se trame quelque chose et le mettre sur ses gardes.
— Ce n’est pas à nous de mettre ton oncle sur ses gardes.
— Oui, je sais bien. Il vaudrait mieux être dénoncé par un traître déguisé en femme ; mais nous sommes forcés de nous dénoncer nous-mêmes. À moins d’être prévenu, mon oncle demeurerait les bras croisés, et après toute la peine que nous nous sommes donnée, nous pourrions gagner le canot sans être poursuivis.
— J’aimerais autant ne pas être poursuivi.
— Ça ne ressemblerait plus à une évasion… Maintenant que j’y songe, nous aurons notre traître. Tu te déguiseras en femme pour glisser la première lettre sous la porte d’entrée.
— Je la glisserai aussi bien sans être déguisé.
— Est-ce que tu aurais l’air d’un traître dans tes habits de tous les jours ?
— La nuit, personne ne saura de quoi j’ai l’air.
— Ça n’a rien à y voir, Huck. Un traître doit toujours être déguisé et trembler d’être reconnu. D’ailleurs, il nous faut la robe pour autre chose. En général, c’est la mère du prisonnier qui l’aide à s’échapper — elle lui prête sa robe et il part à sa place. Le geôlier ne manque jamais de s’y laisser prendre.
— Qui sera la mère de Jim ?
— C’est moi qui suis sa mère.
— Alors tu seras forcé de rester dans la hutte pendant que Jim et moi filerons ?
— Pas si bête ! Je bourrerai de paille les habits de Jim pour faire croire que quelqu’un est couché sur le lit, et nous partirons tous ensemble.
Avant dîner j’avais emprunté la robe demandée, et, le soir, déguisé en traître, je glissai cet avis sous la grande porte :
Veillez au grain. Un orage vous menace. Ne dormez que d’un œil.
Il ne produisit pas beaucoup d’effet, ou du moins on s’abstint d’en parler devant nous. Tom pensa qu’il n’avait peut-être servi qu’à allumer la pipe d’un des nègres. La nuit suivante, nous collâmes un second avis sur la porte de derrière de la maison. C’était tout bonnement une tête de mort entre ces deux inscriptions tracées en lettres de sang :
Tom me dit que personne ne rirait de ce message-là, parce qu’on respectait les sociétés secrètes. En effet, tante Sally se montra un peu effrayée quand Sambo lui apporta le dessin ; mais l’oncle Silas, moins facile à intimider, se moqua d’elle.
— Sois tranquille, me dit Tom. Au troisième avis, qui sera la vraie lettre anonyme, il finira par se décroiser les bras.
Le soir même la lettre était prête ; elle disait :
C’est pour ce soir. Les Ravageurs veulent vous voler le nègre évadé. Ils ont essayé de vous effrayer pour avoir le champ libre. Je suis de la bande, mais je les dénonce parce que j’ai à me venger d’eux. Ils viendront juste à minuit. Ils ont une fausse clef pour ouvrir le cachot. Laissez-les entrer dans le cachot, et pendant qu’ils limeront la chaîne, vous les tuerez à votre loisir.
À souper, l’oncle Silas, afin de rassurer sa femme, avait promis de mettre un nègre armé en faction à chaque porte, de sorte que nous étions embarrassés pour envoyer le dernier message à son adresse. Tom descendit en glissant le long du paratonnerre, trouva la sentinelle endormie et épingla la lettre au chapeau du dormeur.
— Pour le coup, dis-je, lorsqu’il m’eut rejoint, nous voilà obligés de déguerpir.
— Oui, et on n’aura aucun reproche à nous faire ; nous aurons rempli notre devoir.
— Et en prenant une bonne avance… Si nous partions ce soir ?
— Vingt-quatre heures d’avance ! ça ne serait pas loyal, et puis nous avons à nous occuper du radeau.
— Pourquoi n’y as-tu pas pensé plus tôt ?
— J’y ai pensé, Huck. Tu sais bien que j’ai demandé campo pour demain, sous prétexte d’une partie de pêche. Nous profiterons de l’occasion pour inspecter le radeau. Notre canot est assez grand et en bon état ; mais c’est plus amusant de voyager à bord d’un radeau. Je voudrais déjà être installé sous ton wigwam.
En attendant, il se coucha sans se déshabiller et je suivis son exemple. Le lendemain, dès l’aube, nous partîmes avec le déjeuner et le goûter que tante Sally avait préparés la veille. On allait souper lorsque nous revînmes de notre expédition à l’île des Saules. Tom était enchanté du radeau. On ne nous dit pas un mot de la lettre des Ravageurs, qui devait pourtant être arrivée à bon port, car l’oncle Silas lui-même semblait inquiet.

Le souper terminé, tante Sally nous envoya nous coucher. Avant d’obéir, nous courûmes à l’office, où nous remplîmes de provisions un panier que nous emportâmes dans notre chambre. Il était près de dix heures. Tom commença par endosser la robe de la mère de Jim, puis il attacha une corde à l’anse du panier.
— J’ai bien fait de songer aux vivres, me dit-il ; nous avons de quoi en acheter ; mais il ne faut pas s’embarquer sans biscuits, et surtout sans chandelles, lorsqu’on a une lanterne à éclairer. Ah çà ! où as-tu mis les chandelles ?
— Si elles ne sont pas dans le panier, c’est que nous les avons laissées en bas.
— Nous ne pouvons pas nous en passer ; je n’ai pas envie de voir couler le radeau faute d’une chandelle. Va les chercher ; c’est l’affaire de quelques minutes et nous avons deux heures devant nous. Je partirai le premier pour habiller Jim et arranger le mannequin de paille ; nous gagnerons le canot dès que tu nous auras rejoints.
Tout en parlant, il avait déroulé la corde jusqu’à terre et enjambé la balustrade. Ce fut bien à contre-cœur que je retournai à l’office, où j’arrivai sans encombre. Je glissai les chandelles dans ma poche et je réparai, par la même occasion, un oubli de Tom, en emportant une petite motte de beurre qu’il avait posée sur une galette de maïs. Je soufflai ma lumière, me gaudissant de pouvoir montrer à Tom que je n’étais pas seul en faute. Au même instant, tante Sally sortit de la salle à manger, une lampe à la main. J’eus à peine le temps de fourrer la galette et le beurre sous mon chapeau.
— Qu’es-tu allé faire dans l’office ? me demanda-t-elle.
— Rien, ma tante.
En général, elle se contentait de ces réponses-là ; mais, depuis trois jours, la moindre chose la mettait sens dessus dessous.
— Rien ? répéta-t-elle. C’est pour rien que tu te promènes à une pareille heure ? J’en aurai le cœur net ; entre là et attends-moi.
Elle ouvrit une porte et me poussa dans le parloir. Je vis alors que la lettre de Tom avait produit son effet. Une quinzaine de fermiers, dont chacun était armé d’un fusil, attendaient aussi quelqu’un. Ils ne paraissaient pas trop à leur aise. À chaque instant, ils ôtaient et remettaient leur chapeau, se grattaient la tête, ou tiraillaient un des boutons de leur habit, en essayant de se donner un air crâne. Ils me connaissaient tous et continuèrent à causer à voix basse sans s’occuper de moi. Je m’affaissai sur la première chaise qui se trouva derrière moi ; mais, en dépit de mon inquiétude, je me gardai bien de retirer mon chapeau.
Tante Sally revint au bout d’une minute ou deux et m’adressa un tas de questions. La peur m’empêcha de répondre comme il aurait fallu, car je tremblais pour Tom. Les fermiers discutaient de leur côté et parlaient d’aller se mettre en embuscade dans la hutte au lieu d’attendre l’arrivée des Ravageurs. Il commençait à faire joliment chaud dans ce parloir, ou peut-être était-ce moi seul qui avais trop chaud ; en tout cas, le beurre se mit à fondre et à me couler le long des joues.
— Bonté du ciel ! Qu’a donc cet enfant ? s’écria tante Sally, qui devint toute pâle. Quelle maladie est-ce là ? Je ne l’ai jamais vu transpirer comme ça — on dirait de l’huile.
Elle enleva mon chapeau, me laissant coiffé de la galette et de ce qui restait de beurre. Alors, tandis que les autres riaient, elle me sauta au cou.
— Quelle peur tu m’as faite, mauvais garnement ! dit-elle. J’aurais dû deviner ce qui t’amenait à l’office. Va te coucher et que je ne t’y reprenne plus !
En un clin d’œil, je remontai l’escalier ; je redescendis à l’aide du paratonnerre et je gagnai l’appentis. Lorsque je fis mon apparition dans le cachot, j’étais si essoufflé que je pouvais à peine parler.
— Voilà comment tu te dépêches, me dit Tom. As-tu les chandelles ?
— Il s’agit bien de chandelles ! Pas une minute à perdre. Je voudrais déjà être loin. La maison est pleine de gens armés de fusils !
— Vrai ! s’écria Tom, dont les yeux flamboyèrent.
— Il y en a au moins vingt.
— Peuh ! Si c’était à recommencer, j’en ameuterais deux cents.
— Pas une minute à perdre, Tom, répétai-je. Ils veulent s’embusquer dans le cachot et autour du cachot.
— Les lâches ! Ils n’ont pas le droit de venir avant minuit. Heureusement, le prisonnier est habillé ; j’ai eu soin de laisser le panier dans l’appentis ; la palissade n’est qu’à dix pas et, une fois de l’autre côté, nous aurons bientôt gagné le canot.
— Jim ne pourra pas courir avec sa chaîne.
— Oh ! il y a quatre jours, j’ai pris sur moi d’acheter une lime. Que veux-tu ? quand on est pressé… Là, éteignons les lumières et filons.
Nous filâmes par le tunnel. Tom, qui avait insisté pour passer le dernier, prit alors les devants et écouta à la porte de l’appentis.
— Rien ne bouge, dit-il à voix basse. C’est égal, prenons nos précautions, comme si nous courions les plus grands dangers. Nous allons ramper à la queue leu leu jusqu’à la palissade. Tu ouvriras la marche pour montrer le chemin au prisonnier et je formerai l’arrière-garde.
Tom et moi, nous escaladâmes la barrière sans avoir fait plus de bruit qu’une araignée ; mais le pantalon de Jim s’accrocha à la traverse d’en haut et ne se décrocha qu’en brisant un éclat de bois. Il n’en fallut pas davantage pour nous prouver que l’on était déjà en embuscade, car une voix cria :
— Qui va là ? Répondez, ou je tire.
Personne ne répondit, et sauve qui peut ! Pan ! paf ! pan ! Trois coups de feu retentirent. Décidément, les sentinelles y allaient bon jeu, bon argent.
— Les voilà ! Nous les tenons ! Lâchez les chiens !
Ils ne nous tenaient pas encore. Nous les entendions, parce qu’ils avaient des bottes et criaient à tue-tête ; mais nous avions retiré nos chaussures et nous nous gardions bien de souffler mot. Nous suivions le sentier qui menait à la scierie et, quand le bruit se rapprocha, nous nous blottîmes derrière un buisson pour les laisser passer. Les chiens, que l’on avait enfermés afin de mieux surprendre les Ravageurs, arrivèrent en aboyant. Les deux ou trois premiers s’arrêtèrent à peine — le temps de nous donner le bonjour — et la meute reprit sa course pour rejoindre les braillards.
— Bon, dis-je à Tom, ils ont dépassé la scierie ; ils sont sur une fausse piste. Au canot ! Coupons à travers bois avant qu’ils reviennent.
Tom s’était assis sur l’herbe.
— Jim, demanda-t-il au nègre, pourrais-tu me porter sur tes épaules jusqu’au canot ? C’est une course de dix minutes. Huck te guidera.
— Je vous porterais pendant une journée, massa Tom, et Huck par-dessus le marché.
— Eh bien, laisse-moi grimper sur ton dos.
— Comment ! tu es déjà fatigué ? demandai-je à mon tour.
— Ne t’inquiète pas de moi. En route, Jim !
Un quart d’heure après, nous étions à bord de mon canot, que nous avions caché dans une petite crique, un peu au-dessus de la scierie, juste en face de l’île des Saules. Pendant que Jim ramait, je tenais le gouvernail, et il nous fallut près d’une demi-heure pour atteindre le radeau.
— Hourra ! Jim ! te voilà libre ! m’écriai-je.
— Oui, grâce à vous, Huck, et à massa Tom. Je ne l’oublierai pas, allez.
Il dansait de joie. Tom était encore plus content que nous, parce qu’il avait une balle dans le mollet. Nous dûmes le porter dans le wigwam, où j’allumai une chandelle.

— Quelle chance, hein ? dit-il, tandis que nous détachions le mouchoir qu’il avait roulé autour de sa jambe. Une évasion sans coups de fusil ne vaudrait pas deux cents.
Je n’avais plus envie de chanter victoire et Jim n’était plus disposé à danser. Il courut chercher de l’eau pour laver la blessure et déchira une des chemises du duc pour faire un bandage.
— Donne-moi les chiffons, dit Tom. Ne vous occupez pas de moi ; éclairez la lanterne et démarrez ! Ça ne sera rien. Je n’ai senti que comme un coup de fouet.
— Je connais ces coups de fouet là, massa Tom. Ils ne font pas trop de mal d’abord, quand il n’y a pas d’os cassé et que le trou a beaucoup saigné ; après, c’est autre chose. Il faut un médecin pour dénicher la balle.
— Éclairez la lanterne et démarrez la barque ! Je suis le capitaine.
— Huck, ne l’écoutez pas, dit Jim ; il commence à avoir la fièvre. Si un de nous avait été blessé, massa Tom aurait-il voulu partir tout de même ? Non, pour sûr. Tant pis si on me reprend ; je ne bouge pas d’ici.
Je savais bien que mon vieux Jim était blanc en dedans.
— Tu as raison, répliquai-je. Dès qu’il fera un peu jour, je retournerai là-bas et je ramènerai le docteur Thompson.
Tom se mit en colère et déclara que nous allions gâter l’aventure ; mais, lorsqu’il reconnut qu’il ne pouvait pas se lever, il finit par céder.
— Soit, dit-il, puisqu’il n’y a pas moyen de t’en empêcher. Tu lui mettras un bandeau sur les yeux ; tu le conduiras jusqu’au canot par de longs détours et tu le ramèneras de la même façon. C’est le moyen
que l’on emploie en général pour ne pas être dénoncé.
M. Thompson était un jeune homme, très jeune pour un docteur. Tante Sally prétendait qu’il portait des lunettes pour se donner l’air plus vieux, mais qu’on aurait de la peine à trouver un meilleur médecin. Le fait est qu’il guérissait vite les piqûres de guêpes. Tom et moi, nous en savions quelque chose. Il ne me fît guère attendre et vint m’ouvrir lui-même, malgré l’heure matinale.
— As-tu encore mis le nez dans un nid de guêpes, maître Tom ? demanda-t-il en me faisant entrer dans sa pharmacie.
— Non, monsieur Thompson.
— Alors quelqu’un est malade chez toi ?
— Personne n’est malade ; seulement Sid a une balle dans le mollet.
— Une balle ! on serait malade à moins. Dépêchons-nous… Là, j’ai ma trousse. Tu me raconteras en route comment l’accident est arrivé. Partons.
— C’est que Sid n’est pas à la maison.
— Où donc est-il ?
— Vous connaissez l’île des Saules ? Eh bien, hier, nous sommes allés dans l’île… nous avons un canot… à minuit, le fusil de Sid est parti par hasard, et…
— Ah ! vous chassiez à minuit ? dit le docteur, qui releva ses lunettes et me regarda en face… Ces coups de feu que j’ai entendus en rentrant… Je comprends. Vous avez inventé, à vous deux, cette absurde histoire des Ravageurs, et je crains que la plaisanterie n’ait été poussée trop loin.
— Sid dit que ce ne sera rien.
— Nous verrons. Pas de temps à perdre. Tu n’as pas laissé ton frère seul, je suppose ? Le nègre est évadé avec lui, hein ?
— J’avais promis de ne pas le dire ; mais, puisque vous devinez tout, ce n’est pas ma faute.
Lorsque j’eus fini de lui raconter l’aventure de la veille, nous étions arrivés à l’endroit où se trouvait mon canot.
— Ton Jim est un brave nègre, dit le docteur en sautant à bord, sans cela, il ne t’aurait pas donné un si bon conseil, au risque d’être repris. Je tâcherai de le tirer d’affaire quand il m’aura aidé à extraire la balle… Sur le radeau, ton frère ne sera pas trop secoué… Allons, je n’ai pas besoin de toi, tu me gênerais. Détache l’amarre et cours prévenir ta tante.
— Oh ! on doit nous croire dans notre lit, et plus tard on croira que nous sommes encore partis pour pêcher. J’aime mieux attendre votre retour.
— En effet, il est inutile d’effrayer ta tante d’avance, et je ne serais guère revenu avant midi. Tu es tout pâle ; va te reposer chez moi.
J’avais mon idée. À la façon dont il maniait les rames, j’espérais bien le voir arriver avant l’heure du goûter. Je me couchai donc sous les arbres, décidé à monter à mon tour dans le canot, dès que je saurais que la jambe de Tom était arrangée, et à laisser à M. Thompson le soin de rassurer tout le monde. De cette manière, nous pourrions filer avec le radeau, et, en somme, il n’y aurait qu’une demi-journée de perdue. Comme je venais de passer une nuit blanche, ou peu s’en faut, je ne tardai pas à m’endormir. Lorsque je rouvris les yeux, je reconnus qu’il était plus de midi. Je me levai aussitôt et je courus chez le docteur. Il n’était pas rentré. La faim me talonnait ; mais je ne songeais qu’à Tom, et me voilà reparti. En tournant le coin d’une rue, je faillis renverser l’oncle Silas.
— Ah çà ! où cours-tu ainsi ? D’où viens-tu, méchant gamin ?
— Je me promène.
— Jolie façon de se promener ! Tu m’as coupé la respiration.
— Je ne l’ai pas fait exprès.
— Il n’aurait plus manqué que cela, dit l’oncle Silas en frottant le bas de son gilet à l’endroit où j’avais donné tête baissée. Pourquoi ne vous a-t-on vus ni à déjeuner ni à goûter ? Où est Sid ? Est-il allé à la poste, comme sa tante le lui avait commandé hier au soir ?
— Je vais aller le chercher.
— Nous irons ensemble. Je ne te lâche pas, car ta tante s’inquiète ; toutes ces histoires l’ont bouleversée.
À la poste, l’oncle Silas ne trouva qu’une lettre à l’adresse de Mme Phelps, et il m’emmena bon gré, mal gré. Tante Sally ne paraissait pas trop penser à Tom ou à moi en ce moment. J’étais beaucoup plus tourmenté qu’elle, ce qui ne m’empêcha pas de me mettre à table. La salle à manger était remplie d’un tas de vieilles bavardes qui jacassaient sans perdre un coup de dent. Ah ! cela aurait fait du bien à Tom de les entendre. Elles avaient toutes visité le cachot. La meule, les couteaux ébréchés, le bout de corde à nœuds, le mannequin, le pied de lit scié en deux, le tunnel, leur fournissaient du fil à retordre. Une des vieilles dames dit qu’elle donnerait 2 dollars pour déchiffrer les signes mystérieux tracés sur la chemise. C’était sans doute une écriture africaine, quoique Sambo assurât que les nègres n’avaient pas d’écriture.
Quant aux inscriptions qui nous avaient coûté tant de travail, Tom aurait été joliment vexé d’entendre affirmer qu’un nègre seul y comprendrait quelque chose. Cependant, il se serait un peu consolé lorsque tout le monde convint, qu’à moins d’avoir eu une douzaine de complices, Jim aurait mis un an à faire tout ce qu’il avait fait.
— Il a fallu six hommes rien que pour porter cette meule jusqu’à la hutte, dit M. Phelps.
— Je crois bien qu’il a eu des complices, s’écria tante Sally. Ce sont eux qui me dévalisent depuis quinze jours. Ils ont raflé un drap de lit, de la farine, un chandelier, des couteaux, ma robe neuve, une bassinoire, et je ne sais quoi encore ; les bras m’en tombent ! Comme je vous le disais tout à l’heure, mon mari et moi, Sid et Tom, nous étions sans cesse sur le qui-vive. Eh bien ! nous n’avons pas vu l’ombre d’un des voleurs.
Cela n’en finissait pas. Il y avait longtemps que je n’avais plus faim. Par malheur, l’oncle Silas se trouvait entre moi et la porte. Impossible de m’échapper. Enfin, les visiteuses s’éloignèrent et j’espérais que l’occasion de filer se présenterait.

— Ce nègre t’aura coûté plus de 40 dollars, Silas, car tu peux courir après la récompense, dit Mme Phelps. Pour la première fois que tu t’avises de spéculer, tu n’as pas la main heureuse.
— C’est toi qui as envoyé Sid à la poste ? demanda l’oncle Silas, désireux de changer le cours de la conversation.
— Tu sais bien qu’il y va ou fait semblant d’y aller tous les jours, parce que je m’étonne que sœur Polly ne m’ait pas répondu. Il reviendra encore les mains vides.
Je saisis la balle au bond. Je sentais qu’on ne tarderait pas à m’interroger au sujet de Tom et je voulais opérer une diversion qui me fournirait peut-être l’occasion que je cherchais.
— Mais vous avez rapporté une lettre, mon oncle, dis-je.
— C’est vrai, je n’y songeais plus, répliqua-t-il en fouillant dans ses poches dont il tira la lettre. Justement, elle porte le timbre de Saint-Pétersbourg.
Je reconnus que je venais de commettre une bévue ; je me rappelai trop tard que Tom escamotait les réponses. Je n’eus pas le temps de me reprocher mon oubli. Tante Sally laissa tomber la lettre sans l’ouvrir et courut dehors. Elle avait vu quelque chose par la fenêtre ouverte. Moi aussi j’avais vu et je la suivis de près. C’était Tom étendu sur un brancard improvisé avec des branches d’arbres. C’était Jim affublé de la robe de Mme Phelps, les mains attachées derrière le dos, escorté par une dizaine de planteurs qui paraissaient disposés à l’écharper. C’était le docteur qui, au lieu de revenir seul après avoir retiré la balle, ramenait le blessé. Tom avait bien raison de se défier des médecins. Celui-là nous avait trahis.
Tante Sally se jeta sur le brancard en s’écriant :
— Il est mort !
— Rassurez-vous, madame, dit le docteur, je vous garantis qu’il n’y a pas de quoi s’alarmer. Il a reçu une chevrotine dans la jambe ; mais la blessure n’a rien de dangereux.
Au même instant Tom ouvrit les yeux et prononça deux ou trois phrases décousues qui montraient qu’il n’avait pas la tête à lui.
— Il est vivant, grâce au ciel ! dit tante Sally qui embrassa le blessé. Sid, Sid, quelle douleur tu m’as causée. Comment cela a-t-il pu arriver ? Réponds-moi donc !
Ce fut le docteur qui répondit :
— La fièvre lui donne un peu de délire. Vous l’interrogerez plus tard. En attendant, il sera mieux dans son lit que sur ce brancard.
— Vous avez raison ; moi aussi, je perds la tête… Mon pauvre Sid !
Elle embrassa de nouveau Tom et regagna la maison, où l’on eut bientôt installé un lit dans le parloir. Pendant qu’elle donnait des ordres à droite et à gauche, M. Phelps demanda :
— Et vous, docteur, ne pouvez-vous nous renseigner sur la cause de cet accident ?… Ah ! je parie que je devine, continua-t-il en apercevant le groupe que dominait la tête de Jim. Il aura découvert la retraite du fugitif ! Je vais livrer ce gredin au shérif qui le pendra.
— Je vous engage plutôt à commencer par l’enfermer de nouveau, quand ce ne serait que pour empêcher vos amis de le maltraiter. Répétez-leur de ma part que ce nègre-là ne ferait pas de mal à une mouche. Sans lui, je ne serais jamais parvenu à extraire la balle ; bien plus, sachant quel risque il courait, il m’a ensuite aidé à ramener le radeau de l’île des Saules.
— L’île des Saules ! le radeau ! Expliquez-moi…
— Je ne puis vous expliquer qu’une chose : j’ai promis de protéger ce nègre et c’est à vous de tenir ma promesse. Il faut que je voie si mon malade est bien installé, car je ne reviendrai que demain — ce qui doit achever de vous rassurer sur son compte, ajouta-t-il en me regardant.
Je n’osai pas remercier le docteur, qui m’évitait un interrogatoire dont j’aurais eu de la peine à me tirer. L’oncle Silas rejoignit les gens qui entouraient Jim et menaçaient aussi de le pendre s’il s’obstinait à ne pas dénoncer ses complices, « ces gueux d’abolitionnistes ». Jim ne dénonça personne. Il n’eut pas même l’air de me connaître. L’oncle Silas réussit à calmer les planteurs en les autorisant à monter la garde autour de la hutte et à pendre eux-mêmes le nègre à la première tentative d’évasion. Jim fut donc réintégré dans le cachot, dont on avait comblé le tunnel, et je pus dormir tranquille. Comme il n’était venu à l’esprit de personne que Tom et moi avions préparé l’évasion, on ne m’adressa aucune question gênante. Du reste, tante Sally ne quittait guère le parloir, où elle m’avait défendu d’entrer jusqu’à nouvel ordre. M. Phelps passait son temps à écrire des lettres et à rédiger des annonces, parce qu’il ne songeait qu’à se débarrasser de Jim.
Au bout de deux jours, j’appris que Tom allait de mieux en mieux. Il avait dormi toute la nuit ; le médecin déclarait que la fièvre avait presque disparu, et on me permit de voir le malade. Il dormait encore quand je me glissai dans le parloir. Tante Sally était là ; elle me fit signe de m’asseoir et posa un doigt sur ses lèvres.
— Vous devriez vous reposer, tante Sally, lui dis-je à voix basse ; je ne le réveillerai pas.
Au même instant Tom se réveilla tout seul.
— Est-ce que je rêve ? demanda-t-il en regardant autour de lui d’un air surpris. Non, me voilà à la maison. Comment cela se fait-il ? Où est le radeau ? Où est Jim ?
— Sois tranquille, il est en sûreté, répliquai-je.
— À la bonne heure ! Tu as tout raconté à tante Sally ?
— Tout quoi ? demanda tante Sally.
— Mais l’histoire de l’évasion de Jim. C’est nous qui l’avons délivré.
— Vous ? Voilà sa tête qui déménage encore !
— Non, tante Sally, elle ne déménage pas. C’est nous qui avons eu l’idée de mettre le prisonnier en liberté. L’affaire a été bien menée. Ça nous a coûté de la besogne, des semaines de besogne. Tu n’as pas idée du travail qu’il a fallu pour graver ces inscriptions, creuser le tunnel et fabriquer avec ton drap de lit la corde à nœuds, que Jim a reçue dans un pâté. Il ne voulait ni des rats, ni des araignées, ni des serpents à sonnettes ; mais j’ai insisté, parce qu’il y en a toujours dans les livres.
Tante Sally n’y comprenait rien ; elle écoutait, les yeux écarquillés, convaincue que le malade délirait ; mais son inquiétude fit place à la colère lorsque Tom, après avoir fourni d’autres explications qui n’étaient claires que pour moi, continua :
— Sans mes lettres anonymes, il n’y aurait pas eu de coups de fusil. C’est un peu votre faute, ma tante, s’ils sont partis trop tôt. Vous avez fait perdre près d’une heure le soir de l’évasion, et quand nous avons emmené Jim par le tunnel, nous n’avions plus assez d’avance.
— Comment, c’est vous qui… ? Non, cela n’est pas possible ! Vous étiez couchés là-haut, et on avait fermé les portes.
— Le paratonnerre nous servait d’escalier. Nous allions voir Jim tous les soirs pendant que vous dormiez. Oui, l’affaire a été bien menée !
— Je te conseille de t’en vanter. Dès que tu seras debout, je t’apprendrai à mettre la maison sens dessus dessous. Quant à toi, ajouta-t-elle en me saisissant par l’oreille, j’ai bien envie de t’enfermer avec le nègre.

— Hein ! est-ce que Jim n’est pas parti avec le radeau ? demanda Tom.
— Parti ! répliqua tante Sally. Il est sous clef, et cette fois il ne sortira de la hutte que pour être vendu aux enchères, si on ne vient pas le réclamer.
Tom se redressa dans son lit et me cria :
— Voilà ce que tu appelles être en sûreté ? Cours le délivrer. Personne n’a le droit de le vendre ou de le réclamer ! Jim n’est pas plus esclave que moi !
— Allons donc, répliqua tante Sally. Tout le monde sait qu’il s’est évadé de la Nouvelle-Orléans.
— Non ; il s’est évadé de Saint-Pétersbourg ; mais sa maîtresse, la vieille miss Watson, est morte il y a deux mois, et dans son testament elle l’a affranchi.
— Vous le connaissiez donc tous les deux ?
— Parbleu !
— Alors pourquoi ne l’as-tu pas averti tout de suite, puisque tu savais qu’il était affranchi ?
— Parce qu’il n’y aurait plus eu d’aventure. Jim serait sorti tranquillement de son cachot, et on ne trouve pas souvent un prisonnier à faire évader… Tante Polly !
Oui, c’était tante Polly qui venait d’ouvrir la porte. Sa sœur commença par lui sauter au cou et, avant qu’elle eût eu le temps de se retourner, j’étais sous le lit. Les embrassades ne durèrent pas longtemps, car bientôt j’entendis une voix qui disait :
— Ah ! tu n’oses pas me regarder en face, Tom, et cela ne m’étonne pas. J’en ai appris de belles sur ton compte !
— Mais c’est Sid, s’écria Mme Phelps. Tom était là il y a un instant. Où donc a-t-il passé ?
— Tu veux dire Huck Finn, répliqua tante Polly. Je n’ai pas élevé un mauvais garnement comme mon Tom pour ne pas le reconnaître… Sors de là, Huck !
C’est ce que je fis au moment où M. Phelps apparaissait à son tour et on finit par se débrouiller un peu. Tom eut beau prendre ma défense — comme il avait eu la chance d’être blessé, ce fut moi qui fus le plus malmené.
— Voyons, dit-il, Huck ne vous a pas trompée, tante Sally. Il voulait seulement délivrer Jim, et c’est vous qui l’avez pris pour moi. Sans mon arrivée au bon moment, il n’y aurait pas eu d’aventure.
— Non, ajoutai-je, et si j’avais su que Jim était libre, il n’y aurait pas eu de coups de fusil non plus, madame Phelps.
— Là, tu peux continuer à m’appeler tante Sally, répondit Mme Phelps, j’y suis habituée.
Puis elle voulut en avoir le cœur net à propos du testament de miss Watson.
— Ah ! par exemple, dit Tom, je n’ai pas inventé ça.
Alors seulement je cessai de m’étonner qu’un garçon aussi bien élevé que Tom Sawyer eût consenti sans hésiter à se mêler de l’évasion. C’est parce qu’il savait que Jim était libre qu’il m’avait aidé à le délivrer. Mais il y avait un autre mystère qui intriguait tante Polly.
— Je t’ai écrit trois fois, dit-elle à sa sœur, pour savoir ce que tu voulais dire en m’annonçant que Sid était arrivé à bon port. Pourquoi ne m’as-tu pas répondu ?
— Je n’ai reçu aucune lettre de toi, et pourtant Tom allait tous les jours à la poste, répliqua Mme Phelps.
— Tom, où sont ces lettres ? demanda tante Polly.
— Elles sont là-haut dans notre chambre ; je ne les ai pas ouvertes. J’ai pensé que cela ne pressait pas.
— Tu mériterais d’être écorché vif, Tom !
— Eh bien, tante Polly, j’ai été écorché. Si tu veux voir ma jambe…
Alors, au lieu de continuer à le gronder, tante Polly l’embrassa.
— Dis donc, demandai-je à Tom le premier jour où il put sortir, quelle était ton idée si nous avions réussi à partir avec Jim ?
— Oh ! j’avais mon plan, Huck. Je voulais l’emmener sur le radeau jusqu’à l’embouchure du fleuve pour avoir toutes sortes d’aventures comme toi. Ensuite, nous lui aurions annoncé qu’il était libre et nous l’aurions reconduit à Saint-Pétersbourg à bord d’un steamer. Je me serais arrangé pour prévenir le monde de son retour et pour arriver la nuit. Tous les nègres seraient venus au-devant de nous, musique en tête, avec des torches ; ils nous auraient portés en triomphe…
— Tu crois ?
— J’en suis sûr, répondit Tom en poussant un gros soupir. Le coup est manqué. On a mis le grappin sur notre radeau et on a tant gâté Jim qu’il refuserait de bouger.
Il va sans dire que Jim n’était pas resté longtemps dans son cachot. Lorsque tante Polly avait appris qu’il s’était dévoué par amitié pour Tom, elle l’avait rhabillé à neuf et offert de le prendre à son service. En attendant notre départ, il vivait comme un coq en pâte et ne se plaignait nullement de n’avoir pas de rats à apprivoiser. Tom lui avait donné 40 dollars, non en récompense de son dévouement, mais pour avoir si bien rempli son rôle de prisonnier.
— Là, massa Huck, s’écria le nègre en faisant sauter les dollars dans sa main, ne vous avais-je pas dit que je redeviendrais riche un jour, parce que j’ai les bras longs ? C’est un signe qui ne rate jamais. Avec cet argent et celui que je gagnerai je finirai par avoir de quoi racheter ma femme.
— Eh bien, répliqua Tom, j’irai causer avec M. Thatcher à notre retour là-bas et tu finiras par avoir de quoi plus tôt que tu ne penses.
— Oui, ajoutai-je, et si Mme Douglas tient toujours à me civiliser, je tâcherai de me laisser faire, pourvu qu’elle vienne en aide à Jim.
— Tu auras raison, me dit Tom, car elle t’a joliment regretté. Ce n’est pas elle qui nous empêchera de nous amuser. Elle a presque promis de demander à notre tuteur, M. Thatcher, de m’acheter un fusil aux vacances prochaines, et j’espère que tu en auras un aussi.
— Un fusil ! quelle chance !… Mais non… Tu oublies que M. Thatcher ne doit plus avoir d’argent à moi. On me croyait mort et mon père n’aura pas manqué de réclamer ma part.
— Tu te trompes. Tes 6 000 dollars sont toujours là, avec les intérêts. Ton père ne s’est pas remontré.
— Il ne reviendra jamais, dit le nègre.
— Comment le sais-tu ?
— N’importe comment je le sais ; il ne reviendra pas.

Pressé de questions, Jim finit par répondre :
— Eh bien, c’est lui qui était dans la maison
flottante où nous sommes entrés avant de quitter
l’île Jackson. Voilà pourquoi il ne reviendra pas.
Mes aventures sont finies, car tante Polly nous a ramenés à Saint-Pétersbourg, où je suis en train de me civiliser. Mon vieux Jim possède une petite ferme que sa femme et ses deux enfants l’aident à cultiver. Si Tom boite encore un peu de temps à autre, c’est qu’il le fait exprès ; il est bien aise qu’on lui demande à voir la balle qui l’a blessé et qui figure parmi les breloques attachées à sa chaîne de montre.
TABLE DES MATIÈRES
