Mémoires de Suzon sœur de D. B., éd. 1778/1
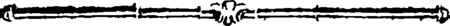
PRÉFACE.
Ces Mémoires n’auroient jamais vu le jour, ſi j’avois pu réſiſter aux inſtances d’une perſonne à qui j’ai les plus grandes obligations & avec qui je paſſe une vie paiſible & agréable. Que dis-je ? Vous n’auriez jamais connu, mon cher Comte, le dépôt que m’a confié mon amie, ſi vos bontés pour moi & vos procédés généreux n’avoient excité ma confiance. Dès que je vous les eus communiqués, vous me fîtes voir ſi clairement combien ils pouvoient être utiles aux jeunes perſonnes, qui ne ſont jamais aſſez en garde contre les ſéductions des hommes, pour réſiſter à tous les piéges qu’ils leur tendent, que je me déterminai enfin à les rendre publics : mais il eſt bon de vous inſtruire, cher Lecteur, comment ces Mémoires ſont tombés entre mes mains.
Ce fut au moment où Suzon partoit pour ce lieu affreux, dont la vue ſeule effraie les paſſans, où l’œil ne voit qu’horreur, où les cris perçans des malheureuſes victimes qu’il renferme dans ſon ſein, déchirent les entrailles des perſonnes les moins ſenſibles, que je reçus ce cher dépôt.
Tiens, me dit mon amie que de cruels ſatellites arrachoient de mes bras & de ceux de ſon frere Saturnin, reçois ce gage précieux de mon amitié… Les malheurs de Suzon ne devoient finir qu’avec ſa vie… Plût à Dieu que ce dernier malheur termine ma carriere… Sa douleur, ſa beauté dont rien n’avoit pu, pour ainſi dire, ternir l’éclat, auroient adouci les tigres les plus furieux : mais que des ſatellites, en exécutant les ordres dont ils ſont chargés, aient jamais témoigné la moindre compaſſion, ce phénomene ſurprendroit avec raiſon. Ces monſtres ne pourroient jamais faire leur cruel métier, ſi en endoſſant l’habit qu’ils portent, ils ne ſe dépouilloient de tout ſentiment d’humanité. Dans la crainte qu’ils ne ſoient pas capables au beſoin d’exercer les plus grandes cruautés, leurs chefs n’emploient que des hommes qui ſe ſont la plupart ſignalés par des forfaits. Mais revenons à ma chere Suzon. Cette tendre amie étoit déjà loin de moi, & il me ſembloit encore que je la voyois me tendre les bras ; mes cris, mes ſanglots ſe faiſoient entendre juſques dans la rue, où le peuple attroupé inſultoit encore au malheur de mon amie. Je voulois fuir de ce lieu d’horreur ; mais les forces me manquerent. Je ſentis mes jambes chanceler ſous moi, bientôt une ſueur froide me couvrit tout le corps. Enfin, je tombai ſans connoiſſance ſur le plancher. La quantité de monde qui étoit dans notre rue excita la curioſité du Comte de C***** qui paſſoit par hazard dans ce moment : il s’informa de ce qui étoit arrivé, déſirant de ſavoir d’où partoient les cris qu’on lui dit avoir entendus, il ſe fit jour au travers de la foule & parvint juſques dans ma chambre. J’étois alors entourée de cinq ou ſix femmes qui employoient tous les ſecours que leur imagination pouvoit leur ſuggérer, pour me tirer de l’état où j’étois. Le Comte voyant le peu d’efficacité de tous leurs remedes, ſortit de ſa poche un flacon qui contenoit un élixir ſi ſpiritueux & ſi ſalutaire aux perſonnes qui ſe trouvent mal, que j’en eus à peine ſur les levres que la connoiſſance me revint auſſi-tôt. Le Comte fut la premiere perſonne qui frappa mes regards. Quelle fut ma ſurpriſe, en voyant un Seigneur dont l’air noble & majeſtueux en impoſoit aux femmes qui m’entouroient, oublier lui-même ſon rang & ſa qualité, pour me procurer des ſecours ? Que de nobleſſe il montroit dans ſes regards ? Que de ſenſibilité ſon viſage annonçoit ! Combien ſa voix étoit propre à remettre le calme dans mon ame ! Il me parut, en un mot, un Ange deſcendu du Ciel, pour me retirer de l’abîme où mon malheur m’entraînoit. Conſolez-vous, Mademoiſelle, me dit le Comte de C***** ; ce qui vient de vous arriver, loin de rendre votre ſort malheureux, va peut-être le faire changer de face, ſur-tout, ſi vous voulez être ſage. Je veux vous mettre pour toujours dans le cas de n’avoir rien à redouter des caprices de la fortune. Je vais, au ſortir d’ici, vous louer un appartement que je ferai meubler par mon tapiſſier, & je viendrai moi même ce ſoir vous chercher pour vous y conduire, & vous en rendre la maîtreſſe.
Ce diſcours me ſurprit tellement que je ne trouvai point d’expreſſions pour remercier ce Seigneur de cette généroſité inattendue. La profonde révérence que je fis, indiquoit ſeulement que la propoſition ne me déplaiſoit pas. Le Comte s’en contenta & ſortit un inſtant après, ſans paroître étonné de mon ſilence. Quant à moi, quoique toujours affligée de la perte de mon amie, m’occupai à faire un paquet de mes hardes.
Dans le moment que ce généreux Seigneur ſortoit de ma chambre, la vieille Sibylle, chez qui nous étions, ma chere Suzon & moi, & qui m’avoit débauchée de chez mes parens, entra auſſi raſſurée depuis le départ des Archers, qu’elle avoit paru effrayée à leur arrivée. Elle me demanda ſi la perſonne qu’elle venoit de rencontrer ſortoit d’avec moi, & quel bénéfice ſa viſite avoit produit. Un très-grand, Madame, lui dis-je, auſſi-tôt, le babil m’étant revenu, je lui fis le détail de ſa douceur & de ſa ſenſibilité, & je n’omis pas ſur-tout de lui parler de la propoſition qu’il m’avoit faite de m’entretenir. Il y avoit trop long temps que je déſirois de quitter cette méchante femme, pour chercher à adoucir le chagrin que devoit lui occaſionner notre ſéparation. Malgré tous les ſoins qu’elle prit pour cacher la douleur que lui cauſoit cette nouvelle, elle en étoit trop étonnée pour qu’elle pût me voiler une partie de ſon trouble. À la fin cependant, faiſant un effort ſur elle-même, elle me dit avec une ſorte d’intérêt : tu n’as pas ſurement eu la folie de refuſer une propoſition auſſi avantageuſe. Je te l’avois toujours bien dit, ma chere Roſalie, que je ſerois la cauſe de ton bonheur. Je te crois trop raiſonnable pour ne pas convenir que tu n’aurois jamais dû, ni pu prétendre à un pareil ſort, ſi tu fuſſes reſtée chez tes parens. Reproche-moi donc, me dit-elle d’un ton mielleux, de t’avoir arrachée des bras de ta famille ? Elle auroit encore parlé plus long-temps, selon ſa louable coutume, que je n’aurois pas prêté plus d’attention à ce qu’elle diſoit. J’étois trop occupée de tout ce qui venoit de m’arriver, pour répondre à cette femme, dont le caquet m’avoit de tout temps ennuyée. Voyant à la fin que par mon ſilence je paroiſſois faire peu de cas de tous ſes diſcours, elle réveilla mon attention, en me rappellant que nous avions un compte à régler enſemble. Je le ſais, Madame, lui dis-je, & ſoyez bien perſuadée que je ne ſortirai point de chez vous, que vous ne ſoyez ſatisfaite. Les Meres Abbeſſes de ce pays ont toutes la ſage précaution que les filles qui ſont chez elles leur doivent, afin d’avoir un prétexte pour les retenir. J’avois affaire à une femme qui ſavoit trop bien ſon métier, pour être exceptée de la regle générale : je ne m’attendois pas, à la vérité, en me rappellant les profits que j’avois faits, être redevable d’une ſomme bien forte. Le contraire cependant arriva. J’eus beau crier : il en fallut paſſer par tout ce qu’on voulut. En un mot, le mémoire fut arrêté.
Sur le ſoir le Comte arriva, ainſi qu’il me l’avoit promis ; il me gronda de ce que je paroiſſois toujours affligée, Reprenez, Mademoiſelle, me dit-il, reprenez votre gaité : votre amie n’eſt pas perdue pour vous. J’aurois même déjà obtenu ſa liberté, ſi la maladie qu’elle a ne s’y étoit oppoſée. Je vous promets qu’elle ſera libre auſſi tôt après ſon entiere guériſon. J’appris alors de mon cher Comte que Suzon n’avoit été priſe, que parce qu’elle avoit donné la vérole à un jeune homme de famille, & que ce jeune homme avoit porté des plaintes à la Police contre elle. Cette nouvelle me fut d’autant plus agréable, que j’eſpérois faire part de mon bonheur à mon amie, & qu’elle me prouvoit que mon cher Comte commençoit déjà à chercher des occaſions de me faire plaiſir. Il m’aſſura, en des termes qui me peignoient ſon amour, qu’il auroit pour moi tant d’égards & de complaiſances, qu’il eſpéroit bientôt bannir de mon eſprit tous les chagrins que j’avois éprouvés. Ce qui vous ſurprendra peut-être, cher lecteur, c’eſt que perſonne n’a jamais été plus exact à tenir ſa parole. D’abord il paya tout ce que je devois ; il pouſſa même le déſintéreſſement juſqu’à vouloir que le paquet qui renfermoit mon linge & mes habits, fût donné à mon hôteſſe. Mais j’étois bien éloignée d’y conſentir. Je voulois que ces mêmes habits, en me rappellant l’état d’où j’avois été tirée, ſerviſſent auſſi à me faire reſſouvenir de mes devoirs. Tout fut donc porté, ſelon mes deſirs, dans le carroſſe du Comte, qui nous attendoit à la porte, & qui nous mena au fauxbourg S. Germain, où mon appartement avoit été loué. Les meubles qui le garniſſoient étoient ſimples, mais propres & choiſis avec goût. Ce ne fut que quelque temps après mon arrivée dans ce quartier, que j’examinai tout ce qui compoſoit mon mobilier. J’avois paſſé ce jour-là par trop d’épreuves différentes pour faire une remarque. Mes domeſtiques n’étoient point nombreux. Aurois-je pu déſirer plus de monde pour me ſervir, qu’un laquais, une femme de chambre, & une cuiſiniere ; moi, qui la veille me ſerois trouvée au comble du bonheur, si je m’étois vue une ſimple ſervante à mes gages ? Je tairai tout ce que leur dit le Comte pour les engager à être exacts à leur devoir, afin de ne point ennuyer le lecteur par mille détails inutiles ; & je vais paſſer à la maniere dont ſe termina la ſoirée.
Nous ſoupâmes de très-bonne heure ; pendant tout le repas, mon amant chercha, par tant d’agaceries, à faire renaître ma joie, que je ne pus m’empêcher de rire à quelques-unes de ſes folies. Il auroit été impoſſible, quand il m’en auroit beaucoup coûté pour me contraindre, de ne pas au moins affecter un air gai. Les complaiſances & les attentions du Comte exigeoient ſans doute ce ſacrifice.
Nous étions à peine ſortis de table, que vis mon amant ſe diſpoſer à ſe retirer. Quoi ! de ſi bonne heure, lui dis-je, M. le Comte ? Oui, ma chere Roſalie, me répondit-il ; vous devez avoir beſoin de repos ; demain je pourrai, ſans vous incommoder, reſter plus long-temps avec vous ; mais il y auroit du danger pour votre ſanté de le faire aujourd’hui. Mettez-vous au lit dès que je ſerai ſorti, & tâchez de bien dormir. Auſſi-tôt il vint m’embraſſer, & ſe retira. Avec quelle ſurpriſe je le vis partir ! malgré toute la bonne opinion que me donnoit de lui une conduite auſſi retenue, j’étois bien éloignée de penſer qu’un Seigneur riche, aimable, âgé de vingt-deux ans, pût avoir autant d’égards & de ménagemens que lui, pour une fille qui étoit en ſa puiſſance, & qu’il avoit retirée d’un lieu de débauche.
Ce que je vais dire étonnera encore plus, ſur-tout ces vieillards décrépits, qui emploient le ſouffle de vie qui leur reſte à être les bourreaux des filles, qui ne ceſſent de les tourmenter & de les faire ſervir à leurs goûts lubriques : que dis-je ? qui cherchent en vain, par des attitudes fatigantes & auſſi mauſſades que leur figure, à ranimer un feu que l’âge a pour jamais éteint dans leurs veines. Dans quel étonnement, dis-je, je te jeterois, cher lecteur, ſi je te diſois que mon amant a vécu avec moi une année entiere, avec les mêmes égards & les mêmes déférences qu’on a pour les filles les plus honnêtes. Je dis plus : il a voulu devoir à l’amour tous les plaiſirs qu’il a goûtés & qu’il goûte continuellement dans mes bras. Vous riez sûrement de ſa conduite ; vous le comparez à ce Marquis de Rozelle, qui vouloit prendre pour femme une Actrice de l’Opéra, que le prétendu repentir de ſa vie paſſée lui faiſoit paroître plus estimable que ſi elle n’eût jamais fait de fautes. Soyez de bonne foi, vous croyez même lui faire grace en le comparant à un jeune homme nouvellement ſorti de ſon Collége, qui, tourmenté par la paſſion de l’amour, n’oſe faire les premieres avances à une femme, & trembleroit même de lâcher un propos équivoque qui pourroit l’offenſer. Dans quelle erreur groſſiere vous êtes, & combien vous êtes loin de juger du cœur de mon amant ! Il vouloit, en me témoignant beaucoup d’eſtime, m’apprendre que le moyen le plus sûr pour lui plaire étoit de m’eſtimer aſſez moi-même pour ne pas lui manquer.
Si cette voie peut quelquefois faire donner lourdement dans les piéges des femmes, elle eſt cependant beaucoup plus sûre pour l’homme qui ne ſe laiſſe pas aveugler par la paſſion, que tous les moyens qu’on emploie ordinairement. La jouiſſance d’une femme, dont on peut ſe dire aimé avec raiſon, & qu’on eſtime & qu’on aime ſoi-même, n’a-t elle pas mille fois plus de charmes que toutes ces liaiſons qui n’ont pour baſe qu’un intérêt vil & ſordide ? Mes ſentimens étoient ſi bien d’accord avec ceux de mon cher Comte, qu’il eſt impoſſible que la fortune raſſemble jamais deux êtres plus faits l’un pour l’autre : auſſi quelle différence on trouvera entre toutes les femmes entretenues & moi ! toutes n’aiment & n’eſtiment dans leurs amans que l’argent qu’ils leur donnent, & que les préſens qu’ils leur font. Le plaiſir qu’elles trouvent à leur être infidelles en a porté pluſieurs à ſe faire baiſer par le dernier des laquais, faute de pouvoir donner leurs faveurs à d’autres.
Au reſte, il faut convenir que les hommes en général le méritent bien ; ils auroient même tort d’exiger qu’un ſexe plus foible que le leur, les fît ſouvent rougir de leur inconſtance. Comme ils ſont moins tourmentés par le deſir de remplir le vide de leur cœur, que par l’envie, en changeant de maîtreſſes, de ſatisfaire leur paſſion brutale, qu’ils volent de conquêtes en conquêtes, une ſeule ne pourroit jamais ſe prêter à leurs goûts auſſi bizarres qu’extraordinaires, trop heureux ſi par quelque maladie cruelle ils ne paient un jour bien chérement les plaiſirs de l’inconſtance. Combien ils ont à redouter le ſort de ma chere Suzon, qui eſt morte, ainſi que je l’ai appris, huit jours après notre ſéparation, dans l’Hôpital de Bicêtre, pour avoir trop négligé d’arrêter les progrès de ſa maladie. Sa perte me ſera toujours d’autant plus ſenſible, que j’ai perdu en elle ma meilleure amie. Elle étoit moins débauchée par goût que par tempéramment. Son cœur malgré la vie qu’elle menoit depuis long-temps, lorſque je commençai à la connoître, n’étoit pas plus corrompu que ſi elle eût toujours eu une conduite réguliere : enfin c’étoit moins pour l’argent qu’elle retiroit du commerce des hommes, qu’elle ſe livroit à eux, que pour le plaiſir qu’elle trouvoit dans la jouiſſance. Avec moins de paſſions, elle n’auroit eu aucun des vices qu’on reproche aux femmes. Elle étoit de bon conſeil, & m’a ſouvent donné des avis dont j’aurais bien fait de profiter. Comme elle ne remarquoit en moi aucun penchant pour le malheureux état que j’avois embraſſé, elle m’a pluſieurs fois conſeillé de retourner chez mes parens. Une réſolution auſſi généreuſe auroit trop coûté à mon amour-propre pour l’exécuter, & j’aurois mieux aimé être mille fois plus malheureuſe que je ne l’étois, plutôt que de rentrer dans ma famille. Quoique ma chere Suzon ſoit perdue pour moi ſans retour, c’eſt dans la lecture de ſes Mémoires que je trouve des leçons plus inſtructives que dans tous les livres que je lis : c’eſt en voyant le tableau de ſes foibleſſes, que j’apprends à être toujours en garde contre les miennes : Auſſi je les ai toujours dans les mains dès que je ſuis ſeule. Chaque anecdote de ſa vie eſt pour moi tous les matins un objet de méditation.
Un jour que j’étois abſorbée dans les réflexions que m’occaſionnoit cette lecture, & que je tenois les Mémoires de Suzon à la main, le Comte entra dans ma chambre. Comme ma femme de chambre qui venoit de ſortir de mon appartement, en avoit laiſſé la porte ouverte, il fit ſi peu de bruit, qu’il étoit près de moi, que je ne m’en étois pas apperçue. Mon premier mouvement fut de cacher le cahier ſous le couſſin de mon fauteuil. Mais il n’étoit plus temps ; il avoit été témoin de mon embarras à ſon arrivée, & avoit remarqué le myſtere que je voulois lui faire. Cette précaution inutile ne ſervit qu’à le chagriner, & qu’à lui faire voir le peu de confiance que j’avois en lui. L’air froid avec lequel il m’aborda contre ſon ordinaire, me l’annonçoit aſſez. Mais je feignis de pas m’en appercevoir. Comment vous portez-vous aujourd’hui, me dit-il ; avez-vous bien dormi cette nuit ? Il m’auroit fait encore, je crois, cent autres queſtions auſſi indifférentes, ſi j’avois pû les ſoutenir & ſi je n’avois rompu cette mauſſade & inſipide converſation. Qu’avez-vous, M. le Comte, aujourd’hui, lui dis je ? L’altération qui paroît ſur votre viſage, ces ſoupirs qui s’échappent malgré vous, vos yeux qui évitent de rencontrer les miens, en un mot tout ce que je vois m’accable de douleur, & ſembleroit m’annoncer que j’ai déjà eu le malheur de vous déplaire. Parlez, mon cher Comte, duſſiez-vous prononcer l’arrêt de ma mort, il ſeroit moins dur pour moi de l’entendre de votre bouche, que de demeurer dans l’état où vous avez la cruauté de me laiſſer. J’accompagnai ces dernieres paroles d’un torrent de larmes. Mon Amant ne put voir mes pleurs ſans s’attendrir. Pourquoi vous chagriner ainſi, me dit-il, ma chere Roſalie ? Les ſujets de plaintes que j’ai à former contre vous, me chagrinent, mais ne peuvent jetter aucune eſpece de ſoupçon, ni ſur votre probité, ni ſur votre amour pour moi. À la vérité, je me rends juſtice & je ſens qu’il n’y a pas aſſez de temps que je vous connois, pour que vous m’ayez accordé toute votre confiance, malgré tout ce que j’ai fait pour vous prouver que je n’en étois pas indigne : d’ailleurs je ſens qu’on redoute toujours avec raiſon l’indiſcrétion des jeunes gens de mon âge. Je ſuis donc fâché du myſtere que vous me faites ; mais je me garderai bien d’exiger de voir ce manuſcrit que vous avez caché à mon arrivée. Puis prenant inſenſiblement un ton plaiſant ; peut-être eſt-ce, me dit-il, le tableau de vos foibleſſes dont vous aurez fait l’eſquiſſe ? Dans ce cas, je ne suis plus ſi étonné du deſir que Vous avez qu’il ſoit ignoré de toute la terre. Dejà même je me reproche d’avoir pû vous laiſſer entrevoir que je ne voulois pas que vous euſſiez des ſecrets pour moi : ceux-là ſont privilégiés & très-privilégiés ; car je ſais combien il en coûte à une jolie femme d’avouer qu’elle s’eſt quelquefois mal défendue contre les hommes.
Que vous êtes loin de deviner, mon cher Comte, lui dis-je, ce que contient ce cahier ! vous avez beau affecter beaucoup d’indifférence à le lire ; il vous ſera fort difficile de me faire accroire que vous ne brûlez pas d’envie de l’avoir entre les mains, ou du moins, tout me le perſuade. Le chagrin que vous avez d’abord témoigné en me le voyant cacher ; le ton plaiſant que vous venez de prendre, depuis que vous vous êtes apperçu que vous m’aviez fait de la peine, ſont autant de moyens que vous employez pour ſatisfaire votre curioſité. Tenez, lui dis-je, je ne veux pas vous faire languir davantage : voilà ce que vous avez tant déſiré. Puiſſai-je, en dépoſant dans votre ſein le ſecret d’une amie dont la perte m’affligera toujours, vous prouver combien je ſuis fâchée d’avoir pû manquer un inſtant de confiance en vous ! Puiſſe votre Amante par ce ſacrifice, vous faire voir qu’elle ne veut jamais avoir rien de caché pour vous !
Le Comte fit d’abord des difficultés pour prendre ce cahier, m’aſſurant qu’il ne ſe pardonneroit jamais le chagrin qu’il m’avoit cauſé, & que dans la ſuite il ne ſeroit plus auſſi curieux. Comme je voulois abſolument qu’il prît connoiſſance des Mémoires de ma chere Suzon qui avoient donné lieu au mouvement de jalouſie qu’il avoit éprouvé, il y conſentit, après s’être fait long-temps prier, mais à condition que je les lirois moi-méme.
Après bien des je ne veux pas… je les ai déjà lus… il fallut céder ; parce que, diſoit-il, le ſon de ma voix portoit dans ſon ame le plus grand raviſſement. Ce compliment étoit bien propre à flatter la vanité d’une femme & ſur-tout d’une jeune perſonne ; mais pour dire la vérité ce n’étoit qu’un prétexte honnête pour colorer le déſir qu’avoit mon Amant de ne laiſſer échapper aucune des impreſſions, que le récit des différentes aventures d’une femme que j’avois beaucoup aimée devoit faire ſur moi.
