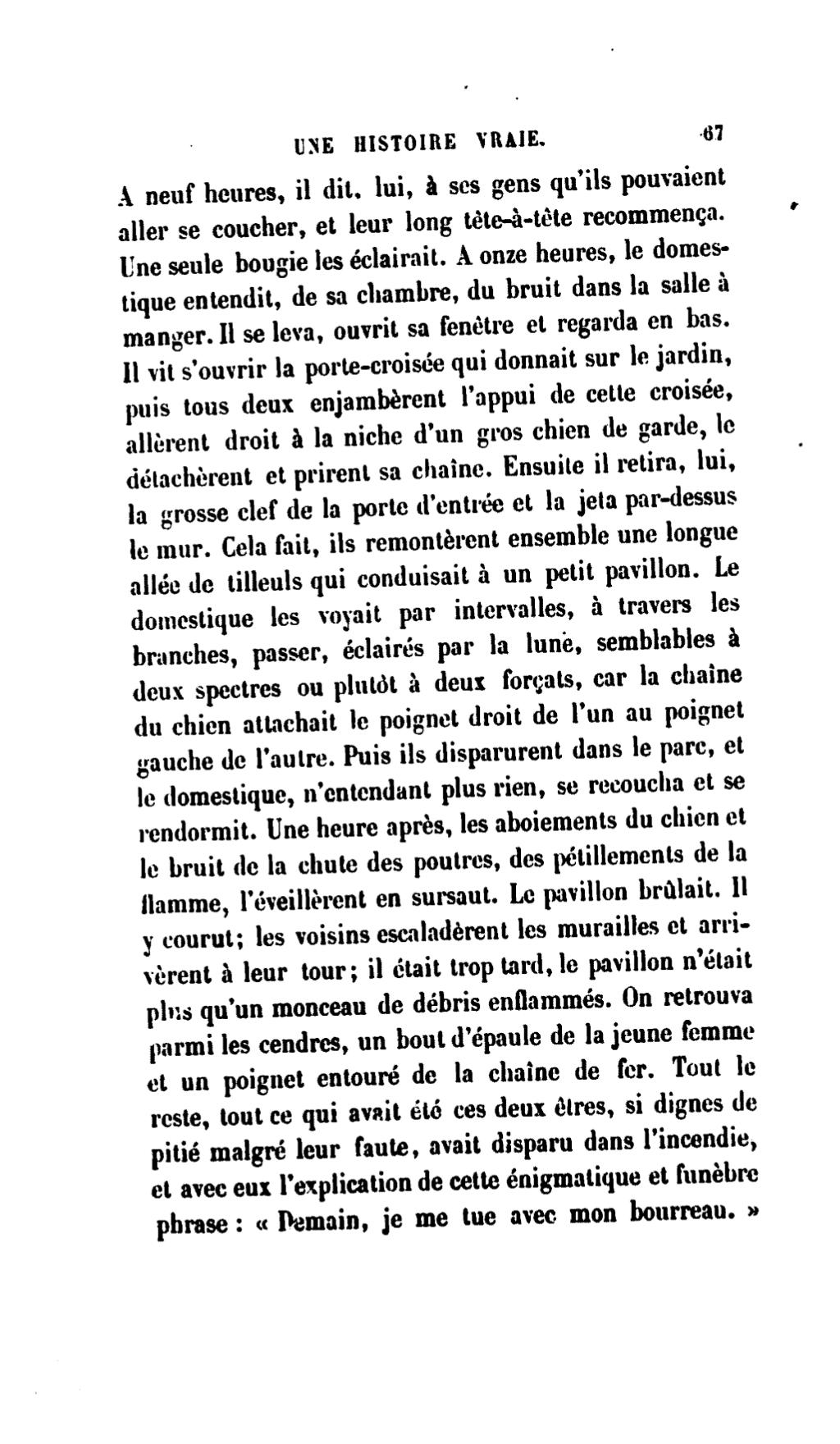neuf heures, il dit, lui, à ses gens qu’ils pouvaient aller se coucher, et leur long tête-à-tête recommença. Une seule bougie les éclairait. A onze heures, le domestique entendit, de sa chambre, du bruit dans la salle à manger. Il se leva, ouvrit sa fenêtre et regarda en bas. Il vit s’ouvrir la porte-croisée qui donnait sur le jardin, puis tous deux enjambèrent l’appui de cette croisée, allèrent droit à la niche d’un gros chien de garde, le détachèrent et prirent sa chaîne. Ensuite il retira, lui, la grosse clef de la porte d’entrée et la jeta par-dessus le mur. Cela fait, ils remontèrent ensemble une longue allée de tilleuls qui conduisait à un petit pavillon. Le domestique les voyait par intervalles, à travers les branches, passer, éclairés par la lune, semblables à deux spectres ou plutôt à deux forçats, car la chaîne du chien attachait le poignet droit de l’un au poignet gauche de l’autre. Puis ils disparurent dans le parc, et le domestique, n’entendant plus rien, se recoucha et se rendormit. Une heure après, les aboiements du chien et le bruit de la chute des poutres, des pétillements de la flamme, l’éveillèrent en sursaut. Le pavillon brûlait. Il y courut ; les voisins escaladèrent les murailles et arrivèrent à leur tour ; il était trop tard, le pavillon n’était plus qu’un monceau de débris enflammés. On retrouva parmi les cendres, un bout d’épaule de la jeune femme et un poignet entouré de la chaîne de fer. Tout le reste, tout ce qui avait été ces deux êtres, si dignes de pitié malgré leur faute, avait disparu dans l’incendie, et avec eux l’explication de cette énigmatique et funèbre phrase : « Demain, je me tue avec mon bourreau. »