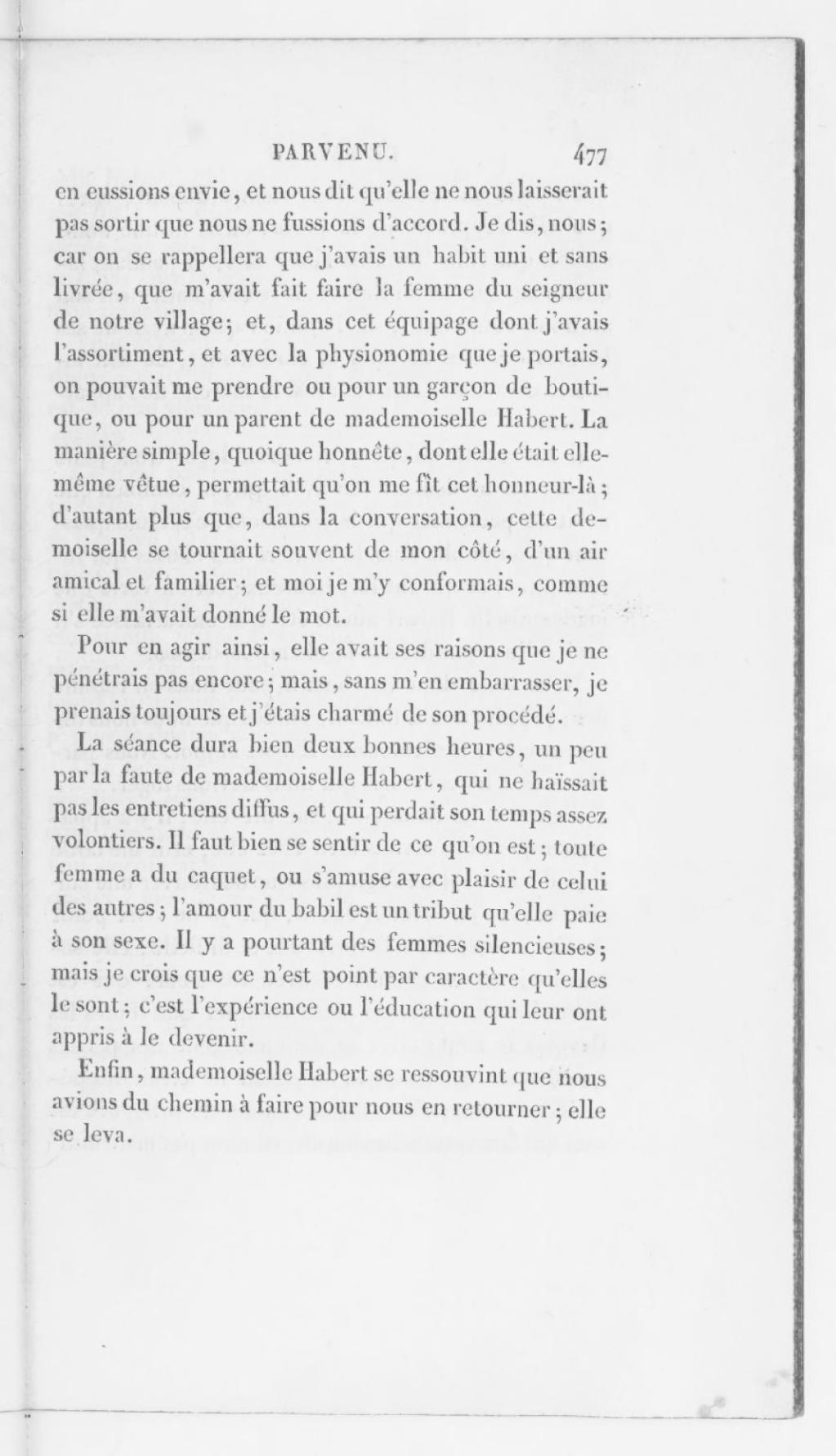en eussions envie, et nous dit qu’elle ne nous laisserait pas sortir que nous ne fussions d’accord. Je dis nous ; car on se rappellera que j’avais un habit uni et sans livrée que m’avait fait faire la femme du seigneur de notre village ; et dans cet équipage dont j’avais l’assortiment, avec la physionomie que je portais, on pouvait me prendre ou pour un garçon de boutique, ou pour un parent de Mlle Habert. Et la manière simple, quoique honnête, dont elle était elle-même vêtue, permettait qu’on me fît cet honneur-là, d’autant plus que, dans la conversation, cette demoiselle se tournait souvent de mon côté, d’un air amical et familier ; et moi je m’y conformais comme si elle m’avait donné le mot.
Pour en agir ainsi, elle avait ses raisons que je ne pénétrais pas encore, mais sans m’en embarrasser, je prenais toujours et j’étais charmé de son procédé.
La séance dura bien deux bonnes heures, un peu par la faute de Mlle Habert, qui ne haïssait pas les entretiens diffus, et qui y perdait son temps assez volontiers. Il faut bien se sentir de ce qu’on est : toute femme a du caquet, ou s’amuse avec plaisir de celui des autres ; l’amour du babil est un tribut qu’elle paye à son sexe. Il y a pourtant des femmes silencieuses, mais je crois que ce n’est point par caractère qu’elles le sont ; c’est l’expérience ou l’éducation qui leur ont appris à le devenir.
Enfin Mlle Habert se ressouvint que nous avions du chemin à faire pour nous en retourner ; elle se leva.