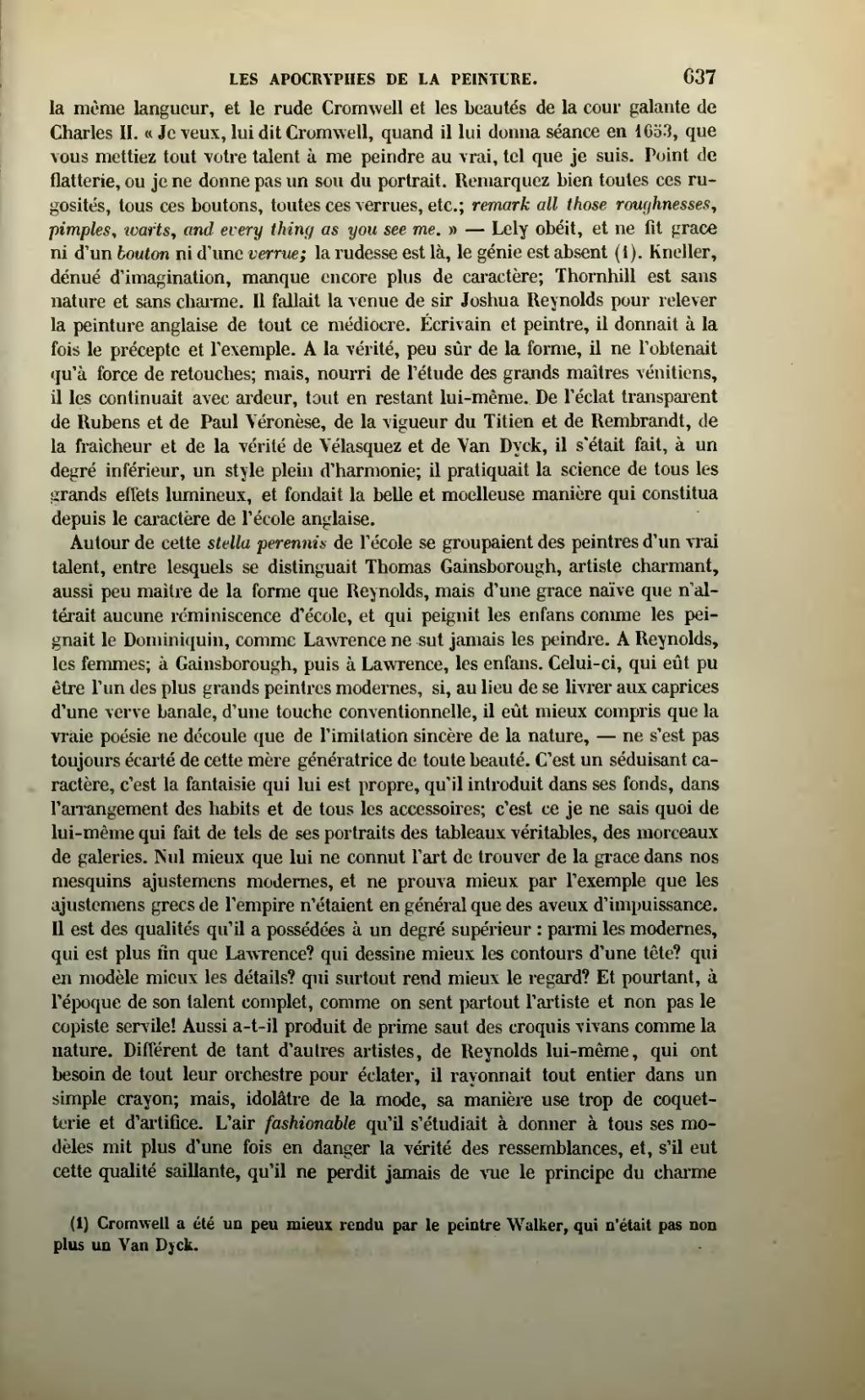la même langueur, et le rude Cromwell et les beautés de la cour galante de Charles II. « Je veux, lui dit Cromwell, quand il lui donna séance en 1653, que vous mettiez tout votre talent à me peindre au vrai, tel que je suis. Point de flatterie, ou je ne donne pas un sou du portrait. Remarquez bien toutes ces rugosités, tous ces boutons, toutes ces verrues, etc. ; remark all those roughnesses, pimples, warts, and eveny thing as you see me. » — Lely obéit, et ne fit grace ni d’un bouton ni d’une verrue ; la rudesse est là, le génit est absent[1]. Kneller, dénué déimagination, manque encore plus de caractère ; Thornhill est sans nature et sans charme. Il fallait la venue de sir Joshua Reynolds pour relever la peinture anglaise de tout ce médiocre. Ecrivain et peintre, il donnait à la fois le précepte et l’exemple. À la vérité, peu sûr de la forme, il ne l’obtenait qu’à force de retouches ; mais, nourri de l’étude des grands maîtres vénitiens, il les continait avec ardeur, tout en restant lui-même. De l’éclat transparent de Rubens et de Paul Véronèse, de la vigueur du Titien et de Rembrandt, de la fraîcheur et de la vérité de Vélasquez et de Van Dyck, il s’était fait, à un degré inférieur, un style plein d’harmonie ; il pratiquait la science de tous les grands effets lumineux, et fondait la belle et moelleuse manière qui constitua depuis le caractère de l’école anglaise.
Autour de cette stella perennis de l’école se groupaient des peintres d’un vrai talent, entre lesquels se distinguait Thomas Gainsborough, artiste charmant, aussi peu maître de la forme que Reynolds, mais d’une race naïve que n’altérait aucune réminiscence d’école, et qui peignit les enfans comme les peignait le Dominiquin, comme Lawrence ne sut jamais les peindre. À Reynolds, les femmes ; à Gainsborough, puis à Lawrence, les enfans. Celui-ci, qui eût pu être l’un des plus grands peintres modernes, si, au lieu de se livrer aux caprices d’une verve banale, d’une touche conventionnelle, il eût mieux compris que la vraie poésie ne découle que de l’imitation sincère de la nature, — ne s’est pas toujours écarté de cette mère génératrice de toute beauté. C’est un séduisant caractère, c’est la fantaisie qui lui est propre, qu’il introduit dans ses fonds, dans l’arrangement des habits et de tous les accessoires ; c’est ce je ne sais quoi de lui-même qui fait de tels de ses portraits des tableaux véritables, des morceaux de galeries. Nul mieux que lui ne connut l’art de trouver de la grace dans nos mesquins ajustemens modernes, et ne prouva mieux par l’exemple que les ajustemens grecs de l’empire n’étaient en général que des aveux d’impuissance. Il est des qualités qu’il a possédées à un degré supérieur : parmi les modernes, qui est plus fin que Lawrence ? qui dessine mieux les contours d’une tête ? qui en modèle le mieux les détails ? qui surtout rend mieux le regard ? Et pourtant, à l’époque de son talent complet, comme on sent partout l’artiste et non pas le copiste servile ! Aussi a-t-il produit de prime saut des croquis vivans comme la nature. Différent de tant d’autres artistes, de Reynolds lui-même, qui ont besoin de tout leur orchestre pour éclater, il rayonnait tout entier dans un simple crayon ; mais, idolâtre de la mode, sa manière use trop de coquetterie et d’artifice L’air fashionable qu’il s’étudiait à donner à tous ses modèles mit plus d’une fois en danger la vérité des ressemblances, et, s’il eut cette qualité saillante, qu’il ne perdit jamais de vue le principe du charme
- ↑ Cromwell a été un peu mieux rendu par le peintre Walker, qui n’était pas non plus un Van Dyck.