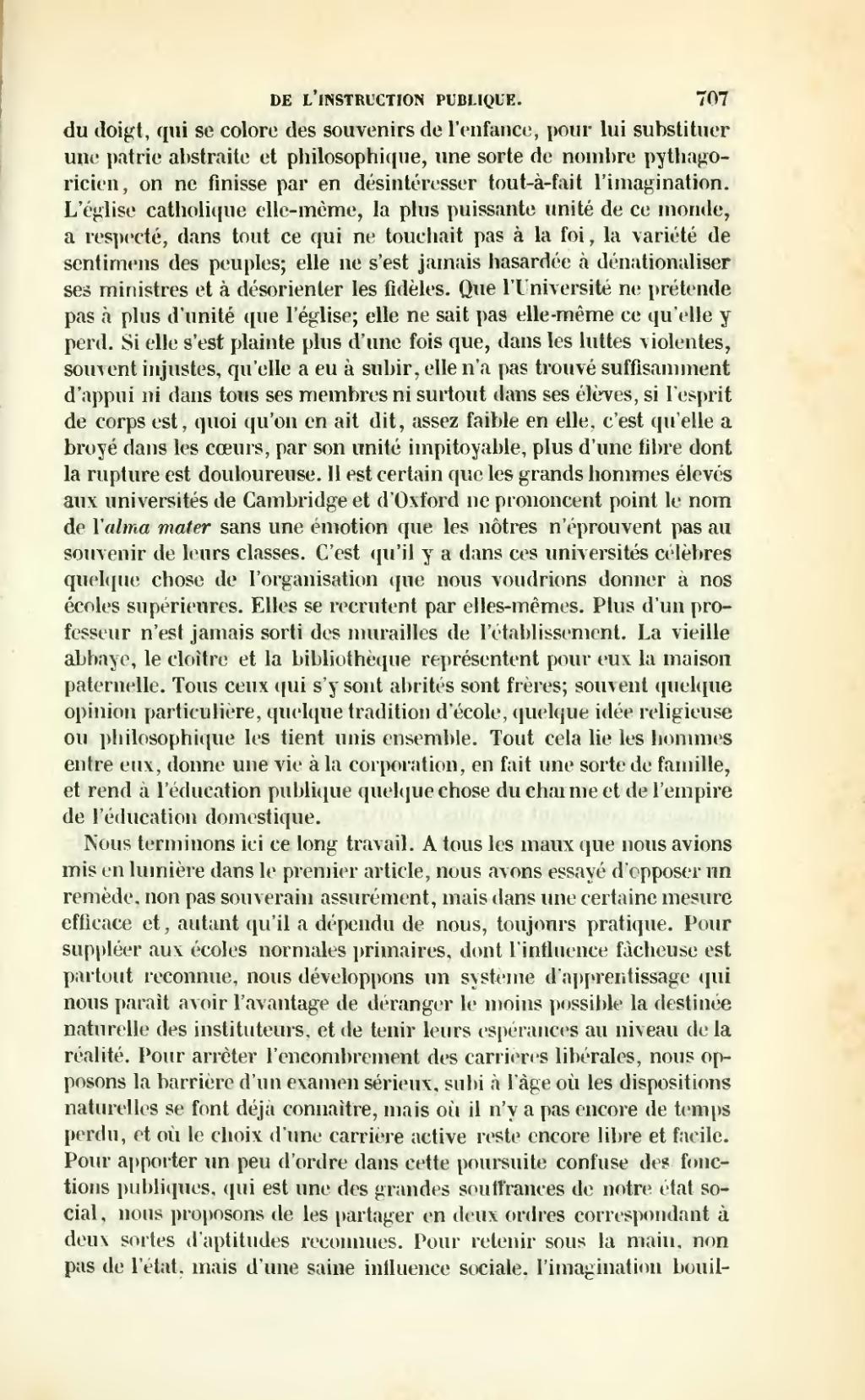du doigt, qui se colore des souvenirs de l’enfance, pour lui substituer une patrie abstraite et philosophique, une sorte de nombre pythagoricien, on ne finisse par en désintéresser tout-à-fait l’imagination. L’église catholique elle-même, la plus puissante unité de ce monde, a respecté, dans tout ce qui ne touchait pas à la foi, la variété de sentimens des peuples ; elle ne s’est jamais hasardée à dénationaliser ses ministres et à désorienter les fidèles. Que l’Université ne prétende pas à plus d’unité que l’église ; elle ne sait pas elle-même ce qu’elle y perd. Si elle s’est plainte plus d’une fois que, dans les luttes violentes, souvent injustes, qu’elle a eu à subir, elle n’a pas trouvé suffisamment d’appui ni dans tous ses membres ni surtout dans ses élèves, si l’esprit de corps est, quoi qu’on en ait, assez faible en elle, c’est qu’elle a dans les cœurs ; par son unité impitoyable, plus d’une fibre dont la rupture est douloureuse. Il est certain que les grands hommes, élevés aux universités de Cambridge et d’Oxford ne prononcent point le nom de l’alma mater sans une émotion que les nôtres n’éprouvent pas au souvenir de leurs classes. C’est qu’il y a dans ces universités célèbres quelque chose de l’organisation que nous voudrions donner à nos écoles supérieures. Elles se recrutent par elles-mêmes. Plus d’un professeur n’est jamais sorti des murailles de l’établissement. La vieille abbaye, le cloître et la bibliothèque représentent pour eux la maison paternelle. Tous ceux qui s’y sont abrités sont frères ; souvent quelque opinion particulière, quelque tradition d’école, quelque idée religieuse ou philosophique les tient unis ensemble. Tout cela lie les hommes entre eux, donne une vie à la corporation, en fait une sorte de famille, et rend à l’éducation publique quelque chose du charme et de l’empire de l’éducation domestique.
Nous terminons ici ce long travail. À tous les maux que nous avions mis en lumière dans le premier article, nous avons essayé d’opposer un remède, non pas souverain assurément, mais dans une certaine mesure efficace et, autant qu’il a dépendu de nous, toujours pratique. Pour suppléer aux écoles normales primaires, dont l’influence fâcheuse est partout reconnue, nous développons un système d’apprentissage qui nous paraît avoir l’avantage, de déranger le moins possible la destinée naturelle des instituteurs, et de tenir leurs espérances au niveau de la réalité. Pour arrêter l’encombrement des carrières libérales, nous opposons la barrière d’un examen sérieux, subi à l’âge où les dispositions naturelles se font déjà connaître, mais où il n’y a pas encore de temps perdu, et où le choix d’une carrière active reste encore libre et facile. Pour apporter un peu d’ordre dans cette poursuite confuse des fonctions publiques, qui est une des grandes souffrances de notre état social, nous proposons de les partager en deux ordres correspondant à deux sortes d’aptitudes reconnues. Pour retenir sous la main, non pas de l’état, mais d’une saine influence sociale, l’imagination bouillante