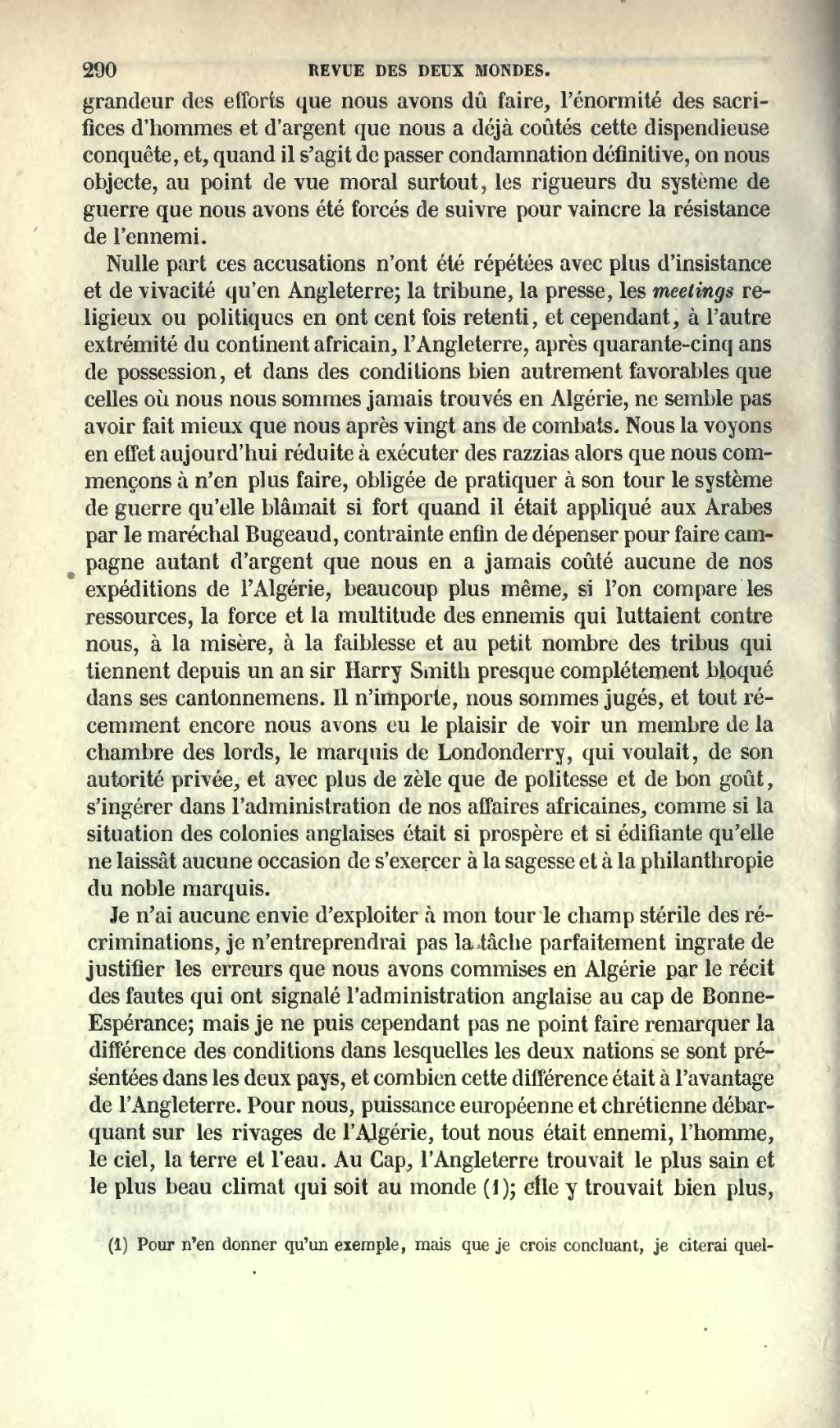grandeur des efforts que nous avons dû faire, l’énormité des sacrifices d’hommes et d’argent que nous a déjà coûtés cette dispendieuse conquête, et, quand il s’agit de passer condamnation définitive, on nous objecte, au point de vue moral surtout, les rigueurs du système de guerre que nous avons été forcés de suivre pour vaincre la résistance de l’ennemi.
Nulle part ces accusations n’ont été répétées avec plus d’insistance et de vivacité qu’en Angleterre ; la tribune, la presse, les meetings religieux ou politiques en ont cent fois retenti, et cependant, à l’autre extrémité du continent africain, l’Angleterre, après quarante-cinq ans de possession, et dans des conditions bien autrement favorables que celles où nous nous sommes jamais trouvés en Algérie, ne semble pas avoir fait mieux que nous après vingt ans de combats. Nous la voyons en effet aujourd’hui réduite à exécuter des razzias alors que nous commençons à n’en plus faire, obligée de pratiquer à son tour le système de guerre qu’elle blâmait si fort quand il était appliqué aux Arabes par le maréchal Bugeaud, contrainte enfin de dépenser pour faire campagne autant d’argent que nous en a jamais coûté aucune de nos expéditions de l’Algérie, beaucoup plus même, si l’on compare les ressources, la force et la multitude des ennemis qui luttaient contre nous, à la misère, à la faiblesse et au petit nombre des tribus qui tiennent depuis un an sir Harry Smith presque complètement bloqué dans ses cantonnemens. Il n’importe, nous sommes jugés, et tout récemment encore nous avons eu le plaisir de voir un membre de la chambre des lords, le marquis de Londonderry, qui voulait, de son autorité privée, et avec plus de zèle que de politesse et de bon goût, s’ingérer dans l’administration de nos affaires africaines, comme si la situation des colonies anglaises était si prospère et si édifiante qu’elle ne laissât aucune occasion de s’exercer à la sagesse et à la philanthropie du noble marquis.
Je n’ai aucune envie d’exploiter à mon tour le champ stérile des récriminations, je n’entreprendrai pas la tâche parfaitement ingrate de justifier les erreurs que nous avons commises en Algérie par le récit des fautes qui ont signalé l’administration anglaise au cap de Bonne-Espérance ; mais je ne puis cependant pas ne point faire remarquer la différence des conditions dans lesquelles les deux nations se sont présentées dans les deux pays, et combien cette différence était à l’avantage de l’Angleterre. Pour nous, puissance européenne et chrétienne débarquant sur les rivages de l’Algérie, tout nous était ennemi, l’homme, le ciel, la terre et l’eau. Au Cap, l’Angleterre trouvait le plus sain et le plus beau climat qui soit au monde[1] ; elle y trouvait bien plus,
- ↑ Pour n’en donner qu’un exemple, mais que je crois concluant, je citerai quelques paroles empruntées au rapport officiel du docteur Murray, chirurgien en chef de la petite armée qui fit en 1835 la guerre contre les Cafres : « Sur une colonne de 3,254 hommes, dit-il, et pendant cinq mois de très laborieuse campagne au milieu d’un pays désert, il ne mourut de maladie ni un officier ni un soldat ; il n’y eut pas même un seul homme obligé de quitter son corps pour cause de maladie, ce que j’attribue en partie à l’excellence du service, mais surtout à la salubrité du climat, rapport sous lequel le Cap est égal, je devrais dire supérieur, à tous les pays du monde. » Comparez ce témoignage au plus consolant de tous ceux que contiennent les innombrables documens publiés par le ministère de la guerre sur l’Algérie.