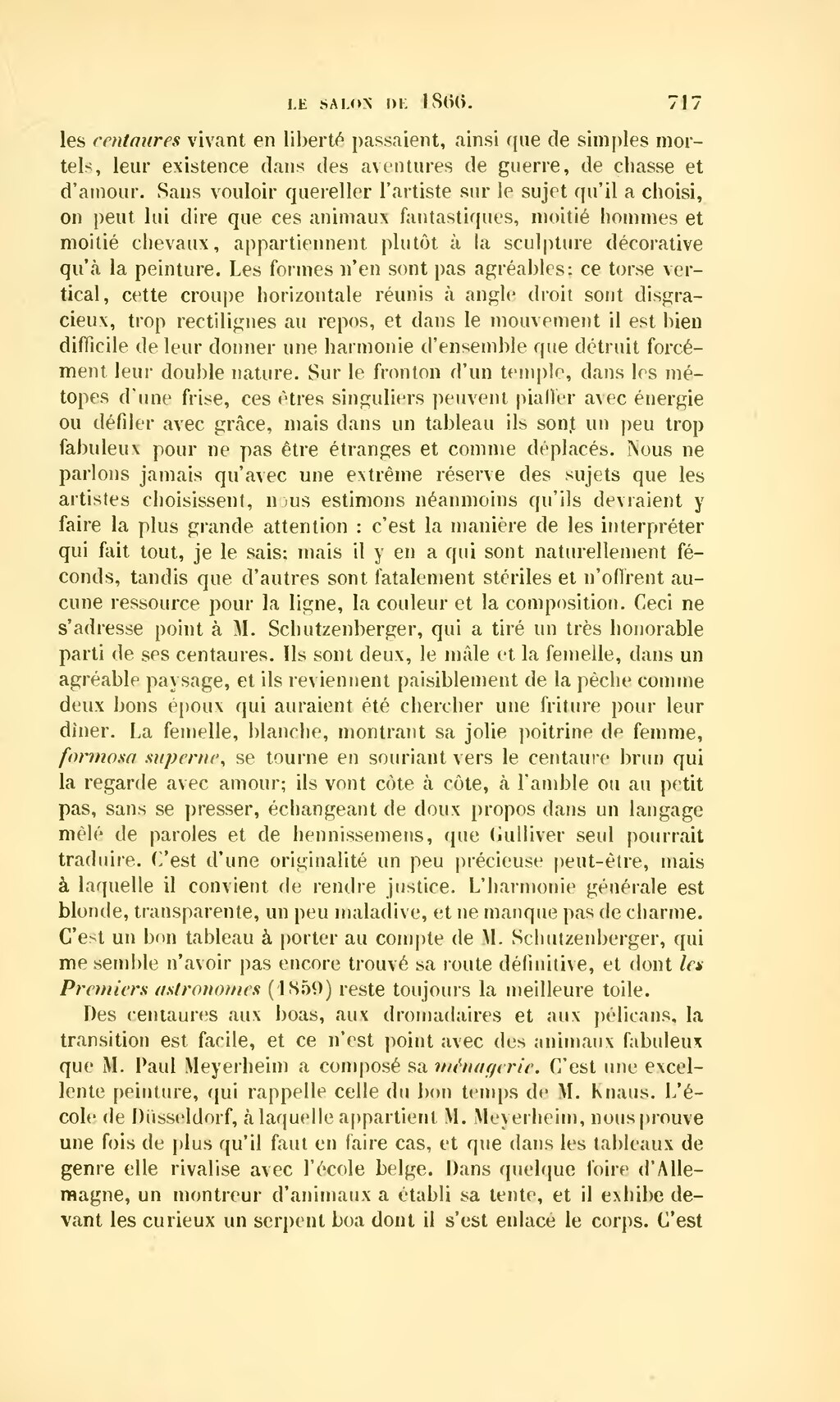les centaures vivant en liberté passaient, ainsi que de simples mortels, leur existence dans des aventures de guerre, de chasse et d’amour. Sans vouloir quereller l’artiste sur le sujet qu’il a choisi, on peut lui dire que ces animaux fantastiques, moitié hommes et moitié chevaux, appartiennent plutôt à la sculpture décorative qu’à la peinture. Les formes n’en sont pas agréables ; ce torse vertical, cette croupe horizontale réunis à angle droit sont disgracieux, trop rectilignes au repos, et dans le mouvement il est bien difficile de leur donner une harmonie d’ensemble que détruit forcément leur double nature. Sur le fronton d’un temple, dans les métopes d’une frise, ces êtres singuliers peuvent piaffer avec énergie ou défiler avec grâce, mais dans un tableau ils sont un peu trop fabuleux pour ne pas être étranges et comme déplacés. Nous ne parlons jamais qu’avec une extrême réserve des sujets que les artistes choisissent, nous estimons néanmoins qu’ils devraient y faire la plus grande attention : c’est la manière de les interpréter qui fait tout, je le sais ; mais il y en a qui sont naturellement féconds, tandis que d’autres sont fatalement stériles et n’offrent aucune ressource pour la ligne, la couleur et la composition. Ceci ne s’adresse point à M. Schutzenberger, qui a tiré un très honorable parti de ses centaures. Ils sont deux, le mâle et la femelle, dans un agréable paysage, et ils reviennent paisiblement de la pêche comme deux bons époux qui auraient été chercher une friture pour leur dîner. La femelle, blanche, montrant sa jolie poitrine de femme, formosa superne, se tourne en souriant vers le centaure brun qui la regarde avec amour ; ils vont côte à côte, à l’amble ou au petit pas, sans se presser, échangeant de doux propos dans un langage mêlé de paroles et de hennissemens, que Gulliver seul pourrait traduire. C’est d’une originalité un peu précieuse peut-être, mais à laquelle il convient de rendre justice. L’harmonie générale est blonde, transparente, un peu maladive, et ne manque pas de charme. C’est un bon tableau à porter au compte de M. Schutzenberger, qui me semble n’avoir pas encore trouvé sa route définitive, et dont les Premiers astronomes (1859) reste toujours la meilleure toile.
Des centaures aux boas, aux dromadaires et aux pélicans, la transition est facile, et ce n’est point avec des animaux fabuleux que M. Paul Meyerheim a composé sa ménagerie. C’est une excellente peinture, qui rappelle celle du bon temps de M. Knaus. L’école de Dusseldorf, à laquelle appartient M. Meyerheim, nous prouve une fois de plus qu’il faut en faire cas, et que dans les tableaux de genre elle rivalise avec l’école belge. Dans quelque foire d’Allemagne, un montreur d’animaux a établi sa tente, et il exhibe devant les curieux un serpent boa dont il s’est enlacé le corps. C’est