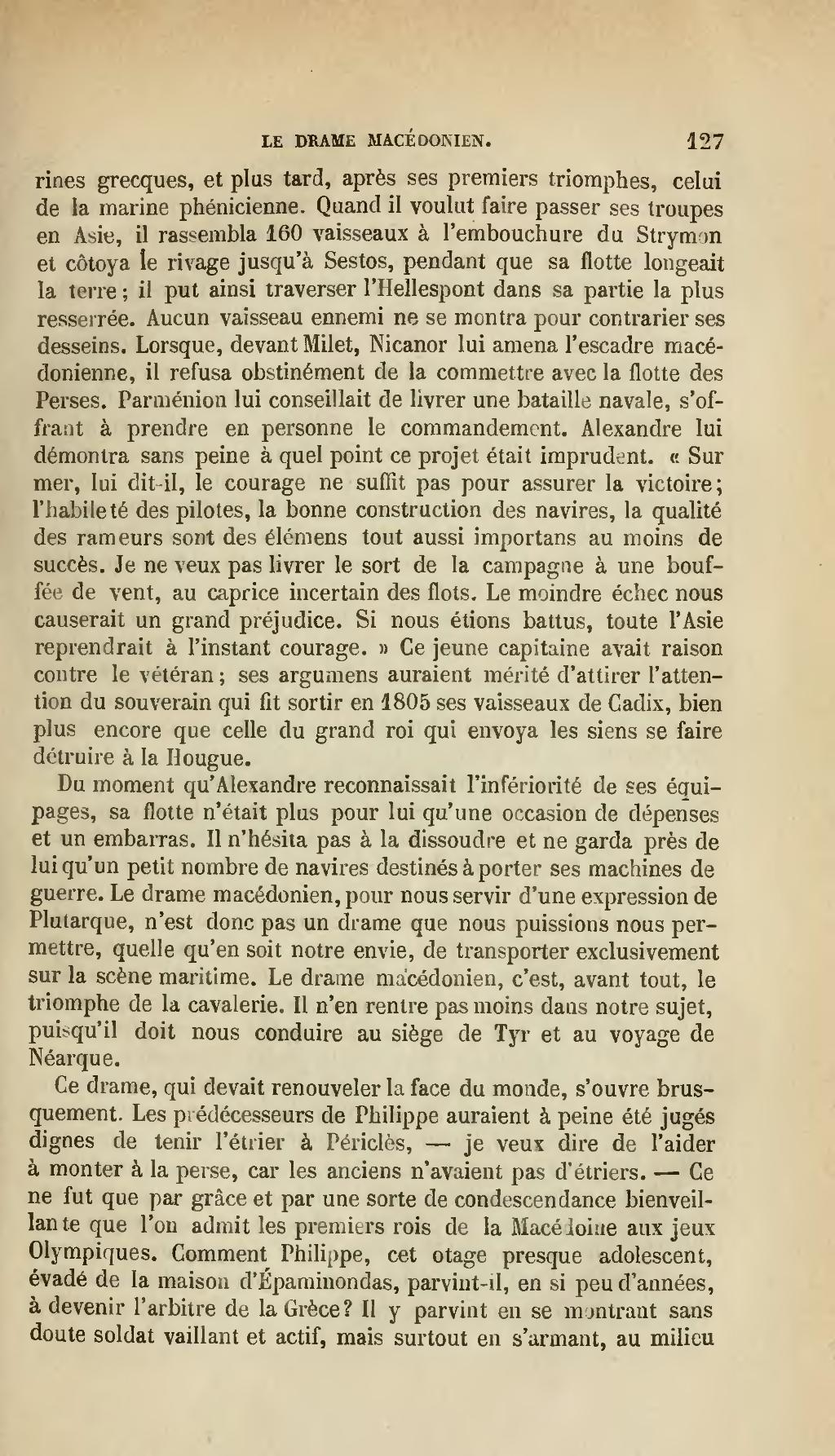marines grecques, et plus tard, après ses premiers triomphes, celui de la marine phénicienne. Quand il voulut faire passer ses troupes en Asie, il rassembla 160 vaisseaux à l’embouchure du Strymon et côtoya le rivage jusqu’à Sestos, pendant que sa flotte longeait la terre ; il put ainsi traverser l’Hellespont dans sa partie la plus resserrée. Aucun vaisseau ennemi ne se montra pour contrarier ses desseins. Lorsque, devant Milet, Nicanor lui amena l’escadre macédonienne, il refusa obstinément de la commettre avec la flotte des Perses. Parménion lui conseillait de livrer une bataille navale, s’offrant à prendre en personne le commandement. Alexandre lui démontra sans peine à quel point ce projet était imprudent. « Sur mer, lui dit-il, le courage ne suffit pas pour assurer la victoire ; l’habileté des pilotes, la bonne construction des navires, la qualité des rameurs sont des élémens tout aussi importans au moins de succès. Je ne veux pas livrer le sort de la campagne à une bouffée de vent, au caprice incertain des flots. Le moindre échec nous causerait un grand préjudice. Si nous étions battus, toute l’Asie reprendrait à l’instant courage. » Ce jeune capitaine avait raison contre le vétéran ; ses argumens auraient mérité d’attirer l’attention du souverain qui fit sortir en 1805 ses vaisseaux de Cadix, bien plus encore que celle du grand roi qui envoya les siens se faire détruire à la Hougue.
Du moment qu’Alexandre reconnaissait l’infériorité de ses équipages, sa flotte n’était plus pour lui qu’une occasion de dépenses et un embarras. Il n’hésita pas à la dissoudre et ne garda près de lui qu’un petit nombre de navires destinés à porter ses machines de guerre. Le drame macédonien, pour nous servir d’une expression de Plutarque, n’est donc pas un drame que nous puissions nous permettre, quelle qu’en soit notre envie, de transporter exclusivement sur la scène maritime. Le drame macédonien, c’est, avant tout, le triomphe de la cavalerie. Il n’en rentre pas moins dans notre sujet, puisqu’il doit nous conduire au siège de Tyr et au voyage de Néarque.
Ce drame, qui devait renouveler la face du monde, s’ouvre brusquement. Les prédécesseurs de Philippe auraient à peine été jugés dignes de tenir l’étrier à Périclès, — je veux dire de l’aider à monter à la perse, car les anciens n’avaient pas d’étriers. — Ce ne fut que par grâce et par une sorte de condescendance bienveillante que l’on admit les premiers rois de la Macédoine aux jeux Olympiques. Comment Philippe, cet otage presque adolescent, évadé de la maison d’Epaminondas, parvint-il, en si peu d’années, à devenir l’arbitre de la Grèce ? Il y parvint en se montrant sans doute soldat vaillant et actif, mais surtout en s’armant, au milieu