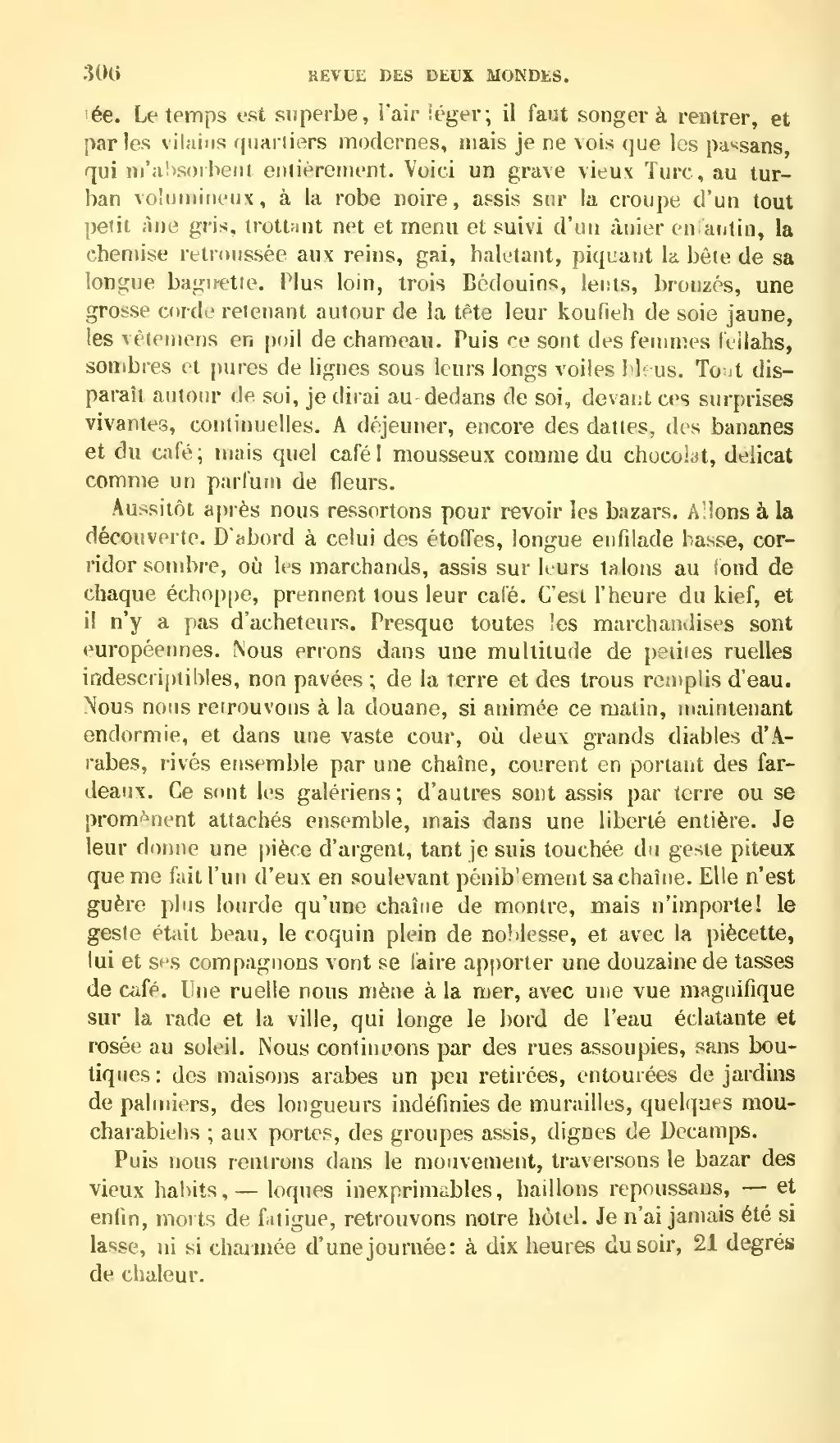fréquentée. Le temps est superbe, l’air léger ; il faut songer à rentrer, et par les vilains quartiers modernes, mais je ne vois que les passans, qui m’absorbent entièrement. Voici un grave vieux Turc, au turban volumineux, à la robe noire, assis sur la croupe d’un tout petit âne gris, trottant net et menu et suivi d’un ânier enfantin, la chemise retroussée aux reins, gai, baie tant, piquant la bête de sa longue baguette. Plus loin, trois Bédouins, lents, bronzés, une grosse corde retenant autour de la tête leur koufieh de soie jaune, les vêtemens en poil de chameau. Puis ce sont des femmes fellahs, sombres et pures de lignes sous leurs longs voiles bleus. Tout disparaît autour de soi, je dirai au-dedans de soi, devant ces surprises vivantes, continuelles. A déjeuner, encore des dattes, des bananes et du café ; mais quel café ! mousseux comme du chocolat, délicat comme un parfum de fleurs.
Aussitôt après nous ressortons pour revoir les bazars. Allons à la découverte. D’abord à celui des étoffes, longue enfilade basse, corridor sombre, où les marchands, assis sur leurs talons au fond de chaque échoppe, prennent tous leur café. C’est l’heure du kief, et il n’y a pas d’acheteurs. Presque toutes les marchandises sont européennes. Nous errons dans une multitude de petites ruelles indescriptibles, non pavées ; de la terre et des trous remplis d’eau. Nous nous retrouvons à la douane, si animée ce matin, maintenant endormie, et dans une vaste cour, où deux grands diables d’Arabes, rivés ensemble par une chaîne, courent en portant des fardeaux. Ce sont les galériens ; d’autres sont assis par terre ou se promènent attachés ensemble, mais dans une liberté entière. Je leur donne une pièce d’argent, tant je suis touchée du geste piteux que me fait l’un d’eux en soulevant péniblement sa chaîne. Elle n’est guère plus lourde qu’une chaîne de montre, mais n’importe ! le geste était beau, le coquin plein de noblesse, et avec la piécette, lui et ses compagnons vont se faire apporter une douzaine de tasses de café. Une ruelle nous mène à la mer, avec une vue magnifique sur la rade et la ville qui longe le bord de l’eau éclatante et rosée au soleil. Nous continuons, par des rues assoupies, sans boutiques : des maisons arabes un peu retirées, entourées de jardins de palmiers, des longueurs indéfinies de murailles, quelques moucharabiehs ; aux portes, des groupes assis, dignes de Decamps.
Puis nous rentrons dans le mouvement, traversons le bazar des vieux habits, — loques inexprimables, haillons repoussans, — et enfin, morts de fatigue, retrouvons notre hôtel. le n’ai jamais été si lasse, ni si charmée d’une journée : à dix heures du soir, 21 degrés de chaleur.