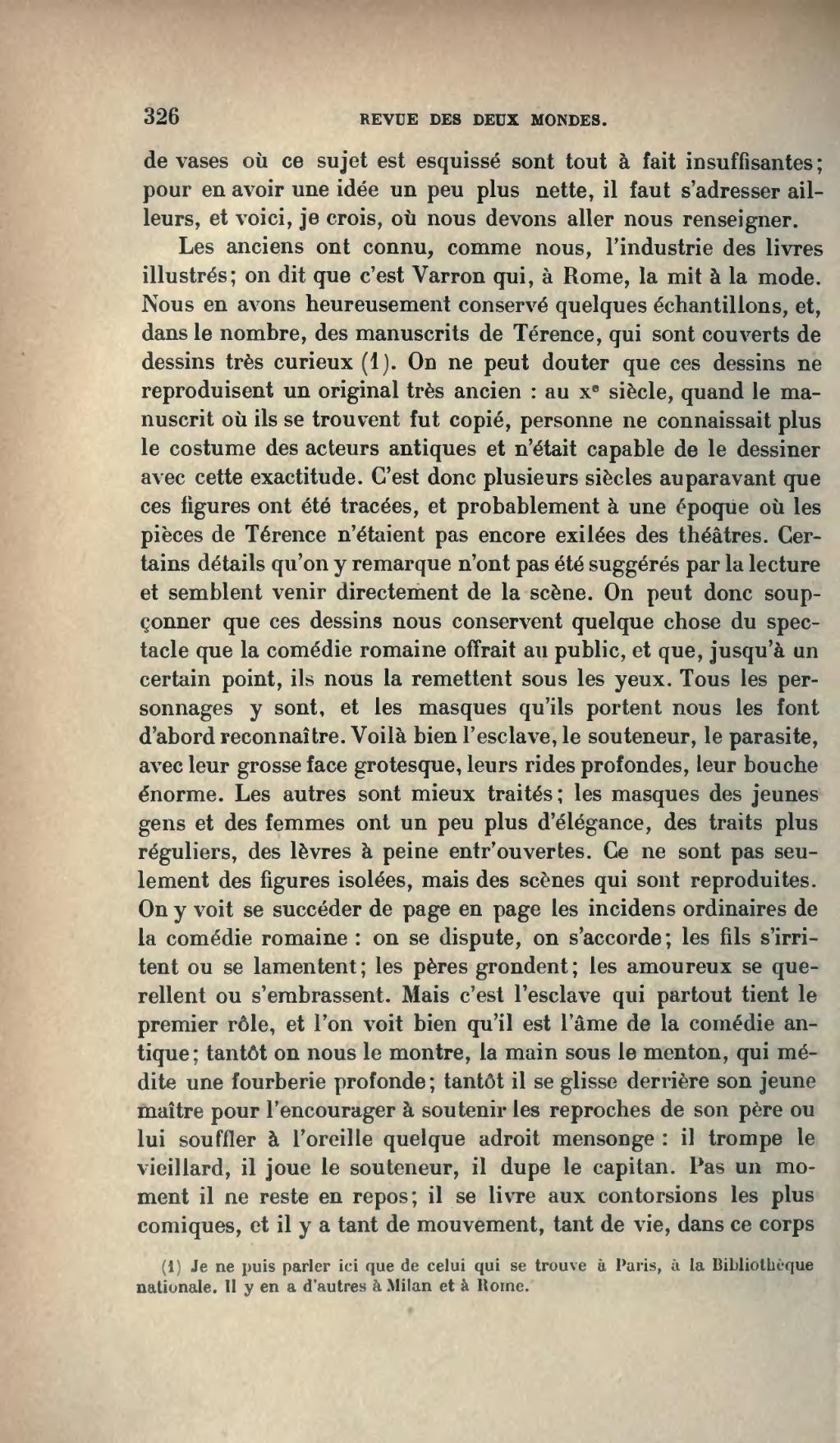de vases où ce sujet est esquissé sont tout à fait insuffisantes ; pour en avoir une idée un peu plus nette, il faut s’adresser ailleurs, et voici, je crois, où nous devons aller nous renseigner.
Les anciens ont connu, comme nous, l’industrie des livres illustrés ; on dit que c’est Varron qui, à Rome, la mit à la mode. Nous en avons heureusement conservé quelques échantillons, et, dans le nombre, des manuscrits de Térence, qui sont couverts de dessins très curieux[1]. On ne peut douter que ces dessins ne reproduisent un original très ancien : au xe siècle, quand le manuscrit où ils se trouvent fut copié, personne ne connaissait plus le costume des acteurs antiques et n’était capable de le dessiner avec cette exactitude. C’est donc plusieurs siècles auparavant que ces figures ont été tracées, et probablement à une époque où les pièces de Térence n’étaient pas encore exilées des théâtres. Certains détails qu’on y remarque n’ont pas été suggérés par la lecture et semblent venir directement de la scène. On peut donc soupçonner que ces dessins nous conservent quelque chose du spectacle que la comédie romaine offrait au public, et que, jusqu’à an certain point, ils nous la remettent sous les yeux. Tous les personnages y sont, et les masques qu’ils portent nous les font d’abord reconnaître. Voilà bien l’esclave, le souteneur, le parasite, avec leur grosse face grotesque, leurs rides profondes, leur bouche énorme. Les autres sont mieux traités ; les masques des jeunes gens et des femmes ont un peu plus d’élégance, des traits plus réguliers, des lèvres à peine entr’ouvertes. Ce ne sont pas seulement des figures isolées, mais des scènes qui sont reproduites. On y voit se succéder de page en page les incidens ordinaires de la comédie romaine : on se dispute, on s’accorde; les fils s’irritent ou se lamentent ; les pères grondent ; les amoureux se querellent ou s’embrassent. Mais c’est l’esclave qui partout tient le premier rôle, et l’on voit bien qu’il est l’âme de la comédie antique ; tantôt on nous le montre, la main sous le menton, qui médite une fourberie profonde ; tantôt il se glisse derrière son jeune maître pour l’encourager à soutenir les reproches de son père ou lui souffler à l’oreille quelque adroit mensonge : il trompe le vieillard, il joue le souteneur, il dupe le capitan. Pas un moment il ne reste en repos; il se livre aux contorsions les plus comiques, et il y a tant de mouvement, tant de vie, dans ce corps
- ↑ Je ne puis parler ici que de celui qui se trouve à Paris, à la Bibliothèque nationale. Il y en a d’autres à Milan et à Rome.