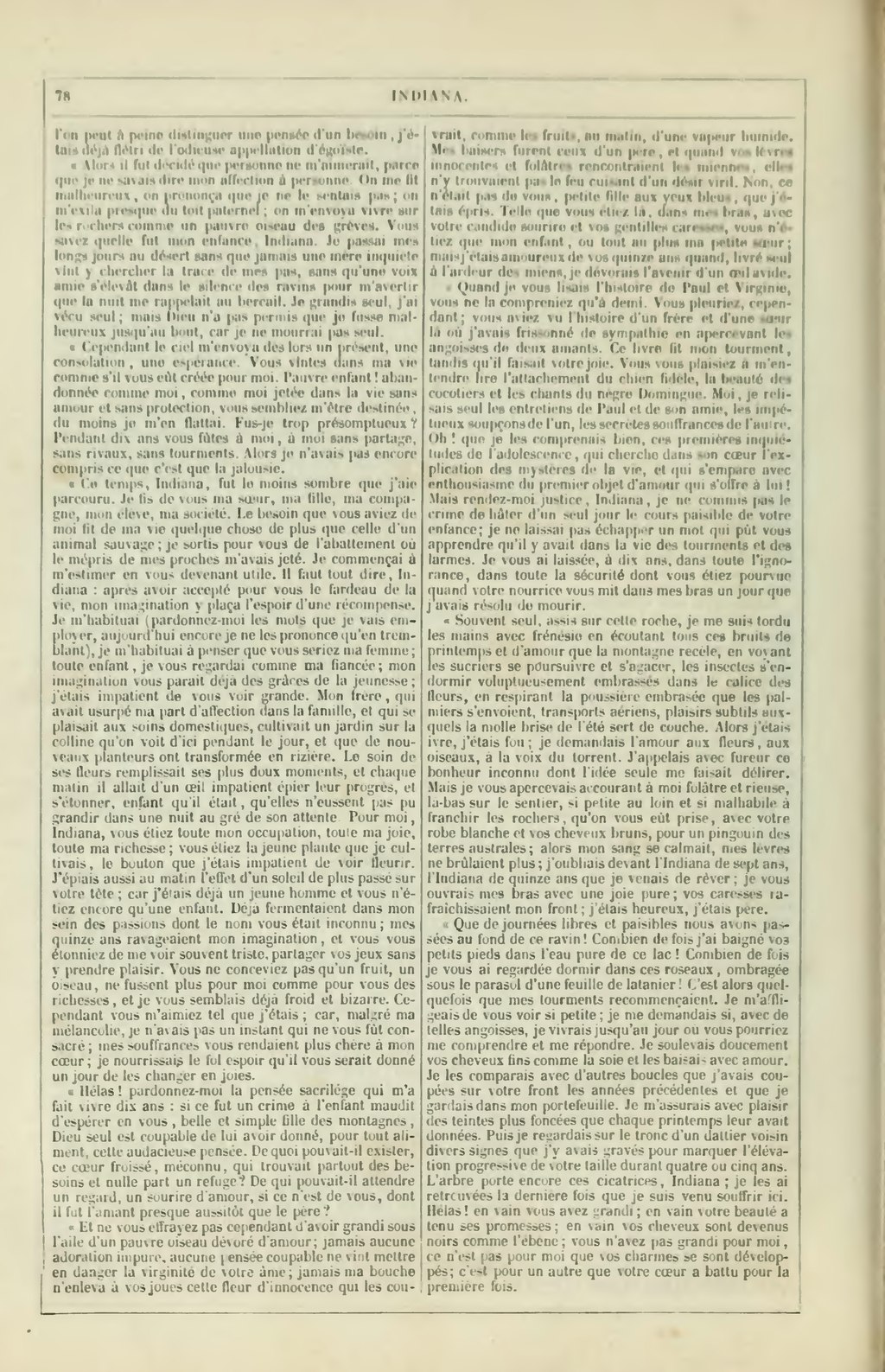l’on peut à peine distinguer une pensée d’un besoin, j’étais déjà flétri de l’odieuse appellation d’égoïste.
Alors il fut décidé que personne ne m’aimerait, parce que je ne savais dire mon affection à personne. On me fit malheureux, on prononça que je ne le sentais pas ; on m’exila presque du toit paternel ; on m’envoya vivre sur les rochers comme un pauvre oiseau des grèves. Vous savez quelle fut mon enfance, Indiana. Je passai mes longs jours au désert sans que jamais une mère inquiète vint y chercher la trace de mes pas, sans qu’une voix amie s’élevât dans le silence des ravins pour m’avertir que la nuit me rappelait au bercail. Je grandis seul, j’ai vécu seul ; mais Dieu n’a pas permis que je fusse malheureux jusqu’au bout, car je ne mourrai pas seul.
« Cependant le ciel m’envoya dès lors un présent, une consolation, une espérance. Vous vîntes dans ma vie comme s’il vous eût créée pour moi. Pauvre enfant ! abandonnée comme moi, comme moi jetée dans la vie sans amour et sans protection, vous sembliez m’être destinée, du moins je m’en flattai. Fus-je trop présomptueux ? Pendant dix ans vous fûtes à moi, à moi sans partage, sans rivaux, sans tourments. Alors je n’avais pas encore compris ce que c’est que la jalousie.
« Ce temps, Indiana, fut le moins sombre que j’aie parcouru. Je fis de vous ma sœur, ma fille, ma compagne, mon élève, ma société. Le besoin que vous aviez de moi fit de ma vie quelque chose de plus que celle d’un animal sauvage ; je sortis pour vous de l’abattement où le mépris de mes proches m’avait jeté. Je commençai à m’estimer en vous devenant utile. Il faut tout dire, Indiana : après avoir accepté pour vous le fardeau de la vie, mon imagination y plaça l’espoir d’une récompense. Je m’habituai (pardonnez-moi les mots que je vais employer, aujourd’hui encore je ne les prononce qu’en tremblant), je m’habituai à penser que vous seriez ma femme ; toute enfant, je vous regardai comme ma fiancée ; mon imagination vous parait déjà des grâces de la jeunesse ; j’étais impatient de vous voir grande. Mon frère, qui avait usurpé ma part d’affection dans la famille, et qui se plaisait aux soins domestiques, cultivait un jardin sur la colline qu’on voit d’ici pendant le jour, et que de nouveaux planteurs ont transformée en rizière. Le soin de ses fleurs remplissait ses plus doux moments, et chaque matin il allait d’un œil impatient épier leur progrès, et s’étonner, enfant qu’il était, qu’elles n’eussent pas pu grandir dans une nuit au gré de son attente. Pour moi, Indiana, vous étiez toute mon occupation, toute ma joie, toute ma richesse ; vous étiez la jeune plante que je cultivais, le bouton que j’étais impatient de voir fleurir. J’épiais aussi au matin l’effet d’un soleil de plus passé sur votre tête ; car j’étais déjà un jeune homme et vous n’étiez encore qu’une enfant. Déjà fermentaient dans mon sein des passions dont le nom vous était inconnu ; mes quinze ans ravageaient mon imagination, et vous vous étonniez de me voir souvent triste, partager vos jeux sans y prendre plaisir. Vous ne conceviez pas qu’un fruit, un oiseau, ne fussent plus pour moi comme pour vous des richesses, et je vous semblais déjà froid et bizarre. Cependant vous m’aimiez tel que j’étais ; car, malgré ma mélancolie, je n’avais pas un instant qui ne vous fût consacré ; mes souffrances vous rendaient plus chère à mon cœur ; je nourrissais le fol espoir qu’il vous serait donné un jour de les changer en joies.
« Hélas ! pardonnez-moi la pensée sacrilège qui m’a fait vivre dix ans : si ce fut un crime à l’enfant maudit d’espérer en vous, belle et simple fille des montagnes, Dieu seul est coupable de lui avoir donné, pour tout aliment, cette audacieuse pensée. De quoi pouvait-il exister, ce cœur froissé, méconnu, qui trouvait partout des besoins et nulle part un refuge ? De qui pouvait-il attendre un regard, un sourire d’amour, si ce n’est de vous, dont il fut l’amant presque aussitôt que le père ?
« Et ne vous effrayez pas cependant d’avoir grandi sous l’aile d’un pauvre oiseau dévoré d’amour ; jamais aucune adoration impure, aucune pensée coupable ne vint mettre en danger la virginité de votre âme ; jamais ma bouche n’enleva à vos joues cette fleur d’innocence qui les couvrait, comme les fruits, au matin, d’une vapeur humide. Mes baisers furent ceux d’un père, et quand vos lèvres innocentes et folâtres rencontraient les miennes, elles n’y trouvaient pas le feu cuisant d’un désir viril. Non, ce n’était pas de vous, petite fille aux yeux bleus, que j’étais épris. Telle vous que étiez là, dans mes bras, avec votre candide sourire et vos gentilles caresses, vous n’étiez que mon enfant, ou tout au plus ma petite sœur ; mais j’étais amoureux de vos quinze ans quand, livré seul à l’ardeur des miens, je dévorais l’avenir d’un œil avide.
« Quand je vous lisais l’histoire de Paul et Virginie, vous ne la compreniez qu’à demi. Vous pleuriez, cependant ; vous aviez vu l’histoire d’un frère et d’une sœur là où j’avais frissonné de sympathie en apercevant les angoisses de deux amants. Ce livre fit mon tourment, tandis qu’il faisait votre joie. Vous vous plaisiez à m’entendre lire l’attachement du chien fidèle, la beauté des cocotiers et les chants du nègre Domingue. Moi, je relisais seul les entretiens de Paul et de son amie, les impétueux soupçons de l’un, les secrètes souffrances de l’autre. Oh ! que je les comprenais bien, ces premières inquiétudes de l’adolescence, qui cherche dans son cœur l’explication des mystères de la vie, et qui s’empare avec enthousiasme du premier objet d’amour qui s’offre à lui ! Mais rendez-moi justice, Indiana, je ne commis pas le crime de hâter d’un seul jour le cours paisible de votre enfance ; je ne laissai pas échapper un mot qui pût vous apprendre qu’il y avait dans la vie des tourments et des larmes. Je vous ai laissée, à dix ans, dans toute l’ignorance, dans toute la sécurité dont vous étiez pourvue quand votre nourrice vous mit dans mes bras un jour que j’avais résolu de mourir.
« Souvent seul, assis sur cette roche, je me suis tordu les mains avec frénésie en écoutant tous ces bruits de printemps et d’amour que la montagne recèle, en voyant les sucriers se poursuivre et s’agacer, les insectes s’endormir voluptueusement embrassés dans le calice des fleurs, en respirant la poussière embrasée que les palmiers s’envoient, transports aériens, plaisirs subtils auxquels la molle brise de l’été sert de couche. Alors j’étais ivre, j’étais fou ; je demandais l’amour aux fleurs, aux oiseaux, à la voix du torrent. J’appelais avec fureur ce bonheur inconnu dont l’idée seule me faisait délirer. Mais je vous apercevais accourant à moi folâtre et rieuse, là-bas sur le sentier, si petite au loin et si malhabile à franchir les rochers, qu’on vous eût prise, avec votre robe blanche et vos cheveux bruns, pour un pingouin des terres australes ; alors mon sang se calmait, mes lèvres ne brûlaient plus ; j’oubliais devant l’Indiana de sept ans, l’Indiana de quinze ans que je venais de rêver ; je vous ouvrais mes bras avec une joie pure ; vos caresses rafraîchissaient mon front ; j’étais heureux, j’étais père.
« Que de journées libres et paisibles nous avons passées au fond de ce ravin ! Combien de fois j’ai baigné vos petits pieds dans l’eau pure de ce lac ! Combien de fois je vous ai regardée dormir dans ces roseaux, ombragée sous le parasol d’une feuille de latanier ! C’est alors quelquefois que mes tourments recommençaient. Je m’affligeais de vous voir si petite : je me demandais si, avec de telles angoisses, je vivrais jusqu’au jour ou vous pourriez me comprendre et me répondre. Je soulevais doucement vos cheveux fins comme la soie et les baisais avec amour. Je les comparais avec d’autres boucles que j’avais coupées sur votre front les années précédentes et que je gardais dans mon portefeuille. Je m’assurais avec plaisir des teintes plus foncées que chaque printemps leur avait données. Puis je regardais sur le tronc d’un dattier voisin divers signes que j’y avais gravés pour marquer l’élévation progressive de votre taille durant quatre ou cinq ans. L’arbre porte encore ces cicatrices, Indiana ; je les ai retrouvées la dernière fois que je suis venu souffrir ici. Hélas ! en vain vous avez grandi ; en vain votre beauté a tenu ses promesses ; en vain vos cheveux sont devenus noirs comme l’ébène ; vous n’avez pas grandi pour moi, ce n’est pas pour moi que vos charmes se sont développés ; c’est pour un autre que votre cœur a battu pour la première fois.