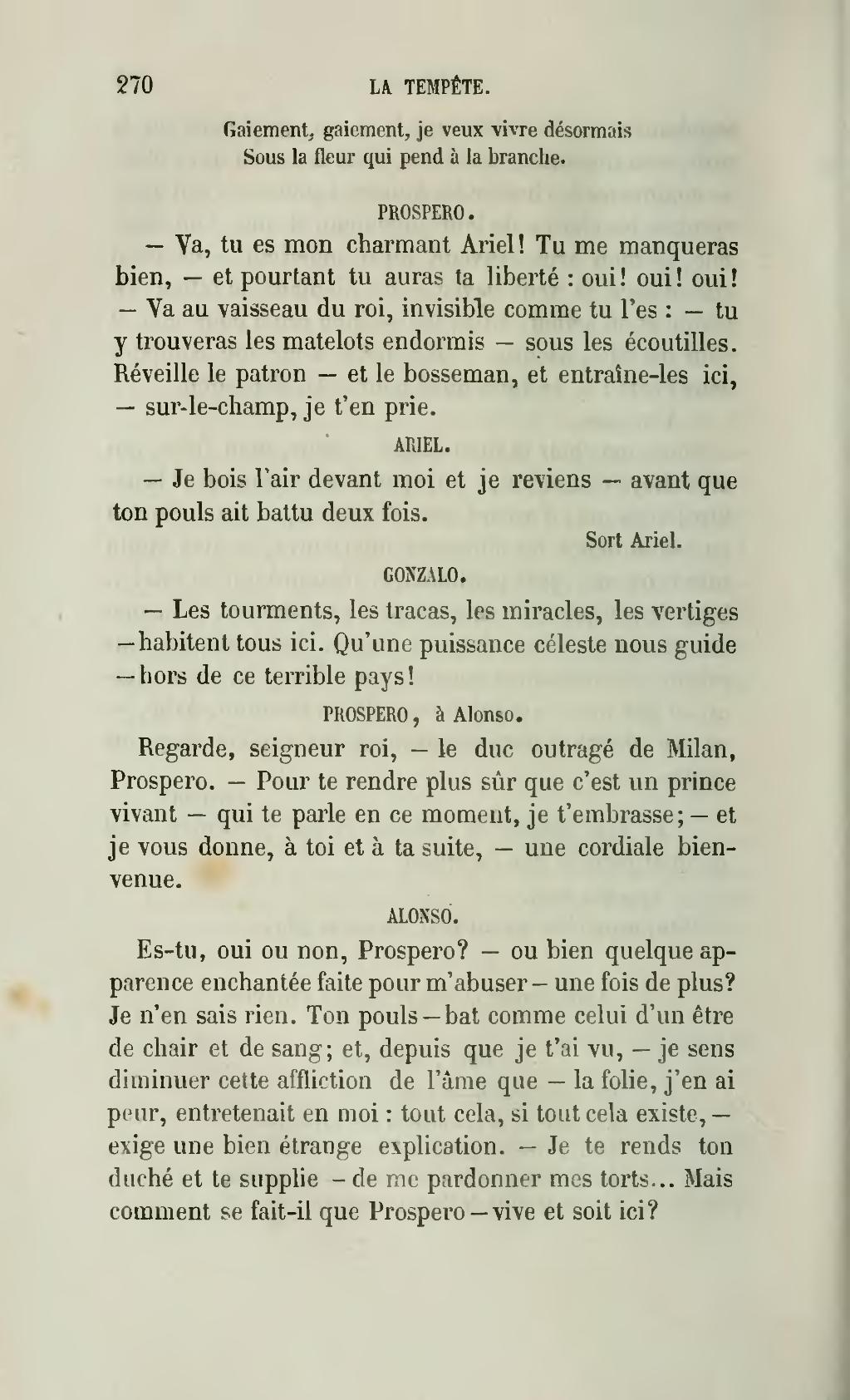Gaiement, gaiement, je veux vivre désormais
Sous la fleur qui pend à la branche.
— Va, tu es mon charmant Ariel ! Tu me manqueras bien, — et pourtant tu auras ta liberté : oui ! oui ! oui ! — Va au vaisseau du roi, invisible comme tu l’es : — tu y trouveras les matelots endormis — sous les écoutilles. Réveille le patron — et le bosseman, et entraîne-les ici, — sur-le-champ, je t’en prie.
— Je bois l’air devant moi et je reviens — avant que ton pouls ait battu deux fois.
— Les tourments, les tracas, les miracles, les vertiges — habitent tous ici. Qu’une puissance céleste nous guide — hors de ce terrible pays !
Regarde, seigneur roi, — le duc outragé de Milan, Prospero. — Pour te rendre plus sûr que c’est un prince vivant — qui te parle en ce moment, je t’embrasse ; — et je vous donne, à toi et à ta suite, — une cordiale bienvenue.
Es-tu, oui ou non, Prospero ? — ou bien quelque apparence enchantée faite pour m’abuser — une fois de plus ? Je n’en sais rien. Ton pouls — bat comme celui d’un être de chair et de sang ; et, depuis que je t’ai vu, — je sens diminuer cette affliction de l’âme que — la folie, j’en ai peur, entretenait en moi : tout cela, si tout cela existe, — exige une bien étrange explication. — Je te rends ton duché et te supplie — de me pardonner mes torts… Mais comment se fait-il que Prospero — vive et soit ici ?