L’amour saphique à travers les âges et les êtres/27
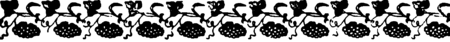
XXVII
Le sadisme, c’est le besoin de la cruauté dans les actes d’amour ; ou même, parfois, la cruauté unique devenue une sensation voluptueuse et remplaçant l’acte passionnel.
Ce vice archi-millénaire a emprunté son nom au marquis de Sade qui, au dix-huitième siècle, se rendit célèbre par ses aventures et ses récits de galanterie féroce.
Le sadisme provient de causes différentes, l’une est naturelle, c’est l’instinct particulier au mâle qui désire la femelle avec violence et s’excite de sa résistance, s’affole de son propre triomphe, jouit d’une brutalité sexuelle qui lui soumet sa victime. L’autre raison est pathologique, et la joie de faire souffrir autrui est plus une hantise, une obsession pareille à n’importe quelle autre monomanie qu’une forme de sensualité proprement dite.
Le sadisme possède une échelle où tous les degrés existent, depuis le plaisir de torturer mentalement, le besoin de pincer, d’égratigner, de mordre aux moments érotiques, jusqu’à la volupté de la torture et de l’assassinat.
Dans l’histoire humaine, les crimes sadiques sont fréquents : ce sont plutôt des hommes qui les commettent ; mais il ne faudrait pas conclure de ce fait que le sadisme est un vice non féminin.
La femme, très femme, très douce, très caressante et faible en est ordinairement exempte ; mais la femme-hermaphrodite et la femme-mâle y sont fort sujettes.
Il est vrai qu’il est rare que, chez elles, le sadisme les pousse au meurtre, aux boucheries de Jack l’éventreur, de Vacher, de Papavoine, etc. ; mais, pour différer de forme, leurs crimes sadiques peuvent être tout aussi excessifs et, peut-être même, plus épouvantables.
Le martyre, si fréquent, d’enfants par leur mère ou leur belle-mère est toujours un crime sadique, même s’il n’est pas accompagné d’actes voluptueux apparents.
Et, fort souvent, c’est parce que leur exécution est impossible à une femme que ces mégères n’exécutent pas tout ce que leur cerveau leur suggère. La preuve en est dans les actes d’abominable cruauté dont se rendirent coupables nombre de souveraines : les assassinats d’amants de Christine de Suède ; les tortures d’esclaves auxquelles se complaisait Messaline ; les empoisonnements qui faisaient les délices de Cléopâtre ; les tortures iniques, spectacle habituel de la reine de Saba. Et, plus récemment, les joies que goûtaient les grandes dames du douzième et treizième siècle à faire fouetter au sang devant elles leurs servantes.
Très souvent, le sadisme féminin se contente en imagination, ou par des actes qu’aggrave ou qu’enjolive l’imagination.
Alors que l’appétit sadique de l’homme peut se satisfaire assez facilement sur les malheureuses prostituées qu’il se procure, dociles et soumises à ses fantaisies ou incapables de se soustraire à ses cruautés, la femme n’a que peu de moyens de mettre à exécution ses rêves.
Elle n’a que la ressource de se contenter en usant de moyens moraux, ou alors en s’attaquant à des enfants.
Le sadisme féminin a donc, non par goût, mais par nécessité, particulièrement l’enfant pour victime.
Nous en citerons plusieurs exemples qui nous ont été fournis soit par des constatations médicales, soit par des procès criminels.
Mme L… était veuve ou, du moins, passait pour l’être, fort dévote, couturière de son état et ayant pour clientèle les dames les mieux pensantes du faubourg Saint-Germain.
Ses mœurs étaient rigides, sa mine austère et sa sévérité sans égale pour ses ouvrières. Elle employait une douzaine de jeunes filles, anciennes élèves d’orphelinats, créatures timides qu’elle terrorisait par la parole, les amendes et les mille vexations qu’elle leur imposait.
Parmi elles, se trouvait une jeune fille de dix-sept ans que l’on avait renvoyée d’un couvent par suite de sa pauvre santé et de sa faiblesse d’esprit. Ni tout à fait folle, ni complètement idiote, Marie X… divaguait cependant fréquemment et, quoique très douce, n’était capable que d’un travail peu compliqué. Mme L… l’employait, répétait-on, avec admiration, par charité.
À la vérité, l’innocente lui était fort utile. Elle acceptait les travaux de couture les plus ingrats et, de plus, servait de bonne à tout faire à la couturière qui, pour son service particulier, n’employait qu’une femme de ménage non couchée.
Marie, sans être jolie, avait un charme fait de blancheur anémique, de cheveux abondants couleur de chanvre, d’yeux bleu pâle un peu égarés, mais semblant pleins de rêve et de vague souffrance.
Ses grands yeux innocents, son expression de langueur douloureuse impressionnaient singulièrement la patronne. Et, bientôt, ses tracasseries envers la pauvre fille prirent un caractère tout spécial. Il semblait que tout lui fût prétexte pour amener dans ce regard de demi-idiote une expression de souffrance plus frappante, plus nette et qui, perçue, lui causait un choc agréable, une émotion véritablement voluptueuse.
Peu à peu le désir de la veuve de torturer cette jeune fille devint plus impérieux.
Néanmoins, elle voulait garder des dehors corrects, et jamais sa tyrannie ne s’exerça en public.
Devant les autres ouvrières, Mme L… se montrait, pour Marie, ni plus ni moins rêche et persécuteuse que pour les autres.
Lorsque la sortie de l’atelier était effectuée, la scène changeait.
La femme de ménage ne faisant son service que jusqu’à deux heures, à partir de six ou sept heures, Mme L. et Marie se trouvaient entièrement seules dans l’appartement. Alors le supplice de l’orpheline commençait.
Il était d’abord moral. Marie, très superstitieuse, croyait aux revenants ; Mme L… lui en faisait apercevoir partout et, par mille ruses, la faisait tomber dans des transes inimaginables. Puis, profitant de la crédulité de sa victime, elle la persuadait que, durant les heures nocturnes, elle était transportée en enfer, où l’âme de Mme L…, elle-même, était chargée de la tourmenter.
Dès que Marie était endormie dans la chambre où sa patronne l’enfermait, celle-ci survenait, nue sous un peignoir flottant, les cheveux épars sur les épaules, le visage sinistre, un fouet à la main, et de l’autre portant une petite lampe.
L’innocente était éveillée par des morsures, des coups, des pinçons, jetée à bas du lit, son vêtement de nuit arraché et les coups pleuvaient sur sa nudité.
Le lendemain, elle se taisait, terrifiée par les menaces du « fantôme » et, d’ailleurs, persuadée que nul ne pourrait lui venir en aide.
Ce martyre, qui dura deux ans, fut enfin découvert, parce que, dans son délire cruel, Mme L… finit par briser le bras de sa victime.
On dut appeler un médecin qui découvrit des traces tellement significatives de sévices sur le corps de la malheureuse Marie qu’une enquête eut lieu où la vérité se fit jour.
Habilement interrogée, Mme L… finit par tout reconnaître et avoua qu’elle éprouvait des sensations voluptueuses inouïes en torturant la jeune fille et que, durant tout le temps qu’elle la frappait, ses parties sexuelles étaient, pour ainsi dire, en orgasme ininterrompu.
Cependant, la cruauté la satisfaisait sexuellement, et jamais elle ne s’était livrée sur sa victime à des actes précisément obscènes.
Un pensionnat laïque fut, pendant une période assez longue, le théâtre de scènes aussi bizarres qu’effroyables.
Cette institution était très spéciale. Deux femmes la dirigeaient qui, entre elles, étaient liées par un violent amour saphique. L’une, âgée de quarante ans environ, avait été renvoyée de l’Université pour cause de sévices envers ses élèves ; sa compagne, qui ne comptait pas plus de vingt-quatre ans, fort jolie personne, avait chanté dans les music-halls. Passionnément éprise de cette Sylvia, Mme R… l’avait prise comme sous-maîtresse lorsqu’elle fonda son petit établissement qui était situé à P.....
Ce pensionnat ne contenait que des internes et il était exclusivement composé d’élèves, filles de demi-mondaines, de chanteuses et danseuses de music-hall peu fortunées et peu soucieuses de leur progéniture.
Le prix de la pension était peu élevé et Mme R… faisait valoir comme avantage que l’on ne donnait jamais de congés ni de vacances aux élèves durant toute l’année, sauf lors de l’ordre exprès des mères. Celles-ci se gardant bien de réclamer leurs filles dont la présence chez elles ne pouvait que les gêner, les enfants demeuraient l’année entière au pensionnat, entièrement livrées aux fantaisies de la directrice.
La vie au pensionnat de P..... pour les pauvres petites filles n’était pas sans avoir quelque ressemblance avec celle des misérables élèves de la pension Squeers, dans le célèbre roman de Dickens.
Comme chez Squeers, les élèves faisaient tout l’ouvrage de la maison, ne recevaient qu’une nourriture déplorable, et l’instruction qu’on leur délivrait était des plus rudimentaires. Comme chez Squeers également, les châtiments corporels pleuvaient. Mais Mme R… et Sylvia, hystériques et sensuelles sadiques, avaient imaginé de grotesques et sinistres raffinements en ces corrections dont elles abreuvaient leurs victimes.
Voici ce que le procès mit au jour, lorsque ces misérables furent enfin dénoncées par l’une des enfants, moins terrorisée, moins abrutie et plus énergique que ses compagnes de douleur et de honte.
Durant toute la matinée, les élèves se livraient aux soins ménagers, dirigées et malmenées par la cuisinière, une maritorne alcoolique, véritable brute, qui ne ménageait ni les taloches, ni les coups de pied ou les coups de balai à ses infortunées aides.
Jusqu’à midi, Madame et Mademoiselle les directrices de l’établissement restaient invisibles, dormant ou s’aimant dans leur chambre. À huit heures, les élèves avaient reçu un gros morceau de pain rassis et la permission de l’arroser au robinet ; à midi, on leur servait une soupe aux légumes, pâtée de pommes de terre ou de haricots assaisonnée d’un rien de graisse, et elles avaient repos jusqu’à deux heures, où « la classe » commençait.
Cette classe, où on leur enseignait la lecture, l’écriture et quelques vagues notions de calcul, d’histoire et de géographie, n’était, en réalité, qu’une sorte de prétexte aux punitions que Mme R… et Sylvia distribuaient avec largesse.
De quatre à cinq, les élèves allaient encore aider la cuisinière ; et, de cinq à sept, commençait l’exécution des punitions données durant le courant de la classe.
Avant de donner le détail des scènes burlesques et tragiques qui se passaient alors, disons tout de suite qu’entre sept et huit heures, les fillettes recevaient une faible portion de ragoût et devaient aller immédiatement se coucher en un dortoir glacé en hiver, où jamais l’ombre de feu n’apparaissait.
Les punitions étaient des plus variées et s’exécutaient sous les yeux de toutes les élèves, et la plupart du temps avec leur participation.
Il y avait le fouet simple, le fouet honteux, la fustigation générale honteuse, le supplice qui se divisait en petit supplice, grand supplice et supplice suprême. Puis, c’étaient toute une suite de punitions compliquées, aux noms divers, minutieusement catalogués par ces deux maniaques, et dont nous donnerons le détail tout à l’heure.
La fillette — les élèves avaient de six à quatorze ans — condamnée au fouet simple montait sur l’estrade où se trouvaient Mme R… et Sylvia, tandis que toutes les autres élèves étaient assises sur leur banc comme pour la classe. Elle s’agenouillait, baisait le plancher et le bas des robes des deux maîtresses, demandait pardon et relevait sa robe. Sylvia qui était vêtue d’un pantalon de cycliste, ouvert comme un pantalon de lingerie, s’emparait de la fillette, la faisait se courber, la prenait entre ses jambes et, la déculottant, mettait ses fesses à l’air, qu’elle caressait de verges plus ou moins longtemps.
Il faut noter que ces fessées n’étaient ni très longues, ni très cruelles : ce n’était qu’une sorte de prélude aux autres punitions. Il y avait tous les jours deux ou trois fessées sans importance, et les punies regagnaient leur banc en sanglotant, tandis que les autres élèves trépignaient et applaudissaient.
Car, il faut noter que ces fillettes, bien que martyres, en somme, étaient gagnées par l’hystérie de leurs tortureuses et tiraient de leurs souffrances mutuelles une sorte de volupté exacerbée.
Le fouet honteux consistait à faire s’étendre la coupable sur une chaise longue, les jambes écartées, les vêtements relevés, les chairs à nu, et les coups de verge étaient appliqués par Sylvia sur le sexe de la victime que Mme R… maintenait fortement, car, là, la douleur était plus sérieuse que lors de la fessée.
Pour la fustigation générale honteuse, la fillette était placée sur la chaise longue à quatre pattes, le ventre soutenu par une pile de coussins. Sylvia maintenait ses épaules ; Mme R… tenait écartées les cuisses complètement découvertes de l’enfant. Tour à tour, ses compagnes venaient la frapper de verges sur les fesses et enfoncer leurs doigts dans son sexe.
Cette punition causait une joie générale aux exécuteuses, qui fouettaient et « pénétraient » avec fureur leur malheureuse compagne, gagnées par la folie sadique et oubliant que, bientôt, ce serait leur tour.
Le supplice consistait à introduire dans le vagin de la condamnée, renversée et attachée sur la chaise longue, des phallus en bois de diamètre différent ; le « petit supplice » déflorait simplement les enfants et n’était douloureux qu’à cause de la longueur de l’opération et de la brutalité des coups donnés avec cet organe postiche, que Mme R… maniait de préférence.
Le grand supplice se donnait avec un phallus disproportionné à l’ouverture de la vulve enfantine et causait à la patiente de vives douleurs.
Le supplice suprême était causé par un énorme phallus garni d’aspérités. À la fin de la séance, la fillette était en sang.
Les punitions témoignaient de l’imagination variée de Mme R… et de Sylvia.
Tantôt les fillettes devaient baiser et lécher le sexe des directrices, tantôt celui de leurs compagnes. Quelquefois, elles devaient avaler l’urine des deux dames. D’autres fois, elles devaient courir, nues, à quatre pattes, des objets fichés dans l’anus ou la matrice. Les fessées aux orties, le sexe saupoudré de poivre, n’étaient pas oubliés. Et toujours, la luxure sadique des deux femmes s’excitait de la présence de toutes les autres élèves et du semblant de punition que revêtaient ces actes de pur vice sensuel.
Dans une maison religieuse analogue à celle du Bon-Pasteur, durant de longues années, des actes sadiques révoltants furent commis à l’égard des jeunes orphelines dont le travail était dirigé par des sœurs converses, véritables brutes cruelles et luxurieuses.
Là, pas de « littérature », pas de mise en scène comme au pensionnat de P.....
Les enfants devaient satisfaire les besoins sexuels de leurs deux bourreaux femelles et, comme récompense, elles n’en recevaient que des coups, des rossées données avec le vieux manche d’un balai, ou des piqûres de ciseaux dans les engelures qui couvraient leurs mains l’hiver.
Nous avons parlé précédemment de cette veuve d’irréprochable réputation et dans une situation honorable qui avait obtenu de l’assistance publique la garde d’une petite fille, dont elle avait fait une esclave pour la satisfaction de ses besoins sexuels.
Mais la monstrueuse créature ne se contentait pas des odieux services imposés à sa victime, il lui fallait encore la torturer de cent autres façons.
Sous le prétexte le plus futile, l’enfant était battue cruellement, privée de nourriture, menacée de tous les supplices les plus effrayants, enfermée dans un cabinet en compagnie d’un chien hargneux, qui la couvrait de morsures et qui était dressé à courir derrière elle et à la houspiller.
Aux bains de mer, où Mme X… s’était rendue traînant toujours avec elle sa petite martyre, les baigneurs firent chasser cette maniaque de la plage, où tous les jours elle offrait un spectacle qui bouleversait et indignait tous les cœurs sensibles.
Sous prétexte d’apprendre à nager à sa pupille, Mme X… la frappait, l’enfonçait sous l’eau, la renversait, lui donnait toutes les affres et la souffrance d’une noyade, qui s’arrêtait juste au moment où l’asphyxie définitive commençait.
Chaque jour, à l’heure du bain, l’enfant voyant son supplice imminent se mettait à pleurer, essayait de s’enfuir, ce qui fournissait à son bourreau un prétexte pour commencer ses brutalités. Durant tout le déshabillage et le bain, les cris affolés, déchirants, de la petite fille, les coups de sa mère adoptive causaient une révolution sur la plage.
Dans les nombreuses affaires de brutalités répétées, de persécution et de séquestration d’enfants, les mères ou belles-mères coupables offrent des exemples de cruauté raffinée, persistante, absolument stupéfiants.
En général l’homme est sujet au sadisme par accès ; au lieu que la femme sadique l’est perpétuellement et s’acharne sans trêve sur sa victime, en usant autant de moyens intellectuels que matériels pour accabler le malheureux sujet sur lequel sa monomanie s’assouvit.
Beaucoup de femmes entachées de sadisme se contentent d’imaginer des actes féroces, sans jamais tenter de mettre ceux-ci à exécution, ou en font une démonstration puérile.
Une certaine demi-mondaine, très riche, très célèbre, bien connue pour ses caprices bizarres dans les maisons de tolérance qu’elle fréquentait, ne goûtait vraiment le plaisir vénérien que si la femme qu’elle caressait de ses mains et de ses lèvres était couverte de sang. — On simulait ce sang avec un peu de carmin délayé dans de la glycérine.
D’autres hystériques exigent que leur compagne leur crie grâce, se débatte, détaille d’abominables souffrances imaginaires pendant qu’elles assouvissent leurs désirs.
Une demi-mondaine adorait, tandis qu’une amante lui donnait le baiser saphique, frapper un petit chien attaché au pied de son lit, les cris plaintifs de l’animal aiguisaient merveilleusement sa joie sensuelle.
Nous avons été à même d’approcher d’une femme dont nous devons citer ici la singulière névrose, car, bien que son sadisme particulier s’assouvît exclusivement sur des hommes, c’était une saphiste invétérée, et c’était en réalité par un contre-coup de ses goûts lesbiens qu’il lui plaisait de torturer des hommes.
Il n’y avait de sa part nulle brutalité, nuls sévices physiques et pourtant, plusieurs fois, elle faillit tuer ses victimes.
Fort belle, très séduisante, d’une lascivité qui éclatait en tout elle, elle conquérait qui elle voulait. Aux hommes qu’elle choisissait, elle donnait l’impression d’une créature très sensuelle, et ils n’avaient pas le moindre doute sur l’intensité de volupté qu’ils savoureraient entre ses bras.
Or, dans le tête-à-tête, après avoir excité les sens de son compagnon jusqu’au délire, elle se refusait obstinément au coït. Et cela avec de tels raffinements, de telles habiletés, avec une science si surprenante pour éteindre et rallumer le désir que l’homme éperdu, affolé, devenu un véritable mannequin entre ses mains, souffrait un indicible martyre.
Durant deux, trois ou quatre heures de suite, elle accomplissait ce tour de force de n’être ni violée ni assassinée par des hommes que la lubricité transformait en véritables aliénés et qui, suivant leur tempérament, finissaient par tomber dans une crise de nerfs, ou s’évanouir, ou s’effondrer dans une prostration cérébrale et physique totale. Un jour, l’une de ses victimes, un jeune homme dont le cœur n’était pas tout à fait dans un état normal, eut une syncope dont il ne sortit que par miracle. Un autre saisi d’un accès de délire tenta de se jeter par la fenêtre.
Le spectacle du désir masculin poussé à son paroxysme, toujours déçu, et les souffrances de cette déception étaient la seule intense joie sensuelle que cette étrange femme pût goûter auprès des hommes. Le coït lui causait une horreur insurmontable, et même les caresses saphiques données par des lèvres et des mains mâles ne lui faisaient ressentir qu’un plaisir médiocre et superficiel.
La flagellation d’autrui a ses adeptes frénétiques parmi les femmes, particulièrement les Anglaises.
Les mœurs de certaine dame de la cour de la reine Victoria étaient si bien connues que les femmes de chambre entrant chez elle se munissaient d’une forte provision de cérat, en prévision des contusions et des blessures dont leurs reins et leurs fesses ne manqueraient pas d’être couverts.
