Le Livre des mille nuits et une nuit/Tome 08/Texte entier
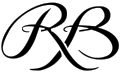
Que mon ami Pierre Louÿs, délicieux traducteur de Chansons selon le mode littéral, reçoive le don de ces simples histoires, pour sa modestie.
HISTOIRE DE ROSE-DANS-LE-CALICE
ET DE DÉLICE-DU-MONDE
Et Schahrazade dit au roi Schahriar :
On raconte qu’il y avait, en l’antiquité du temps et le passé des époques et des âges, un roi d’un très haut rang, plein de puissance et de gloire. Il avait un vizir nommé Ibrahim, dont la fille était une merveille de grâce et de beauté, tout à fait supérieure en élégance et en perfection, et douée d’une intelligence remarquable et de manières notoirement exquises. En outre, elle aimait à l’extrême les réunions joyeuses et le vin qui donne la gaîté, sans dédaigner les visages jolis, les vers en ce qu’ils ont de plus raffiné, et les histoires extraordinaires. Elle avait en elle tant de délicates délices qu’elle attirait d’amour vers elle les têtes et les cœurs, comme l’a d’ailleurs dit un des poètes qui l’ont chantée :
Je suis épris de la séductrice ! Enchanteresse des Turcs et des Arabes, elle connaît toutes les finesses de la jurisprudence, de la syntaxe et des belles-lettres.
Ainsi, quand nous discutons ensemble sur tout cela, voici ce que me dit parfois la maligne :
« Je suis agent passif, et tu t’obstines à me mettre au cas indirect. Pourquoi cela ? Par contre, tu laisses toujours à l’accusatif ton régime dont le rôle est d’être actif, et tu ne lui donnes jamais le signe de l’érection ! »
Je lui dis : « Ce n’est point mon régime seul qui t’appartient, ô ma maîtresse, mais ma vie et toute mon âme ! Seulement ne t’étonne plus de ce renversement des rôles. Aujourd’hui les temps sont changés et les choses bouleversées.
« Toutefois, si, malgré ce que je t’en dis, tu refuses de croire à ce renversement, eh bien ! n’hésite plus et regarde mon régime ! Ne remarques-tu point que le nœud de la tête se trouve à la queue ? »
Or, cette adolescente était si exquise, si douce et d’une beauté si vive qu’on l’appelait Rose-dans-le-Calice…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENTIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, cette adolescente était si exquise, si douce et d’une beauté si vive qu’on l’appelait Rose-dans-le-Calice !
Le roi, qui aimait beaucoup l’avoir à ses côtés, dans les festins, tant elle était douée de finesse d’esprit et de distinction, avait coutume, chaque année, de donner de grandes fêtes et, par la même occasion, de profiter de la présence au palais des principaux personnages de son royaume pour jouer avec eux à la balle.
Lorsque le jour arriva où les invités du roi se réunissaient pour ce jeu de balle, Rose-dans-le-Calice s’assit à sa fenêtre pour jouir du spectacle. Bientôt le jeu commença à s’animer, et la fille du vizir, qui suivait les mouvements et observait les joueurs, aperçut au milieu d’eux un jeune homme infiniment beau, au visage charmant, aux dents souriantes, à la taille élancée et aux vastes épaules. Elle éprouva un tel plaisir à sa vue, qu’elle ne put se rassasier de le contempler ni s’empêcher de lui lancer des œillades répétées. Elle finit par appeler sa nourrice et lui demanda : « Sais-tu le nom de ce jeune homme exquis si plein de distinction, qui est là au milieu des joueurs ? » La nourrice répondit : « Ô ma fille, ils sont tous beaux ! Je ne vois donc pas de qui tu veux parler. » Elle dit : « Attends alors ! Je vais te le montrer ! » Et aussitôt elle prit une pomme et la lança sur le jeune homme qui se retourna et leva la tête vers la fenêtre. Il vit alors Rose-dans-le-Calice, souriante et belle comme la pleine lune illuminant les ténèbres ; et, du coup, avant même qu’il eût le temps de ramener à lui son regard, il se sentit extrêmement ému d’amour ; et il se récita ces vers du poète :
Mon cœur amoureux, qui l’a percé ? Est-ce l’archer ou la flèche de tes prunelles ?
Flèche acérée ! viens-tu si rapide de la masse des guerriers ou simplement d’une fenêtre ?
Rose-dans-le-Calice demanda alors à sa nourrice : « Et maintenant peux-tu me dire enfin le nom de ce jeune homme ? » Elle répondit : « Il s’appelle Délice-du-Monde. » En entendant ces mots, la jeune fille secoua la tête de plaisir et d’émotion, se laissa tomber sur le divan, gémit profondément, et improvisa ces strophes :
Il n’a pas eu à le regretter, celui qui t’a nommé Délice-du-Monde, ô toi qui allies la délicatesse exquise des manières à toutes les choses excellentes.
Ô lever de la pleine lune ! Ô visage éclatant qui éclaires l’univers et illumines le monde,
Tu es, entre toutes les créatures, le seul sultan de la beauté ! Et j’ai des témoins pour me donner raison !
Ton sourcil n’est-il point la lettre noun, parfaitement tracée ? L’amande de ton œil ne ressemble-t-elle pas à la lettre sad, écrite par les doigts amoureux du Créateur ?
Et ta taille ! N’est-elle point le jeune, le tendre rameau flexible qui prend toutes les formes désirables ?
Si déjà ton intrépidité, ô cavalier, a surpassé la valeur des plus forts, que ne dirai-je pas de ta grâce supérieure et de ta beauté ?
Cette improvisation terminée, Rose-dans-le-Calice prit une feuille de papier et y transcrivit les vers, soigneusement. Elle la plia ensuite et la mit dans un sachet de soie brodé d’or qu’elle cacha sous le coussin du divan.
Or, la vieille nourrice, qui avait observé ces divers mouvements de sa maîtresse, se mit à causer avec elle de choses et d’autres jusqu’à ce qu’elle l’eût endormie. Alors elle tira doucement la feuille de dessous le coussin, la lut et, s’étant ainsi assurée de la passion de Rose-dans-le-Calice, la remit à la même place. Puis, une fois l’adolescente réveillée, elle lui dit : « Ô ma maîtresse, je suis pour toi la meilleure et la plus tendre des conseillères ! Je tiens donc à te dire combien violente est la passion d’amour, et à te prévenir que, lorsqu’elle se concentre dans un cœur sans pouvoir s’en épancher, elle le fait fondre, fût-il d’acier, et occasionne dans le corps bien des maladies et des infirmités. Au contraire, si la personne qui souffre de ce mal d’amour le divulgue à une autre, elle ne pourra qu’en tirer du soulagement ! »
En entendant ces paroles de sa nourrice, Rose-dans-le-Calice dit : « Ô nourrice, connaîtrais-tu le remède de l’amour ? » Elle répondit : « Je le connais. C’est de jouir de celui qui en est l’objet ! » Elle demanda : « Et comment fait-on pour arriver à cette jouissance ? » Elle dit : « Ô ma maîtresse, pour cela on n’a d’abord qu’à échanger des lettres pleines de paroles gentilles, de salutations et de compliments ; car c’est là le meilleur moyen qu’ont deux amis de se réunir, et c’est la première chose à faire pour résoudre les difficultés et prévenir les complications. Si donc…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … Si donc, ô ma maîtresse, tu as quelque chose de caché dans le cœur, ne crains point de me le confier ; car si c’est un secret je le garderai intact de toute divulgation, et personne ne saura comme moi te servir avec ses yeux et sa tête pour satisfaire tes moindres désirs et porter discrètement tes missives ! »
Lorsque Rose-dans-le-Calice eut entendu ces paroles de sa nourrice, elle sentit sa raison s’envoler de joie ; mais elle retint son âme de toutes paroles désordonnées, de peur de trahir le trouble qui l’agitait, se disant en elle-même : « Nul ne connaît encore mon secret ; et il vaut mieux pour ma sécurité que cette femme n’en soit informée qu’après des preuves certaines de fidélité. » Mais déjà la nourrice ajoutait : « Ô mon enfant, la nuit dernière j’ai vu un homme qui m’apparut en songe et me dit : « Sache que ta jeune maîtresse et Délice-du-Monde sont amoureux l’un de l’autre, et que c’est à toi à favoriser l’aventure en te chargeant de leurs missives et en leur rendant toutes sortes de services avec une grande discrétion, si tu veux bénéficier sûrement d’une énorme quantité d’avantages ! » Or moi, ô ma maîtresse, je te raconte là ce que j’ai vu ! À toi maintenant la décision ! » Rose-dans-le-Calice répondit : « Ô nourrice, te sens-tu vraiment capable de taire les secrets ? » Elle dit : « Peux-tu en douter un instant, alors que je suis une essence d’entre les essences des cœurs d’élection ? » L’adolescente alors n’hésita plus, lui exhiba le papier sur lequel elle avait écrit les vers et le lui remit en disant : « Hâte-toi de porter ceci à Délice-du-Monde et de me rapporter la réponse ! » La nourrice aussitôt se leva et se rendit chez Délice-du-Monde dont elle commença par baiser la main, pour ensuite le complimenter avec les expressions les plus gentilles et les plus courtoises. Après quoi elle lui remit le billet. Délice-du-Monde déplia le papier et le lut. Puis, lorsqu’il eut bien compris la portée du contenu, il écrivit sur le revers du feuillet les vers suivants :
Mon cœur, que l’amour exalte, bat passionnément, et je comprime ses élans tumultueux, mais en vain ! Mon état dévoile mes sentiments !
Si mes larmes débordent, je dis à mon censeur : « C’est l’effet d’un mal aux yeux ! » Je pense ainsi lui donner le change sur le vrai motif et lui cacher mes intimités.
Libre de tous les liens hier encore, et le cœur tranquille, je ne savais point l’amour ! Je me réveille avec le cœur dominé par l’amour.
Je viens vous soumettre mon état et vous conter ma plainte d’amour, afin que votre cœur ait compassion du malheureux que brûle la passion et que torture le sort.
Cette plainte, je vous la trace ici avec les larmes de mes yeux, pour qu’elle vous prouve mieux ainsi l’amour qui l’a causée.
Qu’Allah préserve de toute atteinte un visage que la beauté a pris soin de recouvrir de son voile, devant qui s’incline la lune et qu’honorent, en esclaves, les étoiles.
Sous le rapport de la beauté, je n’ai jamais vu sa pareille ! Ô sa taille ! Les flexibles rameaux apprennent à onduler en la voyant se balancer.
Maintenant j’ose vous prier, si cela ne vous est point une cause d’ennui, de venir me voir. Ô ! cela m’est d’un grand prix.
Il ne me reste plus qu’à vous faire don de mon âme, dans l’espoir que vous l’accepterez peut-être. Votre venue me sera le Paradis, et votre refus la Géhenne !
Cela écrit, il plia la feuille, la baisa et la remit à la nourrice en lui disant : « Ma mère, je compte sur ta bonté pour prédisposer en ma faveur le bon vouloir de ta maîtresse ! » Elle répondit : « J’écoute et j’obéis ! » prit le billet, et se hâta de se rendre auprès de sa maîtresse à qui elle le remit.
Rose-dans-le-Calice, ayant pris le billet, le porta à ses lèvres, puis à son front, le déplia et le lut. Lorsqu’elle en eut bien compris le sens, elle écrivit en dessous les vers suivants :
Ô toi dont le cœur est épris de notre beauté, ne crains point d’unir la patience à l’amour ! C’est un moyen peut-être d’arriver à nous posséder.
Lorsque nous eûmes reconnu que ton amour était sincère, et que ton cœur était éprouvé par les mêmes tourments que ceux de notre cœur,
Nous eûmes un désir égal à ton désir de nous voir enfin unis, mais nous fûmes retenu par la crainte de nos gardiens.
Sache que lorsque sur nous descend la nuit pleine de ténèbres, notre ardeur s’exalte tant que les feux s’allument dans nos entrailles.
Les tyranniques tourments de ton désir chassent alors le sommeil de notre couche, et la douleur cuisante s’empare de notre corps.
Toutefois n’oublie point que le premier devoir des amoureux est de taire aux autres leur amour ! Garde-toi donc de soulever pour d’autres yeux le voile qui nous protège.
Et maintenant je veux crier que mes entrailles sont bourrées d’amour pour un jouvenceau ! Ô ! que n’est-il toujours resté dans nos demeures !
Lorsqu’elle eut fini d’écrire ces vers…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Lorsqu’elle eut fini d’écrire ces vers, elle plia la feuille et la remit à la nourrice qui la prit et sortit du palais. Mais la destinée voulut qu’elle rencontrât justement le chambellan du vizir, père de Rose-dans-le-Calice, qui lui demanda : « Où vas-tu ainsi à cette heure ? » À ces paroles, elle fut saisie d’un trouble extrême et répondit : « Au hammam ! » et elle continua sa route, mais dans un tel trouble qu’elle laissa tomber, sans y faire attention, le billet qu’elle avait mal assuré dans un pli de sa ceinture. Et voilà pour elle !
Mais pour ce qui est du billet, tombé par terre près de la porte du palais, il fut ramassé par un des eunuques qui se hâta d’aller le porter au vizir.
Or, justement, le vizir venait de sortir de son harem et était entré s’asseoir sur son divan dans la salle de réception. Et pendant qu’il était assis de la sorte, bien tranquille, l’eunuque s’avança en tenant à la main le billet en question et lui dit : « Mon seigneur, je viens de trouver par terre, dans la maison, ce billet que je me suis hâté de ramasser. » Le vizir le lui prit des mains, le déplia, et y trouva écrits les vers en question. Il les lut et, lorsqu’il en eut compris le sens, il en examina l’écriture qui lui parut être sans conteste celle de sa fille Rose-dans-le-Calice.
À cette vue, il se leva et se rendit auprès de son épouse, mère de la jeune fille, en pleurant si abondamment que sa barbe en était toute mouillée. Et son épouse lui demanda : « Qu’est-ce qui te fait pleurer ainsi, ô mon maître ? » Il répondit : « Prends ce papier et regarde ce qu’il contient ! » Elle prit le papier, le lut, et trouva que c’était une correspondance entre sa fille Rose-dans-le-Calice et Délice-du-Monde. À cette constatation, des larmes lui vinrent aux yeux, mais elle maîtrisa son âme, empêcha ses pleurs et dit au vizir : « Ô mpn seigneur, les larmes ne peuvent être d’aucune utilité ; la seule idée excellente serait de songer au moyen de sauvegarder ton honneur et cacher l’affaire de ta fille ! » Et elle continua à le consoler et à l’alléger de ses chagrins. Il lui répondit : « Moi je crains fort pour ma fille cette passion-là ! Ne sais-tu point que le sultan éprouve une affection très grande pour Rose-dans-le-Calice ? Aussi ma crainte dans cette affaire tient à deux causes : la première me concerne, car c’est ma fille ; la seconde, par rapport au sultan, est que Rose-dans-le-Calice est la favorite du sultan, et il se peut que de là sortent de graves complications ! Toi, que penses-tu de tout cela ? » Elle répondit : « Attends un peu, pour me donner le temps de faire la Prière du Parti à prendre ! » Et aussitôt elle se mit dans l’attitude de la prière, selon le rite et la Sunna, en exécutant les pratiques pieuses prescrites en pareil cas.
Cette prière terminée, elle dit à son époux : « Sache qu’il y a, au milieu de la mer qu’on nomme Bahr Al-Konouz, une montagne appelée montagne de Celle-qui-a-perdu-son-enfant. Nul ne peut aborder à cet endroit-là qu’avec des difficultés infinies. Je te conseille donc d’installer là une demeure pour ta fille. »
Le vizir, d’accord sur ce point avec son épouse, résolut de faire construire, sur cette Montagne-de-la-Mère-qui-a-perdu-son-enfant, un palais inaccessible où il confinerait Rose-dans-le-Calice, en ayant soin toutefois de la pourvoir de provisions suffisantes pour une année, renouvelables au commencement de l’année suivante, et de lui donner des gens pour lui tenir compagnie et la servir.
Une fois qu’il eut pris cette résolution, le vizir réunit des menuisiers, des maçons et des architectes, et les envoya à cette montagne, où ils ne manquèrent pas de bâtir un palais inaccessible et tel que l’on n’avait jamais vu son pareil dans le monde.
Alors le vizir fit préparer les provisions du voyage, disposa la caravane, et pénétra durant la nuit chez sa fille et lui ordonna de partir. À cet ordre, Rose-dans-le-Calice ressentit violemment les angoisses de la séparation et ne put, lorsqu’elle fut sortie du palais et qu’elle eut remarqué les préparatifs du voyage, s’empêcher de pleurer des pleurs abondants. Elle eut alors l’idée, pour informer Délice-du-Monde de ce qui se passait en elle en fait d’ardeur amoureuse violente à faire frissonner la peau, fondre les rochers les plus durs et déborder les larmes, d’écrire sur la porte les vers suivants :
Ô maison ! si le bien-aimé passe au matin, en saluant par les signes des amoureux,
Rends-lui de notre part un salut délicieux et parfumé, car nous ne savons où le sort nous mènera ce soir !
Je ne sais moi-même vers quels lieux me porte le voyage, car on m’emmène avec hâte et bien peu de bagages.
La nuit viendra et l’oiseau du fourré annoncera par ses plaintes modulées, sur les rameaux, la nouvelle de notre triste destinée.
Il dira dans son langage : « Ô douleur ! qu’il est cruel de se séparer de celui qu’on aime ! »
Et moi quand j’ai vu les coupes de la séparation déjà pleines et le sort prêt à nous les offrir, malgré nous,
J’ai coupé le breuvage amer avec de la résignation ! Mais la résignation, je le vois bien, hélas ! ne pourra jamais me procurer l’oubli !
Lorsqu’elle eut tracé ces vers sur la porte…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Lorsqu’elle eut tracé ces vers sur la porte, elle prit place sur son palanquin, et la caravane se mit en marche. Ils franchirent les plaines et les déserts, les terrains unis et les monts accidentés, et arrivèrent de la sorte à la mer d’Al-Konouz, sur le rivage de laquelle ils dressèrent leurs tentes ; et ils construisirent un grand navire où ils firent s’embarquer la jeune fille avec sa suite.
Or, comme le vizir avait donné l’ordre aux conducteurs de la caravane de ne point manquer, une fois la jeune fille confinée dans le palais au sommet de la montagne, de revenir sur le rivage et de détruire le navire, ils se gardèrent bien de désobéir et exécutèrent en tous points la mission dont ils étaient chargés, pour revenir ensuite auprès du vizir en pleurant de tout cela. Et voilà pour eux !
Mais pour ce qui est du Délice-du-Monde, lorsqu’il se fut réveillé le lendemain, il ne manqua pas de faire sa prière du matin et de monter à cheval pour se rendre, suivant sa coutume, au service du sultan. Comme il passait devant la porte du vizir, il remarqua les vers qui y étaient inscrits, et il faillit, à cette vue, perdre tout sentiment ; et le feu s’alluma dans ses entrailles bouleversées. Il revint alors chez lui, où, en proie à l’impatience, à l’inquiétude et à l’agitation, il ne put rester un moment en place. Puis, comme la nuit tombait, et qu’il craignait de révéler son état aux gens de sa maison, il se hâta de sortir pour, perplexe et hagard, errer à l’aventure sur les chemins.
Il marcha de la sorte toute la nuit et une partie de la matinée, jusqu’à ce que la chaleur intense et la soif torturante l’eussent obligé à prendre quelque repos. Or, justement il était arrivé au bord d’un ruisseau qu’un arbre ombrageait, et où il s’assit et prit de l’eau dans le creux de ses mains pour boire. Mais, en portant cette eau à ses lèvres, il ne lui trouva aucun goût ; en même temps il sentit que sa figure était altérée et son teint bien jaune ; et il vit ses pieds enflés par la marche et la fatigue.. Alors il se mit à pleurer abondamment, et, les larmes ruisselant sur ses joues, il se récita ces vers :
L’amoureux s’enivre de l’amour de son ami, et son ivresse augmente de l’intensité de ses désirs.
Il erre avec la folie de son amour, exalté et frénétique ; il ne trouve nulle part d’asile ; il ne trouve aucun goût à la nourriture.
Comment l’amoureux peut-il trouver de la joie à vivre loin de son ami ? Ah ! cela serait prodigieux !
Je suis en fusion depuis que m’habite l’amour ; et des pleurs en torrents lavent mes joues.
Ô ! quand verrai-je l’ami, ou quelqu’un de sa tribu qui mette un peu de calme dans ce cœur torturé ?
Lorsqu’il eut récité ces vers, Délice-du-Monde pleura jusqu’à ce qu’il eût mouillé la terre ; puis il se leva et s’éloigna de ces lieux. Pendant que, désolé, il cheminait de la sorte dans les plaines et les déserts, il vit soudain devant lui un lion à la vaste crinière, au cou redoutable, à la tête énorme comme un dôme, à la gueule plus large qu’une porte et aux dents pareilles aux défenses de l’éléphant. À cette vue, il ne douta pas un instant de sa perte ; il se tourna dans la direction de la Mecque, prononça l’acte de foi, et se prépara à la mort. Toutefois il se souvint à ce moment précis avoir lu autrefois dans les livres anciens que le lion était sensible à la douceur des paroles, qu’il trouvait son plaisir dans les flatteries, et se laissait de cette façon facilement apprivoiser. Il se mit donc à lui dire : « Ô lion des forêts, ô lion des plaines, ô lion intrépide, ô chef redouté des braves, ô sultan des animaux, tu vois devant ta grandeur un pauvre amoureux anéanti par la séparation, à la tête affolée, que la passion a réduit à toute extrémité. Écoute mes paroles, et aie pitié de ma perplexité et de ma douleur ! »
Lorsque le lion eut entendu ce discours, il recula de quelques pas, s’assit sur son derrière, leva la tête vers Délice-du-Monde, et se mit à jouer avec sa queue et ses pattes de devant. En voyant ces divers mouvements du lion, Délice-du-Monde récita ces vers :
« Ô lion du désert, vas-tu me tuer avant que j’aie retrouvé celui qui m’a lié le cœur ?
« Je ne suis point un gibier de prix, oh ! non ! ni même gras, car mon corps est consumé par la perte de l’ami, et mon cœur dévasté !
« Que feras-tu d’un mort à qui ne manque que le linceul ?
« Ô lion tumultueux de la mêlée,
« Si tu me maltraites tu fais la joie de mes envieux !
« Je ne suis qu’un pauvre amoureux noyé dans les larmes,
« Au cœur brisé par l’absence de l’ami !
« Qu’est-il devenu, l’ami ? Ô tristes pensées de mes nuits inquiètes !
« Voici que je ne sais plus si ma vie n’est point déjà le néant ! »
Lorsque le lion eut entendu ces vers, il se leva…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Lorsque le lion eut entendu ces vers, il se leva et, les yeux remplis de larmes, il s’avança avec beaucoup de douceur vers Délice-du-Monde dont il se mit à lécher les pieds et les mains avec la langue. Après quoi il lui fit signe de le suivre et marcha devant lui. Délice-du-Monde suivit le lion, et tous deux marchèrent de la sorte pendant un certain temps. Après avoir gravi une haute montagne et en avoir descendu le versant, ils virent dans la plaine les traces des pas de la caravane. Alors Délice-du-Monde se mit à suivre ces traces avec attention, et le lion, le voyant ainsi sur la piste, le laissa continuer seul ses recherches et rebroussa chemin pour s’en aller en sa voie.
Quant à Délice-du-Monde, il continua à suivre jour et nuit les traces de la caravane, et arriva de la sorte au bord de la mer mugissante aux vagues entrechoquées, où les pas se perdaient à la limite des flots. Il comprit alors que la caravane s’était embarquée et avait continué sa route par mer, et il perdit tout espoir de retrouver sa bien-aimée. Alors il fit couler ses larmes et récita ces vers :
« L’amie est si loin maintenant, et ma patience est à bout.
« Comment aller vers elle par les abîmes de la mer ?
« Comment me résigner, alors que mes entrailles sont consumées,
« Et que l’insomnie a remplacé dans mes yeux le sommeil ?
« Du jour qu’il a quitté les demeures et notre terre,
« Mon cœur s’est enflammé. Ah ! par quelle flamme !
« Ô grands fleuves ! Seyhoun, Jeyhoun, et toi Euphrate ! mes larmes coulent comme vous !
« Elles coulent et débordent bien plus que les déluges et les pluies !
« Mes paupières sont heurtées par de tels torrents de larmes qu’elles en sont ulcérées,
« Et mon cœur a pris feu au contact de tant d’étincelles.
« Les hordes de ma passion et de mes désirs sont montées à l’assaut de mon cœur.
« Et l’armée de ma patience est vaincue et en déroute.
« J’ai risqué ma vie sans calculs, pour son amour ;
« Mais le risque de ma vie est le moindre de mes dangers.
« Puissent mes yeux ne point être punis pour avoir vu dans l’enceinte défendue
« Cette merveilleuse beauté plus éclatante que la lune !
« Je me suis vu terrassé, le cœur transpercé par les flèches
« Décochées sans arc par de larges yeux merveilleusement fendus.
« Il m’a séduit par l’harmonie de ses mouvements et sa souplesse,
« Sa souplesse que n’égalerait la flexibilité du jeune rameau sur la tige du saule.
« De toute mon âme je l’implore pour être secouru dans mes peines et mes chagrins.
« Mais il m’a réduit au triste état où vous me voyez
« Et son regard séducteur a seul causé ma perte. »
Lorsqu’il eut fini de réciter ces vers, il se mit à pleurer tellement qu’il tomba sans connaissance et resta longtemps dans cet état. Mais, une fois qu’il fut revenu de son évanouissement, il tourna la tête à droite et à gauche et, comme il se voyait dans un désert sans habitants, il eut bien peur de devenir la proie des animaux sauvages et se mit à gravir une haute montagne, sur le sommet de laquelle il entendit, sortant d’une caverne, les sons d’une voix humaine. Il écouta attentivement la voix et reconnut que c’était celle d’un ermite qui avait quitté le monde et s’était voué à la dévotion. Il s’approcha de cette caverne et en heurta trois fois la porte sans obtenir une réponse de l’ermite, et sans le voir sortir. Alors il soupira profondément et récita ces vers :
« Ô mes désirs, comment arriverez-vous à votre but ?
« Ô mon âme, comment oublieras-tu tes chagrins, tes peines et tes fatigues ?
« Toutes les calamités sont venues une à une vieillir mon cœur
« Et blanchir ma tête dès ma jeunesse première.
« Nul secours pour adoucir la passion qui me consume,
« Nul ami pour alléger le fardeau qui pèse sur mon âme.
« Ah ! qui saura dire les tourments de mes désirs,
« Maintenant que la destinée s’est tournée contre moi ?
« Ô ! grâce, pitié pour le pauvre amoureux désolé,
« Celui qui a bu le calice de la séparation et de l’abandon !
« Le feu est dans ce cœur ; les entrailles sont consumées,
« Et la raison s’est envolée tant la séparation l’a torturée !
« Nul jour ne me fut plus terrible que celui de ma venue dans sa demeure,
« Quand j’ai vu les vers écrits sur la porte !
« Oh ! j’ai bien pleuré ! J’ai fait boire à la terre mes larmes brûlantes,
« Mais j’ai tu mon secret aux proches et aux étrangers.
« Ô ermite qui as cherché le refuge de cette grotte pour ne rien voir de ce monde,
« Peut-être as-tu toi-même goûté à l’amour, et que ta raison aussi s’est envolée !
« Mais moi pourtant, malgré ceci et cela, malgré tout cela,
« Si j’atteins mon but, j’oublierai, certes ! mes peines et mes fatigues. »
Lorsqu’il eut fini de réciter ces vers, il vit soudain la porte de la grotte s’ouvrir et il entendit quelqu’un s’écrier : « La miséricorde sur toi ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… et il entendit quelqu’un s’écrier : « La miséricorde sur toi ! » Alors il franchit la porte et souhaita la paix à l’ermite qui lui rendit son souhait et lui demanda : « Quel est ton nom ? » Il dit : « Mon nom est Délice-du-Monde ! » Il lui demanda : « Quelle est la cause de ta venue ? » Il lui raconta alors son histoire depuis le commencement jusqu’à la fin, et aussi tout ce qui lui était arrivé. Et l’ermite se mit à pleurer et lui dit : « Ô Délice-du-Monde, il y a vingt ans déjà que j’habite ces lieux, et je n’ai jamais vu personne ici durant mon séjour, si ce n’est dans la journée d’hier. J’ai entendu, en effet, des pleurs et du tumulte, et, ayant regardé du côté d’où venaient ces voix, j’ai vu une foule de gens et aussi des tentes dressées sur le rivage. J’ai vu ensuite ces gens construire un navire où ils s’embarquèrent pour disparaître vers la haute mer. Peu de temps après ils revinrent, mais moins nombreux qu’à l’aller, mirent en pièces le navire et s’en retournèrent en leur voie par où ils étaient venus. Aussi je pense que ceux qui sont partis sans revenir sont précisément ceux que tu cherches, ô Délice-du-Monde ! Je comprends donc l’intensité de ton chagrin, et je t’excuse ! Sache pourtant qu’on ne peut trouver un amoureux qui n’ait éprouvé les peines d’amour ! » Et l’ermite récita ces vers :
« Ô Délice-du-Monde, tu me crois sans souci et le cœur plein de quiétude,
« Et tu ne sais point que l’ardeur de la passion me plie comme un linge et me déplie.
« J’ai connu l’amour dès mon enfance première,
« J’ai connu les transports d’amour alors que je tétais encore.
« J’ai longtemps pratiqué l’amour, si longtemps que j’en devins célèbre,
« Et, si tu l’interroges à mon sujet, il te dira qu’il me connaît.
« J’ai bu la coupe de l’amour, et j’en ai goûté la langueur amère.
« Je ne suis plus qu’une apparence de moi-même, tant mon corps a dépéri.
« J’étais plein de force autrefois ; maintenant ma vigueur a disparu
« Et l’armée de ma patience s’est effondrée sous les glaives des regards.
« Ne crois point arriver à l’amour sans épreuves,
« Car dès les temps anciens les choses contraires se touchent.
« L’amour a décrété pour tous les amoureux
« Que l’oubli est illicite à l’égal de l’impiété. »
Et lorsque l’ermite eut fini de réciter ces vers, il s approcha de Délice-du-Monde et le serra dans ses bras ; et tous deux pleurèrent ensemble tellement que les montagnes retentirent de leurs gémissements, et qu’ils finirent par tomber évanouis.
Lorsqu’ils eurent repris connaissance, ils se jurèrent mutuellement de se considérer désormais comme frères en Allah (qu’il soit exalté !) ; et l’ermite dit à Délice-du-Monde : « Moi je vais prier cette nuit et consulter Allah sur ce que tu as à faire. » Délice-du-Monde répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et voilà pour eux !
Mais pour ce qui est de Rose-dans-le-Calice, voici :
Lorsque les gens qui l’accompagnaient l’eurent conduite à la Montagne-de-la-Mère-qui-a-perdu-son-enfant, et qu’elle fut entrée dans le palais préparé pour elle, elle l’examina avec attention et regarda tout son aménagement, puis se mit à pleurer et s’écria : « Ô demeure, par Allah ! tu es délicieuse, mais il manque la présence de l’ami dans tes murs ! » Puis, comme elle remarquait que l’île était habitée par des oiseaux, elle ordonna à sa suite de tendre des filets pour capturer ces oiseaux et de les mettre dans des cages au fur et à mesure de leur capture, pour les placer ensuite à l’intérieur du palais. Et son ordre fut immédiatement exécuté. Alors Rose-dans-le-Calice s’accouda à la fenêtre, et laissa sa pensée aller vers les souvenirs. Et cela réveilla en elle les ardeurs passées, les désirs cuisants et les transports, et lui fit verser des larmes de regret en même temps que cela lui reportait à la mémoire ces vers qu’elle récita :
« Vers qui jetterai-je la plainte de l’amour qui tient mon âme, des angoisses que l’éloignement de l’ami me cause et du feu qui brûle sous mes côtes ? Mais je me tairai par crainte de mon gardien.
« Je suis devenue plus chétive de corps que le bois d’un cure-dent, consumée que je suis par les ardeurs, les tristesses de l’absence et les lamentations.
« Où sont les yeux de l’ami pour qu’ils voient le triste état d’égarement où m’a réduit son souvenir ?
« Ils ont outrepassé leurs droits en me transportant dans un endroit où ne peut venir mon bien-aimé !
« Je charge le soleil de porter mes saluts par milliers, dans les soirs et les matins, à l’amant dont la beauté couvre de honte la pleine lune à son lever, et dont la souplesse de taille surpasse celle du jeune rameau !
« Si les roses veulent imiter sa joue, je dirai aux roses : « Vous ne sauriez, ô roses, ressembler à sa joue, si vous n’êtes pas les roses de l’autre joue ! »
« Sa bouche distille une salive qui rafraîchirait le feu d’un brasier flambant.
« Comment l’oublier alors qu’il est mon cœur, mon âme, ma souffrance, mon mal, mon médecin et mon bien-aimé ? »
Mais lorsque s’avança la nuit avec ses ténèbres, Rose-dans-le-Calice sentit augmenter l’intensité de ses désirs…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Rose-dans-le-Calice sentit augmenter l’intensité de ses désirs, et s’attiser le souvenir cuisant de ses maux. Alors elle récita ces vers :
« Voici la nuit qui m’apporte, avec ses ténèbres, les ardeurs intenses et les malaises ; et mes désirs attisent en moi les brûlantes douleurs.
« Le tourment de la séparation habite maintenant mes entrailles ; mes pensées m’anéantissent, mes ardeurs m’agitent, mes transports me brûlent, et mes larmes trahissent un cher secret.
« Amoureux comme je suis, je ne sais point le moyen de faire cesser mon amaigrissement, ma faiblesse et ma douleur.
« L’enfer de mon cœur est attisé de plus en plus, et l’intensité de sa flamme abîme mon foie.
« Au jour de la séparation, je n’ai pu faire mes adieux au bien-aimé, ô regrets ! ô douleur !
« Mais toi, passant, qui informeras l’ami de tous mes tourments, dis-lui que j’ai enduré des souffrances que nulle plume ne saurait décrire.
« Par Allah ! Je serai toujours fidèle en amour au bien-aimé, j’en fais le serment ! Car dans le code de l’amour le serment est chose licite.
« Ô nuit ! va porter mon salut au bien-aimé, et dis-lui que tu es témoin de mes insomnies. »
Et voilà comment se lamentait Rose-dans-le-Calice.
Quant à Délice-du-Monde, voici ! L’ermite lui dit : « Descends dans la vallée et rapporte-m’en une grande quantité de fibres de palmier. » Il descendit, pour revenir ensuite avec les fibres demandées ; et l’ermite les prit et en confectionna une sorte de filet semblable aux filets où l’on transporte la paille ; puis il dit à Délice-du-Monde : « Sache qu’au fond de la vallée il croît une espèce de courge qui, une fois mûre, se dessèche et se détache de ses racines. Descends ramasser une quantité de ces courges desséchées, attache-les à ce filet, et jette le tout à la mer. Toi, ne manque point de monter dessus, et alors laisse le courant te porter vers la haute mer, et il te fera parvenir au but que tu souhaites. Et n’oublie point que sans risques on ne parvient jamais au but que l’on se propose ! » Il répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et, après que l’ermite lui eût souhaité bonne chance, il lui fit ses adieux et descendit dans la vallée où il ne manqua pas de faire ce qui lui avait été conseillé.
Lorsqu’il fut arrivé, porté sur le filet aux courges, au milieu de la mer, un vent s’éleva avec violence qui le poussa rapidement et le fit disparaître aux yeux de l’ermite. Il fut ainsi ballotté par les flots, tantôt soulevé sur le sommet des lames, tantôt engouffré dans leur creux béant, jouet des terreurs de la mer pendant trois jours et trois nuits, jusqu’à ce qu’il fût jeté par les destins au pied de la Montagne-de-la-Mère-qui-a-perdu-son-enfant. Il arriva au rivage, dans l’état d’un poulet pris de vertige, souffrant de la faim et de la soif ; mais il ne tarda pas à trouver près de là des ruisseaux d’eau courante, des oiseaux gazouillants, et des arbres chargés de grappes de fruits, et il put ainsi assouvir sa faim en mangeant de ces fruits et étancher sa soif en buvant de cette eau pure. Après quoi il se dirigea vers l’intérieur de l’île, et aperçut au loin quelque chose de blanc, dont il s’approcha ; et il reconnut que c’était un palais imposant, aux murs escarpés, et il se dirigea vers la porte qu’il trouva fermée. Alors il s’assit et ne bougea plus durant trois jours, au bout desquels il vit enfin la porte s’ouvrir et en sortir un eunuque qui lui demanda : « D’où viens-tu ? Et comment as-tu fait pour venir jusqu’ici ? » Il répondit : « Je viens d’Ispahân ! Je voyageais sur mer avec mes marchandises, quand le navire où j’étais se fracassa, et les vagues me jetèrent dans cette île ! » À ces paroles, l’esclave se mit à pleurer, puis se jeta au cou de Délice-du-Monde et lui dit : « Qu’Allah te conserve en vie, ô visage ami ! Ispahân est mon pays, et là vivait aussi la fille de mon oncle, celle que j’avais aimée dès ma première enfance et à laquelle j’étais extrêmement attaché. Mais un jour nous fûmes attaqués par une tribu plus nombreuse que la nôtre qui captura une grande partie de nos gens ; et moi je fus compris dans le butin. Comme à cette époque-là j’étais encore enfant, on me coupa les œufs, pour augmenter mon prix, et l’on me vendit comme eunuque. Et tu me vois justement en cet état-là ! » Puis l’eunuque, après avoir encore souhaité la bienvenue à Délice-du-Monde, le fit entrer dans la grande cour du palais.
Il vit alors un merveilleux bassin entouré d’arbres aux belles branches feuillues où des oiseaux, enfermés dans des cages d’argent aux portes d’or, gazouillaient agréablement en bénissant le Créateur. Il s’approcha de la première cage, l’examina avec attention et vit qu’elle contenait une tourterelle, laquelle aussitôt lança un cri qui signifiait : « Ô généreux ! » Et Délice-du-Monde, en entendant ce cri, tomba évanoui ; puis, une fois revenu à lui, il poussa de profonds soupirs et récita ces vers…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… il poussa de profonds soupirs et récita ces vers :
« Si comme moi, ô tourterelle, tu es éperdue d’amour, invoque le Seigneur et roucoule : « Ô généreux ! »
« Qui sait si ton chant est un cri d’allégresse ou la plainte d’amour d’un cœur torturé !
« Gémis-tu à cause du départ de ton ami, ou parce qu’il t’a délaissée faible et languissante, ou bien parce que tu as perdu l’objet de ton amour ?
« S’il en est ainsi, ne crains point d’exhaler tes plaintes et de crier l’amour ancien qui te remplit le cœur.
« Pour moi, qu’Allah conserve mon bien-aimé et je promets de ne jamais l’oublier, mes os seraient-ils déjà poussière ! »
Lorsqu’il eut récité ces vers, il se mit à pleurer tellement qu’il tomba évanoui. Et lorsqu’il eut repris connaissance, il marcha jusqu’à ce qu’il fût arrivé devant la seconde cage, où il vit un ramier qui à sa vue se mit à chanter disant : « Ô Éternel ! je te glorifie ! » Alors Délice-du-Monde soupira longuement et récita ces vers :
« Le ramier plaintif a dit : Ô Éternel, je te glorifie malgré mes calamités !
» Ô Éternel ! j’espère que dans ta bonté tu permettras ma réunion avec la bien-aimée, en ce pays d’exil.
» Que de fois elle m’est apparue avec ses lèvres de miel aromatique, et m’a laissé plus embrasé que jamais.
» Tandis que les feux consument mon cœur et le réduisent en cendres, je pleure des larmes de sang dont le débordement inonde mes joues ; et je m’écrie :
« La créature ne se fortifie que par les épreuves. Aussi je veux prendre mes maux en patience.
« Et si Allah veut permettre ma réunion, avec la maîtresse de mon cœur, je dépenserai mes richesses à héberger la tribu des amoureux, mes semblables.
« Je relâcherai les oiseaux de leur prison, et, dans mon bonheur, je me dévêtirai de mon deuil ! »
Lorsqu’il eut fini de réciter ces vers, il s’approcha de la troisième cage et vit qu’elle contenait un rossignol qui, sitôt qu’il l’eut aperçu, se mit à chanter. En l’entendant, Délice-du-Monde récita ces vers :
« Ô ! que le rossignol m’enchante quand il fait entendre sa voix gentille qui ressemble à une amoureuse voix languissante d’amour.
« Pitié pour les amoureux ! Que de nuits ne passent-ils point dans les transes, les désirs et l’inquiétude !
« Ils semblent, tant leurs angoisses sont cruelles, n’avoir jamais connu que les nuits sans sommeil et sans matin !
« Pour moi dès que j’eus connu mon amie, je fus enchaîné par son amour ; et, enchaîné de la sorte, des chaînons de larmes se déroulent de mes yeux.
« Et je m’écriai : « Voici de mes yeux les chaînons qui se déroulent et m’enchaînent tout entier. Et c’est mon ardeur qui déborde sous cette forme !
« En même temps je suis brisé par l’éloignement de l’amie. Les trésors de ma patience sont épuisés, et mes forces sont anéanties.
« Certes ! si le sort était équitable, il me réunirait avec mon amie !
« Et maintenant, qu’Allah me couvre de son voile pour que je puisse dénuder mon corps devant l’amie, et lui faire voir ainsi à quel degré d’épuisement m’ont réduit les alarmes, l’inquiétude, et l’abandon ! »
Lorsqu’il eut fini de réciter ces vers, il s’avança jusqu’à la quatrième cage et y vit un bulbul qui se mit aussitôt à moduler quelques notes plaintives. Et Délice-du-Monde, à ce chant, poussa de profonds soupirs et récita ces vers :
« Dans les aubes et les aurores, le bulbul ravit le cœur de l’amoureux par le jeu mélodieux des cordes de sa voix.
« Ô Délice-du-Monde, plaintif et languissant ! ton être est anéanti par l’amour !
« Que de chants merveilleux viennent jusqu’à moi, dont s’attendrirait la dureté du fer et de la pierre !
« Et voici que l’air léger du matin vient à nous en passant sur les édens des prairies et les fleurs exquises.
« Ô ! les chants des oiseaux dans les aubes et les matins ! Et toi, brise embaumée des premières lueurs du jour ! Ô ! transports de mon âme de tout cela !
« Je pense alors à l’amie si loin, et mes larmes se précipitent en pluies et en torrents, alors qu’un feu terrible dans mes entrailles crépite en étincelles et en flammes !
« Qu’Allah accorde enfin à l’amoureux passionné de revoir son amie et de jouir de ses charmes. Car l’amoureux n’est-il point manifestement excusable ?
« Moi je fais ce vœu, car je sais bien qu’il n’y a que l’homme clairvoyant pour voir clair et excuser ! »
Puis, ayant fini de réciter ces vers, Délice-du-Monde marcha quelque peu…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Délice-du-Monde marcha quelque peu et vit une cage merveilleuse, bien plus belle que toutes les autres réunies. Cette cage renfermait un pigeon sauvage, qui avait au cou un collier de perles admirables. Et Délice-du-Monde, à la vue de ce pigeon, connu par son chant plaintif et amoureux, et maintenant prisonnier dans cette cage où il avait l’air bien triste et rêveur, se mit à sangloter et récita ce vers :
« Ô pigeon des bois touffus, ô frère des amants, compagnon des âmes sensibles, je te salue !
« J’aime une tendre gazelle dont le regard a pénétré dans mon cœur plus profondément que le tranchant d’une lame coupante.
« Son amour a brûlé mon cœur et mes entrailles, et anéanti mon corps par les maladies.
« Depuis si longtemps je ne goûte plus les douceurs du manger et du dormir.
« La patience et la tranquillité ont fui mon âme, et la passion est venue s’y fixer pour toujours.
« Comment désormais pourrais-je trouver de la joie à vivre loin de l’ami absent ! N’est-il point mon but, mon désir et toute mon âme ? »
Lorsque le pigeon eut entendu ces vers de Délice-du-Monde, il sortit de sa rêverie, et se mit à gémir et à roucouler d’une façon si plaintive et si mélancolique qu’il semblait employer la voix humaine, et, dans son langage, réciter ces vers :
« Ô jeune amoureux, tu viens de me rappeler le temps de ma jeunesse anéantie dans le passé,
« Quand mon ami dont j’adorais les formes gracieuses, car il était merveilleusement beau, me séduisait.
« Sa voix, à travers les branches du monticule sablonneux, me détournait, en extase ravi, des accords aimés de la flûte !
« Un jour le chasseur tendit un filet et le prit. Et mon ami s’écria : « Ô ma liberté dans l’espace ! Ô bonheur envolé ! »
« J’espérais pourtant voir le chasseur compatir à mon amour, et me rendre mon ami ! mais il fut cruel !
« Et mes tortures maintenant sont devenues excessives, et mes désirs sont entretenus par le feu de cette absence si dure !
« Ah ! qu’Allah protège les amants éperdus, torturés par les mêmes angoisses que les miennes !
« Et puisse l’un d’eux, me voyant si triste dans ma cage, m’en ouvrir la porte et me rendre à mon ami ! »
Alors Délice-du-Monde se tourna vers son ami l’eunuque d’Ispahân, et lui dit : « Quel est ce palais ? Quels en sont les habitants ? Et qui l’a bâti ? » Il répondit : « C’est le vizir du roi Un Tel qui l’a bâti pour sa fille, pour la sauvegarder des événements du temps et des accidents de la destinée ! Et il l’y a confinée avec ses serviteurs et sa suite. Ainsi l’on n’ouvre les portes qu’une fois l’an, le jour où l’on nous envoie les provisions ! »
À ces paroles, Délice-du-Monde pensa en son âme : « J’ai atteint le but ! Mais il m’est bien pénible d’attendre si longtemps avant de la voir ! » Et voilà pour lui.
Mais pour ce qui est de Rose-dans-le-Calice, voici !
Depuis son arrivée à ce palais, elle ne pouvait plus goûter le plaisir du boire et du manger, ni celui du repos et du sommeil ; au contraire ! Elle sentit augmenter en elle les tourments de ses transports passionnés ; et elle passait son temps à parcourir tout le palais à la recherche de quelque issue, mais sans résultat. Et un jour, n’en pouvant plus, elle éclata en sanglots, et récita ces vers :
« Pour me torturer ils m’ont emprisonné loin de mon ami, et m’ont fait goûter tous les tourments dans ma prison.
« Ils ont brûlé mon cœur des feux de la passion, en éloignant mes yeux de mon ami.
« Ils m’ont enfermé dans des tours fortifiées, bâties sur des montagnes au milieu des abîmes marins.
« Ont-ils donc ainsi voulu me donner l’oubli ? Or mon amour y depuis lors, s’est accru tellement !
« Comment pourrai-je oublier ? Tout ce que je souffre n’est-il pas dû à un seul regard jeté sur le visage de l’aimé ?
« Mes journées s’écoulent dans les peines, et je passe mes nuits en proie à mes tristes pensées !
« Mais bien que privé de la présence aimée, il m’en reste le souvenir pour me consoler dans la solitude.
« Ô ! puissé-je un jour, après tout cela, voir la destinée me réunir avec le bien-aimé ! »
Lorsqu’elle eut fini de réciter ces vers, Rose-dans-le-Calice monta sur la terrasse du palais…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Rose-dans-le-Calice monta sur la terrasse du palais et, au moyen de solides étoffes de Baalbek auxquelles elle s’attacha soigneusement, elle se glissa du haut des murs jusqu’à terre. Et, vêtue comme elle était de ses plus belles robes et le cou orné d’un collier de pierreries, elle traversa les plaines désertes qui entouraient le palais et arriva de la sorte au bord de la mer.
Là elle aperçut un pêcheur, que le vent du large avait jeté le long de cette côte, en train de pêcher, assis dans sa barque. Le pêcheur aperçut également Rose-dans-le-Calice et, croyant à quelque apparition d’éfrit, eut bien peur et se mit à manœuvrer pour s’éloigner de là au plus vite. Alors Rose-dans-le-Calice l’appela à plusieurs reprises et, tout en lui faisant de nombreux signes, elle lui récita ces vers :
« Ô pêcheur ! calme ton trouble, car je suis un être humain semblable à tous les autres !
« Je te demande de répondre à mes prières et d’écouter ma très véridique histoire.
« Aie pitié de moi et Allah te préservera des ardeurs dont je brûle, s’il t’arrive un jour de jeter les yeux sur un ami farouche et sans pitié,
« Car j’aime un jouvenceau dont le visage resplendissant fait pâlir l’éclat du soleil et de la lune,
« Dont les regards ont fait s’écrier la gazelle elle-même, en s’excusant : « Je suis son esclave ! »
« La beauté a écrit sur son front cette ligne charmante au sens concis :
« Quiconque le regarde comme le flambeau de l’amour entre dans la voie droite ; mais quiconque s’en écarte commet une faute grave et une impiété.
« Ô pêcheur ! si tu consens à me consoler en me le faisant retrouver, quel ne sera pas mon bonheur ! et comme je t’en saurai gré !
« Je te donnerai des pierreries et des joyaux, et des perles fraîchement cueillies et toutes les choses précieuses.
« Puisse mon ami satisfaire un jour mes désirs ! car mon cœur fond dans l’attente et s’émiette ! »
Lorsque le pêcheur eut entendu ces paroles, il pleura, gémit et se lamenta en se souvenant lui aussi des jours de sa jeunesse, quand il était vaincu par l’amour, tourmenté par la passion, torturé par les transes et les désirs, brûlé par les feux des transports amoureux. Et il se mit à réciter ces vers :
« Quelle excuse péremptoire de l’intensité de mon ardeur ! Membres décharnés, larmes répandues, yeux cassés par les veilles, cœur battu comme un briquet étincelant !
« La calamité de l’amour m’a atteint dès la jeunesse, et j’en ai goûté toutes les décevantes douceurs.
« Maintenant je veux bien me vendre pour faire retrouver ton ami absent, au risque d’y perdre l’âme !
« J’espère pourtant que cette vente sera pour moi lucrative, car la coutume des amoureux est de ne jamais marchander le prix de leur ami ! »
Une fois que le pêcheur eut fini de réciter ces vers, il s’approcha avec sa barque du rivage et dit à l’adolescente : « Descends dans la barque, car me voici prêt à te conduire n’importe où tu désireras ! » Alors Rose-dans-le-Calice descendit dans la barque, et le pêcheur s’éloigna de terre à coups de rames.
Lorsqu’ils furent à quelque distance, un vent s’éleva qui poussa la barque par l’arrière et si rapidement qu’ils perdirent bientôt la terre de vue, et que le pêcheur ne sut plus où il était. Pourtant au bout de trois jours la tempête se calma, le vent tomba et avec la permission d’Allah (qu’Il soit exalté !) la barque arriva à une ville située sur le bord de la mer.
Or justement, au moment où la barque du pêcheur abordait, le roi de la ville, dont le nom était le roi Derbas, était assis avec son fils dans son palais à une fenêtre qui donnait sur la mer ; et il vit la barque du pêcheur qui atterrissait, et il aperçut cette adolescente, belle comme la pleine lune au sein du ciel pur, qui portait à ses oreilles des pendants de rubis magnifiques et au cou un collier de merveilleuses pierreries. Alors il comprit qu’elle devait être une fille de roi ou de souverain, et, suivi de son fils, il descendit de son palais et se dirigea vers le rivage en sortant par la porte qui donnait sur la mer.
À ce moment la barque était déjà amarrée, et la jeune fille y dormait tranquillement.
Alors le roi s’approcha d’elle et la surveilla. Et elle, sitôt qu’elle eut ouvert les yeux, se mit à pleurer. Et le roi lui demanda : « D’où viens-tu ? De qui es-tu la fille ? Et quelle est la cause de ta venue en cet endroit ? » Elle répondit : « Je suis la fille d’Ibrahim, vizir du roi Schamikh. Et la cause de ma venue ici est une affaire extraordinaire et une aventure bien étrange ! » Puis elle raconta au roi toute son histoire depuis le commencement jusqu’à la fin, sans lui rien cacher. Après quoi elle poussa de profonds soupirs, versa des pleurs et récita ces vers :
« Voici que les larmes ont ulcéré ma paupière ! Ah ! il a fallu de bien singulières tribulations pour un tel débordement !
« Et la cause de tout cela est un être cher à mon cœur, avec lequel je n’ai jamais pu assouvir la soif de mes désirs.
« Son visage est si beau, si radieux, si éclatant, qu’il surpasse la beauté des Turcs et des Arabes !
« Le soleil et la lune, en le voyant paraître, se sont inclinés d’amour, épris de ses charmes, et ont rivalisé avec lui de galanterie.
« Son regard chargé de sorcellerie est si enchanteur qu’il fascine tous les cœurs par son arc tendu prêt à décocher les flèches.
« Ô toi à qui je viens conter par le menu mes peines amères, aie pitié d’un amoureux devenu le jouet des vicissitudes de l’amour.
« Hélas ! l’amour m’a jeté dans un triste état au milieu de ton pays, et je n’ai plus d’espoir que dans ta générosité !
« L’homme au cœur généreux qui protège celui qui implore son hospitalité, acquiert d’ordinaire un grand mérite.
« Ô toi, mon espoir, étends le voile protecteur sur la tribu des amoureux, et sois, ô mon seigneur, la cause de leur réunion ! »
Puis, une fois qu’elle eut récité ces vers, elle raconta au roi quelques autres détails encore…
— À ce moment de sa narration. Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… une fois qu’elle eut récité ces vers, elle raconta au roi quelques autres détails encore, puis elle fondit en larmes et improvisa les vers suivants :
« J’ai pu jouir de la vie jusqu’au jour où j’ai connu ce prodige d’amour ! Puissent tous les mois de l’année être pour l’ami des mois de tranquillité comme l’est le mois sacré de Ragab !
« Quelle chose étonnante que le jour de mon exil les larmes que j’ai versées aient pu se transformer dans mes entrailles en un feu liquide.
« Ce jour-là de mes paupières il est tombé une pluie de sang en plaques rondes ; et la surface de mes joues en a été colorée en rouge.
« Et les étoffes avec lesquelles on essuya toutes ces larmes furent teintes en rouge tellement, que l’on aurait dit la tunique de Joseph colorée d’un sang menteur ! »
Lorsque le roi eut entendu les paroles de Rose-dans-le-Calice, il ne douta pas un instant de la profondeur de son mal d’amour ; et il la prit en compassion et lui dit : « N’aie aucune crainte ni terreur : tu as atteint ton but ! Car me voici prêt à te faire parvenir à tes fins, et à t’envoyer celui que tu demandes ! Crois-moi donc et écoute de moi ces quelques mots ! » Et aussitôt le roi lui récita ces vers :
« Ô fille d’une race noble et généreuse, tu es arrivée au but poursuivi ! Je te l’annonce avec joie ! Ici tu n’as plus rien à redouter.
« Aujourd’hui même j’amasserai de grandes richesses et les enverrai au roi Schamikh sous la garde des cavaliers et des guerriers.
« Je lui enverrai des coffrets de musc et des ballots de brocarts, en y joignant l’or et le vierge argent.
« Certes ! et mes lettres lui apprendront, par l’artifice de l’écriture, que je désire devenir son allié et son parent !
« Aujourd’hui même je ferai tous mes efforts pour t’aider et te réunir au plus tôt à celui que tu aimes !
« J’ai toujours goûté moi-même à l’amertume de l’amour ! Et, depuis, j’ai appris à plaindre et à excuser ceux qui ont bu à ce calice amer ! »
Lorsqu’il eut fini de réciter ces vers, le roi sortit vers ses soldats et, ayant appelé son vizir, lui fit préparer des ballots en nombre incalculable, contenant les présents en question, lui donna l’ordre de se mettre en route lui-même pour aller les porter au roi Schamikh, père de Rose-dans-le-Calice, et lui dit : « Il te faut, en outre, sans faute, me ramener avec toi de là-bas une personne qu’on nomme Délice-du-Monde. Et tu diras au roi : « Mon maître désire devenir ton allié, et le pacte d’alliance entre toi et lui sera le mariage à conclure entre ta fille et Délice-du-Monde, l’un des personnages de ta suite. Il faut donc me confier ce jeune homme et je le conduirai auprès du roi Derbas afin que devant lui soit dressé le contrat de mariage ! »
Après quoi le roi Derbas écrivit une lettre à ce sujet au roi Schamikh, la remit à son vizir en lui réitérant les ordres qui concernaient Délice-du-Monde, et lui dit : « Sache bien que si tu ne me le ramènes pas, tu seras destitué de ta charge ! » Le vizir répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et se mit aussitôt en route avec les présents vers les contrées du roi Schamikh.
Lorsqu’il arriva auprès du roi Schamikh, il lui transmit le salam de la part du roi Derbas, et lui remit la lettre et les présents qu’il lui avait apportés.
À la vue de ces présents et à la lecture de la lettre, où il était question de Délice-du-Monde, le roi Schamikh versa des larmes en grande quantité et dit au vizir du roi Derbas : « Hélas ! Où est à présent Délice-du-Monde ? Il a disparu ! Et nous ignorons en quel endroit il se trouve ! Si tu peux me le rendre, ô vizir-ambassadeur, je te donnerai le double de ce que tu m’as apporté en présents ! » Et le roi, en disant ces paroles, se mit à fondre en larmes, à pousser des gémissements, à se lamenter et à éclater en sanglots. Puis il récita ces vers :
« Rendez-moi mon bien-aimé ! Qu’ai-je à faire des trésors, des présents de perles et de diamants.
« Il était pour moi la pleine lune au sein d’un ciel pur et beau. Il était l’ami d’élection aux façons exquises et charmantes.
« La fine gazelle ne saurait lui être comparée ! Sa taille est la branche de l’arbre bân dont les fruits seraient ses délicieuses manières.
« Mais la souple branche elle-même ne peut, malgré sa jeune beauté, séduire comme lui la raison des hommes !
« Je l’ai élevé, dès ses tendres années, au milieu des caresses ! Et me voici maintenant triste et désolé de son éloignement, et l’esprit en proie au trouble sans répit. »
Après quoi il se tourna vers le vizir envoyé, qui lui avait apporté les cadeaux et la lettre, et lui dit : « Retourne vers ton maître et dis-lui : « Délice-du-Monde s’en est allé il y a plus d’une année déjà, et le roi, son maître, ignore ce qu’il est devenu ! » Le vizir répondit : « Ô mon seigneur, mon maître m’a dit : « Si tu ne me ramènes pas Délice-du-Monde, tu seras destitué du vizirat, et tu ne remettras jamais plus le pied dans la ville ! » Comment donc oserais-je m’en retourner sans le jeune homme ? »
Alors le roi Schamikh se tourna vers son propre vizir Ibrahim, père de Rose-dans-le-Calice, et lui dit : « Tu vas accompagner le vizir envoyé, et tu prendras avec toi une forte escorte ; et de la sorte tu l’aideras à faire les recherches nécessaires dans toutes les contrées pour retrouver Délice-du-Monde ! » Il répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et aussitôt il se fit escorter, d’une troupe de gardes et, accompagné du vizir envoyé, il partit à la recherche de Délice-du-Monde.
Ils voyagèrent longtemps de la sorte, et chaque fois qu’ils passaient à côté de Bédouins ou de caravanes, ils leur demandaient des nouvelles de Délice-du-Monde en leur disant : « Avez-vous vu passer un Tel, dont le nom est Tel et le signalement tel et tel ! » Et les gens répondaient…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT ONZIÈME NUIT
Elle dit :
… Et les gens répondaient : « Nous ne le connaissons pas ! » Et ils continuèrent à s’informer de la sorte dans les villes et les villages, et à faire des recherches dans les plaines et les terrains accidentés, les terres et les déserts, jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au bord de la mer. Ils s’embarquèrent alors à bord d’un navire, et partirent par mer pour atterrir un jour à la Montagne-de-la-Mère-qui-a-perdu-son-enfant.
Le vizir du roi Derbas dit alors au vizir du roi Schamikh : « Pour quel motif a-t-on donné ce nom à cette montagne ? » Il répondit : « Je vais tout de suite te satisfaire !
« Sache donc que dans les anciens temps une gennia, de la race des genn chinois, est descendue sur cette montagne. Or il advint qu’un jour, dans ses excursions terrestres, elle fit la rencontre d’un homme et elle l’aima d’un amour éperdu. Mais, craignant pour elle-même la colère des genn de sa race, si l’aventure venait à être connue, elle se mit, quand elle ne put plus réprimer l’ardeur de ses désirs, à la recherche de quelque endroit solitaire où cacher son amant aux yeux des genn, ses parents, et finit par trouver cette montagne inconnue aux hommes et aux genn, puisqu’elle n’était sur aucune route parcourue par ceux-ci ou ceux-là. Elle enleva alors son amant et le transporta à travers les airs pour le déposer dans cette île, où elle demeura avec lui. Et elle ne s’absentait de là que pour aller de temps en temps faire acte de présence au milieu de ses parents, et se hâtait de revenir aussitôt auprès de son bien-aimé, en cachette. Cela fit qu’au bout d’un certain temps de cette vie-là elle devint enceinte de lui à plusieurs reprises, et mit au monde dans cette montagne des enfants nombreux. Or, chaque fois que les marchands qui voyageaient de ce côté-là sur leur navire, passaient près de cette montagne, ils entendaient les cris des enfants qui ressemblaient beaucoup aux cris plaintifs d’une mère se lamentant, et ils se disaient : « Il doit y avoir sur cette montagne une pauvre mère qui a perdu ses enfants ! » Et tel est le motif de cette appellation. »
En entendant ces paroles, le vizir du roi Derbas fut extrêmement étonné.
Mais déjà ils étaient descendus à terre, et étaient arrivés au palais dont ils heurtèrent la porte. Aussitôt la porte s’ouvrit et un eunuque en sortit qui reconnut immédiatement son maître, le vizir Ibrahim, père de Rose-dans-le-Calice. Aussitôt il lui baisa la main et l’introduisit, avec son compagnon et sa suite, dans le palais.
Le vizir Ibrahim, arrivé dans la cour du palais, aperçut au milieu des serviteurs un homme d’aspect misérable qu’il ne reconnut pas et qui n’était autre que Délice-du-Monde. Aussi il demanda à ses gens : « D’où vient celui-là ? » Ils répondirent : « C’est un pauvre marchand qui, ayant fait naufrage, a perdu toutes ses marchandises et a réussi à se sauver tout seul. C’est d’ailleurs un homme inoffensif, un saint sans cesse ravi dans l’extase de la prière ! » Le vizir n’insista pas et pénétra à l’intérieur du palais.
Il se dirigea vers l’appartement de sa fille et, en y arrivant, ne l’y trouva pas. Il s’en informa auprès des jeunes filles, ses esclaves, qui se trouvaient par là ; et elles lui répondirent : « Nous ne savons pas comment elle est partie d’ici ! Tout ce que nous pouvons te dire, c’est qu’elle n’est restée au milieu de nous que fort peu de temps ; puis elle disparut ! » À ces paroles, le vizir versa des larmes à profusion, et improvisa ces vers :
« Ô maison, toi qu’ont chantée tes oiseaux, toi dont les seuils ont été si fiers et si beaux,
« Jusqu’au moment où l’amoureux est venu vers toi sanglotant son désir, et a trouvé large ouvertes tes portes hospitalières.
» Ô ! qui me dira où s’est perdu mon amour, le maître de cette demeure maintenant solitaire !
« Ici jadis les chambellans vivaient dans le luxe, la félicité et les honneurs ! Et partout étaient tendues les draperies en brocart !
« Hélas ! qui me dira maintenant le sort des maîtres qui l’habitaient ? »
Puis, ayant fini de dire ces vers, le vizir Ibrahim recommença à pleurer, à gémir et à se lamenter, et dit : « On ne peut échapper aux décrets d’Allah, ni ruser avec ce qu’il a tracé d’avance ! » Puis il monta sur la terrasse du palais et y trouva les étoffes de Baâlbek qui étaient attachées par un bout aux créneaux et pendaient jusqu’au bas des murs. Alors il comprit que sa fille avait pris la fuite de cette façon-là et, égarée par la passion et affolée par la douleur, s’en était ainsi allée. En même temps il aperçut deux gros oiseaux, dont l’un était un corbeau et l’autre un hibou ; et, ne doutant plus que ce ne fût là un triste présage, il éclata en sanglots et récita ces vers :
« Je suis venu à la demeure de l’ami dans l’espoir d’éteindre par sa vue la flamme de mon amour et mes tourments.
« Mais l’ami n’était point dans la maison, et je n’ai vu que la sinistre apparition du corbeau et du hibou.
« Et ce spectacle me disait : Tu as opprimé deux êtres qui s’aimaient avec tendresse, en les séparant par la violence.
« À ton tour maintenant d’approcher de tes lèvres la coupe du chagrin que tu leur as fait goûter ! Et passe ta vie dans la douleur, entre les larmes et les brûlures. »
Après quoi il descendit de la terrasse…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… Après quoi il descendit de la terrasse en pleurant, et donna l’ordre aux esclaves d’aller à la montagne faire toutes les recherches nécessaires pour retrouver leur maîtresse. Et les esclaves exécutèrent l’ordre. Mais ils ne retrouvèrent pas leur maîtresse. Et voilà pour eux !
Mais pour ce qui est de Délice-du-Monde, voici !
Lorsque le jeune homme eut acquis la certitude de la fuite de Rose-dans-le-Calice, il poussa un grand cri et tomba évanoui sur le sol. Comme il restait étendu de la sorte sans reprendre connaissance, les gens du palais pensèrent qu’il venait d’être ravi dans l’extase divine et qu’il avait l’âme noyée dans la beauté de la contemplation auguste du Très-Haut. Et voilà pour lui !
Quant au vizir du roi Derbas, lorsqu’il vit que le vizir Ibrahim avait perdu tout espoir de retrouver sa fille et Délice-du-Monde, et que son cœur était fort péniblement affecté de tout cela, il résolut de retourner à la ville du roi Derbas sans avoir réussi dans la mission dont il était chargé. Il fit donc ses adieux au vizir Ibrahim, père de Rose-dans-le-Calice, et lui dit, en lui montrant le pauvre jeune homme : « Je voudrais bien emmener avec moi ce saint homme, peut-être que, grâce à ses mérites, la bénédiction sera sur nous et qu’Allah (qu’il soit exalté !) touchera le cœur du roi, mon maître, et l’empêchera de me destituer de mes fonctions ! Et moi, après cela, je ne manquerai pas de renvoyer ce saint homme à Ispahân, sa ville, qui n’est pas éloignée de notre pays. » Le vizir Ibrahim lui répondit : « Fais ce que tu veux ! »
Puis les deux vizirs se séparèrent, et chacun d’eux prit la route de son pays respectif, le vizir du roi Derbas ayant au préalable pris soin d’emmener avec lui Délice-du-Monde, dont il était loin de soupçonner l’identité, et qu’il prit soin de placer sur un mulet, étant donné l’état d’évanouissement tenace où il se trouvait.
Cet état d’évanouissement dura encore trois jours, pendant le voyage, et Délice-du-Monde ignorait absolument ce qui se passait autour de lui. Il finit enfin par revenir de son évanouissement et dit : « Où suis-je ? » On lui répondit : « Tu es en compagnie du vizir du roi Derbas ! » Puis on alla aussitôt prévenir le vizir que le saint homme était revenu de son évanouissement. Alors le vizir lui envoya de l’eau de roses sucrée qu’on lui fit boire et qui acheva de le ranimer. Après quoi on continua le voyage et l’on arriva à la ville du roi Derbas.
Aussitôt le roi Derbas envoya dire à son vizir : « Si Délice-du-Monde n’est pas avec toi, prends bien garde de paraître en ma présence ! » En recevant cet ordre, le malheureux vizir ne sut plus quel parti prendre ! En effet, il ignorait complètement la présence de Rose-dans-le-Calice auprès du roi, ni pourquoi le roi désirait retrouver Délice-du-Monde et s’allier avec lui ; et il ignorait également que Délice-du-Monde était là, avec lui, qu’il était ce jeune homme si longtemps en proie aux crises d’évanouissement. De son côté, Délice-du-Monde ne savait point où on le menait, ni que le vizir avait été précisément envoyé à sa recherche.
Or, lorsque le vizir vit que Délice-du-Monde avait repris connaissance, il lui dit : « Ô saint homme d’Allah, je désire avoir recours à tes conseils dans la perplexité cruelle où je me trouve. Sache que le roi, mon maître, m’avait envoyé pour une mission que je n’ai point réussi à accomplir. Et maintenant qu’il a été informé de mon retour, il m’a envoyé une lettre où il me dit : « Si tu n’as pas réussi dans ta mission, tu ne dois pas rentrer dans ma ville ! » Il lui demanda : « Et quelle était cette mission ? » Le vizir lui raconta alors toute l’histoire, et Délice-du-Monde dit : « Ne crains rien ! Rends-toi chez le roi, et prends-moi avec toi. Et je prends sur moi la responsabilité du retour de Délice-du-Monde ! » Le vizir se réjouit fort de la chose, et dit : « Parles-tu vrai ? » Il répondit : « Certainement ! » Alors le vizir monta à cheval, l’emmena, et se rendit avec lui chez le roi.
Lorsqu’ils se présentèrent devant le roi, celui-ci demanda au vizir : « Où est Délice-du-Monde ? » Alors le saint homme s’avança et répondit : « Ô grand roi, moi je sais où se trouve Délice-du-Monde ! » Le roi lui fit signe de s’approcher davantage, et lui demanda, extrêmement ému : « En quel lieu se trouve-t-il ? » Il répondit : « Dans un lieu fort proche d’ici ! Mais dis-moi d’abord ce que tu lui veux, et moi je me hâterai de le faire venir entre tes mains. » Le roi dit : « Certes ! je te le dirai avec plaisir et par devoir ; mais ce cas exige que nous soyons seuls ! » Et aussitôt il ordonna à ses gens de s’éloigner, emmena le jeune homme dans une salle retirée, et lui raconta l’histoire depuis le commencement jusqu’à la fin.
Alors Délice-du-Monde dit au roi : « Fais-moi apporter des habits somptueux et donne-les-moi pour m’en revêtir. Et moi je te ferai venir Délice-du-Monde à l’instant même ! » Le roi aussitôt lui fit apporter une robe somptueuse, et Délice-du-Monde s’en revêtit et s’écria : « C’est moi qui suis Délice-du-Monde, la désolation des envieux ! » Et, à ces mots, perçant les cœurs de ses beaux regards, il improvisa ces vers…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
… à ces mots, perçant les cœurs de ses beaux regards, il improvisa ces vers :
« Le souvenir de ma bien-aimée me tient délicieuse compagnie dans ma solitude, et chasse loin de moi les pénibles regrets de l’éloignement !
« Ici je n’ai point d’autre source que celle de mes larmes ; mais quand cette source coule de mes yeux elle allège mes angoisses !
« Mes désirs sont violents et rien ne peut leur être comparé. Ah ! quelle chose prodigieuse que mon cas en amour et en amitié !
« Je passe mes nuits les paupières ouvertes dans l’insomnie ; et ma vie amoureuse s’écoule dans l’enfer et le paradis.
« Autrefois j’étais doué de la noble résignation ; mais j’ai perdu cette vertu maintenant ; et le seul don que m’ait légué l’amour c’est l’affliction.
« Mon corps s’est aminci et mon visage s’est changé dans la douleur de l’éloignement et l’ardeur de la passion.
« Les paupières de mes yeux se sont ulcérées par l’écoulement des larmes, et je ne puis pourtant faire rentrer ces larmes dans mes yeux.
« Ah ! je n’en puis plus ! J’ai perdu mon cœur ! Ah ! les chagrins en moi s’accumulent sur les chagrins !
« Mon cœur et ma tête se ressemblent, maintenant qu’ils ont vieilli ensemble et blanchi, par suite de l’absence de la bien-aimée, la plus belle des bien-aimées.
« C’est contre son gré que s’est faite notre séparation ; et son seul souci maintenant est de me revoir et de me posséder.
« Mais qui sait maintenant si, après cette longue absence, la destinée me réunira encore avec mon amie, si le sort fermera le livre de l’éloignement resté tout ce temps ouvert et s’il permettra qu’aux angoisses de l’absence succèdent les délices de la réunion !
« Et qui sait s’il me sera donné de revoir encore, dans les demeures, mon amie partager mes plaisirs ; et si mes deuils se changeront enfin en pures délices ! »
Lorsque Délice-du-Monde eut fini de réciter ces vers, le roi Derbas lui dit : « Par Allah ! je vois bien maintenant que vous vous aimez tous deux avec la même sincérité et la même intensité. En vérité vous êtes dans le ciel de la beauté deux astres lumineux ! Votre histoire est prodigieuse et vos aventures surprenantes ! » Puis le roi lui raconta dans tous ses détails l’histoire de Rose-dans-le-Calice. Et Délice-du-Monde lui demanda : « Peux-tu maintenant me dire, ô roi du temps, où elle se trouve ? » Il répondit : « Elle se trouve dans mon palais ! » Et aussitôt il fit venir le kâdi et les témoins et leur fit dresser le contrat de mariage de Rose-dans-le-Calice avec Délice-du-Monde. Après quoi il le combla d’honneurs et de bienfaits, et envoya aussitôt un courrier informer le roi Schamikh de tout ce qui était arrivé à Délice-du-Monde et à Rose-dans-le-Calice.
Lorsque le roi Schamikh eut appris cette nouvelle, il se réjouit à la limite de la joie et envoya au roi Derbas une lettre dans laquelle il lui disait : « Du moment que le contrat de mariage a déjà été dressé, je désire que la célébration des noces et la consommation du mariage aient lieu dans mon palais ! » Et aussitôt il fit préparer les chameaux, les chevaux et les hommes, et les envoya chercher les nouveaux mariés.
À l’arrivée de cette lettre et de cette escorte, le roi Derbas fit don aux nouveaux mariés de sommes considérables, leur donna une magnifique escorte et leur fit ses adieux. Et ils partirent.
Or, ce fut un jour mémorable que celui de leur arrivée dans leur pays, au milieu de la ville d’Ispahân où régnait le roi Schamikh. Jamais on n’avait vu un jour plus beau ou même comparable à celui-là !
Le roi Schamikh, en effet, pour célébrer cette fête, réunit tous les joueurs d’instruments d’harmonie et donna de grands festins. Et les réjouissances durèrent trois jours entiers, durant lesquels le roi distribua de grandes largesses au peuple et fit don de nombreuses robes d’honneur.
Quant aux nouveaux mariés, voici ! Délice-du-Monde, une fois le festin terminé de la nuit première, pénétra dans la chambre nuptiale de Rose-dans-le-Calice ; et tous deux se jetèrent dans les bras l’un de l’autre, puisque c’était à ce moment qu’ils avaient pu enfin se voir depuis leur rencontre ; et ils furent dans une telle joie et une telle félicité qu’ils pleurèrent beaucoup. Et Rose-dans-le-Calice improvisa ces vers :
« La joie est enfin venue chasser la tristesse et le chagrin ; et nous voici réunis à la grande confusion de nos envieux.
« La brise de la réunion a soufflé sur nous son haleine parfumée qui nous a ranimé le cœur, les entrailles et le corps.
« L’enivrement du retour a brillé sur nos visages ; et tout autour de nous les cris de joie et les tambours ont annoncé notre retour !
« Ne croyez pas que nos larmes soient causées par le chagrin ; croyez au contraire que c’est le bonheur qui nous fait pleurer !
« Que de calamités nous avons éprouvées, évanouies maintenant ! Avec quelle résignation n’avons-nous pas supporté des douleurs angoissantes ?
« J’ai oublié en une heure de réunion des tortures et des traverses si terribles que ma tête en a blanchi ! »
Cette improvisation terminée, ils s’étreignirent et restèrent dans les bras l’un de l’autre étroitement enlacés, jusqu’à ce qu’ils fussent tombés pâmés de jouissance et de bonheur…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
… jusqu’à ce qu’ils fussent tombés pâmés de jouissance et de bonheur.
Une fois revenus de leur pâmoison, Délice-du-Monde improvisa les vers suivants :
« Ô douceur des nuits longtemps attendues, quand le bien-aimé se montre équitable dans sa promesse et se donne à son amie !
« Nous voici à jamais réunis, après l’absence ; et les chaînes sont brisées qui nous tenaient captifs dans la séparation.
« Le destin, après s’être montré si farouche à notre égard, nous sourit et nous accorde ses faveurs avec empressement.
« Le bonheur a déployé son étendard en notre honneur, et nous a présenté, pour nous y désaltérer, la coupe pure du plaisir.
« Réunis enfin, après la tourmente, nous nous racontons nos chagrins passés et nos nuits d’insomnie écoulées dans les tristesses !
« Ô mon seigneur, oublions maintenant nos souffrances ! Et que le Dispensateur des miséricordes enrichisse notre âme de l’oubli !
« Ah ! que la vie est douce ! que la vie est délicieuse ! L’union ne fait qu’attiser ma flamme et mon ardeur ! »
Ces vers récités, les deux amants s’étreignirent pour la seconde fois et, s’étant jetés sur leur couche nuptiale, ils s’enlacèrent étroitement dans les plus exquises voluptés ; et ils continuèrent à se caresser, à se livrer à mille ébats et aux jeux aimables jusqu’à ce qu’ils se fussent tout à fait noyés dans la mer des amours tumultueuses. Et leurs délices, leurs voluptés, leur bonheur, leurs plaisirs et leurs joies furent si intenses qu’ils laissèrent s’écouler sept jours et sept nuits sans qu’ils se fussent aperçus de la fuite du temps et de son changement, tout comme si les sept journées n’étaient qu’une seule seulement. Ce ne fut qu’en voyant arriver les joueurs d’instruments qu’ils comprirent qu’ils étaient à la fin du septième jour de leur mariage. Aussi Rose-dans-le-Calice, à la limite de l’émerveillement, improvisa-t-elle à l’instant les vers que voici :
« Bien que j’aie été l’objet de tant d’envie et si gardée, j’ai pu posséder mon bien-aimé.
« Sur la soie vierge et les velours il s’est donné à moi par mille caresses,
« Sur un matelas en peau tendre, garni de duvet d’oiseaux d’une espèce extraordinaire !
« Qu’ai-je besoin de boire du vin, quand un amant plein d’ardeurs nouvelles me fait goûter sa salive de volupté !
« Pour nous, le passé et le présent se confondent dans une union qui nous donne l’oubli.
« N’est-ce point une chose prodigieuse que sept nuits entières aient passé sur nos têtes sans que nous nous en soyons doutés.
« On est, en effet, venu me féliciter à l’occasion du septième jour et me dire : Qu’Allah éternise ton union avec ton ami ! »
Lorsqu’elle eut récité ces vers, Délice-du-Monde l’embrassa un nombre incalculable de fois, puis il improvisa ces vers :
« Voici le jour du bonheur et de la félicité ! Et mon amie est venue me délivrer de l’isolement !
« Que son approche est enivrante et délicieuse ! Quel enchantement que son langage spirituel !
« Elle m’a fait boire le sorbet voluptueux de son intimité, et cette boisson a transporté mes sens hors de ce monde !
« Nous nous sommes épanouis ! Nous nous sommes dilatés ! Nous nous sommes enivrés, étendus sur notre couche ! Et, tout en buvant, nous avons chanté !
« L’ivresse du bonheur nous a fait perdre la notion du temps, et nous n’avons plus su distinguer le premier jour du dernier.
« Que l’amour nous soit toujours délicieux ! Mon amie a éprouvée les mêmes jouissances que moi !
« Pas plus que moi elle ne se souvient des jours amers. Mon Seigneur l’a favorisée comme Il m’a favorisé ! »
Ces vers récités, ils se levèrent tous deux, sortirent de la chambre nuptiale, et distribuèrent à tous les gens du palais de grandes sommes d’argent, des robes magnifiques, des cadeaux et des présents. Après quoi, Rose-dans-le-Calice donna l’ordre à ses esclaves de faire évacuer pour elle seule le hammam du palais, et dit à Délice-du-Monde : « Ô fraîcheur de mon œil, je veux maintenant te voir enfin au hammam, pour être tous deux seuls à notre aise ! » Et, arrivée à ce moment à la limite du bonheur, elle improvisa ces vers :
« Ami, qui depuis si longtemps domines mon cœur — je ne veux plus parler des choses anciennes —,
« Ô toi dont je ne pourrai plus me passer et que je ne pourrai plus remplacer dans mon intimité,
« Viens au hammam, ô lumière de mon œil ! Ce me sera un enfer de flammes au milieu de paradis de délices !
« Nous y brûlerons le parfum du nadd, jusqu’à ce que les vapeurs embaumées remplissent toute la salle et se répandent dans tous les sens.
« Nous pardonnerons à la destinée ses crimes à notre égard, et nous glorifierons la bonté de notre Seigneur !
« Et moi, en te voyant dans le bain, je chanterai : « Que le bain, ô bien-aimé, te soit léger et délicieux ! »
Une fois ces vers récités, les deux amants se levèrent et se rendirent au hammam où ils purent jouir de fort agréables moments. Après quoi ils revinrent au palais, où ils passèrent leur vie dans les félicités les plus intenses jusqu’au moment où vint les visiter la Destructrice des plaisirs et la Séparatrice des amis !
HISTOIRE MAGIQUE DU CHEVAL D’ÉBÈNE
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait dans
l’antiquité du temps et le passé des époques et des
âges, un roi très grand et très puissant d’entre les
rois des Persans, nommé Sabour, qui était certainement
le roi le plus riche en trésors de toutes sortes
comme aussi le plus doué de sagacité et de sagesse.
De plus il était plein de générosité et de bienveillance,
et sa main était toujours large ouverte sans
lassitude, pour aider ceux qui l’imploraient et ne
jamais repousser ceux qui lui demandaient secours.
Il savait donner largement l’hospitalité à ceux qui
ne lui demandaient que l’abri, et réconforter à l’occasion,
par ses paroles et ses manières pleines de
douceur et d’aménité, les cœurs brisés. Il était bon
et charitable pour les pauvres gens ; et les étrangers
ne voyaient jamais fermées à leur appel les portes
de ses palais. Quant aux oppresseurs, ils ne trouvaient
ni grâce ni indulgence devant sa sévère justice.
Et tel il était, en vérité.
Or, le roi Sabour avait trois filles, qui étaient comme autant de belles lunes dans un ciel plein de gloire ou comme trois fleurs merveilleuses d’éclat dans un parterre bien soigné, et un fils qui était la lune elle-même, et s’appelait Kamaralakmar[1].
Chaque année, le roi donnait à son peuple deux grandes fêtes, une au commencement du printemps, celle du Nourouz, et une autre à l’automne, celle du Mihrgân ; et, à ces deux occasions, il faisait ouvrir les portes de tous ses palais, distribuait des largesses, faisait proclamer des édits de grâce par ses crieurs publics, nommait de nouveaux dignitaires, et faisait avancer en grade ses lieutenants et ses chambellans. Aussi de tous les points de son vaste empire accouraient les populations pour rendre hommage à leur roi et le réjouir en ces deux jours de fête en lui portant des présents de toutes sortes et des esclaves et des eunuques en cadeau.
Or, à l’une de ces fêtes, qui était précisément la fête du printemps, le roi, qui à toutes ses qualités joignait l’amour de la science, de la géométrie et de l’astronomie, était assis sur le trône de son royaume quand il vit s’avancer devant lui trois savants, hommes forts versés dans les diverses branches des connaissances les plus secrètes et des arts les plus subtils, sachant modeler les formes avec une perfection qui confondait l’entendement, et n’ignorant aucun des mystères qui échappent d’ordinaire à l’esprit humain. Et ces trois savants arrivaient dans la ville du roi, venant de trois contrées différentes et parlant chacun une langue différente : le premier était Hindi, le second Roumi et le troisième Ajami des frontières extrêmes de la Perse.
Le premier, le savant Hindi, s’approcha du trône, se prosterna devant le roi, embrassa la terre entre ses mains et, après lui avoir souhaité joie et bonheur en ce jour de fête, lui offrit un présent vraiment royal : c’était un homme en or, incrusté de gemmes et de pierreries d’un grand prix, qui tenait à la main une trompette d’or. Et le roi Sabour lui dit : « Ô savant, quelle est l’utilité de cette figure ? » Il répondit : « Ô mon seigneur, l’utilité de cet homme en or est une vertu admirable ! Si tu le places à la porte de la ville, il en deviendra un gardien à toute épreuve ; car si un ennemi vient à entrer dans la place, il le devine à distance, et, soufflant dans la trompette dirigée contre sa figure, il le paralyse et le fait tomber mort de terreur ! » Et le roi, à ces paroles, s’émerveilla beaucoup et dit : « Par Allah ! ô savant, si tu dis vrai je te promets la réalisation de tous tes souhaits et de tous tes désirs ! »
Alors s’avança le savant Roumi qui embrassa la terre entre les mains du roi et lui offrit en cadeau un grand bassin d’argent au milieu duquel se trouvait un paon en or entouré de vingt-quatre paonnes du même métal. Et le roi Sabour les regarda avec étonnement et, se tournant vers le Roumi, lui dit : « Ô savant, quelle est l’utilité de ce paon et de ces paonnes ? » Il répondit : « Ô mon seigneur, chaque fois qu’une heure est écoulée du jour ou de la nuit, le paon donne un coup de bec à l’une des vingt-quatre paonnes et la monte, en battant des ailes, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ait monté toutes les paonnes, en marquant ainsi les heures ; puis lorsque le mois est écoulé de la sorte, il ouvre la bouche et le croissant de la nouvelle lune apparaît au fond de son gosier ! » Et le roi, émerveillé, s’écria : « Par Allah ! si tu dis vrai, tous tes vœux seront accomplis ! »
Le troisième qui s’avança fut le savant de Perse. Il embrassa la terre entre les mains du roi, et, après les compliments et les souhaits, lui offrit un cheval en bois d’ébène, de la qualité la plus noire et la plus rare, incrusté d’or et de pierreries, et harnaché merveilleusement d’une selle, d’une bride et d’étriers comme on n’en voit qu’aux chevaux des rois. Aussi le roi Sabour fut-il émerveillé à la limite de l’émerveillement, et déconcerté de la beauté et des perfections de ce cheval ; puis il dit : « Et quelles sont les vertus de ce cheval d’ébène ? » Le Persan répondit : « Ô mon seigneur, les vertus que possède ce cheval sont une chose prodigieuse et telle que lorsqu’on le monte, il part avec son cavalier à travers les airs avec la rapidité de l’éclair, et le porte partout où on veut le diriger, en couvrant en un jour des distances qu’un cheval ordinaire mettrait un an à parcourir ! » Le roi, prodigieusement étonné de ces trois choses prodigieuses qui se succédaient dans le même jour, se tourna vers le Persan et lui dit : « Par Allah le Tout-Puissant (qu’il soit exalté !), qui créa tous les êtres et leur donna le manger et le boire, si la vérité de tes paroles m’est prouvée, je te promets la réalisation de tes souhaits et du moindre de tes désirs ! »
Après quoi le roi fit mettre à l’épreuve, pendant trois jours, les vertus diverses des trois cadeaux, en faisant exécuter leurs divers mouvements par les trois savants. Et, de fait, l’homme en or souffla dans sa trompette d’or ; le paon en or becqueta et monta régulièrement ses vingt-quatre paonnes d’or, et le savant de Perse…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
… et le savant de Perse monta sur le cheval d’ébène, le fit s’élever dans les airs et parcourir un grand espace avec une rapidité extraordinaire pour, après avoir décrit un grand cercle, redescendre doucement à la place d’où il était parti.
À la vue de tout cela, le roi Sabour fut stupéfait d’abord, puis se trémoussa tellement qu’il faillit s’envoler de joie. Il dit alors aux savants : « Ô savants illustres, j’ai maintenant la preuve de la vérité de vos paroles, et c’est à mon tour de m’acquitter de ma promesse. Demandez-moi donc tout ce que vous désirez, et cela vous sera accordé à l’instant ! »
Alors les trois savants répondirent : « Du moment que notre maître le roi est satisfait de nous et de nos présents, et qu’il nous laisse le choix de la demande à lui faire, nous le prions de nous accorder ses trois filles en mariage, car nous souhaitons vivement devenir ses gendres ! Et c’est là une chose qui ne peut en rien troubler la tranquillité du royaume ! En tout cas les rois ne reviennent jamais sur leurs promesses ! » Le roi répondit : « Je vous accorde à l’instant la satisfaction de votre désir ! » Et aussitôt il donna l’ordre de faire venir le kâdi et les témoins pour dresser le contrat du mariage de ses trois filles avec les trois savants.
Tout cela !
Or, il advint que, pendant ce temps, les trois filles du roi étaient assises justement derrière un rideau de la salle de réception, et entendaient les paroles. Aussi la plus jeune des trois sœurs se mit-elle à considérer avec attention le savant qui devait lui échoir comme époux, et voici ! C’était un vieux bien ancien, âgé d’au moins cent ans, si ce n’est davantage, avec un reste de cheveux blanchis par le temps, une tête branlante, les sourcils mangés de teigne, les oreilles tombantes et fendues, la barbe et les moustaches teintes et sans vie, des yeux rouges et louches se regardant de travers, des bajoues flasques, jaunes et criblées de creux, un nez comme une grosse aubergine noire, une figure ratatinée comme le tablier d’un savetier, des dents saillantes comme les dents d’un cochon sauvage, et des lèvres pendantes et pantelantes comme les testicules du chameau ; en un mot ce vieux savant-là était quelque chose d’effrayant, une horreur composée de monstrueuses laideurs qui en faisaient l’être certainement le plus difforme de son temps et le plus épouvantable de son époque ; car comment ne l’eût-il pas été avec ces divers attributs et, en plus, ses mâchoires vides de leurs molaires et armées, en guise de canines, de crocs qui le rendaient semblable aux éfrits qui épouvantent les petits enfants dans les maisons désertes, et font crier d’effroi les poules dans les poulaillers.
Tout cela !
Et justement la princesse, la plus jeune des trois filles du roi, était l’adolescente la plus belle et la plus gracieuse de son temps, plus élégante que la tendre gazelle, plus douce et plus suave que la brise la plus caressante, et plus brillante que la lune dans son plein ; elle était ainsi vraiment faite pour les ébats amoureux ; elle se mouvait et le rameau flexible était confus de ses balancements onduleux ; elle marchait et le chevreuil léger était confondu de sa gracieuse allure ; et sans conteste elle surpassait de beaucoup ses sœurs en beauté, en blancheur, en charmes et en douceur. Et telle elle était, en vérité.
Aussi lorsqu’elle vit le savant qui devait lui échoir en lot, elle courut à sa chambre et là se laissa tomber la face contre terre en se déchirant les habits, en se griffant les joues et en sanglotant et se lamentant.
Pendant qu’elle était dans cet état, son frère, le prince Kamaralakmar, qui l’aimait beaucoup et la préférait à ses autres sœurs, rentrait d’une partie de chasse et, entendant sa sœur qui se lamentait et pleurait, pénétra dans sa chambre et lui demanda : « Qu’as-tu ? Que t’est-il arrivé ? Hâte-toi de me le dire, et ne me cache rien ! » Alors elle se frappa la poitrine et s’écria : « Ô mon unique frère, ô le chéri, je ne te cacherai rien. Sache que, si même le palais devait se rétrécir devant ton père, je suis prête à m’en aller ; et si ton père devait commettre des choses si odieuses, je n’hésiterais pas à le quitter et à m’enfuir d’ici, sans qu’il m’ait donné les provisions de route ; car Allah pourvoira ! »
À ces paroles, le prince Kamaralakmar lui dit : « Mais dis-moi enfin ce que signifie ce langage, et ce qui te rétrécit la poitrine et trouble tes humeurs ? » La jeune princesse répondit : « Ô mon unique frère, ô le chéri, sache que mon père m’a promise en mariage à un vieux savant, un horrible magicien, qui lui a apporté, en cadeau, un cheval en bois d’ébène, et lui a certainement jeté un sort au moyen de sa sorcellerie et l’a abusé avec son astuce et sa perfidie ! Quant à moi, je suis bien résolue plutôt que de me donner à ce vieux laid, à ne plus être de ce monde ! »
Son frère se mit alors à la calmer et à la consoler en la caressant et la cajolant, puis se hâta d’aller trouver le roi son père et lui dit : « Qu’est-ce que c’est que ce sorcier à qui tu as promis en mariage ma sœur la petite ? Et qu’est-ce que c’est que ce cadeau qu’il t’a apporté, pour te décider ainsi à faire mourir ma sœur de chagrin ? Cela n’est pas juste et ne peut arriver ! »
Or, le Persan était tout près de là, et il entendait ces paroles du fils du roi, et il en était bien furieux et bien mortifié.
Mais le roi répondit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… le roi répondit : « Ô mon fils Kamaralakmar, si tu connaissais le cheval que m’a donné le savant, tu ne serais point si troublé et si stupéfait ! » Et il sortit aussitôt avec son fils dans la grande cour du palais et donna l’ordre aux esclaves d’amener le cheval en question. Et ils exécutèrent l’ordre.
Lorsque le jeune prince vit le cheval, il le trouva fort beau et en fut ravi. Et comme il était un excellent cavalier il sauta sur son dos avec légèreté et lui piqua les flancs soudain avec les éperons, en mettant ses pieds dans les étriers. Mais le cheval ne bougea pas. Et le roi dit au savant : « Va voir un peu pourquoi il ne bouge pas ; et aide mon fils qui, à son tour, ne manquera pas de t’aider à réaliser tes souhaits ! »
Or, le Persan, qui gardait rancune au prince à cause de son opposition au mariage de sa sœur, s’approcha du prince à cheval et lui dit : « Regarde sur le pommeau de la selle cette cheville en or que voici à droite. C’est la cheville de l’ascension. Tu n’as qu’à la tourner ! »
Alors le prince tourna la cheville de l’ascension et voici ! Le cheval aussitôt l’enleva dans les airs avec la rapidité de l’oiseau, et si haut que le roi et tous les assistants le perdirent de vue au bout de peu d’instants.
En voyant ainsi disparaître son fils et en ne le voyant plus revenir au bout de quelques heures d’attente, le roi Sabour fut bien inquiet et bien perplexe et dit au Persan : « Ô savant, comment allons nous faire maintenant pour qu’il revienne ? » Il répondit : « Ô mon maître, moi je n’y puis plus rien ; et toi tu ne reverras ton fils qu’au jour de la Résurrection ! En effet, au lieu de me donner le temps de lui expliquer la façon de se servir de la cheville de gauche, qui est la cheville de la descente, le prince n’a voulu écouter que sa suffisance et son ignorance, et a fait partir le cheval trop vite ! »
Lorsque le roi Sabour eut entendu ces paroles du savant, il fut plein de fureur et, enrageant à la limite de la rage, il ordonna aux esclaves de lui donner la bastonnade et de le jeter ensuite dans le cachot le plus noir, tandis que lui-même arrachait sa couronne de sur sa tête, se donnait de grands coups sur la figure et s’arrachait la barbe. Après quoi il se retira dans son palais, en fit fermer toutes les portes, et se mit à sangloter, à gémir et à se lamenter, lui, son épouse, ses trois filles, ses gens et tous les habitants du palais ainsi que ceux de la ville. Et de la sorte leur joie se changea en affliction, et leur félicité en tristesse et en désespoir. Et voilà pour eux !
Quant au prince, le cheval continua à s’élever avec lui dans les airs sans s’arrêter, tellement qu’il fut sur le point de toucher au soleil. Alors il comprit le péril qu’il courait et quelle mort affreuse l’attendait dans ces régions du ciel ; et il fut bien inquiet et se repentit fort d’être monté sur le cheval, et il pensa en son âme : « Il est certain que l’intention du savant a été de me perdre à cause de ma sœur la petite ! Que faire maintenant ? Il n’y a de force et de puissance qu’en Allah l’Omnipotent ! Me voici perdu sans recours ! » Puis il se dit : « Mais qui sait s’il n’y a pas là une seconde cheville qui serait celle de la descente, comme l’autre est celle de l’ascension ? » Et comme il était doué de sagacité, de science et d’intelligence, il se mit à faire des recherches sur toutes les parties du cheval et finit par trouver une toute petite vis, pas plus grosse qu’une tête d’épingle, sur le côté gauche de la selle ; et il se dit : « Je n’en vois pas d’autre ! » Alors il pressa cette vis, et aussitôt l’ascension diminua peu à peu et le cheval s’arrêta un instant dans les airs pour, immédiatement après, commencer à descendre avec la même rapidité en se ralentissant ensuite petit à petit à mesure que l’on s’approchait de la surface du sol ; et il finit par toucher terre sans secousse aucune et sans mal, tandis que son cavalier commençait à respirer à son aise et à se tranquilliser sur sa vie.
Une fois que le jeune prince Kamaralakmar eut compris le maniement de la cheville et de la vis, il se réjouit fort de sa découverte et remercia Allah le Très-Haut qui avait daigné le délivrer d’une mort certaine. Après quoi il se mit, en faisant tourner tantôt la cheville et tantôt la vis, et en se servant de la bride soit à gauche soit à droite, à faire aller le cheval en avant, en arrière, en haut, en bas, partout où il voulait, tantôt avec la rapidité de l’éclair, tantôt à l’allure de promenade, jusqu’à ce qu’il se fût rendu bien maître de ses divers mouvements. Alors il le fit monter à une certaine hauteur et le poussa dans une certaine direction avec une rapidité modérée, de façon à pouvoir bien jouir du beau spectacle qui se déroulait à ses pieds, sur la terre. Et de cette façon il put regarder à son aise les merveilles de la terre et des mers, et admirer des contrées et des villes qu’il n’avait jamais ni vues ni connues, sa vie durant.
Or, parmi les villes qui de la sorte se déployaient au dessous de lui, il aperçut une cité aux maisons et aux édifices distribués avec symétrie d’une manière charmante, au milieu d’une contrée riante couverte d’une splendide végétation, sillonnée de nombreuses eaux courantes, et riche en pâturages où s’ébattaient en paix les bondissantes gazelles…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… où s’ébattaient en paix les bondissantes gazelles.
Comme de sa nature il aimait se distraire et regarder, Kamaralakmar se dit : « Il faut que je sache le nom de cette ville, et dans quelle contrée elle est située ! » Et il se mit à tourner en l’air tout autour de la ville, en s’arrêtant dans les endroits les plus beaux.
Cependant le jour commençait à décliner et le soleil était arrivé à l’horizon au bas de sa course ; et le prince pensa : « Par Allah ! je ne trouverai certainement pas de meilleure place pour passer la nuit que cette cité ! Ainsi je dormirai ici, et demain à la pointe du jour je reprendrai la route de mon royaume pour rentrer au milieu de mes parents et de mes amis. Et je raconterai alors à mon père tout ce qui m’est arrivé et tout ce que mes yeux ont vu ! » Et il tourna ses regards autour de lui pour choisir un endroit où passer la nuit en sécurité et sans être dérangé, et où remiser son cheval, et il finit par laisser tomber son choix sur un palais élevé, situé au milieu de la ville, flanqué de tours crénelées et gardé par quarante esclaves noirs vêtus de cottes de mailles et armés de lances, de glaives, d’arcs et de flèches. Donc il se dit : « Voilà un endroit excellent ! » et, pressant la vis de descente, il dirigea de ce côté-là son cheval qui vint, tel un oiseau fatigué, se poser doucement sur la terrasse du palais. Alors le prince dit : « Louange à Allah ! » et descendit de son cheval. Il se mit à tourner autour de lui et à l’examiner, en disant : « Par Allah ! celui qui t’a façonné avec une telle perfection est un maître ouvrier et le plus habile des artisans. Aussi, si le Très-Haut prolonge le terme de ma vie et me réunit avec mon père et les miens, je ne manquerai pas de combler ce savant de mes bontés et de le faire bénéficier de ma générosité ! »
Mais déjà la nuit était tombée, et le prince continua à rester sur la terrasse en attendant que tout le palais fût endormi. Puis comme il était torturé par la faim et la soif, vu que depuis son départ il n’avait encore rien mangé ni bu, il se dit : « Un palais comme celui-ci ne doit certes pas manquer de vivres ! » Il laissa donc le cheval sur la terrasse, et résolu à chercher de quoi se nourrir, il se dirigea vers l’escalier du palais et en descendit les marches jusqu’au bas. Et il se trouva soudain dans une large cour pavée de marbre blanc et d’albâtre transparent qui reflétaient dans la nuit la lumière de la lune. Et il s’émerveilla de la beauté de ce palais et de son architecture ; mais il eut beau regarder à droite et à gauche, il ne vit pas une âme vivante et n’entendit pas un son de voix humaine ; et il fut bien inquiet et bien perplexe, et ne sut que devenir. Il finit tout de même par se décider, pensant : « Je n’ai rien de mieux à faire pour le moment qu’à remonter sur la terrasse d’où je suis descendu, et à passer la nuit à côté de mon cheval ; et demain, dès les premières lueurs du jour, je remonterai à cheval et je m’en irai ! » Et comme il allait mettre ce projet à exécution, il aperçut une lumière à l’intérieur du palais, et s’avança de ce côté-là pour voir ce qu’était l’affaire. Et il vit que cette lumière était celle d’un flambeau allumé, placé devant la porte du harem, à la tête du lit d’un eunuque noir endormi, qui ronflait sur un ton fort bruyant, et ressemblait à quelque éfrit d’entre les éfrits aux ordres de Soleimân ou à quelque genni de la tribu noire des genn ; il était étendu sur un matelas en travers de la porte, et il la bouchait mieux que ne l’aurait fait un tronc d’arbre ou un banc de portiers ; et le pommeau de son glaive étincelait furieusement à la lueur du flambeau, tandis que, au dessus de sa tête, était pendu à une colonne de granit son sac à provisions.
À la vue de ce nègre effroyable, le jeune Kamaralakmar fut terrifié et murmura : « Je me réfugie en Allah le Tout-Puissant ! Ô Maître unique du ciel et de la terre, Toi qui m’as déjà sauvé d’une perte certaine, secours-moi encore et tire-moi sain et sauf de l’aventure qui m’attend dans ce palais ! » Il dit, et tendant la main vers le sac à provisions du nègre, il le prit légèrement, sortit de la chambre, l’ouvrit et y trouva des vivres de la meilleure qualité. Il se mit à en manger, et finit par vider complètement le sac ; et, après s’être ainsi restauré, il alla au bassin de la cour et étancha sa soif en buvant de l’eau qui en jaillissait, pure et douce. Après quoi il retourna près de l’eunuque, suspendit le sac à sa place, et, retirant du fourreau le glaive de l’esclave, le prit, tandis que celui-ci était plus endormi et plus ronflant que jamais, et sortit ne sachant encore d’où sa destinée devait venir à sa rencontre…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… ne sachant encore d’où sa destinée devait venir à sa rencontre.
Il s’avança donc dans l’intérieur du palais et arriva à une seconde porte sur laquelle retombait un rideau de velours. Il souleva cette portière et, dans une salle merveilleuse, il vit un large lit de l’ivoire le plus blanc, incrusté de perles, de rubis, d’hyacinthes et d’autres pierreries, et, étendues sur le sol, quatre jeunes esclaves endormies. Il s’approcha alors doucement du lit pour savoir qui pouvait bien y être coucha, et vit une adolescente qui n’avait pour toute chemise que sa chevelure ! Et elle était si belle qu’on l’aurait prise, non point pour la lune à son lever à l’horizon oriental, mais pour une seconde lune plus merveilleuse sortie des mains du Créateur ! Son front était une rose blanche, et ses joues deux anémones d’un rouge tendre, dont l’éclat se rehaussait d’un délicat grain-de-beauté de chaque côté !
À la vue de tant de beauté et de grâces, de charmes et d’élégance, Kamaralakmar faillit tomber à la renverse évanoui sinon mort. Et, lorsqu’il put maîtriser tant soit peu son émotion, il s’approcha de l’adolescente endormie, en tremblant de tous ses muscles et de tous ses nerfs et, frémissant de plaisir et de volupté, il la baisa sur la joue droite.
Au contact de ce baiser, la jeune fille se réveilla en sursaut, ouvrit de grands yeux et, apercevant le jeune prince qui était debout à son chevet, s’écria : « Qui es-tu et d’où viens-tu ? » Il répondit : « Je suis ton esclave et l’amoureux de tes yeux ! » Elle demanda : « Et qui t’a conduit jusqu’ici ? » Il répondit : « Allah, ma destinée et ma bonne chance ! »
À ces paroles, la princesse Schamsennahar (car tel était son nom), sans trop montrer de frayeur ou d’épouvante, dit au jeune homme : « Peut-être es-tu ce fils du roi de l’Inde qui m’a demandée hier en mariage, et que le roi mon père n’a pas accepté comme gendre à cause, prétend-on, de sa laideur. Car si c’est toi, tu n’es, par Allah ! rien moins que laid, et ta beauté me subjugue déjà, ô mon seigneur ! » Et, comme, en effet, il était aussi radieux que la brillante lune, elle l’attira à elle et l’embrassa, et il l’embrassa, et, tous deux, enivrés de leur mutuelle beauté et de leur jeunesse, se firent mille caresses, étendus dans les bras l’un de l’autre, et se dirent mille folies en se faisant mille jeux aimables et mille cajoleries douces ou hardies.
Pendant qu’ils s’égayaient de la sorte, soudain les servantes se réveillèrent, et, apercevant le prince avec leur maîtresse, s’écrièrent : « Ô notre maîtresse, quel est ce jeune homme qui est avec toi ? » Elle répondit : « Je ne sais pas ! En me réveillant, je l’ai trouvé à mes côtés ! Je crois bien toutefois que c’est celui qui m’a sollicitée hier de mon père en mariage ! »
Elles s’écrièrent, éperdues d’émotion : « Le nom d’Allah sur toi et autour de toi ! ô notre maîtresse, ce n’est point du tout celui qui t’a demandée hier en mariage ; car il était bien laid et bien hideux, celui-là ; et cet adolescent est gentil et délicieusement beau ; et il est certainement d’une illustre naissance. Quant à l’autre, le laid d’hier, il n’est même pas digne d’être son esclave ! » Sur quoi les servantes se levèrent et allèrent réveiller l’eunuque de la porte, et lui jetèrent l’alarme au cœur en lui disant : « Comment se fait-il qu’étant le gardien du palais et du harem, tu laisses les hommes pénétrer chez nous pendant notre sommeil ? »
Lorsque l’eunuque nègre entendit ces paroles, il sauta sur ses deux pieds et voulut se saisir de son glaive, mais ne le trouva plus dans le fourreau. Cela le jeta dans une grande terreur, et, tout tremblant, il souleva la portière et entra dans la salle. Et il vit, avec sa maîtresse au lit, le beau jeune homme, dont il fut ébloui tellement qu’il lui demanda : « Ô mon seigneur, es-tu un homme ou un genni ? » Le prince répondit : « Et toi, misérable esclave et le plus maléfique des nègres noirs, comment oses-tu confondre les fils des rois Khosroès avec les genn démoniaques et les éfrits ? » Et ce disant, furieux comme un lion blessé, il se saisit du glaive et cria à l’eunuque : « Je suis le gendre du roi, et il m’a marié avec sa fille, et m’a enjoint de pénétrer chez elle ! »
En entendant ces paroles, l’eunuque répondit : « Ô mon seigneur, si tu es vraiment un homme de l’espèce des hommes, et non point un genni, notre jeune maîtresse est digne de ta beauté, et tu la mérites bien plus que n’importe quel autre roi fils de roi ou de sultan ! »
Là-dessus l’eunuque courut chez le roi, en jetant les hauts cris, en déchirant ses habits et en se couvrant la tête de poussière. Aussi, en entendant ses cris affolés, le roi lui demanda-t-il : « De quelle calamité as-tu donc été atteint ? Parle vite et sois bref, car tu as fait frémir mon cœur ! » L’eunuque répondit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
… L’eunuque répondit : « Ô roi, hâte-toi de voler au secours de ta fille, car un genni d’entre les genn, sous les apparences d’un fils de roi, a pris possession d’elle et a élu domicile en elle ! Il n’y a pas ! Il faut courir ! Sus à lui ! »
En entendant ces paroles de son eunuque, le roi fut à la limite de la fureur, et fut sur le point de le tuer ; puis il lui cria : « Comment as-tu osé être assez négligent pour perdre ma fille de vue, quand je t’avais chargé de sa garde diurne et nocturne, et pour laisser cet éfrit démoniaque pénétrer chez elle et prendre possession d’elle ? » Et, fou d’émotion, il s’élança vers l’appartement de la princesse, où il trouva les servantes qui l’attendaient à la porte pâles et tremblantes, et leur demanda : « Qu’est-il arrivé à ma fille ? » Elles répondirent : « Ô roi, pendant que nous étions endormies nous ne savons ce qui est arrivé ; mais lorsque nous nous sommes réveillées nous avons trouvé dans le lit de la princesse un jeune homme que nous avons pris pour la pleine lune, tant il était beau, et qui causait avec elle d’une manière délicieuse et rassurante. Et vraiment nous n’avons jamais vu quelqu’un de plus beau que cet adolescent. Pourtant nous lui demandâmes qui il était, et il nous répondit : « Je suis celui à qui le roi a accordé sa fille en mariage ! » Plus que cela nous ne savons rien ! Et nous ne pouvons guère te dire s’il est un homme ou un genni. En tout cas nous pouvons t’assurer qu’il est aimable, bien intentionné, modeste, bien élevé, incapable de commettre un méfait quelque léger qu’il soit, ou de faire quelque chose de blâmable ! Comment, quand on est si beau, pourrait-on faire une chose blâmable ? »
Lorsque le roi eut entendu ces paroles, sa colère se refroidit et son inquiétude s’apaisa ; et, tout doucement et avec mille précautions, il souleva un peu la portière et il vit avec sa fille, couché à côté d’elle dans le lit et causant gentiment, un prince des plus charmants, dont le visage était éclatant comme la pleine lune.
Cette vue, au lieu d’achever de l’apaiser, eut pour résultat d’exciter au plus haut point sa jalousie paternelle et ses craintes au sujet du danger que courait l’honneur de sa fille. Aussi, se précipitant par la portière, il s’élança sur eux, l’épée à la main, et furieux et féroce comme un ghoul monstrueux. Mais le prince, qui le vit venir de loin, demanda à la jeune fille : « Est-ce là ton père ? » Elle répondit : « Mais oui ! » Aussitôt il sauta sur ses deux pieds et, saisissant son glaive, il lança un cri si terrible à la figure du roi, que celui-ci en fut épouvanté. Alors Kamaralakmar, plus menaçant que jamais, se disposa à se jeter sur lui et à le transpercer ; mais le roi, qui avait compris qu’il était le plus faible, se hâta de rengainer son glaive et prit une attitude conciliante. Aussi, quand il vit le jeune homme déjà sur lui, il lui dit du ton le plus courtois et le plus aimable : « Ô jouvenceau, es-tu homme ou genni ! » Il répondit : « Par Allah ! si je ne respectais tes droits à l’égal des miens propres, et si je ne me souciais de l’honneur de ta fille, j’aurais déjà répandu ton sang ! Comment oses-tu me confondre avec les genn et les démons, alors que je suis un prince royal de la race des Khosroès, de ceux qui, s’ils voulaient s’emparer de ton royaume, n’hésiteraient pas à se faire un jeu de te faire sauter de ton trône comme par un tremblement de terre, et de te frustrer de tes honneurs, de ta gloire et de ta puissance ! »
Lorsque le roi eut entendu ces paroles, il eut pour lui un grand sentiment de respect et craignit beaucoup pour sa propre sécurité. Aussi se hâta-t-il de répondre : « Comment se fait-il, si tu es vraiment le fils des rois, que tu n’aies pas craint de pénétrer dans mon palais sans mon consentement, de détruire mon honneur et d’arriver à la possession de ma fille, en prétendant être son époux et en proclamant que je te l’avais accordée en mariage, alors que moi j’ai fait tuer tant de rois et de fils de rois qui voulaient me forcer à la leur donner comme épouse ? » Et, le roi excité par ses propres paroles, continua : « Et maintenant, toi aussi, qui pourra te sauver d’entre les mains de ma puissance quand je vais crier à mes esclaves l’ordre de te faire mettre à mort par la pire des morts, et qu’ils obéiront à l’heure et à l’instant ? »
Lorsque le prince Kamaralakmar eut entendu ces paroles du roi, il répondit : « En vérité, je suis stupéfait de ta courte vue et de l’épaisseur de ton entendement ! Dis-moi, pourras-tu donc jamais trouver pour ta fille un meilleur parti que moi ? Et as-tu jamais vu un homme plus intrépide ou mieux partagé ou plus riche en armées, en esclaves et en possessions que moi-même ? » Le roi répondit : « Non, par Allah ! mais, ô jouvenceau, j’eusse bien voulu te voir devenir l’époux de ma fille par devant le kâdi et les témoins ! Mais un mariage fait de cette façon secrète-là ne pourrait que détruire mon honneur ! » Le prince répondit : « Que tu parles bien, ô roi ! Mais ne sais-tu donc que si vraiment tes esclaves et tes gardes devaient, comme tu viens de m’en menacer, se précipiter tous sur moi et me mettre à mort, tu ne ferais que courir plus sûrement à la perte de ton honneur et de ton royaume, en rendant publique ta disgrâce et en forçant ton peuple lui-même à se tourner contre toi ? Crois-moi donc, ô roi ! Il ne te reste qu’un seul parti à prendre, et c’est d’écouter ce que j’ai à te dire et de suivre mes conseils ! » Et le roi demanda : « Parle donc, que j’entende un peu ce que tu as à me dire…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT VINGT-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … Parle donc, que j’entende un peu ce que tu as à me dire ! » Il répondit : « Voici ! De deux choses l’une : ou bien tu vas accepter de lutter avec moi en combat singulier, et alors celui qui vaincra son adversaire sera proclamé le plus vaillant et aura ainsi un titre sérieux au trône du royaume ; ou bien tu vas me laisser ici toute cette nuit avec ta fille, et demain matin tu enverras contre moi la masse entière de tes cavaliers, de tes fantassins et de tes esclaves, et… ; mais auparavant dis-moi quel est leur nombre ! » Le roi répondit : « Ils sont au nombre de quarante mille cavaliers, sans compter mes propres esclaves et les esclaves de mes esclaves, dont le nombre est égal à celui des premiers ! » Alors Kamaralakmar dit : « C’est bien. Donc dès les premières lueurs du jour, fais-les avancer contre moi en ordre de bataille et dis-leur : « Cet homme que voici vient solliciter de moi ma fille en mariage, à condition de lutter à lui seul contre vous tous réunis et de vous vaincre et de vous mettre en déroute, sans que vous puissiez arriver à en venir à bout ! Et c’est là ce qu’il prétend ! » Puis tu me laisseras seul lutter contre eux tous ! S’ils me tuent, alors ton secret est ainsi bien plus sûrement gardé à jamais, et ton honneur sauvé. Si au contraire c’est moi qui triomphe d’eux tous et les mets en déroute, tu auras trouvé un gendre dont pourraient s’honorer les plus grands rois ! »
Le roi alors ne manqua pas de partager cette dernière opinion et d’accepter cette proposition, bien qu’il fût stupéfait d’une telle assurance et qu’il ne sût à quoi attribuer une si folle prétention ; car au fond de son cœur il était persuadé que le jeune prince périrait dans cette lutte insensée, et qu’ainsi son secret serait le mieux gardé et son honneur sauf. Aussi appela-t-il le chef eunuque et lui donna-t-il l’ordre d’aller sans délai trouver le vizir et de lui enjoindre de rassembler toutes les troupes et de les tenir prêtes sur leurs chevaux et revêtues de leurs armes de guerre. Et l’eunuque transmit l’ordre au vizir, qui aussitôt rassembla les chefs et les principaux notables du royaume, et les rangea en ordre de bataille à la tête de leurs troupes revêtues de leurs armes de guerre. Et voilà pour eux !
Quant au roi, il resta encore près du jeune prince à causer avec lui, tant il était charmé de ses paroles sensées, de son bon jugement, de ses manières distinguées et de sa beauté, et aussi parce qu’il ne voulait pas le laisser encore seul avec sa fille cette nuit-là. Mais, à peine jour, il regagna son palais et s’assit sur son trône et donna l’ordre à ses esclaves de tenir prêt pour le prince le plus beau cheval des écuries royales, de le seller magnifiquement et de le harnacher de housses somptueuses. Mais le prince lui dit : « Je ne veux monter à cheval que lorsque je serai arrivé devant les troupes ! » Le roi répondit : « Qu’il soit fait selon ton désir ! » Et tous deux sortirent au meidân où les troupes étaient rangées en ordre de bataille, et le prince put ainsi juger de leur nombre et de leur qualité. Après quoi le roi se tourna vers tous ceux-là, et leur cria : « Ho ! Guerriers, ce jeune homme que voici est venu me trouver et m’a demandé ma fille en mariage. Et moi en vérité je n’ai jamais vu rien de plus beau que lui ni cavalier plus intrépide. D’ailleurs il prétend lui-même qu’il peut, à lui seul, triompher de vous tous et vous mettre en déroute ; et fussiez-vous cent mille fois plus nombreux, il vous considérerait comme peu de chose et vous vaincrait tout de même. Ainsi donc ne manquez pas, quand il vous chargera, de le recevoir sur la pointe de vos glaives et de vos lances ! Cela lui apprendra ce qu’il en coûte de se mêler de si graves affaires ! » Puis le roi se tourna vers le jeune homme et lui dit : « Hardi, mon fils ! et fais-nous voir tes prouesses ! » Mais il répondit : « Ô roi, tu ne me traites ni avec justice ni avec impartialité ! Comment veux-tu en effet que je lutte avec tous ceux-là, moi à pied et eux à cheval ! » Le roi lui dit : « Je t’avais offert de monter à cheval, et tu avais refusé ! Tu peux encore le faire, et choisir au milieu de tous mes chevaux celui qui te plaît le mieux ! » Mais il répondit : « Aucun de tes chevaux ne me plaît, et je ne monterai que sur celui qui m’a porté jusqu’à ta ville ! » Le roi lui demanda : « Et où est-il, ton cheval ? » Il dit : « Il est au-dessus de ton palais. » Il demanda : « Où ça, au-dessus de mon palais ? » Il répondit : « Sur la terrasse de ton palais. »
À ces paroles, le roi le regarda avec attention et s’écria : « Ô l’extravagant ! Voilà la meilleure preuve de ta folie ! Comment un cheval peut-il être sur la terrasse ? Mais nous allons tout de suite voir si tu mens ou si tu dis la vérité ! » Puis il se tourna vers le chef de ses troupes, et lui dit : « Cours au palais et reviens me dire ce que tu auras vu ! Et apporte-moi tout ce tu trouveras sur la terrasse ! »
Quant au peuple, il s’émerveilla des paroles du jeune prince ; et tous les gens se demandèrent : « Comment un cheval pourra-t-il descendre l’escalier du haut de la terrasse ? Vraiment voilà une chose que nous n’avons jamais entendue de notre vie ! »
Cependant le messager du roi arriva au palais et, étant monté sur la terrasse, y trouva le cheval et jugea qu’il n’avait jamais vu son égal en beauté ; mais lorsqu’il s’en fut approché et qu’il l’eut examiné, il vit qu’il était en bois d’ébène et en ivoire ! Alors lui et tous ceux qui l’accompagnaient se mirent, en voyant la chose, à rire et à se dire les uns aux autres…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… à rire et à se dire les uns aux autres : « Par Allah ! est-ce là le cheval dont parlait ce jouvenceau qui ne doit être désormais regardé par nous que comme un fou. Pourtant nous voulons bien voir ce qu’il peut y avoir de vrai dans tout cela. Car il se pourrait en somme que ce fût là une affaire plus importante qu’on ne croit, et que ce jeune homme fût réellement quelqu’un d’un haut rang et d’un mérite excellent ! » Ce disant, ils soulevèrent à eux tous le cheval de bois et, le transportant sur leurs bras, ils le déposèrent devant le roi, alors que tous les gens s’attroupaient tout autour à le regarder en s’émerveillant de sa beauté, de ses proportions, de la richesse de sa selle et de son harnachement. Et le roi aussi l’admira beaucoup et s’en émerveilla à la limite de l’émerveillement ; puis il demanda à Kamaralakmar : « Ô jeune homme, est-ce là ton cheval ? » Il répondit : « Oui, ô roi ! C’est mon cheval, et tu verras bientôt les choses merveilleuses qu’il te montrera ! » Et le roi dit : « Alors prends-le et monte-le ! » Le prince répondit : « Je ne le monterai que lorsque tous ces gens et ces troupes se seront éloignés d’autour de lui ! »
Alors le roi donna l’ordre à tout le monde de s’éloigner de là à la distance d’une portée d’arc. Et le jeune prince lui dit : « Ô roi, regarde-moi bien ! Je vais sauter sur mon cheval et me précipiter au grand galop sur tes troupes que je disperserai à droite et à gauche ; et je jeterai l’épouvante dans leurs cœurs et le tremblement ! » Et le roi répondit : « Fais ce que tu veux maintenant ; mais surtout ne les épargne pas, car ils ne t’épargneront pas ! »
Et Kamaralakmar appuya légèrement sa main sur l’encolure de son cheval, et d’un saut fut sur son dos.
De leur côté, les troupes, anxieuses, s’étaient alignées plus loin en rangs serrés et tumultueux ; et les guerriers se disaient les uns aux autres : « Lorsque ce jouvenceau sera arrivé devant nos rangs nous le cueillerons à la pointe de nos piques et nous le recevrons sur le tranchant de nos cimeterres ! » Mais d’autres disaient : « Par Allah ! c’est là une grande misère ! Comment aurons-nous le cœur de tuer un si beau garçon, un jouvenceau si tendre, si élégant et si gentil ? » Et d’autres disaient : « Par Allah ! il faut que nous soyons insensés pour croire que nous allons facilement venir à bout de ce jeune homme ! Il est certain que s’il s’est jeté dans une pareille aventure, c’est qu’il avait la certitude de réussir. En tout cas, cela nous est une preuve de son courage, de sa valeur, et de l’intrépidité de son âme et de son cœur ! »
Quant à Kamaralakmar, une fois qu’il se fut bien consolidé sur la selle, il fit manœuvrer la cheville de l’ascension, tandis que tous les yeux étaient tournés de son côté pour voir ce qu’il allait faire. Et aussitôt le cheval se mit à s’agiter, à palpiter, à haleter, à piaffer, à se balancer, à se pencher, à avancer et à reculer, pour ensuite, avec une élasticité merveilleuse, commencer à caracoler et à marcher de côté plus élégamment que ne caracolèrent jamais les chevaux le mieux dressés des rois et des sultans. Et soudain ses flancs frémirent et se gonflèrent de vent, et, plus rapide qu’une flèche lancée dans les airs, il prit son essor en s’élevant avec son cavalier en ligne droite dans le ciel !
À cette vue, le roi faillit s’envoler de surprise et de fureur, et cria aux chefs de ses gardes : « Ho ! malheur à vous ! attrapez-le ! attrapez-le ! Il nous échappe ! » Mais ses vizirs et ses lieutenants lui répondirent : « Ô roi, est-ce qu’un homme peut atteindre l’oiseau qui a des ailes ? Celui-là n’est certainement pas un homme comme les autres, mais un puissant magicien ou quelque éfrit ou mared d’entre les éfrits et les mareds de l’air ! Et Allah t’a délivré de lui, et nous avec toi ! Remercions donc le Très-Haut qui a bien voulu te sauver d’entre ses mains, et ton armée avec toi ! »
Alors le roi, à la limite de l’émotion de la perplexité, retourna à son palais et, entrant chez sa fille, la mit au courant de ce qui venait de se passer sur le meidân. Et la jeune fille, à la nouvelle de la disparition du jeune prince, fut si affligée et si désespérée, et pleura et se lamenta si douloureusement, qu’elle tomba gravement malade et fut étendue, sur son lit, en proie à la chaleur de la fièvre et à la noirceur des idées ! Et son père, la voyant dans cet état, se mit à l’embrasser, à la bercer, à la serrer contre sa poitrine, et à la baiser entre les deux yeux, en lui répétant ce qu’il avait vu au meidàn et en lui disant : « Ma fille, remercie plutôt Allah (qu’il soit exalté !) et glorifie-le pour nous avoir délivrés d’entre les mains de cet insigne magicien, de ce menteur, de ce séducteur, de ce voleur, de ce cochon ! » Mais il eut beau lui parler et la cajoler pour la consoler, elle n’entendait, ni n’écoutait, ni ne se consolait, au contraire ! Elle ne fit que sangloter davantage, et pleurer et gémir, en soupirant : « Par Allah ! Je ne veux plus manger ni boire, et cela jusqu’à ce qu’Allah me réunisse avec mon amoureux, le charmant ! Et je ne veux plus savoir que répandre des larmes et m’enterrer dans mon désespoir ! » Alors son père, voyant qu’il ne pouvait tirer sa fille de cet état de langueur et d’affliction, devint fort chagriné, et son cœur s’attrista, et le monde noircit devant son visage. Et voilà pour le roi et pour sa fille, la princesse Schamsennahar…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT VINGT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Et voilà pour le roi et pour sa fille, la princesse Schamsennahar !
Mais pour ce qui est du prince Kamaralakmar, voici ! Lorsqu’il se fut élevé si haut dans les airs, il fit tourner la tête à son cheval du côté de sa terre natale, et, une fois dans la bonne direction, il se mit à rêver à la beauté de la princesse et à ses charmes, et aux moyens à employer pour la retrouver. Et la chose lui semblait bien difficile, bien qu’il eût eu soin de s’informer auprès d’elle du nom de la ville de son père. Il avait appris de la sorte que cette ville s’appelait Sana, et était la ville capitale du royaume d’Al-Yaman.
Durant toute la route il continua à songer à tout cela, et finit, grâce à la grande rapidité d’allure de son cheval, par arriver à la ville de son père. Alors il fit exécuter à son cheval un circuit aérien au-dessus de la cité, et alla mettre pied à terre sur la terrasse du palais. Il laissa alors son cheval sur la terrasse et descendit au palais où, voyant partout un air de deuil et toutes les chambres jonchées de cendres, il pensa qu’un membre de sa famille était mort, et, selon sa coutume, il pénétra dans l’appartement privé, et trouva son père, sa mère et ses sœurs vêtus d’habits de deuil, et bien jaunes de figure et bien amaigris et bien changés et tristes et défaits. Et voici qu’à son entrée son père se leva soudain en l’apercevant et, ayant acquis la certitude que c’était là vraiment son fils, il poussa un grand cri et tomba évanoui ; puis il reprit ses sens, et se jeta dans les bras de son fils et l’embrassa et le serra contre sa poitrine avec les transports de la joie la plus folle, et ému à la limite de l’émotion ; et sa mère et sa sœur, pleurant et sanglotant, le dévoraient de baisers à qui mieux mieux, et dansaient et sautaient dans leur bonheur.
Lorsqu’ils se furent un peu calmés, ils l’interrogèrent sur ce qui lui était arrivé ; et il leur raconta la chose depuis le commencement jusqu’à la fin ; mais il n’y a pas d’utilité à la répéter. Alors son père s’écria : « Louanges à Allah pour ton salut, ô la fraîcheur de mes yeux et le noyau de mon cœur ! » Et il fit donner de grandes fêtes au peuple et de grandes réjouissances, pendant sept jours entiers, et distribua les largesses, au son des fifres et des cymbales, et fit décorer toutes les rues et proclamer le pardon général de tous les prisonniers, en faisant ouvrir toutes grandes les portes des prisons et des cachots. Puis, accompagné de son fils, il parcourut à cheval les divers quartiers de la ville, pour donner à son peuple la joie de revoir le jeune prince que l’on croyait à jamais perdu.
Cependant, une fois les fêtes finies, Kamaralakmar dit à son père : « Ô mon père, qu’est-il donc devenu, le Persan qui t’a donné le cheval ? » Et le roi répondit : « Qu’Allah confonde ce savant et lui retire sa bénédiction à lui et à l’heure où mes yeux l’ont vu pour la première fois ; car il est la cause de ta séparation d’avec nous, ô mon fils ! En ce moment il est enfermé dans le cachot, et il est le seul qui n’ait pas été pardonné ! » Mais, à la prière de son fils, le roi le fit sortir de prison et, l’ayant fait venir en sa présence, le fit rentrer en grâce, lui donna une robe d’honneur et le traita avec une grande libéralité en lui accordant toutes sortes d’honneurs et de richesses ; mais il ne lui fit aucune mention de sa fille et ne songea pas à la lui donner en mariage. Aussi le savant enragea-t-il de cela à la limite de la rage, et se repentit-il fort de l’imprudence qu’il avait commise en laissant le jeune prince monter sur le cheval ; car il comprit que le secret du cheval avait été découvert, ainsi que la façon de le manœuvrer !
Quant au roi, qui n’était pas encore bien tranquille au sujet du cheval, il dit à son fils : « Je suis d’avis, mon fils, que tu ne t’approches plus désormais de ce cheval de malheur et surtout que tu ne le montes jamais plus, car tu es loin de connaître ce qu’il peut encore contenir de choses mystérieuses, et tu n’es pas en sûreté là-dessus ! »
De son côté Kamaralakmar raconta à son père son aventure avec le roi de Sana et sa fille, et comment il avait échappé au ressentiment de ce roi ; et son père répondit : « Mon fils, si le roi de Sana devait te tuer, il t’aurait tué ; mais ton heure n’était pas encore fixée par le destin ! »
Pendant ce temps Kamaralakmar, malgré toutes les réjouissances et les festins que son père continuait à donner pour son retour, était loin d’oublier la princesse Schamsennahar et, en mangeant et en buvant, il pensait toujours à elle. Or un jour le roi, qui avait des esclaves fort expertes dans l’art du chant et le jeu du luth, leur ordonna de faire résonner les cordes des instruments et de chanter quelques beaux vers. Et l’une d’elles prit son luth et, l’appuyant sur ses genoux comme une mère met son enfant dans son sein, elle chanta, en s’accompagnant, ces vers entre autres vers :
« Ton souvenir, ô bien-aimé, ne s’effacera point de mon cœur, ni par l’absence ni par l’éloignement.
« Les jours peuvent passer et le temps mourir, mais jamais ne peut mourir ton amour dans mon cœur.
« Dans cet amour je veux moi-même mourir, et dans cet amour ressusciter. »
Lorsque le prince eut entendu ces vers, les feux du désir étincelèrent dans son cœur, les flammes de la passion redoublèrent de chaleur, les regrets et les tristesses remplirent de deuil son esprit, et l’amour lui bouleversa les entrailles. Aussi, ne pouvant plus résister aux sentiments qui l’agitaient au sujet de la princesse de Sana, il se leva à l’heure et à l’instant, monta sur la terrasse du palais et, malgré le conseil de son père, sauta sur le dos du cheval d’ébène et tourna la cheville de l’ascension. Aussitôt le cheval, comme un oiseau, s’éleva avec lui dans les airs en prenant son essor vers les hautes régions du ciel.
Or, le lendemain matin, le roi son père le chercha dans le palais et, ne le trouvant pas, monta sur la terrasse et fut consterné en constatant la disparition du cheval ; et il se mordit les doigts de repentir, pour n’avoir pas pris ce cheval et ne l’avoir pas mis en pièces ; et il se dit : « Par Allah ! si mon fils me revient encore, je détruirai ce cheval, afin que mon cœur puisse être tranquille et mon esprit désormais sans secousses ! » Et il redescendit dans son palais, où il retomba dans les pleurs, les sanglots et les lamentations. Et voilà pour lui !
Quant à Kamaralakmar, il continua son rapide voyage aérien, et arriva à la ville de Sana. Il mit pied à terre sur la terrasse du palais, descendit l’escalier sans faire de bruit, et se dirigea vers l’appartement de la princesse. Il trouva l’eunuque endormi, selon son habitude, en travers de la porte ; il l’enjamba et, pénétrant à l’intérieur de l’appartement, il arriva à la seconde porte. Il s’approcha alors tout doucement de la portière et, avant de la soulever, écouta attentivement. Et voici ! Il entendit sa bien-aimée qui sanglotait amèrement et récitait des vers plaintifs, tandis que ses femmes essayaient de la consoler, et lui disaient : « Ô notre maîtresse…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ô notre maîtresse, pourquoi pleures-tu quelqu’un qui certainement ne doit point te pleurer ? » Elle répondit : « Que dites-vous, ô dénuées de jugement ? Croyez-vous donc que le charmant que j’aime et que je pleure soit de ceux-là qui oublient ou que l’on peut oublier ? » Et elle redoubla de pleurs et de gémissements, et si fort et si longtemps qu’elle en eut un évanouissement. Alors le prince sentit son cœur s’émietter pour elle et son ampoule à fiel éclater dans son foie. Aussi, sans plus tarder, il souleva la portière et pénétra dans la chambre. Et il vit la jeune fille couchée sur son lit, avec, pour toute chemise, sa chevelure, et pour toute couverture son éventail de plumes blanches. Et comme elle avait l’air d’être assoupie, il s’approcha d’elle et tout doucement il la toucha d’une caresse. Aussitôt elle ouvrit les yeux et le vit debout à côté d’elle, penché dans une interrogation pleine d’anxiété, et murmurant : « Pourquoi ces larmes et ces gémissements ? » À cette vue la jeune fille, ranimée d’une vie nouvelle, se leva soudain et, se jetant tout contre lui, lui entoura le cou de ses bras et se mit à lui couvrir le visage de baisers en lui disant : « Mais tout cela, c’était à cause de ton amour et de ton éloignement, ô lumière de mon œil ! » Il répondit : « Ô ma maîtresse, et moi ! dans quelle désolation n’ai-je pas été à cause de toi tout ce temps-là ! » Elle reprit : « Et moi ! comme aussi j’ai été désolée de ton absence ! Si tu avais tardé plus longtemps à revenir, je serais morte certainement ! » Il dit : « Ô ma maîtresse, que penses-tu de mon cas avec ton père, et de la façon dont il m’a traité ? Par Allah ! n’était ton amour, ô séductrice de la Terre, du Soleil et de la Lune et tentatrice des habitants du Ciel, de la Terre et de l’Enfer, je l’aurais certainement égorgé et j’en aurais fait un exemple et un enseignement à tous les observateurs ! Mais de même que je t’aime, je l’aime lui aussi maintenant ! » Elle reprit : « Comment as-tu pu te décider à m’abandonner ? Et comment la vie m’aurait-elle paru douce après toi ? » Il dit : « Du moment que tu m’aimes, voudras-tu m’écouter et suivre mes conseils ? » Elle répondit : « Tu n’as qu’à parler, et je t’obéirai et j’écouterai tes conseils et je suivrai tous tes avis ! » Il dit : « Commence alors par m’apporter à manger et à boire, car j’ai bien faim et bien soif ! Et, après cela nous parlerons ! »
Alors la jeune fille donna l’ordre à ses servantes d’apporter les mets et les boissons ; et tous deux se mirent à manger, à boire et à causer jusqu’à ce que la nuit fût à peu près écoulée. Alors, comme le jour commençait à poindre, Kamaralakmar se leva pour prendre congé de la jeune fille et s’en aller avant que l’eunuque fût réveillé ; mais Schamsennahar lui demanda : « Et où vas-tu aller de la sorte ? » Il répondit : « À la maison de mon père ! Mais je m’engage sous serment à revenir te voir une fois par semaine ! » À ces paroles, elle éclata en sanglots et s’écria : « Ô ! je te conjure par Allah le Tout-Puissant de me prendre avec toi et de m’emmener partout où tu veux, plutôt que de me faire goûter de nouveau à l’amertume de la coloquinte de la séparation ! » Et lui, épanoui, s’écria : « Vraiment tu veux venir avec moi ? » Elle répondit : « Mais oui ! » Il dit : « Alors, lève-toi et partons ! » Aussitôt elle se leva, ouvrit un coffre rempli de robes somptueuses et d’objets de prix, et s’orna et mit sur elle tout ce qui était de plus riche et de plus précieux parmi les belles choses qui lui appartenaient, sans oublier les colliers, les bagues, les bracelets et les divers joyaux sertis des plus belles pierreries ; puis elle sortit avec son bien-aimé, sans que les servantes eussent songé à l’en empêcher.
Alors Kamaralakmar l’emmena et, l’ayant fait monter sur la terrasse du palais, il sauta sur le dos de son cheval, la prit elle-même en croupe, lui enjoignit de se serrer fort contre lui, et l’attacha à lui au moyen de solides liens. Après quoi il tourna la cheville de l’ascension, et le cheval prit son essor et s’éleva avec eux dans les airs.
À cette vue, les servantes jetèrent les hauts cris, et firent si bien que le roi et la reine accoururent sur la terrasse, à moitié vêtus, sortant de leur sommeil, et eurent juste le temps de voir le cheval magique s’enlever en son vol aérien avec le prince et la princesse. Et le roi, ému et consterné à la limite de la consternation, eut la force de crier au jeune homme qui s’élevait de plus en plus : « Ô fils du roi, je t’en conjure, aie compassion de moi et de mon épouse, cette vieille que voici, et ne nous prive pas de notre fille ! » Mais le prince ne lui répondit même pas. Toutefois il eut un instant l’idée que la jeune fille éprouvait peut-être un regret de quitter ainsi son père et sa mère, et lui demanda : « Dis-moi, ô splendeur, ô ravissement de ton siècle et de mes yeux, veux-tu que je te rende à ton père et à ta mère ?… »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … ô ravissement de ton siècle et de mes yeux, veux-tu que je te rende à ton père et à ta mère ? » Elle répondit : « Par Allah ! ô mon maître, ce n’est point là mon désir ! La seule chose que je souhaite est d’être avec toi partout où tu es ; car l’amour que j’éprouve pour toi me fait tout négliger et tout oublier, y compris mon père et ma mère ! »
En entendant ces paroles, le prince se réjouit à la limite de la joie, et fit voler son cheval à l’allure la plus rapide, sans que cela émût ou troublât la jeune fille ; et de cette façon ils ne tardèrent pas à arriver à mi-route, à un endroit où s’étendait une magnifique prairie arrosée d’eaux courantes, où ils mirent un instant pied à terre. Ils mangèrent, burent, et prirent quelque repos, pour, immédiatement après, remonter sur leur cheval magique et partir à toute vitesse dans la direction de la capitale du roi Sabour, en vue de laquelle ils arrivèrent un matin. Et le prince se réjouit beaucoup de leur arrivée sans accident, et eut d’avance un grand plaisir en songeant qu’il allait enfin pouvoir montrer à la princesse ce qu’il possédait sous sa main en propriétés et en territoires, et lui faire constater la puissance et la gloire de son père, le roi Sabour, tout en lui prouvant combien le roi Sabour était plus riche et plus grand que son père à elle, le roi de Sana ! Il commença donc par atterrir au milieu d’un beau jardin, situé hors de la ville, où le roi son père avait l’habitude de venir se distraire et respirer le bon air, conduisit la jeune fille dans le pavillon d’été, surmonté d’une coupole, que le roi avait fait construire et apprêter pour lui-même, et lui dit : « Je vais te laisser un moment ici pour aller prévenir mon père de notre arrivée. En attendant, je te charge de veiller sur le cheval d’ébène que je laisse à la porte, et de ne pas le perdre de vue. Et moi je t’enverrai bientôt un messager pour t’emmener d’ici et te conduire au palais spécial que je vais faire préparer pour toi seule ! » Et la jeune fille, en entendant ces paroles, fut charmée à l’extrême et comprit qu’en effet elle ne devait entrer en ville qu’avec les honneurs et les hommages dus à son rang ! Puis le prince prit congé d’elle et se dirigea vers le palais du roi son père.
Lorsque le roi Sabour vit arriver son fils, il faillit mourir de joie et d’émotion et, après les embrassades et les souhaits de bienvenue, lui reprocha, en pleurant, son départ qui les avait tous mis aux portes du tombeau. Après quoi, Kamaralakmar lui dit : « Devine un peu qui j’ai amené de là-bas avec moi ? » Il répondit : « Par Allah ! je ne devine pas ! » Il dit : « La fille même du roi de Sana, l’adolescente la plus accomplie de la Perse et de l’Arabie ! Je l’ai laissée pour le moment hors de la ville, dans notre jardin, et je viens te prévenir que tu peux faire préparer de suite le cortège qui doit aller la chercher et qui devra être assez splendide pour lui donner dès l’abord une haute idée de ta puissance, de ta grandeur et de tes richesses ! » Et le roi répondit : « Avec joie et générosité, pour ton plaisir ! » Et aussitôt il donna l’ordre de décorer la ville et de l’orner avec les plus belles décorations et les plus beaux ornements ; et lui-même, après avoir constitué un cortège extraordinaire, se mit à la tête de ses cavaliers chamarrés, toutes bannières éployées, et sortit à la rencontre de la princesse Scharasennahar, en traversant tous les quartiers de la ville au milieu de tous les habitants massés sur plusieurs rangs, précédé de joueurs de fifre, de clarinette, de timbale et de tambour et suivi de la foule immense des gardes, des soldats, des gens du peuple, des femmes et des enfants.
De son côté le prince Kamaralakmar ouvrit ses coffres, ses cassettes et ses trésors, et en tira ce qu’il y avait de plus beau en joyaux, bijouteries et autres choses merveilleuses dont se parent les fils des rois afin de déployer leur faste, leurs richesses et leur splendeur ; et il fit préparer pour la jeune fille un immense baldaquin en brocarts rouges, verts et jaunes, au milieu duquel étant dressé un trône d’or étincelant de pierreries ; et il fit ranger sur les degrés de cet immense baldaquin, surmonté d’un dôme en soies dorées, de jeunes esclaves indiennes, grecques et abyssines, les unes assises et les autres debout, tandis qu’autour du trône se tenaient quatre autres esclaves blanches avec de grands éventails en plumes d’oiseaux d’une espèce extraordinaire. Et des nègres nus jusqu’à la ceinture portèrent le baldaquin sur leurs épaules ou suivirent le cortège, entourés d’une population encore plus dense et, au milieu des cris de joie de tout un peuple et des lu-lu perçants jetés par les gosiers des femmes assises dans le baldaquin et de toutes celles qui se pressaient à l’entour, prirent la route des jardins.
Quant à Kamaralakmar, il ne put se résoudre à accompagner le cortège au pas, et, lançant son cheval à une allure de course, il prit par le chemin le moins long et arriva en quelques instants au pavillon où il avait laissé la princesse, fille du roi de Sana. Et il la chercha partout ; mais il ne trouva pas plus la princesse que le cheval d’ébène.
Alors, Kamaralakmar, à la limite du désespoir, se donna de grands coups au visage, mit en pièces ses vêtements et se mit à courir sans but et à rôder comme un fou dans le jardin, en jetant de grands cris et en appelant de toute la force de son gosier. Mais ce fut en vain !
Au bout d’un certain temps il finit par se calmer un peu et rentrer dans sa raison ; et il se dit : « Comment a-t-elle pu connaître le secret de la manœuvre du cheval, alors que moi je lui ai rien appris à ce sujet ? Il se peut donc que ce soit justement le savant persan, le constructeur du cheval, qui soit venu tomber sur elle à l’improviste et l’enlever, pour se venger du traitement à lui infligé par mon père ! » Et aussitôt il courut trouver les gardiens du jardin et leur demanda…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT VINGT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et aussitôt il courut trouver les gardiens du jardin et leur demanda : « Avez-vous vu quelqu’un passer par ici ou traverser le jardin ? Dites-moi la vérité ou je fais sauter vos têtes à l’instant ! » Les gardiens furent terrifiés par ses menaces, et répondirent d’une seule voix : « Par Allah ! nous n’avons vu personne entrer dans le jardin, si ce n’est le savant persan, qui est venu ici pour cueillir des herbes curatives et que nous n’avons pas encore vu ressortir ! » À ces paroles, le prince acquit la certitude que c’était le Persan qui avait enlevé la jeune fille, et il en fut à la limite de la consternation et de la perplexité ; et, bien ému et déconcerté, il alla au devant du cortège et, se tournant vers son père, lui raconta ce qui était arrivé et lui dit : « Prends tes troupes et retourne avec elles à ton palais ; quant à moi je n’y retournerai plus avant que je n’aie éclairci cette affaire noire ! » En entendant ces paroles et en voyant cette résolution de son fils, le roi se mit à pleurer, à se lamenter et à se frapper la poitrine, et lui dit : « Ô mon fils, de grâce ! calme ta colère, maîtrise ton chagrin et reviens avec nous à la maison. Et alors tu verras quelle fille de roi ou de sultan tu désires avoir, et moi je te la donnerai en mariage ! » Mais Kamaralakmar ne voulut point prêter la moindre attention aux paroles de son père ni écouter ses prières, lui dit quelques mots d’adieu et s’en alla sur son cheval, tandis que le roi, à la limite du désespoir, s’en retournait à la ville au milieu des pleurs et des gémissements. Et leur joie fut ainsi changée en tristesse, en alarmes et en tourments. Et voilà pour tous ceux-là !
Mais pour ce qui est du magicien et de la princesse, voici !
Comme le destin l’avait décrété d’avance, le magicien persan était venu ce jour-là au jardin pour cueillir en effet des herbes curatives et des simples et des plantes aromatiques, et il sentit une odeur délicieuse de musc et autres parfums admirables ; aussi, mettant son nez au vent, il se dirigea du côté d’où s’en venait vers lui cette odeur extraordinaire. Or justement c’était l’odeur de la princesse qui se dégageait de la sorte et embaumait tout le jardin. Aussi le magicien, guidé par son odorat perspicace, ne tarda pas à arriver, après quelques tâtonnements, au pavillon même où se trouvait la princesse. Et quelle ne fut point sa joie de voir, dès le seuil, debout sur ses quatre pieds, le cheval magique, l’œuvre de ses mains ! Et quels ne furent point les frémissements de son cœur à la vue de cet objet dont la perte lui avait enlevé le goût du manger et du boire et le repos du sommeil ! Il se mit donc à l’examiner de tous côtés et le trouva intact et en bon état. Puis, comme il allait sauter dessus et lui donner son vol, il se dit en lui-même : « Il est d’abord nécessaire que je voie ce que le prince a bien pu apporter et laisser ici avec le cheval ! », et il pénétra dans le pavillon. Alors il vit, nonchalamment étendue sur le divan, la princesse qu’il prit d’abord pour le soleil à son lever dans un ciel tranquille. Et il ne douta pas un instant qu’il n’eût là devant les yeux quelque dame d’illustre naissance, et que le prince ne l’eût amenée sur le cheval et laissée dans ce pavillon, en attendant qu’il fût allé lui-même à la ville lui préparer un splendide cortège. Aussi il s’avança de son côté, se prosterna devant elle et embrassa la terre entre ses mains, alors qu’elle levait lentement les yeux vers lui, et, le trouvant extraordinairement horrible et hideux, se hâtait de les refermer pour éviter sa vue, et lui demandait : « Qui donc es-tu ? » Il répondit : « Ô ma maîtresse, je suis le messager envoyé vers toi par le prince Kamaralakmar, afin de te conduire à un autre pavillon, plus beau que celui-ci et plus proche de la ville ; car ma maîtresse, la reine, mère du prince, est aujourd’hui un peu indisposée et, comme elle ne veut pas tout de même, à cause de sa joie de ton arrivée, être devancée auprès de toi par personne, elle souhaite ce changement qui la dispensera d’une course trop prolongée. » Elle demanda : « Mais où est le prince ? » Le Persan répondit : « Il est en ville, avec le roi, et va bientôt arriver à ta rencontre en grand apparat, au milieu d’un cortège splendide ! » Elle dit : « Et toi ! dis-moi, est-ce que le prince n’aurait pas pu trouver quelque autre messager un peu moins hideux, pour me l’envoyer ? » À ces paroles, le magicien, bien que fort mortifié, se mit à rire dans le tablier ratatiné de sa figure jaune, et répondit : « Oui, certes, par Allah ! ô ma maîtresse, il n’y a point au palais de mamelouk aussi hideux que moi ! Seulement que la mauvaise apparence de ma physionomie et l’abominable laideur de ma figure ne t’induisent pas en erreur sur ma valeur ! Et puisses-tu un jour éprouver mes capacités et mettre à profit, comme le prince, les dons précieux que je possède. Et alors tu me loueras, tel que je suis ! Quant au prince, s’il m’a choisi, moi, pour me dépêcher vers toi, il l’a fait justement à cause de ma laideur et de ma dégoûtante physionomie ; et cela pour n’avoir rien à redouter, dans sa jalousie pour tes charmes et ta beauté ! Et ce ne sont pas les mamelouks, ni les jeunes esclaves, ni les beaux nègres, ni les eunuques, ni les serviteurs qui manquent au palais ! Grâce à Allah, leur nombre est incalculable ; et ils sont tous plus séduisants les uns que les autres…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vît apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … et ils sont tous plus séduisants les uns que les autres ! » Or ces paroles du magicien eurent le don de persuader la jeune fille, qui se leva aussitôt, mit sa main dans la main du vieux savant et lui dit : « Ô mon père, que m’as-tu apporté avec toi pour me le faire monter ? » Il répondit : « Ô ma maîtresse, tu monteras le cheval sur lequel tu es venue ! » Elle dit : « Mais je ne puis le monter toute seule ! » Alors il eut un sourire et comprit qu’elle était désormais sous sa puissance ; et il répondit : « Moi-même je monterai avec toi ! » Et il sauta sur son cheval, et prit en croupe la jeune fille qu’il serra bien fort contre lui et l’attacha à lui avec des liens, solidement, tandis qu’elle était loin de se douter de ce qu’il allait faire d’elle. Il tourna alors la cheville de l’ascension, et aussitôt le cheval se remplit de vent quant à son ventre, se mouvementa et s’agita en bondissant comme les vagues de la mer, puis prit avec eux son essor en s’élevant comme un oiseau dans les airs, et, en un instant, laissa loin derrière lui la ville et les jardins.
À cette vue, la jeune fille, bien surprise, s’écria : « Ho, toi ! où vas-tu de la sorte sans exécuter les ordres de ton maître ? » Il répondit : « Mon maître ! Et qui est mon maître ? » Elle dit : « Le fils du roi ! » Il demanda : « Quel roi ? » Elle dit : « Je ne sais pas ! » À ces paroles, le magicien éclata de rire et dit : « Si c’est du jeune Kamaralakmar que tu veux parler, qu’Allah le confonde ! c’est une espèce de stupide coquin, un pauvre garçon, en somme ! » Elle s’écria : « Malheur à toi, ô barbe de malheur ! Comment oses-tu parler de la sorte de ton maître, et lui désobéir ! » Le magicien répondit : « Je te répète que ce jouvenceau-là n’est point mon maître ! Sais-tu, toi, qui je suis ? » La princesse dit : « Je ne sais rien de toi si ce n’est ce que tu m’en as dit toi-même ! » Il sourit et dit : « Tout ce que je t’ai dit n’était qu’un stratagème tramé par moi contre toi et le fils du roi ! Sache, en effet, que ce vaurien avait réussi à me voler ce cheval, l’œuvre de mes mains, sur lequel tu te trouves maintenant ; et il m’a ainsi longtemps brûlé le cœur et fait pleurer sa perte. Mais me voici redevenu le maître de mon bien, et à mon tour je brûle le cœur de ce voleur et je fais pleurer ses yeux sur ta perte ! Raffermis donc ton âme de courage et sèche et rafraîchis tes yeux, car moi je serai pour toi d’un bien plus grand profit que ce jeune fou. Je suis, en outre, généreux et puissant et riche ; mes serviteurs et mes esclaves t’obéiront comme à leur maîtresse ; je te vêtirai des plus belles robes et t’ornerai des plus beaux ornements ; et je réaliserai le moindre de tes désirs avant même qu’il ne soit exprimé ! »
Eh entendant ces paroles, la jeune fille se frappa le visage et se mit à sangloter ; puis elle dit : « Ah ! mon malheur ! Ah ! Hélas ! Je viens de perdre mon bien-aimé ; et j’ai perdu mon père et ma mère ! » Et elle continua à verser des larmes bien amères et bien abondantes sur ce qui lui arrivait, tandis que le magicien dirigeait le vol de son cheval vers le pays des Roums, et, après un long mais rapide voyage, descendait atterrir sur une verte prairie abondante en arbres et en eaux courantes.
Or, cette prairie était située près d’une cité où régnait un roi très puissant. Et justement ce jour-là le roi sortit respirer l’air hors de la ville, et dirigea sa promenade du côté de cette prairie. Et il aperçut le savant qui se tenait à côté du cheval et de la jeune fille. Aussi, avant que le magicien eût le temps de se garer, les esclaves du roi s’étaient déjà précipités sur lui et l’avaient enlevé lui, la jeune fille et le cheval, et les avaient tous amenés entre les mains du roi.
Lorsque le roi vit la laideur dégoûtante du vieux et son horrible physionomie, et la beauté de la jeune fille et ses charmes ravissants, il dit : « Ô ma maîtresse, quelle parenté t’unit donc à ce très vieil homme-là qui est si hideux ? » Mais ce fut le Persan qui se hâta de répondre : « Elle est mon épouse et la fille de mon oncle ! » Alors la jeune fille, à son tour, de répondre, en démentant le vieux : « Ô roi, par Allah ! je ne connais guère ce laid-là ! Et il n’est pas mon époux du tout ! Mais c’est un perfide sorcier qui m’a enlevée par la ruse et par la force ! »
À ces paroles de la jeune fille, le roi des Roums donna l’ordre à ses esclaves de donner la bastonnade au magicien ; et ils la lui donnèrent d’une manière si soignée qu’il faillit expirer sous les coups. Après quoi le roi le fit emporter à la ville et jeter dans le cachot, tandis que lui-même emmenait la jeune fille et faisait transporter le cheval magique dont il était loin de soupçonner les meilleures vertus ou le maniement secret. Et voilà pour le magicien et la princesse !
Quant au prince Kamaralakmar, il se vêtit d’habits de voyage, prit avec lui ce dont il avait besoin en vivres et en argent, et se mit en route, le cœur bien triste et l’esprit dans un bien mauvais état. Et il se mit à la recherche de la princesse, en voyageant de pays en pays et de ville en ville ; et partout il s’enquérait du cheval d’ébène, alors que tous ceux qu’il interrogeait s’étonnaient à l’extrême de son langage et trouvaient ses questions tout à fait énormes et extravagantes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT VINGT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… et trouvaient ses questions tout à fait énormes et extravagantes. Et il continua à agir de la sorte un très long espace de temps, en faisant des recherches de plus en plus actives et en demandant des renseignements de plus en plus nombreux, sans arriver à avoir aucune nouvelle qui pût le mettre sur la voie. Après tout cela il finit par arriver à la ville de Sana, où régnait le père de Schamsennahar, et se renseigna sur son arrivée ; mais nul n’en avait plus entendu parler et ne put lui dire ce qu’elle était devenue depuis son enlèvement ; et on lui dit dans quel état d’anéantissement et de désespoir était enseveli le vieux roi. Alors il continua sa route et se dirigea vers le pays des Roums, en continuant toujours à s’enquérir de la princesse et du cheval d’ébène partout où il passait et à toutes les étapes qu’il faisait.
Or, un jour il s’arrêta en route à un khân où il vit une troupe de marchands assis en rond à causer entre eux ; et il s’assit lui aussi à côté d’eux, et entendit l’un d’eux qui disait : « Ô mes amis, tout dernièrement il vient de m’arriver la chose la plus prodigieuse d’entre les choses prodigieuses ! » Et tous lui demandèrent : « Qu’est-ce donc ? » Il répondit : « J’étais allé avec mes marchandises dans le district tel à la ville telle (et il dit le nom de la ville où se trouvait la princesse) et j’entendis les habitants qui se racontaient les uns aux autres une chose bien étrange qui venait d’avoir lieu. Ils disaient que le roi de la ville, étant sorti un jour à la chasse à courre avec sa suite, avait rencontré un vieux bien dégoûtant debout à côté d’une jeune fille à la beauté incomparable et d’un cheval d’ébène et d’ivoire ! » Et le marchand raconta à ses compagnons, qui s’en émerveillèrent extrêmement, l’histoire en question qu’il n’y a aucune utilité à répéter.
Lorsque Kamaralakmar eut entendu cette histoire, il ne douta pas un instant qu’il ne s’agît là de sa bien-aimée et du cheval magique. Aussi, après s’être bien informé du nom et de la situation de la ville, il se mit aussitôt en route en se dirigeant de ce côté-là, et voyagea sans sursis jusqu’à ce qu’il y fût arrivé. Mais lorsqu’il voulut en franchir les portes, les gardes s’emparèrent de lui pour le conduire, selon les usages en cours dans ce pays, devant leur roi, afin qu’il fût interrogé sur sa condition, sur la cause de sa venue dans le pays et sur son métier. Or ce jour-là il était déjà fort tard quand le prince arriva ; et les gardes, sachant le roi très occupé, remirent la présentation du jeune homme au lendemain, et le conduisirent à la prison pour qu’il y passât la nuit. Mais lorsque les geôliers virent sa beauté et sa gentillesse, ils ne purent se résoudre à l’enfermer, et le prièrent de s’asseoir au milieu d’eux et de leur tenir compagnie ; et ils l’invitèrent à partager avec eux leur repas. Puis lorsqu’ils eurent mangé, ils se mirent à causer, et demandèrent au prince : « Ô jouvenceau, de quel pays es-tu ? » Il répondit : « Du pays de Perse, terre des Khosroès ! » À ces paroles, les geôliers éclatèrent de rire et l’un d’eux dit au jeune homme : « Ô natif du pays des Khosroès, serais-tu, toi, un aussi prodigieux menteur que ton compatriote qui est enfermé dans nos cachots ? » Et un autre dit : « En vérité, j’ai vu bien des gens et j’ai entendu leurs discours et leurs histoires, et j’ai examiné leur manière d’être, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi extravagant que ce vieux fou enfermé ! » Et un autre ajouta : « Et moi, par Allah ! je n’ai jamais rien vu d’aussi hideux que sa figure ou d’aussi laid et dégoûtant que sa physionomie ! » Le prince demanda : « Et qu’avez-vous vu de ses mensonges ? » Ils répondirent : « Il prétend être un savant et illustre médecin ! Or le roi l’avait trouvé, dans une partie de chasse, en compagnie d’une jeune fille et d’un cheval merveilleux en ébène et en ivoire. Et le roi s’éprit à l’extrême de la beauté de la jeune fille, et voulut se marier avec elle ; mais elle devint subitement folle ! Si donc ce vieux savant était, comme il le prétend, un illustre médecin, il aurait trouvé le moyen de la guérir ; car le roi a fait tout le possible pour découvrir un remède qui pût guérir la maladie de cette jeune fille, et voilà déjà un an qu’il dépense pour ce cas d’immenses richesses en frais de médecins et d’astrologues, mais sans résultat ! Quant au cheval d’ébène, il est enfermé dans les trésors du roi ; et le vieux laid est ici, en prison ; et il ne cesse de gémir et de se lamenter toute la nuit, tellement qu’il nous empêche de dormir ! »
En entendant ces paroles, Kamaralakmar se dit : « Me voici enfin sur la voie tant souhaitée. Il me faut maintenant trouver le moyen d’arriver au but ! » Mais bientôt les geôliers, voyant venir pour eux l’heure de dormir, le conduisirent à l’intérieur de la prison et refermèrent la porte sur lui. Alors il entendit le savant qui pleurait et gémissait et déplorait son malheur en langue persane, disant : « Hélas ! quelle calamité pour moi de n’avoir pas su mieux arranger mon plan, et de m’être ainsi perdu moi-même, sans avoir réalisé mes souhaits ni satisfait mon désir sur cette jeune fille ! Tout cela m’est arrivé à cause de mon peu de jugement, et pour avoir ambitionné ce qui n’était guère fait pour moi ! » Alors Kamaralakmar s’adressa à lui en persan et lui dit : « Jusques à quand ces pleurs et ces lamentations ? Crois-tu donc être le seul à avoir éprouvé des malheurs ? » Et le savant, encouragé par ces paroles, lia conversation avec lui et se mit à se plaindre à lui, sans le connaître, de ses malheurs et de ses infortunes ! Et ils passèrent de la sorte la nuit à causer entre eux comme deux amis.
Le lendemain matin, les geôliers vinrent tirer Kamaralakmar de la prison, et l’amenèrent devant le roi, en disant : « Ce jeune homme…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… et ramenèrent devant le roi, en disant : « Ce jeune homme est arrivé hier fort tard dans la soirée, et nous n’avons pu l’amener en ta présence, ô roi, pour qu’il fût interrogé ! » Alors le roi lui demanda : « D’où viens-tu ? Quel est ton nom ? Quelle est ta profession ? Et quel est le motif de ta venue dans notre ville ? » Il répondit : « Pour ce qui est de mon nom, je m’appelle en persan Harjah ! Quant à mon pays, c’est la Perse ! Et de mon métier, je suis un savant d’entre les savants, spécialement versé dans la médecine et l’art de guérir les fous et les aliénés. Et c’est dans ce but que je parcours les contrées et les villes pour exercer mon art et acquérir de nouvelles connaissances à ajouter à celles que je possède déjà ! Et je fais tout cela sans l’accoutrement ordinaire des astrologues et des savants : sans élargir mon turban ni en augmenter le nombre de tours, sans allonger mes manches, sans tenir sous mon bras un gros paquet de livres, sans me noircir les paupières de kohl noir, sans porter au cou un immense chapelet aux gros grains par milliers ; et je guéris mes malades sans marmonner des paroles en un langage mystérieux, sans leur souffler au visage et sans leur mordre le lobe de l’oreille ! Et telle est, ô roi, ma profession ! »
Lorsque le roi eut entendu ces paroles, il se réjouit d’une joie considérable, et lui dit : « Ô très excellent médecin, tu arrives chez nous au moment où nous avons le plus besoin de tes services ! » Et il lui raconta le cas de la jeune fille, et ajouta : « Si tu veux la traiter et si tu la guéris de la folie où l’ont jetée les gens malfaisants, tu n’auras qu’à me demander ce que tu souhaites ; et tout te sera accordé ! » Il répondit : « Qu’Allah accorde ses plus grandes grâces et faveurs à notre maître le roi ! Mais il te faut d’abord me narrer par le détail toutes les choses que tu as constatées de sa folie, et me dire depuis combien de jours elle est dans cet état, sans oublier de me raconter comment tu l’as eue, elle, ainsi que le vieux Persan et le cheval d’ébène ! » Et le roi lui raconta toute l’histoire depuis le commencement jusqu’à la fin, et ajouta : « Quant au vieux, il est dans un cachot ! » Il demanda : « Et le cheval ? » Il répondit : « Il est chez moi, précieusement gardé dans un de mes pavillons ! » Et Kamaralakmar se dit en lui-même : « Il me faut, avant toutes choses, revoir le cheval et m’assurer de mes yeux de l’état où il se trouve. S’il est intact et en bon état, tout est gagné et mon but atteint ; mais si son mécanisme est détérioré, il me faudra songer à quelque autre moyen de délivrer ma bien-aimée ! » Alors il se tourna vers le roi et lui dit : « Ô roi, il faut d’abord que je voie le cheval ; car il est probable que je trouverai, en l’examinant, quelque chose qui me servira pour la guérison de la jeune fille ! » Il répondit : « Avec plaisir et bon cœur ! » et il le prit par la main et le conduisit à l’endroit où se trouvait le cheval d’ébène. Et le prince se mit à faire le tour du cheval, l’examina attentivement, et, l’ayant trouvé intact et en bon, état, il se réjouit fort et dit au roi : « Qu’Allah favorise et exalte le roi ! Me voici prêt à aller trouver la jeune fille, pour voir ce qu’elle peut bien avoir ! Et j’espère, avec le secours d’Allah, arriver à la guérir par ma main guérissante et par l’entremise de ce cheval de bois ! » Et il recommanda aux gardes de faire bien attention au cheval, et se dirigea avec le roi vers l’appartement de la princesse.
Dès qu’il eut pénétré dans la chambre où elle se tenait, il la vit qui se tordait les mains, et se frappait la poitrine, et se jetait et se roulait par terre, en mettant ses vêtements en lambeaux, selon son habitude. Et il vit bien que ce n’était là qu’une folie simulée et que ni genn ni hommes ne lui avaient malmené la raison, au contraire ! Et il comprit qu’elle ne faisait tout cela que dans le but d’empêcher quiconque de l’approcher !
À cette vue, Kamaralakmar s’avança vers elle et lui dit : « Ô enchanteresse des Trois Mondes, loin de toi les peines et les tourments ! » Et elle, l’ayant regardé, le reconnut aussitôt et fut dans une joie si énorme qu’elle poussa un grand cri et tomba sans connaissance. Et le roi ne douta pas que cette crise ne fût l’effet de la crainte que lui inspirait le médecin. Mais Kamaralakmar se pencha sur elle et, l’ayant ranimée, lui dit à voix basse : « Ô Schamsennahar, ô noir de mon œil, noyau de mon cœur, prends soin de ta vie et de ma vie et aie du courage et un peu de patience encore ; car notre situation réclame une grande prudence et des précautions infinies, si nous voulons nous tirer des mains de ce roi tyrannique. Moi, je vais de suite commencer par le raffermir dans son idée à ton sujet, à savoir que tu es possédée par les genn et que c’est de là que découle ta folie ; mais je lui dirai que je viens de te guérir à l’instant au moyen des vertus mystérieuses que je possède ! Toi, seulement, il te faut lui parler avec calme et aménité pour lui donner ainsi la preuve de ta guérison par mon entremise ! Et de la sorte notre but sera atteint, et nous pourrons réaliser notre plan ! » Et la jeune fille répondit : « J’écoute et j’obéis ! »
Alors Kamaralakmar s’approcha du roi, qui se tenait au fond de la pièce, et, avec un visage de bonne nouvelle, lui dit : « Ô roi fortuné, j’ai pu, grâce à ta bonne destinée, reconnaître sa maladie et trouver le remède de sa maladie. Et je te l’ai guérie ! Tu peux donc t’approcher d’elle et lui parler doucement et avec bonté, et lui promettre ce que tu as à lui promettre ; et tout ce que tu désireras d’elle sera accompli ! » Et le roi, à la limite de l’émerveillement, s’approcha de la jeune fille, qui aussitôt se leva pour lui et embrassa la terre entre ses mains, puis lui souhaita la bienvenue et lui dit : « Ta servante est confuse de l’honneur que tu lui fais en lui rendant visite aujourd’hui ! » Et le roi, en entendant et voyant tout cela, fut sur le point de s’envoler de joie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT TRENTIÈME NUIT
Elle dit :
… fut sur le point de s’envoler de joie, et donna l’ordre aux servantes, aux esclaves femmes et aux eunuques de se mettre à son service, de la conduire au hammam, et de lui préparer les robes et les ornements. Et les femmes et les esclaves entrèrent, et lui firent leurs salams ; et elle leur rendit les salams de la façon la plus gentille et du ton de voix le plus doux. Alors elles la vêtirent d’habits royaux, lui entourèrent le cou d’un collier de pierreries et la conduisirent au hammam où elles la baignèrent et la servirent pour, ensuite, la ramener à son appartement, telle la lune à son quatorzième jour. Tout cela !
Aussi le roi, la poitrine dilatée à l’extrême et l’âme épanouie, dit au jeune prince : « Ô sage, ô savant médecin, ô doué de philosophie, tout ce qui nous arrive là d’heureux est dû à tes mérites et à ta bénédiction. Qu’Allah augmente sur nous les bénéfices de ton souffle guérisseur ! » Il répondit : « Ô roi, pour l’achèvement de la guérison, il est nécessaire que tu sortes avec toute ta suite, tes gardes et tes troupes pour aller vers l’endroit où tu avais trouvé la jeune fille, en l’emmenant elle-même avec toi, et en faisant transporter là-bas le cheval d’ébène qui était avec elle, et qui n’est pas autre chose qu’un genni démoniaque ; et c’est justement lui qui la possédait et la rendait folle. Et alors moi je ferai là-bas les exorcismes nécessaires ; sans cela ce genni reviendra la posséder au commencement de chaque mois, et tout serait à recommencer ; tandis que maintenant, moi, une fois que je m’en serai rendu tout à fait maître, je l’enfermerai et le tuerai ! » Et le roi des Roums s’écria : « De tout cœur amical et comme hommages dus ! » Et aussitôt, accompagné du prince et de la jeune fille et suivi de toutes ses troupes, il prit le chemin de la prairie en question.
Lorsqu’ils furent tous arrivés, Kamaralakmar donna l’ordre de faire monter la jeune fille sur le cheval d’ébène, et de les tenir tous deux assez éloignés à une assez grande distance pour n’être point distinctement aperçus par le roi et ses troupes. Et on exécuta l’ordre à l’instant. Alors il dit au roi des Roums : « Maintenant, avec ta permission et ton bon vouloir, je vais procéder aux fumigations et aux conjurations, et m’emparer de cet ennemi du genre humain, de façon qu’il ne puisse plus être nuisible désormais ! Après quoi je monterai moi aussi sur ce cheval de bois qui semble être d’ébène, et je mettrai la jeune fille derrière moi. Et alors tu verras le cheval s’agiter dans tous les sens et se mouvementer pour aussitôt prendre son élan et venir en courant s’arrêter entre tes mains. Et tu auras de la sorte la preuve que nous l’avons tout à fait en notre puissance. Après cela tu pourras faire tout ce que tu veux avec la jeune fille ! »
Lorsque le roi des Roums entendit ces paroles il se réjouit à la limite de la joie, tandis que Kamaralakmar montait sur le cheval et attachait solidement derrière lui la jeune fille. Et pendant que tous les yeux étaient dirigés vers lui et le regardaient faire, il tourna la cheville de l’ascension ; et le cheval, prenant son essor, s’éleva avec eux en ligne droite en disparaissant au plus haut des airs.
Le roi des Roums, qui était loin de se douter de la vérité, continua à rester dans la prairie avec ses troupes, et à attendre leur retour, pendant une demi-journée. Mais, comme il ne les voyait pas revenir, il finit par se décider à aller les attendre dans son palais. Et ce fut également une attente vaine. Alors il pensa au vieux laid qui était enfermé dans le cachot et, l’ayant fait venir en sa présence, lui dit : « Ah ! vieux traître, ah ! cul de singe, comment as-tu osé me cacher le mystère de ce cheval ensorcelé et possédé par les genn démoniaques ? Voilà maintenant qu’il vient d’enlever dans les airs le médecin qui a guéri la jeune fille de sa folie, et la jeune fille elle-même. Et qui sait ce qui va leur arriver ! De plus je te rends responsable de la quantité de bijoux et de choses précieuses, qui ont la valeur d’un trésor, dont je l’avais fait orner à sa sortie du hammam ! Or à l’instant ta tête va sauter de ton corps ! » Et, sur un signe du roi, le porte-glaive s’avança et, d’un seul tournoiement, fit du Persan deux Persans ! Et voilà pour tous ceux-là !
Quant au prince Kamaralakmar et à la princesse Schamsennahar, ils continuèrent tranquillement leur rapide voyage aérien, et arrivèrent en toute sécurité à la capitale du roi Sabour. Ils atterrirent cette fois, non plus dans le pavillon du jardin, mais sur la terrasse même du palais. Et le prince se hâta de mettre en lieu sûr sa bien-aimée pour aller au plus vite aviser son père et sa mère de leur arrivée. Il entra donc dans l’appartement où, plongés dans les larmes et le désespoir, se tenaient le roi, la reine et les trois princesses, ses sœurs, et leur souhaita la paix en les embrassant, tandis que, à sa vue, leur âme se remplissait de bonheur et que leur cœur s’allégeait du poids des afflictions et des tourments.
Alors, pour fêter ce retour et la venue de la princesse, fille du roi de Sana, le roi Sabour donna de grands festins aux habitants de la ville et des réjouissances qui durèrent un mois entier. Et Kamaralakmar entra dans la chambre nuptiale et se réjouit avec la jeune fille durant de longues nuits bénies. Après quoi le roi Sabour, pour avoir désormais l’esprit tranquille, fit mettre en pièces le cheval d’ébène et détruisit lui-même son mécanisme.
De son côté Kamaralakmar écrivit une lettre…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT TRENTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… De son côté Kamaralakmar écrivit une lettre au roi de Sana, père de son épouse, où il le mettait au courant de toute leur histoire, lui annonçait leur mariage et leur séjour ensemble dans le bonheur le plus complet. Et il envoya cette lettre par un messager accompagné de porteurs de présents magnifiques et de choses rares d’une grande valeur. Et le messager arriva à Sana, dans l’Yamân, et remit la lettre et les cadeaux au père de la princesse, qui, ayant lu la lettre, se réjouit à la limite de la joie et accepta les cadeaux. Après quoi il prépara à son tour de fort riches présents pour son gendre, le fils du roi Sabour, et les lui envoya avec le même messager.
Au reçu des présents du père de son épouse, le beau prince Kamaralakmar se réjouit extrêmement ; car il lui eût été pénible de savoir le vieux roi de Sana mécontent de leur conduite à tous deux. Et même il prit pour règle de lui envoyer chaque année une nouvelle lettre et de nouveaux présents. Et il continua à agir de la sorte jusqu’à la mort du roi de Sana. Puis, quand son propre père, le roi Sabour, mourut à son tour, il lui succéda sur le trône du royaume, et commença son règne en mariant sa plus jeune sœur, celle qu’il aimait tant, avec le nouveau roi de l’Yamân. Après quoi il gouverna son royaume avec sagesse et ses sujets avec équité ; et de cette façon il acquit la suprématie sur toutes les contrées, et la fidélité de cœur de tous les habitants. Et lui et son épouse Schamsennahar continuèrent à vivre dans la vie la plus délicieuse, la plus douce, la plus calme et la plus tranquille, jusqu’à ce vînt à eux la Destructrice des délices, la Séparatrice des sociétés et des amis, la Pillarde des palais et des cabanes, la Bâtisseuse des tombeaux et la Pourvoyeuse des cimetières !
Et maintenant gloire au Seul Vivant qui ne meurt point et qui tient dans Ses mains la domination des Mondes et l’empire du Visible et de l’Invisible !
— Et Scharazade, la fille du vizir, ayant ainsi terminé cette histoire, se tut. Alors le roi Schahriar lui dit : « Cette histoire, Schahrazade, est prodigieuse ! Et je voudrais bien connaître le mécanisme extraordinaire de ce cheval d’ébène ! » Schahrazade dit : « Hélas ! il a été détruit ! » Et Schahriar dit : « Par Allah ! mon esprit est bien torturé de cette recherche-là ! » Schahrazade répondit : « Alors, ô Roi fortuné, pour te reposer l’esprit, je suis disposée, si toutefois tu me le permets, à te raconter l’histoire la plus dilatante que je connaisse, celle où il est question de Dalila-la-Rouée et de sa fille Zeinab-la-Fourbe ! » Et le roi Schahriar s’écria : « Par Allah ! tu peux parler ! Car je ne connais pas cette histoire-là ! Après cela je me déciderai quant à ta tête ! »
Alors Schahrazade dit :
HISTOIRE DES ARTIFICES DE
DALILA-LA-ROUÉE ET DE SA FILLE
ZEINAB-LA-FOURBE AVEC
AHMAD-LA-TEIGNE, HASSAN-LA-PESTE
ET ALI VIF-ARGENT
On raconte, ô Roi fortuné, qu’il y avait à Baghdad,
au temps du khalifat Haroun Al-Rachid, un
homme appelé Ahmad-la-Teigne et un autre appelé
Hassan-la-Peste, tous deux réputés pour leur maîtrise
en ruses et en larcins. Leurs exploits en ce
genre-là étaient tout à fait prodigieux : c’est pourquoi
le khalifat, qui savait tirer parti de tous les
genres de talents, les appela à lui et les nomma
chefs de la police. À cet effet il les investit de leur
charge en leur donnant à chacun une robe d’honneur,
des émoluments de mille dinars d’or par mois,
et une garde de quarante solides cavaliers. De cette
façon Ahmad-la-Teigne était chargé de la sûreté de
la ville du côté de la terre, et Hassan-la-Peste du
côté de l’eau. Et tous deux, dans les grandes cérémonies, marchaient aux côtés du khalifat, l’un à sa
droite et l’autre à sa gauche.
Or, le jour de leur nomination à cet emploi, ils sortirent avec le wali de Baghdad, l’émir Khaled, accompagnés de leurs quarante gaillards à cheval, et précédés d’un héraut qui criait le décret du khalifat et disait : « Ô vous tous, habitants de Baghdad, par ordre du khalifat ! sachez que le chef de la police de la Main Droite n’est autre désormais qu’Ahmad-la-Teigne, et que le chef de la police de la Main Gauche n’est autre que Hassan-la-Peste ! Et vous leur devez l’obéissance et le respect en toute occasion ! »
Dans le même temps vivait à Baghdad une vieille redoutable, appelée Dalila, et connue, depuis, sous le nom de Dalila-la-Rouée, qui avait deux filles : l’une mariée et mère d’un petit garnement nommé Mahmoud-l’Avorton, et l’autre, encore célibataire, et connue depuis sous le nom de Zeinab-la-Fourbe. Le mari de la vieille Dalila avait été autrefois un grand personnage, directeur des pigeons qui servaient à porter les messages et les lettres par tout l’empire, et dont l’existence était plus chère et plus précieuse au khalifat, à cause des services qu’ils rendaient, que celle même de ses propres enfants. Aussi l’époux de Dalila avait-il honneurs et prérogatives, et des émoluments de mille dinars par mois. Mais il était mort et oublié, et avait laissé cette vieille femme et ces deux filles-là ! Et, en vérité, cette Dalila était une vieille experte en roueries, artifices, larcins, fourberies, et expédients de toutes sortes, une sorcière capable de circonvenir le serpent en l’attirant hors de son repaire, et de donner à Éblis lui-même des leçons de ruse et de tromperie.
Donc, le jour de l’investiture d’Ahmad-la-Teigne et de Hassan-la-Peste dans les fonctions de chefs de la police, la jeune Zeinab entendit le crieur qui annonçait la chose à la population, et elle dit à sa mère : « Vois, ô mère, ce gredin d’Ahmad-la-Teigne ! Il vint jadis à Baghdad en fugitif, expulsé d’Égypte, et il n’y a point d’expédients et de hauts exploits qu’il n’ait commis ici depuis son arrivée. Et il s’est de cette façon rendu si fameux que le khalifat vient de l’investir de la charge de chef de la police de Sa Main Droite, tandis que son compère Hassan-la-Peste, ce galeux au crâne chauve comme une courge, est investi de la charge de chef de la police de Sa Main Gauche ! Et chacun d’eux a nappe servie de jour et de nuit au palais du khalifat, et une garde, et des émoluments mensuels de mille dinars, et les honneurs et toutes les prérogatives. Et nous, hélas ! nous restons dans notre maison, sans emploi et dans l’oubli, sans honneurs ni privilèges, et sans personne qui se préoccupe de notre sort ! » Et la vieille Dalila hocha la tête et dit : « Oui, par Allah ! ma fille ! » Alors Zeinab lui dit : « Lève-toi donc, ô mère, et trouve-nous quelque expédient capable de nous donner de la renommée ou quelque tour qui nous rende si fameuses et si notoires dans Baghdad, que le bruit en arrive aux oreilles du khalifat qui nous rendra les appointements et les prérogatives de notre père ! »
Lorsque Zeinab-la-Fourbe eut dit ces paroles à sa mère Dalila-la-Rouée, celle-ci lui répondit : « Par la vie de ta tête, ô ma fille…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT TRENTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
« … Par la vie de ta tête, ô ma fille, je te promets de jouer dans Baghdad quelques tours de tout à fait première qualité, qui surpasseront, et de beaucoup, tous ceux joués par Ahmad-la-Teigne et Hassan-la-Peste ! » Et elle se leva à l’heure et à l’instant, se couvrit le visage du litham, s’habilla comme un pauvre soufi en revêtant un grand manteau aux manches si prodigieuses qu’elles descendaient jusqu’à ses talons, et s’entoura la taille d’une large ceinture de laine ; puis elle prit une aiguière qu’elle remplit d’eau jusqu’au col, et mit trois dinars dans l’ouverture qu’elle boucha avec un tampon en fibres de palmier ; ensuite elle s’entoura les épaules et la poitrine de plusieurs rangs de gros chapelets aux grains aussi lourds qu’une charge de fagots, et prit à la main une bannière semblable à celle que portent les soufis mendiants, faite de quelques lambeaux de chiffons rouges, jaunes et verts ; et, accoutrée de la sorte, elle sortit de sa maison en disant à haute voix : « Allah ! Allah ! », priant ainsi avec la langue, tandis que son cœur courait dans le champ de courses des démons, et que sa pensée s’appesantissait dans la recherche d’expédients pervers et redoutables.
Elle parcourut ainsi les divers quartiers de la ville, en passant d’une rue à une autre rue jusqu’à ce qu’elle fût arrivée à une impasse pavée de marbre et balayée et arrosée, au fond de laquelle elle vit une grande porte surmontée d’une magnifique corniche d’albâtre, sur le seuil de laquelle était assis le portier, un Moghrabin fort proprement habillé. Et cette porte était en bois de sandal garnie de solides anneaux en bronze et d’un cadenas en argent. Or cette maison appartenait au chef des gardes du khalifat, un homme fort considéré et propriétaire de grands biens, meubles et immeubles, auquel il était alloué de gros émoluments pour ses fonctions ; mais c’était aussi un homme très violent et mal maniéré ; et c’est pourquoi on l’appelait Mustapha Fléau-des-Rues, vu que chez lui les coups précédaient toujours la parole ! Il était marié avec une jouvencelle charmante qu’il aimait beaucoup et à qui il avait juré, lors de la nuit de sa pénétration première, de ne jamais prendre une seconde femme de son vivant et de ne jamais dormir une nuit hors de sa maison. Et il en fut ainsi jusqu’à ce qu’un jour Mustapha Fléau-des-Rues, étant allé au Diwân, vit que chaque émir avait avec lui un fils ou deux. Et ce jour-là précisément il alla ensuite au hammam et, s’étant regardé dans un miroir, vit que les poils blancs de sa barbe l’emportaient en nombre sur les poils noirs qu’ils recouvraient complètement, et il se dit en lui-même : « Est-ce que Celui qui a déjà pris ton père, ne va pas enfin te gratifier d’un fils ? » Et il alla trouver son épouse et, de fort méchante humeur, s’assit sur le divan sans la regarder ni lui adresser la parole. Alors elle s’approcha de lui et lui dit : « Bonsoir à toi ! » Il répondit : « Va-t’en de devant moi ! Du jour où je t’ai vue je n’ai plus rien vu de bon ! » Elle demanda : « Comment cela ? » Il dit : « La nuit de ma pénétration en toi, tu m’as fait prêter le serment de ne point prendre femme sur toi ! Et moi je t’ai écoutée ! Or aujourd’hui j’ai vu au Diwân chaque émir avec un fils ou même deux fils, et alors me vint la pensée de la mort ; et cela m’affecta à l’extrême puisque je ne suis gratifié ni d’un fils ni même d’une fille ! Et je n’ignore point que celui qui ne laisse pas de postérité ne laisse pas de mémoire ! Et tel est le motif de ma mauvaise humeur, ô stérile, ô mes semailles dans une terre de rocs et de cailloux ! » À ces paroles la rougissante jouvencelle répliqua : « Cela te sied de parler, toi ! Le nom d’Allah sur moi et autour de moi ! Le retard n’est pas de moi ! Et la chose n’est pas de ma faute. Moi je me drogue tellement que j’ai fini par user et trouer les mortiers à force d’y piler des épices, d’y pulvériser des simples et d’y concasser des racines bonnes contre la stérilité ! Mais c’est toi le ratardataire ! Tu n’es qu’un mulet sans vertu au nez camard, et tes œufs sont clairs avec de la semence sans consistance et des graines qui ne fécondent pas ! » Il répondit : « C’est bon ! Mais dès mon retour de voyage je prendrai une seconde femme sur toi ! » Elle répliqua : « Mon lot et ma chance sont sur Allah ! » Alors il sortit de sa maison ; mais, arrivé dans la rue, il regretta ce qui venait d’avoir lieu ; et son épouse, la jouvencelle, regretta également ses paroles un peu vives à l’égard de son maître. Et voilà pour le propriétaire de la maison située dans l’impasse pavée de marbre !
Mais pour ce qui est de Dalila-la-Rouée, voici ! Comme elle était arrivée sous les murs de la maison, elle vit soudain la jeune épouse de l’émir accoudée à sa fenêtre, telle une nouvelle mariée, si belle ! et brillante comme un vrai trésor de tous les bijoux dont elle était ornée, et lumineuse comme une coupole de cristal des blancs habits de neige dont elle était vêtue !
À cette vue, la vieille entremetteuse de malheur se dit en elle-même : « Ô Dalila, voici pour toi le moment arrivé d’entr’ouvrir le sac de tes fourberies ! Nous verrons bien si tu vas pouvoir attirer cette adolescente hors de la maison de son maître, et la dépouiller de ses bijoux et la dénuder de ses beaux vêtements, pour t’emparer de tout le lot ! » Alors elle s’arrêta sous la fenêtre de l’émir, et se mit à invoquer à haute voix le nom d’Allah, disant : « Allah ! Allah ! Et vous tous, les Amis d’Allah, les Walis Bienfaisants, éclairez-moi ! »
En entendant ces invocations, et en voyant cette sainte vieille vêtue comme les soufis mendiants, toutes les femmes du quartier accoururent baiser les. pans de son manteau et lui demander sa bénédiction ; et la jeune épouse de l’émir Fléau-des-Rues pensa : « Allah nous accordera ses grâces par l’entremise de cette sainte vieille ! » Et, les yeux mouillés d’émotion, la jouvencelle appela sa servante et lui dit : « Descends trouver notre portier le cheikh Abou-Ali, baise-lui la main, et dis-lui : « Ma maîtresse Khatoun te prie de laisser entrer chez nous cette sainte vieille pour qu’elle nous obtienne les grâces d’Allah ! » Et la servante descendit trouver le portier et lui baisa la main et lui dit : « Ô cheikh Abou-Ali, ma maîtresse Khatoun te dit : « Laisse entrer chez nous cette sainte vieille pour qu’elle nous obtienne les grâces d’Allah ! Et sa bénédiction s’étendra peut-être sur nous tous ! » Alors le portier s’approcha de la vieille et voulut d’abord lui baiser la main ; mais elle recula vivement et l’en empêcha, disant : « Éloigne-toi de moi ! Toi, qui fais tes prières sans ablutions, comme tous les domestiques, tu vas me souiller de ton contact impur et rendre mon ablution nulle et vaine ! Qu’Allah te délivre de cette servitude, ô portier Abou-Ali, car tu es dans les bonnes grâces des Saints d’Allah et des Walis ! » Or ce souhait toucha à l’extrême le portier Abou-Ali, car précisément il avait un arriéré de trois mois de paye que ne lui donnait pas le terrible émir Fléau-des-Rues, et il était depuis longtemps dans une grande anxiété à ce sujet, et il ne savait quel moyen employer pour recouvrer son dû. Aussi il dit à la vieille : « Ô ma mère, fais-moi boire un peu d’eau de ton aiguière, pour qu’ainsi je puisse gagner de ta bénédiction ! » Alors elle prit l’aiguière de dessus son épaule et la fit tournoyer en l’air plusieurs fois, si bien que le tampon en fibres de palmier s’échappa du col et que les trois dinars d’or roulèrent sur le sol comme s’ils tombaient du ciel ! Et le portier se hâta de les ramasser, et dit en son âme : « Gloire à Allah ! Cette vieille mendiante est une sainte d’entre les saints qui ont les trésors cachés à leur disposition ! Il vient de lui être révélé que je suis un pauvre portier frustré de sa paye et dans un grand besoin d’argent pour les dépenses les plus pressées ; et elle a fait des conjurations pour m’obtenir ces trois dinars en les attirant du fond de l’air ! » Puis il tendit les trois dinars à la vieille et lui dit : « Prends, ma tante, les trois dinars qui sont peut-être tombés de ton aiguière ! » Elle répondit : « Éloigne-toi de moi avec cet argent-là ! Je ne suis point de ceux-là qui s’occupent des choses de ce monde, non, jamais ! Tu peux garder cet argent pour toi, et t’en élargir un peu l’existence, afin de remplacer par là les appointements que l’émir te doit ! » Alors le portier leva les bras et s’écria : « Louanges à Allah pour son assistance ! Voilà un fait du domaine de la révélation ! »
Cependant la servante s’était déjà approchée de la vieille et, après lui avoir baisé la main, s’était hâtée de la conduire auprès de sa jeune maîtresse.
Lorsque la vieille fut arrivée auprès de la jouvencelle, elle fut stupéfaite de sa beauté ; car elle était vraiment comme un trésor nu dont les sceaux talismaniques eussent été brisés pour ainsi l’exposer dans sa gloire…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT TRENTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
Lorsque la vieille fut arrivée auprès de la jouvencelle, elle fut stupéfaite de sa beauté ; car elle était vraiment comme un trésor nu dont les sceaux talismaniques eussent été brisés pour ainsi l’exposer dans sa gloire. Et de son côté la belle Khatoun s’empressa de se jeter aux pieds de la vieille et de lui baiser les mains ; et la vieille lui dit : « Ô ma fille, je ne viens que parce que j’ai deviné que tu avais besoin de mes conseils, après l’inspiration d’Allah ! » Et Khatoun commença d’abord par lui servir à manger, selon la coutume usitée à l’égard des saints mendiants ; mais la vieille ne voulut pas toucher aux mets, et dit : « Je ne veux plus manger que les mets du paradis ; aussi je jeûne tout le temps, excepté cinq jours par an ! Mais, ô mon enfant, je te vois affligée, et je désire que tu me racontes la cause de ta tristesse ! » Elle répondit : « Ô ma mère, le jour de la pénétration, j’ai fait jurer à mon époux de ne jamais prendre une seconde femme sur moi ; mais il vit les fils des autres et il eut bien envie d’en avoir lui aussi ; et il me dit : « Tu es stérile ! » Je lui répondis : « Tu es un mulet qui n’engrosse pas ! » Alors il sortit en colère et me dit : « À mon retour de voyage, je me marierai sur toi ! » Or moi, ô ma mère, j’ai bien peur maintenant qu’il ne réalise sa menace et ne prenne sur moi une seconde femme qui lui donne des enfants ! Et il est riche en terres, en maisons, en émoluments, en villages entiers ; et s’il a des enfants de la seconde, moi je serai frustrée de tous ces biens ! » La vieille répondit : « Ma fille, on voit bien combien tu es ignorante des vertus de mon seigneur, le cheikh Père-des-Assauts, le puissant Maître-des-Charges, le Multiplicateur-des-Grossesses ! Ne sais-tu donc point qu’une seule visite à ce saint fait d’un pauvre débiteur un riche créancier et d’une femme stérile un grenier de fécondité ? » La belle Khatoun répondit : « Ô ma mère, depuis le jour de mon mariage je ne suis pas sortie une seule fois de la maison, et je n’ai même pas pu rendre les visites de félicitations ou de condoléances ! » La vieille dit : « Ô mon enfant, je veux te conduire chez mon seigneur le cheikh Père-des-Assauts et Multiplicateur-des-Grossesses. Et toi, ne crains point de lui confier le poids qui t’oppresse, et fais-lui un vœu. Et alors tu peux être sûre qu’à son retour de voyage, ton époux couchera avec toi, en s’unissant à toi par la copulation ; et tu seras enceinte de ses œuvres d’une fille ou d’un garçon. Mais que ton enfant soit mâle ou femelle, fais le vœu de le consacrer comme derviche au service de mon seigneur le Père-des-Assauts ! »
À ces paroles, la belle Khatoun, émue d’espoir et de plaisir, revêtit ses plus belles robes et s’orna de ses plus beaux bijoux, puis dit à sa servante : « Fais bien attention à la maison ! » Et la servante répondit : « J’écoute et j’obéis, ô ma maîtresse ! » Alors Khatoun sortit avec Dalila et rencontra à la sortie le vieux portier moghrabin Abou-Ali, qui lui demanda : « Pour où, ô ma maîtresse ? » Elle répondit : « Moi je vais visiter le cheikh Multiplicateur-des-Grossesses ! » Le portier dit : « Quelle bénédiction d’Allah que cette sainte vieille, ô ma maîtresse ! Elle a à sa disposition des trésors entiers ! Elle m’a donné trois dinars d’or rouge ; et elle a deviné mon cas et connu ma situation, sans me poser aucune question ; et elle a su que j’étais dans le besoin ! Puisse le bénéfice de son jeûne de toute l’année revenir sur ma tête ! »
Là-dessus, Dalila et la jeune Khatoun s’éloignèrent, et, en chemin, la vieille rouée dit à l’épouse de l’émir Fléau-des-Rues : « Inschallah ! ô ma maîtresse, lorsque tu auras visité le cheikh Père-des-Assauts, puisse-t-il non seulement te donner le calme de l’âme et la satisfaction de tes désirs et le retour de l’affection de ton époux, mais aussi faire en sorte que jamais plus à l’avenir vous n’ayez entre vous deux des sujets de mécontentement ou d’ennui ou vous disiez des paroles désobligeantes ! » Et Khatoun répondit : « Ô ma mère, comme je désire être déjà chez ce saint cheikh ! »
Pendant ce temps, Dalila-la-Rouée se disait en elle-même : « Comment vais-je pouvoir, au milieu de la foule des passants qui vont et viennent, la dépouiller de ses bijoux et la mettre nue ? » Puis soudain elle lui dit : « Ô ma fille, marche loin derrière moi sans toutefois me perdre de vue ; car moi, ta mère, je suis une vieille femme lourdement chargée des fardeaux dont me chargent ceux qui ne peuvent plus en supporter le poids ; et tout le long du chemin les gens viennent me charger des offres pieuses qu’ils ont consacrées à mon seigneur le cheikh, et me prient de les lui porter. Il vaut donc mieux que je marche seule pour le moment ! » Et l’adolescente marcha loin derrière la vieille rouée, jusqu’à ce qu’elles fussent toutes deux arrivées au souk principal des marchands. Et de loin on entendait dans le souk voûté résonner, aux pas de la jouvencelle, le bruit des grelots d’or de ses pieds délicats et le cliquetis des sequins de sa chevelure si mélodieux et cadencé que l’on eût dit une musique de cithares et de cymbales retentissantes !
Sur ces entrefaites elles passèrent, dans le souk, devant la boutique d’un jeune marchand, nommé Sidi-Mohsen, qui était un adolescent très joli avec à peine un léger duvet naissant sur les joues. Et il remarqua la beauté de la jouvencelle et il se mit à lui lancer à la dérobée des œillades que la vieille ne fut pas longtemps à deviner. Aussi elle revint à l’adolescente et lui dit : « Viens t’asseoir un moment à l’écart, ma fille, pour te reposer, pendant que je vais ! parler d’une affaire avec ce jeune marchand qui est là ! » Et Khatoun obéit et s’assit non loin de la boutique du bel adolescent qui put ainsi la mieux regarder et, d’un seul regard qu’elle lui lança, faillit devenir fou ! Lorsqu’il fut ainsi cuit à point, la vieille entremetteuse s’approcha de lui et lui dit, après les salams : « N’es-tu point Sidi-Mohsen le marchand ! » Il répondit : « Mais oui ! Qui a pu te dire mon nom…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT TRENTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … Mais oui ! Qui a pu te dire mon nom ? » Elle dit : « Ce sont des gens de bien qui m’ont envoyée vers toi. Et je viens t’apprendre, mon fils, que cette adolescente que tu vois est ma fille ; et son père, qui était un grand marchand, est mort en lui laissant des richesses considérables. Elle sort aujourd’hui de la maison pour la première fois, car il n’y a pas longtemps qu’elle est pubère et qu’elle est entrée dans l’âge mariable, et cela par divers signes péremptoires. Or moi je me suis hâtée de la faire sortir, car les sages disent : « Offre ta fille en mariage, mais n’offre point ton fils ! » C’est pourquoi, avertie par une inspiration divine et un secret pressentiment, je me suis décidée à venir te l’offrir en mariage. Et toi n’aie aucun souci à son sujet : si tu es pauvre, je te donnerai tout son capital, et je t’ouvrirai au lieu d’une boutique deux boutiques ! Et de cette façon tu auras été gratifié par Allah, non seulement d’une jouvencelle charmante, mais des trois choses désirables en C, à savoir : cassette, confort et cul ! »
À ces paroles, le jeune marchand Sidi-Mohsen répondit à la vieille : « Ô ma mère, tout cela est excellent et c’est plus que je n’en ai jamais souhaité. Aussi je t’en remercie et je ne doute point de tes paroles quant à ce qui concerne les deux premiers C. Mais pour ce qui est du troisième C, je t’avoue que je ne serai tranquille à son sujet que lorsque je l’aurai vu et contrôlé avec mes yeux ; car ma mère, avant de mourir, m’a bien recommandé la chose et m’a dit : « Que j’aurais souhaité te marier, mon fils, avec une jeune fille dont je me serais assurée par mes propres yeux ! » Et moi je lui ai juré que je ne manquerais pas de le faire à sa place ! Et elle est morte tranquille ! » Alors la vieille répondit : « Dans ce cas lève-toi sur tes deux pieds et suis-moi ! Et je me charge de te la montrer toute nue. Seulement prends bien soin de marcher loin derrière elle, mais sans la perdre de vue. Et moi je marcherai en tête pour montrer le chemin ! »
Alors le jeune marchand se leva et prit avec lui une bourse contenant mille dinars, en se disant : « On ne sait ce qui peut arriver ; et je pourrai de la sorte déposer, séance tenante, les frais requis pour le contrat ! » Et il suivit de loin la vieille putain qui ouvrait la marche, et qui se disait en elle-même : « Comment vas-tu faire maintenant, ô Dalila pleine de sagacité, pour dépouiller ce jeune veau ? »
Comme elle marchait de la sorte, suivie par l’adolescente qui était elle-même suivie par le joli marchand, elle arriva devant la boutique d’un teinturier, un nommé Hagg-Môhammad, un homme réputé dans tout le souk pour ses goûts dédoublés. En effet il était semblable au couteau du vendeur de colocases, qui perfore en même temps les parties mâles et femelles du tubercule ; et il aimait au même degré le goût tendre de la figue et le goût acide de la grenade. Or donc le Hagg-Môhammad, en entendant le cliquetis des sequins et des grelots, leva la tête et aperçut le joli garçon et la belle jouvencelle. Et il ressentit ce qu’il ressentit ! Mais déjà Dalila s’était approchée de lui et, après les salams, lui avait dit en s’asseyant : « Tu es bien le Hagg-Môhammad, le teinturier ? » Il répondit : « Oui ! je suis le Hagg-Môhammad ! Que désires-tu ? » Elle répondit : « Moi, des gens de bien m’ont parlé de toi ! Regarde cette jouvencelle charmante, qui est ma fille, et ce gracieux jouvenceau imberbe, qui est mon fils ! Je les ai élevés tous deux, et leur éducation m’a coûté bien des dépenses ! Or sache maintenant que notre maison d’habitation est un vaste et vieil édifice en ruines que j’ai été obligée dernièrement de faire consolider avec des solives de bois et de gros étais ; mais le maître architecte m’a dit : « Tu ferais bien d’aller habiter une autre maison que celle-là ; car elle risque fort de s’écrouler sur toi ! Et lorsque tu l’auras fait reconstruire, tu pourras revenir l’habiter ; mais pas avant ! » Alors moi je suis sortie à la recherche de quelque autre maison où habiter momentanément avec ces deux enfants ; et des gens de bien m’ont adressée à toi. Je désirerais donc me loger chez toi avec ces deux enfants que voici ! Et toi ne doute point de ma générosité ! »
En entendant ces paroles de la vieille, le teinturier sentit son cœur danser au milieu de ses entrailles, et il se dit en lui-même : « Ya Hagg-Môhammad, voici que vient s’offrir à tes dents un bloc de beurre sur un gâteau ! » Puis il dit à Dalila : « Il est vrai que j’ai une maison avec une grande pièce à l’étage supérieur ; mais je ne puis disposer d’aucune chambre, car j’habite en bas, et la pièce du haut me sert à recevoir mes invités les paysans qui m’apportent l’indigo ! » Elle répondit : « Mon fils, la réparation de ma maison ne demandera qu’un mois ou deux tout au plus ; et nous ne connaissons pas beaucoup de monde ici ! Je te prie donc de diviser en deux la grande pièce du haut et de nous en donner la moitié pour nous trois. Et par ta vie, ô mon fils ! si tu veux que tes invités, les paysans planteurs d’indigo, soient nos invités, qu’ils soient les bienvenus ! Nous sommes prêtes à manger avec eux et à dormir avec eux ! » Alors le teinturier se hâta de lui remettre les clefs de sa maison ; il y en avait trois : une grande, une petite et une tordue. Et il lui dit : « La grande clef est celle de la porte de la maison ; la petite clef est celle du vestibule, et la clef tordue est celle de la pièce du haut. Tu peux, ma bonne mère, disposer du tout ! » Alors Dalila prit les clefs et s’éloigna, suivie de l’adolescente, qui était suivie du jeune marchand, et arriva de la sorte à la ruelle où se trouvait la maison du teinturier, dont elle se hâta d’ouvrir la porte avec la grande clef…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT TRENTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… dont elle se hâta d’ouvrir la porte avec la grande clef.
D’abord elle commença par entrer la première et fit entrer la jeune femme en disant au marchand d’attendre. Et elle emmena la belle Khatoun à la pièce du haut, en lui disant : « Ma fille, en bas demeure le vénérable cheikh Père-des-Assauts ! Toi attends-moi ici, et commence par défaire ton grand voile ! Je ne tarderai pas à revenir te trouver ! » Et elle descendit aussitôt ouvrir la porte au jeune marchand, et l’introduisit dans le vestibule en lui disant : « Assieds-toi ici et attends-moi que je revienne te trouver avec ma fille, pour que tu t’assures de ce dont tu veux t’assurer avec tes yeux ! » Puis elle remonta chez la belle Khatoun et lui dit : « Nous allons maintenant rendre visite au Père-des-Assauts ! » Et la jouvencelle s’écria : « Quelle joie, ô ma mère ! » Elle reprit : « Mais, ma fille, j’ai peur pour toi d’une chose ! » Elle demanda : « Et quelle est-elle, ô ma mère ? » Elle répondit : « En bas j’ai un fils idiot, qui est le représentant et l’aide du cheikh Père-des-Assauts. Il ne sait différencier le temps froid d’avec le temps chaud, et reste continuellement nu ! Mais quand une noble visiteuse comme toi entre chez le cheikh, la vue des ornements et des soieries dont elle est vêtue le fait entrer en fureur, et il se précipite sur elle et lui met en pièces les habits, et lui arracha ses pendeloques, en lui déchirant les oreilles, et la dépouille de tous ses bijoux. Tu ferais donc bien de commencer par enlever ici tes bijoux et te dévêtir de toutes tes robes et chemises ; et moi je te garderai le tout en attendant que tu sois revenue de ta visite au cheikh Père-des-Assauts ! » Alors la jouvencelle enleva tous ses bijoux, se dévêtit de tous ses habits, en ne gardant sur elle que sa chemise en soie de dessous, et remit le tout à Dalila, qui lui dit : « Je vais les déposer pour toi sous la robe du Père-des-Assauts, pour qu’ainsi, à son contact, t’advienne la bénédiction ! » Et elle descendit en emportant tout le paquet et, pour le moment, le cacha sous la voûte de l’escalier ; puis elle entra chez le jeune marchand et le trouva dans l’attente de la jouvencelle. Il lui demanda : « Où donc est ta fille, pour que je puisse l’examiner ? » Mais soudain la vieille se mit à se frapper le visage et la poitrine, en silence. Et le jeune marchand lui demanda : « Qu’as-tu ? » Elle répondit : « Ah ! Puissent-elles ne plus être en vie, les voisines mal intentionnées et les envieuses et les calomniatrices ! Elles viennent de te voir entrer avec moi, et m’ont demandé qui tu étais ; et moi je leur ai dit que je t’avais choisi pour époux futur à ma fille. Mais elles, jalouses de moi probablement, et enviant ma chance sur toi, sont allées trouver ma fille et lui ont dit : « Ta mère serait-elle donc si fatiguée de te nourrir qu’elle veuille ainsi te marier avec quelqu’un qui est atteint de la gale et de la lèpre ? » Alors moi je lui ai juré, comme tu l’avais fait toi-même à ta mère, de ne point t’unir à elle avant qu’elle t’ait vu tout nu ! » À ces paroles le jeune marchand s’écria : « Je recours à Allah contre les envieux et les mal intentionnés ! » Et, ce disant, il se dévêtit de tous ses habits, et en sortit nu et intact et blanc comme du vierge argent. Et la vieille lui dit : « Certes ! beau et pur comme tu es, tu n’as rien à redouter ! » Et il s’écria : « Qu’elle vienne me voir maintenant ! » Et il finit de ranger de côté sa belle pelisse de martre, sa ceinture, son poignard d’argent et d’or, et le reste — de ses habits, en cachant dans leurs plis la bourse de mille dinars ! Et la vieille lui dit : « Il ne faut point laisser dans le vestibule toutes ces choses tentantes. Je vais les mettre en lieu sûr ! » Et elle fit un paquet de tous ces objets, comme elle avait fait des vêtements de la jouvencelle et, quittant le jeune marchand, referma sur lui la porte à clef, alla prendre sous l’escalier le premier paquet et sortit sans bruit de la maison, en emportant le tout.
Une fois dans la rue, elle commença par mettre en effet en lieu sûr les deux paquets, en les déposant chez un marchand d’épices de ses connaissances, et retourna chez le teinturier libidineux qui l’attendait avec impatience et lui demanda, sitôt qu’il l’eut aperçue : « Eh bien ! ma tante ? Inschallah ! j’espère que ma maison t’a convenu ! » Elle répondit : « Ta maison est une maison bénie ! J’en suis satisfaite à la limite de la satisfaction. Maintenant je vais de ce pas chercher les portefaix, pour y faire transporter nos meubles et nos effets ! Seulement, comme je suis de la sorte bien occupée, et que mes enfants n’ont rien mangé depuis ce matin, voici un dinar ! Prends-le, je t’en prie, et achète-leur de la panade farcie et recouverte de hachis de viande, et va prendre le repas du jour avec eux à la maison, et leur tenir compagnie ! » Le teinturier répondit : « Mais qui me gardera, pendant ce temps, la boutique et les effets des clients ? » Elle dit : « Par Allah ! ton petit employé ! » Il répondit : « Qu’il en soit donc ainsi ! » Et il prit une assiette et une porcelaine et s’en alla, pour acheter et porter la panade farcie en question. Et voilà pour ce qui est du teinturier ! D’ailleurs nous y reviendrons !
Mais pour ce qui est de Dalila-la-Rouée, elle courut aussitôt reprendre les deux paquets qu’elle avait déposés chez l’épicier, et revint immédiatement à la teinturerie, pour dire au garçon teinturier : « Ton maître m’envoie te dire de courir le rejoindre chez le marchand de panades ! Moi, jusqu’à ton retour, je veux bien garder la boutique. Ne tarde donc pas ! » Le garçon répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il sortit de la boutique, tandis que la vieille commençait par mettre la main sur les effets des clients et ce qu’elle pouvait ramasser dans la boutique. Pendant qu’elle était ainsi occupée, vint à passer, avec son âne, un ânier, qui depuis une semaine n’avait pas trouvé de besogne et qui était un mangeur de haschisch par-dessus le marché. Et la vieille putain l’appela en lui criant : « Hé ! ô ânier, viens ! » Et l’ânier s’arrêta à la porte avec son âne, et la vieille lui demanda : « Toi, connais-tu mon fils, le teinturier ? » Il répondit : « Ya Allah ! et qui le connaît mieux que moi, ô ma maîtresse ? » Elle lui dit : « Alors, sache, ô ânier de bénédiction, que le pauvre garçon…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT TRENTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Alors, sache, ô ânier de bénédiction, que le pauvre garçon est insolvable, et chaque fois qu’il a été mis en prison j’ai réussi à l’en faire sortir. Mais aujourd’hui je veux, pour en finir, qu’il se déclare en faillite. Et je m’occupe en ce moment à ramasser les effets des clients pour les porter à leurs propriétaires. Je désire donc que tu me prêtes ton âne pour le charger de toutes ces hardes, et voici pour toi un dinar comme salaire de l’âne. Toi, en attendant mon retour, occupe-toi à mettre ici tout en pièces, à casser les jarres de teinture, et à détruire les cuves de réserve ; afin qu’ainsi les gens envoyés par le kâdi pour contrôler la faillite ne puissent rien trouver à saisir dans la boutique ! » L’ânier répondit : « Sur ma tête et sur mes yeux, ô ma maîtresse ! Car ton fils, le maître teinturier, m’a comblé de ses bontés et, comme je lui dois de la reconnaissance, je veux lui rendre ce service pour rien, et tout casser et tout détruire dans la boutique pour Allah ! » Alors la vieille le quitta et, après avoir tout chargé sur l’âne, se dirigea vers sa maison, en conduisant l’âne par le licou.
Avec l’aide et la protection du Protecteur, elle arriva sans encombre à sa maison et entra chez sa fille Zeinab, qui l’attendait assise comme sur une poêle à frire, et qui lui dit : « Ô ma mère, mon cœur a été avec toi ! Qu’as-tu accompli en fait de duperies ? » Dalila répondit : « J’ai joué, pour cette première matinée, quatre tours à quatre personnes : un jeune marchand, une épouse d’un terrible capitaine, un teinturier libidineux et un ânier ! Et je t’apporte toutes leurs hardes et tous leurs effets sur l’âne de l’ânier ! » Et Zeinab s’écria : « Ô ma mère, tu ne vas plus pouvoir désormais circuler dans Baghdad, à cause du capitaine dont tu as dépouillé l’épouse, du jeune marchand que tu as dénudé, du teinturier auquel tu as enlevé les effets de ses clients, et de l’ânier maître de l’âne ! » Dalila répondit : « Pouh ! ma fille, moi je ne me préoccupe guère de tous ceux-là, excepté seulement de l’ânier, car il me connaît ! » Et voilà, pour le moment, ce qui concerne Dalila.
Quant au maître teinturier, une fois qu’il eut acheté les panades farcies en question, il en chargea son garçon et prit avec lui le chemin de sa maison, en repassant devant sa teinturerie. Et voici ! Il vit l’ânier dans la boutique en train de tout démolir et de casser les grandes jarres et les cuves ; et déjà la boutique n’était qu’un amas de décombres et de boue bleue ruisselante. À cette vue, il s’écria : « Arrête, ô ânier ! » Et l’ânier s’arrêta dans sa besogne et dit au teinturier : « Louanges à Allah pour ta sortie de prison, ô maître teinturier ! Vraiment mon cœur était avec toi ! » Il demanda : « Que dis-tu là, ô ànier, et que signifie tout cela ? » L’ânier dit : « On a fait, pendant ton absence, la déclaration de ta faillite ! » Il demanda, avec le gosier serré et des lèvres tremblantes et des yeux saillants : « Qui te l’a dit ? » Il répliqua : « C’est ta mère qui me l’a dit, et m’a ordonné, dans ton intérêt, de tout détruire et de tout casser ici pour que les envoyés du kâdi ne puissent rien saisir ! » Le teinturier, à la limite de la stupéfaction, répondit : « Qu’Allah confonde l’Éloigné-Malin ! Il y a longtemps que ma mère est morte ! » Et il se donna de grands coups sur la poitrine en criant à plein gosier : « Hélas ! ô perte de mon bien et du bien des clients ! » Et de son côté l’ânier se mit à pleurer et à crier : « Hélas ! ô perte de mon âne ! » Puis il cria au teinturier : « Ô teinturier de mon cul, rends-moi mon âne, celui que m’a pris ta mère ! » Et le teinturier se précipita sur l’ânier, le saisit à la nuque et se mit à l’assommer de coups de poing en lui criant : « Où est-elle, ta vieille putain ? » Mais l’ânier se mit à crier du fond de ses entrailles : « Mon âne ! où est mon âne ? Rends-moi mon âne ! » Et tous deux se suspendirent l’un à l’autre, en se mordant, en s’insultant, en s’administrant des horions à qui mieux mieux et des coups de tête dans l’estomac, et en tâchant de s’emparer chacun des testicules de l’adversaire pour les lui écraser avec les doigts ! Cependant la foule s’attroupait autour d’eux en grossissant ; et l’on réussit enfin à les séparer, non sans dommage, et l’un des assistants demanda au teinturier : « Ya Hagg-Môhammad, qu’y a-t-il donc entre vous deux ? » Mais ce fut l’ânier qui se hâta de répondre, en criant son histoire à plein gosier, et il la termina disant : « Moi, j’ai fait tout cela pour rendre service au teinturier ! » Alors on demanda au teinturier : « Ya Hagg-Môhammad, tu dois sans doute connaître cette vieille femme pour lui avoir ainsi confié la garde de ta boutique ? » Il répondit : « Je ne l’ai point connue avant ce jour ! Mais elle est allée habiter dans ma maison avec son fils et sa fille ! » Alors l’un des assistants opina : « Moi, sur ma conscience, je crois que c’est le teinturier qui est responsable de l’âne de l’ânier ; car si l’ânier n’avait pas remarqué que le teinturier avait confié la garde de sa boutique à la vieille, il n’aurait pas à son tour confié son âne à cette vieille-là ! » Et un troisième ajouta : « Ya Hagg-Môhammad, du moment que tu as logé cette vieille chez toi, tu dois rendre l’âne à l’ânier ou lui payer une indemnité ! » Puis tous, avec les deux adversaires, prirent le chemin de la maison du teinturier. Tout cela…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT TRENTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Tout cela !
Mais pour ce qui est de la jouvencelle et du jeune marchand, voici !
Pendant que le jeune marchand attendait dans le vestibule l’arrivée de la jouvencelle pour l’examiner, celle-ci de son côté attendait dans la pièce du haut que la vieille sainte revînt lui apporter la permission de l’idiot, le lieutenant du Père-des-Assauts, afin qu’elle pût rendre visite au Père-des-Assauts. Mais comme la vieille tardait à revenir, la belle Khatoun, vêtue seulement de sa simple chemise fine, sortit de la pièce et descendit l’escalier. Alors elle entendit, dans le vestibule, le jeune marchand qui, ayant reconnu le cliquetis des grelots qu’elle n’avait pu enlever de ses chevilles, lui disait : « Hâte-toi donc ! Et viens ici avec ta mère qui t’a amenée pour te marier avec moi ! » Mais l’adolescente répondit : « Ma mère est morte ! mais toi, tu es, n’est-ce pas, l’idiot ? Et c’est bien toi le lieutenant du Père-des-Assauts ? » Il répondit à tout hasard : « Non, par Allah, ô mon œil, je ne suis pas encore tout à fait idiot ! Mais quant à être le Père-des-Assauts, je suis réputé comme tel ! » À ces paroles la rougissante jouvencelle ne sut que faire et résolut, malgré les objurgations du jeune marchand qu’elle prenait toujours pour l’idiot, lieutenant du Multiplicateur-des-Grossesses, d’attendre sur l’escalier l’arrivée de la sainte vieille.
Sur ces entrefaites, arrivèrent les gens qui accompagnaient le teinturier et l’ânier ; et ils frappèrent à la porte et attendirent longtemps qu’on leur ouvrit de l’intérieur. Mais comme personne ne répondait, ils enfoncèrent la porte et se précipitèrent d’abord dans le vestibule où ils virent le jeune marchand complètement nu, et essayant de cacher et de contenir dans ses deux mains sa marchandise à découvert. Et le teinturier lui cria : « Ah ! fils de putain, où est ta mère, la calamiteuse ? » Il répondit : « Il y a longtemps que ma mère est morte. Quant à la vieille dont c’est ici la maison, elle n’est que ma future belle-mère. » Et il raconta au teinturier, à l’ânier et à toute la foule son histoire dans tous ses détails. Et il ajouta : « Quant à celle que je dois examiner, elle est là derrière la porte ! » À ces paroles, on enfonça la porte et l’on trouva, derrière, l’effarée jouvencelle, toute nue, sauf la chemise seulement, qui essayait de recouvrir le plus bas possible la nudité de ses cuisses de gloire. Et le teinturier lui demanda : « Ah ! fille adultérine, où est ta mère, l’entremetteuse ? » Elle répondit, bien honteuse : « Ma mère est bien morte depuis longtemps. Quant à la vieille femme qui m’a conduite ici, c’est une sainte au service de mon seigneur le cheikh Multiplicateur ! »
À ces paroles, tous les assistants, et le teinturier, malgré sa boutique détruite, et l’ânier malgré son âne perdu, et le jeune marchand malgré la perte de sa bourse et de ses habits, se mirent à rire tellement qu’ils se renversèrent tous sur le derrière !
Après quoi, ayant compris que la vieille s’était jouée d’eux, les trois dupes résolurent de se venger d’elle ; et l’on commença par donner des habits à l’effarée jouvencelle qui s’en revêtit et se hâta de rentrer à sa maison où nous la retrouverons bientôt, au retour de voyage de son époux.
Quant au teinturier Hagg-Môhammad et à l’ânier, ils se réconcilièrent en se demandant mutuellement pardon, et ils s’en allèrent de compagnie, avec le jeune marchand, trouver le wali de la ville, Ternir Khaled, à qui ils racontèrent leur aventure, en lui demandant vengeance contre la vieille calamiteuse. Et le wali leur répondit : « Ô braves gens, quelle histoire prodigieuse me racontez-vous là ! » Ils répondirent : « Ô notre maître, par Allah ! et par la vie de la tête de l’émir des Croyants, nous ne te disons que la vérité ! » Et le wali leur dit : « Ô braves gens, comment ferais-je pour retrouver une vieille femme au milieu de toutes les vieilles femmes de Baghdad ? Vous savez que nous ne pouvons envoyer nos hommes courir les harems et enlever les voiles des femmes ! » Ils s’écrièrent : « Ô calamité ! ah ! ma boutique ! ah ! mon âne ! ah ! ma bourse de mille dinars ! » Alors le wali, apitoyé sur leur sort, leur dit : « Ô braves gens, allez ! parcourez toute la ville et essayez de retrouver cette vieille-là, et mettez la main sur elle ! Et moi, si vous réussissez, je vous promets de la mettre à la torture pour vous, et je l’obligerai à faire ses aveux ! » Et les trois dupes de Dalila-la-Rouée sortirent de chez le wali et se dispersèrent dans différentes directions, à la recherche de la maudite vieille. Et en attendant, voilà pour eux ! Mais nous les retrouverons !
Quant à la vieille Dalila-la-Rouée, elle dit à sa fille Zeinab : « Ô ma fille, tout cela n’est rien ! Je vais trouver mieux ! » Et Zeinab lui dit : « Ô ma mère, j’ai bien peur maintenant pour toi ! » Elle répondit : « Ne crains rien, ma fille, à mon sujet. Moi je suis comme la fève dans sa cosse, à l’épreuve contre le feu et contre l’eau…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT TRENTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Moi je suis comme la fève dans sa cosse, à l’épreuve contre le feu et contre l’eau ! » Et elle se leva, et rejeta ses vêtements de soufi pour revêtir des habits de servante d’entre les servantes des grands, et sortit en songeant au méfait nouveau qu’elle allait perpétrer dans Baghdad.
Elle arriva de la sorte à une rue écartée, entièrement décorée, et ornée dans toute sa longueur et sa largeur de belles étoffes et de lanternes multicolores ; et le sol en était recouvert de riches tapis. Et elle entendit là-dedans les voix des chanteuses et les tambourinements des doufoufs et les battements des daraboukas sonores et le retentissement des cymbales. Et elle vit à la porte de la demeure pavoisée une esclave qui portait à califourchon sur son épaule un jeune enfant habillé d’étoffes splendides en velours d’or et d’argent, coiffé d’un tarbousch rouge orné de trois rangs de perles, le cou entouré d’un collier d’or incrusté de pierreries, et les épaules recouvertes d’un mantelet de brocart. Et elle apprit des curieux et des invités qui entraient et sortaient que cette maison appartenait au syndic des marchands de Baghdad, et que cet enfant était son enfant. Et elle apprit également que le syndic avait aussi une fille, vierge et pubère, dont on célébrait précisément ce jour-là les fiançailles ; et que tel était le motif de ce déploiement de décorations et d’ornements. Et comme la mère de l’enfant était fort occupée à recevoir les dames ses invitées, et à leur faire les honneurs de sa maison, elle avait confié l’enfant, qui la dérangeait et s’attachait chaque fois à ses robes, à cette jeune esclave avec charge de le distraire et de le faire jouer en attendant que les invitées fussent parties.
Or, lorsque la vieille Dalila eut aperçu cet enfant à califourchon sur l’épaule de l’esclave, et qu’elle se fut renseignée de la sorte sur ses parents et la cérémonie qui avait lieu, elle se dit en elle-même : « Ô Dalila, le tour à faire pour le moment c’est de subtiliser cet enfant en l’enlevant à cette esclave ! » Et elle s’avança, en s’exclamant : « Quelle honte sur moi d’être si en retard avec la digne épouse du syndic ! » Puis elle dit à la jeune esclave, qui était une niaise, en lui mettant dans la main une pièce de fausse monnaie : « Voici un dinar pour ta peine ! Monte, ma fille, auprès de ta maîtresse et dis-lui : « Ta vieille nourrice Omm Al-Khayr se réjouit beaucoup pour toi, en raison de toute la gratitude qu’elle te doit pour tes bontés ! Aussi, au jour de la grande réunion, elle viendra te voir avec ses filles, et ne manquera pas de mettre de généreuses offrandes de noces, selon la coutume, dans les mains des dames d’atours ! » L’esclave répondit : « Ma bonne mère, je ferais volontiers ta commission ; mais mon jeune maître, cet enfant-ci, chaque fois qu’il voit sa mère ? s’accroche à elle et s’attache à ses vêtements ! » Elle répondit : « Alors confie-le-moi, le temps pour toi d’aller et de revenir ! » Et l’esclave prit la fausse pièce, et remit l’enfant à la vieille, pour monter aussitôt faire sa commission.
Quant à Dalila, elle se hâta de déguerpir avec l’enfant et d’aller à une ruelle obscure où elle le dépouilla de toutes les choses précieuses qu’il portait sur lui, et se dit en elle-même : « Maintenant, ô Dalila, ça n’est pas tout ça ! Si tu es vraiment une fine entre les fines, il s’agit de tirer de ce marmot tout le parti possible en l’engageant, par exemple, pour quelque somme imposante ! » À cette pensée, elle bondit sur ses deux pieds, et alla au souk des bijoutiers où elle vit dans une boutique un Juif, grand joaillier, qui était assis derrière sa boîte de devanture ; et elle entra dans la boutique du Juif, en se disant : « Voilà mon affaire toute trouvée ! » Lorsque le Juif de ses propres yeux la vit entrer, il regarda l’enfant qu’elle portait et reconnut le fils du syndic des marchands. Or ce Juif, bien que fort riche, ne manquait jamais d’être jaloux de ses voisins quand ils faisaient une vente alors que lui, par hasard, n’en faisait pas une autre au même moment. Aussi, fort réjoui de l’entrée de la vieille, il lui demanda : « Que désires-tu, ô ma maîtresse ? » Elle répondit : « C’est bien toi, maître Izra le Juif ? » Il répondit : « Naâm ! » Elle lui dit : « La sœur de cet enfant, la fille du schahbandar des marchands, est fiancée d’aujourd’hui, et on célèbre, en ce moment la cérémonie des accordailles. Or on a besoin de suite pour elle de certains bijoux, dont deux paires de bracelets de chevilles en or, une paire de bracelets ordinaires en or, une paire de pendeloques en perles, un ceinturon d’or filigrane, un poignard avec une poignée de jade incrustée de rubis et une bague à cachet ! » Aussitôt le Juif s’empressa de lui donner ce qu’elle demandait, et dont le prix s’élevait pour le moins à mille dinars d’or. Et Dalila lui dit : « Je prends toutes ces choses à condition ! Je vais les porter à la maison, et ma maîtresse choisira ce qui lui plaît le mieux. Après quoi je reviendrai ici te porter le prix de ce qu’elle aura choisi ! Mais en attendant je te prie de garder cet enfant jusqu’à mon retour ! » Le Juif répondit : « Qu’il soit fait selon ton désir ! » Et elle prit les joyaux et se hâta de se rendre directement à sa maison.
Lorsque la jeune Zeinab-la-Fourbe vit entrer sa mère, elle lui dit : « Quel exploit viens-tu d’accomplir, ô mère ? » Elle répondit : « Un tout petit, seulement, pour cette fois. Je me suis contentée d’enlever et de dépouiller le jeune fils du schahbandar des marchands et de le mettre en dépôt chez le Juif Izra contre des bijoux de la valeur de mille dinars ! » Alors sa fille s’écria : « Certes ! cette fois c’est fini ! Tu ne vas plus pouvoir sortir et circuler dans Baghdad ! » Elle répondit : « Tout ce que j’ai fait là n’est rien, pas même une mesure sur mille ! Mais toi, ma fille, sois sans crainte à mon sujet ! »
Quant à ce qui est de la jeune esclave niaise, elle entra dans la salle de réception et dit : « Ô ma maîtresse, ta nourrice Omm Al-Khayr t’envoie ses salams et ses souhaits et te dit qu’elle s’est beaucoup réjouie pour toi, et qu’elle viendra ici avec ses filles le jour du mariage et sera généreuse pour les dames d’atours ! » Sa maîtresse lui demanda : « Où as-tu laissé ton jeune maître ? » Elle répondit : « Je l’ai laissé avec elle, de peur qu’il ne s’accrochât à toi ! Et voici une pièce d’or qu’elle me donna pour les chanteuses ! » Et elle tendit la pièce à la principale chanteuse en disant : « Voilà pour tes étrennes ! » Et la chanteuse prit la pièce et trouva qu’elle était en cuivre. Alors la maîtresse cria à la servante : « Ah ! prostituée, descends vite retrouver ton jeune maître ! » Et l’esclave se hâta de redescendre, mais elle ne retrouva ni l’enfant ni la vieille. Alors elle jeta un grand cri et tomba sur son visage, alors que toutes les femmes accouraient du haut, et que la joie se changeait en deuil dans leurs cœurs. Et voici que, sur ces entrefaites, arriva le syndic lui-même ; et son épouse se hâta, la figure retournée d’émotion, de le mettre au courant de ce qui venait de se passer. Aussitôt il sortit à la recherche de l’enfant, suivi de tous les marchands, ses invités, qui se mirent de leur côté à faire des recherches dans toutes les directions. Et il finit, après mille transes, par trouver l’enfant presque nu sur le seuil de la boutique du Juif, et il se précipita, fou de joie et de colère, sur le Juif en criant : « Ah ! maudit ! Que voulais-tu faire de mon fils ! Et pourquoi l’as-tu dépouillé de ses vêtements ? » Le Juif répondit, en tremblant et à la limite de la stupéfaction : « Par Allah ! ô mon maître, je n’avais pas besoin d’un semblable gage ! Mais c’est la vieille qui a tenu à me le laisser, après m’avoir pris pour mille dinars de bijoux pour ta fille ! » Le syndic, de plus en plus, indigné, s’écria : « Eh ! maudit, crois-tu donc que ma fille manque de bijoux pour recourir à toi ? Hâte-toi de me rendre les habits et les ornements dont tu as dépouillé mon fils ! » À ces paroles, le Juif s’écria, terrifié : « À mon secours, ô musulmans ! » Et juste à ce moment apparurent, venant de différentes directions, les trois dupes premières : l’ânier, le jeune marchand et le teinturier. Et ils s’informèrent de l’affaire, et, ayant appris de quoi il s’agissait, ils ne doutèrent pas un instant que ce fût là un nouvel exploit de la vieille calamiteuse, et ils s’écrièrent : « Nous connaissons la vieille ! C’est une escroqueuse qui nous a déjà dupés avant vous ! » Et ils racontèrent leur histoire aux assistants qui en furent stupéfaits et au syndic, qui, faute de mieux, s’écria : « C’est encore une chance que j’aie retrouvé mon enfant ! Je ne veux plus me préoccuper de ses habits perdus, puisqu’ils deviennent sa rançon ! Seulement je saurai bien les réclamer un jour à la vieille ! » Et il ne voulut pas s’attarder davantage hors de sa maison, et courut faire partager à son épouse la joie d’avoir retrouvé leur enfant.
Quant au Juif, il demanda aux trois : « Où pensez-vous aller maintenant ? » Ils répondirent : « Nous allons continuer nos recherches ! » Il dit : « Emmenez-moi avec vous autres ! » Puis il demanda : « Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui l’ait connue avant son exploit ? » L’ânier répondit : « Moi ! » Le Juif dit : « Alors il vaut mieux que nous ne marchions pas ensemble, et que nos recherches soient faites séparement, pour ne pas lui donner l’éveil ! » Alors l’ânier répondit : « C’est juste ! Et, pour nous retrouver, prenons comme point de réunion, pour midi, la boutique du barbier moghrabin Hagg-Mass’oud ! » Ils convinrent du rendez-vous, et se mirent en route chacun de son côté.
Or, il était écrit que c’était l’ânier qui devrait le premier rencontrer la vieille rouée…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUARANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, il était écrit que c’était l’ânier qui devait le premier rencontrer la vieille rouée, alors qu’elle parcourait la ville à la recherche de quelque nouvel expédient. En effet dès que l’ânier l’eut aperçue, il la reconnut malgré son déguisement et fonça sur elle en lui criant : « Malheur à toi, vieille décrépite, bois sec ! Je te retrouve enfin ! » Elle demanda : « Que t’arrive-t-il, mon fils ? » Il s’écria : « L’âne ! Rends-moi l’âne ! » Elle répondit d’une voix attendrie : « Mon fils, parle bas, et couvre ce que Allah a couvert de son voile ! Voyons ! Que demandes-tu ? Est-ce ton âne ou bien les effets des autres gens ? » Il répondit : « Mon âne seulement ! » Elle dit : « Mon fils, je te sais pauvre, et je n’ai point voulu te priver de ton âne. Je te l’ai laissé chez le barbier moghrabin Hagg-Mass’oud, dont la boutique est là, juste en face ! Je vais de suite le trouver et le prier de me remettre l’âne. Attends-moi un instant ! » Et elle le précéda chez le barbier Hagg-Mass’oud. Elle entra en pleurant, lui baisa la main, et dit : « Hélas sur moi ! » Il lui demanda : « Qu’as-tu, bonne tante ? » Elle répondit : « Ne vois-tu pas mon fils qui est là debout en face de ta boutique ? Il était, de sa profession, un ânier conducteur d’ânes. Mais il est tombé malade un jour, et il fut éventé quant à son corps par un coup d’air qui lui a corrompu et fait tourner le sang ; et cela lui a fait perdre la raison et l’a rendu fou ! Depuis, il ne cesse de demander son âne. S’il se lève, il crie : « Mon âne ! » ; s’il se couche, il crie : « Mon âne ! » ; s’il marche, il crie : « Mon âne ! » Alors un médecin d’entre les médecins, m’a dit : « Ton fils a sa raison disloquée et dans un grand dérangement. Et rien ne le saurait guérir et remettre dans ses gonds que l’arrachement de ses deux grosses molaires du fond, et une bonne cautérisation sur les tempes avec des mouches cantharides ou un fer chaud ! Voici donc un dinar pour ta peine, et appelle-le et dis-lui : « Ton âne se trouve chez moi. Viens ! »
À ces paroles, le barbier répondit : « Que je reste une année sans manger, si je ne lui remets pas son âne entre les mains, ma tante ! » Là-dessus, comme il avait à son service deux aides barbiers, habitués à tous les travaux du métier, il dit à l’un d’eux : « Va faire chauffer au rouge deux clous ! » Puis il cria à l’ânier : « Eh ! mon fils, viens ici ! Ton âne est chez moi ! » Et pendant que l’ânier entrait dans la boutique, la vieille en sortait et s’arrêtait sur le seuil.
Donc, une fois que l’ânier fut entré, le barbier le prit par la main et le conduisit dans son arrière-boutique, où soudain il lui appliqua un coup de poing dans le ventre en lui allongeant un croc-en jambe, et le fit ainsi tomber à la renverse sur le sol où les deux aides le garrottèrent solidement des pieds et des mains et l’empêchèrent de faire le moindre mouvement. Alors le maître barbier se leva et commença par lui enfoncer dans le gosier deux tenailles semblables à celles du forgeron, et dont il se servait pour dompter les dents récalcitrantes ; puis d’un tour de bras il lui extirpa les deux molaires à la fois. Après quoi, malgré ses hurlements et ses contorsions, il prit avec une pince, Fun après l’autre, les deux clous rougis, et lui en cautérisa largement les tempes en invoquant le nom d’Allah pour la réussite.
Lorsque le barbier eut terminé ces deux opérations, il dit à l’ânier : « Ouallahi ! ta mère sera contente de moi ! Je vais l’appeler pour qu’elle constate l’efficacité de mon travail et ta guérison ? » Et pendant que l’ânier se débattait sous la poigne des aides, le barbier rentra dans sa boutique et là… ! sa boutique était vide, nettoyée comme par un coup de vent ! Plus rien ! Rasoirs, glaces à main en nacre, ciseaux, cuirs à repasser, cuvettes, aiguières, serviettes, escabeaux, tout avait disparu ! Plus rien ! Pas même l’ombre de tout cela ! Et la vieille aussi avait disparu ! Rien ! Pas même l’odeur de la vieille ! Et, en outre, la boutique était fraîchement balayée et arrosée comme si elle venait d’être nouvellement louée à l’instant.
À cette vue, le barbier, à la limite de la fureur, se précipita dans l’arrière-boutique et, prenant l’ânier à la gorge, le secoua comme une hotte et lui cria ; « Où est ta mère, l’entremetteuse ! » Le pauvre ânier, fou de douleur et de rage, lui dit : « Ah ! fils de mille chiffons ! Ma mère ? Mais elle est dans la paix d’Allah ! » Il le secoua encore et lui cria : « Où est ta mère, la vieille putain qui t’a conduit ici, et qui est partie après m’avoir volé toute la boutique ? » L’ânier, le corps agité de tremblements, allait répondre quand soudain entrèrent dans la boutique, revenant de leurs recherches infructueuses, les trois autres dupes : le teinturier, le jeune marchand et le Juif. Et ils virent aux prises le barbier, les yeux hors de la tête, et l’ânier, les tempes cautérisées et gonflées de deux larges ampoules et les lèvres écumantes de sang avec, de chaque côté, les deux molaires encore pendantes au dehors. Alors ils s’écrièrent : « Qu’y a-t-il donc ? » Et l’ânier, de tout son gosier, s’exclama : « Ô musulmans, justice contre cet enculé ! » Et il leur raconta ce qui venait d’arriver. Alors ils demandèrent au barbier : « Pourquoi as-tu fait cela à cet ânier, ô maître Mass’oud ? » Et le barbier leur raconta à son tour comment sa boutique venait d’être nettoyée par la vieille. Alors ils ne doutèrent plus que ce fût la vieille qui eût encore accompli ce nouveau forfait, et s’écrièrent : « Par Allah ! c’est la vieille maudite qui est la cause de tout cela ! » Et tous finirent par s’expliquer et tomber d’accord là-dessus. Alors le barbier se hâta de fermer sa boutique et de se joindre aux quatre dupes pour les aider dans leurs recherches. Et le pauvre ânier ne cessait de geindre : « Ah ! mon âne ! Ah ! mes molaires perdues…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT QUARANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ah ! mon âne ! ah ! mes molaires perdues ! »
Ils parcoururent longtemps ainsi les divers quartiers de la ville ; mais tout d’un coup, à un tournant de rue, l’ânier, cette fois encore, fut le premier à apercevoir et à reconnaître Dalila-la-Rouée, dont aucun d’eux ne connaissait d’ailleurs ni le nom ni l’habitation ! Et dès qu’il la vit, l’ânier se jeta sur elle en criant : « La voilà ! Elle va nous dédommager de tout maintenant ! » Et ils la traînèrent chez le wali de la ville, l’émir Khaled.
Lorsqu’ils furent arrivés au palais du wali, ils remirent la vieille aux gardes et leur dirent : « Nous voulons voir le wali ! » Ils répondirent : « Il fait la sieste. Attendez un peu qu’il soit réveillé ! » Et les cinq plaignants attendirent dans la cour, tandis que les gardes remettaient la vieille aux eunuques pour qu’ils l’enfermassent dans une chambre du harem jusqu’au réveil du wali.
Arrivée dans le harem, la vieille rouée réussit à se glisser jusqu’à l’appartement de l’épouse du wali et, après les salams et les baise-mains, dit à la dame qui était loin de se douter de l’affaire : « Ô ma maîtresse, je désirerais bien voir notre maître le wali ! » Elle répondit : « Le wali fait la sieste ! Mais que lui veux-tu ? » Elle dit : « Mon mari, qui est marchand de meubles et d’esclaves, m’a remis, avant de partir en voyage, cinq mamelouks, avec charge de les vendre au plus offrant. Et justement notre maître le wali les a vus avec moi et, m’en ayant offert mille deux cents dinars, j’ai consenti à les lui laisser à ce prix ! Et je viens maintenant les lui livrer ? » Or le wali avait effectivement besoin d’esclaves et avait même remis, la veille, à son épouse mille dinars pour cet achat. Aussi elle n’hésita pas à croire aux paroles de la vieille, et lui demanda : « Où sont-ils les cinq esclaves ? » Elle répondit : « Là, sous tes fenêtres, dans la cour du palais ! » Et la dame regarda dans la cour et aperçut les cinq dupes qui attendaient le réveil du wali. Alors elle dit : « Par Allah ! ils sont fort beaux, et l’un d’eux vaut à lui seul les mille dinars ! » Puis elle alla ouvrir son coffre, et remit à la vieille mille dinars en lui disant : « Ma bonne mère, je te dois encore deux cents autres dinars, pour faire le prix. Mais comme je ne les ai pas, je te prie d’attendre le réveil du wali. » La vieille répondit : « Ô ma maîtresse, sur ces deux cents dinars il y en a cent que je te laisse pour la gargoulette de sirop que tu m’as fait boire, et cent que tu me devras à ma prochaine visite ! Maintenant je te prie de me faire sortir du palais par la porte réservée du harem, afin que mes anciens esclaves ne me voient pas ! » Et l’épouse du wali la fit sortir par la porte secrète, et le Protecteur la protégea et la fit arriver sans encombre à sa maison. Lorsque sa fille Zeinab la vit entrer, elle lui demanda : « Ô mère mienne, qu’as-tu fait aujourd’hui ? » Elle répondit : « Ma fille, j’ai joué un tour à l’épouse du wali en lui vendant pour mille dinars, comme esclaves, l’ânier, le teinturier, le Juif, le barbier et le jeune marchand ! Cependant, ô ma fille, de ceux-là il n’y a qu’un seul qui me préoccupe et dont je redoute la perspicacité : c’est l’ânier ! C’est ce fils de putain qui me reconnaît chaque fois ! » Et sa fille lui dit : « Alors, ô mère mienne, assez sortir comme cela ! Garde maintenant la maison, et n’oublie point le proverbe qui dit :
« Il n’est pas certain que la gargoulette
« Reste sans se casser chaque fois qu’on la jette ! »
Et elle essaya de persuader sa mère de ne plus sortir désormais, mais inutilement.
Quant aux cinq, voici ! Lorsque le wali se fut réveillé de sa sieste, son épouse lui dit : « Puisse l’a douceur du sommeil t’avoir dulcifié ! Je me suis réjouie pour toi au sujet des cinq esclaves que tu nous as achetés ! » Il demanda : « Quels esclaves ? » Elle dit : « Pourquoi veux-tu me cacher la chose ? Puissent-ils alors te jouer d’aussi mauvais tours que celui que tu me joues ! » Il dit : « Par Allah ! je n’ai point acheté d’esclaves ! Qui t’a donné ce renseignement ! » Elle répondit : « C’est la vieille elle-même, à qui tu les as achetés pour mille deux cents dinars, qui me les a amenés et me les a montrés là, dans la cour, vêtus chacun d’une robe qui vaut a elle seule mille dinars ! » Il demanda : « Et lui aurais-tu remis l’argent ! » Elle dit : « Oui, par Allah ! » Alors le wali se hâta de descendre dans la cour, où il ne vit que l’ânier, le barbier, le Juif, le jeune marchand et le teinturier ; et il demanda à ses gardes : « Où sont les cinq esclaves que la vieille marchande vient de vendre à votre maîtresse ? » Ils répondirent : « Depuis la sieste de notre maître, nous n’avons vu que ces cinq qui sont là ! » Alors le wali se tourna vers les cinq et leur dit : « Votre maîtresse, la vieille, vient de vous vendre à moi pour mille dinars ! Vous allez commencer votre travail par vider les fosses des vidanges ! » À ces paroles les cinq plaignants, à la limite de la stupéfaction, s’écrièrent : « Si c’est là ta justice, nous n’avons plus qu’à recourir contre toi à notre maître le khalifat ! Nous sommes des hommes libres qu’on ne peut vendre ni acheter ! Yallah ! viens avec nous chez le khalifat…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUARANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
« … Yallah ! viens avec nous chez le khalifat ! » Alors le wali leur dit : « Si vous n’êtes pas des esclaves, c’est qu’alors vous êtes des escrocs et des larrons ! Et c’est vous qui avez conduit cette vieille à mon palais et avez combiné avec elle cette escroquerie ! Or, par Allah ! moi, à mon tour, je vais vous revendre à des étrangers pour cent dinars chacun ! »
Sur ces entrefaites entra dans la cour du palais le capitaine Fléau-des-Rues, qui venait se plaindre au wali de la mésaventure subie par son épouse, la jouvencelle. En effet, à son retour de voyage, il avait vu son épouse, au lit, malade de honte et d’émotion, et avait appris d’elle tout ce qui lui était arrivé, et elle avait ajouté : « Tout cela ne m’est arrivé qu’à cause de tes paroles désobligeantes, qui m’ont décidée à recourir à l’entremise du cheikh Multiplicateur ! »
Aussi dès que le capitaine Fléau eut aperçu le wali, il lui cria : « Est-ce toi qui permets ainsi aux vieilles entremetteuses de pénétrer dans les harems et d’escroquer les épouses des émirs ? Est-ce là tout ton métier ? Or, par Allah ! moi je te rends responsable de l’escroquerie commise à mon égard et des dommages causés à mon épouse ! » À ces paroles du capitaine Fléau-des-Rues, les cinq s’écrièrent : « Ô émir, ô vaillant capitaine Fléau, nous remettons aussi notre cause entre tes mains ! » Et il leur demanda : « Qu’avez-vous, vous autres aussi, à réclamer ? » Alors ils lui racontèrent toute leur histoire, qu’il est inutile de répéter. Et le capitaine Fléau leur dit : « Certes ! vous aussi vous avez été dupés ! Et maintenant le wali se trompe fort s’il croit pouvoir nous incarcérer ! »
Lorsque le wali eut entendu toutes ces paroles, il dit au capitaine Fléau : « Ô émir, je prends à ma charge le paiement des indemnités qui te sont dues et la restitution des effets de ton épouse ; et je me porte garant de la vieille escroqueuse ! » Puis il se tourna vers les cinq et leur demanda : « Qui de vous saura reconnaître la vieille ? » L’ânier répondit, accompagné par les autres en chœur : « Nous tous nous saurons la reconnaître ! » Et l’ânier ajouta : « Moi, je la reconnaîtrais entre mille putains à ses yeux bleus et étincelants ! Seulement donne-nous dix de tes gardes pour nous aidera nous en emparer ! » Et le wali, leur ayant donné les gardes demandés, ils sortirent du palais.
Or à peine avaient-ils fait quelques pas dans la rue, l’ânier en tête, qu’ils tombèrent juste sur la vieille, qui voulut alors leur échapper. Mais ils réussirent à l’attraper et lui attachèrent les mains derrière le dos et la traînèrent devant le wali qui lui demanda : « Qu’as-tu fait de toutes les choses volées ? » Elle répondit : « Moi ! je n’ai jamais rien volé à personne ! Et je n’ai rien vu ! Et je ne comprends pas ! » Alors le wali se tourna vers le gardien en chef des prisons et lui dit : « Jette-la jusqu’à demain dans ton cachot le plus moisi ! » Mais le geôlier répondit : « Par Allah ! je me garderai bien de prendre sur moi une telle responsabilité ! Je suis sûr qu’elle saura trouver un expédient pour m’échapper ! » Alors le wali se dit : « Le mieux, c’est de l’exposer à tous les regards, pour qu’elle ne puisse s’échapper, et de là faire surveiller toute cette nuit, pour que demain nous puissions la juger ! » Et il monta à cheval et, suivi de toute la bande, il la fit traîner hors des murs de Baghdad et attacher par les cheveux à un poteau en rase campagne. Puis, pour qu’il n’y eût pas de mécompte, il chargea les cinq plaignants eux-mêmes de la veiller cette nuit-là jusqu’au matin.
Donc les cinq, surtout l’ânier, commencèrent par assouvir sur elle leur ressentiment en l’appelant par tous les noms que leur suggéraient les avanies et escroqueries par eux subies ! Mais comme toute chose a une fin, même le fond du sac à quolibets d’un ânier et de la cuvette à malices d’un barbier et de la cuve à acides d’un teinturier, et comme d’ailleurs la privation de sommeil depuis trois jours et les émotions les avaient anéantis, les cinq plaignants, finirent, une fois leur repas terminé, par s’assoupir au pied du poteau où était attachée par les cheveux Dalila-la-Rouée.
Or, la nuit était déjà avancée, et les cinq compagnons ronflaient autour du poteau, lorsque deux Bédouins à cheval, qui s’entretenaient ensemble en allant au pas, s’approchèrent de l’endroit où était attachée Dalila. Et la vieille les entendit qui se faisaient part de leurs sensations. L’un des Bédouins, en effet, demandait à son compagnon : « Toi, frère, qu’as-tu fait de mieux durant ton séjour dans la merveilleuse Baghdad…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUARANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Toi, frère, qu’as-tu fait de mieux durant ton séjour dans la merveilleuse Baghdad ? » L’autre répondit, après un silence : « Moi, par Allah ! j’y ai mangé de délicieux beignets au miel et à la crème, ceux-là que j’aime ! Et voilà certes ce que j’ai fait de mieux à Baghdad ! » Alors l’autre, reniflant dans l’air l’odeur d’imaginaires beignets frits à l’huile et farcis de crème et dulcifiés de miel, s’écria : « Par l’honneur des Arabes ! je vais de ce pas aller à Baghdad manger de ces délicieuses bouchées-là dont je n’ai goûté de ma vie, durant mes courses dans le désert ! » Alors le Bédouin qui avait déjà mangé des beignets farcis à la crème et au miel prit congé de son compagnon l’alléché, pour retourner sur ses pas, tandis que celui-ci, continuant sa route sur Baghdad, arrivait au poteau et y découvrait Dalila attachée par les cheveux avec, autour d’elle, les cinq hommes endormis.
À cette vue, il s’approcha de la vieille et lui demanda : « Qui es-tu ? Et pourquoi es-tu là ! » Elle dit, en pleurant : « Ô cheikh des Arabes, je me mets sous ta protection ! » Il dit : « Allah est le plus grand Protecteur ! Mais pourquoi es-tu attachée à ce poteau ? » Elle répondit : « Sache, ô cheikh arabe, ô très honorable, que j’ai comme ennemi un pâtissier marchand de beignets farcis à la crème et au miel, qui est certainement le plus réputé à Baghdad pour la confection à point, dans la friture, de ces beignets. Or moi, l’autre jour, pour me venger d’une injure qu’il m’avait faite, je me suis approchée de sa devanture et j’ai craché sur ses beignets. Alors le pâtissier alla porter plainte contre moi au wali qui m’a condamnée à être attachée à ce poteau et à y demeurer si je ne puis manger, en une seule séance, dix plateaux entiers remplis de beignets. Et c’est demain matin que l’on doit me présenter les dix plateaux de beignets. Or moi, par Allah ! ô cheikh des Arabes, j’ai une âme qui a toujours eu du dégoût pour toutes les douceurs, et qui surtout n’accepte pas les beignets farcis de crème et de miel. Hélas sur moi ! Je vais donc me laisser ici mourir de faim ! » À ces paroles, le Bédouin s’écria : « Par l’honneur des Arabes ! moi je ne suis venu de ma tribu et je ne vais à Baghdad que pour satisfaire mon désir sur les beignets ! Si tu veux, ma bonne tante, je mangerai les plateaux à ta place ! » Elle répondit : « On ne te le laissera pas faire, à moins que tu ne sois attaché à ma place à ce poteau ! Et justement, comme j’ai toujours eu la figure voilée, nul ne m’a vue et ne saurait deviner le changement ! Tu n’as, pour cela, qu’à changer d’habits avec moi, après m’avoir détachée ! » Le Bédouin, qui ne demandait que cela, se hâta de la détacher et, après avoir changé d’habits avec elle, se fit attacher au poteau à sa place, tandis qu’elle-même, revêtue du burnous du Bédouin et la tête ceinte de ses cordelières noires en poils de chameau, sautait sur le cheval et disparaissait dans le loin, vers Baghdad.
Le lendemain, en ouvrant les yeux, les cinq, pour souhaiter le bonjour à la vieille, recommencèrent leurs invectives de la nuit. Mais le Bédouin leur dit : « Où sont les beignets ? Mon estomac les souhaite ardemment ! » En entendant cette voix, les cinq S’écrièrent : « Par Allah ! c’est un homme ! Et son parler est celui des Bédouins ! » Et l’ânier sauta sur ses pieds et s’approcha de lui, et lui demanda : « Ya Badawi, que fais-tu là ? Et comment as-tu osé détacher la vieille ? » Il répondit : « Où sont les beignets ? Je n’ai pas mangé de toute la nuit ! Surtout n’économisez pas le miel ! Elle, la pauvre vieille, avait une âme qui abhorrait les pâtisseries ; mais la mienne les aime bien ! »
À ces paroles, les cinq comprirent que le Bédouin avait été dupé comme eux par la vieille et, après s’être donné à eux-mêmes, dans leur désespoir, de grands coups sur le visage, s’écrièrent : « On ne peut fuir sa destinée ni éviter l’accomplissement de ce qui est écrit par Allah ! » Et pendant qu’ils étaient dans l’incertitude sur ce qui leur restait à faire, le wali, accompagné de ses gardes, arriva à l’endroit où ils se trouvaient, et s’approcha du poteau. Alors le Bédouin lui demanda : « Où sont les plateaux de beignets au miel ? » À ces paroles le wali leva les yeux vers le poteau et aperçut là le Bédouin à la place de la vieille ; et il demanda aux cinq : « Qu’est-ce que cela ? » Ils répondirent : « C’est la destinée ! » et ajoutèrent : « La vieille s’est échappée en dupant ce Bédouin. Et c’est toi, ô wali, que nous rendons responsable devant le khalifat de sa fuite ; car si tu nous avais donné des gardes pour la surveiller, elle n’aurait pas réussi à s’échapper. Nous ne sommes pas plus des gardes que nous ne sommes des esclaves bons à vendre ou à acheter ! » Alors le wali se tourna vers le Bédouin et lui demanda ce qui s’était passé ; et celui-ci, avec force exclamations de désir, lui raconta son histoire, et termina en disant : « À moi les beignets, maintenant ! » À ces paroles, le wali et les gardes lancèrent un considérable éclat de rire, alors que les cinq roulaient des yeux rouges de sang et de vengeance, et disaient au wali : « Nous ne te quitterons que chez notre maître l’émir des Croyants ! » Et le Bédouin, ayant fini par comprendre qu’il avait été dupé, dit également au wali : « Moi, je ne rends que toi seul responsable de la perte de mon cheval et de mes vêtements ! » Alors le wali fut obligé de les emmener et d’aller avec eu à Baghdad, au palais de l’émir des Croyants, le khalifat Haroun Al-Rachid…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUARANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… et d’aller avec eux à Baghdad, au palais de l’émir des Croyants, le khalifat Haroun Al-Rachid.
L’audience leur fut accordée et ils entrèrent au Diwân, où déjà les avait précédés le capitaine Fléau-des-Rues, l’un des premiers plaignants.
Le khalifat, qui faisait tout par lui-même, commença par les interroger l’un après l’autre, l’ânier le premier et le wali le dernier. Et chacun d’eux raconta au khalifat son histoire, avec tous ses détails.
Alors le khalifat, extrêmement émerveillé de toute l’affaire, dit à tous ceux-là : « Par l’honneur de mes aïeux les Bani-Abbas ! je vous donne l’assurance que tout ce qui vous a été dérobé vous sera rendu. Toi, l’ânier, tu auras ton âne et une indemnité ! Toi, le barbier, tu auras tous tes meubles et ustensiles ! Toi, marchand, ta bourse et tes vêtements ! Toi, juif, tes bijoux ! Toi, teinturier, une boutique neuve ! Et toi, cheikh arabe, ton cheval, tes habits et autant de plateaux de beignets au miel que peut en souhaiter la capacité de ton âme ! Aussi faut-il d’abord retrouver la vieille ! » Et il se tourna vers le wali et le capitaine Fléau et leur dit : « Toi, émir Khaled, tes mille dinars te seront également restitués ! Et toi, émir Mustapha, les bijoux et les vêtements de ton épouse et une indemnité. Mais il faut, à vous deux, retrouver la vieille ! Je vous charge de ce soin. »
À ces paroles, l’émir Khaled secoua ses habits et leva les bras au ciel, en s’écriant : « Par Allah ! ô émir des Croyants, excuse-moi ! Je n’ose me charger encore de l’accomplissement de cette tâche-là ! Après tous les tours que cette vieille m’a joués, je ne réponds pas qu’elle ne trouve encore quelque expédient pour se tirer d’affaire à mes dépens ! » Et le khalifat se mit à rire et lui dit : « Alors charge un autre de ce soin ! » Il dit : « Dans ce cas, ô émir des Croyants, donne toi-même l’ordre de rechercher la vieille à l’homme le plus habile de Baghdad, le chef même de la police de Ta Droite, Ahmad-la-Teigne ! Jusqu’à présent, malgré toute son habileté, les services qu’il peut rendre et les gros appointements qu’il touche chaque mois, il n’a encore rien eu à faire ! » Alors le khalifat appela : « Ya mokaddem Ahmad ! » Et Ahmad-la-Teigne s’avança aussitôt entre les mains du khalifat et dit : « À tes ordres, ô émir des Croyants ! » Le khalifat lui dit : « Écoute ! capitaine Ahmad, il y a une vieille qui a fait telle et telle choses ! Et c’est toi que je charge de la retrouver et de me l’amener ! » Et Ahmad-la-Teigne dit : « Je réponds d’elle, ô émir des Croyants ! » Et il sortit, suivi de ses quarante archers, tandis que le khalifat gardait auprès de lui les cinq et le Bédouin.
Or, le chef des archers d’Ahmad-la-Teigne était un homme rompu à ces sortes de recherches, et qui s’appelait Ayoub Dos-de-Chameau. Comme il avait l’habitude de parler librement à son chef Ahmad-la-Teigne, l’ancien larron, il s’approcha de lui et lui dit : « Capitaine Ahmad, il n’y a pas qu’une seule vieille dans Baghdad ; et la capture va être difficile, crois ma barbe ! » Et Ahmad-la-Teigne lui demanda : « Alors qu’as-tu à me dire à ce sujet, ô Ayoub Dos-de-Chameau ? » Il répondit : « Nous ne serons jamais assez nombreux pour arriver à circonvenir la vieille ; et je suis d’avis de décider le capitaine Hassan-la-Peste à nous accompagner avec ses quarante archers ; car il a mieux que nous l’expérience de ces sortes d’expéditions ! » Mais Ahmad-la-Teigne, qui ne voulait point partager avec son collègue la gloire de la capture, répondit à haute voix, de façon à être entendu de Hassan-la-Peste qui se tenait à la grande porte du palais : « Par Allah ! ô Dos-de-Chameau, depuis quand avons-nous besoin d’autrui pour faire nos affaires ? » Et il passa fièrement à cheval, avec ses quarante archers, devant Hassan-la-Peste mortifié de cette réponse et aussi du choix qu’avait fait le khalifat du seul Ahmad-la-Teigne, en le négligeant, lui Hassan ! Et il se dit : « Par la vie de ma tête rasée ! ils auront besoin de moi ! »
Quant à Ahmad-la-Teigne, une fois qu’il fut arrivé sur la place qui s’étendait devant le palais du khalifat, il harangua ses hommes, pour les encourager, et leur dit : « Ô mes braves, vous allez vous diviser en quatre groupes pour faire des perquisitions dans les quatre quartiers de Baghdad. Et demain, vers l’heure de midi, vous reviendrez tous me trouver au cabaret de la rue Mustapha pour me rendre compte de ce que vous aurez fait ou trouvé ! » Et, ayant ainsi convenu du point de réunion, ils se divisèrent en quatre groupes, qui allèrent parcourir chacun un quartier différent, tandis que de son côté Ahmad-la-Teigne se mettait à flairer le vent devant lui.
Mais pour ce qui est de Dalila et de sa fille Zeinab, elles ne tardèrent pas à apprendre, par la rumeur publique, les perquisitions dont le khalifat avait chargé Ahmad-la-Teigne dans le but d’arrêter une vieille friponne dont les ruses faisaient l’entretien de tout Baghdad. À cette nouvelle, Dalila dit à sa fille : « Ô fille mienne, je n’ai rien à craindre de tous ceux-là, du moment que Hassan-la-Peste n’est pas avec eux ; car Hassan est le seul homme à Baghdad dont je redoute la perspicacité, puisqu’il est le seul à me connaître et à te connaître ; et il peut, quand il veut, aujourd’hui même, venir nous arrêter sans que nous puissions trouver le moindre expédient pour lui échapper, Remercions donc le Protecteur qui nous protège ! » Sa fille Zeinab répondit : « Ô mère mienne, quelle belle occasion alors ce serait pour nous de jouer quelque tour excellent à cet Ahmad-la-Teigne et à ses quarante idiots ! Quelle joie ce serait, ô mère mienne ! » Dali la répondit : « Ô fille de mes entrailles, aujourd’hui je me sens un peu indisposée, et je compte sur toi pour berner ces quarante et un bandits ! La chose est aisée » et je ne doute pas de ta sagacité ! » Alors Zeinab, qui était une adolescente gracieuse et souple avec des yeux sombres dans un visage charmant et clair…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUARANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors Zeinab, qui était une adolescente gracieuse et souple avec des yeux sombres dans un visage charmant et clair, se leva aussitôt et s’habilla avec une grande élégance et se voila le visage d’une légère mousseline de soie, tant que l’éclat de ses yeux en était plus velouté et captivant. Alors, attifée de la sorte, elle vint embrasser sa mère et lui dit : « Ô mère, je jure, par la vie de mon cadenas intact et fermé ! de me rendre la maîtresse des Quarante et Un, et d’en faire mon jouet ! » Et elle sortit de la maison et s’en alla à la rue Mustapha, et entra dans le cabaret tenu par le Hagg-Karim de Mossoul.
Elle commença d’abord par faire un salam très gentil au Hagg-Karim, le cabaretier, qui, charmé, lui rendit au double son salam. Alors elle lui dit : « Ya Hagg-Karim, voici cinq dinars pour toi si tu veux me louer pour jusqu’à demain ta grande salle du fond, où je veux inviter quelques amis, sans que les clients ordinaires puissent y pénétrer ! » Il répondit : « Par ta vie, ô ma maîtresse, et par la vie de tes yeux, les beaux yeux, je consens à te louer ma grande salle pour rien, à charge seulement pour toi de ne point ménageries boissons à tes invités ! » Elle sourit et lui dit : « Ceux que j’invite, ya Hagg, sont des gargoulettes dont le potier a oublié de fermer le cul ! Toute ta boutique, quant à ses liquides, y passera ! Sois sans crainte à ce sujet ! » Et aussitôt elle retourna à la maison où elle prit l’âne de l’ânier et le cheval du Bédouin, les chargea de matelas, de tapis, d’escabeaux, de nappes, de plateaux, d’assiettes et autres ustensiles et revint en toute hâte au cabaret, et déchargea l’âne et le cheval de toutes ces choses pour les ranger dans la grande salle qu’elle avait louée. Elle tendit ensuite les nappes, mit en ordre les pots de boissons, les coupes et les mets qu’elle avait achetés, et, ce travail achevé, elle alla se poster à la porte du cabaret.
Il n’y avait pas longtemps qu’elle était là quand elle vit poindre dix des archers d’Ahmad-la-Teigne, avec, à leur tête, Dos-de-Chameau qui avait un air bien farouche. Et il se dirigea précisément vers la boutique, avec les neuf autres, et vit à son tour la belle adolescente qui avait pris soin de relever, comme par inadvertance, le léger voile de mousseline qui lui couvrait le visage. Et Dos-de-Chameau fut ébloui à la fois et charmé de sa jeune beauté si avenante, et lui demanda : « Que fais-tu là, ô jouvencelle ? » Elle répondit, en lui coulant de côté un regard langoureux : « Rien ! J’attends ma destinée ! Serais-tu le capitaine Ahmad ? » Il dit : « Non, par Allah ! Mais je puis le remplacer s’il s’agit d’un service que tu lui demandes, car je suis le chef de ses archers, Ayoub Dos-de-Chameau, ton esclave, ô œil de gazelle ! » Elle lui sourit encore et lui dit : « Par Allah ! ô chef archer, si la politesse et les bonnes manières voulaient élire un domicile sûr, elles choisiraient les quarante vôtres pour guides ! Entrez donc ici, et soyez les bienvenus ! L’accueil amical que vous trouverez chez moi n’est qu’un hommage dû aux hôtes charmants ! » Et elle les introduisit dans la salle apprêtée et, les ayant invités à s’asseoir autour des grands plateaux des boissons, leur offrit à boire du vin mélangé au soporifique bang. Aussi, dès les premières coupes vidées, les dix tombèrent sur le dos comme des éléphants ivres ou des buffles pris de vertige, et ils s’enfoncèrent dans un profond sommeil.
Alors Zeinab les traîna, à tour de rôle, par les pieds et les jeta tout au fond de la boutique en les entassant les uns sur les autres, les cacha sous une large couverture, tira sur eux un grand rideau, remit tout en ordre dans la pièce, et sortit se poster de nouveau à la porte du cabaret.
Bientôt apparut la seconde escouade de dix archers, qui subit le même ensorcellement par les yeux sombres et le visage clair de la belle Zeinab et le même traitement que la précédente, ainsi que la troisième et la quatrième escouades. Et l’adolescente, après avoir entassé tous les archers les uns sur les autres derrière le grand rideau, remit tout en ordre dans la salle et sortit attendre l’arrivée d’Ahmad-la-Teigne lui-même.
Elle n’était pas là depuis longtemps quand apparut sur son cheval, menaçant et les yeux chargés d’éclairs et les poils de la barbe et des moustaches hérissés comme les poils de la hyène affamée, Ahmad-la-Teigne. Arrivé devant la porte, il descendit de cheval et attacha la bête par la bride à l’un des anneaux en fer scellés dans les murs du cabaret, et s’écria : « Où sont-ils, tous ces fils de chiens ? Je leur avais ordonné de m’attendre ici ? Les aurais-tu vus, toi ? » Alors Zeinab balança ses hanches, coula un regard doux à gauche, puis un autre à droite, sourit de ses lèvres et dit : « Qui donc, ô mon maître ? » Or, Ahmad, des deux regards à lui jetés par l’adolescente, sentit ses entrailles lui bouleverser l’estomac, et gémir l’enfant, seul héritage qui lui restât, capital et intérêts ! Alors il dit à la souriante Zeinab immobile dans une pose naïve : « Ô jouvencelle, mes quarante archers ! » À ces paroles Zeinab, comme subitement prise d’un grand sentiment de respect, s’avança vers Ahmad-la-Teigne, et lui baisa la main en disant : « Ô capitaine Ahmad, chef de la Droite du khalifat, les quarante archers m’ont chargée de te dire qu’ils avaient aperçu, au fond de la ruelle, la vieille Dalila que tu cherches, et qu’ils allaient se mettre à sa poursuite sans s’arrêter ici ; mais ils t’assurent qu’ils reviendront bientôt avec elle ; et tu n’as qu’à les attendre dans la grande salle du cabaret où je te servirai moi-même avec mes yeux ! » Alors Ahmad-la-Teigne, précédé par l’adolescente, pénétra dans la boutique où il ne tarda pas, grisé par les charmes de la friponne et subjugué par ses artifices, à boire coupe sur coupe et à tomber comme mort sous l’effet opéré sur sa raison par le bang soporifique mélangé aux boissons.
Alors Zeinab, sans perdre de temps, commença par dépouiller Ahmad-la-Teigne de tous ses habits et de tout ce qu’il portait sur lui, ne lui laissant sur le corps que sa chemise et son large caleçon ; puis elle alla aux autres et les dépouilla de la même façon. Après quoi elle ramassa tous ses ustensiles et tous les effets qu’elle venait de voler, les chargea sur le cheval d’Ahmad-la-Teigne, sur celui du Bédouin et sur l’âne de l’ânier et, riche ainsi de tous ces trophées de sa victoire, elle regagna sa maison sans encombre, et remit le tout à sa mère Dalila qui l’embrassa en pleurant de joie.
Quant à Ahmad-la-Teigne et à ses quarante compagnons…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUARANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Quant à Ahmad-la-Teigne et à ses quarante compagnons, ils restèrent endormis pendant deux jours et deux nuits, et lorsque, au matin du troisième jour, ils se furent réveillés de leur sommeil extraordinaire, ils ne surent d’abord comment s’expliquer leur présence là-dedans, et finirent, à force de suppositions, par ne plus douter du tour qui leur avait été joué. Alors ils se trouvèrent fort humiliés, surtout Ahmad-la-Teigne qui avait montré une telle assurance en présence de Hassan-la-Peste, et qui éprouvait maintenant une grande honte à se montrer dans la rue, dans l’accoutrement où il se trouvait. Il se décida pourtant à sortir du cabaret et, précisément, la première personne qu’il rencontra sur sa route fut son collègue Hassan-la-Peste qui, le voyant ainsi vêtu de la chemise et du caleçon, et suivi de ses quarante archers accoutrés comme lui, comprit, à ce seul coup d’œil, l’aventure dont ils venaient tous d’être les victimes. À cette vue Hassan-la-Peste exulta à la limite de l’exultation et se mit à chanter ces vers :
« Les jeunes filles naïves croient tous les hommes semblables ! Elles ne savent point que nous ne nous ressemblons que par nos turbans !
» Parmi nous les uns sont des savants, et les autres des imbéciles ! N’y a-t-il point au ciel des étoiles sans éclat et d’autres qui sont des perles ?
» Les aigles et les faucons ne mangent point la chair morte ; mais les vautours impurs s’abattent sur les cadavres ! »
Lorsque Hassan-la-Peste eut fini de chanter, il s’approcha d’Ahmad-la-Teigne, qu’il feignit de reconnaître à l’instant, et lui dit : « Par Allah ! mokaddem Ahmad, les matinées sont fraîches sur le Tigre, et vous êtes des imprudents de sortir ainsi en chemise et en caleçon ! » Et Ahmad-la-Teigne répondit : « Et toi, ya Hassan, tu es encore plus lourd et plus froid d’esprit que cette matinée ! Nul n’échappe à son sort, et notre sort a été d’être joués par une jeune fille. La connaîtrais-tu, toi ? » Il répondit : « Je la connais et je connais sa mère ! Et si tu veux, je vais aller te les capturer à l’instant ? » Il demanda : « Et comment cela ? » Il répondit : « Tu n’auras qu’à te présenter devant le khalifat, et, en signe d’incapacité, tu secoueras ton collier ; et tu lui diras de me charger de la capture à ta place ! » Alors Ahmad-la-Teigne, après s’être habillé, alla au Diwân avec Hassan-la-Peste, et le khalifat lui demanda : « Où est la vieille, mokaddem Ahmad ? » Il secoua son collier et répondit : « Par Allah ! ô émir des Croyants, moi je ne la connais pas ! Le mokaddem Hassan ferait mieux l’affaire ! Il la connaît et affirme même que la vieille n’a fait tout cela que pour faire parler d’elle et attirer l’attention de notre maître le khalifat ! » Alors Al-Rachid se tourna vers Hassan et lui demanda : « Est-ce vrai, mokaddem Hassan ? Connais-tu la vieille ? Et crois-tu qu’elle n’a fait tout cela que pour mériter mes faveurs ? » Il répondit : « C’est vrai, ô émir des Croyants ! » Alors le khalifat s’écria : « Par la tombe et l’honneur de mes ancêtres ! si cette vieille restitue à tous ceux-là ce qu’elle leur a pris, je lui pardonne ! » Et Hassan-la-Peste dit : « Alors, ô émir des Croyants, donne-moi pour elle le sauf-conduit de la sécurité ! » Et le khalifat jeta son mouchoir à Hassan-la-Peste comme gage de sécurité pour la vieille.
Aussitôt Hassan, après avoir ramassé le gage de la sécurité, sortit du Diwân et courut directement à la maison de Dalila qu’il connaissait de longue date. Il frappa à la porte et Zeinab vint lui ouvrir elle-même. Il demanda : « Où est ta mère ? » Elle dit : « En haut ! » Il dit : « Va lui dire que Hassan, le mokaddem de la Gauche, est en bas porteur pour elle, de la part du khalifat, du mouchoir de la sécurité, mais à condition qu’elle restitue tout ce qu’elle a pris. Et dis-lui de descendre par les bonnes manières, sinon je serais obligé d’employer la force à son égard ! » Or Dalila, qui avait entendu ces paroles, s’écria du dedans : « Jette-moi le mouchoir de la sécurité ! Et je t’accompagne chez le khalifat avec toutes les choses enlevées ! » Alors la Peste lui jeta le mouchoir, dont aussitôt Dalila s’entoura le cou ; puis elle se mit, aidée par sa fille, à charger l’âne de l’ânier et les deux chevaux de tous les objets dérobés. Lorsqu’elles eurent fini, Hassan dit à Dalila : « Il reste encore les effets d’Ahmad-la-Teigne et de ses quarante ! » Elle répondit : « Par le Nom le Plus Grand ! ce n’est pas moi qui les ai enlevés ! » Il se mit à rire et dit : « C’est vrai ! Mais c’est ta fille Zeinab qui a joué le tour ! Soit ! Garde-les, ceux-là ! » Puis, suivi des trois bêtes qu’il traînait l’une derrière l’autre par une corde les reliant toutes, il emmena Dalila et la conduisit au Diwân, entre les mains du khalifat…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUARANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… il emmena Dalila et la conduisit au Diwân, entre les mains du khalifat.
Lorsque Al-Rachid vit entrer cette vieille diabolique, il ne put s’empêcher de crier l’ordre de la jeter immédiatement sur le tapis du sang pour qu’elle y fût exécutée. Alors elle s’écria : « Je suis sous ta protection, ô Hassan ! » Et Hassan-la-Peste se leva et baisa les mains du khalifat et lui dit : « Pardon pour elle, ô émir des Croyants ! Tu lui as donné le gage de la sécurité. Et le voilà à son cou ! » Le khalifat répondit : « C’est vrai ! Aussi je lui pardonne par égard pour toi ! » Puis il se tourna vers Dalila et lui dit : « Viens ici, ô vieille femme ! Quel est ton nom ? » Elle répondit : « Mon nom est Dalila, l’épouse de ton ancien directeur des pigeons ! » Il dit : « En vérité tu es une astucieuse pleine d’expédients. Et désormais tu seras appelé Dalila-la-Rouée ! » Puis il lui dit : « Peux-tu au moins me dire dans quel but tu as joué tous ces tours à ces gens que voici, et nous as donné tant de tracas en fatiguant nos cœurs ? » Alors Dalila se jeta aux pieds du khalifat, et répondit : « Moi, ô émir des Croyants, je n’ai point agi de la sorte par cupidité ! Mais, ayant entendu parler des anciens expédients et des tours joués autrefois dans Baghdad par les chefs de Ta Droite et de Ta Gauche, Ahmad-la-Teigne et Hassan-la-Peste, j’ai eu l’idée à mon tour de faire comme eux, sinon de les dépasser, afin de pouvoir obtenir de notre maître le khalifat les appointements et la charge de mon défunt mari, le père de mes pauvres filles ! »
À ces paroles, l’ânier se leva vivement et s’écria : « Qu’Allah juge et se prononce entre moi et cette vieille ! Elle ne s’est pas seulement contentée de me voler mon âne, mais elle a poussé le barbier moghrabin que voici à m’arracher mes deux molaires du fond et à me cautériser les deux tempes au fer rougi des clous ! » Et le Bédouin aussi se leva et s’écria : « Qu’Allah juge et se prononce entre moi et cette vieille ! Elle ne s’est pas seulement contentée de m’attacher au poteau à sa place et de me voler mon cheval, mais elle m’a occasionné une envie rentrée, en m’empêchant de satisfaire mon désir sur les beignets farcis au miel ! » Et le teinturier, le barbier, le jeune marchand, le capitaine Fléau, le juif et le wali se levèrent chacun à son tour en demandant à Allah la réparation des dommages à eux causés par la vieille. Aussi le khalifat, qui était magnanime et généreux, commença par rendre à chacun d’eux les objets qui leur avaient été volés, et les dédommagea amplement sur sa cassette particulière. Et spécialement à l’ânier, à cause de la perte de ses deux molaires et des cautérisations subies, il fit donner mille dinars d’or, et il le nomma chef de la corporation des âniers. Et tous sortirent du Diwân, en se félicitant de la générosité du khalifat et de sa justice, et oublièrent leurs tribulations.
Quant à Dalila, le khalifat lui dit : « Maintenant, ô Dalila, tu peux me demander ce que tu souhaites ! » Elle embrassa la terre entre les mains du khalifat et répondit : « Ô émir des Croyants, je ne souhaite qu’une seule chose de ta générosité, et c’est de rentrer dans la charge et les appointements de mon défunt mari, le directeur des pigeons messagers ! Et je saurai remplir ces fonctions, car du vivant de mon mari c’était moi qui, aidée de ma fille Zeinab, donnais les grains aux pigeons et nettoyais le pigeonnier et attachais les lettres à leur cou. Et c’était moi également qui surveillais le grand khân que tu as fait construire pour le service des pigeons, et que gardaient jour et nuit quarante nègres et quarante chiens, ceux-là mêmes que tu as pris au roi des Afghans, descendants de Soleimân, lors de ta victoire sur ce roi ! » Et le khalifat répondit : « Soit ! ô Dalila, je vais te faire écrire à l’instant la direction du grand khân des pigeons messagers et le commandement des quarante nègres et des quarante chiens enlevés au roi des Afghans, descendants de Soleimân ! Et tu seras ainsi responsable sur ta tête de la perte d’un de ces pigeons qui me sont plus précieux que la vie même de mes enfants. Mais je ne doute point de tes capacités ! » Alors Dalila ajouta : « Je voudrais également, ô émir des Croyants, que ma fille Zeinab habitât avec moi dans le khân pour m’aider dans la surveillance générale ! » Et le khalifat lui en donna l’autorisation.
Alors Dalila, après avoir baisé les mains du khalifat, se rendit à sa maison et, aidée par sa fille Zeinab, fit transporter ses meubles et ses effets dans le grand khân, et choisit comme lieu d’habitation le pavillon construit à l’entrée même du khân. Et, le jour même, elle prit le commandement des quarante nègres, et, habillée d’habits d’homme et la tête coiffée d’un casque d’or, elle se rendit à cheval auprès du khalifat pour prendre ses ordres et s’informer des messages qu’il pouvait y avoir à expédier dans les provinces ! Et, quand vint la nuit, elle lâcha dans la grande cour du khân, pour la garde, les quarante chiens de la race de ceux des bergers de Soleimân. Et tous les jours elle continua à se rendre au Diwân, à cheval, coiffée du casque d’or surmonté d’un pigeon en argent, et accompagnée du cortège de ses quarante nègres vêtus de soie rouge et de brocart. Et, pour orner sa nouvelle demeure, elle y suspendit les habits d’Ahmad-la-Teigne, d’Ayoub Dos-de-Chameau et de leurs compagnons.
Et c’est ainsi que dans Baghdad Dalila-la-Rouée et sa fille Zeinab-la-Fourbe obtinrent, par leur adresse et leurs artifices, la charge si honorable de la direction des pigeons, et le commandement des quarante nègres et des quarante chiens gardiens nocturnes du grand khân ! Mais Allah est plus savant !
— Or, maintenant, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, il est temps de te parler d’Ali Vif-Argent et de ses aventures avec Dalila et sa fille Zeinab, et avec le frère de Dalila, Zaraïk, marchand de poisson frit, et le Juif magicien Azaria ! Car ces aventures sont infiniment plus étonnantes et plus extraordinaires que toutes celles entendues jusqu’à présent ? » Et le roi Schahriar se dit en lui-même : « Par Allah ! je ne la tuerai qu’après avoir entendu les aventures d’Ali Vif-Argent ? » Et Schahrazade, voyant apparaître le matin, se tut discrètement.
LA QUATRE CENT QUARANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait à Baghdad, du temps où y vivaient Ahmad-la-Teigne et Hassan-la-Peste, un autre larron si subtil et si fluide que jamais les gens de la police ne pouvaient mettre la main sur lui ; car sitôt qu’ils croyaient le tenir, il leur échappait comme glisse d’entre les doigts une boule de vif-argent qu’on essaye de saisir. C’est pourquoi on l’avait autrefois surnommé, au Caire, sa patrie, Ali Vif-Argent.
En effet ! Avant son arrivée à Baghdad, Ali Vif-Argent demeurait au Caire, et il n’en était parti pour venir à Baghdad qu’à la suite de circonstances dignes de mémoire, et qui méritent d’être mentionnées au commencement de cette histoire.
Il était un jour assis, triste et désœuvré, au milieu de ses compagnons dans la salle souterraine qui leur servait de point de réunion ; et ceux-ci, voyant qu’il avait le cœur serré et la poitrine rétrécie, essayaient de le distraire, mais il restait farouche dans son coin, avec le visage renfrogné, les traits contractés et les sourcils froncés. Alors l’un d’eux lui dit : « Ô notre grand, pour te dilater la poitrine il n’y a rien de mieux qu’une promenade à travers les rues et les souks du Caire ! » Et Ali Vif-Argent, pour en finir, se leva et sortit errer à travers les quartiers du Caire, sans que s’éclaircît son humeur noire. Et il arriva de la sorte à la rue Rouge, alors que sur son passage tous les gens s’écartaient avec empressement par égard et respect pour lui.
Comme il débouchait dans la rue Rouge et voulait entrer dans un cabaret où il avait coutume de s’enivrer, il vit, près de la porte, un porteur d’eau qui avait son outre en peau de chèvre sur le dos, et allait son chemin en faisant tinter l’une sur l’autre les deux tasses de cuivre où il versait l’eau à boire aux altérés. Et il chantait son cri de rue, où son eau devenait tantôt du miel tantôt du vin, au gré du désir ! Et ce jour-là il chantait ainsi son cri, en le rythmant au tintement de ses deux tasses entre-choquées :
« C’est du raisin que vient la meilleure liqueur ! Il n’est point de bonheur sans un ami de cœur ! Le délice chez soi double ainsi de valeur ! Et la place d’honneur est pour le beau parleur ! »
Lorsque le porteur d’eau aperçut Ali Vif-Argent, il fit tinter en son honneur les deux tasses retentissantes, et chanta :
« Ô passant, voilà la pure ! la douce, la délicieuse, la fraîche, l’eau ! l’œil du coq, mon eau ! le cristal, mon eau ! l’œil, ô mon eau ! la joie des gosiers ! le diamant ! l’eau, l’eau, mon eau ! »
Puis il demanda : « Mon seigneur, en veux-tu une tasse ? » Vif-Argent répondit : « Donne ! » Et le porteur lui remplit une tasse, qu’il eut soin au préalable de soigneusement rincer, et la lui offrit, disant : « Le délice ! » Mais Ali, ayant pris la tasse, la regarda un instant, l’agita et en répandit l’eau à terre, en disant : « Donne-m’en une autre ! » Alors le porteur, formalisé, le mesura des yeux, et s’écria : « Par Allah ! et que trouves-tu dans cette eau plus claire que l’œil du coq, pour ainsi la répandre à terre ? » Il répondit : « C’est mon plaisir ! Verse-m’en une autre ! » Et le porteur remplit d’eau la tasse pour la seconde fois et l’offrit religieusement à Ali Vif-Argent qui la prit et la répandit encore, en disant : « Remplis-la-moi encore une fois ! » Et le porteur s’écria : « Ya sidi, si tu ne veux pas boire, laisse-moi continuer mon chemin ! » et il lui tendit une troisième tasse d’eau. Mais cette fois Vif-Argent vida la tasse d’un trait et la remit au porteur en y déposant un dinar d’or, comme gratification. Or le porteur, loin de se montrer satisfait d’une pareille aubaine, toisa du regard Vif-Argent et lui dit d’un ton narquois : « Bonne chance à toi, mon seigneur, bonne chance à toi ! Les petites gens sont une chose, et les grands seigneurs tout autre chose ! » À ces paroles, Ali Vif-Argent, à qui il ne fallait pas tant pour que la colère le fît éternuer, saisit le porteur d’eau par son caban, lui administra une volée de coups de poing en le secouant, lui et son outre, l’accula contre le mur de la fontaine publique de la rue Rouge, et lui cria : « Ah ! fils d’entremetteur, tu trouves qu’un dinar d’or c’est peu pour trois tasses d’eau ? Ah ! c’est bien peu ? Mais ton outre, telle quelle, vaut à peine trois pièces d’argent, et la quantité d’eau que j’ai jetée ou bue n’arrive même pas à une pinte ! » Le porteur répondit : « C’est juste, mon seigneur ! » Vif-Argent demanda : « Mais alors pourquoi m’as-tu parlé de la sorte ? Aurais-tu trouvé dans ta vie quelqu’un plus généreux que je ne le suis envers toi ? » Le porteur d’eau répondit : « Oui, par Allah ! J’ai rencontré dans ma vie quelqu’un plus généreux que toi ! Car tant que les femmes seront enceintes et engendreront des enfants, il y aura toujours sur la terre des hommes au cœur généreux ! » Vif-Argent demanda : « Et pourrais-tu me dire quel est cet homme, plus généreux que moi, que tu as rencontré ! » Le porteur d’eau répondit : « Lâche-moi d’abord, et assieds-toi là, sur la marche de la fontaine ! Et je te raconterai mon aventure qui est étrange extrêmement ! » Alors Ali Vif-Argent lâcha le porteur d’eau ; et, tous deux s’étant assis sur l’un des degrés de marbre de la fontaine publique, à côté de l’outre déposée sur le sol, le porteur d’eau raconta…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT CINQUANTIÈME NUIT
Elle dit :
… et, tous deux s’étant assis sur l’un des degrés de marbre de la fontaine publique, à côté de l’outre déposée sur le sol, le porteur d’eau raconta :
« Sache, ô mon généreux maître, que mon père était le cheikh de la corporation des porteurs d’eau du Caire, non point des porteurs qui vendent l’eau en gros aux maisons, mais de ceux qui, comme moi, la vendent au détail, en la débitant dans les rues sur leur dos.
« Lorsque mon père mourut, il me laissa en héritage cinq chameaux, un mulet, la boutique et la maison. C’était plus qu’il ne fallait à un homme de ma condition pour vivre heureux ! Mais, ô mon maître, le pauvre n’est jamais satisfait ; et le jour où par hasard il est enfin satisfait, il meurt ! Moi donc je pensai en mon âme : « Je vais augmenter mon héritage par le trafic et le commerce ! » Et aussitôt j’allai trouver divers prêteurs qui me confièrent des marchandises. Je chargeai ces marchandises sur mes chameaux et mon mulet, et partis trafiquer au Hedjaz, au temps du pèlerinage de la Mecque. Mais, ô mon maître, le pauvre ne s’enrichit jamais ; et s’il s’enrichit, il meurt ! Moi je fis un trafic si malheureux qu’avant la fin du pèlerinage je perdis tout ce que je possédais, et fus obligé de vendre mes chameaux et mon mulet pour subvenir au plus pressé. Et je me dis : « Si tu retournes au Caire, tes créanciers vont te saisir et te jeter en prison ! » Alors moi je me joignis à la caravane de Syrie, et j’allai à Damas, à Alep et de là à Baghdad.
« Une fois arrivé à Baghdad, je m’informai du chef de la corporation des porteurs d’eau et me rendis auprès de lui. Je commençai, en bon musulman, par lui réciter le chapitre liminaire du Korân, et lui souhaitai la paix. Alors il m’interrogea sur mon état, et je lui racontai tout ce qui m’était arrivé. Et lui, sans tarder, il me donna une camisole, une outre et deux tasses pour que je pusse gagner ma vie. Et je sortis sur la voie d’Allah un matin, avec mon outre sur le dos, et me mis à circuler dans les divers quartiers de la ville, en chantant mon cri, comme les porteurs d’eau du Caire. Mais, ô mon maître, le pauvre reste pauvre, puisque c’est sa destinée !
« En effet, je ne tardai pas à voir combien grande était la différence entre les habitants de Baghdad et ceux du Caire. À Baghdad, ô mon maître, les gens n’ont pas soif ; et ceux qui, par hasard, se décident à boire ne paient pas ! Car l’eau est à Allah ! Je vis donc combien le métier était mauvais, aux réponses des premiers auxquels je fis mes offres chantées. En effet, comme je tendais ma tasse à l’un d’eux, il me répondit : « M’as-tu donc donné à manger, pour m’offrir à boire ! » Moi, je continuai alors mon chemin, en m’étonnant du procédé et de ce mauvais présage de début, et je tendis la tasse à un second ; mais il me répondit : « Le gain est sur Allah ! passe ton chemin, ô porteur ! » Moi, je ne voulus point me décourager, et continuai à cheminer à travers les souks, en m’arrêtant devant les boutiques bien achalandées, mais personne ne me fit signe de verser, ni ne voulut se laisser tenter par mes offres et le tintement de mes gobelets de cuivre. Et je restai de la sorte jusqu’à midi sans avoir gagné de quoi m’acheter une galette de pain et un concombre. Car, ô mon maître, la destinée du pauvre l’oblige à avoir faim quelquefois. Mais la faim, ô mon maître, est moins dure que l’humiliation ! Et le riche éprouve bien des humiliations, et les supporte moins bien que le pauvre qui n’a rien à perdre ni à gagner. Ainsi moi, par exemple, si je me suis formalisé de ton emportement, ce n’est point à cause de moi, mais à cause de mon eau qui est un don excellent d’Allah ! Mais toi, ô mon maître, ton emportement contre moi est dû à des motifs qui te touchent dans ta personne !
« Donc moi, en voyant mon séjour à Baghdad commencer d’une manière si attristante, je pensai en mon âme : « Mieux eût valu pour toi, ô pauvre, mourir dans une prison de ton pays qu’au milieu de ces gens qui n’aiment pas l’eau ! » Et comme je m’appesantissais dans mes pensées, je vis soudain une grande poussée se faire dans le souk et des gens courir dans une certaine direction. Alors moi, dont le métier est d’être là où se trouve la foule, je courus de toutes mes forces, avec mon outre sur le dos ; et je suivis le mouvement. Et je vis alors un cortège splendide composé d’hommes qui marchaient sur deux rangs, portaient de longs bâtons à la main, étaient coiffés de grands bonnets enrichis de perles, étaient habillés de beaux burnous en soie, et laissaient pendre à leur côté de beaux glaives incrustés richement. Et à leur tête marchait un cavalier à l’aspect terrible, devant qui s’inclinaient toutes les têtes jusqu’à terre. Alors moi je demandai : « Pour qui ce cortège ? Et qui est ce cavalier ? » On me répondit : « On voit bien, à ton accent égyptien et à ton ignorance, que tu n’es point de Baghdad ! Ce cortège est celui du mokaddem Ahmad-la-Teigne, le chef de police de la Droite du khalifat, celui qui est chargé de maintenir l’ordre dans les faubourgs. Et c’est lui-même que tu vois à cheval. Il est très honoré, et a des appointements de mille dinars par mois, exactement comme son collègue Hassan-la-Peste, chef de la Gauche ! Et chacun de leurs hommes touche cent dinars par mois ! Ils viennent justement de sortir du Diwân, et vont rentrer chez eux prendre leur repas de midi ! »
« Alors moi, ô mon maître, je me mis à chanter mon cri, selon le mode égyptien, exactement comme tu m’as entendu le faire tout à l’heure, en m’accompagnant au rythme de mes gobelets retentissants. Et je fis si bien que le mokaddem Ahmad m’entendit et m’aperçut et, poussant son cheval de mon côté, me dit : « Ô frère d’Égypte, je te reconnais à ton chant ! Donne-moi une tasse de ton eau ! » Et il prit la tasse que je lui tendais, la secoua et jeta le contenu à terre, pour me la faire remplir une seconde fois et en répandre encore l’eau à terre, exactement comme toi, ô mon maître, et boire d’un trait la troisième tasse qu’il me fit remplir. Puis il s’écria à haute voix : « Vive le Caire avec ses habitants, ô porteur, mon frère ! Pourquoi es-tu venu dans cette ville où les porteurs d’eau ne sont point estimés et rémunérés ? » Et moi je lui racontai mon histoire et lui fis comprendre que j’étais endetté, et en fuite précisément à cause de mes dettes et de ma détresse ! Alors il s’écria : « Sois donc le bienvenu à Baghdad ! » et il me donna cinq dinars d’or et, se tournant vers tous les hommes de son cortège, il leur dit : « Pour l’amour d’Allah, je recommande cet homme de ma patrie à votre libéralité ! » Aussitôt chaque homme du cortège me demanda une tasse d’eau et, après l’avoir vidée, y déposa un dinar d’or ! Si bien que j’eus, au bout de ma tournée, plus de cent dinars d’or dans la boîte en cuivre pendue à ma ceinture. Puis le mokaddem Ahmad-la-Teigne me dit : « Durant tout ton séjour à Baghdad, telle sera ta rémunération chaque fois que tu nous verseras à boire ! » Aussi, en peu de jours, ma boite de cuivre se trouva plusieurs fois remplie ; et moi je comptai les dinars et vis qu’il y en avait mille et quelques ! Alors je pensai en mon âme : « Il est maintenant venu pour toi, le temps de retourner dans ton pays, ô porteur ! car, si bien qu’on soit sur une terre étrangère, on se trouve encore mieux dans sa patrie ! Et d’ailleurs tu as des dettes, et il te faut aller les payer ! » Alors je me dirigeai vers le Diwân, où déjà l’on me connaissait et où l’on me traitait avec beaucoup d’égards ; et j’entrai prendre congé de mon bienfaiteur, en lui récitant ces vers…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT CINQUANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … et j’entrai prendre congé de mon bienfaiteur, en lui récitant ces vers :
« La demeure de l’étranger sur la terre étrangère est semblable à un édifice construit sur les vents.
« Le vent souffle, l’édifice s’écroule et l’étranger l’abandonne ! Mieux eût-il valu ne rien construire ! »
« Puis je lui dis : « Voici d’ailleurs qu’une caravane part pour le Caire, et je voudrais bien me joindre à elle pour retourner au milieu des miens ! » Alors il me donna une mule et cent dinars, et me dit : « Je voudrais, à mon tour, te charger, ô cheikh, d’une commission de confiance. Connais-tu beaucoup de gens au Caire ? » Je répondis : « Je connais tous les gens généreux qui l’habitent. » Il me dit : « Alors prends cette lettre que voici, et remets-la en mains propres à mon ancien compagnon Ali Vif-Argent du Caire ; et dis-lui de ma part : « Ton grand t’envoie ses salams et ses souhaits ! Il est maintenant avec le khalifat Haroun Al-Rachid ! »
« Moi alors je pris la lettre, je baisai la main du mokaddem Ahmad, et je quittai Baghdad pour le Caire, où j’arrivai il y a à peine cinq jours. Je commençai par aller trouver mes créanciers que je payai intégralement avec tout l’argent que j’avais gagné à Baghdad, grâce à la générosité d’Ahmad-la-Teigne. Après quoi je revêtis ma camisole de cuir, je chargeai mon outre sur mon dos, et je devins porteur d’eau comme avant, tel que tu me vois, ô mon maître ! Mais j’ai beau chercher dans tout le Caire l’ami d’Ahmad-la-Teigne, Ali Vif-Argent, je ne puis arriver à le trouver pour lui remettre la lettre que je porte toujours dans la doublure de mon caban !
« Et telle est, ô mon maître, l’aventure que j’ai eue avec le plus généreux de mes clients ! »
Lorsque le porteur d’eau eut fini de raconter son histoire, Ali Vif-Argent se leva et l’embrassa comme le frère embrasse son frère, et lui dit : « Ô porteur, mon semblable, pardonne-moi mon emportement de tout à l’heure à ton égard ! L’homme, certes plus généreux que moi, le seul plus généreux que moi, que tu as rencontré à Baghdad est mon ancien chef grand ! Car c’est moi-même Ali Vif-Argent que tu cherches, le premier compagnon d’Ahmad-la-Teigne ! Réjouis donc ton âme, rafraîchis tes yeux et ton cœur et donne-moi la lettre de mon grand ! » Alors le porteur d’eau lui remit la lettre qu’il ouvrit et où il lut ce qui suit :
« Le salam du mokaddem Ahmad au plus illustre et au premier de ses enfants Ali Vif-Argent !
« Je t’écris, ô ornement des plus beaux, sur une feuille qui volera vers toi avec les vents.
« Si moi-même j’étais oiseau, je m’envolerais de désir vers tes bras ! Mais un oiseau dont on a coupé les ailes pourrait-il encore s’envoler ?
« Sache, en effet, ô le plus beau, que je suis maintenant à la tête des quarante gaillards d’Ayoub Dos-de-Chameau, tous, comme nous, d’anciens braves, auteurs de mille superbes coups. Et j’ai été nommé par le khalifat Haroun Al-Rachid, notre maître, chef de police de Sa Droite, chargé de la garde de la ville et des faubourgs, avec des appointements de mille dinars par mois, sans compter les rentrées extraordinaires et ordinaires de la part des gens qui veulent obtenir mes bonnes grâces.
« Si donc, ô le plus cher, tu veux donner un vaste meidân à l’essor de ton génie et t’ouvrir la porte des honneurs et des richesses, tu n’as qu’à venir rejoindre ton ancien à Baghdad. Tu accompliras ici quelques hauts exploits, et je te promets de t’obtenir les faveurs du khalifat, une place digne de toi et de notre amitié, et un traitement aussi considérable que le mien.
« Viens donc, mon fils, viens me rejoindre et me dilater le cœur par ta présence désirée !
« Et que la Paix d’Allah et ses bénédictions soient sur toi, ya Ali ! »
Lorsque Ali Vif-Argent eut lu cette lettre d’Ahmad-la-Teigne son grand, il se trémoussa de joie et d’émotion et, brandissant son long bâton d’une main et la lettre de l’autre main, il exécuta une danse fantastique sur les marches de la fontaine, en bousculant les vieilles femmes et les mendiants. Puis il baisa plusieurs fois la lettre en la portant ensuite à son front ; et il défit sa ceinture de cuir et la vida de toutes les pièces d’or qu’elle contenait entre les mains du porteur d’eau, pour le remercier de la bonne nouvelle et de la commission. Et il se hâta d’aller rejoindre, dans le souterrain, les gaillards de sa bande pour leur annoncer son départ immédiat pour Baghdad.
Lorsqu’il fut arrivé au milieu d’eux, il leur dit : « Mes enfants, je vous recommande les uns aux autres ! » Alors son lieutenant s’écria : « Comment, maître ! Tu nous quittes donc ? » Il répondit : « Ma destinée m’attend à Baghdad, entre les mains de mon grand, Ahmad-la-Teigne ! » Il dit : « Le moment est bien difficile pour nous justement ! Notre magasin de provisions est vide ! Et sans toi qu’allons-nous devenir ? » Il répondit : « Avant même mon arrivée à Baghdad, dès que je serai entré dans Damas, je saurai bien trouver, pour vous l’envoyer, de quoi subvenir à tous vos besoins. Soyez donc sans crainte, mes enfants ! » Puis il enleva les vêtements qu’il portait, fit ses ablutions et s’habilla d’une robe serrée à la taille, d’un grand manteau de voyage aux vastes manches, enfonça dans sa ceinture de cuir deux poignards et un coutelas, se coiffa d’un extraordinaire tarbousch, et prit à la main une immense lance, longue de quarante-deux coudées, et faite en nœuds de bambou qui pouvaient rentrer les uns dans les autres à volonté. Puis il sauta sur le dos de son cheval et s’en alla.
Il était à peine sorti du Caire, qu’il aperçut…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT CINQUANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Il était à peine sorti du Caire qu’il aperçut une caravane dont il s’approcha et à laquelle il se joignit, ayant appris qu’elle se dirigeait vers Damas et Baghdad. Cette caravane était celle du syndic des marchands de Damas, homme fort riche, qui revenait de la Mecque et regagnait son pays. Or Ali, qui était jeune, beau et sans poils encore sur les joues, plut à l’extrême au syndic des marchands, aux chameliers et aux muletiers, et sut, tout en se défendant contre leurs diverses entreprises nocturnes, leur rendre quantité de services appréciables en les protégeant contre les Bédouins pillards et les lions du désert ; si bien qu’à leur arrivée à Damas ils lui marquèrent leur reconnaissance en le gratifiant chacun de cinq dinars ; et le syndic des marchands lui donna mille dinars. Et Ali, qui n’oubliait point ses compagnons du Caire, se hâta de leur envoyer tout cet argent, ne gardant sur lui que juste ce qui lui était nécessaire pour continuer sa route et arriver enfin à Baghdad !
Et voilà comment Ali Vif-Argent du Caire avait quitté son pays pour aller à Baghdad chercher sa destinée entre les mains d’Ahmad-la-Teigne, son grand, l’ancien chef des braves.
Dès qu’il fut entré dans la ville, il se mit à chercher la demeure de son ami, et s’en informa à plusieurs personnes qui ne purent ou ne voulurent la lui indiquer. Et il arriva de la sorte sur une place, nommée Al-Nafz, où il vit des jeunes garçons qui jouaient entre eux, sous la direction d’un autre, plus petit qu’eux tous, et qu’ils appelaient Mahmoud l’Avorton. Et c’était justement ce petit Mahmoud l’Avorton-là qui était le fils de la sœur de Zeinab, celle-là qui était mariée. Et Ali Vif-Argent pensa en lui-même : « Ya Ali, les nouvelles des gens se prennent chez leurs enfants ! » Et aussitôt, pour attirer à lui les enfants, il se dirigea vers la boutique d’un marchand de douceurs, et y acheta un gros morceau de halawa à l’huile de sésame et au sucre ; puis il s’approcha des petits joueurs et leur cria : « Qui de vous veut du halawa encore chaud ? » Mais Mahmoud l’Avorton empêcha les enfants de s’avancer, et vint tout seul devant Ali et lui dit : « Donne le halawa ! » Alors Ali lui donna le morceau et, en même temps, lui glissa dans la main une pièce d’argent. Mais lorsque l’Avorton vit l’argent, il crut que l’homme le lui donnait pour l’entreprendre et le séduire, et il lui cria : « Va-t’en ! Je ne me vends pas ! Je ne fais pas de turpitudes ! Interroge les autres sur moi, et ils te répondront ! » Ali Vif-Argent, qui ne pensait point à ce moment-là à des turpitudes ou autres choses semblables, dit au petit crapuleux : « Mon enfant, ce que je te donne là est le prix d’un renseignement que je veux te demander ; et je te paie de la sorte, parce que les braves paient toujours les services qu’ils demandent à d’autres braves. Peux-tu seulement me dire où se trouve la demeure du mokaddem Ahmad la-Teigne ? » L’Avorton répondit : « Si ce n’est que cela que tu me demandes, la chose est facile ! Je vais marcher devant toi, et quand j’arriverai devant la maison d’Ahmad-la-Teigne, j’attraperai un caillou avec mes orteils nus et je le lancerai contre la porte. De cette façon personne ne me verra te donner l’indication. Et tu sauras de la sorte quelle est la demeure d’Ahmad-la-Teigne ! » Et il se mit effectivement à courir devant Vif-Argent, et, au bout d’un certain temps, il ramassa un caillou avec ses orteils nus et le lança, sans bouger, contre la porte d’une maison ! Et Vif-Argent émerveillé de la prudence, de la précocité, de l’adresse, de la méfiance, de la malice et de la finesse du garnement, s’écria : « Inschallah, ya Mahmoud, le jour où moi aussi je serai nommé capitaine de la garde ou chef de police, je te choisirai le premier pour être du nombre de mes braves ! » Puis Ali frappa à la porte d’Ahmad-la-Teigne.
Lorsque Ahmad-la-Teigne entendit les coups frappés à sa porte, il bondit sur ses deux pieds, à la limite de l’émotion, et cria à son lieutenant Dos-de-Chameau : « Ô Dos-de-Chameau, va vite ouvrir au plus beau des fils des hommes ! Celui qui frappe à ma porte n’est autre que mon ancien lieutenant du Caire, Ali Vif-Argent ! Je le reconnais à sa manière de frapper ! » Et Dos-de-Chameau ne douta pas un instant que ce fût précisément Ali Vif-Argent qui était là, et se hâta d’aller lui ouvrir la porte et de l’introduire auprès d’Ahmad-la-Teigne. Et les deux anciens amis s’embrassèrent tendrement ; et Ahmad-la-Teigne, après les premières effusions et les salams réitérés, le mit en présence de ses quarante gardes qui lui souhaitèrent la bienvenue comme à leur frère. Après quoi Ahmad-la-Teigne l’habilla d’une magnifique robe en lui disant : « Quand le khalifat m’a nommé chef de Sa Droite et donné les habillements de mes hommes, j’ai mis pour toi de côté cette robe, pensant qu’un jour ou l’autre je te retrouverais ! » Puis il le fit s’asseoir au milieu d’eux à la place d’honneur ; et il fit servir un festin prodigieux pour fêter son retour ; et ils se mirent tous à manger, à boire et à se réjouir, durant toute cette nuit-là !
Le lendemain matin, comme c’était l’heure pour Ahmad de se rendre au Diwân à la tête de ses quarante, il dit à son ami Ali : « Ya Ali, il te faut être prudent au commencement de ton séjour à Baghdad. Garde-toi donc bien de sortir de la maison, pour ne point attirer sur toi la curiosité des habitants d’ici, qui sont gluants ! Ne crois point que Baghdad soit le Caire ! Baghdad est le siège du khalifat, et les espions y fourmillent comme en Égypte les mouches, et les escrocs et les roués y pullulent comme là-bas les oies et les crapauds ! » Et Ali Vif-Argent répondit : « Ô mon grand, suis-je donc venu à Baghdad pour m’enfermer comme une vierge entre les murs d’une maison ? » Mais Ahmad lui conseilla la patience et s’en alla au Diwân à la tête de ses archers.
Quant à Ali Vif-Argent…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT CINQUANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Quant à Ali Vif-Argent il eut la patience de rester enfermé trois jours dans la maison de son ami. Mais le quatrième jour il sentit se contracter son cœur et se rétrécir sa poitrine, et il demanda à Ahmad si le temps n’était point venu pour lui de commencer les exploits qui devaient l’illustrer et lui mériter les faveurs du khalifat ? Ahmad répondit : « Toute chose vient en son temps, mon fils. Laisse-moi entièrement le soin de m’occuper de toi et de pressentir le khalifat à ton sujet, avant même que tu aies accompli tes exploits ! »
Mais dès qu’Ahmad-la-Teigne fut sorti, Vif-Argent ne put plus rester en place, et se dit : « Je vais aller simplement respirer un peu d’air pour me dilater la poitrine ! » Et il quitta la maison et se mit à parcourir les rues de Baghdad, en passant d’un endroit à l’autre, et s’arrêtant quelquefois chez un pâtissier ou dans une boutique de cuisinier pour manger un morceau ou avaler une bouchée de pâtisserie. Et voici qu’il aperçut un cortège de quarante nègres habillés de soie rouge, coiffés de hauts bonnets de feutre blanc et armés de grands coutelas d’acier. Ils marchaient deux par deux, en bon ordre ; et derrière eux, montée sur une mule harnachée richement, coiffée d’un casque d’or surmonté d’une colombe en argent, et revêtue d’une cotte de mailles en acier, s’avançait, dans sa gloire et sa splendeur, la directrice des pigeons, Dalila-la-Rouée !
Elle venait précisément de sortir du Diwân et rentrait au khân. Mais comme elle passait devant Ali Vif-Argent, qu’elle ne connaissait pas et qui ne la connaissait pas, elle fut étonnée de sa beauté, de sa jeunesse, de sa belle taille, de son maintien élégant, de son extérieur agréable et surtout de sa ressemblance, comme expression de regard, avec Ahmad-la-Teigne lui-même, son ennemi. Et aussitôt elle dit un mot à l’un de ses nègres, qui alla s’informer en cachette auprès des marchands du souk du nom et de la condition du beau jeune homme ; mais nul ne sut le renseigner. Aussi lorsque Dalila fut rentrée à son pavillon du khân, elle appela sa fille Zeinab et lui dit d’apporter la table du sable divinatoire ; puis elle ajouta : « Ma fille, je viens de rencontrer dans le souk un jeune homme si beau que la beauté le reconnaîtrait pour l’un de ses favoris ! Mais, ô ma fille, son regard ressemble étrangement à celui de notre ennemi Ahmad-la-Teigne ! Et je crains fort que cet étranger, que personne ne connaît dans le souk, ne soit venu à Baghdad pour nous jouer quelque mauvais tour ! C’est pour cela que je vais consulter à son sujet ma table divinatoire ! »
À ces paroles, elle agita le sable, selon le mode cabalistique, en marmottant des paroles talismaniques et lisant à l’envers des lignes hébraïques ; puis elle fit, sur un grimoire, des combinaisons de nombres et de lettres algébriques et alchimiques, et, se tournant vers sa fille, lui dit : « Ô fille mienne, ce beau jeune homme s’appelle Ali Vif-Argent du Caire ! Il est l’ami de notre ennemi Ahmad-la-Teigne qui ne l’a fait venir à Baghdad que pour nous jouer quelque mauvais tour, et se venger ainsi de celui que tu lui as joué toi-même en l’enivrant et le dépouillement de ses habits, lui et ses quarante ! » D’ailleurs il loge dans la maison même d’Ahmad-la-Teigne ! » Mais sa fille Zeinab lui répondit : « Ô mère mienne, et qu’est-il après tout, celui-là encore ! Ne voilà-t-il pas que tu fais cas de cet imberbe jouvenceau ! » Elle répondit : « La table de sable vient de me révéler, en outre, que la chance de cet adolescent remportera, et de beaucoup, sur ma chance et la tienne ! » Elle dit : « Nous allons bien voir, ô mère ! » Et aussitôt elle se vêtit de sa plus belle robe, après s’être velouté le regard avec sa baguette de kohl et joint les sourcils avec sa patte noire parfumée, et sortit pour tâcher de rencontrer le jeune homme en question.
Elle se mit à parcourir lentement les souks de Baghdad, en balançant ses hanches et mouvant ses yeux sous sa voilette, et lançant les regards destructeurs des cœurs, avec des sourires aux uns, des promesses tacites aux autres, des coquetteries, des minauderies, des agaceries, des réponses avec les yeux, des demandes avec les sourcils, des assassinats avec les cils, des réveils avec les bracelets, de la musique avec ses grelots et du feu dans toutes les entrailles, jusqu’à ce qu’elle eût rencontré, devant la devanture d’un marchand de kenafa, Ali Vif-Argent lui-même qu’elle reconnut à sa beauté ! Alors elle s’approcha de lui et, comme par inadvertance, lui envoya un coup d’épaule qui le fit trébucher, et, comme formalisée qu’on l’eût touchée elle-même, elle lui dit : « Vivent les aveugles, ô clairvoyant ! »
À ces paroles, Ali Vif-Argent se contenta de sourire, en voyant la belle adolescente dont le regard le transperçait déjà d’outre en outre, et répondit : « Ô ! que tu es belle, ô jouvencelle ! à qui appartiens-tu ? » Elle ferma à demi ses yeux magnifiques sous la voilette, et répondit : « À tout être beau qui te ressemble ! » Vif-Argent demanda : « Es-tu mariée ou vierge ? » Elle répondit : « Mariée, pour ta chance ! » Il dit : « Alors sera-ce chez moi ou chez toi ? » Elle répondit : « J’aime mieux chez moi ? Sache que je suis mariée à un marchand ; et je suis la fille d’un marchand. Et c’est aujourd’hui la première fois que je peux enfin sortir de la maison, vu que mon époux vient de s’absenter pour une semaine. Or moi, dès qu’il fut parti, je voulus me réjouir, et je dis à ma servante de me cuisiner des mets très appétissants. Mais comme les mets les plus appétissants ne sauraient être délicieux qu’en la société des amis, je suis sortie de ma maison à la recherche de quelqu’un d’aussi beau et bien élevé que toi pour partager mon repos et passer la nuit avec moi ! Et je t’ai vu, et ton amour m’est entré dans le cœur. Voudrais-tu donc daigner me réjouir l’âme, me soulager le cœur et accepter de manger une bouchée chez moi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète se tut.
LA QUATRE CENT CINQUANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … et accepter de manger une bouchée chez moi ? » Il répondit : « Quand on est invité, on ne peut refuser ! » Alors elle marcha devant lui, et il la suivit de rue en rue, en marchant à une certaine distance.
Or, pendant qu’il cheminait ainsi derrière elle, il pensa : « Ya Ali, quelle imprudence tu fais, pour un étranger nouvellement arrivé ! Qui sait si tu ne vas pas t’exposer au ressentiment du mari qui tombera soudain sur toi pendant ton sommeil et, pour se venger de toi, te coupera ton coq et ses œufs de couvaison ! Et d’ailleurs le Sage a dit : « Celui qui fornique dans un pays étranger, dont il est l’hôte, sera châtié par le Grand Hospitalier ! » Il serait donc plus raisonnable pour toi de t’excuser poliment auprès d’elle en lui disant quelques paroles gentilles ! » Il profita donc d’un moment où ils étaient arrivés à un endroit écarté, s’approcha d elle et lui dit : « Ô jouvencelle, tiens, prends ce dinar pour toi, et renvoyons notre rencontre à un autre jour ! » Elle répondit : « Par le Nom le Plus Grand ! il te faut absolument être mon hôte aujourd’hui, car je ne me suis jamais sentie comme aujourd’hui disposée aux multiples ébats et aux jeux hardis ! » Alors il la suivit, et arriva avec elle devant une vaste maison dont la porte était fermée avec une forte serrure de bois. Et la jeune fille fit le geste de chercher dans sa robe la cheville d’ouverture, puis s’écria, désappointée : « Voilà que j’ai perdu ma cheville ! Comment faire pour ouvrir la porte maintenant ? » Puis elle fit semblant d’en prendre son parti et lui dit : « Ouvre-la, toi ! » Il dit : « Comment pourrai-je ouvrir une serrure sans cheville ni clef ? Je ne puis pourtant me décider à l’ouvrir de force ! » Pour toute réponse, elle lui lança de dessous sa voilette deux œillades qui lui ouvrirent ses serrures les plus profondes ; puis elle ajouta : « Tu n’auras qu’à la toucher, et elle s’ouvrira ! » Et Vif-Argent mit la main sur la serrure de bois, et Zeinab se hâta de marmonner sur elle les noms de la mère de Moïse ! Et aussitôt la serrure céda, et la porte s’ouvrit. Ils entrèrent tous deux, et elle le conduisit dans une salle remplie de belles armes et tendue de beaux tapis, où elle le fit s’asseoir. Sans tarder, elle tendit la nappe et, s’asseyant à côté de lui, elle se mit à manger avec lui et à lui mettre elle-même les bouchées entre les lèvres, puis à boire avec lui et à se réjouir, sans toutefois lui permettre de la toucher ou d’en prendre un baiser ou un pincement ou une morsure ; car chaque fois qu’il se penchait sur elle pour l’embrasser, elle interposait vivement sa main entre sa joue et les lèvres du jeune homme, et le baiser ne lui touchait ainsi que la main. Et, à ses demandes pressantes, elle répondait ; « La volupté n’acquiert sa plénitude que la nuit ! »
Leur repas se termina de la sorte ; et ils se levèrent pour se laver les mains, et sortirent dans la cour près du puits ; et Zeinab voulut elle-même manœuvrer la corde et la poulie, et tirer le seau du fond du puits ; mais soudain elle poussa un cri et se pencha sur la margelle, en se frappant la poitrine et se tordant les bras, en proie à un désespoir extrême ; et Vif-Argent lui demanda : « Qu’as-tu donc, ô mon œil ? » Elle répondit : « Ma bague de rubis, trop large à mon doigt, vient de glisser et de tomber au fond du puits. Mon mari me l’avait achetée hier pour cinq cents dinars ! Et moi, l’ayant trouvée trop large, je l’avais rétrécie avec de la cire ! Cela ne m’a servi de rien, puisqu’elle vient de tomber là-dedans ! » Puis elle ajouta : « Je vais à l’instant me mettre nue et descendre dans le puits, qui n’est pas profond, pour chercher ma bague ! Tourne donc ton visage du côté du mur, pour que je puisse me déshabiller ! » Mais Vif-Argent répondit : « Quel opprobre sur moi, ô ma maîtresse, si, moi présent, je souffrais que tu descendisses toi-même ! C’est moi seul qui vais descendre te chercher ta bague au fond de l’eau ! Et aussitôt il se déshabilla complètement, saisit des deux mains la corde en fibres de palmier de la poulie, et se fit descendre dans le seau au fond du puits. Lorsqu’il fut arrivé dans l’eau, il lâcha la corde et plongea à la recherche de la bague ; et l’eau lui arrivait aux épaules, froide et noire dans l’obscurité. Et au même moment Zeinab-la-Fourbe remonta vivement le seau, et cria à Vif-Argent : « Tu peux appeler maintenant à ton secours ton ami Ahmad-la-Teigne ! » et se hâta de sortir de la maison, en emportant les effets de Vif-Argent. Puis sans même refermer la porte derrière elle, elle retourna près de sa mère.
Or la maison dans laquelle Zeinab avait entraîné Vif-Argent appartenait à un émir du Diwân, absent alors pour ses affaires. Aussi lorsqu’il fut de retour à sa maison et qu’il vit sa porte ouverte, il fut persuadé qu’un voleur était entré chez lui, et il appela son palefrenier et se mit à faire des recherches par toute la maison ; mais voyant que rien n’avait été enlevé et qu’il n’y avait pas trace de voleur, il ne tarda pas à être rassuré. Puis, comme il voulait faire ses ablutions, il dit à son palefrenier : « Prends l’aiguière, et va me la remplir de l’eau fraîche du puits ! » Et le palefrenier alla au puits et y fit descendre le seau, et, lorsqu’il le crut rempli à point, il voulut le retirer ; mais il le trouva extraordinairement lourd. Alors il regarda au fond du puits et aperçut, assise sur le seau, une vague forme noire qu’il prit pour un éfrit ! À cette vue, il lâcha la corde et, affolé, se mit à courir en criant : « Ya sidi, un éfrit habite le puits ! Il est assis dans le seau ! » Alors l’émir lui demanda : « Et comment est-il ? » Il dit : « Il est terrible et noir ! Et il grognait comme un cochon ! » Et l’émir lui dit : « Cours vite chercher quatre savants lecteurs du Korân, pour qu’ils viennent lire le Korân sur cet éfrit et l’exorciser…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT CINQUANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … pour qu’ils viennent lire le Korân sur cet éfrit et l’exorciser ! » Et le palefrenier se hâta de courir chercher les savants lecteurs du Korân qui s’installèrent autour du puits. Et ils commencèrent à réciter les versets conjuratoires, pendant que le palefrenier et son maître tiraient sur la corde et amenaient le seau hors du puits. Et tous, à la limite de l’effarement, virent l’éfrit en question, qui n’était autre qu’Ali Vif-Argent, sauter sur ses deux pieds hors du seau et s’écrier : « Allah Akbar ! » Et les quatre lecteurs se dirent : « C’est un éfrit d’entre les Croyants, puisqu’il prononce le Nom ! » Mais l’émir ne tarda pas à voir que c’était un homme de l’espèce des hommes, et lui dit : « Serais-tu un voleur ? » Il répondit : « Non, par Allah ! mais je suis un pauvre pêcheur ! Comme j’étais endormi sur les bords du Tigre, j’ai copulé l’air dans mon sommeil, m’étant réveillé et trouvé mouillé, je suis entré dans l’eau pour me laver ; mais un tourbillon m’entraîna au fond de l’eau, et un courant du fond souterrain me poussa à travers les nappes liquides jusque dans ce puits, où ma destinée se trouvait et mon salut par ton entremise ! » L’émir ne douta pas un instant de la véracité de ce récit et dit : « Tout arrive de ce qui est écrit ! » Et il lui donna un vieux manteau pour s’en couvrir, et le renvoya en le plaignant de son séjour dans l’eau froide du puits.
Lorsque Vif-Argent arriva chez Ahmad-la-Teigne, où l’on était fort inquiet à son sujet, et qu’il raconta son aventure, on se moqua beaucoup de lui, surtout Ayoub Dos-de-Chameau qui lui dit : « Par Allah ! comment peux-tu avoir été chef de bande au Caire, et te laisser duper et dépouiller à Baghdad par une jouvencelle ? » Et Hassan-la-Peste, qui était précisément en visite chez son collègue, demanda à Vif-Argent : « Ô naïf Égyptien, connais-tu au moins le nom de l’adolescente qui s’est jouée de toi, et sais-tu qui elle est, et de qui elle est la fille ? » Il répondit : « Oui, par Allah ! elle est la fille d’un marchand et l’épouse d’un marchand ! Quant à son nom, elle ne me l’a pas dit ! » À ces paroles Hassan-la-Peste partit d’un retentissant éclat de rire, et lui dit : « Je vais te l’apprendre ! Celle que tu crois être une femme mariée est une jeune fille vierge, j’en réponds ! Elle s’appelle Zeinab ! Et elle n’est la fille d’aucun marchand, mais de Dalila-la-Rouée, notre directrice des pigeons messagers ! À elle et sa mère, elles feraient tourner tout Baghdad sur leur petit doigt, ya Ali ! Et c’est elle-même qui s’est jouée de ton grand et l’a dépouillé de ses habits, lui et ses quarante que voici ! » Et comme Ali Vif-Argent réfléchissait profondément, Hassan-la-Peste lui demanda : « Que penses-tu faire maintenant ? » Il répondit : « Me marier avec elle ! Car, malgré tout, je l’aime éperdument ! » Alors Hassan lui dit : « Dans ce cas, mon garçon, je veux t’en fournir les moyens, car, sans moi, tu peux d’avance abandonner un si téméraire projet, faire ton acte de renoncement, et apaiser ton foie au sujet de la fine jouvencelle ! » Vif-Argent s’écria : « Ya Hassan, aide-moi de tes conseils ! » Il lui dit : « De tout cœur amical ! mais à condition que désormais tu ne boives que dans ma paume et ne marches que sous ma bannière ! Et moi, dans ce cas, je te promets la réussite de ton projet et la satisfaction de tes désirs ! » Il répondit : « Ya Hassan, je suis ton garçon et ton disciple ! » Alors la Peste lui dit : « Commence donc par te déshabiller complètement ! » Et Vif-Argent rejeta le vieux manteau qu’il portait, et en sortit tout à fait nu !
Alors Hassan-la-Peste prit un pot rempli de poix et une plume de poule, et en noircit tout le corps de Vif-Argent et son visage, si bien qu’il le rendit semblable à un nègre ; puis, pour compléter la ressemblance, il lui teignit de rouge vif les lèvres et les bords des paupières, le laissa sécher un moment, lui cacha, avec une serviette, le vénérable héritage de son père, puis lui dit : « Te voici transformé en nègre, ya Ali ! Et tu vas également devenir cuisinier. Sache en effet que le cuisinier de Dalila, celui qui s’occupe de la nourriture de Dalila, de Zeinab, des quarante nègres et des quarante chiens de la race de ceux des bergers de Soleimân, est, comme toi, un nègre ! Tu vas aller essayer de le rencontrer, et tu lui parleras en langage nègre et, après les salams, tu lui diras : « Il y a longtemps, frère nègre, que nous n’avons ensemble bu de cette excellente bouza, notre boisson fermentée, ni mangé du kabab d’agneau ? Allons festoyer aujourd’hui ! » Mais il te répondra que ses occupations et les soins de sa cuisine l’en empêchent, et il t’invitera lui-même à sa cuisine ! Alors, là, tu tâcheras de l’enivrer et de l’interroger sur la qualité et la quantité de mets qu’il cuisine pour Dalila et sa fille, sur la nourriture des quarante nègres et des quarante chiens, sur la place où se trouvent les clefs de la cuisine et du magasin à provisions, et sur tout ! Et lui te dira tout ! Car l’ivrogne ne cache jamais rien de ce qu’il ne raconte point en dehors de l’ivresse. Une fois que tu auras tiré de lui ces divers renseignements, tu l’endormiras avec le bang, tu revêtiras ses propres habits, tu piqueras ses couteaux de cuisine dans ta ceinture, tu prendras le panier à provisions, tu iras au souk acheter la viande et les légumes, tu reviendras à la cuisine, tu iras au magasin à provisions prendre ce qu’il te faut en beurre, huile, riz, et autres choses semblables, tu cuisineras les mets selon les indications apprises, tu les serviras bien, tu y mélangeras du bang, et tu iras les offrir à Dalila, à sa fille, aux quarante nègres et aux quarante chiens, que tu endormiras de la sorte. Alors tu les dépouilleras tous de leurs effets et de leurs vêtements, et tu me les apporteras. Mais si, ya Ali, tu désires arriver à obtenir Zeinab comme épouse, tu devras, en outre, t’emparer des quarante pigeons messagers du khalifat, les mettre dans une cage, et me les apporter…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE CENT CINQUANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … tu devras, en outre, t’emparer des quarante pigeons messagers du khalifat, les mettre dans une cage et me les apporter ! »
En entendant ces paroles, Ali Vif-Argent, pour toute réponse, porta sa main à son front et, sans prononcer un mot, sortit à la recherche du cuisinier nègre. Il le rencontra au souk, l’accosta et, après les salams de reconnaissance, l’invita à boire de la bouza. Mais le cuisinier prétexta ses occupations et invita Ali à l’accompagner au khân. Là, Vif-Argent agit exactement d’après les instructions de Hassan-la-Peste, et, une fois qu’il eut enivré son hôte, il l’interrogea sur les mets du jour. Le cuisinier répondit : « Ô frère nègre, tous les jours, pour le repas de midi, il me faut préparer pour Sett Dalila et Sett Zeinab cinq plats différents et de couleur différente ; et le même nombre de plats pour le repas du soir. Mais aujourd’hui on m’en a commandé deux de plus. Aussi voici les plats que je vais cuisiner pour midi : des lentilles, des pois, une soupe, une fricassée de mouton en ragoût et du sorbet de rose ; quant aux deux plats supplémentaires, ce sont : du riz au miel et au safran, et un plateau de grains de grenade aux amandes décortiquées, au sucre et aux fleurs ! » Ali lui demanda : « Et comment leur sers-tu leurs repas d’ordinaire à tes maîtresses ? » Il répondit : « Je leur sers leur nappe à chacune à part. » Il demanda : « Et les quarante nègres ? » Il dit : « Je leur donne des fèves cuites à l’eau et sautées au beurre et aux oignons, et, comme boisson, une cruche de bouza ! C’est assez pour eux ! » Il demanda : « Et les chiens ? » Il dit : « À ceux-là, je leur donne trois onces de viande à chacun, et les os qui restent du repas de mes maîtresses ! »
Lorsque Vif-Argent eut ces divers renseignements, il mélangea prestement du bang avec la boisson du cuisinier qui, l’ayant absorbée, s’écroula sur le sol comme un buffle noir. Alors Vif-Argent s’empara des clefs qui pendaient à un clou, et reconnut la clef de la cuisine aux pelures d’oignons et aux plumes qui y étaient collées, et la clef de la dépense à l’huile et au beurre qui l’enduisaient. Et il alla prendre ou acheter toutes les provisions qu’il lui fallait et, guidé par le chat du cuisinier qui, lui-même, fut trompé par la ressemblance d’Ali avec son maître, il circula par tout le khân, comme s’il l’habitait depuis son enfance, cuisina les mets, tendit les nappes, et servit à manger à Dalila, à Zeinab, aux nègres et aux chiens, après avoir mélangé le bang à leur nourriture, sans que personne pût s’apercevoir du changement de cuisine ou de cuisinier.
Tout cela !
Quand Vif-Argent vit que tout le monde dans le khân était endormi sous l’effet du soporifique, il commença par déshabiller la vieille et la trouva extrêmement laide et tout à fait détestable. Il lui prit alors son costume de parade et son casque et pénétra dans la chambre de Zeinab, celle qu’il aimait et pour laquelle il accomplissait son premier exploit. Il la dévêtit complètement, et la trouva merveilleuse et désirable à souhait, et soignée et propre et sentant bon ; mais, comme il était fort consciencieux, il ne voulut point l’ouvrir sans son consentement, et se contenta de la tâter et de la palper partout en connaisseur pour bien juger de sa valeur future, de sa consistance, de son degré de tendreté, de son velouté, et de sa sensibilité ; et, pour cette dernière expérience, il la chatouilla sous la plante des pieds et vit, au violent coup de pied qu’elle lui envoya, qu’elle était sensible à l’extrême. Alors, rassuré de la sorte sur son tempérament, il lui prit ses habits, et alla dépouiller tous les nègres ; puis il monta sur la terrasse, entra dans le pigeonnier et s’empara de tous les pigeons, qu’il mit dans une cage, et, tranquillement, sans fermer les portes, il revint à la maison d’Ahmad-la-Teigne, où l’attendait Hassan-la-Peste, auquel il remit tout le butin, ainsi que les pigeons. Et Hassan-la-Peste, émerveillé de son adresse, le félicita et lui promit son concours pour lui obtenir Zeinab en mariage.
Quant à Dalila-la-Rouée, elle fut la première a sortir du sommeil où l’avait jetée le bang. Elle mit un certain temps avant de recouvrer complètement ses sens ; mais, lorsqu’elle eut compris qu’elle avait été endormie, elle sauta sur ses deux pieds, se couvrit de ses vêtements ordinaires de vieille femme et courut d’abord au pigeonnier, qu’elle trouva vide de ses pigeons. Elle descendit alors dans la cour du khân et vit ses chiens encore endormis, étendus comme morts dans leurs chenils. Elle chercha les nègres et les trouva plongés dans le sommeil, ainsi que le cuisinier. Alors elle courut, à la limite de la fureur, dans la chambre de sa fille Zeinab, et la trouva endormie, toute nue, avec, au cou, un papier suspendu par un fil. Elle ouvrit le papier, et y lut les mots suivants : « C’est moi, Ali Vif-Argent du Caire, et nul autre que moi, qui suis le brave, le vaillant, le fin, l’adroit auteur de tout cela ! » À cette vue Dalila pensa : « Qui sait si ce maudit ne lui a pas brisé le cadenas ! » Et elle se pencha vivement sur sa fille qu’elle examina, et vit que son cadenas était resté intact. Cette constatation la consola un peu, et la décida à réveiller Zeinab en lui faisant respirer du contre-bang. Puis elle lui raconta tout ce qui venait de se passer, et ajouta : « Ô fille mienne, tu dois tout de même être reconnaissante à ce Vif-Argent pour n’avoir pas, quand il le pouvait si aisément, brisé ton cadenas ! Il s’est contenté, au lieu de faire saigner ton oiseau, d’enlever les pigeons du khalifat. Qu’allons-nous devenir maintenant ? » Mais bientôt elle trouva un moyen de recouvrer les pigeons, et dit à sa fille : « Attends-moi ici. Je ne vais pas longtemps m’absenter ! » Et elle sortit du khân et se dirigea vers la maison d’Ahmad-la-Teigne, et frappa à la porte.
Aussitôt Hassan-la-Peste, qui était là, s’écria : « C’est Dalila-la-Rouée ! Je la reconnais à sa manière de frapper. Va vite lui ouvrir, ya Ali ! » Et Ali, accompagné de Dos-de-Chameau, alla ouvrir la porte à Dalila qui entra, le visage souriant, et salua toute l’assistance.
Or, justement Hassan-la-Peste, Ahmad-la-Teigne et les autres étaient à ce moment assis par terre autour de la nappe, et prenaient leur repas composé de pigeons rôtis, de radis et de concombres. Aussi lorsque Dalila fut entrée, la Peste et la Teigne se levèrent en son honneur et lui dirent : « Ô vieille pleine de spiritualité, notre mère, assieds-toi manger avec nous de ces pigeons ! Nous t’avons laissé de côté ta part du festin ! » À ces paroles Dalila sentit le monde noircir devant son visage et s’écria : « N’est-ce point une honte sur vous tous de voler et rôtir les pigeons que le khalifat préfère à ses propres enfants ! » Ils répondirent : « Et qui donc a volé les pigeons du khalifat, ô notre mère ? » Elle dit : « C’est cet Égyptien Ali Vif-Argent ! » Celui-ci répondit : « Ô mère de Zeinab, lorsque j’ai fait rôtir ces pigeons je ne savais point qu’ils étaient messagers ! En tout cas, voici celui qui te revient ! » Et il lui offrit un des pigeons rôtis. Alors Dalila prit un morceau de l’aile du pigeon, le porta à ses lèvres, le goûta un instant et s’écria : « Par Allah ! mes pigeons vivent encore ! car ce n’est point là de leur chair ! Moi je les avais nourris avec du grain mélangé de musc, et je les reconnaîtrais à l’odeur et au goût qu’ils en ont conservé ! »
À ces paroles de Dalila, toute l’assistance se mit à rire, et Hassan-la-Peste lui dit : « Ô notre mère, tes pigeons sont en sûreté chez moi ! Et je veux bien consentir à te les rendre, mais à une condition ! » Elle dit : « Parle, ya Hassan ! Je consens d’avance à toutes tes conditions ; et voici ma tête entre tes mains…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT CINQUANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Parle, ya Hassan ! Je consens d’avance à toutes tes conditions ; et voici ma tête entre tes mains ! » Hassan dit : « Eh bien, si tu veux recouvrer tes pigeons, tu n’as qu’à accéder au désir d’Ali Vif-Argent du Caire, le premier de nos garçons ! » Elle demanda : « Et quel est son désir ? » Il dit : « C’est d’avoir ta fille Zeinab en mariage ! » Elle répondit : « C’est un honneur pour moi et pour elle ! Il sera sur ma tête et mes yeux ! Mais je ne puis forcer ma fille à se marier contre son gré. Commence donc par me rendre mes pigeons ! Car ce n’est point par la rouerie qu’il faut essayer de gagner ma fille, mais par les procédés de la galanterie ! » Alors Hassan dit à Ali : « Rends-lui les pigeons ! » Vif-Argent remit la cage à Dalila, qui lui dit : « Si maintenant, mon garçon, tu désires vraiment t’unir par les bons moyens à ma fille, ce n’est point à moi qu’il faut t’adresser, mais à son oncle, mon frère Zoraïk, le marchand de poisson frit. C’est lui en effet qui est le tuteur légal de Zeinab ; et ni moi ni elle nous ne pouvons rien sans son consentement ! Mais je te promets de parler de toi à ma fille, et d’intercéder pour toi auprès de Zoraïk, mon frère ! » Et elle s’en alla, en riant, raconter à sa fille Zeinab ce qui venait de se passer, et comme quoi Ali Vif-Argent la demandait en mariage. Et Zeinab répondit : « Ô mère mienne, pour ma part je ne m’oppose pas à ce mariage ; car Ali est beau et gentil et, en outre, il a été fort convenable avec moi en ne brisant pas ce qu’il pouvait briser pendant mon sommeil ! » Mais Dalila répondit : « Ô ma fille, je crois bien qu’avant de réussir à t’obtenir de ton oncle Zoraïk, Ali perdra à la tâche ses bras et jambes, sinon sa vie même ! » Et voilà pour elles !
Quant à Ali Vif-Argent, il demanda à Hassan-la-Peste : « Dis-moi donc qui est ce Zoraïk, et où se trouve sa boutique, pour que j’aille à l’instant lui demander en mariage la fille de sa sœur ! » La Peste répondit : « Mon fils, tu peux dès cet instant faire ton acte de renoncement au sujet de la belle Zeinab, si tu songes à l’obtenir de cet extraordinaire fripon qu’on nomme Zoraïk ! Sache en effet, ya Ali, que ce vieux Zoraïk, actuellement marchand de poisson frit, est un ancien chef de bande, connu dans tout l’Irak pour ses exploits qui dépassent les miens, les tiens et ceux de notre frère Ahmad-la-Teigne ! C’est un compère si rusé et si adroit qu’il est capable, sans bouger, de percer les montagnes, de cueillir les étoiles dans le ciel, et de voler le kohl qui embellit les yeux de la lune. Nul de nous ne peut l’égaler en roueries, en malices et en tours de toutes sortes. Il est vrai que maintenant il s’est assagi et, ayant renoncé à son ancien métier de larron et de chef de bande, a ouvert boutique et s’est fait marchand de poisson frit. Mais cela ne l’a pas, tout de même, empêché de garder quelque chose de ses talents passés. Ainsi pour te donner, ya Ali, une idée de la finesse de ce chenapan, je ne te raconterai que le dernier expédient qu’il a trouvé et qu’il emploie pour attirer les clients à sa boutique et se défaire de son poisson. Il a suspendu au milieu de l’entrée de sa boutique, avec un cordon de soie, une bourse qui contient mille dinars, toute sa fortune, et il a fait annoncer dans tout le souk par le crieur public : « Ô vous tous, larrons de l’Irak, fripons de Baghdad, brigands du désert, voleurs d’Égypte, apprenez la nouvelle ! Et vous tous, genn et éfrits de l’air et de dessous terre, apprenez la nouvelle ! Quiconque pourra enlever la bourse suspendue dans la boutique de Zoraïk, marchand de poisson frit, en sera le légitime possesseur ! » Or tu comprends facilement si, avec une annonce pareille, les clients se sont empressés d’accourir et d’essayer d’enlever la bourse, en achetant du poisson ; mais les plus habiles d’entre eux n’y ont guère réussi ; car le roué Zoraïk a installé tout un mécanisme qui correspond, au moyen d’une ficelle, avec la bourse suspendue. Or celle-ci, à peine touchée, quelque légèrement que ce soit, met en branle le mécanisme composé d’un système étonnant de clochettes et de grelots qui font un tel vacarme que Zoraïk, au cas où il est au fond de sa boutique ou occupé avec un client, entend le bruit et a le temps d’empêcher le vol de sa bourse. Pour cela il n’a qu’à se baisser pour ramasser un gros morceau de plomb d’une provision de gros morceaux amassés à ses pieds, et à le lancer de toutes ses forces contre le voleur en lui abîmant ainsi un bras ou une jambe, ou même en lui brisant le crâne. Ainsi donc, ya Ali, je te conseille l’abstention, sinon tu ressemblerais à ces gens qui suivent un enterrement et se lamentent sans même savoir le nom du mort. Tu ne peux lutter avec un coquin de cette taille. Et, à ta place, j’oublierais Zeinab et le mariage avec Zeinab ; car l’oubli est le commencement du bonheur ; et celui qui a oublié une chose peut désormais vivre sans elle ! »
Lorsque Ali Vif-Argent entendit ces paroles du prudent Hassan-la-Peste, il s’écria : « Non, par Allah ! je ne pourrai jamais me résoudre à oublier cette jouvencelle aux yeux sombres, à la sensibilité extrême, au tempérament extraordinaire ! Ce serait un opprobre pour un homme comme moi ! Il me faut donc aller tenter d’enlever cette bourse, et obliger de la sorte le vieux bandit à consentir à mon mariage, par l’échange de la jeune fille contre la bourse enlevée ! » Et à l’instant il alla acheter des habits comme en portent les jeunes femmes, et s’en vêtit, après s’être allongé les yeux de kohl et teint les doigts de henné. Après quoi il ramena modestement le voile de soie sur son visage, et se mit à faire quelques pas d’essai, en se balançant comme les femmes, et y réussit à merveille. Mais ce ne fut point tout…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT CINQUANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Mais ce ne fut point tout ! Il se fit apporter un mouton, l’égorgea, en recueillit le sang, en retira l’estomac, remplit de sang cet estomac, et le plaça sur son ventre, sous ses vêtements, de façon à avoir l’air d’une femme enceinte. Après quoi il égorgea deux poulets, en retira le gésier, remplit les deux gésiers de lait tiède et se les appliqua chacun sur un sein, de façon à paraître volumineux quant à ces parties-là et pareil à une femme sur le point d’accoucher. Bien plus ! pour que rien ne laissât à désirer, il s’appliqua sur le derrière plusieurs rangs de serviettes amidonnées qui, une fois sèches, lui firent une croupe montueuse et solide à la fois ! Ainsi transformé, Vif-Argent sortit dans la rue, et se dirigea lentement vers la boutique de Zoraïk, le marchand de poisson frit, alors que sur son passage les hommes s’écriaient : « Ya Allah ! quel gros derrière ! »
En route Vif-Argent, qui finit par se trouver gêné, quant à sa croupe, de par les serviettes amidonnées qui la mortifiaient, héla un ânier qui passait avec son âne, et se fit jucher sur l’âne avec mille précautions pour ne point crever la vessie remplie de sang ou les gésiers pleins de lait, et arriva de la sorte devant la boutique aux poissons frits, où il vit en effet la bourse suspendue à l’entrée, et Zoraïk occupé à frire les poissons en les regardant d’un œil tandis que son autre œil surveillait les allées et venues des clients ou des passants. Alors Vif-Argent dit à l’ânier : « Ya hammar, mon odorat est touché par les poissons frits, et mon désir de femme enceinte se porte avec intensité vers ces poissons ! Hâte-toi d’aller m’en chercher un, que je le mange de suite, ou sinon je vais certainement avorter en pleine rue ! » Alors l’ânier arrêta son âne devant la boutique, et dit à Zoraïk : « Donne-moi vite un poisson frit pour cette dame enceinte, dont l’enfant, à cause de cette odeur de friture, est en train de s’agiter éperdument et menace de sortir en avortement ! » Le vieux fripon répondit : « Attends un peu. Les poissons ne sont pas encore cuits ! Puis, si tu ne peux attendre, fais-moi voir la largeur de ton dos ! » L’ânier dit : « Donne-m’en un de ceux qui sont à l’étalage ! » Il répondit : « Ils ne sont pas à vendre, ceux-là ! » Puis, sans plus faire attention à l’ânier qui aidait la prétendue femme enceinte à descendre de l’âne, et à venir s’appuyer, pleine d’attente anxieuse, à la devanture de la boutique, Zoraïk, avec le sourire du métier, continua à tourner les poissons dans la poêle en chantant son cri de vente :
« Repas des délicats, ô chair des oiseaux de l’eau !
« Or et argent qu’on acquiert pour une pièce de cuivre !
« Ô poissons qui frétillez dans l’huile heureuse de vous contenir !
« Ô repas des délicats ! »
Or, pendant que Zoraïk chantait son cri de la sorte, la femme enceinte poussa soudain un grand cri, tandis qu’un flot de sang s’échappait de dessous ses vêtements et inondait la boutique, et gémit douloureusement : « Aï ! aï ! ouye ! ouye ! le fruit de mes entrailles ! Aï ! mon dos se brise ! Ah ! mes flancs ! Ah ! mon enfant ! »
À cette vue, l’ânier cria à Zoraïk : « Tu vois, ô barbe calamiteuse ! Je te l’avais dit ! Ton mauvais vouloir à satisfaire son désir l’a fait avorter ! Tu en es responsable devant Allah et son mari ! » Alors Zoraïk, un peu effrayé de cet accident et craignant d’être sali par le sang qui s’échappait de la femme, recula jusqu’au fond de la boutique, en perdant de vue un instant sa bourse suspendue à l’entrée. Alors Vif-Argent voulut profiter de ce court moment pour s’emparer de la bourse ; mais à peine en avait-il approché sa main qu’un vacarme extraordinaire de clochettes, de grelots et de ferrailles retentit dans tous les coins de la boutique et avertit de la tentative Zoraïk qui accourut et qui, apercevant la main tendue de Vif-Argent, comprit d’un coup d’œil le tour qu’on lui voulait jouer, saisit une grosse plaque de plomb et la lança dans le ventre de Vif-Argent en lui criant : « Ah ! oiseau de gibet ! attrape ça ! » Et le gâteau de plomb fut envoyé avec une telle violence qu’Ali roula au milieu de la rue, empêtré dans ses serviettes, dans le sang et dans le lait des gésiers crevés, et faillit du coup rendre l’âme. Il put tout de même se relever et se traîner jusqu’à la maison d’Ahmad-la-Teigne où il raconta sa tentative infructueuse, tandis que les passants s’attroupaient devant la boutique de Zoraïk et lui criaient : « Es-tu marchand dans le souk ou bien batailleur de profession ? Si tu es marchand, exerce donc ton métier sans bravades, descends cette bourse tentatrice et épargne ainsi aux gens ta malice et ta méchanceté ! » Il répondit, en ricanant : « Par le Nom d’Allah ! Bismillah ! Sur ma tête et sur mon œil ! »
Quant à Ali Vif-Argent, une fois rentré à la maison et remis de la violente secousse qu’il avait essuyée, il ne voulut point tout de même renoncer à accomplir son projet. Il alla se laver et se nettoyer, se déguisa en palefrenier, prit une assiette vide dans une main et cinq pièces de monnaie de cuivre dans l’autre main, et se rendit à la boutique de Zoraïk pour acheter du poisson…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT CINQUANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… il se rendit à la boutique de Zoraïk pour acheter du poisson. Il tendit donc les cinq pièces de cuivre à Zoraïk, et lui dit : « Mets-moi de ton poisson dans mon assiette ! » Et Zoraïk répondit : « Sur ma tête, ô mon maître ! » Et il voulut donner au palefrenier du poisson qui était exposé sur le plateau de devanture ; mais le palefrenier refusa, disant : « J’en veux du chaud ! » Et Zoraïk répondit : « Il est encore à frire. Attends un peu que j’attise le feu ! » et il entra dans son arrière-boutique.
Aussitôt Vif-Argent profita de ce moment pour porter la main à la bourse ; mais soudain toute la boutique retentit du vacarme assourdissant des clochettes, des grelots, des hochets et des ferrailles ; et Zoraïk, bondissant d’une extrémité à l’autre de sa boutique, saisit un gâteau de plomb et le lança de toutes ses forces à la tête du faux palefrenier en lui criant : « Ah ! vieil enculé, si tu crois que je ne t’ai pas deviné, rien qu’à la façon dont tu tenais dans tes mains l’assiette et la monnaie ! » Mais Vif-Argent, qu’une première expérience avait déjà mis en garde, esquiva le coup en baissant prestement la tête, et s’échappa de la boutique, tandis que le lourd gâteau de plomb allait s’abattre au milieu d’un plateau contenant des porcelaines remplies de lait caillé et que portait sur sa tête l’esclave du kâdi ! Et le lait caillé éclaboussa le visage et la barbe du kâdi et lui inonda sa robe et son turban. Et les passants rassemblés autour de la boutique crièrent à Zoraïk : « Cette fois, ô Zoraïk, le kâdi te fera payer les intérêts du capital renfermé dans ta bourse, ô chef des batailleurs ! »
Quant à Vif-Argent, une fois arrivé chez Ahmad-la-Teigne, à qui il raconta ainsi qu’à la Peste sa seconde tentative sans succès, il ne voulut point perdre courage, car l’amour de Zeinab le soutenait. Il se déguisa en charmeur de serpents et joueur de gobelets, et retourna devant la boutique de Zoraïk. Il s’assit par terre, tira de son sac trois gros serpents au cou gonflé, à la langue pointue comme un dard, et se mit à leur jouer de la flûte, en s’interrompant des fois pour faire une multitude de tours de gobelets et de passe-passe ; puis soudain, d’un mouvement brusque il lança le plus gros serpent au milieu de la boutique, aux pieds de Zoraïk qui, épouvanté, car rien ne l’épouvantait comme les serpents, s’enfuit en hurlant au fond de sa boutique. Et Vif-Argent bondit aussitôt vers la bourse et voulut l’enlever. Mais il comptait sans Zoraïk qui, malgré sa terreur, le surveillait d’un œil, et qui réussit d’abord à asséner au serpent un coup si ajusté avec un gâteau de plomb qu’il lui écrasa la tête, puis, de l’autre main, à envoyer de toutes ses forces un second gâteau à la tête de Vif-Argent, qui l’esquiva en se baissant et s’enfuit, tandis que le gâteau redoutable allait s’abattre sur une vieille femme et l’écrasait sans recours. Alors tous les gens attroupés lui crièrent : « Ya Zoraïk, cela n’est point permis, par Allah ! Il te faut absolument décrocher de là ta bourse calamiteuse, ou nous allons te l’enlever par la force ! Assez suscité de malheurs par ta méchanceté ! » Et Zoraïk répondit : « Sur ma tête ! » et il se décida, mais bien à contre-cœur, à décrocher la bourse et à aller la cacher dans sa maison, en se disant : « Ce garnement d’Ali Vif-Argent pourrait bien, sans cela, opiniâtre comme il est, s’introduire la nuit dans ma boutique et m’enlever la bourse ! »
Or, Zoraïk était marié à une négresse, autrefois esclave de Giafar Al-Barmaki et, depuis, libérée par sa générosité. Et Zoraïk avait même eu de son épouse, la négresse, un enfant mâle dont on allait bientôt célébrer la circoncision. Aussi lorsque Zoraïk eut apporté la bourse à sa femme, celle-ci lui dit : « Voilà une générosité qui ne t’est point habituelle, ô père d’Abdallah ! La circoncision d’Abdallah va donc être célébrée somptueusement ! » Il répondit : « Alors tu crois que je t’apporte la bourse pour que tu la vides en dépenses de circoncision ? Non, par Allah ! Va vite la cacher en bas, dans un trou creusé dans le sol de la cuisine ! Et reviens vite pour dormir ! » Et la négresse descendit creuser un trou dans la cuisine, y enterra la bourse et revint se coucher aux pieds de Zoraïk. Et Zoraïk fut gagné par le sommeil, à cause de la chaleur de la négresse, et eut un rêve dans lequel il lui semblait voir un grand oiseau creuser du bec un trou dans sa cuisine, en déterrer la bourse, et l’emporter dans ses serres en s’envolant dans les airs ! Et il se réveilla en sursaut et criant : « Ô mère d’Abdallah, la bourse vient d’être enlevée ! Va vite voir à la cuisine ! » Et la négresse, tirée de son sommeil, se hâta de descendre à la cuisine avec de la lumière, et vit effectivement non point un oiseau, mais un homme qui, la bourse à la main, s’enfuyait par la porte ouverte et courait dans la rue ! C’était Vif-Argent qui avait suivi Zoraïk, épié ses mouvements et ceux de son épouse, et avait fini, caché derrière la porte de la cuisine, par réussir enfin à enlever cette bourse tant convoitée.
Lorsque Zoraïk eut constaté la perte de sa bourse, il s’écria : « Par Allah ! je la reprendrai ce soir même ! » Et son épouse, la négresse, lui dit : « Si tu ne la rapportes pas, je ne t’ouvrirai point la porte de notre maison, et je te laisserai coucher dans la rue ! » Alors Zoraïk…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors Zoraïk sortit en toute hâte de chez lui et, par des raccourcis, précéda Ali Vif-Argent à la maison d’Ahmad-la-Teigne où il le savait loger, ouvrit le loquet de la porte au moyen de diverses chevilles dont il avait sur lui tout un attirail, la referma soigneusement derrière lui, et attendit tranquillement Ali Vif-Argent qui ne tarda pas à arriver à son tour, et à frapper selon sa coutume. Alors Zoraïk, contrefaisant la voix de Hassan-la-Peste demanda : « Qui est là ? » Il répondit : « Ali l’Égyptien ! » Il lui demanda : « Et la bourse de ce fripon de Zoraïk, l’as-tu apportée ? » Il répondit : « Je la tiens ! » Il dit : « Hâte-toi, avant que je t’ouvre la porte, de me la passer à travers le creux, car j’ai fait avec la Teigne un pari dont je te parlerai ! » Et Vif-Argent passa la bourse à travers le creux de la porte à Zoraïk qui aussitôt grimpa sur la terrasse et de là passa sur la terrasse d’une maison voisine dont il descendit l’escalier et, en ouvrant la porte, s’échappa dans la rue et se dirigea vers sa maison.
Quant à Ali Vif-Argent il stationna longtemps dans la rue ; mais, quand il vit que personne ne se décidait à lui ouvrir, il frappa à la porte un coup terrible qui réveilla toute la maison, et Hassan-la-Peste s’écria : « C’est Ali qui est à la porte ! Va vite lui ouvrir, ô Dos-de-Chameau ! » Puis quand Vif-Argent fut entré, il lui demanda, ironique : « Et la bourse du fripon ? » Vif-Argent s’écria : « Assez plaisanter, ô mon grand ! Tu sais bien que je te l’ai passée à travers la porte ! » À ces paroles Hassan-la-Peste se renversa sur son derrière par la force explosive de son rire, et s’écria : « C’est à recommencer, ya Ali ! C’est Zoraïk qui a repris son bien ! » Alors Vif-Argent réfléchit un instant et s’écria : « Par Allah ! ô mon grand, si cette fois je ne te la rapporte pas, cette bourse-là, je ne veux plus me considérer digne de mon nom ! » Et, sans tarder, il courut par des chemins très raccourcis à la maison de Zoraïk, avant que celui-ci y fût arrivé, y pénétra par la terrasse voisine, et commença par entrer dans la chambre où dormait la négresse avec son enfant, le petit garçon qu’on devait circoncire le lendemain. Il se jeta d’abord sur la négresse, l’immobilisa sur son matelas en lui liant les bras et les jambes et la bâillonna ; puis il prit le petit garçon qu’il bâillonna également, le mit dans un panier rempli de gâteaux encore chauds qui devaient servir à la fête du lendemain, et alla s’accouder à la fenêtre en attendant l’arrivée de Zoraïk qui ne tarda pas à venir frapper à la porte.
Alors Vif-Argent, contrefaisant la voix et le parler de la négresse, demanda : « C’est toi, ya sidi ? » Il répondit : « Oui ! c’est moi ! » Il dit : « As-tu rapporté la bourse ? » Il dit : « La voilà ! » Il dit : « Je ne la vois pas dans l’obscurité ! Et je ne t’ouvrirai la porte que lorsque j’aurai compté l’argent ! Je vais te descendre un panier par la fenêtre et tu me l’y mettras ! Et ensuite moi je t’ouvrirai la porte ! » Puis Vif-Argent descendit par la fenêtre un panier où Zoraïk mit la bourse ; et il se hâta de le remonter. Il prit la bourse, le petit garçon et le panier de gâteaux et s’enfuît par le chemin d’où il était venu, pour arriver chez Ahmad-la-Teigne et remettre enfin entre les mains de Hassan-la-Peste le triple butin triomphal. À cette vue la Peste le félicita beaucoup et fut très fier de lui ; et tous se mirent ensuite à manger les gâteaux de la fête, en faisant mille plaisanteries sur le compte de Zoraïk.
Quant à Zoraïk, il attendit longtemps dans la rue que son épouse, la négresse, lui ouvrît ; mais la négresse ne venait pas, et il finit, impatienté, par frapper la porte à grands coups redoublés qui réveillèrent tous les voisins et les chiens du quartier. Et nul ne lui ouvrait. Alors il enfonça la porte, et, furieux, il monta chez son épouse, et il vit ce qu’il vit.
Lorsqu’il eut appris de son épouse délivrée ce qui venait de se passer, il se donna de grands coups au visage, s’arracha la barbe et courut, dans cet état, frapper à la porte d’Ahmad-la-Teigne. C’était déjà le matin, et tout le monde était levé. Aussi Dos-de-Chameau alla ouvrir et introduisit Zoraïk, piteux, dans la salle de réunion, ou on l’accueillit par un retentissant éclat de rire. Alors il se tourna vers Vif-Argent et lui dit : « Par Allah ! ya Ali, pour ce qui est de la bourse, tu l’as gagnée ! Mais rends-moi mon enfant ! » Et Hassan-la-Peste répondit : « Sache, ô Zoraïk, que mon garçon Ali Vif-Argent est prêt à te rendre ton enfant et même ta bourse, si tu veux consentir à lui donner en mariage la fille de ta sœur Dalila, la jeune Zeinab qu’il aime ! » Il répondit : « Et depuis quand pose-t-on des conditions au père en lui demandant sa fille en mariage ? Qu’on me rende d’abord l’enfant et la bourse, et nous parlerons après de l’affaire ! » Alors Hassan fit signe à Ali qui aussitôt remit l’enfant et la bourse à Zoraïk, et lui dit : « À quand le mariage ! » Et Zoraïk sourit et répondit : « Doucement ! Doucement ! Crois-tu, ya Ali, que je puis disposer de Zeinab comme d’un mouton ou d’un poisson frit ? Je ne puis te l’accorder, à moins que tu ne lui apportes la dot qu’elle réclame ! » Vif-Argent répondit : « Je suis prêt à lui apporter la dot qu’elle réclame ! Quelle est-elle ? » Zoraïk dit : « Sache qu’elle a fait le serment de ne jamais se laisser monter sur la poitrine par quelqu’un avant qu’il lui eût apporté, en présents de noces, la robe brochée d’or de la jeune Kamaria, fille du Juif Azaria, ainsi que sa couronne d’or, sa ceinture d’or et sa pantoufle d’or…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … Sache qu’elle a fait le serment de ne jamais se laisser monter sur la poitrine par quelqu’un, avant qu’il lui eût apporté, en présents de noces, la robe brochée d’or de la jeune Kamaria, fille du Juif Azaria, ainsi que sa couronne d’or, sa ceinture d’or et sa pantoufle d’or ! » Alors Vif-Argent s’écria : « Si ce n’est que cela, je veux, si ce soir même je n’ai pas apporté les présents réclamés, n’avoir plus aucun droit à mon mariage avec Zeinab ! »
À ces paroles Hassan-la-Peste lui dit : « Malheur à toi, ya Ali ! quel serment as-tu fait ! Tu es un homme mort ! Ne sais-tu donc que le Juif Azaria est un magicien perfide, roué et plein de malice ? Il a à ses ordres tous les genn et les éfrits ! Il habite hors de la ville un palais dont les pierres sont en briques d’or et d’argent alternativement ! Mais ce palais, visible seulement quand le magicien l’habite, disparaît chaque jour quand son propriétaire vient en ville pour des affaires d’usurier. Tous les soirs, une fois rentré chez lui, le Juif monte à sa fenêtre et montre sur un plateau d’or la robe de sa fille en criant : « Ô vous tous maîtres voleurs et fripons de l’Irak, de la Perse et de l’Arabie, venez, si vous le pouvez, vous emparer de la robe de ma fille Kamaria ! Et je donnerai Kamaria en mariage à celui qui pourra enlever sa robe ! » Or, y a Ali, les plus fins larrons et les plus rusés fripons d’entre nous n’ont pu jusqu’à présent tenter l’aventure qu’à leurs dépens ; car l’insigne magicien a changé les téméraires qui ont entrepris le coup soit en mulets, soit en ours, soit en ânes, soit en singes. Je te conseille donc de renoncer à la chose, et de rester avec nous ! » Mais Ali s’écria : « Quelle honte sur moi si je renonçais, à cause de la difficulté, à l’amour de la sensible Zeinab ! Par Allah ! j’apporterai la robe d’or et j’en revêtirai Zeinab la nuit des noces, et je lui mettrai la couronne d’or sur la tête, la ceinture d’or autour de sa taille exquise, et la pantoufle d’or au pied ! » Et il sortit sur-le-champ à la recherche de la boutique du Juif magicien et usurier Azaria.
Lorsqu’il fut arrivé au souk des changeurs, Ali s’informa de la boutique, et on lui montra le Juif qui était occupé précisément à peser de l’or dans ses balances, à le vider ensuite dans des sacs et à charger les sacs sur le dos d’une mule attachée à la porte. Il était bien laid et d’aspect rébarbatif ! Et Ali fut un peu ému de sa physionomie. Pourtant il attendit que le Juif eût fini de ranger les sacs, de fermer sa boutique et d’enfourcher sa mule, pour le suivre sans en être remarqué. Il arriva de la sorte derrière lui hors des murs de la ville.
Ali commençait à se demander jusqu’où il allait marcher encore, quand il vit soudain le Juif tirer de la poche de son manteau un sac, y plonger la main, la sortir pleine de sable et jeter le sable en l’air en soufflant dessus. Et aussitôt devant lui il vit s’élever un magnifique palais en briques alternées d’or et d’argent, avec un immense portique d’albâtre et des marches de marbre que le Juif monta avec sa mule, pour disparaître à l’intérieur. Mais quelques instants après, il parut à la fenêtre avec un plateau d’or où se trouvait une robe splendide brochée d’or, une couronne, une ceinture et la pantoufle d’or ; et il s’écria : « Ô vous tous maîtres voleurs et fripons de l’Irak, de la Perse et de l’Arabie, venez, si vous le pouvez, vous emparer de tout cela, et ma fille Kamaria vous appartiendra ! »
En voyant et entendant ces choses-là, Vif-Argent qui était doué de beaucoup de jugement se dit : « Le plus sage parti est encore d’aller trouver ce maudit Juif-là et de lui demander la robe par les bonnes paroles en lui expliquant mon cas avec Zoraïk ! » Et il leva le doigt en l’air, en criant au magicien : « Moi, Ali Vif-Argent, le premier des garçons d’Ahmad le mokaddem du khalifat, je désire te parler ! » Et le Juif lui dit : « Tu peux monter ! » Et lorsque Ali fut arrivé en sa présence, il lui demanda : « Toi, que veux-tu ? » Et Ali lui raconta son histoire et lui dit : « Or maintenant il me faut cette robe d’or et les autres objets pour les porter à Zeinab fille de Dalila ! »
À ces paroles, le Juif se mit à rire en montrant des dents épouvantables, prit une table de sable divinatoire et, après avoir tiré l’horoscope d’Ali, lui dit : « Écoute ! si ta vie t’est chère, et si tu ne tiens pas à te perdre sans recours, suis mon conseil ! Renonce à ton projet ! Car ceux qui t’ont poussé à entreprendre cette aventure ne l’ont fait que pour te perdre, comme ont été perdus tous ceux qui ont essayé déjà la chose ! D’ailleurs si je ne venais de tirer ton horoscope et de voir par le sable que ta fortune l’emportait sur ma fortune, je n’aurais certes pas hésité à te couper le cou ! » Mais Ali, que ces dernières paroles avaient subitement enflammé et stimulé, tira soudain son glaive et, le dirigeant contre la poitrine du magicien Juif, lui cria : « Si de suite tu ne consens à me donner ces effets et, en outre, à abjurer tes hérésies et te faire musulman en prononçant l’acte de foi, ton âme va sortir de ton corps ! » Alors le Juif étendit la main comme pour prononcer l’acte de foi et dit : « Que ta main droite se dessèche ! » Et aussitôt la main droite d’Ali, celle qui tenait le glaive, se dessécha dans la position où elle se trouvait, et le glaive tomba sur le sol. Mais Ali le ramassa de la main gauche et en menaça la poitrine du magicien ; mais celui-ci prononça : « Ô main gauche, dessèche-toi ! » Et la main gauche menaçante d’Ali se dessécha, et le glaive tomba sur le sol. Alors Ali, à la limite de la fureur, leva la jambe droite et voulut l’enfoncer dans le ventre du Juif ; mais celui-ci, étendant sa main, prononça : « Ô jambe droite, dessèche-toi ! » Et la jambe élevée en l’air d’Ali se dessécha dans sa position, et Ali ne se trouva plus debout que sur un seul pied, le gauche…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… et Ali ne se trouva plus debout que sur son seul pied, le gauche ! Et il eut beau vouloir se servir de ses membres hors de service, il ne put arriver qu’à perdre l’équilibre et à tantôt rouler et tantôt se relever jusqu’à ce qu’il fût épuisé et que le magicien lui dît : « As-tu renoncé à ton projet ? » Mais Ali répliqua : « Il me faut absolument les effets de ta fille ! » Alors le Juif lui dit : « Ah ! tu veux les effets ! Eh bien, je vais te les faire porter ! » Et il prit une tasse remplie d’eau, l’en aspergea et lui cria : « Deviens un âne ! » Et à l’instant Ali Vif-Argent fut changé en âne, avec une figure d’âne, des sabots ferrés à neuf, et des oreilles monumentales. Et il se mit incontinent à braire comme un âne en levant le nez et la queue et en reniflant l’air. Et le Juif prononça sur lui les paroles dominatrices, pour s’en rendre complètement maître, et l’obligea à descendre les escaliers sur ses pattes de derrière ; et, une fois dans la cour du palais, il traça autour de lui un cercle magique dans la sable ; et aussitôt une muraille s’éleva en formant une enceinte assez étroite d’où il ne pouvait point s’échapper.
Le matin le Juif vint à lui, le sella, le brida, le monta et lui dit dans l’oreille : « Tu vas remplacer la mule ! » Et il le fit sortir du palais enchanté qui disparut aussitôt et lui fit prendre le chemin de la boutique, où il ne tarda pas à arriver. Il ouvrit sa boutique, attacha l’âne Ali à l’endroit où la veille était attachée la mule, et se mit à s’occuper de ses balances, de ses poids, de son or et de son argent. Et l’âne Ali, qui conservait au-dedans de sa peau toutes ses facultés d’homme en tant que jugement et sensations, à l’exception de la parole seulement, fut obligé, pour ne point mourir de faim, de moudre entre ses dents les fèves sèches de sa ration ; mais, pour se consoler, il déchargeait son humeur noire par des séries de pets retentissants à la figure des clients.
Sur ces entrefaites, un jeune marchand, ruiné par les revers du temps, vint trouver le Juif usurier Azaria et lui dit : « Je suis ruiné, et il faut pourtant que je gagne ma vie et nourrisse mon épouse. Voici que je t’apporte les bracelets d’or de mon épouse, le seul et dernier bien qui nous reste, pour qu’en échange tu me donnes leur valeur en argent, afin que je puisse m’acheter quelque mulet ou quelque âne et exercer le métier de vendeur d’eau d’arrosage ! » Le Juif répondit : « Comptes-tu faire peiner l’âne que tu vas acheter et lui rendre la vie malheureuse s’il refuse de marcher ou de porter de grosses charges d’eau ? » Le futur ânier répondit : « Par Allah ! s’il refuse de marcher ou de travailler, je lui enfoncerai mon bâton dans les parties sensibles, et le forcerai à faire la besogne ! » Tout cela ! Et l’âne Ali entendit les paroles et, en manière de protestation, lança un pet épouvantable. Quant au Juif Azaria, il répondit à son client : « Dans ce cas, je veux bien te céder, pour ces bracelets, mon propre âne qui est là attaché à la porte ! Ne l’épargne pas, sinon il prendra l’habitude de la paresse ; et charge son dos lourdement, car il est solide et jeune ! » Puis, le marché conclu, le vendeur d’eau emmena l’âne Ali, tandis que celui-ci pensait en son âme : « Ya Ali, ton maître est prêt à charger ton dos d’un bât de bois dur et de grosses outres pesantes ; et il te fera faire dix longues courses, ou plus, par jour ! Sans doute tu es abîmé sans recours ! »
Lorsque le vendeur d’eau eut conduit l’âne à sa maison, il dit à son épouse de descendre à l’écurie lui donner sa ration. Et l’épouse, qui était jeune et fort agréable à regarder, prit la ration de fèves et descendit chez l’âne Ali pour la lui mettre au cou, dans le sac des rations. Mais l’âne Ali, qui la regardait du coin de l’œil depuis un moment, se mit soudain à renifler l’air avec force et lui donna un coup de tête qui la renversa sur l’auge, la robe retournée, la saillit en lui caressant la figure avec ses grosses lèvres frémissantes, et étala sa marchandise d’âne, considérable héritage des aïeux ânes.
À cette vue, l’épouse du vendeur d’eau poussa des cris si aigus que toutes les voisines accoururent les premières à l’écurie et, voyant le spectacle, se hâtèrent de repousser l’âne Ali de dessus la poitrine de la renversée. Et voici qu’à son tour arriva le mari qui demanda à la renversée : « Qu’as-tu ? » Elle lui cracha à la figure et lui dit : « Ah ! fils d’adultérins, tu n’as su trouver dans tout Bagdad, pour l’acheter, que cet âne coureur de femmes ? Par Allah ! ou le divorce ou le renvoi de cet âne ! » Il demanda : « Mais qu’a-t-il fait, cet âne ? » Elle dit : « Il m’a renversée et assaillie ! Et, sans les voisines, il me pénétrait épouvantablement ! » Alors le vendeur d’eau tomba sur l’âne à coups de trique, et finit par le ramener au Juif auquel il raconta ses entreprises inconvenantes, et le força à le reprendre et à restituer les bracelets. Lorsque le vendeur d’eau fut parti, le magicien Azaria se tourna vers l’âne Ali et lui dit : « Voilà que tu te lances dans les polissonneries avec les femmes, ô scélérat ! Attends ! puisque tu es si content de ta condition d’âne et que tu ne refrènes guère tes caprices effrontés, je vais t’arranger autrement ! Et tu seras la risée des petits et des grands ! » Et il ferma sa boutique, enfourcha l’âne et sortit de la ville.
Comme la veille, il fit sortir de terre et du fond de l’air le palais enchanté…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Comme la veille, il fit sortir de terre et du fond de l’air le palais enchanté, et pénétra avec l’âne au fond de la cour, dans l’enceinte protectrice. Il commença d’abord par marmotter sur l’âne Ali des paroles incantatrices et il l’aspergea avec quelques gouttes d’eau qui lui rendirent sa première forme humaine ; puis, le tenant à une certaine distance, il lui dit : « Veux-tu, ya Ali, suivre maintenant mes conseils et, avant que je te métamorphose en quelque forme nouvelle pire que la première, renoncer à ton projet téméraire et t’en aller en ta voie ? » Il répondit : « Non, par Allah ! du moment qu’il est écrit que ma fortune l’emporte sur ta fortune, il me faut ou te tuer ou m’emparer de la robe de Kamaria, et te convertir à la foi de l’Islam ! » Et il voulut se précipiter sur le magicien Azaria qui, à cette vue, étendit la main et lui jeta au visage quelques gouttes de la tasse gravée de paroles talismaniques, en lui criant : « Deviens un ours ! » Et aussitôt Ali Vif-Argent fut transformé en ours, avec une grosse chaîne pendue à un anneau de fer qui lui traversait les naseaux, et muselé et tout dressé à danser. Puis il se pencha à son oreille et lui dit : « Ah ! scélérat, tu es semblable à la noix qui ne saurait être utilisée avant qu’on lui ait cassé la coque et l’écale ! » Et il l’attacha à un pieu fiché dans l’enceinte fortifiée, et ne vint le reprendre que le lendemain. Il monta alors sur sa mule des jours passés, et traîna derrière lui l’ours Ali jusqu’à la boutique, après avoir fait disparaître le palais enchanté, et l’attacha à côté de la mule, pour s’occuper ensuite de son or et de ses clients. Et l’ours Ali entendait et comprenait, mais ne pouvait parler !
Sur ces entrefaites, un homme vint à passer devant la boutique qui vit l’ours enchaîné et entra à l’instant demander au juif : « Ô maître Azaria, veux-tu me vendre cet ours ? On a prescrit à mon épouse malade de la chair d’ours et, comme onguent, de la graisse d’ours ; mais je n’en trouve nulle part ! » Le magicien répondit : « Vas-tu l’immoler de suite ou l’engraisser d’abord pour avoir plus d’onguent ? » Il répondit : « Il est assez gras comme cela pour mon épouse. Et je vais le faire égorger aujourd’hui même ! » Le magicien, à la limite de la joie, répondit : « Puisque c’est pour le bien de ton épouse, je te cède l’ours pour rien ! » Alors l’homme emmena l’ours à sa maison et appela un boucher qui arriva avec deux grands coutelas qu’il se mit à aiguiser l’un sur l’autre, après s’être retroussé les manches. À cette vue, la cherté de l’âme doubla les forces de l’ours Ali qui, au moment où ils le renversaient pour l’égorger, bondit soudain d’entre leurs mains, et s’envola plus qu’il ne courut jusqu’au palais du magicien.
Lorsque Azaria vit revenir l’ours Ali, il se dit : « Je vais encore faire une dernière tentative sur lui ! » Il l’aspergea, comme à l’ordinaire, et lui rendit sa forme humaine, après avoir appelé, cette fois, sa fille Kamaria à assister à la métamorphose. Et la jeune fille vit Ali sous sa forme humaine et le trouva si beau que dans son cœur elle conçut pour lui un amour violent. Aussi, se tournant vers lui, elle lui demanda : « Est-ce vrai, ô beau jeune homme, que ce n’est point moi que tu désires, mais seulement ma robe et mes effets ? » Il répondit : « C’est vrai ! Car je les destine à Zeinab la sensible, fille de Dalila la fine ! » Ces paroles jetèrent la jeune fille dans une grande douleur et consternation, car aussitôt son père s’écria : « Tu entends toi-même le scélérat ! Il ne se repent pas ! » Et il aspergea à l’instant Ali avec l’eau de la tasse talismanique, en lui criant : « Sois chien ! » Et Ali se trouva de suite changé en chien, de l’espèce des rues ; et le magicien lui cracha à la figure et lui donna un coup de pied en le chassant du palais.
Le chien Ali se mit à errer hors des murs ; mais comme il ne trouvait rien à manger, il se décida à entrer dans Baghdad. Mais aussitôt il fut accueilli par l’immense clameur de tous les chiens des divers quartiers où il passait et qui, à l’aspect de cet étranger qu’ils ne connaissaient pas et qui violait ainsi les frontières dont ils étaient les gardiens, se mirent à le poursuivre à coups de dents jusqu’à leurs limites respectives. Et l’intrus tombait de la sorte de territoire en territoire, partout poursuivi et mordu cruellement ; mais il put enfin se réfugier dans une boutique ouverte qui se trouvait être par hasard en territoire neutre. D’ailleurs le propriétaire, qui était un brocanteur pour les objets de seconde main, voyant ce malheureux chien à la queue entre les jambes poursuivi furieusement par l’armée des autres chiens, prit son bâton et le défendit contre les agresseurs qui finirent par se disperser en aboyant dans le loin. Alors le chien Ali, pour témoigner sa reconnaissance au brocanteur, se coucha à ses pieds, les larmes aux yeux, et le caressa en le léchant et battant de la queue avec émotion. Et il resta auprès de lui jusqu’au soir, en se disant : « Il vaut encore mieux être chien que singe, par exemple, ou pire encore ! » Et le soir, quand le brocanteur eut fermé sa boutique, il se colla à lui et le suivit à sa maison.
Or, à peine le brocanteur fut-il entré chez lui, que sa fille se couvrit le visage et s’écria…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Or à peine le brocanteur fut-il entré chez lui, que sa fille se couvrit le visage et s’écria : « Ô mon père, comment prends-tu sur toi de faire entrer chez ta fille un homme étranger ! » Le brocanteur dit : « Quel étranger ? Il n’y a ici que le chien ! » Elle répondit : « Ce chien n’est autre qu’Ali Vif-Argent du Caire qui a été ensorcelé par le juif Azaria le magicien, et cela à cause de la robe de sa fille Kamaria ! » À ces paroles, le brocanteur se tourna vers le chien et lui demanda : « Est-ce vrai, cela ? » Et le chien lui fit avec la tête un signe qui signifiait : « Oui ! » Et la jeune fille continua : « Je suis prête, s’il veut consentir à m’épouser, à lui rendre sa première forme humaine ! » Et le brocanteur s’écria : « Par Allah ! ô ma fille, rends-lui cette forme-là, et certainement il t’épousera ! » Puis il se tourna vers le chien et lui demanda : « Tu as entendu ! Consens-tu à la chose ? » Il remua la queue et fit un signe de tête qui signifiait : « Oui ! » Alors la jeune fille prit une tasse talismanique remplie d’eau, et elle commençait à prononcer dessus les paroles conjuratoires, quand soudain un grand cri se fit entendre et la jeune esclave de la jeune fille entra dans la chambre en disant à sa maîtresse : « Où est ta promesse, ô ma maîtresse, et le pacte conclu entre nous deux ? Tu m’as juré, quand je t’ai enseigné la sorcellerie, de ne jamais faire d’opération magique sans me consulter ! Or justement moi aussi je veux épouser le jeune Ali Vif-Argent, chien présentement ; et je ne consentirai à sa transformation en homme qu’à condition qu’il nous appartiendra à toutes deux en commun et qu’il passera une nuit avec moi et une nuit avec toi ! » Et, la jeune fille ayant consenti à cet arrangement, son père, assez étonné de tout cela, lui demanda : « Et depuis quand as-tu appris la sorcellerie ? » Elle répondit : « Depuis l’arrivée de notre nouvelle esclave, celle-ci, qui l’avait apprise elle-même quand elle était autrefois au service du juif Azaria et qu’elle pouvait feuilleter en cachette les grimoires et les livres anciens de cet insigne magicien ! »
Après quoi les deux jeunes filles prirent chacune une tasse talismanique et, après y avoir marmotté des paroles en langue hébraïque, aspergèrent d’eau le chien Ali en lui disant : « Par les vertus et les mérites de Soleimân, redeviens un être humain vivant ! » Et Ali Vif-Argent sauta à l’instant sur ses deux pieds, plus jeune et plus beau que jamais. Mais au même moment un grand cri se fit entendre, la porte s’ouvrit toute grande, et une merveilleuse jeune fille fit son entrée dans la chambre en portant sur ses bras deux plateaux d’or superposés : sur le plateau d’or du bas se trouvaient la robe d’or, la couronne d’or, la ceinture d’or et la pantoufle d’or, et sur le plateau plus petit du haut, sanglante et les yeux convulsés, se trouvait la tête coupée du Juif Azaria !
Or, cette troisième jeune fille, si belle, n’était autre que Kamaria, la fille du magicien qui, ayant déposé les deux plateaux aux pieds d’Ali Vif-Argent, lui dit : « Je t’apporte, ô Ali, car je t’aime, les effets que tu convoitais et la tête de mon père le Juif ! Car moi maintenant je suis devenue musulmane ! » Et elle prononça : « Il n’y a de Dieu qu’Allah ! Et Môhammad est l’envoyé d’Allah ! »
À ces paroles, Ali Vif-Argent répondit : « Je veux bien consentir à t’épouser conjointement à ces deux jeunes filles que voici, puisque tu m’apportes, toi femme, contrairement aux ordinaires usages, un si beau présent de noces ! Mais c’est à condition qu’à mon tour je fasse cadeau de ces objets à Zeinab, fille de Dalila, que je désire avoir comme quatrième épouse, puisque la loi permet quatre épouses légitimes ! » Kamaria y consentit, et les deux autres jeunes filles également. Et le brocanteur demanda : « Nous promets-tu au moins de ne point prendre sur tes quatre épouses légitimes des concubines ? » Il répondit : « Je le promets ! » Et il prit le plateau d’or qui contenait les effets de Kamaria, et sortit pour aller les porter à Zeinab, fille de Dalila.
Comme il se dirigeait vers la maison de Dalila, il aperçut un marchand ambulant qui portait sur sa tête un grand plateau de confitures sèches, de halawa et d’amandes habillées de sucre, et il se dit : « Je ferai bien de prendre avec moi de ces douceurs pour les portera Zeinab ! » D’ailleurs le marchand, qui semblait le guetter, lui dit : « Ô mon maître, il n’y a pas dans Baghdad quelqu’un qui réussisse comme moi la confiture de carottes aux noix ! Combien t’en faut-il ? Mais d’abord, avant d’acheter, goûte ce petit morceau et dis-moi ce que tu en penses ! » Et Vif-Argent prit le morceau et l’avala. Mais au même moment il tomba sur le sol, comme inanimé. Le morceau de confiture était mélangé de bang ; et le marchand n’était autre que Mahmoud l’Avorton qui exerçait ce métier lucratif de dépouiller les clients. Il avait vu toutes les belles choses que portait Vif-Argent, et l’avait endormi pour les lui voler. En effet, une fois Vif-Argent étendu sans mouvement, l’Avorton s’empara de la robe d’or et des autres choses, et se disposa à s’enfuir ; mais soudain apparut à cheval Hassan-la-Peste, accompagné de ses quarante gardes, qui aperçut le voleur et l’arrêta. Et l’Avorton fut obligé de faire des aveux et de montrer à Hassan le corps étendu sur le sol. Aussitôt Hassan, qui, depuis la disparition d’Ali, parcourait avec ses gardes tous les quartiers de Baghdad à sa recherche, fit apporter du contre-bang et le lui administra. Et, quand il fut réveillé, son premier cri fut de demander des nouvelles des effets qu’il portait à Zeinab. Et Hassan les lui montra et, après les effusions de leur rencontre, le félicita de son adresse et lui dit : « Par Allah ! tu nous surpasses tous ! » Puis il le conduisit à la maison d’Ahmad-la-Teigne et, après de nouveaux salams de part et d’autre, il se fit raconter toute l’aventure, et lui dit : « Mais alors ! Le palais enchanté du magicien te revient de droit, puisque tu vas prendre Kamaria comme une de tes quatre épouses ! C’est là que nous célébrerons tes quadruples noces ! Et je vais à l’instant porter les présents de ta part à Zeinab, et décider son oncle Zoraïk à te l’accorder en mariage. Et je te promets que cette fois le vieux fripon ne refusera pas ! Quant à Mahmoud l’Avorton nous ne pouvons le châtier, puisque tu deviens son parent, en entrant dans sa famille…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … Quant à Mahmoud l’Avorton, nous ne pouvons le châtier, puisque tu deviens son parent, en entrant dans sa famille ! »
Lorsqu’il eut dit ces paroles, Hassan-la-Peste prit la robe d’or, la couronne d’or, la ceinture d’or et la pantoufle d’or et alla au khân des pigeons, où il trouva Dalila et Zeinab en train justement de distribuer le grain aux pigeons. Après les salams, il leur dit de faire venir Zoraïk ; et, Zoraïk étant arrivé, il leur fit voir les présents de noces qu’ils avaient réclamés pour dot de Zeinab, et leur dit : « Maintenant nul refus n’est possible ! Sinon c’est moi, Hassan, que l’offense regarderait ! » Et Dalila et Zoraïk acceptèrent les présents, et donnèrent leur consentement au mariage de Zeinab avec Ali Vif-Argent.
Or, dès le lendemain Ali Vif-Argent alla prendre possession du palais du Juif Azaria ; et le soir même, devant le kâdi et les témoins d’une part, et Ahmad-la-Teigne avec ses quarante et Hassan-la-Peste avec ses quarante d’autre part, on écrivit le contrat de mariage d’Ali Vif-Argent avec Zeinab, fille de Dalila, avec Kamaria, fille d’Azaria, avec la fille du brocanteur, et avec la jeune esclave du brocanteur. Et l’on célébra somptueusement les cérémonies des quatre mariages. Et c’était certainement Zeinab qui, de l’avis de toutes les femmes du cortège, était la plus touchante sous ses voiles de mariée et la plus belle. Elle était d’ailleurs vêtue de la robe d’or, de la couronne d’or, de la ceinture d’or et de la pantoufle d’or ; et les trois autres adolescentes marchaient autour d’elle comme les étoiles autour de la lune.
Aussi, cette nuit-là même, Ali Vif-Argent commença sa tournée de noces en pénétrant d’abord chez son épouse Zeinab. Et il trouva qu’elle était une vraie perle imperforée et une pouliche non montée. Et il se délecta d’elle à la limite de la délectation, et pénétra ensuite chez chacune de ses trois autres épouses, à tour de rôle. Et, comme il les trouva absolument parfaites en beauté et en virginité, il se délecta d’elles également, et leur prit ce qu’il avait à leur prendre et leur donna ce qu’il avait à leur donner, et cela en toute générosité de part et d’autre et complète satisfaction.
Quant aux festins donnés à l’occasion des noces, ils durèrent trente jours et trente nuits ; et l’on n’épargna rien pour qu’ils fussent dignes de celui qui en était le dispensateur. Et l’on se réjouit, et l’on rit, et l’on chanta, et l’on s’amusa extrêmement.
Lorsque les fêtes furent terminées, Hassan-la-Peste vint trouver Vif-Argent et, après lui avoir réitéré ses félicitations, lui dit : « Ya Ali, voici que le temps est enfin venu pour toi d’être présenté à notre maître le khalifat, pour qu’il t’accorde ses faveurs ! » Et il l’emmena au Diwân, où le khalifat ne tarda pas à faire son entrée.
Le khalifat, à la vue du jeune Ali Vif-Argent, fut très charmé ; car, en vérité, sa bonne mine ne pouvait que prévenir en sa faveur, et la beauté pouvait témoigner qu’elle le reconnaissait pour son élu. Et Ali Vif-Argent, poussé par Hassan-la-Peste, s’avança devant le khalifat et embrassa la terre entre ses mains. Puis il se releva et, prenant un plateau couvert d’une étoffe de soie que tenait Dos-de-Chameau, il le découvrit devant le khalifat. Et l’on vit la tête coupée du Juif Azaria le magicien.
À cette vue, le khalifat, étonné, demanda : « Quelle est cette tête ? » Et Vif-Argent répondit : « Celle du plus grand de tes ennemis, ô émir des Croyants ! Son propriétaire était un insigne magicien capable de détruire Baghdad avec tous ses palais ! » Et il raconta à Haroun Al-Rachid toute l’histoire depuis le commencement jusqu’à la fin sans omettre un détail.
Cette histoire émerveilla tellement le khalifat qu’il nomma à l’instant Vif-Argent comme intendant général de la police, avec le même rang, les mêmes prérogatives et les mêmes émoluments qu’Ahmad-la-Teigne et Hassan-la-Peste ; puis il lui dit : « Vivent les braves qui te ressemblent, ya Ali ! Je veux que tu me demandes encore quelque chose ! » Vif-Argent répondit : « La durée éternelle de la vie du khalifat, et la permission de faire venir du Caire, ma patrie, mes anciens compagnons les quarante, pour les avoir ici comme gardes, à l’exemple de ceux de mes deux collègues ! » Et le khalifat répondit : « Tu le peux ! » Puis il ordonna aux plus habiles scribes du palais d’écrire soigneusement cette histoire, et de la serrer dans les archives du règne, pour qu’elle servît de leçon à la fois et d’amusement aux peuples musulmans et à tous les futurs croyants en Allah et en son prophète Môhammad, le meilleur des hommes (sur lui la prière et la paix !).
Et tous vécurent de la vie la plus délicieuse et la plus gaie, jusqu’à ce que vînt les visiter la Destructrice des Joies et la Séparatrice des Amis !
Et telle est, ô Roi fortuné, dans tous ses détails exacts, comme elle m’est parvenue, l’histoire véridique de Dalila-la-Rouée et de sa fille Zeinab-la-Fourbe avec Ahmad-la-Teigne, Hassan-la-Peste, Ali Vif-Argent et Zoraïk, le marchand de poisson frit ! Mais Allah (qu’il soit glorifié et exalté !) est plus savant et plus pénétrant ! »
— Puis Schahrazade ajouta : « Toutefois ne crois point, ô Roi fortuné, que cette histoire soit plus véridique que celle de Jouder le Pêcheur et de ses frères ! » Et, aussitôt, elle raconta :
HISTOIRE DE JOUDER LE PÊCHEUR
OU LE SAC ENCHANTÉ
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait autrefois un homme marchand, nommé Omar, qui avait en fait de postérité trois enfants : l’un s’appelait Salem, le second s’appelait Salim, et le plus petit s’appelait Jouder. Il les avait élevés jusqu’à ce qu’ils eussent atteint l’âge d’homme ; mais comme il aimait Jouder beaucoup plus que ses frères, ceux-ci remarquèrent cette préférence, furent pris de jalousie et détestèrent Jouder. Aussi, lorsque le marchand Omar, qui était un homme déjà vieux d’années, eut à son tour remarqué cette haine de ses deux fils pour leur frère, il eut bien peur que, lui mort, Jouder n’eût à souffrir de ses frères. Il assembla donc les membres de sa famille et quelques hommes de science ainsi que diverses personnes qui s’occupaient des successions par ordre du kâdi, et leur dit : « Qu’on apporte tous mes biens et toutes les étoffes de ma boutique ! » Et quand on lui eut apporté le tout, il dit : « Ô gens, divisez ces biens et ces étoffes en quatre parts, selon la loi ! » Et ils les divisèrent en quatre parts, Et le vieillard donna une part à chacun de ses enfants, garda pour lui la quatrième part et dit : « Tout cela était mon bien, et je l’ai divisé entre eux de mon vivant, pour qu’ils n’aient plus rien à me réclamer ni à se réclamer entre eux, et qu’à ma mort ils n’aient point à être en désaccord. Quant à la quatrième part que j’ai prise, elle doit revenir à mon épouse, la mère de ces enfants, afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins ! »
Or, peu de temps après, le vieillard mourut ; mais ses fils Salem et Salim ne voulurent point se contenter du partage qui avait été fait, et réclamèrent à Jouder une partie de ce qui lui était revenu, en lui disant : « La fortune de notre père est tombée entre tes mains…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … La fortune de notre père est tombée entre tes mains ! » Et Jouder fut obligé de recourir contre eux aux juges, et de faire comparaître les témoins musulmans qui avaient assisté au partage, et qui témoignèrent de ce qu’ils savaient : aussi le juge empêcha-t-il les deux frères de prétendre à la part de Jouder. Seulement les frais du procès firent perdre à Jouder et à ses frères une partie de ce qu’ils possédaient. Mais cela n’empêcha pas ces derniers, au bout d’un certain temps, de comploter contre Jouder qui fut encore obligé d’en appeler aux juges contre eux ; et cela, de nouveau, leur fit perdre à tous une bonne partie de leur avoir, en frais de procès. Mais ils ne s’arrêtèrent point là, et allèrent devant un troisième juge, et puis devant un quatrième, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils eussent fait manger par les juges tout l’héritage, et qu’ils fussent devenus trois pauvres, sans une pièce de cuivre pour s’acheter une galette et un oignon.
Lorsque les deux frères Salem et Salim se virent dans cet état, et comme ils ne pouvaient plus rien réclamer à Jouder qui était aussi misérable qu’eux, ils allèrent comploter contre leur mère qu’ils réussirent à tromper et à dépouiller, après l’avoir maltraitée. Et la pauvre femme vint en pleurant trouver son fils Jouder et lui dit : « Tes frères m’ont fait telle et telle chose ! Et ils m’ont dépouillée de ma part d’héritage ! » Et elle se mit à proférer des imprécations contre eux. Mais Jouder lui dit : « Ô ma mère ne fais point d’imprécations contre eux ! car Allah saura bien traiter chacun d’eux selon ses actions ! Quant à moi je ne puis plus les attaquer devant le kâdi et les autres juges, puisque les procès demandent des dépenses et que j’ai perdu en jugements tout mon avoir. Il vaut donc mieux nous résigner tous deux au silence. D’ailleurs, ô mère, tu n’as qu’à demeurer chez moi ; et le pain que je mangerais, je te le laisserai ! Toi seulement, ô mère mienne, fais des vœux pour moi, et Allah m’accordera le nécessaire pour te nourrir ! Quant à mes frères, laisse-les recevoir du Souverain Juge la récompense de leur action, et console-toi avec ces paroles du poète :
« Si l’insensé t’opprime, supporte-le patiemment ; et ne compte que sur le Temps pour te venger.
« Mais évite la tyrannie ! car une montagne qui opprimerait une montagne serait à son tour brisée par plus solide qu’elle et volerait en éclats. »
Et Jouder continua à dire de bonnes paroles à sa mère, à la caresser et à l’apaiser, et réussit ainsi à la consoler et à la décider à demeurer chez lui. Et lui, pour gagner leur nourriture, se procura un filet de pêche et se mit à aller tous les jours pêcher soit dans le Nil à Boulak, soit dans les grands étangs, soit dans les autres endroits remplis d’eau ; et il faisait de la sorte un gain tantôt de dix cuivres, tantôt de vingt, tantôt de trente ; et il dépensait le tout sur sa mère et sur lui-même ; et de la sorte ils mangeaient bien et buvaient bien.
Quant à ses deux frères, ils n’avaient rien : ni métier, ni vente, ni achat. La misère, la ruine et toutes les calamités les accablèrent ; et, comme ils n’avaient pas tardé à dissiper ce qu’ils avaient enlevé à leur mère, ils furent réduits à la plus misérable condition et devinrent de malheureux mendiants nus manquant de tout. Aussi ils se virent obligés de venir recourir à leur mère et s’humilier à l’extrême devant elle et se plaindre à elle de la faim qui les torturait. Or le cœur de la mère est compatissant et pitoyable ! Et leur mère, émue de leur misère, leur donnait les galettes qui restaient et qui souvent étaient déjà toutes moisies ; et elle leur servait également les restes du repas de la veille, en leur disant : « Mangez vite et partez avant que votre frère revienne ; car de vous voir ici il ne serait point content et son cœur durcirait contre moi ; et de la sorte vous me compromettriez vis-à-vis de lui ! » Et eux se hâtaient de manger et de s’en aller. Mais, un jour d’entre les jours, ils entrèrent chez leur mère qui, selon son habitude, mit devant eux des mets et du pain pour qu’ils mangeassent ; et soudain Jouder fit son entrée. Et la mère fut très honteuse et bien confuse ; et, dans sa peur qu’il se fâchât contre elle, elle baissa la tête vers la terre, avec des regards bien humbles du côté de son fils. Mais Jouder, loin de se montrer contrarié, sourit au visage de ses frères, et leur dit : « Soyez les bienvenus, ô mes frères ! Et bénie soit votre journée ! Qu’est-il donc arrivé pour que vous vous soyez enfin décidés à venir nous voir en ce jour de bénédiction ? » Et il se jeta à leur cou, et les embrassa avec effusion, en leur disant : « En vérité, que c’est mal à vous de m’avoir fait ainsi languir de la tristesse de ne plus vous voir ! Vous n’êtes plus venus chez moi pour avoir de mes nouvelles et des nouvelles de votre mère ! » Ils répondirent : « Par Allah ! ô notre frère, le désir de te voir nous a fait également bien languir ; et nous n’avons été retenus loin de toi que par la honte de ce qui s’était passé entre nous et toi ! Mais nous voici repentants à l’extrême ! Et d’ailleurs tout cela était l’œuvre de Satan (qu’il soit maudit par Allah l’Exalté !) et maintenant nous n’avons d’autre bénédiction que toi et notre mère ! » Et Jouder, bien ému de ces paroles, leur dit : « Et moi je n’ai d’autre bénédiction que vous deux, frères miens ! » Alors la mère se tourna vers Jouder et lui dit : « Ô mon enfant, qu’Allah blanchisse ton visage et augmente ta prospérité, car tu es le plus généreux de nous tous, ô mon enfant ! » Et Jouder dit : « Soyez les bienvenus et demeurez chez moi ! Allah est généreux, et les biens abondent dans la demeure ! » Et il acheva de se réconcilier avec ses frères qui soupèrent avec lui et passèrent la nuit dans sa maison.
Le lendemain ils prirent tous ensemble le repas du matin, et Jouder, chargé de son filet, s’en alla confiant en la générosité de l’Ouvreur, tandis que ses deux frères de leur côté s’en allaient et restaient absents jusqu’à midi, pour alors revenir déjeuner avec leur mère. Quant à Jouder, il ne revint que le soir, apportant avec lui de la viande et des légumes, toutes choses achetées avec son gain de la journée. Et ils vécurent de la sorte l’espace d’un mois, Jouder péchant du poisson pour le vendre et en dépenser le produit sur sa mère et ses frères qui mangeaient et se divertissaient.
Or, un jour d’entre les jours…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, un jour d’entre les jours, Jouder jeta son filet dans le fleuve et, l’ayant ramené, le trouva vide ; il le jeta une seconde fois, et le ramena vide ; alors il se dit en lui-même : « Il n’y a pas de poisson en cet endroit-ci ! » Et il changea de place, et, ayant jeté son filet, le ramena vide encore ! Il changea de place une seconde fois, une troisième fois et ainsi de suite depuis le matin jusqu’au soir sans réussir à pêcher un seul goujon. Alors il s’écria : « Ô prodiges ! N’y aurait-il plus de poissons dans l’eau ? Ou bien la cause serait-elle autre chose ? » Et, comme le soir tombait, il chargea son filet sur son dos et s’en revint bien peiné, bien triste, et portant avec lui le chagrin et le souci de ses frères et de sa mère, sans savoir comment il allait leur donner à souper ; et il passa de la sorte devant une boutique de boulanger où il avait coutume, en rentrant, d’acheter le pain du soir. Et il vit la foule des clients qui se pressaient pour acheter le pain, leur monnaie à la main, sans que le boulanger leur prêtât grande attention. Et Jouder s’arrêta tristement à l’écart, en regardant les acheteurs et en soupirant. Alors le boulanger lui dit : « La bienvenue à toi, ô Jouder ! As-tu besoin de pain ? » Mais Jouder garda le silence. Le boulanger lui dit : « Si tu n’as point sur toi d’argent, prends tout de même ce dont tu as besoin, et je te donne du délai pour me payer ! » Et Jouder lui dit alors : « Donne-moi du pain pour dix cuivres, et prends chez toi mon filet en gage ! » Mais le boulanger répondit : « Non, ô pauvre ! ton filet est la porte de ton gain, et si je le prenais je fermerais sur toi la porte de la subsistance. Voici donc les pains que tu prends d’ordinaire ! Et voici de ma part pour toi dix pièces de cuivre dont tu pourrais avoir besoin. Et demain, ya Jouder, tu m’apporteras du poisson pour vingt cuivres ! » Et Jouder répondit : « Sur ma tête et mes yeux ! » et, après avoir beaucoup remercié le boulanger, il prit le pain et les dix cuivres avec lesquels il alla acheter de la viande et des légumes, en se disant : « Demain le Seigneur saura me procurer les moyens de m’acquitter ; et Il dissipera mes soucis ! » Et il revint à sa maison où sa mère fit la cuisine comme à l’ordinaire. Et Jouder soupa et s’endormit.
Le lendemain il prit son filet et voulut sortir ; mais sa mère lui dit : « Tu sors sans manger ton pain du matin ! » Il répondit : « Toi, ô mère, mange-le avec mes frères ! » et il s’en alla au fleuve où il jeta son filet une première, deuxième et troisième fois, en changeant plusieurs fois d’endroit, et cela jusqu’à l’heure de la prière de l’après-midi, mais sans rien pêcher. Alors il reprit son filet et s’en revint désolé à l’extrême ; et il fut obligé, n’ayant point d’autre route pour rentrer chez lui, de passer devant la boutique du boulanger qui l’aperçut et lui compta dix nouveaux pains et dix cuivres, et lui dit : « Prends cela et va ! Et si ce que le sort a décidé n’arrive pas aujourd’hui, il arrivera demain ! » Et Jouder voulut s’excuser ; mais le boulanger lui dit : « Allons, ô pauvre, tu n’as point d’excuses à me faire ! Si tu avais pêché quelque chose, tu aurais eu de quoi me payer ! Et si demain aussi tu ne pêches rien, tu viendras ici sans honte ; et tu as tout délai et tout crédit ! »
Or justement le lendemain Jouder ne pêcha rien du tout, et fut encore obligé de se rendre chez le boulanger ; et il eut la même malechance pendant sept jours de suite, au bout desquels il fut dans une grande angoisse de cœur, et se dit en lui-même : « Aujourd’hui je vais aller pêcher au lac Karoun. Peut-être est-ce là que se trouve ma destinée ! »
Il alla donc au lac Karoun, situé non loin du Caire, et se disposait à y jeter son filet, quand il vit venir à lui un Moghrabin monté sur une mule. Il était vêtu d’une robe extraordinairement belle, et était si bien enveloppé dans son burnous et son foulard de tête qu’on ne lui apercevait qu’un œil. La mule également était caparaçonnée et harnachée de velours d’or et de soieries, et sur sa croupe il y avait une besace en laine de couleur.
Lorsque le Moghrabin fut tout près de Jouder, il descendit de sa mule, et dit : « Le salam sur toi, ô Jouder, ô fils d’Omar ! » Et Jouder répondit : « Et sur toi le salam, ô mon maître le pèlerin ! » Le Moghrabin dit : « Ô Jouder, j’ai besoin de toi ! Si tu veux m’obéir, tu recueilleras de grands avantages et un bien immense ; et tu deviendras mon ami ; et tu règleras toutes mes affaires ! » Jouder répondit : « Ô mon maître le pèlerin, dis-moi ce que tu as dans l’esprit, et moi je t’obéirai sans restriction ! » Alors le Moghrabin lui dit : « Commence donc par réciter le chapitre liminaire du Korân ! » Et Jouder récita avec lui la fatiha du Korân. Alors le Moghrabin tira de sa besace des cordons en soie et lui dit : « Ô Jouder fils d’Omar, tu vas m’attacher les bras avec ces cordons de soie, le plus solidement que tu pourras ! Après quoi tu me jetteras dans le lac, et tu attendras un certain temps. Si tu vois paraître au dessus de l’eau ma main avant mon corps, hâte-toi de jeter ton filet et de me ramener sur le rivage ; mais si tu vois paraître mon pied hors de l’eau, sache que je suis mort. Alors ne t’inquiète plus de moi, prends la mule avec la besace, et va au souk des marchands où tu trouveras un Juif nommé Schamayâa. Tu lui remettras la mule, et il te donnera cent dinars que tu prendras pour t’en aller en ta voie ! Mais seulement garde le secret sur tout cela…
— À ce moment de sa narration Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Mais seulement garde le secret sur tout cela ! » Alors Jouder répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et il attacha les bras du Moghrabin qui lui disait : « Plus solidement encore ! » et, lorsqu’il eut bien fait la chose, il le souleva et le jeta dans le lac. Puis il attendit quelques instants pour voir ce qui allait arriver.
Or, au bout d’un certain temps, il vit soudain sortir et émerger de l’eau les deux pieds à la fois du Moghrabin.
Alors il comprit que l’homme était mort, et, sans plus s’inquiéter de lui, il prit la mule et alla au souk des marchands où, de fait, il vit le Juif en question assis sur une chaise à l’entrée de sa boutique, et qui, à la vue de la mule, s’écria : « Il n’y a plus de doute ! L’homme a péri ! » Puis il ajouta : « Il a péri victime de son avidité ! » Et, sans ajouter un mot, il prit la mule des mains de Jouder, et lui compta cent dinars d’or, en lui recommandant de garder le secret.
Jouder prit donc l’argent du Juif, et se hâta d’aller trouver le boulanger auquel il prit du pain comme à l’ordinaire, et, lui tendant un dinar, lui dit : « Voici pour te payer ce que je te dois, ô mon maître ! » Et le boulanger fit son compte et lui dit : « Il te reste chez moi du pain pour deux jours ! » Et Jouder le quitta et alla trouver le boucher et le vendeur de légumes et, leur donnant à chacun un dinar, leur dit : « Donnez-moi ce qu’il me faut, et gardez chez vous, en compte, le reste de l’argent ! » Et il prit la viande et les légumes, et porta le tout à la maison, où il trouva ses frères bien affamés et sa mère qui leur disait de prendre patience jusqu’au retour de leur frère. Alors il mit devant eux les provisions, sur lesquelles ils se précipitèrent comme des ghouls, et commencèrent, en attendant la cuisson, par dévorer tout le pain.
Le lendemain, avant de partir, Jouder remit tout l’or qu’il avait à sa mère, en lui disant : « Garde-le pour toi, et pour en donner à mes frères afin qu’ils ne manquent jamais de rien ! » Et il prit son filet de pêche, et retourna au lac Karoun ; et il allait commencer son travail, quand il vit un second Moghrabin, qui ressemblait au premier, s’avancer de son côté, bien plus richement vêtu, et monté sur une mule plus somptueusement harnachée. Il mit pied à terre et dit : « Le salam sur toi, ô Jouder fils d’Omar ! » Il répondit : « Et sur toi le salam, ô mon seigneur le pèlerin ! » Il dit : « As-tu vu hier venir à toi un Moghrabin monté sur une mule comme celle-ci ! » Mais Jouder, qui eut peur d’être accusé de la mort de l’homme, se dit qu’il valait mieux nier absolument, et répondit : « Non ! je n’ai vu personne ! » Le second Moghrabin sourit et dit : « Ô pauvre Jouder, ne sais-tu donc que je n’ignore rien de ce qui s’est passé ? L’homme que tu as jeté dans le lac, et dont tu as vendu la mule au Juif Schamayâa pour cent dinars, était mon frère ! Pourquoi chercher à nier ? » Il répondit : « Du moment que tu sais tout cela, pourquoi me le demandes-tu ? » Il dit : « Parce que, ô Jouder, j’ai besoin que tu me rendes le même service qu’à mon frère ! » Et il tira de sa besace précieuse de gros cordons de soie qu’il remit à Jouder, en lui disant : « Attache-moi aussi solidement que tu l’as attaché, et jette-moi à l’eau ! Si tu vois sortir mon pied le premier, je serai mort ! Tu prendras alors la mule et tu la vendras au Juif pour cent dinars ! »
Jouder répondit : « Avance alors ! » Et le Moghrabin s’avança, et Jouder lui attacha les bras et, le soulevant, le jeta dans le lac, où il coula à fond.
Or, au bout de quelques instants, il vit deux pieds sortir de l’eau ! Et il comprit que le Moghrabin était mort ; et il se dit : « Il est mort ! Qu’il ne revienne plus ! Et qu’il aille en calamité ! Inschallah ! puissé-je tous les jours voir venir à moi un Moghrabin que je jetterai à l’eau et qui me fera gagner cent dinars ! » Et il prit la mule et s’en alla trouva le Juif qui, en le voyant, s’écria : « Il est mort, le second ! » Jouder répondit : « Puisse ta tête vivre ! » Et le Juif ajouta : « Telle est la récompense des ambitieux ! » Et il prit la mule et donna cent dinars à Jouder qui se rendit auprès de sa mère et les lui remit. Et sa mère lui demanda : « Mais, ô mon enfant, d’où te vient tout cet or ? » Alors il lui raconta ce qui lui était arrivé ; et elle, bien effrayée, lui dit : « Tu feras bien de ne plus retourner au lac Karoun ! J’ai grand peur pour toi des Moghrabins ! » Il répondit : « Mais, ô ma mère, je ne les jette à l’eau qu’avec leur consentement ! D’ailleurs comment ne point agir de la sorte, quand le métier de noyeur me rapporte cent dinars par jour ? Par Allah ! je veux maintenant me rendre quotidiennement au lac Karoun, jusqu’à ce que le dernier des Moghrabins soit noyé par mes mains, et qu’il ne reste plus trace de Moghrabins ! »
Le troisième jour, Jouder retourna donc au lac Karoun, et, au même instant, il vit venir un troisième Moghrabin qui ressemblait étonnamment aux deux premiers, mais les surpassait encore par la richesse de ses habits et la beauté des harnachements dont était ornée la mule qu’il montait ; et, derrière lui, dans la besace, il y avait, de chaque côté, un grand bocal en verre avec un couvercle. Il s’approcha de Jouder et lui dit : « Le salam sur toi, ô Jouder fils d’Omar ! » Il lui rendit le salam, en pensant : « Comment se fait-il donc que tous me connaissent et connaissent mon nom ? » Le Moghrabin lui demanda…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Le Moghrabin lui demanda : « As-tu vu passer des Moghrabins par ici ? » Il répondit : « Deux ! » Il demanda : « Où sont-ils allés ? » Il dit : « Je leur ai attaché les bras, et je les ai jetés dans ce lac où ils se sont noyés ! Et, si leur sort te convient, je le tiens en réserve pour toi également ! » À ces paroles le Moghrabin se mit à rire, et répondit : « Ô pauvre, ne sais-tu que toute vie a son terme fixé d’avance ? » Et il descendit de sa mule, et ajouta tranquillement : « Ô Jouder, je souhaite que tu me fasses ce que tu leur as fait ! » Et il tira de sa besace de gros cordons de soie et les lui remit ; et Jouder lui dit : « Alors tends-moi tes mains pour que je te les attache derrière le dos ; et fais vite, car je suis très pressé, et le temps presse ! D’ailleurs je suis bien au courant du métier ; et tu peux avoir confiance en mon habileté de noyeur ! » Alors le Moghrabin livra ses bras. Jouder les lui attacha derrière le dos ; puis il le souleva et le lança dans le lac, où il le vit plonger et disparaître. Et, avant de s’en aller avec la mule, il attendit que les pieds du Moghrabin fussent sortis de l’eau ; mais, à sa surprise extrême, ce furent les deux mains qui trouèrent l’eau, suivies de la tête et du Moghrabin entier qui lui cria : « Je ne sais point nager ! Hâte-toi de m’attraper avec ton filet, ô pauvre ! » Et Jouder jeta sur lui le filet, et réussit à le ramener sur le rivage. Alors il vit dans ses mains, chose qu’il n’avait pas d’abord remarquée, deux poissons de couleur rouge comme le corail, un poisson dans chaque main. Et le Moghrabin se hâta d’aller à sa mule, prit les deux bocaux de verre, mit un poisson dans chaque bocal, referma les couvercles, et replaça les bocaux dans la besace. Après quoi il revint vers Jouder et, le prenant dans ses bras, se mit à l’embrasser avec une grande effusion sur la joue droite et sur la joue gauche ; et il lui dit : « Par Allah ! sans toi je ne serais plus vivant, et je n’aurais pas pu attraper ces deux poissons-là ! »
Tout cela !
Or Jouder, qui ne remuait plus dans sa surprise, finit par lui dire : « Par Allah ! ô mon maître le pèlerin, si tu crois vraiment que je suis pour quelque chose dans ta délivrance et la capture de ces poissons-là, hâte-toi, pour toute gratitude, de me raconter ce que tu sais au sujet des deux Moghrabins noyés, et la vérité sur les deux poissons en question et sur le juif Schamayâa du souk ! » Alors le Moghrabin dit :
« Ô Jouder, sache que les deux Moghrabins qui se sont noyés étaient mes frères. L’un s’appelait Abd Al-Salam et l’autre s’appelait Abd Al-Ahad. Quant à moi, je m’appelle Abd Al-Samad. Et celui que tu crois être un Juif, n’est point juif du tout, mais un vrai musulman du rite malékite : son nom est Abd Al-Rahim, et il est également notre frère. Or, ya Jouder, notre père, qui s’appelait Abd Al-Wadoud, était un grand magicien qui possédait à fond toutes les sciences mystérieuses, et il nous enseigna, à nous ses quatre fils, la magie, la sorcellerie et l’art de découvrir et d’ouvrir les trésors les plus cachés. Aussi nous nous appliquâmes vivement à l’étude de ces sciences, où nous atteignîmes un tel degré de savoir que nous finîmes par soumettre à nos ordres les genn, les mareds et les éfrits.
« Lorsque notre père mourut, il nous laissa de grands biens et d’immenses richesses. Alors nous partageâmes entre nous, selon l’équité, les trésors laissés, les talismans divers et les livres de science ; mais sur la possession de certains manuscrits nous ne tombâmes pas d’accord. Le plus important de ces manuscrits était un livre intitulé Annales des Anciens, et vraiment inestimable de prix et de valeur, et tel qu’il ne pouvait être payé même avec son pesant de pierreries ! En effet là-dedans on trouvait des indications précises sur tous les trésors cachés au sein de la terre, et sur la solution des énigmes et des signes mystérieux. Et c’était justement dans ce manuscrit que notre père avait puisé toute la science qu’il possédait.
« Comme la discorde commençait à se confirmer entre nous, nous vîmes entrer dans notre maison un vénérable cheikh, celui-là même qui avait élevé notre père et lui avait enseigné la magie et la divination. Et ce cheikh, qui s’appelait Le Très-Profond Cohen, nous dit : « Apportez-moi ce livre ! » Et nous lui apportâmes les Annales des Anciens qu’il prit et nous dit : « Ô mes enfants, vous êtes les fils de mon fils, et je ne puis favoriser l’un de vous au dément des autres ! Il faut donc que celui de vous qui désire posséder ce livre aille ouvrir le trésor appelé Al-Schamardal, et m’en apporte la sphère céleste, la fiole de kohl, le glaive et le sceau ! Car tous ces objets sont contenus dans ce trésor. Et leurs vertus sont extraordinaires ! En effet le sceau est gardé par un genni dont le nom seul est effrayant à prononcer : il s’appelle l’Éfrit Tonnerre Tonitruant ! Et l’homme qui devient le possesseur de ce sceau peut affronter sans crainte la puissance des rois et des sultans ; et il peut, quand il veut, être le dominateur de la terre en large comme en long. Le glaive ! celui qui le possède peut, à sa guise, détruire les armées rien qu’en le brandissant : car aussitôt des flammes et des éclairs en sortent qui réduisent à néant tous les guerriers. La sphère céleste ! celui qui la possède peut, selon son désir, voyager sur tous les points de l’univers sans se déranger de sa place, et visiter toutes les contrées de l’Orient à l’Occident ! Pour cela il n’a qu’à toucher du doigt le point où il veut aller et les régions qu’il désire parcourir, et la sphère se met à tourner en lui faisant passer sous les yeux toutes les choses intéressantes des pays en question ainsi que leurs habitants, tout comme s’ils étaient entre ses mains. Et si, des fois, il a à se plaindre de l’hospitalité des indigènes d’un pays quelconque ou de la réception d’une ville d’entre les villes, il n’a qu’à tourner vers le soleil le point où se trouve la région ennemie, et aussitôt elle devient la proie des flammes et brûle avec tous ses habitants. Quant à la fiole de kohl ! celui qui se frotte les paupières avec le kohl qu’elle contient, voit à l’instant tous les trésors cachés dans la terre ! Voilà ! Toutefois le livre ne reviendra de droit qu’à celui qui réussira dans son entreprise ; et ceux qui auront échoué ne pourront faire aucune réclamation. Acceptez-vous ces conditions ? » Nous répondîmes : « Nous les acceptons, ô cheikh de notre père ! Mais nous ne savons rien au sujet de ce trésor de Schamardal ! » Alors il nous dit : « Sachez, mes enfants, que ce trésor de Schamardal se trouve…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Sachez, mes enfants, que ce trésor de Schamardal se trouve sous la domination des deux fils du roi Rouge. Votre père autrefois avait essayé de s’emparer de ce trésor ; mais, pour l’ouvrir, il fallait auparavant s’emparer des fils du roi Rouge. Or, au moment où votre père allait mettre la main dessus, ils lui échappèrent et allèrent se jeter, transformés en poissons rouges, au fond du lac Karoun, près du Caire. Et comme ce lac est lui-même enchanté, votre père eut beau faire, il ne put arriver à attraper les deux poissons. Alors il vint me trouver et se plaignit à moi de l’insuccès de ses tentatives. Et moi aussitôt je fis mes calculs astrologiques et tirai l’horoscope ; et je découvris que ce trésor de Schamardal ne pouvait être ouvert que par l’entremise et sur le visage d’un jeune homme du Caire, nommé Jouder ben-Omar, pêcheur de son métier. On peut rencontrer ce Jouder sur les bords du lac Karoun. Et l’enchantement de ce lac ne peut être dénoué que par ce Jouder-là, qui devra attacher les bras de celui dont la destinée est de descendre dans ce lac ; et il le jettera à l’eau. Et celui qui aura été jeté, aura à lutter contre les deux fils enchantés du roi Rouge ; et si son sort est de les vaincre et de s’en emparer, il ne se noiera pas, et sa main viendra surnager la première au dessus de l’eau. Et ce sera Jouder qui le pêchera avec son filet ! Mais celui qui périra, remontera sur l’eau les pieds les premiers, et devra être abandonné ! »
« En entendant ces paroles du cheikh Le Plus Profond Cohen, nous répondîmes : « Certes ! nous voulons tenter l’entreprise, même au risque de périr ! » Seul notre frère Abd Al-Rahim ne voulut point de l’aventure, et nous dit : « Moi, je ne veux pas ! » Alors nous le décidâmes à se déguiser en marchand juif ; et nous convînmes ensemble de lui envoyer la mule et la besace, pour qu’il les achetât du pêcheur, dans le cas où nous péririons dans notre tentative !
« Or tu sais, ô Jouder, ce qui est arrivé ! Mes deux frères ont péri dans le lac, victimes des fils du roi Rouge ! Et moi à mon tour, lorsque tu m’eus jeté au lac, je faillis succomber dans ma lutte contre eux ; mais, grâce à une conjuration mentale, je réussis à me défaire de mes liens, à dénouer l’enchantement invincible du lac et à m’emparer des deux fils du roi Rouge, qui sont ces deux poissons couleur de corail que tu m’as vu enfermer dans les bocaux de ma besace. Or ces deux poissons enchantés, fils du roi Rouge, sont tout simplement deux éfrits puissants ; et c’est grâce à leur capture que je vais pouvoir enfin ouvrir le trésor de Schamardal.
« Seulement, pour ouvrir ce trésor, il est absolument nécessaire que tu sois toi-même présent, puisque l’horoscope tiré par Le Plus Profond Cohen prédisait que la chose ne pouvait être faite que sur ton visage !
« Veux-tu donc, ô Jouder, accepter de venir avec moi au Maghreb, dans un endroit situé non loin de Fas et de Miknas, afin de m’aider à ouvrir le trésor de Schamardal ? Et moi je te donnerai tout ce que tu demanderas ! Et tu seras pour toujours mon frère en Allah ! Et, après ce voyage, tu reviendras le cœur joyeux au milieu de ta famille ! »
Lorsque Jouder eut entendu ces paroles, il répondit : « Ô mon seigneur le pèlerin, moi j’ai à mon cou ma mère et mes frères ! Et c’est moi qui m’occupe de les faire vivre ! Si donc je consens à m’en aller avec toi, qui leur donnera le pain qui les nourrit ? » Le Moghrabin répondit : « Le motif de ton abstention n’est que de la paresse ! Si vraiment ce n’est que le manque d’argent qui t’empêche de partir et le souci de ta mère, moi je suis disposé à te donner de suite mille dinars d’or pour les dépenses de ta mère, en attendant ton retour au bout d’une absence de quatre mois à peine ! » À ces mots de mille dinars, Jouder s’écria : « Donne, ô pèlerin, les mille dinars pour que j’aille les porter à ma mère et que je parte ensuite avec toi ! » Et le Moghrabin lui remit aussitôt les mille dinars qu’il alla donner à sa mère, en lui disant : « Prends ces mille dinars pour tes dépenses et celles de mes frères ; car moi je vais partir avec un Moghrabin pour un voyage de quatre mois au Maghreb ! Et toi, ô mère, fais des vœux pour moi, pendant mon absence, et je serai comblé de bienfaits par ta bénédiction sur moi ! » Elle répondit : « Ô mon enfant, comme ton absence va me faire languir de tristesse ! Et que j’ai peur pour toi ! » Il dit : « Ô mère mienne, il n’y a rien à redouter pour quelqu’un qui est sous la garde d’Allah ! Et puis le Moghrabin est un très brave homme ! » Et il lui loua beaucoup le Moghrabin. Et sa mère lui dit : « Qu’Allah incline vers toi le cœur de ce Moghrabin de bien ! Pars avec lui, mon fils ! Peut-être qu’il sera généreux envers toi ! » Alors Jouder fit ses adieux à sa mère et s’en alla trouver le Moghrabin.
En le voyant arriver, le Moghrabin lui demanda : « As-tu consulté ta mère ? » Il répondit : « Oui, certes ! et elle a fait des vœux pour moi et m’a béni ! »
Il lui dit : « Monte en croupe derrière moi ! » Et Jouder monta derrière le Moghrabin sur le dos de la mule, et voyagea de la sorte depuis midi jusqu’au milieu de l’après-midi. Or le voyage donna un grand appétit à Jouder qui eut extrêmement faim…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
Or le voyage donna un grand appétit à Jouder qui eut extrêmement faim. Mais comme il ne voyait point de provisions dans le sac de voyage, il dit au Moghrabin : « Ô mon seigneur le pèlerin, je crois bien que tu as oublié de prendre des provisions pour en manger durant le voyage ! » Il répondit : « Aurais-tu faim ? » Il dit : « Eh ! ouallah ! » Alors le Moghrabin arrêta la mule, mit pied à terre, ainsi que Jouder, et dit à celui-ci : « Apporte-moi ici le sac ! » Et, Jouder lui ayant apporté le sac, il lui demanda : « Que souhaite ton âme, ô mon frère ? » Il répondit : « N’importe quoi ! » Le Moghrabin dit : « Par Allah sur toi ! dis-moi ce que tu souhaites manger ? » Il répondit : « Du pain et du fromage ! » Il sourit et dit : « Ô pauvre, du pain et du fromage ? C’est vraiment peu digne de ton rang ! Demande-moi donc quelque chose d’excellent ! » Jouder répondit : « Moi, en ce moment-ci, je trouverai tout excellent ! » Le Moghrabin lui demanda : « Aimes-tu les poulets rôtis ? » Il dit : « Ya Allah ! oui ! » Il lui demanda : « Aimes-tu le riz au miel ? » Il dit : « Beaucoup ! » Il lui demanda : « Aimes-tu les aubergines farcies ? les têtes d’oiseaux aux tomates ? les topinambours au persil et les colocases ? les têtes de moutons au four ? l’orge pilée et gonflée et habillée ? les feuilles de vigne farcies ? les pâtisseries ? telle et telle et telle chose ? » Et il énuméra de la sorte vingt-quatre espèces de mets, pendant que Jouder pensait : « Serait-il donc fou ? Car d’où va-t-il m’apporter les mets qu’il vient d’énumérer, alors qu’il n’a ici ni cuisine ni cuisinier ? Je vais lui dire maintenant que c’est vraiment assez ! » Et il dit au Moghrabin : « C’est assez ! Jusqu’à quand vas-tu me faire désirer ces différents mets sans m’en montrer aucun ? » Mais le Moghrabin répondit : « La bienvenue sur toi, ô Jouder ! » Et il plongea sa main dans le sac et en tira un plat d’or avec deux poulets rôtis bien chauds ; puis il plongea sa main une seconde fois et tira un plat d’or avec des brochettes d’agneau, et ainsi de suite, l’un après l’autre, les vingt-quatre plats qu’il avait énumérés, exactement !
À cette vue Jouder fut stupéfait. Et le Moghrabin lui dit : « Mange, mon pauvre ami ! » Mais Jouder s’écria : « Ouallah ! ô mon seigneur le pèlerin, toi tu as sans aucun doute placé dans ce sac une cuisine avec sa batterie et des cuisiniers ! » Le Moghrabin se mit à rire et répondit : « Ô Jouder, ce sac est enchanté ! Et il est servi par un éfrit qui, si nous le voulions, nous apporterait à l’instant mille mets syriens, mille mets égyptiens, mille mets indiens, mille mets chinois ! » Et Jouder s’écria : « Ô ! que ce sac est beau ! et quels prodiges il contient et quelle opulence ! » Puis ils mangèrent tous deux jusqu’à satiété et jetèrent ce qui resta de leur repas. Et le Moghrabin remit les plats d’or dans le sac ; puis il plongea sa main dans l’autre poche de la besace et en tira une aiguière d’or pleine d’eau fraîche et douce. Et ils burent et firent leurs ablutions et récitèrent la prière de l’après-midi, pour ensuite remettre l’aiguière dans le sac à côté de l’un des bocaux, le sac sur le dos de la mule, et monter eux-mêmes sur la mule et continuer leur voyage.
Au bout d’un certain temps, le Moghrabin demanda à Jouder : « Sais-tu, ô Jouder, combien nous avons fait de chemin depuis le Caire jusqu’ici ? » Il répondit : « Par Allah ! je ne sais pas ! » Il dit : « Exactement, en ces deux heures, nous avons parcouru un espace qui exige pour le moins un mois de chemin ! » Il demanda : « Et comment cela ? » Il dit : « Sache, ô Jouder, que cette mule que nous montons est tout simplement une gennia d’entre les genn ! En un jour elle parcourt d’ordinaire l’espace d’une année de chemin ; mais aujourd’hui, pour ne point te fatiguer, elle a marché lentement, au pas ! » Et là-dessus ils poursuivirent leur chemin vers le Maghreb ; et tous les jours, matin et soir, le sac subvenait à tous leurs besoins ; et Jouder n’avait qu’à souhaiter un mets, fût-il le plus compliqué et le plus extraordinaire, pour qu’aussitôt il le trouvât au fond du sac, tout préparé et arrangé sur un plat d’or. Et ils arrivèrent de la sorte, au bout de cinq jours, au Maghreb, et entrèrent dans la ville de Fas et de Miknas.
Or, tout le long des rues, chaque passant reconnaissait le seigneur Moghrabin, et lui souhaitait le salam, ou bien venait lui baiser la main, jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés à la porte d’une maison où le Moghrabin descendit frapper. Et aussitôt la porte s’ouvrit, et sur le seuil apparut une jeune fille, tout à fait comme la lune, et belle et svelte comme une gazelle languissante de soif, qui leur sourit d’un sourire de bienvenue. Et le Moghrabin, paternel, lui dit : « Ô Rahma, ma fille, hâte-toi d’aller nous ouvrir la grande salle du palais ! » Et la jeune fille Rahma répondit : « Sur la tête et sur l’œil ! » et les précéda à l’intérieur du palais en balançant ses hanches. Et la raison de Jouder s’envola ; et il se dit en lui-même : « Il n’y a pas ! cette jeune fille est certainement la fille de quelque roi ! »
Quant au Moghrabin, il commença d’abord par retirer le sac de sur le dos de la mule, et dit : « Ô mule, retourne là d’où tu es venue ! Et qu’Allah te bénisse ! » Et voici que soudain la terre s’entr’ouvrit et reçut la mule dans son sein, pour se refermer sur elle immédiatement. Et Jouder s’écria : « Ô Protecteur ! Louanges à Allah qui nous a délivrés et nous a gardés pendant que nous étions sur son dos ! » Mais le Moghrabin lui dit : « Pourquoi t’étonnes-tu, ô Jouder ? Ne t’avais-je pas prévenu qu’elle était une gennia d’entre les éfrits ? Mais hâtons-nous d’entrer dans le palais et de monter à la grande salle ! » Et ils suivirent la jeune fille.
Lorsque Jouder eut pénétré dans le palais, il fut ébloui…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
Lorsque Jouder eut pénétré dans le palais, il fut ébloui par l’éclat et la multitude des richesses qu’il renfermait et par la beauté des lustres d’argent et des suspensions d’or ainsi que par la profusion des pierreries et des métaux. Et, une fois qu’ils se furent assis sur les tapis, le Moghrabin dit à sa fille : « Ya Rahma, va vite nous apporter le paquet en soie que tu connais ! » Et la jeune fille courut aussitôt apporter le paquet en question et le donna à son père qui l’ouvrit et en tira une robe qui valait au moins mille dinars et, la donnant à Jouder, lui dit : « Habille-t’en, ô Jouder, et sois ici l’hôte bienvenu ! » Et Jouder la revêtit et en devint si splendide qu’il était semblable à quelque roi d’entre les rois des Arabes occidentaux !
Après quoi le Moghrabin, qui avait le sac devant lui, y plongea sa main et en tira une multitude de plats, qu’il rangea sur la nappe tendue par la jeune fille, et ne s’arrêta que lorsqu’il eut rangé de la sorte quarante plats de couleur différente et de mets différents. Puis il dit à Jouder : « Avance la main et mange, ô mon maître, et sois indulgent à notre égard pour le peu que nous te servons ; car vraiment nous ne savons point encore tes goûts et tes préférences quant aux mets ! Tu n’as donc qu’à nous dire ce que tu aimes le mieux et ce que ton âme souhaite, et nous te le présenterons sans retard ! » Jouder répondit : « Par Allah ! ô mon maître le pèlerin, moi j’aime tous les mets sans exception et je n’en déteste pas un ! Ne m’interroge donc plus sur mes préférences, et apporte-moi tout ce qui te viendra à l’idée ! Car moi ! manger c’est tout ce que je sais ! Et c’est ce que j’aime le plus au monde ! Je mange bien ! Voilà ! » Et il mangea bien ce soir-là, et d’ailleurs tous les jours, sans que jamais pour cela on vît fumer la cuisine. En effet le Moghrabin n’avait qu’à plonger sa main dans le sac, en pensant à un mets, et aussitôt il l’en tirait sur un plat d’or ! Et il en était ainsi pour les fruits et les pâtisseries. Et Jouder vécut de la sorte dans le palais du Moghrabin, pendant vingt jours, en changeant de robe chaque matin ; et chaque robe était plus merveilleuse que sa sœur !
Au matin du vingt-unième jour, le Moghrabin vint le trouver et lui dit : « Lève-toi, ô Jouder ! Voilà le jour fixé pour l’ouverture du trésor de Schamardal ! » Et Jouder se leva et sortit avec le Moghrabin. Et lorsqu’ils furent arrivés hors des murailles de la ville, soudain apparurent deux mules qu’ils enfourchèrent, et deux esclaves nègres qui marchèrent derrière les mules. Et ils cheminèrent de la sorte jusqu’à midi, où ils arrivèrent aux bords d’un cours d’eau ; et le Moghrabin mit pied à terre, et dit à Jouder : « Descends ! » Et lorsque Jouder fut descendu, il fit un signe de la main aux deux nègres, en leur disant : « Allons ! » Aussitôt les deux nègres emmenèrent les deux mules qui disparurent, puis revinrent sur les bords du fleuve chargés d’une tente et de tapis et de coussins, et dressèrent la tente et la tapissèrent et rangèrent tout autour les coussins et les oreillers. Après quoi ils apportèrent le sac et les deux bocaux où se trouvaient enfermés les deux poissons couleur de corail. Puis ils tendirent la nappe et servirent, l’ayant tiré du sac, un repas de vingt-quatre plats. Après quoi ils disparurent.
Alors le Moghrabin se leva, plaça devant lui les deux bocaux, sur un escabeau, et se mit à marmotter dessus des formules magiques et des conjurations jusqu’à ce que les deux poissons se fussent mis à crier de l’intérieur : « Nous voici ! ô souverain magicien, fais-nous miséricorde ! » Et ils continuèrent à le supplier, pendant qu’il formulait les conjurations. Et soudain les deux bocaux éclatèrent à la fois et volèrent en pièces, tandis que devant le Moghrabin apparaissaient deux personnages, les bras croisés humblement, qui disaient : « La sauvegarde et le pardon, ô puissant devin ! Quel est ton intention à notre sujet ? » Il répondit : « Mon intention est de vous étrangler, de vous brûler ! à moins que vous ne me promettiez d’ouvrir le trésor de Schamardal ! » Ils dirent : « Nous te le promettons ! et nous t’ouvrirons le trésor ! Mais il faut absolument que tu fasses venir ici Jouder le pêcheur du Caire. Car il est écrit dans le livre du Destin que le trésor ne peut être ouvert que sur le visage de Jouder ! Et nul ne peut entrer dans le lieu où il se trouve si ce n’est Jouder fils d’Omar ! » Il répondit : « Celui dont vous parlez, je l’ai déjà amené ! Il est présent ici même ! Le voici ! Il vous voit et vous entend ! » Et les deux personnages regardèrent Jouder avec attention et dirent : « Maintenant tout obstacle est levé ! Et tu peux compter sur nous ! Nous te le jurons par le Nom ! » Aussi le Moghrabin leur permit d’aller là où ils devaient aller. Et ils disparurent dans l’eau du fleuve.
Alors le Moghrabin prit un grand roseau creux sur lequel il plaça deux plaques de cornaline rouge ; et sur ces plaques il mit une cassolette d’or remplie de charbon, sur laquelle il souffla une seule fois. Et aussitôt le charbon prit feu et devint de la braise ardente. Alors le Moghrabin répandit de l’encens sur la braise et dit : « Ô Jouder, voici que les fumées de l’encens s’élèvent, et je vais de suite réciter les conjurations magiques de l’ouverture. Mais comme une fois que j’aurai commencé les conjurations je ne pourrai plus les interrompre sans risquer de rendre vaines les puissances talismaniques, je vais auparavant t’instruire de ce que tu as à faire pour atteindre le but que nous nous sommes proposé en venant au Maghreb ! » Et Jouder répondit : « Instruis-moi, ô mon maître souverain ! » Et le Moghrabin dit : « Sache, ô Jouder…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Sache, ô Jouder, que lorsque je commencerai à réciter les formules magiques sur l’encens fumant, l’eau du fleuve se mettra à diminuer peu à peu et le fleuve finira par se dessécher complètement et à faire voir son lit à nu. Alors tu verras t’apparaître, sur la pente du lit à sec, une grande porte d’or aussi haute que la porte de la ville, avec deux anneaux du même métal. Toi, dirige-toi vers cette porte et heurte-la très légèrement avec l’un des anneaux qui forment battant, et attends un instant. Puis frappe un second coup plus fort que le premier, et attends encore ! Ensuite frappe un troisième coup plus fort que les deux autres, et ne bouge plus. Et lorsque tu auras ainsi frappé les trois coups successifs, tu entendras de l’intérieur quelqu’un s’écrier : « Qui frappe à la porte des Trésors, et ne sait point dénouer les enchantements ? » Tu répondras : « Je suis Jouder le pêcheur, fils d’Omar, du Caire ! » Et la porte s’ouvrira et sur le seuil t’apparaîtra un personnage qui, le glaive à la main, te dira : « Si vraiment tu es cet homme, tends le cou pour que je te tranche la tête ! » Et toi, tu tendras ton cou sans crainte ; et il lèvera le glaive sur toi, mais pour tomber aussitôt à tes pieds ; et tu ne verras plus qu’un corps sans âme ! Et toi tu n’auras aucun mal. Mais si, par crainte, tu refuses de lui obéir, il te tuera à l’heure et à l’instant.
« Lorsque de la sorte tu auras rompu ce premier charme, tu pénétreras à l’intérieur et tu verras une seconde porte où tu frapperas un seul coup, mais très fort. Alors t’apparaîtra un cavalier portant sur son épaule une grande lance, et qui te dira, en te menaçant de sa lance soudainement brandie : « Quel motif t’amène en ces lieux que ne hantent ni ne foulent jamais les hordes des humains et les tribus des genn ? » Et toi, pour toute réponse, tu lui présenteras hardiment ta poitrine à découvert pour qu’il te frappe ; et il te frappera de sa lance. Mais toi, tu n’en auras aucun mal ; et lui, il tombera à tes pieds et tu ne verras qu’un corps sans âme ! Mais si tu recules, il te tuera !
« Tu arriveras alors à une troisième porte, d’où sortira à ta rencontre un archer qui tendra contre toi son arc armé de la flèche ; mais toi, présente-lui hardiment ta poitrine comme point de mire, et il tombera à tes pieds corps sans âme ! Or, si tu hésites, il te tuera !
« Tu pénétreras plus loin et tu arriveras à une quatrième porte d’où s’élancera sur toi un lion à la face effroyable qui, la gueule large ouverte, voudra te manger. Toi, n’aie point peur de lui et ne le fuis pas ; mais tends-lui ta main ; et à peine l’aura-t-il eue entre ses lèvres, qu’il tombera à tes pieds, sans te faire de mal.
« Dirige-toi alors vers la cinquième porte d’où tu verras sortir un nègre noir qui te demandera : « Qui es-tu ? » Tu diras : « Je suis Jouder ! » Et il te répondra : « Si tu es vraiment cet homme, essaie alors d’ouvrir la sixième porte ! »
« Aussitôt, toi, tu iras droit à la sixième porte et tu crieras : « Ô Jésus, ordonne à Moïse d’ouvrir la porte ! » Et la porte devant toi s’ouvrira et tu verras t’apparaître deux énormes dragons, l’un à droite et l’autre à gauche, qui, la gueule ouverte, bondiront sur toi. N’en aie point peur ! Et tends-leur à chacun une de tes mains, qu’ils essaieront de mordre, mais en vain : car déjà ils auront roulé impuissants à tes pieds. Et surtout ne fait point mine de les redouter : sinon ta mort est certaine.
« Tu arriveras enfin à la septième porte et tu y frapperas. Et la personne qui t’ouvrira et t’apparaîtra sur le seuil sera ta mère ! Et elle te dira : « Sois le bienvenu mon fils ! Approche-toi de moi pour que je te souhaite la paix ! » Mais tu lui répondras : « Reste là où tu es ! Et déshabille-toi ! » Elle te dira : « Ô mon enfant, je suis ta mère ! Et tu me dois quelque reconnaissance et quelque respect en retour de l’allaitement et de l’éducation que je t’ai donnés ! Comment penses-tu me faire mettre nue ? » Tu lui répondras, en criant : « Si tu n’enlèves pas tes habits, je te tue ! » Et tu saisiras un glaive que tu trouveras suspendu à droite sur le mur, et tu lui diras : « Allons ! commence ! » Et elle, elle essaiera de t’émouvoir et cherchera à te tromper en s’apitoyant sur elle-même. Mais toi, prends garde de te laisser toucher par ses manières, et chaque fois qu’elle enlèvera une pièce de ses vêtements, tu lui crieras : « Enlève le reste ! » ; et tu continueras à la menacer de la mort jusqu’à ce qu’elle soit tout à fait nue ! Mais alors tu la verras s’évanouir et disparaître !
« Et de cette façon, ô Jouder, tu auras rompu tous les charmes et dissous les enchantements, tout en ayant assuré ta vie. Et il ne te restera plus qu’à recueillir le fruit de tes labeurs.
« Dans ce but, tu n’auras qu’à franchir cette septième porte, et tu trouveras à l’intérieur l’or amassé en monceaux. Mais n’y prête aucune attention, et dirige-toi droit à un petit pavillon, au centre du trésor, sur lequel sera tendu un rideau. Soulève alors ce rideau, et tu verras, couché sur un trône d’or, le grand magicien Schamardal, celui-là même à qui appartient ce trésor ! Et près de sa tête tu verras étinceler quelque chose d’arrondi comme la lune : c’est la sphère céleste. Tu le verras ceint du glaive en question, avec le sceau au doigt et, suspendue à son cou par une chaîne d’or, la fiole de kohl ! Toi alors n’hésite pas ! Empare-toi de ces quatre objets précieux, et hâte-toi de sortir du trésor pour venir me les remettre !
« Mais, ô Jouder, prends bien garde d’oublier quoi que ce soit de ce que je viens de t’enseigner, ou d’agir autrement que selon mes recommandations. Sinon tu t’en repentiras, et il y aura beaucoup à craindre pour toi ! »
Et lorsqu’il eut ainsi parlé, le Moghrabin réitéra ses recommandations à Jouder une première, deuxième, troisième et quatrième fois, pour les lui bien faire entrer dans l’esprit, et cela jusqu’à ce que Jouder de lui-même eût dit : « J’ai bien retenu à présent ! Mais quel est l’être humain qui…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
« … J’ai bien retenu à présent ! Mais quel est l’être humain qui pourra affronter ces redoutables talismans dont tu parles, et supporter ces terribles dangers ? » Le Moghrabin répondit : « Ô Jouder, n’aie donc aucune crainte à ce sujet ! Les divers personnages que tu verras aux portes ne sont que de vains fantômes sans âme ! Tu peux donc vraiment être bien tranquille ! » Et Jouder prononça : « Je mets ma confiance en Allah ! »
Aussitôt le Moghrabin commença ses fumigations magiques. Il jeta de nouveau de l’encens sur la braise de la cassolette, et se mit à réciter les formules conjuratoires. Et voici que l’eau du fleuve diminua peu à peu et s’écoula, et le lit du fleuve apparut à sec avec la grande porte du trésor.
À cette vue Jouder, sans plus hésiter, s’engagea dans le lit du fleuve et se dirigea vers la porte d’or qu’il frappa légèrement une première, deuxième et troisième fois. Et de l’intérieur une voix se fit entendre qui disait : « Quel est celui qui frappe à la porte des Trésors, sans savoir rompre les enchantements ! » Il répondit : « Je suis Jouder ben-Omar ! » Et aussitôt la porte s’ouvrit et sur le seuil apparut un personnage qui, le glaive nu à la main, lui cria : « Tends le cou ! » Et Jouder tendit son cou ; et l’autre abaissa son glaive, mais pour tomber au même moment. Et il en fut de même pour les autres portes jusqu’à la septième, exactement comme le lui avait prédit et recommandé le Moghrabin. Et chaque fois Jouder rompit tous les enchantements, avec un grand courage, jusqu’à ce que sa mère lui fût apparue, sortant de la septième porte. Elle le regarda et lui dit : « Tous les salams sur toi, ô mon enfant ! » Mais Jouder lui cria : « Et qui es-tu, toi ? » Elle répondit : « Je suis ta mère, ô mon fils ! Je suis celle qui t’a porté neuf mois dans son sein, qui t’a allaité et t’a donné l’éducation que tu as, ô mon enfant ! » Il lui cria : « Ôte tes vêtements ! » Elle répondit : « Tu es mon fils, et comment me demandes-tu d’être nue ? » Il dit : « Ôte ! ou sinon je jetterai ta tête avec ce glaive ! » Et il tendit la main vers la muraille, saisit le glaive qui y était suspendu, et le brandit en criant : « Si tu ne te déshabilles, je te tue ! » Alors elle se décida à ôter quelque peu de ses vêtements ; mais il lui dit : « Enlève le reste ! » Et elle ôta encore quelque chose. Il lui dit : « Encore ! » et il continua à la harceler jusqu’à ce qu’elle eût ôté tous ses vêtements, et qu’elle n’eût plus sur elle que le caleçon, et que, honteuse, elle lui eût dit : « Ah ! mon fils, tu m’as frustrée de tout le temps que j’ai employé à t’élever ! Quelle déception ! As-tu donc un cœur de pierre ! Et veux-tu me mettre dans une position honteuse en m’obligeant à montrer ma plus intime nudité ! Ô mon enfant, n’est-ce point une chose illicite et un sacrilège ? » Il dit : « Tu dis vrai ! Tu peux en effet garder sur toi le caleçon ! » Mais à peine Jouder eut-il prononcé ces mots, que la vieille s’écria : « Il a consenti ! Frappez-le ! » Et aussitôt de tous les côtés des coups lui tombèrent sur les épaules, drus et nombreux comme les gouttes de pluie, assénés par tous les gardiens invisibles du trésor. Et vraiment ce fut pour Jouder une raclée sans précédents, et telle qu’il ne devait l’oublier de sa vie ! Puis les éfrits invisibles en un clin d’œil le chassèrent, à force de coups, hors des salles du trésor et hors de la dernière porte qu’ils refermèrent comme avant !
Or, le Moghrabin le vit, alors qu’il venait d’être jeté hors de la porte, et se hâta de courir le ramasser, car déjà les eaux, revenues à grand fracas, envahissaient le lit du fleuve et reprenaient leur cours interrompu. Et il le transporta évanoui sur le rivage, et se mit à réciter sur lui des versets du Korân jusqu’à ce qu’il eût repris ses sens. Alors il lui dit : « Qu’as-tu fait, ô pauvre ? Hélas ! » Il répondit : « J’avais déjà surmonté tous les obstacles et rompu tous les charmes ! Et il a fallu justement que ce fût le caleçon de ma mère qui m’occasionnât la perte de tout ce que j’avais gagné, et fût pour moi la cause de cette raclée dont je porte les traces ! » Et il lui raconta tout ce qui lui était arrivé dans le trésor.
Alors le Moghrabin lui dit : « Ne t’avais-je pas recommandé de ne point me désobéir ? Tu vois ! Tu m’as fait du tort à moi et tu t’en es fait à toi-même, et tout cela parce que tu n’as pas voulu l’obliger à ôter son caleçon ! C’est fini pour cette année-ci ! Et nous devons attendre jusqu’à l’année prochaine pour répéter notre tentative ! D’ici là tu vas habiter chez moi ! » Et il héla les deux nègres qui apparurent aussitôt et plièrent la tente et ramassèrent ce qui était à ramasser, et disparurent uni moment pour revenir avec les deux mules sur lesquelles montèrent Jouder et le Moghrabin, pour rentrer immédiatement dans la ville de Fas.
Jouder habita donc chez le Moghrabin une année entière, en revêtant chaque jour une robe nouvelle, de grande valeur, et en mangeant bien et en buvant bien de tout ce qui sortait du sac, selon ses souhaits et ses désirs.
Or, le jour arriva, qui était fixé au commencement de la nouvelle année, pour la tentative ; et le Moghrabin vint trouver Jouder et lui dit : « Lève-toi ! Et allons-nous-en là où nous devons aller ! » Il répondit : « Certainement ! » Et ils sortirent de la ville, et virent les deux nègres qui leur présentèrent les deux mules qu’ils enfourchèrent aussitôt et ils poussèrent dans la direction du fleuve sur les bords duquel ils ne tardèrent pas à arriver. La tente fut dressée et tendue et servie comme la première fois. Et, après qu’ils eurent mangé, le Moghrabin prit le roseau creux, les tables de cornaline rouge, la cassolette remplie de braise et l’encens ; et, avant de commencer les fumigations magiques, il dit à Jouder : « Ô Jouder, j’ai une recommandation à te faire ! » Jouder s’écria : « Ô mon seigneur le pèlerin, vraiment ce n’est pas la peine ! Si j’avais oublié la raclée, j’aurais oublié aussi tes excellentes recommandations de l’année dernière…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Si j’avais oublié la raclée, j’aurais oublié aussi tes excellentes recommandations de l’année dernière ! » Il lui demanda : « Alors vraiment tu t’en souviens ? » Il répondit : « Ah ! certes oui ! » Il dit : « Eh ! bien, Jouder, conserve ton âme ! Et surtout ne va pas encore t’imaginer que la vieille femme est ta mère, alors qu’elle n’est qu’un fantôme qui a pris l’image de ta mère pour t’induire en erreur ! Or, si la première fois tu es sorti de là avec tes os, cette fois-ci, si tu te trompes, tu es sûr de les laisser dans le trésor ! » Il répondit : « Je me suis trompé ! Mais si cette fois je me trompe encore, je mériterai d’être brûlé ! »
Alors le Moghrabin jeta l’encens sur la braise et formula ses conjurations. Et aussitôt le fleuve se dessécha, et permit à Jouder de s’avancer vers la porte d’or. Il frappa à cette porte qui s’ouvrit ; et il réussit à rompre les enchantements divers des portes jusqu’à ce qu’il fût arrivé devant sa mère qui lui dit : « Sois le bienvenu, ô mon enfant ! » Il répondit : « Et depuis quand et comment suis-je ton fils, ô maudite ? Ôte tes vêtements ! » Alors elle se mit, tout en cherchant à le tromper, à ôter lentement et pièce par pièce ses vêtements, jusqu’à ce qu’elle n’eût plus sur elle que le caleçon. Et Jouder lui cria : « Ôte-le, ô maudite. » Et elle ôta son caleçon, mais pour aussitôt s’évanouir, fantôme sans âme !
Jouder pénétra alors sans difficulté dans le trésor, et vit les monceaux d’or accumulés en rangs serrés ; mais, sans y prêter la moindre attention, il se dirigea vers le petit pavillon et, ayant soulevé le rideau, il vit le grand devin Al-Schamardal couché sur le trône d’or, ceint du glaive talismanique, le sceau au doigt, la fiole de kohl suspendue à son cou par la chaîne d’or, et, au-dessus de sa tête, la sphère céleste brillante et arrondie comme la lune.
Alors, sans hésiter, il s’avança et défit le glaive du ceinturon, retira le sceau talismanique, détacha la fiole de khôl, prit la sphère céleste, et recula pour sortir. Et aussitôt un concert d’instruments se fit entendre, invisible, autour de lui, et l’accompagna triomphalement jusqu’à la sortie, alors que de tous les points du trésor souterrain les voix des gardiens s’élevaient, qui le félicitaient en criant : « Grand bien te fasse, ô Jouder, de ce que tu as su gagner ! Compliments ! Compliments ! » Et la musique ne cessa de jouer et les voix ne cessèrent de le féliciter, que lorsqu’il fut hors du trésor souterrain.
En le voyant arriver chargé des talismans, le Moghrabin cessa ses fumigations et ses conjurations, et se leva et se mit à l’embrasser en le serrant contre sa poitrine et en lui faisant des salams cordiaux. Et lorsque Jouder lui eut remis les quatre talismans, il appela du fond de l’air les deux nègres qui arrivèrent, serrèrent la tente et amenèrent les deux mules que Jouder et le Moghrabin enfourchèrent pour rentrer dans la ville de Fas.
Lorsqu’ils furent arrivés au palais, ils s’assirent autour de la nappe tendue et servie d’innombrables plats tirés du sac, et le Moghrabin dit à Jouder : « Ô mon frère, ô Jouder, mange ! » Et Jouder mangea, et se rassasia. On remit alors les plats vides dans le sac, on enleva la nappe, et le Moghrabin Abd Al-Samad dit : « Ô Jouder, tu as quitté ta terre et ton pays à cause de moi ! Et tu as mené à bien mes affaires ! Et moi de la sorte je te suis redevable des droits que tu as acquis sur moi ! Tu n’as qu’à fixer toi-même l’estimation de tes droits ; car Allah (qu’il soit exalté !) sera généreux à ton égard par notre entremise ! Demande-moi donc tout ce que tu souhaites ; et fais-le sans honte, car tu es méritant ! » Jouder répondit : « Ô mon seigneur, je souhaite seulement d’Allah et de toi que tu me donnes le sac ! » Et le Moghrabin lui mit aussitôt le sac entre les mains en lui disant : « Tu l’as certes mérité ! Et si tu avais souhaité n’importe quoi d’autre, tu l’aurais eu ! Mais, ô pauvre, ce sac ne pourra t’être utile que pour manger ! » Il répondit : « Et que pourrais-je souhaiter de mieux ? » Il dit : « Tu as supporté bien des fatigues avec moi ; et je t’avais promis de te reconduire dans ton pays le cœur content et satisfait. Or, ce sac ne peut fournir qu’à ta nourriture ; mais il ne t’enrichira pas ! Et moi je veux, en plus, t’enrichir !
Prends donc ce sac pour en tirer tous les mets que tu souhaites ; mais je vais te donner, en outre, un sac rempli d’or et de joyaux de toutes sortes, pour que, une fois de retour dans ton pays, tu deviennes un grand marchand, et que tu puisses subvenir, et au delà, à tous tes besoins et à ceux de ta famille, sans jamais te préoccuper d’économiser ! » Puis il ajouta : « Pour ce qui est du sac de la nourriture, je vais t’apprendre comment t’en servir pour en tirer les mets de ton désir ! Tu n’as pour cela qu’à y plonger la main, en formulant : « Ô serviteur de ce sac, je te conjure par la vertu des Puissants Noms Magiques qui ont tout pouvoir sur toi, de m’apporter tel mets ! » Et à l’instant tu trouveras au fond du sac tous les mets que tu auras souhaités, fussent-ils chaque jour mille de couleurs différentes et de goût différent ! »
Ensuite le Moghrabin fit apparaître l’un des deux nègres, avec l’une des deux mules, prit un grand sac à deux poches, semblable au sac de la nourriture, et en remplit l’une des poches avec de l’or monnayé et en lingots, et l’autre poche avec des joyaux et des pierreries, le mit sur le dos de la mule, les couvrit avec le sac de la nourriture qui avait l’air d’être tout à fait vide, et dit à Jouder : « Monte sur la mule ! Le nègre marchera devant toi et te montrera la route à suivre, et te conduira de la sorte jusqu’à la porte même de ta maison, au Caire. Et lorsque tu y seras arrivé, prends les deux sacs et livre la mule au nègre qui me la ramènera ! Et ne mets personne au courant de notre secret ! Et maintenant je te fais mes adieux en Allah…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et maintenant je te fais mes adieux en Allah ! » Jouder répondit : « Qu’Allah augmente ta prospérité et tes bienfaits ! Je te remercie bien ! » Et il monta sur le dos de la mule, ayant les deux doubles sacs au dessous de lui, et il se mit en route, précédé du nègre.
Or, la mule se mit à suivre fidèlement le nègre conducteur, tout le long du jour et de la nuit ; et il ne lui fallut cette fois qu’un jour seulement pour effectuer le voyage du Maghreb au Caire ; car le lendemain matin, Jouder se vit devant les murs du Caire, et il entra dans sa ville natale par la Porte de la Victoire. Et il arriva à sa maison. Et il vit sa mère assise sur le seuil, la main tendue aux passants, qui demandait l’aumône en disant : « Quelque chose, pour Allah ! »
À cette vue, la raison de Jouder s’envola, et il descendit de la mule et s’élança, les bras ouverts, vers sa mère qui, en le voyant, se mit à pleurer. Et il l’entraîna dans la maison, après avoir pris les deux sacs et confié la mule au nègre afin qu’il la ramenât au Moghrabin : car la mule était une gennia et le nègre un genni !
Lorsque Jouder eut fait rentrer sa mère dans la maison, il la fit s’asseoir sur la natte, et, comme il était bien péniblement affecté de l’avoir vue mendier sur la route, il lui dit : « Ô ma mère, mes frères sont-ils bien portants ? » Elle répondit : « Ils sont bien portants ! » Il demanda : « Pourquoi mendiais-tu sur la route ? » Elle répondit : « Ô mon fils, à cause de ma faim ! » Il dit : « Comment cela ? Je t’avais donné avant de partir cent dinars le premier jour, cent dinars le second jour, et mille dinars le jour de mon départ ! » Elle répondit : « Ô mon enfant, tes frères ont imaginé une ruse contre moi et ont réussi à me prendre tout cet argent, pour ensuite me chasser de la maison. Et moi je fus obligée, pour ne point mourir de faim, de mendier par les rues ! » Il dit : « Ô ma mère, tu n’as plus rien à souffrir, puisque je suis revenu et que je suis là ! N’aie donc plus aucun souci ! Voici un sac plein d’or et de joyaux ! Et le bien est en abondance dans la demeure ! » Elle répondit : « Ô mon enfant, toi tu es vraiment né béni et fortuné ! Qu’Allah t’accorde ses bonnes grâces et augmente ses bienfaits sur toi ! Va, mon fils, va nous chercher à tous deux un peu de pain pour manger, car je me suis couchée hier sans avoir pris aucune nourriture, et je suis encore à jeun ce matin ! » Et Jouder, à ce mot de pain, sourit et dit : « La bienvenue sur toi, ô ma mère, et la largesse ! Tu n’as qu’à me demander les mets que tu souhaites, et je te les donnerai à l’instant, sans avoir besoin d’aller les acheter au souk ou de les cuire à la cuisine ! » Elle dit : « Ô mon enfant, je ne vois pourtant rien de tout cela avec toi ! Et tu n’as apporté pour tout bagage que ces deux sacs, dont l’un est vide ! » Il dit : « J’ai tout ce que tu veux, et de toutes les couleurs ! » Elle dit : « Ô Mon enfant, n’importe quoi fera l’affaire et calmera la faim ! » Il dit : « Tu dis vrai ! Dans la nécessité l’homme se contente de la moindre chose ! Mais lorsqu’il y a abondance de tout, on aime bien faire son choix et ne manger que les choses les plus délicates ! Or, j’ai avec moi une abondance de tout, et tu n’as qu’à faire ton choix ! » Elle dit : « Mon enfant, je désire alors une galette chaude et un morceau de fromage ! » Il répondit : « Ô ma mère, cela n’est point digne de ton rang ! » Elle dit : « Toi tu sais mieux que moi ce qui est convenable ! Tu n’as donc qu’à faire ce que tu juges convenable ! » Il dit : « Ô ma mère, moi je juge convenable et digne de ton rang un agneau rôti, et aussi les poulets rôtis et le riz assaisonné de piment ! Je juge également de ton rang les tripes farcies, les courges farcies, les moutons farcis, les côtes farcies, la kenafa préparée avec des amandes, du miel d’abeilles et du sucre, les bouchées soufflées farcies de pistaches et parfumées à l’ambre, et les losanges de baklaoua ! » En entendant ces paroles, la pauvre femme crut que son fils se moquait d’elle ou avait perdu la raison, et s’écria : « Youh ! Youh ! Que t’est-il arrivé, ô mon fils, ô Jouder ? Rêves-tu ou bien es-tu devenu fou ? » Il dit : « Et pourquoi donc ? » Elle répondit : « Mais parce que tu me cites là des espèces étonnantes et si chères et si difficiles à préparer qu’il serait bien malaisé de les avoir ! » Il dit : « Par ma vie ! il me faut absolument te faire manger de toutes les choses que je viens d’énumérer à l’instant ! » Elle répondit : « Mais je ne vois rien de cela nulle part ici ! » Il dit : « Apporte-moi le sac ! » Et elle lui apporta le sac, et le palpa et le trouva vide. Elle le lui donna pourtant ; et lui, aussitôt, il y plongea la main et en tira d’abord un plat d’or où s’étageaient, odorantes et moites et nageant dans leur sauce appétissante, les tripes farcies ; puis il plongea la main une seconde fois et une quantité d’autres fois, pour en tirer au fur et à mesure toutes les choses qu’il avait énumérées et d’autres même qu’il n’avait pas énumérées. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, le sac est bien petit et tout à fait vide, et tu en as tiré tous ces mets et tous ces plats ! Où donc était tout cela ? » Il dit : « ma mère, sache que ce sac m’a été donné par le Moghrabin ! Et ce sac est enchanté ! Il a comme serviteur un genni qui obéit aux ordres qui lui sont donnés d’après la formule telle ! » Et il lui dit la formule. Et sa mère lui demanda : « Alors si, moi, je plonge ma main dans ce sac en demandant un mets d’après la formule, je le trouverai ? » Il dit : « Certainement ! » Alors elle y plongea la main et dit : « Ô serviteur de ce sac, par la vertu des Noms Magiques qui ont tout pouvoir sur toi, je te conjure de m’apporter encore une seconde côte farcie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … je te conjure de m’apporter encore une seconde côte farcie ! » Et aussitôt elle sentit le plat sous sa main et le tira du sac. Et c’était une côte farcie merveilleusement, et aromatisée de clous de girofle et d’autres épices fines ! Alors elle dit : « Je désire encore, tout de même, une galette chaude et du fromage ; car j’y suis habituée et rien ne peut m’en distraire ! » Et elle plongea la main, prononça la formule, et les retira ! Alors Jouder lui dit : « Ô ma mère, il faut, lorsque nous aurons fini de manger, remettre dans le sac les plats vides ; car le talisman comporte ce soin ! Et surtout n’en divulgue pas le secret ; et cache bien ce sac dans ton coffre, pour ne le sortir qu’au moment du besoin. Mais ne te gêne point pour cela ; sois généreuse envers tout le monde, envers les voisins et les pauvres ; et sers de tous les mets à mes frères, aussi bien en ma présence qu’en mon absence ! »
Or, Jouder avait à peine fini de parler que ses deux frères entrèrent, et virent le repas merveilleux !
En effet, ils venaient d’apprendre la nouvelle de l’arrivée de Jouder par un homme d’entre les fils du quartier, qui leur dit : « Votre frère vient d’arriver de voyage, monté sur une mule, précédé d’un nègre, et vêtu d’habits qui n’ont point leurs pareils ! » Et eux se dirent alors : « Plût à Allah que nous n’eussions jamais maltraité notre mère ! Car elle va sans doute lui raconter maintenant ce que lui avons fait éprouver ! Et alors, ô notre confusion vis-à-vis de lui ! » Mais l’un ajouta : « Notre mère est pitoyable ! En tout cas si tout de même elle racontait la chose, notre frère est encore plus pitoyable qu’elle et plus indulgent ! Et si nous alléguons un prétexte quelconque à notre conduite, il admettra notre prétexte et nous excusera ! » Et ils décidèrent alors d’aller le trouver.
Donc lorsqu’ils furent entrés et que Jouder les eut vus, il se leva aussitôt en leur honneur et leur fit les souhaits de paix avec les plus grandes marques d’égards, et leur dit : « Asseyez-vous et mangez avec nous ! » Et ils s’assirent et ils mangèrent. Et ils étaient bien affaiblis et amaigris par la faim et les privations !
Lorsqu’ils eurent fini de manger et se furent rassasiés, Jouder leur dit : « Ô mes frères, prenez ces restes du repas et distribuez-les aux pauvres et aux mendiants de notre quartier ! » Ils répondirent : « Ô notre frère, il vaut peut-être mieux les garder pour notre souper ! » Il leur dit : « À l’heure du souper, vous trouverez bien plus que tout cela ! » Alors ils ramassèrent les restes et sortirent les distribuer aux pauvres et aux mendiants qui passaient, en leur disant : « Prenez et mangez ! » Après quoi ils rapportèrent les plats vides à Jouder qui les remit à sa mère en lui disant : « Mets-les dans le sac ! »
Le soir, à l’heure du repas, Jouder prit le sac et en tira quarante espèces de plats que sa mère rangea l’un après l’autre sur la nappe ; puis il invita ses frères à entrer manger. Et lorsqu’ils eurent fini, il leur tira des pâtisseries pour qu’ils s’en dulcifiassent ; et ils s’en dulcifièrent. Alors il leur dit : « Prenez les restes de notre repas et distribuez-les aux pauvres et aux mendiants ! » Puis le lendemain il leur servit d’aussi splendides repas ; et il en fut de même pendant dix jours consécutifs.
Or, au bout de ce temps, Salem dit à Salim : « Comprends-tu, toi, comment fait notre frère pour nous servir de si splendides repas tous les jours, une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir, et une fois des pâtisseries pendant la nuit ? Vraiment les sultans ne font point autrement ! D’où ont pu lui venir une telle fortune et tant d’opulence ? Et nous ne nous demandons point d’où il tire tous ces mets étonnants et ces pâtisseries, alors que nous ne le voyons acheter jamais rien, ni allumer de feu, ni s’occuper de la cuisine, ni posséder de cuisinier ! » Et Salim répondit : « Par Allah ! je n’en sais rien ! Mais connais-tu, toi, quelqu’un qui puisse nous renseigner sûr la vérité de cette affaire-là ? » Il dit : « Seule notre mère pourra nous renseigner à ce sujet ! » Et à l’instant ils imaginèrent une ruse et entrèrent chez leur mère, pendant l’absence de leur frère, et lui dirent : « Ô notre mère, nous avons bien faim ! » Elle répondit : « Réjouissez-vous, car vous allez tout de suite être satisfaits ! » Et elle entra dans la salle où se trouvait le sac, plongea la main dans le sac en demandant au serviteur quelques mets bien chauds, et les retira aussitôt pour les porter à ses fils qui lui dirent : « Ô notre mère, ces mets sont chauds, et nous ne te voyons jamais cuisiner ni souffler sur le feu ! » Elle répondit : « Je les tire du sac ! » Ils demandèrent : « Et qu’est-ce donc que ce sac ? » Elle répondit : « C’est un sac enchanté ! Et toutes les demandes qu’on lui fait sont exécutées par le genni serviteur du sac ! » Et elle leur expliqua la formule et leur dit : « Gardez-en le secret ! » Ils répondirent : « Sois tranquille. Le secret sera gardé ! » Et, après avoir éprouvé eux-mêmes les vertus du sac et réussi à en tirer plusieurs mets, ils se tinrent tranquilles ce soir-là.
Mais le lendemain Salem dit à Salim : « Ô mon frère, jusqu’à quand allons-nous continuer à demeurer chez Jouder dans cette situation de domestiques, en mangeant de ses aumônes ? Ne penses-tu pas qu’il vaut mieux que nous imaginions une ruse pour prendre ce sac et l’avoir à nous tout seuls ! » Salim répondit : « Quelle ruse pourrions-nous combiner ? » Il dit : « Vendre tout simplement notre frère Jouder au chef-capitaine de la mer de Suez ! » Il demanda : « Et comment ferons-nous pour le vendre ? » Salem répondit : « Nous irons, toi et moi, trouver ce chef-capitaine, qui est en ce moment au Caire…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Nous irons, toi et moi, trouver ce chef-capitaine, qui est en ce moment au Caire, et nous l’inviterons, lui et deux de ses matelots, à venir prendre un repas avec nous ! Et tu verras ! Tu n’auras seulement qu’à confirmer les paroles que je dirai à Jouder, et tu verras ce que j’aurai fait avant la fin de cette nuit ! »
Lorsqu’ils furent tombés bien d’accord sur cette vente projetée de leur frère, ils allèrent trouver le chef-capitaine de Suez et lui dirent, après les salams : « Ô capitaine, nous venons te voir pour une chose qui te réjouira certainement ! » Il répondit : « Bon ! » Ils dirent : « Nous sommes deux frères ; mais nous avons un troisième frère, un garnement bon à rien. Lorsque notre père mourut, il nous laissa un héritage que nous nous partageâmes entre nous trois ; et notre frère prit sa part et se hâta de la dépenser dans le libertinage et la corruption ! Et lorsqu’il fut réduit à la misère, il se mit à nous traiter avec une injustice extraordinaire, et finit par nous citer devant les juges, gens iniques et oppresseurs, en nous accusant de l’avoir frustré de sa part d’héritage ! Et les juges iniques et corrompus ne tardèrent pas à nous faire perdre en frais de procès tout l’héritage de notre père ! Mais il ne se contenta point de ce premier méfait ! Il nous cita une seconde fois devant les oppresseurs, et réussit de la sorte à nous réduire à la dernière misère ! Et maintenant nous ne savons point ce qu’il complote encore contre nous ! Nous venons donc te trouver pour te demander de nous délivrer de sa présence en l’achetant de nous pour t’en servir comme rameur sur l’un de tes navires ! »
Le chef-capitaine répondit : « Pourriez-vous trouver un stratagème quelconque pour me l’amener jusqu’ici ? Et moi, dans ce cas, je me charge de le faire transporter jusqu’à la mer, sans retard ! » Ils répondirent : « Ce nous sera bien difficile de l’amener jusqu’ici ! Mais toi accepte d’être notre invité ce soir ; et amène chez nous avec toi deux de tes hommes, sans plus. Et lorsqu’il se sera endormi, à nous cinq ensemble nous nous saisirons de lui, nous lui mettrons un bâillon dans la bouche, et nous te le livrerons ! Et toi, à la faveur de la nuit, tu le transporteras hors de la maison et tu en feras ce que tu voudras ! » Il leur répondit : « De toute ouïe et obéissance ! Voulez-vous me le céder pour quarante dinars ? » Ils répondirent : « C’est vraiment trop peu ! mais pour toi nous le voulons bien. À la tombée de la nuit tu viendras donc à telle rue, près de telle mosquée, où tu trouveras l’un de nous dans ton attente ! Et n’oublie point d’amener avec toi deux de tes hommes ! » Et ils s’en allèrent trouver leur frère Jouder, s’entretinrent avec lui de choses et d’autres, et, au bout d’un certain temps, Salem lui baisa la main avec l’air d’un demandeur. Et Jouder lui dit : « Que souhaites-tu, ô mon frère ! » Il répondit : « Sache, ô mon frère, ô Jouder, que j’ai un ami qui m’a invité bien des fois à sa maison, pendant ton absence, et m’a toujours traité avec beaucoup d’égards, et m’a rendu ainsi son obligé. Je suis donc allé lui rendre visite aujourd’hui pour le remercier, et il m’a invité à rester dîner avec lui ; mais je lui dis : « Moi, je ne puis vraiment laisser mon frère Jouder tout seul à la maison ! » Il me dit : « Amène-le ici avec toi ! » Je répondis : « Je ne crois pas qu’il accepte ! Mais toi tu pourrais bien accepter notre invitation ce soir, avec tes frères ! » Or justement ses frères étaient présents, et je les invitai aussi, croyant à part moi qu’ils n’accepteraient pas l’invitation et que je m’en tirerais de la sorte poliment ; mais malheureusement ils ne firent aucune difficulté, et leur frère, voyant qu’ils acceptaient, accepta également et me dit : « Tu m’attendras à l’entrée de ta ruelle, près de la porte de la mosquée, et je viendrai te trouver là, avec mes frères ! » Or moi maintenant, ô mon frère Jouder, je crois bien qu’ils doivent être déjà là, et tu me vois bien honteux vis-à-vis de toi à cause de cette liberté que j’ai prise ! Et si tu voulais vraiment me rendre ton obligé à jamais, accepte-les pour hôtes ce soir ! Tes bienfaits nous ont déjà comblés, et l’abondance est dans ta demeure, ô mon frère ! Mais si, pour une raison ou pour une autre, tu ne veux point d’eux pour hôtes dans la maison, permets-moi de les inviter dans la maison de nos voisins où je les servirai moi-même ! » Jouder répondit : « Et pourquoi donc les inviter dans la maison de nos voisins, ô Salem ! Notre maison serait-elle si étroite et si inhospitalière ? Ou bien n’aurions-nous pas de quoi leur donner à souper ? Vraiment n’as-tu point honte de me consulter à ce sujet ? Tu n’as qu’à les faire entrer, et à leur servir en abondance les mets et les douceurs, sans parcimonie, de façon à ce qu’il y en ait de reste ! Et désormais si tu invitais de tes amis, pendant mon absence, tu n’aurais qu’à demander à notre mère tous les mets nécessaires et le superflu ! Va donc chercher tes amis de ce soir ! Les bénédictions sont descendues sur nous à travers de tels hôtes, ô mon frère ! »
À ces paroles, Salem baisa la main de Jouder, et alla à la porte de la petite mosquée trouver les gens en question qu’il se hâta d’amener à la maison. Et Jouder se leva en leur honneur et leur dit : « La bienvenue sur vous ! » Puis il les fit s’asseoir à côté de lui, et se mit à les entretenir amicalement, sans se douter de ce qui était caché pour lui dans le destin dont ils étaient l’instrument ! Et il pria sa mère de leur tendre la nappe et de leur servir un repas de quarante plats de couleur différente, en lui disant : « Porte-nous telle couleur, et telle couleur, et encore telle couleur ! » Et ils mangèrent et se rassasièrent, en croyant que ce splendide repas était dû à la générosité de ses frères Salem et Salim. Puis, lorsque le tiers de la nuit se fut écoulé, on servit les douceurs et les pâtisseries ; et l’on mangea jusqu’à minuit. Alors, à un signe de Salem, les matelots se précipitèrent sur Jouder et, tous à la fois, le maîtrisèrent, le bâillonnèrent, lui attachèrent solidement les bras, lui garrottèrent les pieds et le transportèrent hors de la maison, à la faveur des ténèbres, pour aussitôt se mettre en route pour Suez où, dès leur arrivée, ils le jetèrent au fond de l’un de leurs navires, avec les fers aux pieds, au milieu des autres esclaves et des forçats, et le condamnèrent à servir sur le banc des rameurs, une année entière. Et voilà pour Jouder…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et discrète, se tut.
LA QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Et voilà pour Jouder !
Quant à ses frères, lorsqu’ils se réveillèrent le matin, ils entrèrent chez leur mère, qui n’avait rien su de la chose, et lui dirent : « Ô notre mère, Jouder n’est pas encore réveillé ! » Elle dit : « Allez le réveiller ! » Ils répondirent : « Où est-il couché ? » Elle dit : « Dans la chambre des invités ! » Ils reprirent : « Il n’y a personne dans cette chambre ! Peut-être est-il parti la nuit avec ces marins ! Car, ô notre mère, notre frère Jouder a déjà goûté aux voyages lointains ! Et d’ailleurs nous l’avons entendu parler avec ces étrangers qui lui disaient : « Nous t’emmènerons et tu ouvriras des trésors cachés que nous connaissons ! » Elle dit : « Il est probable alors qu’il sera parti avec eux, sans nous avertir ! Nous pouvons être tranquilles à son sujet ; car Allah saura le diriger dans la bonne voie ; et comme il est né fortuné et favorisé du destin, il nous reviendra bientôt avec d’immenses richesses ! » Puis, comme tout de même l’absence est chose dure pour une mère, elle se mit à pleurer. Alors ils lui crièrent : « Ô maudite scélérate, tu aimes donc Jouder d’un tel amour, alors que si nous, tes fils, nous venions à nous absenter ou à être de retour, tu ne t’affligerais ni te réjouirais ! Ne sommes-nous donc point tes fils comme Jouder est ton fils ? » Elle répondit : « Vous êtes aussi mes fils, mais vous êtes deux misérables, deux méchants ! Depuis le jour de la mort de votre père vous ne m’avez fait aucun bien, et je n’ai pas eu un jour heureux avec vous ni un soin quelconque de votre côté ! Quant à Jouder, j’ai eu de lui beaucoup de bonté ; et il a toujours eu à cœur de me faire plaisir et de me montrer du respect et de me traiter avec générosité. Certes celui-là mérite bien que je pleure sur lui, car ses bienfaits sont sur moi et sur vous deux également ! » En entendant ce langage de leur pauvre mère, les deux misérables se mirent à l’injurier et à la frapper ; puis ils entrèrent dans l’autre chambre et cherchèrent partout le sac enchanté et le sac aux choses précieuses ; et ils finirent par mettre la main dessus et les prirent, en enlevant du second tout l’or qui se trouvait dans l’une des poches et tous les joyaux de pierreries qui se trouvaient dans la seconde poche ; et ils dirent : « Cela est le bien de notre père ! » Mais elle s’écria : « Non, par Allah ! c’est le bien de votre frère Jouder ! Et il l’a apporté du pays des Moghrabins ! » Ils lui crièrent : « Tu mens ! c’est le bien de notre père ! Et nous avons le droit d’en user déjà notre guise ! » Et aussitôt ils se disposèrent à en faire le partage entre eux deux. Mais ils ne purent tomber d’accord sur la possession du sac enchanté ; car Salem disait : « Moi je le prends ! » et Salim disait : « Moi je le prends ! » et la discussion s’établit entre eux et la querelle ! Alors leur mère dit : « Ô mes enfants, vous avez partagé entre vous deux le sac de l’or et des joyaux ; mais ce sac-ci ne peut guère être partagé ni divisé, sinon son charme serait rompu et il perdrait ses vertus. Mais laissez-le moi plutôt ; et moi, tous les jours, j’en tirerai les mets que vous désirerez et autant de fois que vous le désirerez. Et pour ce qui me regarde, je me promets de me contenter du morceau de pain ou de la bouchée que vous me laisserez. Et si vous vouliez bien me donner, en outre, ce qui me serait nécessaire comme vêtements, ce serait par pure générosité de votre part, et non point par obligation. De la sorte chacun de vous pourra, sans nul empêchement, faire le commerce qui lui plaît ! Je n’oublie point que vous êtes mes deux enfants, et que je suis votre mère. Restons unis et d’accord, pour que, au retour de votre frère, vous n’ayez rien à vous reprocher ni n’ayez honte devant lui de vos actions ! » Mais ils ne voulurent point accepter ses conseils, et passèrent leur nuit à discuter entre eux à haute voix et à se quereller si fort qu’un archer du roi, qui était invité dans la maison voisine, entendit tout ce qu’ils disaient et comprit point par point tout le motif du litige. Aussi dès le lendemain il se hâta d’aller au palais demander une audience au roi d’Égypte, qui s’appelait Schams Al-Daoula, et lui raconta tout ce qu’il avait entendu. Et le roi envoya aussitôt chercher les deux frères de Jouder et leur fit subir la torture jusqu’à ce qu’ils eussent fait des aveux complets. Alors le roi leur prit les deux sacs, et les jeta eux-mêmes dans le cachot. Après quoi il fit à la mère de Jouder une pension qui suffisait à ses besoins quotidiens. Et voilà pour tous ceux-là !
Quant à Jouder ! Comme il était depuis déjà une année esclave à bord du navire appartenant au chef-capitaine de Suez, une tempête s’éleva un jour contre le navire, et le désempara et le jeta contre une côte escarpée, si bien qu’il se fracassa et que tous les gens se noyèrent, excepté Jouder qui put à la nage gagner le rivage. Et il put pénétrer à l’intérieur du pays ; et il arriva de la sorte au milieu d’un campement de Bédouins nomades qui l’interrogèrent sur son état, et lui demandèrent s’il était marin. Et il leur raconta qu’en effet il était marin à bord d’un navire qui avait fait naufrage ; et il leur donna des détails sur son histoire.
Or il y avait, de passage dans le campement, un homme marchand, natif de Jedda, qui fut ému de compassion sur le sort de Jouder, et lui dit : « Veux-tu entrer à mon service, ô Égyptien ? Et moi, en retour, je te fournirai des vêtements et je t’emmènerai avec moi à Jedda ! » Et Jouder accepta d’entrer à son service et partit avec lui et arriva à Jedda, où le marchand le traita généreusement et le combla de bienfaits. Puis, quelque temps après, le marchand alla en pèlerinage à la Mecque et l’emmena également avec lui.
Lorsqu’ils furent arrivés à la Mecque…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
… Lorsqu’ils furent arrivés à la Mecque, Jouder se hâta d’aller se mêler à la procession autour de l’enceinte sacrée de la Kaâba, pour accomplir les sept tours rituels, et juste voici qu’il rencontre au milieu des pèlerins de la procession, son ami le cheikh Abd Al-Samad le Moghrabin, qui faisait également ses sept tours. Et le Moghrabin le vit, de son côté, et lui jeta un salam fraternel et lui demanda de ses nouvelles. Alors Jouder pleura. Puis il raconta ce qui lui était arrivé. Et le Moghrabin le prit par la main et le conduisit à la maison où il était descendu, le traita généreusement, l’habilla d’une robe splendide et sans pareille, et lui dit : « Le malheur s’est tout à fait éloigné de toi, ô Jouder ! » Puis il lui tira son horoscope, vit par là tout ce qui était arrivé à ses frères, et lui dit : « Sache, ô Jouder, qu’il est arrivé telle et telle chose à tes frères, et qu’ils sont à l’heure actuelle emprisonnés dans le cachot du roi d’Égypte. Mais tu es le bienvenu dans ma maison où tu vas rester jusqu’à l’accomplissement des rites prescrits ! Et tu verras désormais que tout ira bien ! » Jouder répondit : « Permets-moi, ô mon maître, d’aller trouver le marchand avec lequel je suis venu, pour lui demander son bon plaisir et prendre congé de lui ! Et je reviendrai tout de suite auprès de toi ! » Il lui demanda : « Es-tu son débiteur en argent ? » Il répondit : « Non ! » Il dit : « Va donc lui demander son bon plaisir et prendre congé de lui, sans tarder ; car, en vérité, le pain que l’on a mangé a des titres réels chez les honnêtes gens ! » Et Jouder alla trouver son maître, le marchand de Jedda, lui demanda son bon plaisir et lui dit : « Je viens de retrouver mon ami qui m’est plus cher qu’un frère ! » Il répondit : « Va le chercher et nous donnerons un festin en son honneur ! » Jouder dit : « Par Allah ! il n’a que faire des festins ! Il est un d’entre les fils de l’opulence, et il a beaucoup de serviteurs ! » Alors le marchand lui donna vingt dinars en lui disant : « Prends-les et libère ma conscience et ma responsabilité ! » Jouder répondit : « Qu’Allah t’acquitte de tout ce que tu me dois ! » Et il prit congé de lui et sortit pour aller retrouver son ami le Moghrabin. Mais il rencontra sur son chemin un pauvre homme et lui donna en aumône les vingt dinars ; puis il arriva chez le Moghrabin, et demeura avec lui jusqu’à accomplissement de tous les rites et obligations du pèlerinage.
Alors le Moghrabin vint le trouver et, tirant de son doigt le sceau que Jouder avait autrefois rapporté du trésor de Schamardal, le lui donna en disant ; « Prends ce sceau, ô Jouder, qui réalisera tous tes souhaits. Sache, en effet, que ce sceau a comme serviteur un genni, nommé Tonnerre-Tonitruant, qui sera à tes ordres pour tout ce que lui demanderas. Tu n’as pour cela qu’à frotter le chaton du sceau, et aussitôt t’apparaîtra Tonnerre-Tonitruant qui se chargera d’exécuter toutes tes volontés et de rapporter, si tu lui en fais la demande, tout ce que tu désireras des biens de l’univers ! » Et, pour lui en montrer le maniement, il le frotta devant lui avec le pouce. Aussitôt l’éfrit Tonnerre-Tonitruant apparut et, s’inclinant devant le Moghrabin, dit : « Me voici, ya sidi ! Ordonne et tu seras obéi ! Demande et tu recevras ! Veux-tu reconstruire une ville en ruines ou bien détruire une ville florissante ? Veux-tu tuer et assassiner ? Veux-tu arracher l’âme d’un roi ou seulement mettre en pièces ses armées ? Parle ! » Le Moghrabin répondit : « Ô Tonnerre, voici désormais ton maître ! Je te le recommande beaucoup ! Sers-le bien ! » Puis il le congédia, et, se tournant vers Jouder, lui dit : « N’oublie pas, ô Jouder, qu’au moyen de ce sceau tu vas pouvoir te défaire et te venger de tous tes ennemis ! » Et ne sois pas ignorant du degré de sa puissance ! » Jouder dit : « Dans ce cas, ô mon maître, je désirerais bien retourner à mon pays et à ma demeure ! » Il répondit : « Frotte le sceau, et lorsque l’éfrit Tonnerre t’apparaîtra et te dira : « Me voici ! Demande et tu obtiendras ! » toi, tu lui répondras : « Je veux monter sur ton dos ! Porte-moi aujourd’hui même dans mon pays ! » Et il t’obéira ! »
Alors Jouder fit ses adieux à Abd Al-Samad le Moghrabin et frotta le sceau. Et à l’instant apparut Tonnerre-Tonitruant qui lui dit : « Me voici ! Demande et tu obtiendras ! » Et Jouder répondit : « Conduis-moi au Caire aujourd’hui même ! » Il dit : « C’est facile ! » et, se courbant en deux, il le prit sur son dos et s’envola avec lui ! Et le voyage dura depuis midi jusqu’à minuit ; et l’éfrit déposa Jouder dans la maison même de sa mère, au Caire, et disparut.
Lorsque la mère de Jouder le vit entrer, elle se leva et pleura en lui souhaitant la paix. Puis elle lui raconta ce qui était arrivé à ses frères, et comment le roi leur avait fait donner la bastonnade et leur avait enlevé le sac enchanté et le sac de l’or et des joyaux ! Et Jouder, en entendant cela, ne put être indifférent au sort, de ses frères, et dit à sa mère : « Ne t’afflige pas pour cela ! Moi, à l’instant, je te montrerai ce que je puis faire, et je t’amènerai mes frères ! » En même temps il frotta le chaton ; et aussitôt apparut le serviteur qui dit : « Me voici ! Demande et tu obtiendras ! » Jouder dit : « Je t’ordonne d’aller enlever mes frères du cachot du roi pour me les amener ici ! » Et le genni disparut pour exécuter l’ordre.
Or, Salem et Salim gisaient dans leur cachot en proie à de grandes souffrances et aux plus profondes angoisses et peines, à cause des tortures et des privations éprouvées, tant qu’ils souhaitaient la mort comme une délivrance et un terme à leurs maux. Et précisément ils s’entretenaient ensemble avec une grande amertume sur ce sujet, en appelant la mort, quand ils virent soudain le sol s’entr’ouvrir sous leurs pieds et leur apparaître Tonnerre-Tonitruant qui, sans leur laisser le temps de se reconnaître, les enleva tous deux et disparut avec eux dans les profondeurs de la terre, tandis qu’ils s’évanouissaient de terreur dans ses bras pour ne reprendre leurs sens que dans la maison de leur mère et se voir étendus sur les tapis entre leur frère Jouder et leur mère attentifs à les soigner. Et Jouder, en les voyant ouvrir les yeux, leur dit : « Que tous les salams soient sur vous, ô mes frères ! Ne me reconnaissez-vous plus et m’avez-vous oublié…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … Que tous les salams soient sur vous, ô mes frères ! Ne me reconnaissez-vous plus et m’avez-vous oublié ? » Ils baissèrent la tête et se mirent à pleurer en silence. Alors il leur dit : « Ne pleurez pas ! Car c’est Satan et la convoitise qui vous ont contraints à agir comme vous avez agi ! Comment seulement avez-vous pu vous décider à me vendre ? Mais ne pleurez plus ! Ce m’est, en effet, une consolation de penser que je ressemble en cela à Joseph, fils de Jacob, vendu par ses frères ! D’ailleurs les frères de Joseph avaient encore bien plus mal agi à son égard que vous au mien ; car ils l’avaient, en outre, jeté au fond d’une citerne ! Demandez simplement pardon à Allah, en vous repentant, et Il vous pardonnera — car Il est le Clément-sans-bornes et le Grand-Pardonnateur, — comme moi je vous pardonne ! Que la bienvenue soit donc sur vous ! Et soyez désormais sans nulle crainte et sans contrainte ! » Et il continua à les consoler et à les réconforter jusqu’à ce qu’il eût calmé leurs cœurs ; puis il se mit à leur raconter toutes les épreuves et les souffrances qu’il avait endurées jusqu’à ce qu’il eût rencontré à la Mecque le cheikh Abd Al-Samad. Et il leur fit voir également le sceau magique.
Alors ils lui répondirent : « Ô notre frère, pardonne-nous cette fois ! Si nous retournons à nos anciennes manières d’agir, tu feras de nous ce que bon te semblera ! » Il répondit : « N’ayez donc plus aucun regret ni souci ! Et hâtez-vous de me raconter ce que vous a fait le roi ! » Ils dirent : « Il nous a fait donner la bastonnade, et nous a menacés de pis ; puis il a fini par nous enlever les deux sacs ! » Il dit : « Il va voir alors ! » et il frotta le chaton du sceau ; et aussitôt apparut l’éfrit Tonnerre-Tonitruant.
À sa vue, les deux frères furent épouvantés et crurent, dans leur cœur, que Jouder ne l’avait mandé que pour les faire mettre à mort. Et ils se précipitèrent chez leur mère en lui criant ; « Ô notre mère, nous nous mettons sous ta généreuse protection ! Ô notre mère, intercède pour nous ! » Elle leur répondit : « Ô mes enfants, n’ayez pas peur ! »
Pendant ce temps, Jouder avait dit à Tonnerre : « Je t’ordonne de m’apporter tout ce qui se trouve en fait de joyaux et de choses précieuses dans les armoires du roi, sans y rien laisser, et de m’apporter en même temps le sac enchanté et le sac des choses précieuses qui ont été tous deux soustraits à mes frères ! » Et le genni du sceau répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et à l’instant alla exécuter l’ordre et revint déposer entre les mains de Jouder les deux sacs, intacts comme ils étaient, et les trésors du roi, en disant : « Ya sidi, je n’ai rien laissé dans les armoires ! » Alors Jouder remit à sa mère le sac des choses précieuses et les trésors du roi, en lui recommandant de les bien garder, et plaça devant lui le sac enchanté. Puis il dit au genni du sceau : « Je t’ordonne de me construire cette nuit même un palais haut et splendide, de l’ornementer avec l’eau d’or, et de le tapisser et de le meubler somptueusement. Et je veux que tout soit terminé au lever du jour ! » Et le genni du sceau, Tonnerre-Tonitruant, répondit : « Ta volonté sera faite ! » et disparut dans le sein de la terre, tandis que Jouder tirait du sac enchanté des mets délicieux qu’il mangea avec sa mère et ses frères, à la limite du contentement, pour s’endormir ensuite jusqu’au matin.
Quant au genni du sceau, il alla aussitôt rassembler ses compagnons, les éfrits souterrains, en choisissant les plus habiles parmi eux dans l’art des bâtisses ; et tous commencèrent le travail. Ils se mirent les uns à tailler les pierres, les autres à les édifier, d’autres à badigeonner, d’autres à sculpter et à graver, et d’autres enfin à tapisser et à meubler les salles, si bien qu’avant le lever du jour le palais était entièrement terminé et décoré ! Alors le genni du sceau se présenta devant Jouder, dès qu’il fut réveillé, et lui dit : « Ya sidi, le palais est achevé et sa décoration est terminée ! Si tu veux venir le regarder et l’examiner ? » Alors Jouder se leva et emmena sa mère et ses frères ; et tous ensemble examinèrent le palais et trouvèrent qu’il n’avait pas son égal, tant il confondait la raison par la beauté de son architecture et son ordonnance heureuse. Et Jouder fut enchanté en regardant sa façade imposante vraiment, et il s’émerveilla en pensant que tout cela ne lui avait rien coûté. Et il se tourna vers sa mère et lui demanda : « Veux-tu habiter ce palais ? » Elle répondit : « Je veux bien ! » et elle fit des vœux pour lui et appela sur sa tête les bénédictions d’Allah. Alors Jouder frotta le sceau talismanique, et dit au genni qui aussitôt était apparu : « Je t’ordonne de m’amener à l’instant quarante jeunes esclaves blanches bien belles, quarante jeunes négresses bien taillées, quarante jeunes garçons et quarante nègres ! » Il répondit : « Tout cela est à toi ! » Et il s’envola, avec quarante de ses compagnons, pour les contrées de l’Inde, du Sindh et de la Perse ; et à eux tous ils se mirent à enlever toute jeune fille qu’ils trouvaient tout à fait belle et tout jeune garçon tout à fait beau. Et de la sorte ils rassemblèrent quarante de chaque espèce. Après quoi ils choisirent quarante belles négresses et quarante beaux nègres, et transportèrent tout ce lot au palais de Jouder. Et Tonnerre les fit défiler, un par un, devant Jouder qui les trouva tous à sa convenance, et dit : « Il faut maintenant leur donner à chacun et à chacune une robe, tout ce qu’il y a de plus beau…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … donner à chacun et à chacune une robe, tout ce qu’il y a de plus beau ! » Il répondit : « Voici ! » Il dit : « Il faut encore apporter une robe pour ma mère et une robe pour moi ! » Et Tonnerre apporta le tout, et habilla lui-même les jeunes esclaves blanches et noires, en leur disant : « Allez maintenant baiser la main de votre maîtresse, la mère de votre maître ! Et suivez bien les ordres qu’elle vous donnera, et suivez-la avec vos yeux, ô blanches et noires ! » Puis le genni Tonnerre alla également habiller les jeunes garçons et les nègres, et les envoya baiser la main de Jouder. Ensuite il habilla Salem et Salim, avec un soin tout particulier. Et quand tout le monde fut habillé, Jouder parut semblable, en vérité, à un roi et ses frères semblables à des vizirs.
Comme le palais était très vaste, Jouder fit habiter dans l’une des ailes son frère Salem et ses serviteurs et ses femmes, et dans une autre aile son frère Salim avec ses serviteurs et ses femmes. Quant à lui, il habita avec sa mère dans le corps même du palais. Et chacun d’eux était à sa place respective exactement comme un sultan. Et voilà pour eux !
Quant au roi ! Lorsque le chef-trésorier vint le matin pour prendre de l’armoire du Trésor quelques objets dont il avait besoin pour le roi, il l’ouvrit et n’y trouva plus rien ! Et c’était bien à cette armoire que pouvait s’appliquer ce dire du poète :
Ce vieux tronc d’arbre était riche et beau de sa ruche d’abeilles sonores et de ses rayons de miel doré ; mais lorsque s’envola l’essaim d’abeilles et disparut la ruche, ce ne fut plus qu’un vieux creux plein de vide !
Et le chef-trésorier, à cette vue, poussa un grand cri et tomba sans connaissance. Et lorsqu’il revint à lui, il se précipita, les bras levés, hors de la chambre du Trésor et courut trouver le roi Schams Al-Daoula auquel il dit : « Ô émir des Croyants, je viens t’informer que le Trésor a été vidé cette nuit ! » Et le roi s’écria : « Ô misérable ! qu’as-tu fait des richesses contenues dans mon Trésor ? » Il répondit : « Par Allah ! je n’en ai rien fait ! Et je ne sais ce qu’elles sont devenues, ni comment le Trésor a été vidé ! Hier au soir encore, selon mon habitude, j’ai contrôlé le Trésor et je l’ai trouvé rempli ; et ce matin je l’ai visité et l’ai trouvé vide, sans rien dedans ! Pourtant les portes n’ont point été forcées et je les ai trouvées fermées sans traces de perforation ou de brisure, avec les cadenas intacts et les serrures fermées ! Ce n’est donc point un voleur qui a vidé le Trésor ! » Le roi demanda : « Et les deux sacs ont-ils également disparu ? » Il répondit : « Oui ! » À ces paroles, la raison du roi s’envola de sa tête ; et il se leva sur ses pieds, et cria au chef-trésorier : « Marche devant moi ! » Et le trésorier se dirigea vers le Trésor ; et le roi le suivit et arriva au Trésor qu’il trouva, en effet, complètement vide à l’intérieur et intact au dehors ; et le roi fut stupéfait et anéanti, et dit : « Voici que l’on a pillé mon Trésor sans craindre ma puissance et ma colère ! » Et il fut courroucé d’un grand courroux et alla à l’instant assembler son Diwân ; et les émirs et les grands de la cour entrèrent dans le Diwân et chacun d’eux se demandait avec effroi s’il n’était pas la cause du courroux du roi ! Mais le roi leur dit : « Ô vous tous, sachez que mon Trésor a été pillé cette nuit ; et je ne sais quel est celui qui a commis cette action, en me faisant un tel affront et m’outrageant d’un tel outrage, sans redouter ma colère ! » Et tous demandèrent : « Mais comment cela ? » Le roi répondit : « Vous n’avez qu’à interroger le chef-trésorier qui est devant vous ! » Et ils l’interrogèrent et il leur dit : « Hier encore le Trésor était plein, et aujourd’hui je l’ai visité et l’ai trouvé vide, sans plus rien dedans, et au dehors sans perforation ni brisure de porte ! » Et tous furent prodigieusement étonnés et, ne sachant que répondre, ils baissèrent la tête devant les regards fulgurants du roi et gardèrent le silence. Mais au même moment entra l’archer qui avait autrefois dénoncé au roi Salem et Salim, et il dit : « Ô roi du temps, j’ai passé toute cette nuit sans dormir, tant j’y ai vu de choses extraordinaires ! » Et le roi demanda : « Et qu’as-tu donc vu ? » Il dit : « Sache, ô roi du temps, que j’ai passé toute cette nuit à me distraire et à m’amuser agréablement en regardant des maçons en train de bâtir et de manœuvrer marteaux, truelles et tous autres instruments. Et, au lever du jour, j’ai aperçu à cet endroit-là un magnifique palais entièrement achevé et qui n’a point son égal dans le monde. Moi alors j’allai aux renseignements, et l’on me renseigna, disant : « C’est Jouder fils d’Omar qui est revenu de voyage et a bâti ce palais ! Et il a amené avec lui de nombreux esclaves et beaucoup de jeunes garçons ! Et il est chargé de richesses et comblé de biens ! Et il a délivré ses frères du cachot ! Et il est maintenant assis dans son palais comme un sultan ! »
À ces paroles du kawas, le roi dit : « Qu’on aille tout de suite voir au cachot ! » Et l’on alla voir au cachot et l’on revint annoncer au roi que Salem et Salim n’étaient plus là ! Alors le roi s’écria : « Je tiens le voleur ! Celui qui a tiré de prison Salem et Salim, est celui-là même qui a volé mon trésor ! » Et le grand-vizir demanda : « Qui donc est-il ? » Il répondit : « C’est Jouder, leur frère ! Et c’est lui qui a également volé les deux sacs ! Mais, ô mon vizir, tu vas à l’instant envoyer contre eux tous un émir avec cinquante guerriers qui vont les saisir et, après avoir mis les scellés sur tous leurs biens, me les conduire ici pour que je les pende…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
« … me les conduire ici pour que je les pende ! » Et il augmenta encore en courroux et cria : « Oui ! et qu’on aille vite me les chercher ! car je veux les tuer ! » Le grand-vizir répondit : « Ô roi, sois clément et indulgent, car Allah est clément et ne se presse pas de punir son esclave en faute et révolté ! Et puis ! L’homme qui a pu bâtir un palais en l’espace d’une nuit, ne doit vraiment avoir rien à redouter de personne au monde ! Et moi j’ai bien peur pour l’émir qui sera envoyé, et je crains pour lui le ressentiment de Jouder ! Patiente donc jusqu’à ce que je trouve pour toi le meilleur moyen d’arriver à connaître la vérité sur cette affaire ; et alors seulement tu pourras, sans inconvénients, réaliser ce que tu as résolu de réaliser ! » Et le roi répondit : « Alors, ô mon vizir, avise-moi de ce que j’ai à faire ! » Il dit : « Dépêche vers lui un émir pour l’inviter à venir au palais. Et moi alors je saurai comment le prendre, je lui montrerai beaucoup d’amitié et je le questionnerai habilement sur ce qu’il fait et ne fait pas ! Et alors nous verrons ! Si vraiment sa puissance est grande, nous le prendrons par la ruse ; mais si son pouvoir est faible, nous le prendrons par la force ; et nous te le livrerons. Et tu en feras ce que tu voudras ! » Le roi dit : « Qu’on l’invite ! » Et le grand-vizir donna à un émir appelé l’émir Othman l’ordre d’aller chercher Jouder et de l’inviter en lui disant ; « Le roi désire te voir chez lui au nombre de ses hôtes aujourd’hui ! » Et le roi lui-même ajouta : « Et surtout ne reviens pas sans lui ! »
Or, cet émir Othman était un homme sot, orgueilleux et infatué de lui-même. En arrivant devant la porte du palais il aperçut un eunuque assis au seuil sur une belle chaise de bambou. Et il s’avança vers lui ; mais l’eunuque ne se leva point pour lui et ne se dérangea point, tout comme s’il ne le voyait pas. Et pourtant l’émir Othman était bien visible, et avait avec lui cinquante hommes bien visibles ! Il s’approcha tout de même et lui demanda : « Ô esclave, où est ton maître ? » Il répondit : « Dans le palais ! » sans même tourner la tête, et sans se départir de son air indifférent et de sa posture nonchalante. Alors l’émir Othman fut bien courroucé et lui cria : « Ô calamiteux eunuque de poix ! N’as-tu pas honte de rester, pendant que je te parle, étendu là dans une pose nonchalante comme un crapuleux garçon ? » L’eunuque répondit : « Va-t’en ! Et ne dis pas un mot de plus ! » À ces paroles, l’émir Othman fut à la limite de l’indignation et, brandissant sa masse d’armes, voulut en frapper l’eunuque. Or, il ne savait pas que cet eunuque n’était autre que l’éfrit du sceau, Tonnerre-Tonitruant, qui avait été chargé par Jouder de remplir l’office de portier du palais. Aussi quand le prétendu eunuque eut vu le mouvement de l’émir Othman, il se leva en le regardant avec un œil seulement, pendant que l’autre œil était fermé, lui souffla au visage et, de ce souffle, le renversa sur le sol. Puis il lui enleva des mains la masse d’armes, et lui en asséna quatre coups, sans plus !
À cette vue, les cinquante guerriers de l’émir furent indignés et, ne pouvant supporter l’affront infligé à leur chef, tirèrent leurs glaives et se précipitèrent sur l’eunuque pour le massacrer. Mais l’eunuque sourit avec calme et leur dit : « Ah ! vous tirez vos glaives, ô chiens ! Attendez un peu ! » Et il en saisit quelques-uns et leur plongea dans le ventre leurs propres glaives, et les noya dans leur propre sang ! Et il continua à les mettre en pièces, tellement que les autres, pris d’épouvante, s’enfuirent et ne s’arrêtèrent, avec leur émir en tête, que devant le roi, tandis que Tonnerre venait reprendre sur la chaise sa pose nonchalante.
Lorsque le roi eut appris de l’émir Othman ce qui venait de se passer, il fut à la limite de la fureur, et dit : « Que cent guerriers aillent contre cet eunuque ! » Et les cent guerriers, arrivés devant la porte du palais, furent reçus par l’eunuque à coups de masse d’arme, et étrillés et mis en fuite en un clin d’œil. Et ils revinrent dire au roi : « Nous avons été dispersés et terrifiés par lui ! » Et le roi dit : « Que deux cents descendent contre lui ! » Et les deux cents descendirent et furent taillés en pièces par l’eunuque. Alors le roi cria à son grand-vizir : « Tu vas maintenant toi-même descendre contre lui avec cinq cents guerriers et le traîner devant moi à l’instant ! Et tu m’amèneras également son maître Jouder avec ses deux frères ! » Mais le grand-vizir répondit : « Ô roi du temps, je préfère ne prendre avec moi aucun guerrier, et aller plutôt tout seul le trouver, sans armes ! » Le roi dit : « Va ! et fais ce qui te semblera le plus convenable ! »
Alors le grand-vizir jeta ses armes loin de lui et se vêtit d’une longue robe blanche ; puis il prit à la main un grand chapelet et se dirigea lentement vers la porte du palais de Jouder en égrenant le chapelet. Et il vit l’eunuque en question assis sur la chaise, et il s’approcha de lui en souriant, s’assit par terre en face de lui, avec beaucoup de politesse, et lui dit : « Le salam sur vous ! » Il répondit : « Et sur toi le salam, ô être humain ! Que désires-tu ? » Lorsque le grand-vizir eut entendu ce mot « être humain », il comprit que l’eunuque était un d’entre les genn, et il trembla d’épouvante. Puis il demanda humblement : « Ton maître, le seigneur Jouder, serait-il ici ? » Il répondit : « Oui, il est dans le palais ! » Il reprit : « Ya sidi, je te prie d’aller le trouver et de lui dire : « Ya sidi, le roi Schams Al-Daoula t’invite à te rendre auprès de lui, car il donne un festin en ton honneur. Et c’est lui-même qui te transmet le salam et te prie d’honorer sa demeure en acceptant son hospitalité ! » Tonnerre répondit : « Attends-moi ici que j’aille lui demander son bon plaisir…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Attends-moi ici que j’aille lui demander son bon plaisir ! » Et le grand-vizir attendit, dans une attitude très polie, tandis que le mared allait trouver Jouder auquel il dit : « Sache, ya sidi, que le roi t’avait d’abord envoyé un émir bien fort que j’ai battu ; et il avait avec lui cinquante guerriers que j’ai défaits ! Puis il a envoyé contre moi cent guerriers que j’ai battus, puis deux cents que j’ai défaits et mis en fuite. Alors il a envoyé son grand-vizir, sans armes et vêtu de blanc, pour t’inviter à manger des mets de son hospitalité ! Qu’en dis-tu ? » Il répondit : « Va et m’amène ici le grand-vizir ! » Et Tonnerre descendit lui dire : « Ô vizir, viens parler à mon maître ! » Il répondit : « Sur la tête ! » Et il monta au palais, et entra dans la salle de réception où il vit Jouder, plus imposant que les rois, assis sur un trône dont nul sultan ne pouvait posséder l’égal, avec, étendu à ses pieds, un tapis splendide tout à fait. Et il fut stupéfait et resta ahuri et ébahi et ébloui de la beauté du palais, de ses ornementations, de sa décoration, de ses sculptures et de ses meubles ; et il se vit, par comparaison, moindre qu’un mendiant à côté de si belles choses et en face du maître du lieu. Aussi il s’inclina et embrassa la terre entre ses mains et fit des vœux pour sa prospérité. Et Jouder lui demanda : « Quelle demande veux-tu me faire, ô vizir ? » Il répondit : « Ô mon seigneur, ton ami le roi Schams Al-Daoula te transmet le salam ! Il désire ardemment se réjouir les yeux de ton visage ; et, dans ce but, il donne un festin en ton honneur ! Voudrais-tu donc accepter pour lui faire plaisir ? » Jouder répondit : « Du moment qu’il est mon ami, va lui transmettre mon salam et dis-lui qu’il vienne plutôt lui-même chez moi ! » Le vizir dit : « Sur la tête ! » Alors Jouder frotta le chaton du sceau ; et, Tonnerre ayant paru devant lui, il lui dit : « Apporte-moi une robe tout ce qu’il y a de plus beau ! » Et, Tonnerre ayant apporté la robe, Jouder dit au vizir : « C’est pour toi, à vizir ! Revêts-la ! » Et, le vizir ayant revêtu la robe, Jouder lui dit : « Va dire au roi ce que tu as entendu et vu ! » Et le vizir descendit, revêtu de cette robe dont nul au monde n’avait revêtu la pareille, et alla trouver le roi, le mit au courant de la situation de Jouder, lui fit une louangeuse description du palais et de son contenu, et lui dit : « Jouder t’invite ! » Le roi dit : « Allons, ô soldats ! » Et tous se levèrent sur leurs pieds ; et il leur dit : « Montez sur vos chevaux ! Et qu’on m’amène mon coursier de bataille pour que j’aille voir Jouder ! » Puis il monta à cheval et, suivi de tous ses gardes et soldats, il se dirigea vers le palais de Jouder.
Lorsque Jouder vit de loin arriver le roi avec sa suite, il dit à l’éfrit du sceau : « Je désire que tu m’amènes de tes compagnons les éfrits afin que, sous l’aspect d’êtres humains, ils fassent la haie dans la grande cour du palais sur le passage du roi. Et le roi, qui verra leur nombre et leur qualité, en sera terrifié et épouvanté, et son cœur en frémira. Et alors il saura que ma puissance dépasse la sienne ; et il en fera son profit ! » Et, à l’instant, l’éfrit Tonnerre convoqua et fit paraître deux cents éfrits sous l’aspect de gardes armés et revêtus de riches armures, et bien terribles et de taille énorme. Et le roi entra dans la cour et passa entre les deux rangs de soldats ; et en voyant leur aspect terrible, il sentit frémir son cœur. Puis il monta au palais et entra dans la salle où se trouvait Jouder ; et il le trouva assis avec une allure et un air que vraiment n’avaient jamais eus ni roi ni sultan ! Et il lui jeta le salam et s’inclina entre ses mains et formula ses souhaits, sans que Jouder se levât en son honneur ou lui montrât des égards ou l’invitât à s’asseoir, au contraire ! Il le laissa debout, pour ainsi se faire valoir, si bien que le roi perdit toute contenance et ne sut plus s’il devait rester là ou s’en aller. Et Jouder, au bout d’un certain temps, lui dit enfin : « En vérité, est-ce là une façon de se conduire que d’opprimer, comme tu l’as fait, les gens sans défense et que de les dépouiller de leurs biens ? » Il répondit : « Ô mon seigneur, daigne m’excuser ! C’est par la convoitise et l’ambition que j’ai été poussé à agir de la sorte, et aussi parce que c’était ma destinée ! Et d’ailleurs sans la faute il n’y aurait point de pardon ! » Et il continua à s’excuser de tout ce qu’il avait pu commettre par le passé, et à le supplier pour l’indulgence et le pardon ; et même, entre autres excuses, il lui récita ces vers :
« Ô toi, caractère généreux, enfant issu d’illustres ancêtres et d’une noble race, ne me reproche pas ce que j’ai pu commettre à ton égard dans le passé !
« De même que nous serions prêt à te pardonner si tu étais coupable de quelque méfait, de même, si nous sommes coupables, pardonne-nous. »
Et il ne cessa de s’humilier de la sorte entre les mains de Jouder, jusqu’à ce que Jouder lui eût dit : « Qu’Allah te pardonne ! » et lui eût permis de s’asseoir ; et il s’assit. Alors Jouder l’investit de la robe de la sauvegarde, et donna l’ordre à ses frères de tendre la nappe et de servir des mets extraordinaires et nombreux. Et, après le repas, il donna de beaux vêtements à tous les gens de la suite du roi, et les traita avec égards et générosité. Alors seulement le roi prit congé de Jouder et sortit du palais ; mais ce fut pour y retourner tous les jours passer tout son temps avec Jouder ; et même ce fut chez lui qu’il assemblait son Diwân et présidait aux affaires du royaume. Et l’amitié et la camaraderie entre eux deux ne fit que s’accroître et se consolider. Et ils vécurent de la sorte un certain temps.
Mais un jour le roi, se trouvant seul avec son grand-vizir, lui dit : « Ô vizir, moi j’ai bien peur que Jouder ne me tue et ne me dépouille de mon trône…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ô vizir, moi j’ai bien peur que Jouder ne me tue et ne me dépouille de mon trône ! » Le vizir répondit : « Ô roi du temps, pour ce qui est de ton trône, ne crains point que Jouder t’en dépouille ! Car la puissance et l’opulence de Jouder sont de beaucoup plus considérables que celles du roi ! Que veux-tu donc qu’il fasse de ton trône ? D’ailleurs ton trône ne serait pour lui qu’un signe de déchéance, dans l’état où il se trouve ! Mais pour ce qui est de te tuer, si vraiment tu redoutes la chose, tu as une fille ! Tu n’aurais donc qu’à la lui donner en mariage, et tu partagerais de la sorte avec lui la puissance suprême ; et vous seriez tous deux dans les mêmes conditions ! » Il répondit : « Ô vizir, toi, sois l’intermédiaire entre moi et lui ! » Il dit : « Pour cela tu n’as qu’à l’inviter chez toi ; et nous passerons la soirée dans la grande salle du palais. Alors tu ordonneras à ta fille de s’orner de ses plus beaux ornements et de passer comme un éclair devant la porte de la salle. Et Jouder l’apercevra ; et comme sa curiosité en sera très excitée et que son esprit travaillera au sujet de la princesse entrevue, il en deviendra éperdument amoureux ; et il me demandera qui elle est. Alors moi je me pencherai mystérieusement vers lui et je lui dirai : « C’est la fille du roi ! » Et je me mettrai à converser avec lui à ce sujet et à prendre et à laisser des paroles et à entrer et sortir dans les paroles avec lui, sans qu’il sache que tu es au courant, jusqu’à ce que je l’aie décidé à venir te la demander en mariage ! Et lorsque tu l’auras ainsi marié avec la jeune fille, votre accord à tous deux désormais sera chose certaine ; et à sa mort tu hériteras de la majeure partie de ce qu’il possède ! » Et le roi répondit : « Tu dis vrai, ô vizir ! » Et il donna le festin et invita Jouder qui se rendit au palais, et s’assit dans la grande salle, au milieu de la gaieté et de la bonne chère, jusqu’à la fin de la journée.
Or, le roi avait envoyé dire à son épouse de parer la jeune fille de ses plus belles parures et de l’orner de ses plus beaux ornements, et de la faire passer rapidement devant la porte de la salle du festin. Et la mère de la jeune fille fit ce qu’il lui avait été ordonné de faire. Aussi lorsque la jeune fille eut passé comme un éclair devant la salle du festin, belle et parée et brillante et merveilleuse, Jouder l’aperçut et poussa un cri d’admiration et un profond soupir, et fit : « Ah ! » Et ses membres se relâchèrent, et il devint jaune de teint ! Et l’amour et la passion et le désir et l’ardeur entrèrent en lui et le dominèrent. Alors le vizir lui dit : « Loin de toi toute peine et tout mal, mon seigneur ! Pourquoi te vois-je subitement changé et souffrant et endolori ? » Il répondit : « Ô vizir, cette jeune fille ! De qui est-elle la fille ? Elle m’a asservi et m’a ravi la raison ! » Il répondit : « Elle est la fille de ton ami le roi ! Si vraiment elle te plaît, moi je parlerai au roi pour qu’il te la donne en mariage ! » Il dit : « Ô vizir, parle-lui ! Et moi, par ma vie, je te donnerai tout ce que tu me demanderas ! Et je donnerai au roi tout ce qu’il me réclamera comme dot de sa fille ! Et nous serons des amis et des parents par alliance ! » Le vizir répondit : « Je vais employer toute mon influence pour t’obtenir ce que tu souhaites ! » Et il parla au roi en secret et lui dit : « Ô roi Schams Al-Daoula, voici que ton ami Jouder désire se rapprocher de toi par l’alliance ! Et il s’est recommandé à moi pour que je te parle afin que tu lui accordes en mariage ta fille El-Sett Asia ! Ne me repousse donc point et accepte mon intercession ! Et tout ce que tu demanderas comme dot pour ta fille, Jouder te le paiera ! » Le roi répondit : « La dot est déjà toute payée et reçue ! Et la fille est une esclave à son service ! Je la lui donne comme épouse ; et en l’acceptant de moi il me fait le plus grand honneur ! » Et ils passèrent cette nuit-là sans rien préciser davantage.
Mais le lendemain matin, le roi réunit son Diwân, et y convoqua les grands et les petits, les maîtres et les serviteurs ; et il fit venir le cheikh al-Islam, pour la circonstance. Et Jouder posa sa demande de mariage et le roi l’accepta et dit : « Quant à la dot, je l’ai reçue ! » Et on écrivit le contrat.
Alors Jouder fit apporter le sac des joyaux et des pierreries, et en fit présent au roi comme dot de sa fille. Et aussitôt résonnèrent les timbales et les tambours, et jouèrent les flûtes et les clarinettes, et la fête et la noce furent en leur plein, cependant que Jouder pénétrait dans la chambre nuptiale et possédait la jeune fille.
Et Jouder et le roi vécurent ensemble étroitement unis, durant des jours nombreux. Après quoi, le roi mourut.
Alors les troupes se mirent à demander Jouder pour le sultanat, et, comme il se refusait, ils continuèrent à l’importuner jusqu’à ce qu’il eût accepté. Et ils le nommèrent sultan.
Or, le premier acte de Jouder, comme sultan, fut d’ériger une mosquée sur la tombe du roi Schams Al-Daoula ; et il y attacha de riches donations ; et il choisit, comme emplacement de cette mosquée, le quartier des Boundoukaniya, alors que son palais à lui s’élevait dans le quartier des Yamaniya. Et depuis lors le quartier de la mosquée et la mosquée elle-même prirent le nom de Jouderiya.
Le sultan Jouder s’empressa ensuite de nommer vizirs ses deux frères, Salem comme vizir de Sa Droite, et Salim comme vizir de Sa Gauche. Et ils vécurent de la sorte, en paix, une seule année, pas davantage.
Au bout de ce temps, Salem dit à Salim : « Ô mon frère, jusques à quand…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Au bout de ce temps, Salem dit à Salim : « Ô mon frère, jusques à quand allons-nous rester en cet état ? Passerons-nous toute notre vie comme serviteurs de Jouder, sans à notre tour jouir de l’autorité et de la félicité tant que Jouder est vivant ? » Salim répondit : « Comment pourrions-nous faire pour le tuer et lui enlever le sceau et le sac ? Toi seul pourrais combiner quelque stratagème pour arriver à le tuer, car tu es plus expérimenté et plus intelligent que moi ! » Salem dit : « Si je combinais le stratagème de sa mort, toi, accepterais-tu que je devinsse sultan, avec toi comme vizir de Ma Droite ? Et moi j’aurais ainsi le sceau et toi le sac ! » Il dit : « J’accepte ! » Et ils furent d’accord sur l’assassinat de Jouder, pour arriver au souverain pouvoir et jouir en rois des biens de ce monde.
Lorsqu’ils eurent combiné le stratagème, ils allèrent trouver Jouder et lui dirent : « Ô notre frère, nous voudrions bien que tu acceptasses de venir ce soir nous faire le plaisir de goûter à notre nappe, depuis le temps que nous ne t’avons plus vu franchir le seuil de notre hospitalité ! » Il dit : « Ne vous tourmentez plus ! Chez lequel de vous deux dois-je me rendre pour l’invitation ? » Salem répondit : « Chez moi d’abord ! Et lorsque tu auras goûté aux mets de mon hospitalité, tu te rendras à l’invitation de mon frère ! » Il répondit : « Il n’y a point d’inconvénient. » Et il se rendit avec Salem dans l’aile du palais qu’il habitait.
Or, il ne savait pas ce qui l’attendait ! car à peine avait-il pris la première bouchée du festin, qu’il tomba tout entier en petites miettes, les chairs d’un côté et les os de l’autre ! Le poison avait produit son effet.
Alors Salem se leva et voulut lui arracher le sceau du doigt ; mais comme le sceau ne voulait point sortir, il coupa le doigt avec un couteau. Il prit alors le sceau et en frotta le chaton. Aussitôt apparut l’éfrit Tonnerre-Tonitruant, le serviteur du sceau, qui dit : « Me voici ! Demande et tu obtiendras ! » Salem lui dit : « Je t’ordonne de te saisir de mon frère Salim et de le tuer. Puis tu l’enlèveras et tu enlèveras Jouder, qui est là sans vie, et tu iras jeter les deux corps, celui de l’empoisonné et celui de l’assassiné, devant les chefs principaux des troupes ! » Et aussitôt l’éfrit Tonnerre, qui obéissait à tous ordres donnés par n’importe quel possesseur du sceau, alla prendre Salim et le tua ; puis il enleva les deux corps sans vie et alla les jeter devant les chefs des troupes, qui précisément étaient réunis pour le repas, dans la salle des repas !
Lorsque les chefs des troupes virent les corps sans vie de Jouder et de Salim, ils cessèrent de manger et levèrent leurs bras en l’air, épouvantés et tremblants, et demandèrent au mared : « Qui a commis cela sur la personne du roi et du vizir ? » Il répondit : « Leur frère Salem ! » Et, au même moment, Salem fit son entrée et leur dit : « Ô chefs de mes troupes, et vous tous, mes soldats, mangez et soyez contents ! Je suis devenu le maître de ce sceau que j’ai enlevé à mon frère Jouder. Et ce mared-ci, qui est devant vous, est le mared Tonnerre-Tonitruant, serviteur du sceau. Et c’est moi qui lui ai ordonné de mettre à mort mon frère Salim, pour n’avoir point de compétiteur au trône ! D’ailleurs c’était un traître, et j’avais à craindre qu’il ne me trahît ! De plus, comme Jouder est mort, je reste le seul sultan ! Voulez-vous donc m’accepter pour roi, ou bien voulez-vous que je frotte le sceau et que je vous fasse tuer par l’éfrit, les grands et les petits, tous jusqu’au dernier ? »
À ces paroles, les chefs des troupes, saisis d’une grande crainte, n’osèrent protester et répondirent : « Nous t’acceptons pour roi et sultan ! »
Alors Salem ordonna que l’on fît les funérailles de ses frères. Puis il convoqua le Diwân, et lorsque tout le monde fut de retour des funérailles, il s’assit sur le trône ; et il reçut en roi les hommages de tous ses sujets. Après quoi il dit : « Maintenant je veux écrire mon contrat sur l’épouse de mon frère ! » On lui répondit : « Il n’y a pas d’inconvénient. Mais il faut attendre que les quatre mois et dix jours du veuvage soient écoulés ! » Il répondit : « Moi je ne connais pas ces formalités-là, ni autres choses semblables ! Par la vie de ma tête ! il me faut entrer cette nuit même sur l’épouse de mon frère ! » On fut alors obligé d’écrire le contrat du mariage, et l’on alla prévenir de la chose l’épouse de Jouder, El-Sett Asia, qui répondit : « Qu’il vienne…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… et l’on alla prévenir de la chose l’épouse de Jouder, El-Sett Asia qui répondit : « Qu’il vienne ! » Et Salem, à la tombée de la nuit, pénétra chez l’épouse de Jouder, qui le reçut avec les démonstrations de la joie la plus vive et avec les souhaits de bienvenue. Et elle lui offrit, comme rafraîchissement, une coupe de sorbet qu’il but, mais pour aussitôt tomber en miettes, corps sans âme. Et telle fut sa mort.
Alors El-Sett Asia prit le sceau magique et le cassa en morceaux, pour que personne désormais n’en fît un coupable usage, et coupa en deux le sac enchanté, rompant ainsi le charme qu’il possédait.
Après quoi elle envoya prévenir le cheikh al-Islam de tout ce qui s’était passé, et aviser les principaux du royaume d’avoir à élire un nouveau roi, en leur disant : « Choisissez, pour vous gouverner, un nouveau sultan ! »
— Et voilà, continua Schahrazade, tout ce que je sais de l’histoire de Jouder, de ses frères, et du sac et du sceau enchantés ! Mais je sais également, ô Roi fortuné, une histoire étonnante qui s’appelle…
- ↑ Kamar Al-Akmar : lune des lunes.
