Manuel-Roret du relieur/II-II
CHAPITRE II.
Atelier et outillage du relieur.
Avant de parler de l’outillage, disons quelques mots de l’atelier. Il doit être absolument à l’abri de l’humidité et orienté de telle sorte que la lumière y pénètre en abondance. Il faut, en outre, qu’il ait des dimensions assez grandes pour que les différentes opérations puissent s’y faire sans gêne, et que les pièces encombrantes de l’outillage soient toujours d’un facile accès.
Outre un fourneau pour la préparation des colles, colle forte et colle de pâte, l’atelier doit contenir une ou plusieurs armoires, vitrées ou non, pour recevoir, les unes les ouvrages en feuilles et les ouvrages brochés, les autres les ouvrages terminés et prêts à être livrés aux clients. D’autres armoires sont destinées à renfermer les peaux, les papiers et les autres matières dont le relieur peut avoir besoin. Des tablettes, fixées solidement contre la muraille, servent au même usage pour celles de ces matières qui ne craignent pas la poussière. Enfin, une ou plusieurs tables très-solides et de dimensions variables complètent le mobilier.
Le relieur ordinaire, surtout celui des petites villes, fait tout à la fois la reliure proprement dite, la marbrure des tranches et la dorure. Nous supposerons ici qu’il ne s’occupe que de la reliure. En conséfluence, nous ne parlerons que de l’outillage qui lui est exclusivement propre, et nous ne nous occuperons de celui du marbreur et du doreur qu’aux chapitres consacrés à ces deux professions.
L’outillage du relieur se compose des objets suivants :
C’est un bloc de pierre ou de marbre qui a 85 centimètres de haut sur 40 à 50 centimètres en carré. La pierre de liais est préférable parce qu’elle a le grain très-fin et lisse moins le papier. Il est indispensable que la surface sur laquelle on bat soit unie et parfaitement horizontale.
Pour donner une plus grande solidité à la pierre à battre, on l’enfonce dans la terre de 40 à 50 centimetres. Elle a donc en tout 1m 25 à 1m 85 de hauteur.
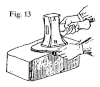
Le marteau à battre, ou marteau du relieur, est l’accessoire obligé de la pierre dont il vient d’être question. C’est une masse de fer A (fig. 13), dont la tête B est large et carrée de 11 centimètres environ de côté. Cette partie se nomme platine ; c’est celle par laquelle on bat ordinairement les volumes. Les vives arêtes de ce carré sont arrondies, afin que les batteurs ne soient pas exposés à couper les feuilles, dans le cas ou le marteau viendrait à vaciller dans leurs mains. En outre, la surface de la tête est un peu convexe afin que les ouvriers puissent travailler plus aisément ; les relieurs donnent à cette convexité le nom de panse ; elle est nécessaire, pour que, dans le travail, il porte moins fort sur les bords que vers le milieu. Ce n’est que dans le cas ou l’on bat des volumes dont le format est très-petit, comme des in-32 et au-dessous, qu’on peut renverser le marteau et s’en servir, par la partie A, pour les battre ; mais il faut que la surface de cette partie soit disposée de la même manière que l’autre côté. Il vaudrait mieux avoir des marteaux plus petits disposés pour cela ; car la règle est de ne se servir jamais du marteau ainsi retourné, parce qu’il écrase trop le volume, dont on ne peut pas facilement unir la battée.
Le marteau est percé du côté d’une de ses faces d’un trou de 1 centimètre de large parallèle à sa surface, pour y fixer le manche, et a une hauteur telle que les jointures des doigts de l’ouvrier soient suffisamment éloignés du livre pour qu’elles ne puissent pas y toucher ; sans cela, il serait exposé à se blesser continuellement. Le manche C est court et gros, afin qu’on puisse le tenir solidement dans la main il a 19 à 22 centimètres de long, et 3 à 3 centimètres 1/4 de diamètre près de la tête, et un peu plus vers l’autre extrémité. Le marteau pèse, avec son manche, 4 kil. 50 à 5 kil. 50 environ.

On appelle cousoir le métier qui sert à coudre les feuilles ou cahiers d’un livre. Il se compose (fig. 16) d’une table ou planche a, formée ordinairement d’un dessus très-simple, de 2 centimètres d’épaisseur, d’environ 1 mètre de long sur 1m.65 de large. Cette planche est posée fixement sur quatre pieds b, b, etc., carrés, arrêtés en bas par deux traverses dans lesquelles une barre est assemblée à tenons et mortaises. À 5 centimètres environ à l’extrémité d’un des grands côtés, et à 14 ou 15 centimètres des petits, on a pratiqué une entaille f, f, de 70 centimètres de long, sur 4 centimètres 1/2 de large, pour recevoir les ficelles g, g, g, g, qui doivent former les nerfs.
Le dessus de la table déborde le haut des pieds à peu près de 10 centimètres. À 5 centimètres environ des bords de cette table sont placées deux vis en bois hi, hi, posées verticalement, leurs pas ou filets en haut ; ces vis ont 65 centimètres de long, dont 44 centimètres de pas de vis ; les 21 centimètres restants du bout qui touche la table n’ont point de pas de vis ; ils sont taillés à huit pans, et forment ce qu’on appelle le manche ll ou la poignée de ces vis ; le bout se termine par un pivot cylindrique, qui entre dans un trou pratique dans la table sans y être arrêté. Ces pivots entrent librement dans leurs trous, et les vis ne sont arrêtées fixement que lorsqu’on tend les ficelles qui forment les nerfs.
Une traverse mm, maintient les vis dans une situation verticale ; et ses deux extrémités sont percées chacune d’un trou taraudé du même pas que le filet de la vis et qui sert d’écrou. On fait monter et descendre cette traverse selon qu’on tourne d’un côté ou de l’autre les deux vis à la fois, en les prenant par le manche l.
Vers le milieu de la traverse sont placés des bouts de ficelle oo, noués en forme de boucle, qu’on appelle entre-nerfs, et qui sont en nombre suffisant pour la quantité de ficelles, ou nerfs, qu’on doit mettre au volume ; ils ont été déterminés soit par le nombre de coups de scie qui ont été donnés en grecquant, soit par le relieur qui indique à la couturière le nombre de nerfs qu’il veut avoir lorsqu’il ne grecque pas.
On attache chaque ficelle g à l’une des boucles, soit en l’y nouant lorsqu’on met la ficelle simple, soit en l’enveloppant lorsque la ficelle est double. Ensuite on la tend avec la main, et on la coupe à 8 centimètres environ au-dessous de la table du cousoir, afin de l’y arrêter et de la bien tendre au moyen d’une chevillette. Ce petit instrument, que l’on voit en A, à côté du cousoir, est en cuivre jaune, long de 6 centimètres et de 4 millimètres environ d’épaisseur ; la figure en montre sa forme. On y remarque vers la tête r, un trou carré, et l’extrémité opposée se termine par deux branches ss.

C’est un étau véritable, en fer ou en acier, dont les mâchoires ou mordaches ont une longueur en rapport avec les dimensions du volume à endosser, et peuvent être rapprochées à volonté au moyen d’une pédale qui ajoute son action à celle d’une vis de serrage. La figure 40, planche II en représente une.

L’étau convient surtout pour les grands formats. Pour les petits formats et les formats moyens, on emploie de préférence des machines de dimensions relativement très-restreintes, appelées endosseuses et dont il existe plusieurs variétés. L’une des plus simples et des plus usitées est l’endosseuse dite américaine (figure 30, planche II.) Le volume étant serré à volonté par un mordage mû par l’action d’une pédale, le dos est formé en quelques secondes par l’oscillation circulaire d’un rouleau que l’ouvrier fait mouvoir à l’aide d’un levier.
Comme son nom l’indique, c’est avec elle que l’on coupe la tranche des livres. Sa construction ne diffère guère de celle de la presse à endosser dont nous dirons bientôt quelques mots ; mais elle a des dimensions plus grandes. Elle est représentée figures 31 à 36, planche II, ainsi que son accessoire indispensable, le fût à rogner. On en distingue deux sortes la presse ordinaire et la presse anglaise.
La presse à rogner usuelle se compose de six pieces :

1o Deux jumelles A B (figure 34), de 1m.17 de long, 18 centim. de large et 14 centim. d’épaisseur ;
2o Deux clés de 65 cent. de long et 3 cent. et demi en carré ;
3o Deux vis E F (figure 34), dont la longueur totale est de 76 centim. Pour avoir une force, suffisante, ces vis doivent avoir 7 centim. de diamètre, et leurs pas être serrés autant que peut le permettre la résistance du bois.
La tête de ces vis est plus grosse que leur corps, afin de bien appuyer contre la jumelle et d’exercer la pression désirable. Cette tête est percée de deux trous diamétralement opposés, dans lesquels on passe la barre C pour faire mouvoir la vis. Elle a environ 17 centim. de long.
Les filets de chaque vis ne descendent qu’à 14 cent. de la tête. Dans cet espace, qu’on appelle le blanc de la vis, on a creusé au tour une rainure de 2 centimètres de diamètre et 10 millimètres de profondeur, qui reliait une cheville de ce même diamètre, sur laquelle la vis tourne, sans que la tête sorte, pour pousser ou attirer l’autre jumelle. La cheville dont il vient d’être question traverse la jumelle de devant. Cette jumelle est renforcée intérieurement par une tringle de bois dur, de 7 millimètres d’épaisseur, dressée en chanfrein, c’est-à-dire plus épaisse vers le bord supérieur de la jumelle avec lequel elle affleure, que par le bas. Cette disposition est nécessaire pour que le livre soit bien serré par le haut où s’opère la rognure.
Un pas de vis exactement semblable est pratiqué dans les trous de la jumelle de derrière, qui sert d’écrou à chaque vis. Au-dessus de cette jumelle est fixé un liteau de bois dur qui sert à diriger le fût du couteau. Ce liteau, de 18 a 20 millimètres de large et 13 millimètres d’épaisseur, est fixé parallèlement à la ligne qui joint les deux jumelles. Il est reçu dans une rainure pratiquée au-dessous du fût, dans laquelle la vis est taraudée.
La presse à rogner se pose à plat sur un porte-presse D (figure 34), pour qu’elle se trouve à la hauteur de l’ouvrier. Le porte-presse est une espèce de caisse très-solide qui tout à la fois sert de support à la presse et reçoit les rognures à mesure qu’elles tombent.
Le fût à rogner est une petite presse destinée à glisser sur la grande, que nous venons de décrire. Il est formé de deux jumelles, de deux clés et d’une seule vis. Ces pièces sont assemblées comme celles de la presse à rogner. La jumelle de devant, contre laquelle appuie la tête de la vis, porte par-dessous le couteau. Ce couteau, qui est en acier, et dont le tranchant aiguisé par-dessus en fer de lance, et plat en dessous, est reçu, en queue d’aronde, dans une pièce de fer portée par la jumelle de devant. On le sort plus ou moins, à volonté, et on le fixe à l’endroit convenable, au moyen d’une vis à oreilles, taraudée dans la partie supérieure de la pièce de fer qui le supporte.
La pièce de fer qui supporte le couteau est placée sous la jumelle de devant ; elle est fixée à cette jumelle par un boulon à vis à tête carrée, dont la tige traverse la jumelle à côté du blanc de la vis, et remplace la cheville de bois qui empêche la vis de sortir dans la presse à rogner elle se loge, comme cette dernière, dans une entaille circulaire creusée au tour. Ce boulon se termine, en dessus du fût, par une vis serrée par un écrou à oreilles.
Le dessous de la plaque dont nous venons de parler est en queue d’aronde ; il reçoit le manche du couteau, qui, ayant une même forme, y glisse librement et sans jeu. L’extrémité du couteau est comprimée, vers son tranchant, par une vis à oreilles, comme nous l’avons dit, pour le fixer au point convenable. C’est un relieur de Lyon qui a imaginé ce perfectionnement ; de là est venu le nom de fût à la lyonnaise, donné au fût qui présente cette disposition et, qui est le meilleur de tous.

La fig. 31 montre le fût hors de la presse. On y remarque la vis a b, les deux clefs e et f, et les deux jumelles c et d. La jumelle d est taillée en dessous en queue d’aronde pour s’engager dans une tringle placée sur la presse à rogner et découpée pareillement en queue d’aronde ; la jumelle c porte par-dessous une boîte n, en fer et à coulisse, dans laquelle passe à queue d’aronde le couteau mm, qui est pressé au point convenable par la vis à oreille o.

Fig. 32 et 33. Les deux jumelles c d vues de face, un peu en perspective par-dessous. Le trou g de la jumelle d est taraudé et sert d’écrou à la vis a. Le trou h de la jumelle c n’est pas taraudé ; il reçoit le collet de la vis, qui y tourne librement, lorsque l’ouvrier la fait mouvoir circulairement. Les quatre trous carrés i, i, i, i, reçoivent les clés e et f. On remarque aussi sur cette jumelle c une coulisse en queue d’aronde q et une entaille p, dans laquelle se loge la boîte en fer n qui porte le couteau à rogner.

La fig. 35 donne une coupe sur une plus grande échelle de la jumelle c afin de montrer l’ajustement du couteau à la lyonnaise. On voit en n une plaque en fer qui porte par-dessous une rainure en queue d’aronde pour recevoir, pareillement à queue d’aronde, la queue du couteau qu’on avance ou qu’on recule à volonté et qu’on fixe à la longueur convenable par la vis de pression o, fig. 32. La boîte n reçoit dans un trou carré et à biseaux la tête pareillement carrée et à biseaux du bouton à vis r qui traverse la hauteur de la jumelle et fixe cette boîte contre le dessous de la jumelle par un écrou à oreilles s, le tout représenté dans la figure 36.

On peut rendre la presse à rogner plus juste (elles ne le sont jamais trop), en fixant une plaque de laiton écroui sur la surface entière de chacune des deux jumelles, ce qui empêche que ces jumelles ne se creusent autant qu’elles le font, à l’endroit où frotte le fût en rognant.

Cette presse, représentée fig. 37, pl. II, a été inventée par M. James Hardie, relieur à Glascow. Une seule vis en fer remplace les deux vis en bois de la presse ordinaire. L’appareil consiste en un châssis carré. Deux des jumelles ont une rainure, ou coulisse intérieure, dans laquelle avance et recule une traverse mobile, suivant l’impulsion que lui donne une vis dont l’écrou est noyé dans la traverse qui ferme le châssis à droite de l’ouvrier. Cette vis est liée par l’autre bout à la traverse mobile, par un collier qui lui permet d’ailleurs de tourner librement. La presse Hardie est plus simple que la presse ordinaire, moins coûteuse, plus commode, mieux appropriée à un travail économique. Néanmoins, elle est peu employée en Angleterre, et elle est presque inconnue en France.
La grande presse du relieur est une presse à vis qui, anciennement tout en bois, est construite aujourd’hui, tantôt en fer seulement, tantôt en bois et fer. En outre, le barreau, employé autrefois pour faire tourner les vis, a été avantageusement remplacé par d’autres mécanismes, balanciers, volants horizontaux avec ou sans poignées, etc. Nos planches représentent quelques-uns des modèles qui sont actuellement en usage.

Le dessin (fig. 25, planche II), fait aisément comprendre le jeu et la manœuvre de cette machine.
Quatre jumelles en fer fondu sont implantées dans un plateau solide et fixe. Elles maintiennent un autre plateau mobile. C’est entre ces deux plateaux que les livres doivent être pressés.
La pression est exercée au moyen d’une vis de métal, qui est mise en jeu au moyen d’une roue horizontale dont les dents sont prises dans le filet d’une vis sans fin que l’on fait tourner.
Aucune presse ne tient moins de place que celle-ci. La pression est graduée, uniforme, sans secousse, et convient par conséquent aux délicates opérations de la reliure, bien mieux que les anciennes presses à levier et la plupart des presses actuelles à balancier.

Cette presse (fig. 26, planche II) est également tout en fer. Elle offre les mêmes avantages que la précédente, dont elle n’est, en réalité qu’une heureuse simplification. Comme l’indique le dessin, on la met en mouvement en agissant sur des poignées fixées à la partie inférieure d’un volant horizontal. À cause de la facilité avec laquelle on peut la faire fonctionner et régler son action, c’est celle qu’on préfère aujourd’hui dans un grand nombre d’ateliers.

Cette presse (fig. 27, pl. II), qui est aussi tout en fer, peut servir pour presser les livres, et en même temps de presse à dorer.
On applique la pression au moyen du balancier a, des sphères bb dont il est armé, et des poignées dont celles-ci sont munies. La distance entre les colonnes en fer forgé c, c est d’environ 0m.60. Le bloc en fer d peut être enlevé pour qu’on puisse insérer les gros volumes, ou remplacé, quand il s’agit de dorer, par des boîtes contenant des objets en fer portés au rouge.
Cette presse et toutes celles du même système ont deux inconvénients assez graves. D’abord, si l’objet qu’on veut presser est élastique, la vis est sujette à remonter après le coup de balancier ; en second lieu, lorsqu’on veut appliquer une nouvelle pression, il faut d’abord que la vis desserre pour pouvoir donner une nouvelle impulsion au balancier, desserrage qui peut avoir pour conséquence de déplacer les objets en presse, et d’exiger du temps pour les remettre en place et donner une succession de coups.
En général, les presses à balancier sont plus particulièrement propres à donner une forte pression aux feuilles pliées, qu’on peut ainsi se dispenser de battre.
La presse à mouvement différentiel de Hunter, possède la double propriété d’appliquer une pression énergique, et d’opérer avec une grande célérité.
« Dans les presses ordinaires pourvues d’une vis simple, l’action de la vis, par suite de l’antagonisme entre la vitesse et la force, se trouve renfermée dans d’étroites limites, de façon qu’une presse d’une construction déterminée, ne peut être employée qu’à un seul service. Ainsi, par exemple, s’il s’agit de presser du papier mou et doux, pour qu’il y ait économie du temps, il faut que le mouvement soit, au commencement, étendu ou rapide, tant que le papier ne présente encore que peu de résistance, puis, à mesure que la pression augmente, il est nécessaire que la vitesse, c’est-à-dire la descente de la vis diminue, et au contraire qu’on puisse augmenter la pression pour surmonter la résistance croissante. Si donc on fait usage d’une seule et même presse pour presser diverses natures de papier, on perd un temps considérable, quand la vis est d’un pas fin, jusqu’au moment où la platine vient à être mise en contact avec le volume, et cette platine ne marche pas avec plus de célérité à vide que quand la presse est en charge.
« Même dans le cas ou une perte de temps est sans conséquence, il faut, quand on veut obtenir une pression très-énergique, faire le levier de presse très-long ou, ce qui est la même chose, la marche de la vis très-lente au moyen d’un pas fin, moyen, toutefois, dont on ne peut user que dans certaines limites, car, dans ce cas, le levier devient d’un grand poids, et exige une vis forte en proportion, et d’un autre côté, le filet doit être assez fort pour pouvoir résister aux efforts auxquels il est soumis.
« La particularité qui distingue la presse à mouvement différentiel de Hunter, consiste dans la combinaison de deux pas de vis différents. La vis différentielle marche, en effet, dans la direction que doit avoir la vis à grande allure, tandis que la vis à petit pas s’avance en même temps en sens contraire. Il en résulte que pendant un tour, le mouvement de vis n’est pas égal à la somme du pas des deux vis, mais bien à leur différence, c’est-à-dire qu’on obtient le même effet que celui que donnerait une vis simple, dont le pas ne serait que la différence des pas des deux vis. On parvient donc ainsi à obtenir cette pression qu’on désire, en règlant convenablement le mouvement réciproque de ces vis.


« La figure 28, pl. II, est une vue en élévation de la presse de Hunter, et la figure 29, une section partielle prise par la vis et l’écrou.
« La traverse A est renflée au milieu, et constitue à son intérieur un écrou taraudé, dans lequel joue la vis B, qu’on manœuvre au moyen du double levier C C. À travers cette vis B, qui est creuse et taraudée aussi à son intérieur, passe la vis massive D D, qu’on fait tourner avec le levier E. Pour relever la platine F F à la hauteur voulue, on fait tourner, au moyen du levier supérieur E, la vis intérieure, et après qu’on a disposé dessous, l’objet qu’on veut presser, on la fait redescendre jusqu’à ce qu’elle touche cet objet.
À partir de ce point, où l’on a besoin d’une pression plus énergique, on saisit des deux mains les leviers C, C qu’on fait tourner, ce qui imprime à la vis D, dans la ligne verticale, un mouvement différentiel dans lequel, à raison du frottement sur la platine F F, elle n’éprouve aucune rotation. Plus est grande la différence entre les pas des deux vis, plus aussi est puissante, dans les mêmes circonstances, la pression produite.
« Ces sortes de presses occupent peu de place, sont peu massives, les filets y sont peu exposés à se rompre, leur manœuvre est simple et rapide, et leur service excellent. »
Les relieurs dont les travaux sont très-considérables, ne trouvant pas assez de puissance à la presse ordinaire plus ou moins améliorée, ont recours à la presse hydraulique, la plus puissante de toutes celles qui ont été inventées. Nous ne voulons pas la décrire en détail, car un appareil de cette importance ne pourrait être compris sur les indications sommaires dans lesquelles nous serions forcés de nous renfermer ; mais nous en donnerons au moins une idée succincte.
Dans la presse hydraulique, la pression est exercée au moyen d’une platine mobile entre quatre montants en fer ; mais à l’inverse de ce qui a lieu dans les presses ordinaires, cette platine exerce la pression de bas en haut, et non de haut en has.
La puissance de compression vient d’une pompe qui est placée à la droite de la presse, et qui est alimentée par l’eau contenue dans un réservoir situé à proximité et ordinairement sous la pompe. L’eau qu’elle aspire est ensuite envoyée par elle dans la base de la presse sur laquelle elle exerce sa pression. Ce liquide agissant avec une force proportionnelle à la largeur de cette base, multipliée par la force avec laquelle il est poussé, soulève avec une énergie irrésistible le cylindre qui supporte la platine, et par conséquent presse fortement contre la faîtière de la presse les papiers et les livres dont elle est chargée. Quand la pression a été poussée aussi loin que le permet le levier ordinaire de la pompe, on y ajoute, si l’on veut, un levier plus long, qui alors est manœuvré par deux hommes.
La puissance de la presse hydraulique est si considérable que, dans les ouvrages communs, on peut épargner les trois quarts du temps nécessaire avec la presse ordinaire. Quand on veut retirer les livres, on ouvre un robinet placé au bas du tube de compression, l’eau s’écoule dans la citerne, la platine s’abaisse, et les livres descendent à la portée de l’ouvrier.
Ordinairement la même pompe sert à faire agir deux presses placées l’une à droite, l’autre à gauche. Mais nous devons dire que cet appareil doit être manœuvré avec précaution. Il est assez fort pour faire éclater en allumettes une bûche de poêle placée à bois debout. Si l’on poussait la pression sans ménagement, les feuilles finiraient par s’incorporer ensemble de façon à ne pouvoir plus être séparées.
On appelle ais des planchettes de la grandeur des volumes qu’on travaille. Il y en a donc pour tous les formats. En outre, on en distingue plusieurs sortes, chacune spécialement appliquée à telle ou telle opération dont on leur donne le nom. En voici l’énumération :

Ais à endosser ; ils sont en chêne ou on hêtre et de deux espèces. On appelle entre-deux, ceux qui se placent entre les volumes ; leur épaisseur est plus grande du côté du mors. On nomme membrures, ceux qui se mettent aux deux extrémités du paquet, ou pile, de livres qu’on travaille à la fois ; ils sont trois fois plus épais que les entre-deux, et plus épais du côté du mors. Pour que ces derniers puissent résister plus longtemps aux coups de marteau, l’on en consolide le bord supérieur avec une garniture de fer, ce qui les fait alors appeler ais ferrés, (figure 65, membrure garnie d’une bande de fer a, a, fixée au moyen de vis à bois). L’adoption des étaux à endosser rend inutile l’emploi de ces ais, dont l’assortiment n’est pas l’un des moindres embarras des petits ateliers.
Ais à mettre en presse ; ce sont des planchettes de même épaisseur partout et dont on se sert pour mettre les volumes à la presse. Ceux qu’on emploie pour la rognure doivent être recouverts intérieurement d’une bande de papier de verre, qu’on y a collée, pour que les volumes ne puissent glisser.
Ais à brunir ; comme leur nom l’indique, ils sont employés dans l’opération du brunissage. Leur épaisseur est plus grande d’un bout à l’autre, pour la tête et la queue des volumes, et plus épais du côté du mors pour la gouttière.
Ais à polir ; ils sont destinés à recevoir les livres pour la polissure. Aussi doivent-ils être eux-mêmes unis et même polis. Leur épaisseur est égale partout. Les uns sont en poirier, les autres en carton bien laminé, d’autres enfin en fer-blanc doublé de bois.
Ais à rabaisser ; c’est une planche de hêtre bien unie sur laquelle on coupe le carton. On lui donne ordinairement 66 centimètres de long, 22 à 28 centimètres de largeur et 6 centimètres d’épaisseur.
Indépendamment de la grande presse, qui est la presse proprement dite, et de la presse à rogner, le relieur en a deux autres qui ne sont en réalité qu’un seul et même appareil légèrement modifié. L’un est la presse à grecquer, l’autre la pressse à endosser toutes les deux en bois et de dimensions en rapport avec celles du volume qu’on veut y placer. Elles consistent en deux pièces jumelles que l’on écarte ou rapproche à volonté en agissant sur deux longues vis, également en bois, placées à chacune de leurs extrémités. C’est dans le vide qui existe entre les jumelles et les vis que se placent les livves à grecquer ou à endosser.

Parmi les autres outils, nous citerons encore La pointe à rabaisser, lame d’acier dont l’extrémité est aiguisée à quatre faces et en pointe, comme un grattoir de bureau. Elle sert à couper le carton sur l’ais dit à rabaisser. Cette lame est ordinairement emmanchée entre deux morceaux de bois que serrent plusieurs tours de ficelle. Souvent aussi (fig. 99, pl. IV), et cela est préférable, elle est enfermée dans une gaine ou fourreau de tôle, d’où il est possible de n’en faire sortir que la quantité nécessaire, et de la fixer au point convenable au moyen d’une vis de pression à oreilles. Dans le dessin, b est le couteau, a la gaine, et c la vis.

Le fer à polir, lame de fer a, (fig. 100, pl. 4) en forme de quart d’ellipse, qui est fixée à l’extrémité d’un manche de bois c. Le bord b est en forme de biseau, et cette partie est très-unie et parfaitement lisse ;
Le poinçon à endosser, petit outil composé d’un fer en forme de langue de carpe et d’un manche en bois ;
Le grattoir, outil dont le fer est plat et dentelé ;
Le frottoir, outil analogue mais dont le fer est arrondi dans la largeur, à peu près dans la forme du dos d’un livre ;
(Ces trois outils sont employés pour l’endossure dite à la française ; on ne s’en sert presque plus aujourd’hui) ;
Une équerre à rebords pour faciliter la rognure à angles droits ;
Des vases pour préparer les couleurs et des pinceaux pour les appliquer ;
Un grillage et des brosses pour jasper. Le grillage consiste en un cadre en fer, garni de fils de laiton très-rapprochés et muni d’un manche pour le tenir à la main ; les brosses sont des brosses ordinaires à longs poils ; Une pierre et un couteau à parer ou paroir pour amincir les peaux ; la pierre est une plaque de liais très-fine, de 40 centimètres de long sur 27 de large et 10 d’épaisseur. Le couteau consiste en une lame d’acier plate, longue de 16 à 25 centimètres et large de 6 à 8 centimètres, qui, munie d’un manche de bois d’environ 14 centimètres de long, se termine en un tranchant un peu arrondi ;
Plusieurs palettes, fers longs et étroits qui servent à dorer les nerfs, en appuyant, sans pousser devant, et à marquer la place des pièces de titre ;
Des brunissoirs d’agate de plusieurs dimensions ; ces instruments sont vulgairement appelés dents de loup à cause de leur forme.
