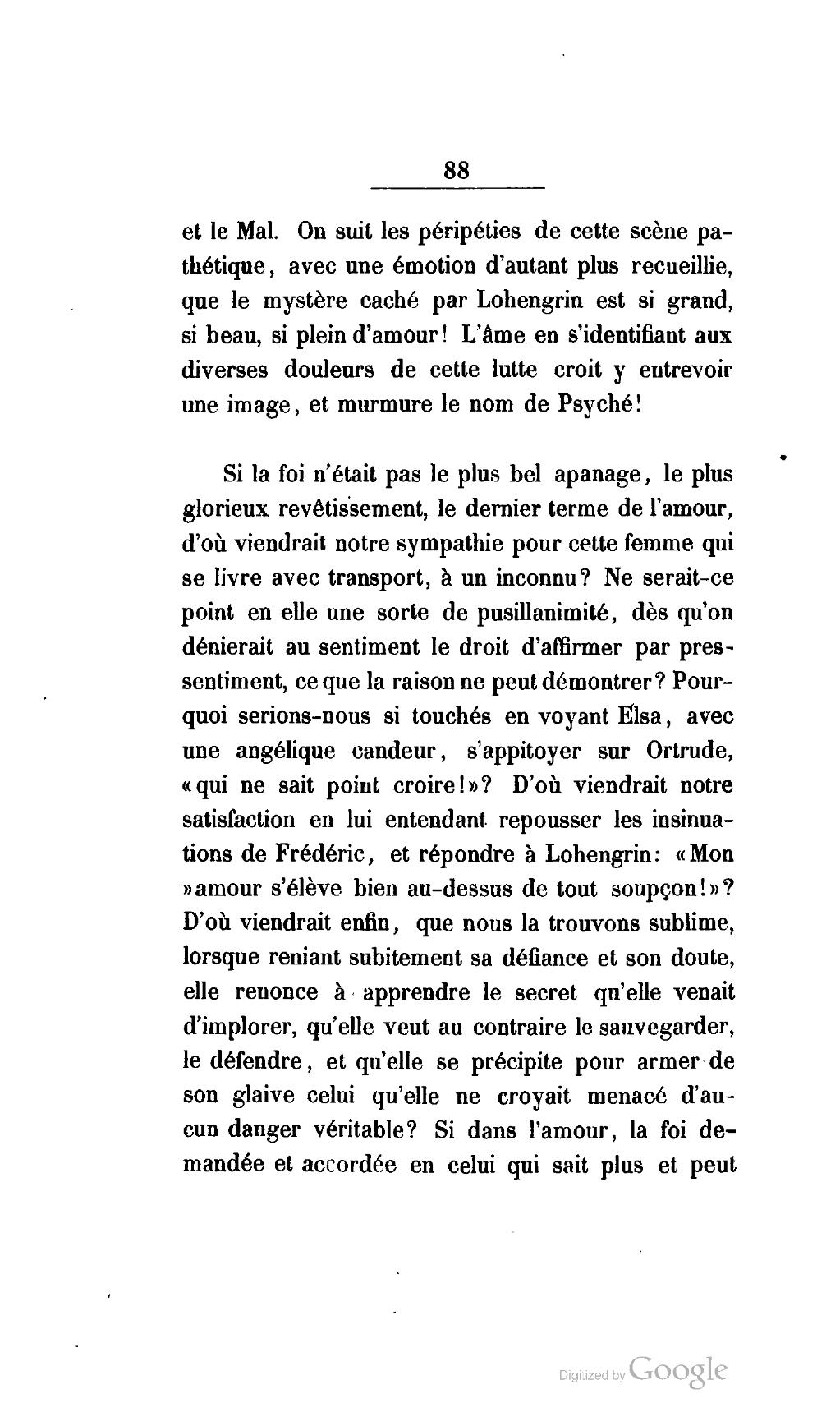et le Mal. On suit les péripéties de cette scène pathétique, avec une émotion d’autant plus recueillie, que le mystère caché par Lohengrin est si grand, si beau, si plein d’amour ! L’âme en s’identifiant aux diverses douleurs de cette lutte croit y entrevoir une image, et murmure le nom de Psyché !
Si la foi n’était pas le plus bel apanage, le plus glorieux revêtissement, le dernier terme de l’amour, d’où viendrait notre sympathie pour cette femme qui se livre avec transport, à un inconnu ? Ne serait-ce point en elle une sorte de pusillanimité, dès qu’on dénierait au sentiment le droit d’affirmer par pressentiment, ce que la raisonne peut démontrer ? Pourquoi serions-nous si touchés en voyant Elsa, avec une angélique candeur, s’appitoyer sur Ortrude, « qui ne sait point croire ! » ? D’où viendrait notre satisfaction en lui entendant repousser les insinuations de Frédéric, et répondre à Lohengrin : « Mon amour s’élève bien au-dessus de tout soupçon ! » ? D’où viendrait enfin, que nous la trouvons sublime, lorsque reniant subitement sa défiance et son doute, elle renonce à apprendre le secret qu’elle venait d’implorer, qu’elle veut au contraire le sauvegarder, le défendre, et qu’elle se précipite pour armer de son glaive celui qu’elle ne croyait menacé d’aucun danger véritable ? Si dans l’amour, la foi demandée et accordée en celui qui sait plus et peut