Tombouctou la mystérieuse/XII
XII
TOMBOUCTOU À TRAVERS LES SIÈCLES
Pour comprendre Dienné il a fallu nous reporter à l’histoire des pays situés à l’est du Niger, et nous avons retrouvé le filon de la civilisation égyptienne.
Tombouctou procède, en ses origines, de directions opposées. Son passé la rattache à l’histoire de l’Afrique septentrionale et à la civilisation arabe.
L’Afrique septentrionale, c’est le monde berbère, — toutes ces peuplades blanches que nous avons, suivant les lieux, appelées : Touaregs dans le Sahara, Kabyles en Algérie, Maures au Maroc et au Sénégal, Foulbés dans leurs infiltrations au Soudan.
Trompé par leur situation présente, on les croit d’éternels nomades. Rien de plus inexact. Ainsi qu’aux Juifs, les circonstances seules leur ont fait adopter la vie errante. Les Berbères représentent, en effet, la population autochtone de l’Afrique méditerranéenne, de ces pays qui s’appellent aujourd’hui le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Tripolitaine. Ibn Chaldoun, leur grand historien, dit : « Toute l’Afrique septentrionale, jusqu’au Pays des Noirs, a été habitée par la race berbère, et cela depuis une époque dont on ne connaît ni les événements antérieurs, ni le commencement. » Avant la colonisation phénicienne et romaine, elle vivait sédentaire sur la
côte africaine et cultivait les belles vallées du Tell.
Carthage et Rome mirent les Berbères en mouvement, les refoulèrent vers l’intérieur, et les transformèrent ainsi en nomades.
D’abord, les Berbères marocains, c’est-à-dire les Maures, furent les moins éprouvés. La colonisation ancienne, moins directe au Maroc, eut des effets moins intenses qu’en Algérie

et en Tunisie. Le pays ne fut pas complètement évacué. Tandis
qu’une partie de sa population se dirigeait vers le Pays des
Noirs en suivant les côtes de l’Atlantique, une autre partie
parvenait à se maintenir auprès des envahisseurs. Celle-ci
demeura sédentaire et assez compacte jusqu’au moment de
l’invasion arabe. Maures et Arabes conquirent alors l’Espagne. Pendant trois siècles ils jouirent en paix de l’hospitalité qu’ils
s’étaient offerte en Europe. On sait quels précieux auxiliaires
ils furent pour la Renaissance occidentale, par leurs mœurs polies,
leur art charmant, leur culte des lettres et leur industrie avancée.
On s’est demandé ce que sont devenues ces brillantes populations lorsqu’elles ont été chassées d’Espagne. Revenues au Maroc et trouvant leur ancienne patrie aux mains des Arabes, nombre d’entre elles durent poursuivre leur exode vers le sud, prendre le chemin de la côte atlantique et du Pays des Noirs, et se faire nomades à leur tour. Les Maures-Espagnols vinrent errer autour des grands lacs de la rive gauche du Niger, dans les environs de Oualata et de Tombouctou. Leurs tribus portent

maintenant encore un nom qui ne laisse aucun doute à
cet égard : on les appelle les Andalousses.
Nous verrons plus tard que ces Maures d’Espagne furent, à l’époque de leur retour, l’un des facteurs de la grandeur de Tombouctou. Aujourd’hui, les architectes exquis et les somptueux possesseurs des palais et des mosquées de Séville, de Grenade, de Cordoue, ont pour demeures des tentes en cuir, et le sable du Sahara pour lieu de prière. Des troupeaux de chèvres, de moutons, de bœufs à bosse, quelques chevaux et quelques livres, sont leurs uniques richesses. Les vicissitudes de la vie nomade les ont fait déchoir de la haute civilisation à laquelle ils avaient atteint. Cependant certains travaux de bijouterie, et surtout la délicate ornementation de leurs cuirs, ouvragés en besaces, pochettes, coussins et gaines de fusil rappellent encore de manière très caractéristique l’art merveilleux auquel ils initièrent l’Europe.
Voyons maintenant ce que sont devenus les Berbères d’AIgérie et de Tunisie où l’action des Anciens fut plus brutale.

Rejetés au delà de l’Atlas, un petit nombre trouvèrent la liberté,
un refuge sûr et une terre capable de les nourrir dans les montagnes et
les vallons de la Kabylie actuelle. Ceux-là se maintinrent
sédentaires et inexpugnables à travers les temps.
La majeure partie, pour conserver son indépendance, dut prendre le chemin du Sahara qui était encore un domaine de la race noire. En ces temps, cette vaste contrée était plus habitable et plus fertile que maintenant. L’inexpérience des nouveaux venus, leurs déboisements excessifs et les ravages de leurs troupeaux ne tardèrent pas à diminuer les dons, parcimonieux déjà, de la nature.
Ils commencèrent dans cet exil une existence à tous égards nouvelle qui, peu à peu, transforma la race. Le milieu tout particulier leur imposa une vie et des mœurs, et même un costume particuliers. C’est cette partie du peuple berbère, réfugiée dans le Sahara, que nous avons appelée : les Touaregs. Eux-mêmes ignorent du reste totalement ce nom qui est d’origine arabe.

Le nom qu’ils revendiquent est celui de Imohars,
qui est dérivé d’un verbe de leur langue signifiant : être libre.
Ils se subdivisent en Aoulémidens, Tenguérégifs, Taddémékets,
Hoggars, Adzers, Aĩrs, qui sont les noms de leurs principales tribus.
Dans le Sahara, l’élevage des chevaux, bœufs, moutons et chèvres, devint leur principale industrie. Le lait et la chair de leurs bêtes furent, avec les dattes, leur principale nourriture. Peut-on persévérer dans la culture sous un ciel qui ne laisse pas tomber de pluies pendant six ou huit années consécutives ?
Le costume subit de même une transformation. Leurs yeux n’étaient pas habitués à la terrible réverbération du blanc désert, ni leurs poitrines aux tempêtes de sable. Pour remédier à ces maux quotidiens, ils adoptèrent une coiffure faite de deux voiles : l’un, le nicab, qui s’enroule autour du front et descend sur les yeux en manière d’abat-jour ; l’autre, le litham,

qui, depuis les narines, couvre toute la partie inféricure
de la figure jusqu’au vêtement. On le voit, l’hygiène est la seule
raison de cet accoutrement mystérieux qui a conduit les savants
à rechercher pour les Touaregs d’extraordinaires origines.
La preuve en est non seulement dans leurs propres dires, mais dans le sobriquet qu’ils donnent à ceux qui n’usent
point de cette coiffure : ils les appellent des bouches à mouches.
Eux ne quittent jamais leurs voiles, même pour manger.
L’usage leur en est devenu si familier que « celui à qui on
l’aurait enlevé serait devenu méconnaissable pour ses amis et
parents ». Si l’un est tué au combat et qu’il ait été dépouillé,
« personne ne peut dire qui il est, jusqu’à ce que cette partie
de son habillement ait été remise à sa place ». Et cependant
l’arête du nez et le bas des yeux restent seuls découverts !
La rareté de l’eau et l’épuisement rapide des maigres pâturages les mirent en marche perpétuelle. Avec cette mobilité extrême, et l’agglomération leur étant interdite dans un pareil pays, toute organisation politique ou sociale devint impossible, s’effaça, disparut. Ils perdirent la notion de l’Autorité et de la Loi. Il leur arriva ce qui est advenu aux Juifs et à tous les peuples jetés hors de leur voie normale ; leur cerveau et leur âme se couvrirent de tares. Chacun fut livré à ses instincts. La seule loi reconnue fut la loi du plus fort. La vie nomade les mena au vagabondage, au pillage et au brigandage.
Le vol devint leur industrie nationale concurremment avec l’élevage. Ils prirent l’habitude d’augmenter le maigre ordinaire de leurs troupeaux en rançonnant les uns et en dépouillant complètement les autres. Voyageurs, commerçants, voisins, devinrent leur proie. Quand les étrangers manquaient, ils se volaient et se tuaient entre eux, car nul lien n’unissait leurs tribus, divisées au contraire par des haines acerbes et persistantes.
Ils adoptent vaguement l’islamisme qui se réduit chez eux en la croyance aux talismans. Mais aucune morale, ni musulmane, ni autre, n’étant parvenue à s’implanter, les pires vices deviennent leur caractéristique, sans qu’on puisse leur découvrir une qualité, sinon physique : une endurance extrême. Pillards et meurtriers quand leur nombre le permet, ils sont des mendiants obséquieux, s’ils se sentent les plus faibles, et restent sans foi ni parole toujours. Un proverbe soudanais dit : « La parole d’un Touareg est comme l’eau qui tombe dans les sables : on ne la retrouve Jamais. » Il y a parmi eux des nobles, des serfs et des esclaves, mais de noblesse point. Si l’on voulait en trouver quelque trait autre que la vanité, l’infatuation et l’orgueil, il le faudrait chercher parmi leurs esclaves nègres. Ni le vieillard, ni la femme, ne leur inspirent respect ou pitié dans leurs razzias. Sanguinaires et cruels, ils n’ont même pas cette bravoure sans limites qui éclaire la sombre silhouette du condottiere. C’est la nuit surtout que leur vient le courage, pendant le sommeil de leurs adversaires ou victimes. La ruse est leur principale arme de combat, encore qu’ils ne marchent jamais sans une lance au poing, une épée au côté et un poignard attaché au bras gauche. Aussi les populations soudanaises leur ont-elles donné trois surnoms qui résument fort justement toute la psychologie des Touaregs : les Voleurs, les Hyènes, les Abandonnés de Dieu.
Et cependant c’est à ce peuple, devenu le plus inutile et le plus néfaste de la terre, que Tombouctou doit sa fondation.
Vers le cinquième siècle de l’Hégire, c’est-à-dire vers l’an 1100 de notre ère, une tribu de Touaregs, les Maks ara[1], déambulait avec ses troupeaux entre la ville d’Araouan dans le Sahara et le petit village d’Amtagh[2] situé sur une dune des bords du Niger.
En été, durant la saison sèche, ils emmenaient leurs troupeaux sur les rives du fleuve. Pendant les hautes eaux et l’hiver, ils retournaient au désert.
Dans leurs déplacements multiples ils distinguèrent pourtant une sorte d’oasis que les débordements du Niger formaient au milieu des sables. Par une dépression étroite mais assez profonde, puisque les hippopotames y venaient chercher refuge, le fleuve gonflé se glissait à l’intérieur des terres. Cette inondation avait l’aspect d’une rivière. À toute époque de l’année et tous les ans, on était assuré de trouver sur ses bords queique végétation ainsi que de l’eau abondante et excellente, car elle ne se corrompait pas dans sa cuvette de sable, quoique stagnante à certaines époques.
L’emplacement était donc précieux aux gens comme aux troupeaux. Il ne manquait pas d’agrément, d’autre part. Des palmiers y dressaient leurs élégantes silhouettes. Les nomades résolurent de s’en assurer l’exclusive possession. Un campement fixe y fut établi pour que personne ne vint s’y installer durant une de leurs absences. Dans la brousse voisine on alla couper des touffes de mimosas épineux, et, selon la coutume, on traça un sanié ou enclos en épines mortes, afin de se préserver des fauves du désert : lions, panthères, hyènes. Derrière cet abri des huttes en paille furent dressées, dans lesquelles les Touaregs déposèrent les provisions et autres objets qui les encombraient. Quelques Bailas ou esclaves furent commis à la garde de ce dépôt, et placés sous l’autorité d’une vieille femme de confiance, appelée Tomboutou, « la Mère-augros-nombril ».
Le sobriquet ne tarda pas à devenir populaire dans le pays et contribua à faire rapidement connaître ce campement fixe et ses avantages. « Les voyageurs s’y arrêtèrent, dit le Tarik è Soudân, ensuite les gens commencèrent à s’y installer à demeure fixe. Par la puissance et la volonté de Dieu la population s’augmenta. Les caravanes venant du Nord et de l’Est (Algérie et Tripoli) et allant vers les royaumes de Mali et de Ganata séjournèrent là pour renouveler leurs provisions. Un marché s’établit. À la barrière d’épines mortes se substitua une haute clôture en nattes. Ce fut le lieu de rencontre de ceux qui voyagent en pirogue et de ceux qui cheminent à chameau. »
C’est ainsi que naquit Tombouctou, le campement ayant pris le nom populaire de « la Mère-au-gros-nombril ».
Cependant le lieu ne devint une ville digne de ce nom que le jour où les commerçants de Dienné (vieille déjà de plus de trois cents ans) y vinrent et s’y installèrent. Cette tradition que j’avais notée déjà là-bas me fut confirmée à Tombouctou : « Les Touaregs sont les pères de la ville, me dirent mes amis. Ce n’est pas tout. Quand tu étais petit, comment appelais-tu celle qui te nourrit, qui te donna son sein ? Ta mère, n’est-ce pas ? Eh bien, Dienné est la mère de Tombouctou, car c’est elle qui fit vivre et grandir le campement, et l’éleva à une grande place de commerce en y apportant des marchandises nombreuses. »
En même temps que le commerce, les Diennéens enseignèrent la manière de bâtir des demeures en briques crues. L’enceinte de nattes fut remplacée par un mur en terre, mais peu élevé « car ceux qui étaient à l’extérieur de la ville pouvaient voir ce qui se passait à l’intérieur ». On éleva sommairement une mosquée qui fut dans la suite la mosquée cathédrale, Ghinghéréber. Puis une femme très riche, originaire de Sokolo, fit bâtir un second temple, Sankoré, qui fut plus tard la mosquée-université. Et ainsi dégrossie, Tombouctou entra en concurrence avec Oualata.
Oualata[3] était au XIIe siècle le grand marché cosmopolite de l’Ouest-africain. « C’est là que se rendaient toutes les caravanes et qu’habitaient les premiers parmi les hommes savants et pieux, et les premiers parmi les hommes riches. Il en venait de tous les pays et de toutes les tribus : de l’Égypte, du Fezzan, de Sousse, du Touat, de Tafilalet, de Ghadamès, de Ouargla, de Fez. » Cette population, fortement imprégnée de civilisation arabe, intelligente et active, ne tarda pas à connaître

Tombouctou et à apprécier les multiples avantages de
sa position. Précisément, au xiie siècle, l’Ouest-africain
est troublé par les grandes conquêtes des rois de Mali. Peu à
peu les caravanes se détournent de Oualata. Ses commerçants
et ses savants émigrent vers la cité nouvelle ; une fraction de
la grande tribu maure des Senhadia y vient également. Bref,
au xive siècle, Oualata était éclipsée : de sa ruine sortit la
splendeur de Tombouctou.
Les Touaregs, eux, avaient continué de mener leur vie errante dans le Désert. Ils s’étaient contentés de donner à la ville un gouverneur qui prélevait l’impôt en leur nom. Cependant avec la prospérité croissante leurs exigences s’augmentèrent démesurément : ce furent de véritables rançons que les habitants et les caravanes eurent à leur payer. On se lassa. Le royaume de Mali était alors à son apogée. Son roi Koukour-Moussa

revenait d’un pélerinage à la Mecque et, chemin
faisant, avait conquis le Songhoï : les Tombouctiens l’invitèrent
à prendre également possession de leur ville. Il y
entra en 1330, dota la mosquée cathédrale d’un minaret de
forme pyramidale, construisit un palais et installa en partant un gouverneur.
Le début de la domination des Malinkés ne fut pas très heureux. La renommée de Tombouctou était déjà telle, qu’elle avait excité les convoitises des gens du Mossi, pays situé au fond de la boucle du Niger. « Leur sultan vint à la tête d’une grande armée. Les nouveaux maîtres de la ville eurent peur et s’enfuirent. L’ennemi pilla, incendia, et tua beaucoup d’habitants. Puis, chargé de richesses, le sultan et son armée rentrèrent au Mossi. Les gens du Mali reprirent possession de Tombouctou et en restèrent maîtres pendant cent ans. » (1337-1434)
La jeune cité se releva de ses ruines. Les habitations en paille se firent de plus en plus rares. Cependant, tandis que Tombouctou renaissait, le royaume du Mali déclinait. « Les premiers maîtres de la ville ne manquèrent pas de profiter de cette décadence. Les Touaregs Maksara s’habituèrent à piller les environs, et les Malinkés n’osaient se présenter pour combattre. Alors Akil, le chef des Touaregs, leur fit savoir : « Si vous ne pouvez défendre Tombouctou, cessez de l’occuper. » Et les gens du Mali se retirèrent.
Pendant une quarantaine d’années les nomades régnèrent de nouveau et commirent de nouveau les pires excès, « se montrant oppresseurs et tyrans, accumulant les exactions, chassant les gens de leurs demeures et violant leurs femmes », si bien que, pour la seconde fois, les Tombouctiens cherchèrent un maître.
Vers le milieu du xve siècle, Ali le Conquérant commençait à Jeter les bases de [a grandeur des Songhoïs. Les Touaregs ayant lésé même leur propre gouverneur, Oumar[4], celui-ci en conçut une vive irritation et songea à se venger. « Ayant envoyé secrètement un messager à Sunni Ali, il l’informa en toutes choses sur Akil et les Touaregs, montra leur faiblesse et promit de lui livrer la ville. En même temps que ces paroles le messager apportait les sandales d’Oumar, pour
prouver la véracité de ses dires. Sunni Ali accepta la proposi
L’an 1469, où Sunni Ali s’empara de Tombouctou, est une date capitale dans l’histoire de la cité. Désormais elle fait, sans interruption, partie de l’empire songhoï. En même temps que ce dernier elle ne cesse de croître encore et encore, pour devenir Tombouctou la Grande, la ville d’universelle renommée, la ville fabuleuse, la Reine du Soudan.
Plus d’un siècle de tranquillité s’étend devant elle, et c’est le siècle d’Askia le Grand ! Grâce à la sage innovation des armées permanentes, cette grande ère de guerre ne jette aucune perturbation dans le Soudan. L’uniforme et forte organisation dont est doté le Songhoï agrandi, ses vice-rois et ses gouverneurs, pacifient rapidement les territoires annexés. Chaque conquête nouvelle étend plus au loin la renommée de Tombouctou et lui vaut un client nouveau.
L’immense puissance du Songhoï qui règne sur tout l’Ouest-africain s’étend également sur la moitié du Sahara, depuis Thegazza jusqu’à Agadès. Les Touaregs, matés, ont interrompu leurs brigandages, et dans les mains des Askia sont devenus les dociles auxiliaires de leurs armées. Les routes du Désert sont sûres ; les caravanes vont et viennent avec une activité inconnue.
Cette sécurité, qui plane au nord comme au sud de Tombouctou, n’est pas le seul élément de sa prospérité culminante : l’organisation et la police des marchés secondaires, la répression des falsificateurs, l’unification des poids et des mesures, etc., sont autant de facteurs non moins importants. Plus qu’à tout autre les sages mesures et les victoires du grand Askia profitent à Tombouctou.
La ville double maintenant son étendue. Toutes ses maisons sont bicn construites et alignées en rues régulières. Les anciennes mosquées sont rebâties et l’on en édifie de nouvelles. Une grande immigration de Songhoïs est venue renforcer les Diennéens, et contrebalancer l’élément arabe et berbère, dominant jusqu’alors. La langue de Dienné et de Gaô devient le parler courant. L’arabe reste la langue des relations avec l’étranger ainsi que le langage de la science. La mosquée-université de Sankoré atteint une notoriété lointaine. La renommée de ses professeurs est connue non seulement au Pays des Noirs, mais dans l’Afrique arabe même. Les savants étrangers accourent du Maroc, de Tunisie, d’Égypte.
La civilisation arabe a tendu la main à la vieille civilisation égyptienne, et de cette union résulte l’apogée de Tombouctou (1494-1591).
L’éclat fut tel qu’aujourd’hui il rayonne encore dans les imaginations, après trois siècles que l’astre s’en est allé déclinant. Telle fut la splendeur que, malgré un aussi long temps de vicissitudes, la vitalité de Tombouctou n’est point éteinte.
C’est avec la conquête marocaine que commence la décadence, en 1591. La forte armature forgée par Askia le Grand ayant été brisée, tout l’Ouest africain est ébranlé. Sur le Niger oriental les derniers Askia luttent pour l’indépendance nationale ; sur le Niger occidental, Dienné se soulève ; un peu partout les Touaregs, les Foulbés, les Bambaras, les Malinkés, imitent son exemple. Le nord et le sud sont également bouleversés. Tombouctou, leur intermédiaire, voit sa vie commerciale arrêtée. Elle-même se soulève à son tour : après une répression brutale, la fleur de ses savants est envoyée en exil au Maroc (1594). Puis une disette épouvantable, provoquée par le manque de pluie, visite la ville. On en est réduit à « manger les cadavres des animaux et même des hommes ». Une peste survint (1618).
Lorsque le Soudan est enfin pacifié, Tombouctou qui, par sa situation rapprochée du Maroc, est devenue la capitale des conquérants, ne peut pas reprendre un nouvel essor. C’est dans ses murs que se déroulent les rivalités des Roumas, que les pachas se disputent le pouvoir suprême. C’est dans ses rues que la troupe fait ses pronunciamientos. À chaque instant la ville est le théâtre d’une panique.
Les causes de décadence se multiplient dès que la désorganisation de la colonie marocaine devient visible, vers la fin du xviie siècle.
Au dehors, une nouvelle période de révoltes se dessine chez les Touaregs et autres nomades, principalement. Les Roumas sont encore assez forts pour les réprimer, mais on devine les perturbations et les ruines qui en résultent pour la clientèle de la ville.
Au dedans, les rivalités des chefs marocains prennent un caractère de plus en plus aigu. Les compétiteurs au titre de pacha tour à tour pillent et maltraitent les habitants. La population se divise et prend parti qui pour l’un, qui pour l’autre des prétendants. Des barricades s’élèvent, on se bat dans les rues, la populace pille les riches. L’une de ces révolutions, en 1716, dure quatre mois : nul ne peut se rendre au marché pendant tout ce temps, et « l’herbe y pousse » ! À un autre moment, en 1735, l’un des rivaux s’empare de Kabara, empêche de décharger les navires, et les marchandises de pénétrer à Tombouctou.
Rien d’étonnant dès lors que la ville se dépeuple et que les caravanes se fassent plus rares. Et puis, voici que les Touaregs, les Maures, les Foulbés, interviennent à leur tour dans ce gâchis. Ils commencent par inquiéter les environs de la ville. Des patrouilles sont obligées de protéger les commerçants sur Ja route de Kabara. À mesure que leurs incursions deviennent plus fréquentes, la résistance des Roumas se fait moins énergique. En 1770, les hommes voilés s’enhardissent jusqu’à investir Tombouctou pendant trois mois. Les Roumas sont incapables de conquérir la paix. Ils l’achètent. « On paya aux Touaregs un tribut de 48 chevaux pris parmi les meilleurs de la ville, 1,200 vêtements, des marchandises diverses et 7,000 mitkals d’or. »
Les nomades se répandent alors en toute liberté sur les rives du Niger et dans la Boucle, guettent et pillent les navires qui se rendent à Kabara, et lèsent ainsi les clients même les plus lointains de Tombouctou.
Au commencement du xixe siècle la cité était retombée dans la même situation qu’avant sa conquête par Sunni Ali : les Roumas et leur chef y étaient les représentants des Touaregs, gouvernaient et prélevaient l’impôt en leur nom. À mesure que la décadence s’accentue, la ville diminue en étendue. Les huttes de paille reparaissent. Les quartiers nouveaux bâtis au temps des Askia au nord de la ville se dépeuplent et leurs maisons tombent en ruines, si bien qu’aujourd’hui la ville est revenue à son périmètre du xve siècle, groupée autour de ses trois premières mosquées.
Une fois de plus Tombouctou fut délivrée des mains des Touaregs en 1827, lorsque surgit l’empire foulbé : Cheikou-Ahmadou fit contre eux une campagne heureuse et s’empara de la ville. Mais les nomades, redevenus agressifs, finirent par lasser ses successeurs, et ceux-ci, pour n’être pas obligés de faire d’incessantes colonnes, se résignèrent à leur verser un tiers de l’impôt qu’ils prélevaient à Tombouctou. Cela dura ainsi jusqu’en 1861 où EI Hadj Omar brisa la puissance des Foulbés.
Alors commença pour Tombouctou la période la plus critique de son histoire. Jamais les voies soudanaises ni les routes sahariennes n’avaient été moins sûres. Jamais le commerce n’avait rencontré plus de difficultés pour s’alimenter : par surcroît, dans la ville même, la sécurité des transactions disparut.

Tombouctou n’avait plus de maître. Elle eut mille tyrans : les Touaregs, qui jouèrent d’elle comme les flots d’un navire sans gouvernail. Tenguérégifs et Irregenaten la mirent en coupe réglée et lui firent la tragique et sordide toilette dans laquelle se présente aujourd’hui Ia Reine du Soudan.
Voici comment me furent racontés ces temps d’épreuves : « Tu les as vus, les hommes voilés, de sombre vêtus, la poitrine et le dos comme cuirassés de talismans en cuir rouge et jaune ? Quand ils viennent vers nous maintenant, ils sont modestes. Mais avant votre arrivée leurs silhouettes sèches s’avançaient hardies et insolentes à travers la ville, appuyées sur de grandes lances en fer. Chaque année nous leur donnions un impôt, tant en or qu’en nature : céréales, sel, vêtements, turbans, etc. Les chefs et leur suite étaient largement hébergés à chaque visite. Dans le Désert les caravanes qui venaient ici leur payaient un droit de passage, et de même sur le fleuve les navires qui se rendaient à Kabara. Mais tout cela ne leur suffisait pas : c’étaient là les moindres de nos maux ! Du commencement de l’année à la fin ils nous traitaient comme des captifs de guerre, comme des esclaves. Ils arrivaient à tout instant par petits groupes et se dispersaient à travers la ville. Dès qu’on les apercevait, les maisons se fermaient. Mais eux frappaient les portes de grands coups de lance dont partout tu peux encore voir les traces. On était forcé d’ouvrir. Sans faire attention au propriétaire ni à sa famille, ils s’installaient dans les meilleures pièces, forçant tout le monde à leur céder les coussins et les couchettes, et demandaient grossièrement à boire et à manger, exigeant du sucre, du miel, de la viande. Au moment de repartir pour leurs campements, en guise de remerciements, ils volaient quelque objet, et crachaient sur leur hôte.
« Étaient-ils tombés chez un homme peu fortuné qui ne pouvait les satisfaire, ils marquaient leur mauvaise humeur par des dégâts. Essayait-on de leur résister, ils levaient aussitôt la lance. Arrivaient-ils en pleine nuit, il fallait de même leur céder la place, et leur préparer un repas sur l’heure.
« Au marché ils faisaient main basse sur tout ce qui était à leur convenance. Les boutiquiers voisins, marchands d’étoffes et de vètements, avaient des gens apostés pour signaler leur apparition, et aussitôt ils se barricadaient. Dans les rues ils dévalisaient les passants. Rencontrant un homme avec une belle robe brodée, un vêtement neuf ou simplement propre,

avec des bottes ou des sandales, ils le dépouillaient sur place.
Aux femmes ils enlevaient leurs bijoux d’or, leurs ornements
en verroterie ou leurs colliers de corail ; ils agissaient de
même avec les enfants et les esclaves.
« Autrefois les écoles se tenaient devant les demeures des maîtres, et les enfants jouaient dans les rues, comme partout au Soudan. Les Touaregs s’en emparaient, les enlevaient et ne les rendaient que contre de fortes rançons. Aux précautions ils répondaient par la ruse : quelqu’un avait-il caché tout objet de valeur dans sa maison, et le soupçonnaient-ils d’être riche, en se retirant bredouille ils oubliaient n’importe quoi dans la demeure, puis revenaient nombreux et criaient au vol ; on retrouvait en effet l’objet soi-disant volé, et l’homme prudent était forcé de payer une indemnité. »
Les narrateurs entrecoupaient leurs souvenirs de nombreux Imsh’ Allah ! (que la volonté de Dieu soit faite !) résignés. « Et pourquoi ne vous êtes-vous pas unis contre vos tyrans ? leur demandai-Je.
— Oh ! quand on leur résistait c’était pis encore. Un jour un jeune homme revenant du marché, où il avait acheté de la viande, est rencontré par un Touareg qui s’empare de son achat. L’autre résiste, et l’Abandonnéde Dieu le tue d’un coup de lance, pour un morceau de viande ! Une autre fois, une femme qui se trouvait seule à la maison est maltraitée par l’un d’eux. Ses cris attirent son frère qui, pris de colère, blesse mortellement le Touareg. Le vengeur s’est sauvé aussitôt et réfugié à Saréféré. Mais on l’a forcé à revenir, et les hommes voilés lui ont coupé la gorge comme à un mouton.
« Nous ne pouvions rien contre eux parce que nous sommes des marchands et non des guerriers. Et puis, les aurions-nous vaincus qu’ils restaient néanmoins nos maîtres, car ils tenaient les routes des caravanes comme le chemin de Kabara : aussitôt qu’il leur aurait plu, ils pouvaient nous ruiner, et nous faire mourir de faim…
Telle fut existence de Tombouctou durant ces trente-cinq dernières années. On devine les résultats désastreux qu’un pareil régime dut produire à la longue. Molestés, les étrangers s’aventurèrent en nombre de plus en plus restreint. Lassée de vivre dans des alarmes continues et de subir des vexations dont elle ne voyait pas la fin, la population émigra. Les étrangers qui s’étaient fixés dans la ville retournèrent dans leur pays natal. Les indigènes qui avaient de la famille dans les pays voisins allèrent la rejoindre. Leurs demeures inoccupées

se lézardèrent. Aucun nouvel habitant ne se présentant,
des écroulements et des brèches se produisirent : de là les
îlots de ruines, si inattendues, si inexpliquées, si impressionnantes
au moment de l’arrivée.
Les plus pauvres et les plus riches, principalement, restèrent fidèles à la cité. Les premiers, habitant des cases en paille, et ne possédant rien, n’avaient rien à perdre au contact des Touaregs. Les seconds, de gros négociants, pouvaient, grâce à leur fortune, supporter plus allègrement les vexations et, d’autre part, l’émigration des petits concurrents leur permettait d’augmenter leurs affaires et leurs bénéfices.
Cependant on ne s’habitue guère à être pillé et maltraité, même en échange de compensations. Alors pour ne plus être dépouillé en pleine rue, pour ne pas voir sa maison envahie, bouleversée, ensanglantée, l’habitant s’imposa une existence nouvelle, transforma ses vêtements et sa demeure, maquilla sa vie et sa ville.

Ayant cessé d’être Tombouctou la Grande, elle devint ce qu’elle n’avait Jamais été jusqu’alors : Tombouctou la Mystérieuse.
Au lieu de turbans blancs, massifs et imposants, ou de beaux turbans sombres de Haoussa, en tissu scintillant comme du mica, la population ne se coiffa plus que de loques peu tentantes ou de bonnets sans prix. De vieilles savates se substituèrent aux bottes des hommes en fin cuir rouge, brodées de soie, et aux fraîches babouches jaunes des femmes, Les cafetans, les amples vêtements éclatants de blancheur, les belles robes finement brodées, les Dissas frangées et ornementées qui se jettent sur l’épaule comme la cape du toréador, et ajoutent encore à l’allure solennelle du Soudanais, disparurent. On s’attifa de vieux vêtements, étriqués, dont la malpropreté était le seul ornement, et n’éveillait pas la tentation. La haute canne agrémentée de cuivre ou de fer gravé, sur laquelle le riche Soudanais aime à appuyer sa belle silhouette, devint un simple bâton de bois blanc. Il importait de ne pas trahir l’aisance, de ne pas éveiller l’attention même dans le moindre détail.
Dans leurs rares sorties, les femmes se couvraient d’étoffes grossières, et quittaient leurs ornements d’or et d’ambre. Avant d’aller au marché ou de chercher l’eau aux portes de la ville, les esclaves cachaient leurs modestes bijoux. Pour ne pas exposer les enfants à quelque rapt, on les gardait dans les cours et le maître faisait, de même, l’école à l’intérieur de sa demeure.
Les habitations se travestirent comme leurs propriétaires. Pour ne pas provoquer la visite des hommes voilés, elles non plus ne devaient pas avoir les apparences de la richesse ou de la prospérité. Je n’affirmerai pas qu’on les dégrada volontairement. On laissa le temps et les intempéries faire leur œuvre, sans l’entraver en rien. La couche de crépi s’en alla lavée par les tornades de l’hivernage. Sur les façades, les briques en terre crue se montrèrent à nu. Les murs des terrasses s’effritèrent et leurs petites fenêtres mauresques se déchaussèrent. Devant les maisons, plus de ces larges bancs en terre battue (timtims) sur lesquels les gens aisés passaient les heures de loisir en causeries ou en lectures. On se garda de réparer quoi que ce soit, mais à l’extérieur seulement. Intérieurement on continuait la coutume de l’entretien annuel.
Le décor de la ville représenta bientôt masures et pauvreté. Tout s’émiettait par les rues, sauf les portes cependant, ces portes bardées et si obstinément closes qui étonnent aussitôt le voyageur. Elles concentraient les soins les plus raffinés. Pour elles on dépensait sans regarder. De loin on faisait venir des plaques de bois dur et lourd. On les couvrait de ferrures partout, comme un gentilhomme d’Azincourt. Et ainsi barricadés les habitants menèrent, derrière leurs paravents de misère, une vie de cloitrés, aussi silencieuse que possible. On cessa de piler le couscouss dans les grands mortiers en bois, selon l’usage du Soudan. La cadence du lourd pilon n’aurait pas manqué d’attirer le Touareg en quête d’un repas. On écrasa le grain entre deux pierres, on le broya sans bruit. Frappait-on à la porte, toute la maisonnée faisait le mort ou s’empressait, à tout hasard, de cacher les objets de prix. Le visiteur n’était-il pas initié, il faisait à haute voix un long discours devant la porte, déclinant ses noms, ses recommandations, le but de sa visite. L’exposé de ces motifs avait-il été jugé satisfaisant, on se décidait à donner signe de vie : quelques questions encore et on ouvrait enfin.
Le même mystère s’étendit naturellement aux opérations commerciales. On profitait du moment où aucun Touareg n’était signalé en ville pour aller trailer les affaires. Dans le cas contraire, on attendait que la nuit fût venue. De toute façon, la livraison des marchandises ne se faisait que dans l’obscurité.
… J’étais initié au secret de Tombouctou. La désastreuse vision de l’arrivée n’était expliquée. Avec mes narrateurs pour guides je commençai alors à parcourir les mêmes rues et les mêmes places que lors de mon arrivée. Ils me montrèrent de plus près les petites masures cubiques et les grandes maisons croulantes, me firent ouvrir les portes bardées et closes, me révélèrent tout ce que cachaient les décors de ruines.
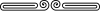

- ↑ Aujourd’hui les Markasseghi, fixés à l’est de Tombouctou, dans la Boucle, et faisant partie de la famille des Tenghérégifs.
- ↑ Aujourd’hui Hamtagal, au sud-ouest de Tombouctou.
- ↑ Appelée dans les anciens textes Ganata et Gana, par les Arabes, et Birou par les Songhoïs.
- ↑ Ce fut lui qui édifia la troisième mosquée de Tombouctou, Sidi Yahia, appelée ainsi du nom d’un pieux et savant ami d’Oumar qui y fut enterré.
