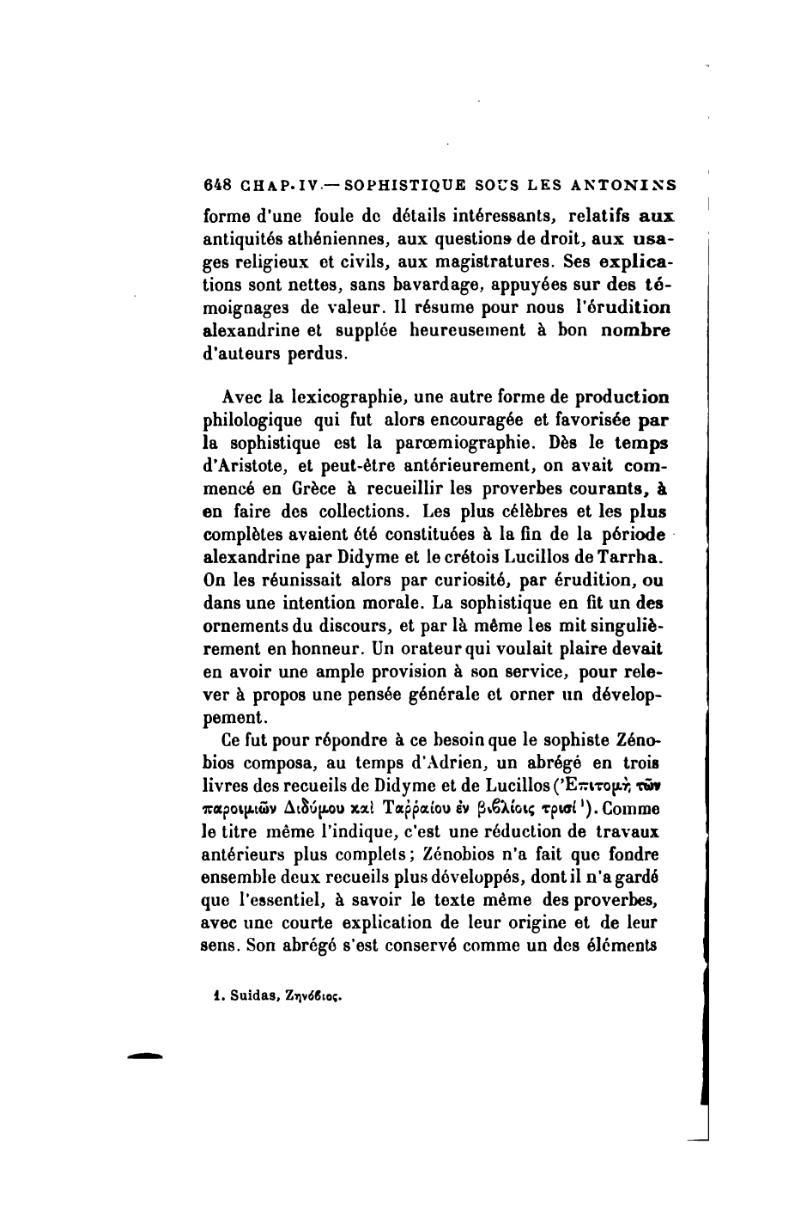forme d’une foule de détails intéressants, relatifs aux antiquités athéniennes, aux questions de droit, aux usages religieux et civils, aux magistratures. Ses explications sont nettes, sans bavardage, appuyées sur des témoignages de valeur. Il résume pour nous l’érudition alexandrine et supplée heureusement à bon nombre d’auteurs perdus.
Avec la lexicographie, une autre forme de production philologique qui fut alors encouragée et favorisée par la sophistique est la parœmiographie. Dès le temps d’Aristote, et peut-être antérieurement, on avait commencé en Grèce à recueillir les proverbes courants, à en faire des collections. Les plus célèbres et les plus complétés avaient été constituées à la fin de la période alexandrine par Didyme et le crétois Lucillos de Tarrha. On les réunissait alors par curiosité, par érudition, ou dans une intention morale. La sophistique en fit un des ornements du discours, et par la même les mit singulièrement en honneur. Un orateur qui voulait plaire devait en avoir une ample provision à son service, pour relever à propos une pensée générale et orner un développement.
Ce fut pour répondre à ce besoin que le sophiste Zénobios composa, au temps d’Adrien, un abrégé en trois livres des recueils de Didyme et de Lucillos (Ἐπιτομὴ τῶν παροιμιῶν Διδύμου καὶ Ταῤῥαίου ἐν βιβλίοις τρισί[1]). Comme le titre même l’indique, c’est une réduction de travaux antérieurs plus complets ; Zénobios n’a fait que fondre ensemble deux recueils plus développés, dont il n’a gardé que l’essentiel, à savoir le texte même des proverbes, avec une courte explication de leur origine et de leur sens. Son abrégé s’est conservé comme un des éléments
- ↑ Suidas, Ζηνόβιος.