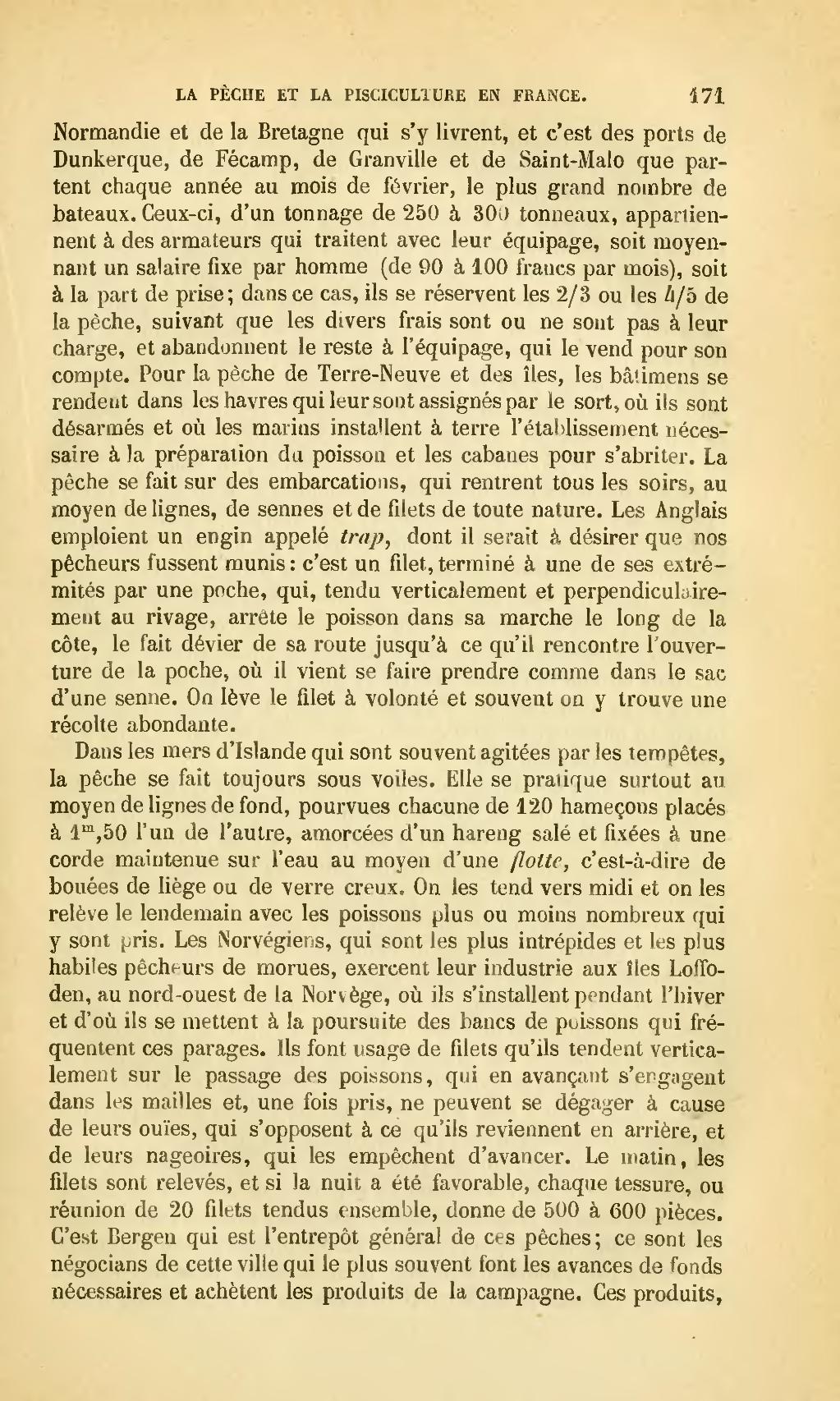Normandie et de la Bretagne qui s’y livrent, et c’est des ports de Dunkerque, de Fécamp, de Granville et de Saint-Malo que partent chaque année au mois de février, le plus grand nombre de bateaux. Ceux-ci, d’un tonnage de 250 à 300 tonneaux, appartiennent à des armateurs qui traitent avec leur équipage, soit moyennant un salaire fixe par homme (de 90 à 100 francs par mois), soit à la part de prise ; dans ce cas, ils se réservent les 2/3 ou les 4/5 de la pêche, suivant que les divers frais sont ou ne sont pas à leur charge, et abandonnent le reste à l’équipage, qui le vend pour son compte. Pour la pêche de Terre-Neuve et des îles, les bâtimens se rendent dans les havres qui leur sont assignés par le sort, où ils sont désarmés et où les marins installent à terre l’établissement nécessaire à la préparation du poisson et les cabanes pour s’abriter. La pêche se fait sur des embarcations, qui rentrent tous les soirs, au moyen de lignes, de sennes et de filets de toute nature. Les Anglais emploient un engin appelé trap, dont il serait à désirer que nos pêcheurs fussent munis : c’est un filet, terminé à une de ses extrémités par une poche, qui, tendu verticalement et perpendiculairement au rivage, arrête le poisson dans sa marche le long de la côte, le fait dévier de sa route jusqu’à ce qu’il rencontre l’ouverture de la poche, où il vient se faire prendre comme dans le sac d’une senne. On lève le filet à volonté et souvent on y trouve une récolte abondante.
Dans les mers d’Islande qui sont souvent agitées par les tempêtes, la pêche se fait toujours sous voiles. Elle se pratique surtout au moyen de lignes de fond, pourvues chacune de 120 hameçons placés à 1m,50 l’un de l’autre, amorcées d’un hareng salé et fixées à une corde maintenue sur l’eau au moyen d’une flotte, c’est-à-dire de bouées de liège ou de verre creux. On les tend vers midi et on les relève le lendemain avec les poissons plus ou moins nombreux qui y sont pris. Les Norvégiens, qui sont les plus intrépides et les plus habiles pêcheurs de morues, exercent leur industrie aux îles Loffoden, au nord-ouest de la Norvège, où ils s’installent pendant l’hiver et d’où ils se mettent à la poursuite des bancs de poissons qui fréquentent ces parages. Ils font usage de filets qu’ils tendent verticalement sur le passage des poissons, qui en avançant s’engagent dans les mailles et, une fois pris, ne peuvent se dégager à cause de leurs ouïes, qui s’opposent à ce qu’ils reviennent en arrière, et de leurs nageoires, qui les empêchent d’avancer. Le matin, les filets sont relevés, et si la nuit a été favorable, chaque tessure, ou réunion de 20 filets tendus ensemble, donne de 500 à 600 pièces. C’est Bergen qui est l’entrepôt général de ces pêches ; ce sont lest négociant de cette ville qui le plus souvent font les avances de fonds nécessaires et achètent les produits de la campagne. Ces produits,