Anecdotes pour servir à l’histoire secrète des Ebugors. Statuts des sodomites au XVIIe siècle./II
La France devenue italienne, avec les autres désordres de la cour,qui nous a transmis les statuts des sodomites au xviie siècle, fait partie d’un ensemble de libelles portant le titre L’Histoire amoureuse des Gaules, et attribués à Bussy-Rabutin. Ces pamphlets furent publiés séparément et clandestinement, en Hollande pour la plupart, de 1665 à 1691, et il est difficile de déterminer exactement lesquels appartiennent vraiment au comte Roger de Bussy-Rabutin.
La France devenue italienne figure en tête du tome V de la jolie édition de l’Histoire amoureuse des Gaules, publiée en 1754 (s. l.), en 5 volumes in-12, avec titres gravés. Un exemplaire relié en veau marbré, portant sur le plat les armes de Marie-Antoinette, est à la Bibliothèque nationale (L. B. 37, 3523 D. Réserve).

LES STATUTS
DES SODOMITES
au XVIIe siècle.

 A facilité de toutes les dames
avait rendu leurs charmes si
méprisables à la jeunesse,
qu’on ne savait presque plus à
la cour ce que c’était que de les regarder ;
la débauche y régnait plus qu’en aucun lieu
du monde, et quoique le Roi eût témoigné
plusieurs fois une horreur inconcevable
pour ces sortes de plaisirs, il n’y avait
qu’en cela qu’il ne pouvait être obéi. Le
vin et ce que je n’ose dire étaient si fort à
la mode qu’on ne regardait presque plus
ceux qui recherchaient à passer leur temps
plus agréablement, et quelque penchant
qu’ils eussent à vivre selon l’ordre de la
nature, comme le nombre était plus grand
de ceux qui vivaient dans le désordre, leur
exemple les pervertissait tellement qu’ils
ne demeuraient pas longtemps dans les
mêmes sentiments.
A facilité de toutes les dames
avait rendu leurs charmes si
méprisables à la jeunesse,
qu’on ne savait presque plus à
la cour ce que c’était que de les regarder ;
la débauche y régnait plus qu’en aucun lieu
du monde, et quoique le Roi eût témoigné
plusieurs fois une horreur inconcevable
pour ces sortes de plaisirs, il n’y avait
qu’en cela qu’il ne pouvait être obéi. Le
vin et ce que je n’ose dire étaient si fort à
la mode qu’on ne regardait presque plus
ceux qui recherchaient à passer leur temps
plus agréablement, et quelque penchant
qu’ils eussent à vivre selon l’ordre de la
nature, comme le nombre était plus grand
de ceux qui vivaient dans le désordre, leur
exemple les pervertissait tellement qu’ils
ne demeuraient pas longtemps dans les
mêmes sentiments.
La plupart des gens de qualité étaient non seulement de ce caractère, mais il y avait encore des princes, ce qui fâchait extraordinairement le Roi. Ils se cachaient cependant autant qu’ils pouvaient pour ne lui pas déplaire, et cela les obligeait à courir toute la nuit, espérant que les ténèbres leur seraient favorables. Mais le Roi (qui était averti de tout) sut qu’un jour après son coucher ils étaient venus à Paris, où ils avaient fait une telle débauche qu’il y en avait beaucoup qui s’en étaient retournés saoûls dans leurs carrosses. Et comme cela s’était passé dans le cabaret (car ils ne prenaient pas plus de précautions pour cacher leurs désordres), il prit sujet de là d’en faire une grande mercuriale à un jeune prince qui s’y était trouvé, en qui il prenait intérêt. Il lui dit que du moins, s’il était assez malheureux pour être adonné au vin, il bût chez lui tout son saoûl et non pas dans un endroit comme celui-là, qui était de toutes façons si indigne pour une personne de sa naissance.
Le reste de la cabale n’essuya pas les mêmes reproches, parce qu’il n’y en avait pas un qui touchât le Roi de si près ; mais, en récompense, il leur témoigna un si grand mépris qu’ils furent bien mortifiés. Et, à la vérité, ils furent quelque temps sans oser rien faire qu’en cachette ; mais, comme leur caractère ne leur permettait pas de se contraindre longtemps, ils en revinrent bientôt à leur inclination, qui les portait à faire les choses avec plus d’éclat.
Pour ne pas s’attirer néanmoins la colère du Roi, ils jugèrent à propos de faire serment et de le faire faire à tous ceux qui entreraient dans leur confrérie de renoncer à toutes les femmes ; car ils accusaient un d’entre eux d’avoir révélé leurs mystères à une dame avec qui il était bien, et ils croyaient que c’était par là que le Roi apprenait tout ce qu’ils faisaient. Ils résolurent même de ne le plus admettre dans leur compagnie ; mais s’étant présenté pour y être reçu et ayant juré de ne plus voir cette femme, on lui fit grâce pour cette fois, à condition que s’il y retournait il n’y aurait plus de miséricorde. Ce fut la première règle de leur confrérie ; mais la plupart ayant dit que, leur ordre allant devenir bientôt aussi grand que celui de Saint-François, il était nécessaire d’en établir de solides et auxquelles on serait obligé de se tenir ; le reste approuva cette résolution et il ne fut plus question que de choisir celui qui travaillerait à ce formulaire. Les avis furent partagés là-dessus et comme on voyait bien que c’était proprement déclarer chef de l’Ordre celui à qui l’on donnerait ce soin, chacun brigua les voix et fit paraître de l’émulation pour un si bel emploi. Manicamp, le duc de Grammont et le chevalier de Tilladet[1] étaient ceux qui faisaient le plus de bruit dans le chapitre et qui prétendaient s’attribuer cet honneur à l’exclusion l’un de l’autre : Manicamp, parce qu’il avait plus d’expérience qu’aucun dans le métier ; le duc de Grammont, parce qu’il était duc et pair et qu’il ne manquait pas aussi d’acquit ; pour ce qui est du chevalier de Tilladet, il fondait ses prétentions sur ce qu’étant chevalier de Malte, c’était une qualité si essentielle pour être parfaitement débauché que, quelque avantage qu’eussent les autres, comme ils n’avaient pas celui-là, il était sûr qu’il les surpasserait de beaucoup dans la pratique des vertus.
Comme ils avaient tous trois du crédit dans le chapitre, on eut de la peine à s’accorder sur le choix, et quelqu’un ayant été d’opinion qu’ils devaient donner des reproches les uns contre les autres, afin que l’on choisît après cela celui qui serait le plus parfait, chacun approuva cette méthode. Et le chevalier de Tilladet, prenant la parole en même temps, dit qu’il était ravi qu’on eût pris cette voie et qu’elle allait lui faire obtenir ce qu’il désirait ; que Manicamp aurait pu autrefois entrer en concurrence avec lui et qu’il ne l’aurait pas trouvé étrange, parce que le bruit était qu’il avait eu de grandes qualités, mais qu’aujourd’hui que ses forces étaient énervées, c’était un abus que de le vouloir constituer en charge, à moins qu’on ne déclarât que ce qu’on en ferait ne tirerait à aucune conséquence pour l’avenir ; qu’en effet, il n’avait plus rien de bon que la langue et que toutes les autres parties de son corps étaient mortes en lui.
Manicamp ne put souffrir qu’on lui fît ainsi son procès en si bonne compagnie, et ayant peur qu’après cela personne ne le voulût plus approcher, il dit qu’il n’était pas encore si infirme qu’il n’eût rendu quelque service à la maréchale d’Estrées, sa sœur[2] ; qu’elle en avait été assez contente pour ne pas chercher parti ailleurs ; que ceux qui la connaissaient savaient pourtant bien qu’elle ne se satisfaisait pas de si peu de chose et que, puisqu’elle ne s’était pas plainte, c’était une marque qu’il valait mieux qu’on ne disait.
Il y en eut qui voulurent dire que cette raison n’était pas convaincante et qu’une femme qui avait pris un mari à quatre-vingt-quinze ou seize ans n’était pas partie capable d’en juger ; mais ceux qui connaissaient son tempérament leur imposèrent silence et soutinrent qu’elle s’y connaissait mieux que personne.
Le chevalier de Tilladet fut un peu démonté par cette réponse ; néanmoins il dit encore beaucoup de choses pour soutenir son droit, et, entre autres, qu’il avait eu affaire à Manicamp et qu’il n’avait pas éprouvé cette grande vigueur dont il faisait tant de parade. On fut obligé de l’en croire sur sa parole, et il s’éleva un murmure dans la compagnie qui fit juger à Manicamp que son affaire n’irait pas bien. Quand ce murmure fut apaisé, le chevalier de Tilladet reprit la parole et dit qu’à l’égard du duc de Grammont il y avait un péché originel qui l’excluait de ses prétentions : qu’il aimait trop sa femme, et que, comme cela était incompatible avec la chose dont il s’agissait, il n’avait point d’autres reproches à faire contre lui.
Le duc de Grammont, qui ne s’attendait pas à cette insulte, ne balança point un moment sur la réponse qu’il avait à faire ; et comme il savait qu’il n’y a rien de tel que de dire la vérité, il avoua de bonne foi que cela avait été autrefois, mais que cela n’était plus. La raison qu’il en rapporta fut qu’il s’était mépris à son tempérament ; qu’il avait attribué les faveurs qu’il en avait obtenues avant son mariage au penchant qu’elle avait pour lui ; mais que celles qu’elle avait données depuis à son valet de chambre lui ayant fait connaître qu’il était impossible de répondre d’une femme, il lui avait si bien ôté son amitié qu’il lui avait fait succéder le mépris ; que c’était pour cela qu’il avait renoncé à l’amour du beau sexe, lequel avait eu autrefois son étoile, et qui l’aurait peut-être encore si l’on pouvait prendre quelque confiance ; que, quoiqu’il fût fils d’un père et cadet d’un frère[3] qui avaient eu tous deux de grandes parties pour obtenir les plus hautes dignités de l’Ordre, il était cependant moins redevable de son mérite à ce qu’il avait hérité d’eux qu’à son dépit ; que Dieu se servait de toutes choses pour attirer à la perfection ; qu’ainsi, bien loin de murmurer contre sa Providence pour les sujets de chagrin qu’il lui envoyait, il avouait tous les jours qu’il lui en était bien redevable.
Le chevalier de Tilladet n’eut rien à répondre à cela, et chacun crut que l’humilité du duc de Grammont, jointe à une si grande sincérité, ferait faire réflexion aux avantages qu’il avait par-dessus les autres, soit pour les charmes de sa personne ou pour le rang qu’il tenait. En effet, il allait obtenir tout d’une voix la chose pour laquelle on était alors assemblé, si le comte de Tallard[4] ne se fût avisé de dire que l’Ordre allait devenir trop fameux pour n’avoir qu’un grand maître ; que tous trois étaient dignes de cette charge, et qu’à l’exemple de celui de Saint-Lazare, où l’on venait d’établir plusieurs grands prieurs, on ne pouvait manquer de les choisir tous trois.
Chacun, qui prétendait à son tour de parvenir à cette dignité, approuva cette opinion ; mais comme on fit réflexion que dans quelques établissements que ce soit, c’est dans les commencements où l’on a particulièrement besoin d’esprit, on résolut de faire choix d’un quatrième, parce que les trois autres n’étaient pas soupçonnés de pouvoir jamais faire une hérésie nouvelle. Le choix tomba sur le marquis de Biran[5], homme qui avait plus d’esprit qu’il n’était gros, mais dont la trop grande jeunesse l’eût exclu de cet honneur sans le besoin qu’on en avait. D’abord que l’élection fut faite, on les pria de travailler tous quatre aux règles de l’Ordre, dont le principal but consistait de bannir les femmes de leur compagnie. Pour pouvoir vaquer à une chose si sainte, ils quittèrent non seulement la cour, mais encore la ville de Paris, où ils craignaient de recevoir quelque distraction, et, étant enfermés dans une maison de campagne, ils donnèrent rendez-vous aux autres, deux jours après, leur promettant qu’il ne leur en fallait pas davantage pour être inspirés. En effet, chacun les étant allé trouver au bout de ce temps-là, on trouva qu’ils avaient rédigé ces règles par écrit, dont voici les articles :
I.
Qu’on ne recevrait plus dorénavant dans l’Ordre des personnes qui ne fussent visitées par les grands maîtres, pour voir si toutes les parties de leur corps étaient saines, afin qu’elles pussent supporter les austérités.
II.
Qu’ils feraient vœu d’obéissance et de chasteté à l’égard des femmes, et que si aucun y contrevenait, il serait chassé de la compagnie, sans pouvoir y rentrer sous quelque prétexte que ce fût.
III.
Que chacun serait admis indifféremment dans l’Ordre, sans distinction de qualité, laquelle n’empêchait point qu’on ne se soumit aux rigueurs du noviciat qui durerait jusqu’à ce que la barbe fût venue au menton.
IV.
Que si aucun des frères se mariait, il serait obligé de déclarer que ce n’était que pour le bien de ses affaires, ou parce que ses parents l’y obligeaient, ou parce qu’il fallait laisser un héritier. Qu’il ferait serment en même temps de ne jamais aimer sa femme, de ne coucher avec elle que jusqu’à ce qu’il en eût un, et que cependant il en demanderait permission, laquelle ne pourrait lui être accordée que pour un jour de la semaine.
V.
Qu’on diviserait les frères en quatre classes, afin que chaque grand prieur en eût autant l’un que l’autre. Et qu’à l’égard de ceux qui se présenteraient pour entrer dans l’Ordre, les quatre grands prieurs les auraient à tour de rôle, afin que la jalousie ne pût donner atteinte à leur union.
VI.
Qu’on se dirait les uns aux autres tout ce qui se serait passé en particulier, afin que quand il viendrait une charge à vaquer, elle ne s’accordât qu’au mérite, lequel serait reconnu par ce moyen.
VII.
Qu’à l’égard des personnes indifférentes, il ne serait pas permis de leur révéler les mystères, et que quiconque le ferait en serait privé lui-même pendant huit jours, et même davantage, si le grand maître dont il dépendrait le jugeait à propos.
VIII.
Que néanmoins l’on pourrait s’ouvrir à ceux qu’on aurait espérance d’attirer dans l’Ordre ; mais qu’il faudrait que ce fût avec tant de discrétion, que l’on fût sûr du succès avant que de faire cette démarche.
IX.
Que ceux qui amèneraient des frères au couvent jouiraient des mêmes prérogatives, pendant deux jours, dont les grands maîtres jouissaient ; bien entendu, néanmoins, qu’ils laisseraient passer les grands maîtres devant et se contenteraient d’avoir ce qu’on aurait desservi de dessus leur table.
C’est ainsi que les règles de l’Ordre furent dressées, et ayant été lues en présence de tout le monde, elles furent approuvées généralement, à la réserve que quelques-uns furent d’avis qu’on apportât quelque tempérament à l’égard des femmes, crime qu’ils voulaient n’être pas traité à la dernière rigueur, mais pour lequel ils souhaitaient qu’on pût obtenir grâce, après néanmoins qu’on l’aurait demandé en plein chapitre et observé quelque forme de pénitence. Mais tous les grands maîtres se trouvèrent si zélés que ceux qui avaient ouvert cette opinion pensèrent être chassés sur-le-champ, et s’ils n’avaient témoigné un grand repentir, on ne leur aurait jamais pardonné leur faute.
On célébra dans cette maison de campagne de grandes réjouissances pour être venu à bout si facilement d’une si grande entreprise, et après bien des choses qui se passèrent, et qu’il est bon de taire, on convint que les chevaliers porteraient une croix entre la chemise et le justaucorps, où il y aurait élevé en bosse un homme qui foulerait une femme aux pieds, à l’exemple des croix de saint Michel, où l’on voit que ce saint foule aux pieds le démon.
Après qu’on eût accompli ces saints mystères, chacun s’en revint à Paris, et quelqu’un n’ayant pas gardé le secret, il se répandit bientôt un bruit de tout ce qui s’était passé dans cette maison de campagne, de sorte que les uns excités par leur inclination, les autres par la nouveauté du fait, s’empressèrent d’entrer dans l’Ordre.
Un prince, dont il n’est pas permis de révéler le nom, ayant eu ce désir, fut présenté au chapitre par le marquis de Biran, et ayant demandé à être relevé des cérémonies, on lui fit réponse que cela ne se pouvait et qu’il fallait qu’il montrât exemple aux autres. Tout ce qu’on fit pour lui, c’est qu’on lui accorda qu’il choisirait celui des grands maîtres qui lui plairait le plus, et il choisit celui qui l’avait présenté, ce qui fit grand dépit aux autres, qui le voyaient beau, jeune et bien fait.
Cette grâce fut encore suivie d’une autre qu’on lui accorda, savoir : qu’il pourrait choisir de tous les frères celui qui lui serait le plus agréable, dont néanmoins la plupart commencèrent à murmurer, disant que, puisqu’on violait sitôt les règles, tout serait bientôt perverti. Mais on leur fit réponse que ces règles, quelque étroites qu’elles pussent être, pouvaient souffrir quelque modération à l’égard d’une personne de si grande qualité ; que quoiqu’on eût dit qu’elles seraient égales pour tout le monde, c’est qu’on n’avait pas cru qu’il se dût présenter un prince d’un si haut rang ; que, comme à Malte les princes de maison souveraine étaient naturellement chevaliers grand’croix, il était bien juste qu’ils eussent pareillement quelque privilège dans leur Ordre ; autrement qu’ils n’y entreraient pas, ce qui ne leur apporterait pas grand honneur.
On n’eut garde de ne se pas rendre à de si bonnes raisons, et chacun ayant calmé sa colère, on complimenta le prince sur l’avantage qui revenait à l’Ordre d’avoir une personne de sa naissance, et il n’y en eut point qui ne s’offrit à lui donner toute sorte de contentement. Il se montra fort civil envers tout le monde et promit qu’on verrait dans peu qu’il ne serait pas le moins zélé des chevaliers. En effet, il n’eut pas plutôt révélé les mystères à ses amis que chacun se fit un mérite d’entrer dans l’Ordre, de sorte qu’il fut bientôt rempli de toutes sortes d’honnêtes gens.
Mais comme le trop grand zèle est nuisible en toutes choses, le Roi fut bientôt averti de ce qui se passait et que même on avait séduit un autre prince, en qui il prenait encore plus d’intérêt qu’en celui dont je viens de parler. Le Roi, qui haïssait à la mort ces sortes de débauches, voulut beaucoup de mal à tous ceux qui en étaient accusés ; mais eux, qui ne croyaient pas qu’on les en pût convaincre, se présentèrent devant lui comme auparavant, jusqu’à ce que, s’étant informé plus particulièrement de la chose, il en relégua quelques-uns dans des villes éloignées de la cour, fit donner le fouet à un de ces princes en sa présence, envoya l’autre à Chantilly, et enfin témoigna une si grande aversion pour tous ceux qui y avaient trempé que personne n’osa parler pour eux.
Le chevalier de Tilladet, qui était cousin germain du marquis de Louvois, se servit de la faveur de ce ministre pour obtenir sa grâce, et lui protesta si bien qu’il était innocent qu’il en fut parler à l’heure même à Sa Majesté. Mais Elle, qui ne croyait pas légèrement, ne s’en voulut pas rapporter à ce qu’il lui disait et remit à lui faire réponse quand il en serait instruit plus particulièrement. Pour cet effet, il fit appeler le jeune prince qui avait eu le fouet, et lui ayant commandé, en présence du marquis de Louvois, de lui dire la vérité, le marquis de Louvois fut si fâché d’entendre que le chevalier de Tilladet lui avait menti, qu’il s’en fut du même pas lui dire tout ce que la rage et le dépit étaient capables de lui inspirer.
Il n’y eut que le duc de Grammont à qui le Roi ne parla de rien, comme s’il n’eût pas été du nombre ; ce qui donna lieu de murmurer aux parents des exilés, qui étaient fâchés de le voir rester à Paris pendant que les autres s’en allaient dans le fond des provinces. Mais le Roi, sachant leur mécontentement, dit qu’ils ne devaient pas s’en étonner ; qu’il y avait longtemps que le duc de Grammont lui était devenu si méprisable que tout ce qu’il pouvait faire lui était indifférent, de sorte que ce serait lui faire trop d’honneur que d’avoir quelque ressentiment contre lui. La cour était trop peste pour cacher au duc une réponse comme celle-là, et au lieu qu’il tirait vanité auparavant d’avoir été oublié, il eut tant de sujet de s’en affliger que tout autre que lui en serait mort de douleur.
La cabale fut dissipée par ce moyen ; mais, quelque pouvoir qu’eût le Roi, il lui fut impossible d’arracher de l’esprit de la jeunesse la semence de débauche qui y était trop fortement enracinée pour être sitôt éteinte. Cependant, les dames firent de grandes réjouissances de ce qui venait d’arriver, et, quelques-unes des croix de ces chevaliers étant tombées entre leurs mains, elles les jugèrent dignes du feu, quoique ce fût une faible vengeance pour elles. Après cela, elles crurent que cette jeunesse serait obligée de revenir à elles ; mais elle se jeta dans le vin, de sorte que tous les jours on ne faisait qu’entendre parler de ses excès.
Cependant, quelque débauche qu’elle fît, pas une n’approcha de celle qui fut faite dans un honnête lieu où, après avoir traité à la mode d’Italie celles des courtisanes qui lui parurent les plus belles, elle en prit une par force, lui attacha les bras et les jambes aux quenouilles du lit, puis lui ayant mis une fusée dans un endroit que la bienséance ne me permet pas de nommer, elle y mit le feu impitoyablement, sans être touchée des cris de cette misérable, qui se désespérait. Après une action si enragée, elle poussa sa brutalité jusqu’au dernier excès : elle courut les rues toute la nuit, brisant un nombre infini de lanternes et ne s’arrêtant que sur le pont de bois qui aboutit dans l’île, où, pour comble de fureur, ou pour mieux dire d’impiété, elle arracha le crucifix qui était au milieu ; de quoi n’étant pas encore contente, elle tâcha de mettre le feu au pont dont elle ne put venir à bout.
Un excès si abominable fit grand bruit dans Paris ; on l’attribua à des laquais, ne croyant pas que des gens de qualité fussent capables d’une chose si épouvantable ; mais la femme chez qui ils avaient fait la débauche étant venue trouver M. Colbert le lendemain, sous prétexte de lui présenter un placet, lui dit que, s’il ne lui faisait justice de son fils le chevalier, qui était fourré des plus avant, elle allait se jeter aux pieds du Roi et lui apprendre que ceux-là qui avaient servi de bourreaux à la fille étaient les mêmes qui avaient arraché le crucifix ; elle ajouta qu’elle les avait suivis à la piste, dans le dessein de les faire arrêter par le guet, mais que malheureusement il s’était déjà retiré.
M. Colbert n’eut pas de peine à croire cela de son fils[6], qui lui avait déjà fait d’autres pièces de cette nature : et comme il appréhendait sur toutes choses que cela ne vint aux oreilles du Roi, non seulement il prit soin de la fille, mais il empêcha encore sous main qu’on ne fit une perquisition exacte de ce qui était arrivé la nuit. Mais quelque précaution qu’il eût, la chose pensa éclater lorsqu’il y pensait le moins. Un laquais de ces débauchés fut pris, deux ou trois mois après, pour vol ; et étant menacé par Deffita, lieutenant criminel, d’être appliqué à la question s’il ne révélait tous les crimes qu’il pourrait avoir commis, il avoua de bonne foi que pas un ne lui faisait tant de peine que d’avoir aidé au chevalier Colbert à arracher le crucifix dont nous avons parlé ; qu’il en demandait pardon à Dieu, et qu’il croyait que c’était pour cela qu’il le punissait. Mais il en arriva tout autrement, et ce fut au contraire la cause de son salut ; car Deffita, qui était homme à faire sa cour au préjudice de sa conscience, s’en fut trouver au même temps M. Colbert, et lui demanda ce qu’il voulait qu’il fit du prisonnier, après lui avoir insinué toutefois, auparavant, qu’il était dangereux qu’il ne parlât si on le faisait mourir. M. Colbert le remercia du soin qu’il avait de sa famille et, l’ayant prié de sauver ce misérable, il le rendit blanc comme neige, quoiqu’il méritât mille fois plutôt d’être roué.

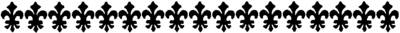
NOTE
Les nobles protagonistes de cet amour ultramontain ont été chansonnés « en famille » dans les couplets suivants :
Contre les bougres de France,
Pon patapon tarare pon pon,
Nous verrons au premier jour,
À la ville et à la Cour,
Publier cette défense,
Pon patapon tarare pon pon.
On suit de bien près la piste
De tous les anticonistes,
Pon patapon tarare pon pon,
Les Dames, dans leur chagrin,
Travaillent soir et matin
Pour en composer la liste,
Pon patapon tarare pon pon.
Gramont fait une partie
Pour aller en Italie,
Pon patapon tarare pon pon,
Ceux qui furent du repas
Y suivront bientôt ses pas,
Pon patapon tarare pon pon.
Dans ce repas agréable
L’amiral devint traitable,
Pon patapon tarare pon pon.
Des convives secondé,
Se leva bientôt de table,
Pon patapon tarare pon pon.
Après certain badinage,
L’amiral tourna visage,
Pon patapon tarare pon pon.
Celui qui fut son vainqueur
En reçut beaucoup d’honneur,
Chacun lui rendit hommage,
Pon patapon tarare pon pon.
Biran, dont la beauté brille,
Surtout lorsqu’il est en fille,
Pon patapon tarare pon pon,
Voudrait, pour tous ses appas,
Avoir été du repas :
Il eût conduit le quadrille,
Pon patapon tarare pon pon.
Louvois, qui prend son parti,
En aura le démenti,
Car il est sur le mémoire,
Pon patapon tarare pon pon.
Les Roncis ont mis leur père
Dans une extrême colère,
Pon patapon tarare pon pon,
On peut bien, dit-il, choisir
De l’un ou l’autre plaisir,
Pourvu qu’on sache se taire,
Pon patapon tarare pon pon.
Mailly, sans cette aventure,
Était en bonne figure,
Pon patapon tarare pon pon.
Il est au rang des proscrits,
Son frère a, dans ses écrits,
Un secret pour la brûlure,
Pon patapon tarare pon pon.
La Ferté, dans son jeune âge,
Était amoureux d’un page,
Pon patapon tarare pon pon.
Mais une nouvelle amour
Fait qu’on le souffre à la Cour.
Biran dit qu’il n’est pas sage,
Pon patapon tarare pon pon.
Mimur était sans reproche,
Mais enfin on le chevauche,
Pon patapon tarare pon pon.
Il est déchu par malheur
Du titre d’enfant d’honneur ;
Il est enfant de débauche,
Pon patapon tarare pon pon[7].

- ↑ Au livre premier de l’Histoire amoureuse des
Gaules, Bussy-Rabutin trace de Manicamp un long
portrait, au cours duquel il dit que le comte de Guiche
et lui s’aimaient fortement, « comme s’ils eussent été
de différents sexes ».
Le duc de Grammont, fils du maréchal et frère du comte de Guiche. Il épousa, le 15 mai 1668, Marie-Charlotte de Castelnau, fille du maréchal de ce nom.
Gabriel de Cassagnet, dit le chevalier de Tilladet, chevalier de Malte en 1646, fut lieutenant général des armées du roi et gouverneur d’Aire. Il mourut en 1702.
- ↑ Gabrielle de Longueval, sœur du marquis de Manicamp, était la troisième femme du maréchal d’Estrées ; elle avait épousé en 1663 le vieux duc, qui mourut en 1670. Elle-même mourut dix-sept ans plus tard, en 1687.
- ↑ Le comte de Guiche, frère du duc de Grammont, « avait une beauté du premier choix parmi celles qui ne sont pas viriles ». Il fut surtout l’ami préféré du duc d’Anjou et de Manicamp. On l’avait marié à Mlle de Béthune, petite-fille de Séguier, âgée de 13 ans ; mais il ne consentit jamais à feindre de l’aimer et l’abandonna. Il mourut en 1673. La Comtesse d’Olonne, comédie attribuée à Bussy-Rabutin, confirme l’accusation de sodomie portée contre le comte de Guiche.
- ↑ Camille d’Hostun, duc de Haston, marquis de La Beaune, comte de Tallard, né en 1652. Il est question de lui dans l’Histoire de la maréchale de La Ferté, une autre partie de l’Histoire amoureuse des Gaules.
- ↑ Gaston-Jean-Baptiste-Antoine de Roqueraule, fils de Gaston, duc de Roqueraule, et de Mlle du Lude, porta le nom de marquis de Biran jusqu’à la mort de son père, en mars 1683. Il fut nommé maréchal de France le 2 février 1724.
- ↑ C’était le troisième fils de Jean-Baptiste Colbert et de Marie Charron. Il faisait partie, avec Biran, d’une bande de jeunes débauchés, terreur des filles de joie. Dans La France galante ou Histoires amoureuses de la Cour, Bussy Rabutin conte un autre exploit de ces débauchés : « Ils firent en ce temps-là une débauche qui alla un peu trop loin et qui fit beaucoup de bruit et à la Cour et dans la ville ; car, après avoir passé toute la journée chez des courtisanes où ils avaient fait mille désordres, ils furent souper aux Cuillers, dans la rue aux Ours. Ils se prirent là de vin, et, étant soûls, pour ainsi dire, comme des cochons, ils firent monter un oublieur, à qui ils coupèrent les parties viriles et les lui mirent dans son corbillon. Ce pauvre malheureux, se voyant entre les mains de ces satellites, alarma non seulement toute la maison, mais encore toute la rue par ses cris et ses lamentations ; mais, quoiqu’il survînt beaucoup de monde qui les voulait détourner d’un coup si inhumain, ils n’en voulurent rien démordre et l’opération étant faite, ils renvoyèrent le malheureux oublieur, qui s’en alla mourir chez son maître. »
- ↑ Chansonnier Maurepas, XXV, 251.
