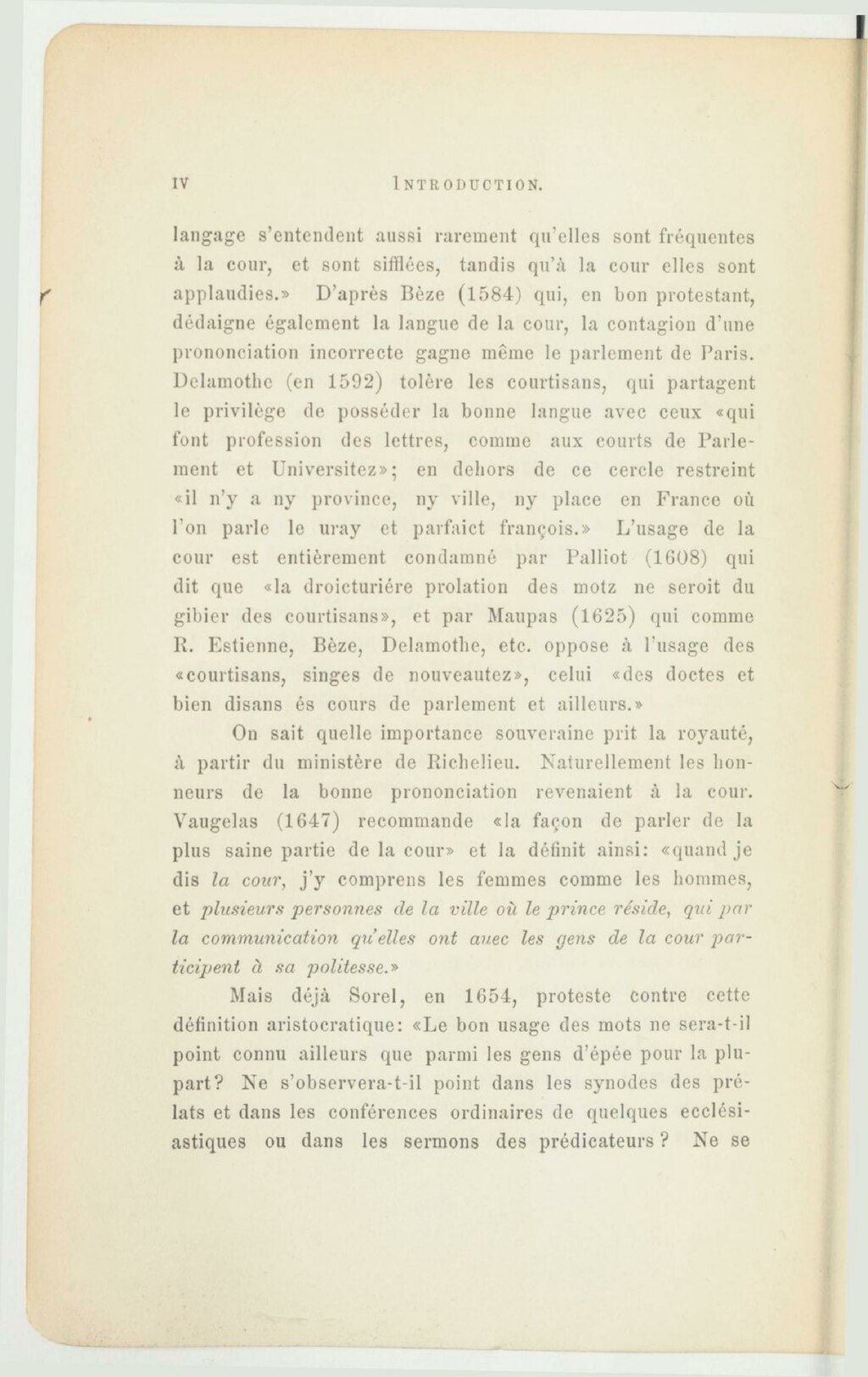langage s’entendent aussi rarement qu’elles sont fréquentes à la cour, et sont sifflées, tandis qu’à la cour elles sont applaudies.» D’après Bèze (1584) qui, en bon protestant, dédaigne également la langue de la cour, la contagion d’une prononciation incorrecte gagne même le parlement de Paris. Delamothe (en 1592) tolère les courtisans, qui partagent le privilège de posséder la bonne langue avec ceux «qui font profession des lettres, comme aux courts de Parlement et Universtiez»; en dehors de ce cercle restreint «il n’y a ny province, ny ville, ny place en France où l’on parle le uray et parfaict françois.» L’usage de la cour est entièrement condamné par Palliot (1608) qui dit que la «droicturiére prolation des motz ne seroit du gibier des courtisans», et par Maupas (1625) qui comme R. Estienne, Bèze, Delamothe, etc. oppose à l’usage des «courtisans, singes de nouveautez», celui «des doctes et bien disans és cours de parlement et ailleurs.»
On sait quelle importance souveraine prit la royauté, à partir du ministère de Richelieu. Naturellement les honneurs de la bonne prononciation revenaient à la cour. Vaugelas (1647) recommande «la façon de parler de la plus saine partie de la cour» et la définit ainsi: «quand je dis la cour, j’y comprens les femmes comme les hommes, et plusieurs personnes de la ville où le prince réside, qui par la communication qu’elles ont auec les gens de la cour participent à sa politesse.»
Mais déjà Sorel, en 1654, proteste contre cette définition aristocratique: «Le bon usage des mots ne sera-t-il point connu ailleurs que parmi les gens d’épée pour la plupart? Ne s’observera-t-il point dans les synodes des prélats et dans les conférences ordinaires de quelques ecclésiastiques ou dans les sermons des prédicateurs? Ne se