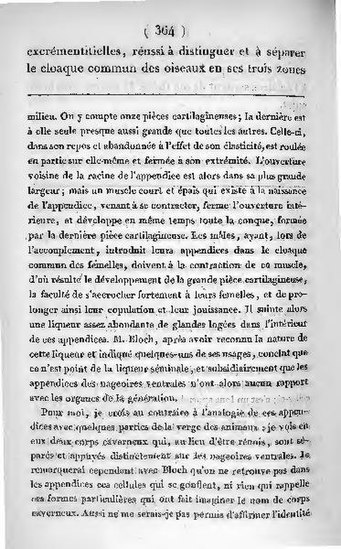excrémentitielles, réussi à distinguer et à séparer le cloaque commun des oiseaux en ses trois zones
milieu. On y compte onze pièces cartilagineuses ; la dernière est à elle seule presque aussi grande que toutes les autres. Celle-ci, dans son repos et abandonnée à l’effet de son élasticité, est roulée en partie sur elle-même et fermée à son extrémité. L’ouverture voisine de la racine de l’appendice est alors dans sa plus grande largeur ; mais un muscle court et épais qui existe à la naissance de l’appendice, venant à se contracter, ferme l’ouverture intérieure, et développe en même temps toute la conque, formée par la dernière pièce cartilagineuse. Les mâles, ayant, lors de l’accouplement, introduit leurs appendices dans le cloaque commun des femelles, doivent à la contraction de ce muscle, d’où résulte le développement de la grande pièce cartilagineuse, la faculté de s’accrocher fortement à leurs femelles, et de prolonger ainsi leur copulation et leur jouissance. Il suinte alors une liqueur assez abondante de glandes logées dans l’intérieur de ces appendices. M. Bloch, après avoir reconnu la nature de cette liqueur et indiqué quelques-uns de ses usages, conclut que ce n’est point de la liqueur séminale, et subsidiairement que les appendices des nageoires ventrales n’ont alors aucun rapport avec les organes de la génération.
« Pour moi, je crois au contraire à l’analogie de ces appendices avec quelques parties de la verge des animaux : je vois en eux deux corps caverneux qui, au lieu d’être réunis, sont séparés et appuyés distinctement sur les nageoires ventrales. Je remarquerai cependant avec Bloch qu’on ne retrouve pas dans les appendices ces cellules qui se gonflent, ni rien qui rappelle ces formes particulières qui ont fait imaginer le nom de corps caverneux. Aussi ne me serais-je pas permis d’affirmer l’identité