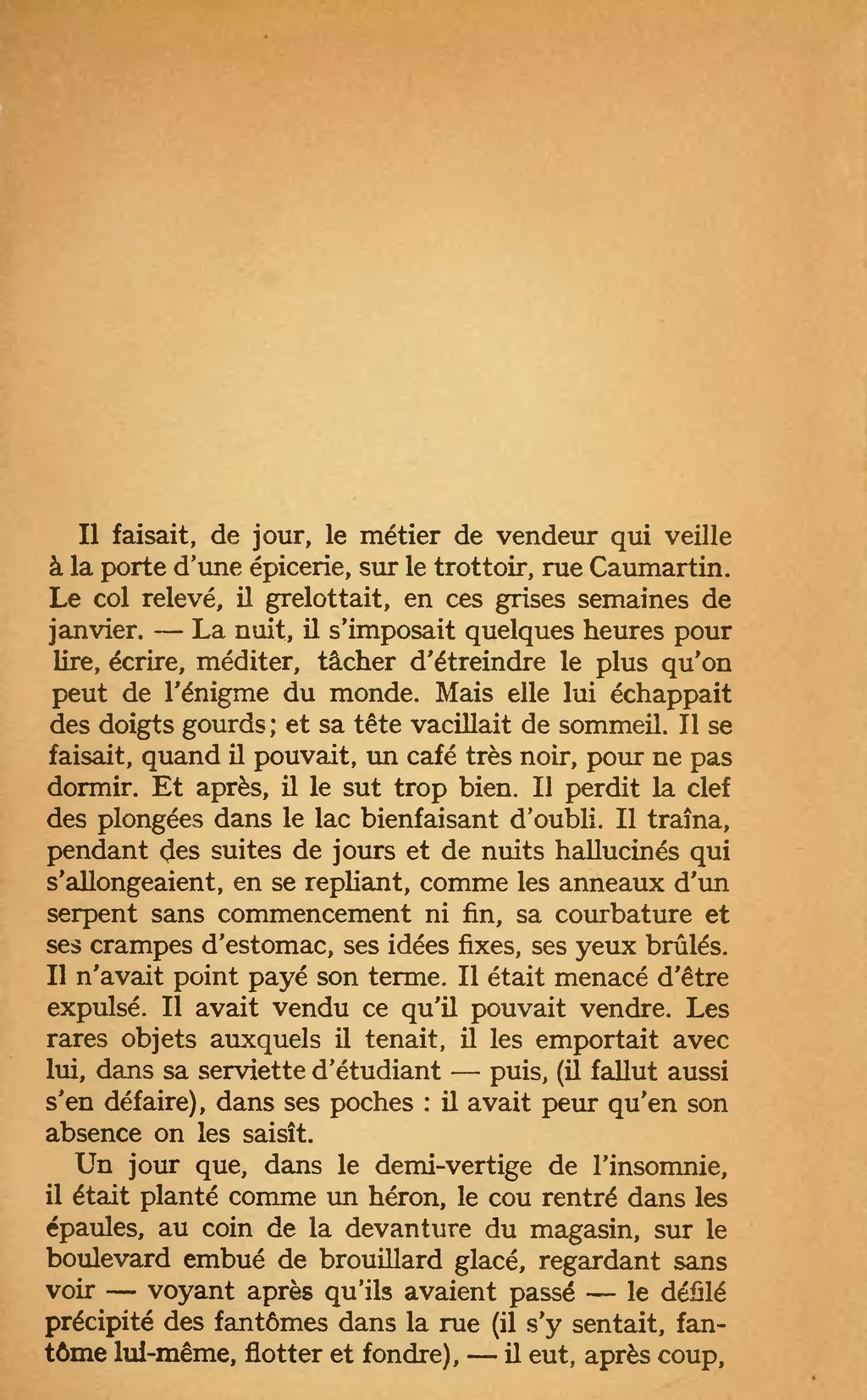Il faisait, de jour, le métier de vendeur qui veille à la porte d’une épicerie, sur le trottoir, rue Caumartin. Le col relevé, il grelottait, en ces grises semaines de janvier. — La nuit, il s’imposait quelques heures pour lire, écrire, méditer, tâcher d’étreindre le plus qu’on peut de l’énigme du monde. Mais elle lui échappait des doigts gourds ; et sa tête vacillait de sommeil. Il se faisait, quand il pouvait, un café très noir, pour ne pas dormir. Et après, il le sut trop bien. Il perdit la clef des plongées dans le lac bienfaisant d’oubli. Il traîna, pendant des suites de jours et de nuits hallucinés qui s’allongeaient, en se repliant, comme les anneaux d’un serpent sans commencement ni fin, sa courbature et ses crampes d’estomac, ses idées fixes, ses yeux brûlés. Il n’avait point payé son terme. Il était menacé d’être expulsé. Il avait vendu ce qu’il pouvait vendre. Les rares objets auxquels il tenait, il les emportait avec lui, dans sa serviette d’étudiant — puis, (il fallut aussi s’en défaire), dans ses poches : il avait peur qu’en son absence on les saisît.
Un jour que, dans le demi-vertige de l’insomnie, il était planté comme un héron, le cou rentré dans les épaules, au coin de la devanture du magasin, sur le boulevard embué de brouillard glacé, regardant sans voir — voyant après qu’ils avaient passé — le défilé précipité des fantômes dans la rue (il s’y sentait, fantôme lui-même, flotter et fondre), — il eut, après coup,