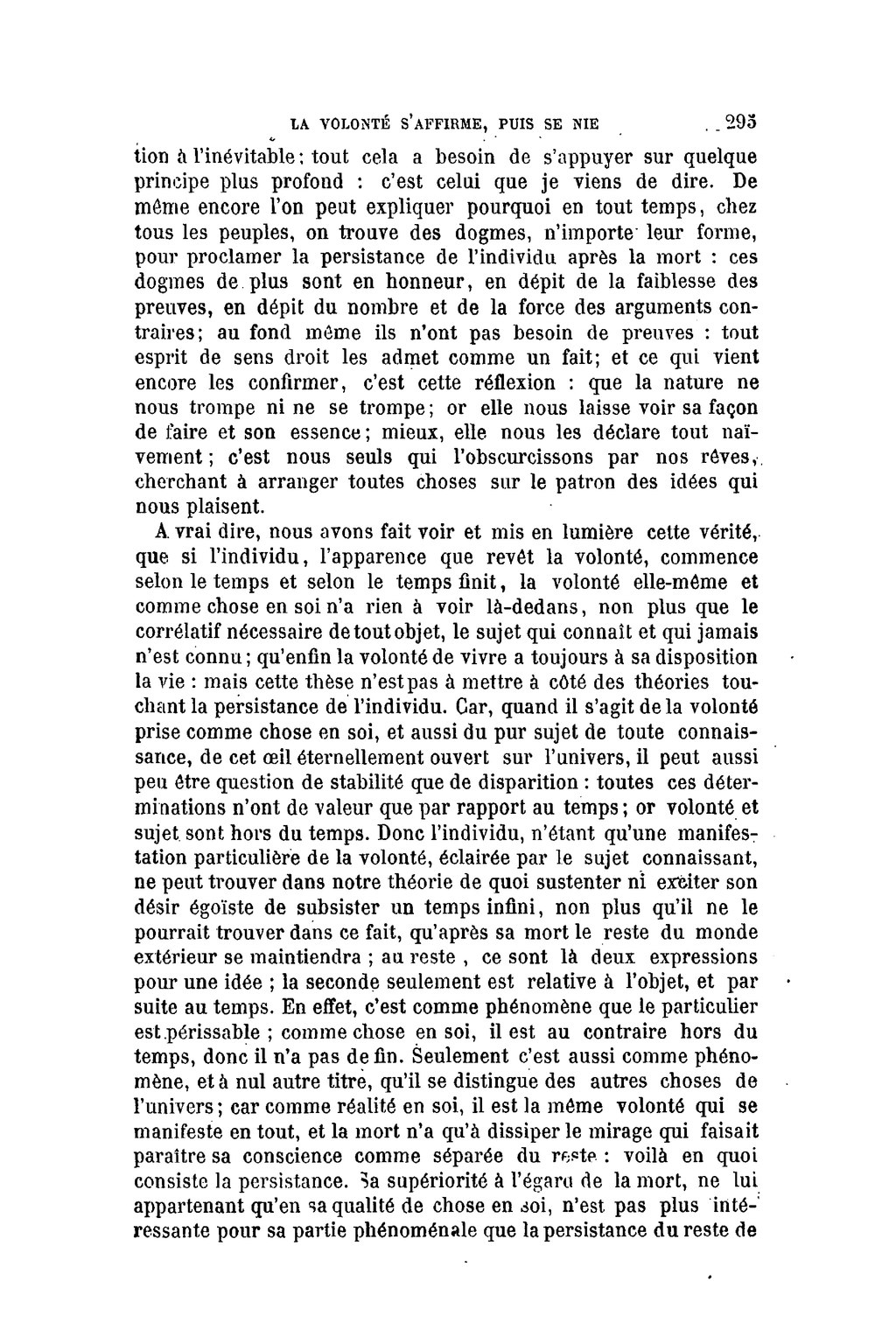tion à l’inévitable : tout cela a besoin de s’appuyer sur quelque principe plus profond : c’est celui que je viens de dire. De même encore l’on peut expliquer pourquoi en tout temps, chez tous les peuples, on trouve des dogmes, n’importe leur forme, pour proclamer la persistance de l’individu après la mort : ces dogmes de plus sont en honneur, en dépit de la faiblesse des preuves, en dépit du nombre et de la force des arguments contraires ; au fond même ils n’ont pas besoin de preuves : tout esprit de sens droit les admet comme un fait ; et ce qui vient encore les confirmer, c’est cette réflexion : que la nature ne nous trompe ni ne se trompe ; or elle nous laisse voir sa façon de faire et son essence ; mieux, elle nous les déclare tout naïvement ; c’est nous seuls qui l’obscurcissons par nos rêves, cherchant à arranger toutes choses sur le patron des idées qui nous plaisent.
A vrai dire, nous avons fait voir et mis en lumière cette vérité, que si l’individu, l’apparence que revêt la volonté, commence selon le temps et selon le temps unit, la volonté elle-même et comme chose en soi n’a rien à voir là-dedans, non plus que le corrélatif nécessaire de tout objet, le sujet qui connaît et qui jamais n’est connu ; qu’enfin la volonté de vivre a toujours à sa disposition la vie : mais cette thèse n’est pas à mettre à côté des théories touchant la persistance de l’individu. Car, quand il s’agit de la volonté prise comme chose en soi, et aussi du pur sujet de toute connaissance, de cet œil éternellement ouvert sur l’univers, il peut aussi peu être question de stabilité que de disparition : toutes ces déterminations n’ont de valeur que par rapport au temps ; or volonté et sujet sont hors du temps. Donc l’individu, n’étant qu’une manifestation particulière de la volonté, éclairée par le sujet connaissant, ne peut trouver dans notre théorie de quoi sustenter ni exciter son désir égoïste de subsister un temps infini, non plus qu’il ne le pourrait trouver dans ce fait, qu’après sa mort le reste du monde extérieur se maintiendra ; au reste, ce sont là deux expressions pour une idée ; la seconde seulement est relative à l’objet, et par suite au temps. En effet, c’est comme phénomène que le particulier est périssable ; comme chose en soi, il est au contraire hors du temps, donc il n’a pas de fin. Seulement c’est aussi comme phénomène, et à nul autre titre, qu’il se distingue des autres choses de l’univers ; car comme réalité en soi, il est la même volonté qui se manifeste en tout, et la mort n’a qu’à dissiper le mirage qui faisait paraître sa conscience comme séparée du reste ; voilà en quoi consiste la persistance. Sa supériorité à l’égard de la mort, ne lui appartenant qu’en sa qualité de chose en soi, n’est pas plus intéressante pour sa partie phénoménale que la persistance du reste de