Les Merveilles de la science/La Photographie

Il y a bien des motifs divers pour aimer, pour admirer cette invention brillante de la photographie, qui sera l’honneur de ce siècle et la gloire de notre patrie. Mais parmi les titres si nombreux qui la désignent à nos hommages, il en est un qui frappe surtout : c’est le témoignage éclatant qu’elle a fourni, de la puissance et de la haute portée des sciences physiques à notre époque. Si l’on demandait quelque preuve irrécusable de la valeur des méthodes scientifiques actuelles, et des résultats auxquels peut conduire leur application, il ne faudrait pas chercher cette preuve ailleurs que dans la découverte de la photographie et dans la série admirable de ses perfectionnements successifs. Où trouver, en effet, un plus merveilleux enchaînement de créations fécondes ? Il y a trois siècles, un physicien napolitain, Jean-Baptiste Porta, imagina la chambre obscure. En plaçant une lentille convergente au devant de l’orifice percé sur l’une des parois d’une boîte fermée, on obtenait, sur un écran placé à l’intérieur, la reproduction exacte de toutes les vues environnantes. Dans cet espace étroit venaient se peindre, avec une fidélité et une précision extraordinaires, le spectacle changeant, les aspects variés, du paysage extérieur. Mais ces tableaux si parfaits n’étaient qu’une fugitive empreinte, qui s’évanouissait avec la clarté du jour. Trois siècles durant, on les considéra d’un œil d’envie, avec le regret de n’en pouvoir fixer la trace éphémère : le petit nombre de physiciens qui, dans ce long intervalle, avaient essayé d’aborder un tel problème, avaient reculé tout aussitôt, effrayés et comme honteux de leur audace. Plus tard, la physique et la chimie naissantes vinrent s’exercer tour à tour sur cet objet difficile. Le physicien Wedgwood, le chimiste Humphry Davy, tentèrent de mettre à profit, pour fixer et conserver les images de la chambre obscure, la modification que les composés d’argent subissent au contact des rayons lumineux. Mais Wedgwood et Davy furent contraints l’un après l’autre d’abandonner l’entreprise.
Tout espoir sous ce rapport semblait donc à jamais perdu, lorsque tout à coup vint à circuler un bruit étrange. Un homme s’était rencontré qui avait résolu le problème extraordinaire de fixer à jamais les dessins de la chambre obscure. Cet homme, cet artiste habile s’il en fut, c’était Daguerre. Jamais la science n’avait remporté une aussi brillante victoire ; jamais preuve aussi merveilleuse de son pouvoir n’était venue s’offrir à l’admiration de tous. On ne peut se faire une idée du concert d’acclamations enthousiastes qu’excita l’annonce de cette découverte imprévue.
Tout n’était pas dit néanmoins, car bientôt la rapide série des perfectionnements apportés à l’art photographique, vint ajouter encore à l’admiration qu’avaient provoquée ses débuts.
Quand les produits du daguerréotype furent connus pour la première fois, c’est à peine si l’on osait s’attendre à les voir s’enrichir de quelques progrès importants. Cet étrange problème de fixer l’image des objets extérieurs par l’action spontanée de la lumière, paraissait alors résolu d’une manière si complète, qu’exiger des perfectionnements nouveaux, semblait, à cette époque, une injustice et comme une offense envers l’inventeur. Cependant, les améliorations progressivement apportées à la méthode primitive, changèrent peu à peu la face entière de la photographie ; de telle sorte que les résultats obtenus à l’origine, ne devaient plus être considérés que comme les ébauches de l’art.
L’empreinte du dessin photographique, d’abord si légère et si fugace que le souffle d’un enfant aurait suffi pour l’enlever, fut bientôt fixée d’une manière inaltérable. Le miroitement métallique, qui ôtait tant de charme à ces images, disparut en grande partie, et le trait acquit, en même temps, une netteté incomparable. Grâce aux procédés électro-chimiques, l’or, le cuivre ou l’argent, déposés en minces pellicules, prêtèrent des tons séduisants à ces petits tableaux. Grâce à l’emploi des agents accélérateurs, les épreuves qui, au début, exigeaient un quart d’heure d’exposition à la lumière, purent s’obtenir en quelques secondes.
Bientôt, cet art, déjà si merveilleux, entra dans une phase nouvelle. Le vœu, tant de fois exprimé, d’obtenir sur le papier les images photographiques, fut rempli avec un entier bonheur, et la découverte de procédés irréprochables pour l’exécution de la photographie sur papier, vint marquer un pas de plus dans cette carrière de précieuses inventions. Vint ensuite la méthode des agrandissements et des réductions, qui permit d’amplifier démesurément une épreuve, ou de la réduire à de si microscopiques dimensions qu’on put porter sur une bague, une image ou un portrait, et que l’on put entendre crier par les rues : La vue photographique de l’Exposition de 1867, sur une tête d’épingle !
Enfin une découverte fondamentale, objet de tous les vœux, est venue terminer cette série de merveilles de l’art. Grâce à l’application des procédés galvanoplastiques, on a transformé en planches propres à la gravure, les épreuves photographiques, et l’on a pu multiplier à volonté ces types, en tirant les épreuves sur la pierre lithographique, ou sur la planche d’acier, comme une gravure ordinaire. Ainsi a été atteint le comble et la dernière limite de cet art.
Tout est surprenant, tout est merveilleux dans les mille inventions nouvelles qui se rattachent aux perfectionnements de la photographie. La lumière est domptée, le fluide électrique est un serviteur obéissant ; de la lumière on fait un pinceau, et de l’électricité un burin. Partout la main de l’homme est bannie. À la main tremblante de l’artiste, au regard incertain, à l’instrument rebelle, on substitue les forces irrésistibles des agents naturels. C’est ainsi que les puissances aveugles de la nature tendent à remplacer la main et presque l’intelligence de l’homme.
Rien ne peut donc mieux caractériser la haute portée de nos sciences physiques, que cette rapide série de créations et de perfectionnements, qui, en quelques années, ont conduit la photographie à des résultats qu’il était à peine permis de soupçonner au début. Cette découverte, la plus curieuse de notre siècle, est encore celle qui fait le mieux apprécier le pouvoir et les ressources de la science contemporaine.
Tel est aussi le double motif qui nous porte à présenter avec une certaine étendue les faits qui concernent la photographie. Rappeler les circonstances qui ont présidé à sa découverte, faire connaître les perfectionnements divers qu’elle a reçus depuis son origine, indiquer son état présent, signaler enfin les applications principales qu’elle a déjà reçues, tel est l’objet que nous avons à remplir pour cette notice.
CHAPITRE PREMIER
La lune cornée, ou l’argent corné, en d’autres termes, le chlorure d’argent, fut découvert par les alchimistes, à l’époque de la Renaissance. Ce composé a la propriété essentielle, de se colorer en bleu foncé, quand il reste exposé au soleil, ou à la lumière diffuse. Le premier opérateur qui eut entre les mains, dans un laboratoire, l’argent corné, dut constater aussitôt la modification qu’il subit par l’action des rayons lumineux. D’après Arago, ce serait un alchimiste, nommé Fabricius, qui aurait le premier, en 1566, obtenu l’argent corné, en versant du sel marin dans une dissolution d’un sel d’argent, et qui aurait remarqué la coloration de ce produit, par l’action de la lumière. C’est donc dans le laboratoire d’un alchimiste qu’il faut chercher l’origine historique du principe général de la photographie.
En 1777, le chimiste suédois Schèele reconnut que l’argent corné est plus sensible aux rayons bleus et violets du spectre solaire, qu’aux rayons rouges.
Le professeur Charles, ce même physicien à qui l’aérostation naissante dut, comme nous l’avons raconté, son organisation régulière et tous ses moyens d’action, eut aussi le mérite de faire, le premier, usage de la chambre obscure inventée, au seizième siècle, par J.-B. Porta, pour exécuter des photographies rudimentaires.
Dans les cours publics qu’il donnait, à Paris, vers 1780, Charles montrait aux assistants le curieux spectacle que voici. Il formait une image sur l’écran de la chambre obscure, recouvert d’avance d’une feuille de papier enduite de chlorure d’argent, et les parties lumineuses de l’image s’imprimaient en noir sur le papier. D’autres fois, Charles s’amusait à former la silhouette de l’un des assistants, en plaçant la personne dans un lieu fortement éclairé. L’ombre du modèle se projetait sur l’écran. Une feuille de papier enduite de chlorure d’argent, disposée sur cet écran, recevait la silhouette, qui se maintenait visible tant que la lumière ambiante ne l’avait pas altérée. On se passait de main en main, ce papier qui bientôt, noircissant en entier, offrait un second phénomène aussi curieux que le premier.

C’était là une pure récréation scientifique, et comme le jeu d’une idée pleine d’avenir. D’autres savants eurent à cœur d’étudier plus sérieusement le même phénomène.
Wedgwood, physicien et industriel anglais, bien connu par le pyromètre qui porte son nom et par ses travaux dans l’art de la céramique, copiait, au soleil, le profil d’une personne dont l’ombre était projetée sur un papier enduit d’azotate d’argent. C’était l’expérience de Charles, dans laquelle l’azotate d’argent remplaçait le chlorure. En 1802, parut un mémoire posthume de Wedgwood, dans lequel l’auteur faisait connaître le moyen de copier sur du papier enduit d’azotate d’argent, des estampes et des vitraux d’église.
Humphry Davy essaya, à la suite de Wedgwood, de fixer sur le papier imprégné d’azotate ou de chlorure d’argent, les images de la chambre obscure. Mais l’azotate d’argent était trop peu impressionnable à la lumière ; Davy ne réussit qu’en se servant d’un microscope solaire, c’est-à-dire en éclairant les corps par les rayons du soleil concentrés par une lentille dans une chambre obscure. Seulement les images qu’il formait ainsi, disparaissaient rapidement par l’action ultérieure du jour, car les parties non influencées par la lumière dans la chambre obscure, à leur tour sous l’influence de la lumière diffuse, faisaient disparaître les dessins sous une masse uniformément noire.
« Il ne manque, écrivait Humphry Davy, en parlant du procédé de Wedgwood, qu’un moyen d’empêcher que les parties éclairées du dessin ne soient colorées par la lumière du jour, pour que ce procédé devienne aussi utile qu’il est simple dans son exécution.
« La copie d’un dessin, dès qu’elle est obtenue, ajoutait Humphry Davy, doit être conservée dans un lieu obscur. On peut bien l’examiner à l’ombre, mais ce ne doit être que pour peu de temps. Aucun des moyens que nous avons mis en œuvre pour empêcher les parties incolores de noircir à la lumière n’a pu réussir… Quant aux images de la chambre obscure, elles se sont trouvées trop faiblement éclairées pour former un dessin avec le nitrate d’argent, même au bout d’un temps assez prolongé. C’était là cependant l’objet principal des expériences. Mais tous les essais ont été inutiles[1]. »
Humphry Davy ne fut donc pas plus heureux que ne l’avait été Wedgwood, dans ses tentatives pour rendre inaltérables à l’action ultérieure de la lumière, les images formées dans la chambre obscure, sur le papier imprégné d’un sel d’argent.
Le célèbre James Watt, à qui revient la gloire d’avoir créé, pièce à pièce, la machine à vapeur, en perfectionnant les appareils primitifs de Newcomen et de Savery, s’occupa également du problème de la fixation des images formées dans la chambre obscure sur du papier enduit de chlorure d’argent. On a retrouvé une épreuve photographique sur papier représentant la manufacture de Soho ; mais il n’a pas été possible d’établir avec assez d’exactitude la véritable origine et la date de cette curieuse pièce, pour que l’on puisse faire figurer James Watt parmi les précurseurs de la photographie.
En résumé, toutes ces tentatives n’ont que très-faiblement influé sur la création de la photographie moderne. Elles marquent seulement son origine historique, et font comprendre toutes les difficultés du problème à résoudre. Au temps de Wedgwood et de Davy, la photographie était encore dans les limbes de l’avenir.
CHAPITRE II
Le premier nom que nous ayons à inscrire après ceux de Wedgwood et de Davy, dans l’histoire des premiers temps de la photographie, est celui de Joseph-Nicéphore Niépce.
Né à Chalon-sur-Saône, en 1765, Joseph-Nicéphore Niépce était fils de Claude Niépce, écuyer, receveur des consignations au bailliage de Châlon. Élevé dans une certaine aisance, il avait atteint l’âge de vingt-sept ans sans trop se presser de choisir une profession. Un moment on avait eu la pensée de le faire entrer dans les ordres ecclésiastiques, mais il ne fut pas donné suite à ce projet.
Le 10 mars 1792, Nicéphore Niépce fut admis, en qualité de sous-lieutenant, au régiment de Limousin, plus tard 42e régiment de ligne. Il passa de là, en qualité de lieutenant, au deuxième bataillon de la 83e demi-brigade. Le 6 mai 1793, il partit, avec sa compagnie, pour la Sardaigne, et fit la campagne de Cagliari. Pendant la même année, il entra à l’armée d’Italie. Le 9 mars 1794, il fut attaché à l’état-major du général Frottier.
Il se trouvait à Nice, lorsqu’il fut atteint d’une maladie épidémique qui sévissait sur l’armée et les habitants de la ville, et qui affecta gravement sa vue. Les suites de cette maladie l’obligèrent à abandonner l’état militaire. Il donna sa démission d’officier, le 21 novembre 1794. Peu de temps auparavant, il s’était marié à Nice. Il avait épousé la fille de son hôtesse, mademoiselle Marie Roméro, aux soins intelligents de laquelle il avait dû la vie.
Nicéphore Niépce demeura à Nice après son mariage. Au mois de janvier 1795, lors du renouvellement des autorités de cette ville, alors française, il fut nommé, par les représentants du peuple, commissaires de la Convention, administrateur du district de Nice.
Mais le mauvais état de sa santé l’obligea à se démettre de cette nouvelle fonction. Il loua, à peu de distance de Nice, près du village de Saint-Roch, une maison de campagne, et s’y installa avec sa femme. La tranquillité d’une vie exempte des soucis de la carrière publique, jointe à l’air vivifiant des environs de Nice, lui eut bientôt rendu la santé.
Le bonheur dont jouissait Nicéphore Niépce, fut encore augmenté par l’arrivée imprévue de son frère aîné, Claude Niépce.
Claude Niépce avait embrassé, comme Nicéphore, la carrière militaire. Il s’était embarqué en 1791, comme soldat volontaire, sur un bâtiment de l’État, et avait couru les mers jusqu’en 1794. Au bout de ce temps, il avait quitté le service, et il rejoignait son frère à Nice.
Claude Niépce était un très-habile mécanicien ; de son côté, Joseph-Nicéphore avait l’esprit tourné vers les études scientifiques. Les deux frères firent comme avaient fait, avant eux, les deux Montgolfier : ils mirent en commun leurs idées, leur bourse, leurs espérances, pour se lancer à la poursuite d’inventions mécaniques. Une intimité touchante ne cessa, pendant leur vie entière, de lier ces deux hommes de bien.
Pendant leur séjour à la campagne, dans les environs de Nice, les frères Niépce conçurent l’idée d’une machine, qu’ils nommaient pyréolophore, dans laquelle l’air brusquement chauffé, puis refroidi, devait produire les effets de la vapeur. C’était le principe des machines à air chaud, ou machines d’Ericsson, dont nous avons parlé dans le premier volume de cet ouvrage, et sur lesquelles l’attention des mécaniciens se reporte aujourd’hui d’une manière décidée. On voit que les frères Niépce avaient le pressentiment des grandes choses.
Mais pour se livrer à des expériences mécaniques et entreprendre la construction d’appareils nouveaux, les deux frères étaient mal à l’aise dans un pays étranger pour eux. Le 23 juin 1807, ils revinrent tous les deux à la maison paternelle de Chalon-sur-Saône. Là, ils reprirent le cours de leurs travaux.
Le 3 août 1807, ils obtinrent un brevet d’invention de dix ans, pour leur pyréolophore. Cette machine, qui reposait sur la brusque dilatation de l’air par le calorique, développait une assez grande puissance. Les frères Niépce firent marcher pendant plusieurs jours, un bateau mû par cet appareil, sur les eaux de la Saône, ainsi que sur l’étang de Batterey, situé au milieu du bois de la Charmée, près de la maison de campagne des inventeurs, qui était située à Saint-Loup de Varennes, près de Châlon.
Cette machine fut l’objet d’un rapport flatteur adressé à l’Académie des sciences, par Carnot[2].
Peu de temps après, le gouvernement impérial ayant mis au concours les plans d’une machine hydraulique, destinée à remplacer celle de Marly, qui élevait les eaux de la Seine jusqu’à Versailles, les frères Niépce envoyèrent, pour ce concours, le modèle d’une pompe, qu’ils nommaient hydro-statique, et qui renfermait un marteau d’eau, comme le bélier hydraulique de Montgolfier. Carnot adressa aux frères Niépce une lettre flatteuse à l’occasion de cette nouvelle machine, dont le projet ne fut pas, d’ailleurs, poussé plus loin.
Sous l’Empire, le blocus continental privait la France de la plupart des produits nécessaires à son industrie. Il fallait adresser un appel au génie des inventeurs, pour suppléer, par la fabrication nationale, aux produits du dehors, sévèrement consignés à nos frontières. La plante indigène qui porte le nom de pastel (Isatis tinctoria) peut remplacer l’indigo, matière tirée des Indes, et qui alors manquait totalement en France, par suite de l’interruption des relations commerciales avec le dehors. Le gouvernement encouragea donc la culture du pastel, par un décret du 14 janvier 1813, accordant des primes aux producteurs de cette matière colorante. Les frères Niépce s’adonnèrent, sur leur domaine, à la culture en grand du pastel, et se mirent, à cette occasion, en rapport, par l’intermédiaire du préfet, avec le ministre de l’intérieur, à qui ils faisaient parvenir les produits de leur fabrication.
« La culture du pastel-indigo, dit M. Fouque, dans un ouvrage consacré aux travaux de Joseph-Nicéphore Niépce, sur lequel nous aurons à revenir, a laissé de nombreuses traces dans ce qui constituait autrefois le beau domaine Niépce, aux Gras, commune de Saint-Loup de Varennes. Les jardins de la résidence de cette famille, les champs, voire même les fossés de la grande route, sur une étendue de plusieurs kilomètres, renferment des plants de Pastel soit par groupes plus ou moins nombreux, soit par plants isolés, et qui se reproduisent naturellement sans culture, depuis plus d’un demi-siècle[3]. »
Mais il n’est rien de plus difficile que l’extraction de la matière colorante du pastel. Les frères Niépce, pas plus que d’autres expérimentateurs, ne purent obtenir aucun résultat utile.
De 1813 à 1816, ils s’occupèrent de la culture du pastel, concurremment avec d’autres travaux industriels ou agricoles. Ils entreprirent l’extraction du sucre de betterave. Mais ils ne poussèrent pas bien loin cette tentative, qui, à la même époque, commençait à fournir, dans le nord de la France, de si remarquables résultats. Ils entreprirent aussi d’extraire d’une espèce de courge, de la fécule, qui prit le nom de fécule Giraumont.
Les travaux industriels et agricoles auxquels les frères Niépce se livraient en commun, dans leur domaine des Gras, furent interrompus par le départ de l’un d’eux.
Claude Niépce avait avant tout à cœur son pyréolophore. Au mois de mars 1816, il quitta Châlon, pour n’y plus revenir. Il se rendait à Paris, dans l’espoir d’y perfectionner cette machine à air chaud, et de la faire adopter comme rivale des machines à vapeur, qui commençaient à s’introduire en France.
Quittant la tranquille retraite de sa maison de campagne des Gras et s’arrachant aux douceurs de la vie de famille, Claude Niépce va donc s’installer à Paris. Là, il invente, il combine de nouveaux perfectionnements à sa machine à air chaud. Il fait construire, à Bercy, un bateau destiné à recevoir ce nouveau moteur : il s’efforce de réunir des fonds et des actionnaires, pour tenter l’exécution en grand de sa machine.
Mais il échoua dans toutes ses démarches. Le gouvernement lui refusa la bien minime faveur de prolonger de cinq ans, comme il le demandait, son brevet d’invention, et il ne put parvenir à convaincre les gens d’affaires des bonnes qualités de sa machine. Il se décida alors à quitter la France.
Il se rendit en Angleterre, pour y poursuivre l’idée de son pyréolophore. Mais les Anglais firent la sourde oreille, comme ses compatriotes, et la malheureuse machine ne put jamais voir le jour.
Claude Niépce, une fois en Angleterre, ne la quitta plus. Il s’établit à Kiew, près de Londres, toujours occupé d’inventions mécaniques, et en correspondance continuelle avec son frère Nicéphore. Il est touchant de lire dans l’ouvrage consciencieux que M. Victor Fouque a consacré à Nicéphore Niépce, quelques extraits de la correspondance entre les deux frères, séparés par les événements et la distance. C’est un épanchement continuel, une tendresse incessante, qui ont pour objet, tout à la fois, les conceptions mécaniques et les affections du cœur. Les frères Niépce rappellent les Montgolfier, par leur attachement mutuel et par la constante communauté de leurs vues.
Demeuré seul, Nicéphore reprit la suite de ses travaux. Il fixa sa principale demeure à sa maison de campagne des Gras. La maison paternelle de Châlon ne fut pour lui, à partir de ce moment, qu’une sorte de pied-à-terre. Possédant une fortune, que l’on peut évaluer à quinze mille livres de revenu, il vivait avec une grande aisance, des produits de sa terre.

Nous avons fait dessiner (fig. 3) d’après une épreuve photographique, exécutée en 1845, la maison de campagne des Gras, où Nicéphore Niépce se livrait à ses travaux. On ne peut contempler sans émotion cet asile modeste qui fut le berceau de la photographie naissante. C’est un simple et bourgeois manoir, tout entouré de foisonnantes charmilles. Derrière cet humble séjour, la Saône coule lentement, à travers un paysage d’une monotone sérénité. Au-devant, passe sans façon la grande route, tachant de sa poussière jaunâtre et siliceuse, les verts buissons dont le domaine est entouré. Sous les combles de cette honnête maison, l’œil recherche avec intérêt une étroite fenêtre, que bien des amateurs de mes amis ne verraient pas sans un attendrissement délicieux, car c’est dans cette mansarde, ouvrant sur la Saône, que Niépce avait installé ses appareils. C’est là qu’il passa dix années de sa vie laborieuse, poursuivant en silence le grand problème de la fixation des images de la chambre obscure.
C’est vers 1815 que Nicéphore Niépce songea, pour la première fois, à obtenir des images par l’action chimique de la lumière sur des substances impressionnables. Il fut mis sur la voie de ce genre de recherches, par l’invention de la lithographie, qui, découverte en Allemagne par Senefelder, avait été importée en France en 1814 par M. de Lasteyrie.
Cet art nouveau fixait alors l’attention générale, et excitait un intérêt sans égal. On s’étonnait avec raison, de voir imiter en quelques instants, avec un bout de crayon et un fragment de pierre polie, les produits de l’art pénible et compliqué du graveur. Saisi pour cet art nouveau d’un engouement qui dura plus de dix années, le public recherchait avec empressement les produits, encore fort imparfaits, sortis des mains des artistes. Les amateurs eux-mêmes s’essayaient à ces procédés intéressants, et jusque dans les châteaux on trouvait des presses lithographiques.
En réfléchissant sur le principe de la lithographie, Niépce osa penser qu’il ne serait peut-être pas impossible d’aller encore plus loin. Dans ces curieuses productions qui étonnaient et qui charmaient l’Europe, le génie de Senefelder avait banni la main du graveur, et laissé au seul dessinateur l’exécution du travail ; Niépce rêva d’exclure à son tour la main du dessinateur même, et de demander à la nature seule tous les frais de l’opération.
Niépce fit des essais de lithographie sur quelques pierres d’un grain délicat destinées à être jetées sur la route de Lyon. Ces tentatives ayant échoué, il imagina de substituer à la pierre un métal poli. Il essaya de tirer des épreuves sur une lame d’étain, avec des crayons lithographiques, et c’est dans le cours de ces recherches que lui vint l’idée d’obtenir sur une plaque métallique la représentation des objets extérieurs par la seule action des rayons lumineux.
Il est assez difficile de connaître la suite et l’enchaînement des tentatives de Niépce pour fixer les images des objets extérieurs par l’action de la lumière. On n’en trouve les traces que dans la correspondance qu’il entretenait avec son frère Claude, établi à Kiew ; mais, comme dans cette correspondance, Nicéphore Niépce s’abstenait avec soin de nommer les substances dont il faisait usage, dans la crainte que ses lettres ne tombassent entre les mains de quelque indiscret, il est très-difficile de ressaisir aujourd’hui les anneaux perdus de cette chaîne d’expériences.
M. Victor Fouque, dans son intéressante biographie de Nicéphore Niépce, a publié un certain nombre de ces lettres, les seuls documents qui puissent nous éclairer sur ces questions, et elles laissent bien des points indécis. Ce que nous y voyons de plus clair, c’est que Nicéphore Niépce commença par faire usage du chlorure d’argent, c’est-à-dire qu’il suivit les traces de Charles et de Wedgwood, mais que bientôt il abandonna ces substances impressionnables, pour en chercher d’autres.
Il copiait des estampes en soumettant à l’action de la lumière cette estampe rendue transparente par un vernis, et l’appliquant sur la substance impressionnable, préalablement étalée, en couche mince, sur une planche d’étain. Il essayait, en même temps, de faire usage de la chambre obscure, car dès l’année 1816, il avait construit une sorte de chambre obscure, en adaptant une lentille à une boîte, qui avait servi de baguier. Tout cela était fort grossier, fort imparfait ; mais pouvait-on faire mieux au fond d’une province et dans une campagne isolée ?
Quelques passages des lettres publiées par M. Victor Fouque, sont tout ce que l’on possède concernant les premières recherches de Nicéphore Niépce. Nous les rapporterons, pour que le lecteur puisse se former lui-même une opinion sur la véritable portée des premiers essais du physicien de Châlon.
Le 12 avril 1816, Joseph-Nicéphore écrivait à son frère Claude :
« Je profite du peu de temps que nous avons à passer ici, pour faire faire une espèce d’œil artificiel qui est tout simplement une petite boîte carrée de six pouces de chaque face, laquelle sera munie d’un tuyau susceptible de s’allonger et portant un verre lenticulaire. Je ne pourrais sans cet appareil me rendre complétement raison de mon procédé. Je m’empresserai de t’informer du résultat de l’expérience que je compte faire lorsque nous serons de retour à Saint-Loup. »
Mais, en arrangeant la lentille dans cette boîte, il cassa son objectif. Il écrivait donc à son frère, le 22 du même mois :
« Je comptais faire hier l’expérience dont je t’ai parlé ; mais j’ai cassé mon objectif dont le foyer était le mieux assorti aux dimensions de l’appareil. J’en ai bien un autre, mais qui n’a pas le même foyer ; ce qui nécessitera quelques petits changements dont je vais m’occuper. Ce retard ne sera pas long, et bien sûrement j’aurai le plaisir de te mander dans une prochaine lettre le résultat que j’aurai obtenu. Je souhaite, sans trop l’espérer, qu’il justifie l’intérêt que tu veux bien me témoigner à ce sujet. »
Il écrivait ensuite le 5 mai 1816 :
« Tu as vu par ma dernière lettre que j’avais cassé l’objectif de ma chambre obscure, mais qu’il m’en restait un autre dont j’espérais tirer parti. Mon attente a été trompée : ce verre avait le foyer plus court que le diamètre de la boîte ; ainsi je n’ai pu m’en servir. Nous sommes allés à la ville lundi dernier ; je n’ai pu trouver chez Scotti qu’une lentille d’un foyer plus long que la première ; et il m’a fallu faire allonger le tuyau qui la porte, et au moyen duquel on détermine la vraie distance du foyer. Nous sommes revenus ici mercredi soir ; mais depuis ce jour-là, le temps a toujours été couvert ; ce qui ne m’a pas permis de donner suite à mes expériences. Et j’en suis d’autant plus fâché qu’elles m’intéressent beaucoup. Il faut se déplacer de temps en temps, faire des visites ou en recevoir : c’est fatigant. Je préférerais, je te l’avoue, être dans un désert.
« Lorsque mon objectif fut cassé, ne pouvant plus me servir de ma chambre obscure, je fis un œil artificiel avec le baguier d’Isidore, qui est une petite boîte de seize à dix-huit lignes en carré. J’avais heureusement les lentilles du microscope solaire qui, comme tu le sais, vient de notre grand-père Barrault. Une de ces petites lentilles se trouva précisément du foyer convenable ; et l’image des objets se peignait d’une manière très-nette et très-vive sur un champ de treize lignes de diamètre.
« Je plaçai l’appareil dans la chambre où je travaille, en face de la volière, et les croisées ouvertes. Je fis l’expérience d’après le procédé que tu connais, mon cher ami, et je vis sur le papier blanc toute la partie de la volière qui pouvait être aperçue de la fenêtre et une légère image des croisées qui se trouvaient moins éclairées que les objets extérieurs. On distinguait les effets de la lumière dans la représentation de la volière et jusqu’au châssis de la fenêtre. Ceci n’est qu’un essai encore bien imparfait ; mais l’image des objets était extrêmement petite. La possibilité de peindre de cette manière me paraît à peu près démontrée ; et si je parviens à perfectionner mon procédé, je m’empresserai, en t’en faisant part, de répondre au tendre intérêt que tu veux bien me témoigner. Je ne me dissimule point qu’il y a de grandes difficultés, surtout pour fixer les couleurs ; mais avec du travail et beaucoup de patience on peut faire bien des choses. Ce que tu avais prévu est arrivé. Le fond du tableau est noir, et les objets sont blancs, c’est-à-dire plus clairs que le fond.
« Je crois que cette manière de peindre n’est pas inusitée, et j’ai vu des gravures de ce genre. Au reste, il ne serait peut-être pas impossible de changer cette disposition des couleurs ; j’ai même là-dessus quelques données que je suis curieux de vérifier[4]… »
Nous ne pouvons savoir quelle était la substance impressionnable sur laquelle Niépce recevait l’image de la chambre obscure ; mais il est certain qu’il obtenait déjà par la lumière, de véritables impressions à effet lumineux inverse, c’est-à-dire des plaques sur lesquelles les tons blancs de la nature étaient représentés par des noirs, et les ombres accusées au contraire par des clairs. C’est ce qui ressort de la lettre suivante adressée par Nicéphore Niépce à son frère, le 19 mai 1816 :
« Je m’empresse de répondre à ta lettre du 14, que nous avons reçue avant-hier, et qui nous a fait un bien grand plaisir. Je t’écris sur une simple demi-feuille, parce que la messe ce matin, et ce soir une visite à rendre à madame de Mortenil ne me laisseront guère de temps, et, en second lieu, pour ne pas trop augmenter le port de ma lettre, à laquelle je joins deux gravures faites d’après le procédé que tu connais. La plus grande provient du baguier, et l’autre de la boîte dont je t’ai parlé, qui tient le milieu entre le baguier et la grande boîte. Pour mieux juger de l’effet, il faut se placer un peu dans l’ombre ; il faut placer la gravure sur un corps opaque et se mettre contre le jour. Cette espèce de gravure s’altérerait, je crois, à la longue, quoique garantie du contact de la lumière, par la réaction de l’acide nitrique, qui n’est pas neutralisé. Je crains aussi qu’elle ne soit endommagée par les secousses de la voiture. Ceci n’est encore qu’un essai ; mais si les effets étaient un peu mieux sentis (ce que j’espère obtenir), et surtout si l’ordre des teintes était interverti, je crois que l’illusion serait complète. Ces deux gravures ont été faites dans la chambre où je travaille, et le champ n’a de grandeur que la largeur de la croisée. J’ai lu, dans l’abbé Nollet, que, pour pouvoir représenter un plus grand nombre d’objets éloignés, il faut des lentilles d’un plus grand foyer, et mettre un verre de plus au tuyau qui porte l’objectif. Si tu veux conserver ces deux rétines, quoiqu’elles n’en valent guère la peine, tu n’as qu’à les laisser dans le papier gris, et placer le tout dans un livre.
« Je vais m’occuper de trois choses : 1o de donner plus de netteté à la représentation des objets ; 2o de transposer les couleurs ; 3o et enfin de les fixer, ce qui ne sera pas le plus aisé. Mais, comme tu le dis fort bien, mon cher ami, nous ne manquons pas de patience, et avec de la patience on vient à bout de tout. Si je suis assez heureux pour perfectionner le procédé en question, je ne manquerai pas de t’adresser de nouveaux échantillons pour répondre au vif intérêt que tu veux bien prendre à une chose qui pourrait être utile aux arts, et dont nous pourrions tirer un bon parti[5]. »
Par le mot transposer les couleurs, il faut entendre rétablir les véritables tons de la nature, c’est-à-dire obtenir, au lieu d’une image négative, une image positive, représentant les ombres et les clairs tels qu’ils sont dans la nature.
Le 28 du même mois, Joseph-Nicéphore envoyait à son frère les plaques sur lesquelles il avait obtenu ce qu’il nomme « les gravures », et qui n’était que des planches métalliques portant les impressions produites par la lumière.
« Je m’empresse, écrivait-il, de te faire passer quatre nouvelles épreuves, deux grandes et deux petites, que j’ai obtenues plus nettes et plus correctes à l’aide d’un procédé très-simple, qui consiste à rétrécir avec un disque de carton percé, le diamètre de l’objectif. L’intérieur de la boîte étant moins éclairé, l’image en devient plus vive, et ses contours, ainsi que les ombres et les jours, sont bien mieux marqués. Tu en jugeras par le toit de la volière, par les angles de ses murs, par les croisées dont on aperçoit les croisillons ; les vitres mêmes paraissent transparentes en certains endroits ; enfin le papier retient exactement l’empreinte de l’image colorée ; et si l’on n’aperçoit pas tout distinctement, c’est que l’image de l’objet représenté étant très-petite, cet objet paraît tel qu’il serait s’il était vu de loin. D’après cela, il faudrait, comme je te l’ai dit, deux verres à l’objectif pour peindre convenablement les objets éloignés, et en réunir un plus grand nombre sur la rétine ; mais ceci est une affaire à part. La volière étant peinte renversée, la grange ou plutôt le toit de la grange est à gauche au lieu d’être à droite. Cette masse blanche qui est à droite de la volière, au-dessus de la claire-voie, qu’on ne voit que confusément, mais telle qu’elle est peinte sur le papier par la réflexion de l’image, c’est le poirier de beurré blanc qui se trouve beaucoup plus éloigné ; et cette tache noire au haut de la cime, c’est une éclaircie qu’on aperçoit entre les branches. Cette ombre, à droite, indique le toit du four qui paraît plus bas qu’il ne doit être, parce que les boîtes sont placées à cinq pieds (1m, 62) environ au-dessus du plancher. Enfin, mon cher ami, ces petits traits blancs marqués au-dessus du toit de la grange, ce sont quelques branches d’arbres du verger qu’on entrevoit et qui sont représentées sur la rétine. L’effet serait bien plus frappant, si, comme je te l’ai dit, ou plutôt comme je n’ai pas besoin de te le dire, l’ordre des ombres et des jours pouvait être interverti ; c’est là ce dont je vais m’occuper avant de tâcher de fixer les couleurs, et ça n’est pas facile.
« Jusqu’à présent je n’ai peint que la volière, afin de pouvoir comparer entre elles les épreuves. Tu trouveras une des deux grandes et des deux petites moins colorées que les deux autres, quoique les contours des objets soient très-bien marqués ; ceci provient de ce que j’ai trop rétréci l’ouverture du carton qui couvre l’objectif. Il paraît qu’il y a des proportions dont on ne peut pas trop s’écarter ; et je n’ai peut-être pas encore trouvé la meilleure. Lorsque l’objectif est à nu, l’épreuve qu’on obtient paraît estompée, et le spectre coloré a cette apparence-là, parce que les contours des objets sont peu prononcés et semblent en quelque sorte se perdre dans le vague.
« Je souhaite, sans cependant trop l’espérer, que ces épreuves te parviennent en bon état, pour que tu sois, mon cher ami, plus à portée de juger de l’amélioration que j’ai cru obtenir[6]. »
Après avoir obtenu ces impressions lumineuses, Nicéphore Niépce songea à transformer ses plaques en planches propres à la gravure. Il espérait arriver à ce résultat en les attaquant par un acide faible, c’est-à-dire en imitant le procédé employé pour obtenir les pierres lithographiques ou les planches métalliques destinées au tirage des gravures en taille-douce. C’est ce qui résulte de la lettre suivante :
« Je présume que tu auras reçu hier, mon cher ami, ma lettre du 28 mai, laquelle contenait quatre nouvelles épreuves qui m’ont paru plus correctes que les précédentes. Je suis on ne peut plus sensible aux choses honnêtes que tu veux bien me dire à ce sujet, et, quoique je sois loin de les mériter, elles n’en sont pas moins pour moi un grand motif d’encouragement. Si je parvenais à fixer la couleur et à changer la disposition des jours et des ombres, le procédé que j’emploie maintenant, serait, je pense, le meilleur. Car il est impossible de trouver une substance qui soit plus susceptible de retenir les moindres impressions de la lumière. L’enduit de la volière du côté de la basse-cour, est d’une couleur rembrunie. Mais au-dessus de la porte et jusqu’à celle du tecq-à-pourceaux, il y a une plaque blanche qui se trouve marquée très-distinctement en noir sur la gravure.
« Quoique j’aie encore beaucoup à faire avant d’atteindre le but, c’est déjà quelque chose. J’ai bien essayé de graver sur le métal à l’aide de certains acides, mais jusqu’ici je n’ai rien obtenu de satisfaisant, le fluide lumineux ne paraît pas modifier d’une manière sensible l’action des acides. Cependant mon intention n’est pas d’en rester là, parce que ce genre de gravure serait encore supérieur à l’autre, toute réflexion faite, à raison de la facilité qu’il donnerait de multiplier les épreuves, et de les avoir inaltérables. Si je parviens à obtenir d’une manière ou de l’autre de bons résultats, je m’empresserai, mon cher ami, de te les faire connaître[7]. »
Nous disons qu’il est impossible de savoir aujourd’hui quelle était la substance chimique dont Niépce faisait usage pour obtenir ses impressions lumineuses. En effet, le nom de la substance n’est pas prononcé dans les lettres que nous venons de citer.
Cette substance ne devait pas le satisfaire sans doute, car nous allons le voir faire des essais photographiques avec des matières nouvelles qu’il fait connaître à son frère, et qui sont d’abord le chlorure de fer, ensuite l’oxyde noir de manganèse. Le 16 juin, il écrivait à son frère, la lettre suivante :
«… J’avais lu qu’une solution alcoolique de muriate de fer, qui est d’un beau jaune, devenait blanche au soleil, et reprenait à l’ombre sa couleur naturelle. J’ai imprégné de cette solution un morceau de papier que j’ai fait sécher, la partie exposée au jour est devenue blanche, tandis que la partie qui se trouvait hors du contact de la lumière, est restée jaune. Mais cette solution attirant trop l’humidité de l’air, je ne l’ai plus employée, parce que le hasard m’a fait trouver quelque chose de plus simple et de meilleur.
« Un morceau de papier couvert d’une ou de plusieurs couches de rouille ou safran de Mars, et exposé aux vapeurs du gaz acide muriatique oxygéné, devient d’un beau jaune jonquille, et blanchit mieux et plus vite que le précédent. Je les ai placés l’un et l’autre dans la chambre obscure, et cependant l’action de la lumière, n’a produit sur eux aucun effet sensible, quoique j’aie eu soin de varier la position de l’appareil. Peut-être n’ai-je pas attendu assez longtemps, et c’est ce dont il faudra encore m’assurer ; car je n’ai fait qu’effleurer la matière.
« Je croyais aussi comme toi, mon cher ami, qu’en mettant dans la boîte optique une épreuve bien marquée sur un papier teint d’une couleur fugace, ou recouvert de la substance que j’emploie, l’image viendrait se peindre sur ce papier avec ses couleurs naturelles ; puisque les parties noires de l’épreuve, étant plus opaques, intercepteraient plus ou moins le passage des rayons lumineux ; mais il n’y a eu aucun effet de produit. Il est à présumer que l’action de la lumière n’est point assez forte ; que le papier que j’emploie est trop épais, ou qu’étant trop couvert, il offre un obstacle insurmontable au passage du fluide ; car j’applique jusqu’à six couches de blanc. Tels sont les résultats négatifs que j’ai obtenus ; heureusement qu’ils ne prouvent encore rien contre la bonté de l’idée, et qu’il est même permis de revenir là-dessus avec quelque espoir de succès.
« Je suis aussi parvenu à décolorer l’oxyde noir de manganèse, c’est-à-dire qu’un papier peint avec cet oxyde, devient parfaitement blanc lorsqu’on le met en contact avec le gaz acide muriatique oxygéné. Si, avant qu’il soit tout à fait décoloré, on l’expose à la lumière, il finit par blanchir en très-peu de temps ; et lorsqu’il est devenu blanc, si on le noircit légèrement avec ce même oxyde, il est encore décoloré par la seule action du fluide lumineux. Je pense, mon cher ami, que cette substance mérite d’être soumise à de nouvelles épreuves, et je compte bien m’en occuper plus sérieusement.
« J’ai voulu aussi m’assurer si ces différents gaz pourraient fixer l’image colorée ou modifier l’action de la lumière, en la faisant communiquer à l’aide d’un tube avec l’appareil, pendant l’opération. Je n’ai encore employé que le gaz muriatique oxygéné, le gaz hydrogène et le gaz carbonique ; le premier décolore l’image, le second ne m’a paru produire aucun effet sensible ; et le troisième détruit en grande partie, dans la substance dont je me sers, la faculté d’absorber la lumière. Car cette substance, tant que le contact du gaz a lieu, se colore à peine dans les parties même les plus éclairées ; et cependant ce contact a duré plus de huit heures. Je reprendrai ces expériences intéressantes, et j’essayerai successivement plusieurs autres gaz, surtout le gaz oxygène qui, à raison de ses affinités avec les oxydes métalliques et la lumière, mérite une attention particulière.
« Enfin, mon cher ami, j’ai fait de nouveaux essais pour parvenir à graver sur le métal à l’aide des acides minéraux ; mais les acides que j’ai employés, c’est-à-dire l’acide muriatique, l’acide nitreux, ainsi que l’acide muriatique oxygéné, soit sous forme gazeuse, soit en liqueur, n’ont laissé pour toute empreinte qu’une tache noirâtre, plus ou moins foncée, suivant la force du dissolvant. L’acide muriatique oxygéné est le seul dont on pourrait tirer parti ; mais il n’est décomposé par la lumière que lorsqu’il est uni à l’eau, et, dans cet état même, il n’agit pas sur les métaux avec assez d’énergie pour les creuser sensiblement ; car il ne produit aucune effervescence avec eux, et les oxyde comme ferait le foie de soufre, ce qui n’est pas notre affaire. Mais j’ai reconnu avec plaisir que, sans produire le bouillonnement incommode des autres acides, il attaque très-bien et d’une manière très-nette la pierre calcaire dont nous nous servons pour graver ; il l’attaque lentement, c’est-à-dire comme il le faut pour que l’influence de la lumière soit plus sensible, et que cet acide puisse creuser plus ou moins à raison de la différence des teintes.
« Je m’occuperai donc, toute affaire cessante, de préparer une de ces pierres qui remplacera le papier, et sur laquelle l’image colorée doit se peindre. Je la laisserai tremper quelque temps dans l’eau chaude, et ensuite je la mettrai en contact avec le gaz acide muriatique oxygéné qui, d’après mon procédé, communique dans l’intérieur de l’appareil. Je crois qu’à l’aide de cette disposition, on doit obtenir un résultat décisif, si, comme on n’en peut douter, l’acide en question est décomposé par la lumière, et si par là sa force dissolvante se trouve modifiée.
« Tu vois, mon cher ami, que depuis quelques jours je n’ai guère fait que battre la campagne, mais c’est toujours quelque chose que de multiplier les données qui peuvent conduire à la solution du problème proposé. Aussitôt que j’aurai trouvé quelque perfectionnement utile et vraiment propre à atteindre ce but, je m’empresserai de t’en instruire[8]. »
Mais ces nouvelles tentatives n’amenaient à aucun résultat, d’après les termes d’une autre lettre, en date du 2 juillet suivant :
« D’après des expériences réitérées, j’ai reconnu l’impossibilité de pouvoir fixer l’image des objets à l’aide de la gravure sur pierre par l’action des acides aidée du concours de la lumière. Ce fluide ne m’a paru avoir aucune influence sensible sur la propriété dissolvante de ces agents chimiques ; j’y ai donc entièrement renoncé ; et je doute fort que l’on eût pu par ce procédé faire ce que l’on peut faire avec la substance que j’emploie, puisqu’elle rend sensibles les différentes teintes que réfléchit l’enduit de la volière, qui est blanc dans certaines parties, et noir dans d’autres. Je fais dans ce moment de nouvelles recherches pour parvenir à fixer et à transposer les couleurs de l’image représentée. Le champ à parcourir est assez vaste, et je ne le quitterai pas que je n’aie épuisé toutes les combinaisons[9]. »

Pendant près d’une année, Niépce paraît occupé d’autres travaux, car ce n’est que dans une lettre du 20 avril 1817, citée par M. Fouque, que l’on trouve signalée la reprise des travaux héliographiques, comme les appelle déjà le physicien de Châlon. Dans cet intervalle, il avait essayé d’appliquer sur la pierre d’autres substances, entre autres le chlorure d’argent, mais il n’avait pu rien obtenir. Il s’adressa alors à des matières organiques, c’est-à-dire à la résine de gaïac, qui, exposée à la lumière, par une cassure récente, prend, en quelques heures, une couleur verte. Bientôt, mécontent de cette substance, il s’adresse au phosphore, corps simple, qui, exposé à la lumière, noircit. Mais il se dégoûte de ce nouvel agent, parce qu’il trouve son effet insuffisant, et qu’il se brûle la main en maniant ce « dangereux combustible. »
« Tu auras pu voir, écrit-il à son frère, le 20 avril 1817, que je me proposais de te donner des détails circonstanciés sur les recherches qui m’occupent, et auxquelles tu as la bonté de prendre un intérêt que je serais bien heureux de pouvoir justifier. Je n’ai point encore la certitude démontrée du succès ; mais j’ai acquis quelques probabilités de plus, ce qui ranime mon courage et me porte à reprendre la suite de mes expériences.
« Je crois t’avoir mandé, mon cher ami, que j’avais renoncé à l’emploi du muriate d’argent, et tu sais les raisons qui m’y ont déterminé. J’étais fort embarrassé de savoir par quelle autre substance je pourrais remplacer cet oxyde métallique, lorsque je lus, dans un ouvrage de chimie, que la résine de gaïac, qui est d’un gris jaunâtre, devenait d’un fort beau vert quand on l’exposait à la lumière ; qu’elle acquérait par là de nouvelles propriétés, et qu’il fallait, pour la dissoudre dans cet état, un alcool plus rectifié que celui qui la dissout dans son état naturel. Je m’empressai donc de préparer une forte dissolution de cette résine, et je vis en effet, qu’étendue en couches légères sur du papier, et soumise au contact du fluide lumineux, elle devenait d’un beau vert foncé en assez peu de temps ; mais, réduite en couches aussi minces qu’elles devaient l’être pour l’objet proposé, sa solution dans l’alcool ne m’offrit pas la moindre différence sensible. De sorte qu’après plusieurs tentatives également infructueuses, j’y renonçai, bien convaincu de l’insuffisance de ce nouveau moyen.
« Enfin, en jetant les yeux sur une note du Dictionnaire de Klaproth, article Phosphore, et surtout en lisant le mémoire de M. Vogel, sur les changements que l’action de la lumière fait subir à ce combustible, je m’imaginai qu’il serait possible de l’appliquer avantageusement à mes recherches.
« Le phosphore est naturellement jaunâtre ; mais, fondu convenablement dans l’eau chaude, il devient presque aussi blanc, aussi transparent que le verre, et alors il est peut-être plus susceptible que le muriate d’argent lui-même, des impressions de la lumière. Ce fluide le fait passer très-rapidement du blanc au jaune, et du jaune au rouge foncé, qui finit par devenir noirâtre. L’alcool de Lampadius, qui dissout aisément le phosphore blanc, n’attaque point le Phosphore rouge, et il faut pour fondre ce dernier une chaleur beaucoup plus forte que pour fondre le premier. Le Phosphore rouge exposé à l’air, ne tombe pas en déliquescence comme le Phosphore blanc, qui, après avoir absorbé l’oxygène, se convertit en acide phosphoreux. Cet acide a la consistance de l’huile et corrode la pierre comme les acides minéraux. J’ai constaté la vérité de toutes ces assertions, et sans m’étendre davantage là-dessus, je suis persuadé que tu sentiras comme moi, mon cher ami, combien cet agent chimique peut offrir de combinaisons utiles pour la solution du problème qu’il s’agit de résoudre.
« La seule difficulté qui m’embarrasse maintenant, c’est d’étendre le phosphore comme un vernis sur la pierre. Il faut qu’il soit en couche très-mince, autrement la lumière ne le pénétrerait pas à fond, et, le phosphore n’étant pas oxydé dans toute son épaisseur, on manquerait ainsi le but qu’on se propose d’atteindre. Cette substance est attaquée par l’alcool et surtout par les huiles ; mais ces dissolvants lui enlèvent la propriété qu’il importe le plus de lui conserver, ainsi que l’expérience me l’a démontré. Je suis parvenu à l’étendre sur la pierre à l’aide du calorique, dans mon appareil qui est une espèce de soufflet rempli de gaz nitreux, dont l’âme inférieure reçoit la pierre en question, et qui porte à son âme supérieure un petit mécanisme pour répandre également le phosphore, ainsi qu’un verre pour éclairer l’intérieur ; mais cet appareil ne fermait point assez exactement pour empêcher l’air ambiant d’y pénétrer ; et le phosphore s’enflammait avant que l’opération fût terminée. Pour arriver à une démonstration complète, il faut donc que je tâche d’abord de remédier à cet inconvénient majeur, et j’espère y parvenir d’une manière ou de l’autre. Je m’empresserai de te faire connaître, mon cher ami, le résultat de mes recherches ultérieures à cet égard[10]. »
Au bout de trois mois, il signifie à son correspondant, l’insuccès définitif de ses expériences avec le phosphore, dans la lettre suivante, datée du 2 juillet 1817 :
« Mes expériences les plus importantes sur le phosphore n’ont pas réussi ; je n’ai pu parvenir jusqu’ici à fixer avec cette substance, l’image des objets à l’aide de l’appareil dont tu sais que je me servais. Je crois qu’il y a une grande différence, ainsi que je l’ai observé, entre les corps qui retiennent la lumière en l’absorbant, et ceux qu’elle ne fait qu’altérer en changeant ou modifiant leur couleur. Au reste, je n’ai pas encore assez varié mes expériences pour me regarder comme battu, et je ne me décourage point[11]. »
Il ajoute, dans une lettre du 11 juillet 1817 :
« Je viens de m’occuper de l’analyse de la gomme-résine de gaïac. Mon objet était de mettre à nu la partie de cette substance qui est susceptible des impressions de la lumière. J’ai déjà reconnu avec plaisir que cette singulière propriété n’existe point dans la matière gommeuse que l’eau dissout aisément ; et que la résine débarrassée de cette gomme rougeâtre, est bien plus sensible à l’action du fluide lumineux ; mais cette même résine est encore unie à un principe qui n’est soluble ni dans l’eau ni dans l’alcool, ce qui m’offre le moyen de l’obtenir (la résine) parfaitement pure. Si dans cet état, sa combinaison avec l’oxygène à l’aide de la lumière, la rend moins attaquable par l’alcool, j’aurai fait un grand pas vers la solution du problème que je me suis proposé.
« Tu sais que le phosphore ne m’a fourni que des résultats peu satisfaisants ; son emploi d’ailleurs est dangereux, et une forte brûlure que je me suis faite à la main, n’a pas peu contribué à me dégoûter entièrement de ce perfide combustible.
« Je vais donc reprendre mes expériences, et je ne manquerai pas de t’instruire du résultat, bon ou mauvais, que j’aurai obtenu. Tu vois, d’après cela, que je n’ai pas encore perdu l’espoir de réussir[12]. »
Ici s’arrêtent les documents qui peuvent éclairer l’histoire des travaux photographiques de Nicéphore Niépce. M. Fouque n’a pu trouver une seule lettre relative à ses expériences, dans un intervalle de neuf ans, c’est-à-dire de 1817 jusqu’à 1826.
Ce n’est pas qu’il eût abandonné ses recherches, il les continuait au contraire avec ardeur. En 1826, il avait renoncé à tous les agents chimiques expérimentés par lui pendant dix ans, et s’était arrêté à l’emploi du bitume de Judée, substance résineuse qui, étalée en couche mince et soumise à l’action de la lumière solaire, s’oxyde, blanchit, et reproduit en traits blanchâtres, quand on la place dans la chambre obscure, l’image formée au foyer de cet instrument.
Nous allons décrire, d’après le mémoire qu’il rédigea plus tard, c’est-à-dire lors de son association avec Daguerre, la méthode que Nicéphore Niépce employait, sous le nom d’héliographie. Cette méthode permettait : 1o d’obtenir la reproduction des estampes en les exposant à la lumière extérieure ; 2o de fixer l’image formée au foyer de la chambre obscure.
En ce qui concerne le premier objet, Niépce prenait une estampe ; il la vernissait sur le verso, pour la rendre transparente, et l’appliquait sur une lame d’étain, préalablement recouverte d’une couche de bitume de Judée. Les parties noires de l’estampe arrêtaient les rayons lumineux ; au contraire, les parties transparentes ou qui ne présentaient aucun trait de burin, les laissaient passer librement. Les rayons lumineux, traversant les parties diaphanes du papier, allaient blanchir la couche de bitume de Judée appliquée sur la lame métallique, et l’on obtenait ainsi une reproduction fidèle du dessin, dans laquelle les clairs et les ombres conservaient leur situation naturelle. En plongeant ensuite la lame métallique dans l’essence de lavande, les portions du bitume non impressionnées par l’agent lumineux, étaient dissoutes, tandis que les parties modifiées par la lumière restaient sans se dissoudre ; l’image se trouvait ainsi mise à l’abri de l’action du jour.
Mais la copie des gravures n’était qu’une opération sans aucun intérêt ; le problème consistait à reproduire les dessins de la chambre obscure.
Tout le monde connaît la chambre obscure. C’est une sorte de boîte fermée de toutes parts, dans laquelle la lumière s’introduit par un petit orifice. Les rayons lumineux émanant des objets placés au dehors, traversant l’orifice et continuant leur marche rectiligne, produisent, sur un écran disposé à l’intérieur de la boîte, une image, renversée et très-petite, de ces objets. Pour donner plus de champ à l’image et pour en augmenter la netteté, on place devant l’orifice lumineux, une lentille convergente.
La figure 5 montre la marche des rayons lumineux passant à travers un simple orifice percé dans une boîte fermée de toutes parts. On voit que, par suite de la marche rectiligne des rayons lumineux, l’objet extérieur, c’est-à-dire la flèche AB, vient se peindre sur l’écran de la chambre obscure, renversé et de dimensions plus petites, parce que le rayon lumineux partant du point A, ou de la pointe de la flèche, et traversant l’orifice O, vient, d’après sa direction rectiligne, se peindre au point A′, à l’intérieur de la boîte. Il en est de même de la base B de la flèche, qui vient se peindre au point B′. Les parties intermédiaires de la flèche occupant des points correspondants, l’image de l’objet, formée à l’intérieur de la boîte, est, comme le représente la figure, renversée et de dimensions réduites.

La chambre obscure n’est autre chose que cette boîte percée d’un trou, et destinée à produire le mécanisme optique qui vient d’être décrit. Seulement, pour embrasser un champ de vision plus vaste et pour donner plus de netteté à l’image, on enchâsse dans l’ouverture O du volet, une lentille convergente, biconvexe. Cette lentille recueille plus de lumière que le simple trou percé dans la paroi de la boîte, et, la concentrant en un seul point, elle produit le même effet que cet orifice, mais avec infiniment plus de netteté, et en embrassant un espace beaucoup plus étendu.
La chambre noire ou chambre obscure des physiciens, que les photographes ont adoptée, consiste, en définitive, en une boîte fermée de toutes parts, munie d’une lentille convergente, ou objectif, et d’un écran en verre dépoli.

La figure 6 représente cet appareil. Α est la boîte portée sur le trépied de bois B ; CC, l’écran ; DD, le tuyau dans lequel est enchâssée la lentille convergente, ou objectif.
La chambre obscure est donc un œil artificiel dans lequel viennent se peindre toutes les vues extérieures.
Ces images, il fallait les fixer ; la chambre obscure est un miroir ; de ce miroir il fallait faire un tableau.
C’est ce qu’avaient déjà essayé Charles, en France, Wedgwood et Davy, en Angleterre, et ce que Niépce tenta après eux.
Le procédé qui lui permit de fixer les dessins de la chambre noire, était fondé sur la même action chimique qu’il avait appliquée à la copie des gravures. Il reposait sur ce fait, que le bitume de Judée, exposé pendant un certain temps aux rayons lumineux, s’oxyde, et devient insoluble dans certains liquides, notamment dans l’essence de lavande ; tandis que les parties non touchées par la lumière, conservent la propriété de se dissoudre dans cette essence.
Quant à la pratique de l’opération, Niépce procédait de la manière suivante. Il appliquait une couche de bitume de Judée sur une lame d’étain, qu’il plaçait dans la chambre noire, et il faisait tomber à sa surface, l’image transmise par la lentille de l’instrument. Au bout d’un temps fort long, la lumière avait agi sur la surface résineuse. En plongeant alors la plaque dans un mélange d’essence de lavande et de pétrole, les parties de l’enduit bitumineux que la lumière avait frappées, restaient intactes, tandis que les autres se dissolvaient. On obtenait ainsi un dessin, dans lequel les clairs correspondaient aux clairs, et les ombres aux ombres ; les clairs étaient formés par l’enduit blanchâtre de bitume, les ombres par les parties polies et dénudées du métal ; les demi-teintes, par les portions du vernis sur lesquelles le dissolvant avait partiellement agi. Comme ces dessins métalliques n’avaient qu’une médiocre vigueur, Niépce essaya de les renforcer en exposant la plaque à l’évaporation spontanée de l’iode, ou aux vapeurs émanées du sulfure de potasse, afin de produire un fond noir sur lequel les traits se détacheraient avec plus de fermeté ; mais il ne réussit nullement à obtenir ce dernier résultat.
L’inconvénient capital de ce moyen, c’était le temps considérable qu’exigeait l’impression lumineuse. Le bitume de Judée est une substance qui ne se modifie par l’action de la lumière qu’avec une lenteur excessive ; il ne fallait pas moins de dix heures pour produire un dessin. Pendant cet intervalle, le soleil, qui n’attendait pas le bon plaisir de cette substance paresseuse, déplaçait les lumières et les ombres, avant que l’image fût saisie. Ce procédé était donc fort imparfait.
Niépce s’occupa ensuite d’appliquer sa découverte à l’art de la gravure ; car tel était, il faut bien le remarquer, le but qu’il se proposait dans les essais que nous venons de rapporter. En attaquant ses plaques par un acide affaibli, il creusait le métal, en respectant les traits abrités par l’enduit résineux, et formait ainsi des planches à l’usage des graveurs en taille-douce.
Il avait donc à peu près résolu le problème qu’il s’était posé dix ans auparavant, et qui consistait à créer une branche nouvelle de la gravure ou de la lithographie sur métal, dans laquelle la lumière seule produirait directement, sur une plaque métallique, un dessin qu’il suffirait ensuite d’attaquer par un acide pour rendre la plaque immédiatement propre au tirage sur papier. Niépce désignait ce nouveau procédé de gravure sous le nom d’héliographie. M. Lemaître, graveur à Paris, à qui Niépce avait confié le tirage de ses planches, possède encore quelques gravures de ce genre, que nous avons pu examiner.
On a beau cependant être homme d’habileté exquise, de patience infatigable ou d’imagination féconde, il est, dans les recherches scientifiques, quelque chose qui rend toute habileté vaine, qui déconcerte la patience la plus obstinée et qui impose une barrière à l’imagination la plus active : c’est l’imperfection de l’instrument dont l’opérateur fait usage. Tel fut l’obstacle que Nicéphore Niépce rencontra. Les lentilles que l’on appliquait, de son temps, aux chambres noires, étaient loin de réunir les conditions si remarquables de réfrangibilité qu’elles présentent de nos jours ; on ne pouvait pas alors, comme on le fait aujourd’hui, se procurer, pour un prix modique, des objectifs d’une pureté irréprochable. En outre, l’extrême longueur que l’on donnait au foyer de la lentille, faisait perdre la plus grande partie de la lumière qui traversait l’instrument. Toutes ces causes devaient empêcher l’inventeur de réaliser ses espérances. Par son procédé héliographique, on fixait sans doute les images de la chambre obscure, mais il fallait, pour arriver à ce résultat, un temps considérable : huit à dix heures d’exposition étaient nécessaires pour obtenir une épreuve, et cette circonstance suffisait pour empêcher toute application sérieuse d’un tel procédé.
C’est pour cela que, malgré dix ans d’études et d’expériences, Nicéphore Niépce n’était parvenu, en fin de compte, qu’à des résultats très-médiocres. Il avait suivi la voie ouverte par Charles en France, et Wedgwood en Angleterre. Au lieu de chlorure d’argent, dont ces deux chimistes faisaient usage, il avait employé le bitume de Judée, substance assez mal choisie, d’ailleurs, comme agent photographique, car elle ne s’impressionne qu’avec lenteur à la lumière, et les contrastes entre les blancs et les noirs sont à peine accusés. Il fallait se placer sous un jour particulier, pour apercevoir l’image, qui était toujours fort peu appréciable.
Niépce n’eut jamais aucune idée de l’existence des agents révélateurs, c’est-à-dire des substances qui font apparaître subitement l’image formée par la lumière, image qui existe à l’état latent, pour ainsi dire ensevelie dans les profondeurs de la substance, et d’où le révélateur vient les faire sortir, comme par un miracle scientifique. Ces agents révélateurs qui constituent la véritable photographie, ne furent pas même soupçonnés par lui. C’est à Daguerre qu’il fut donné d’accomplir cette magnifique découverte, et de créer ainsi la photographie. Niépce n’avait fait autre chose qu’essayer l’action directe de la lumière sur différentes substances impressionnables, et le bitume de Judée, qu’il avait choisi, était bien défavorable sous ce rapport. On ne s’explique guère qu’ayant sous la main les sels d’argent, qui s’impressionnent à la lumière avec tant de rapidité, il soit allé s’adresser à une matière résineuse qui exige pour être influencée chimiquement par l’agent lumineux, une demi-journée d’exposition dans la chambre obscure.
Niépce n’eut jamais la notion des épreuves négatives et positives, qui sont la base de la photographie. Il ne songea pas à faire usage des épreuves négatives, c’est-à-dire dans lesquelles les blancs de la nature sont représentés par des noirs, pour obtenir des épreuves directes présentant les tons réels de la nature. Ce fut la découverte particulière de Talbot ; expérimentateur anglais.
Niépce s’était proposé de transformer ses plaques d’étain, ou d’argent plaqué, en planches propres à la gravure en taille-douce. Mais la pratique démontra bien vite que ce résultat n’était pas possible. Le graveur Lemaître, à qui il avait confié le soin de terminer ses planches, s’assura qu’elles ne pouvaient tirer plus d’une vingtaine d’épreuves. Il n’avait donc pas été plus heureux sous le rapport de la gravure, que sous le rapport de la photographie simple.
Malgré ses longs efforts, Niépce ne fit donc qu’entrevoir la photographie. Les résultats qu’il obtint n’étaient que les préludes de la grande découverte que nous essayons de raconter. C’était l’embryon de l’art, et non l’art lui-même. Nous allons arriver aux véritables inventeurs : à Daguerre et à Talbot.
CHAPITRE III
Tandis qu’au fond de sa province et dans sa tranquille maison de campagne des bords de la Saône, Nicéphore Niépce cherchait péniblement, et sans y parvenir, à tirer la photographie de ses langes, un autre expérimentateur poursuivait, de son côté, la même voie, et était parvenu, à la même époque, à un résultat important. Le nom même de cet inventeur est resté inconnu, par les circonstances que nous allons raconter.

Tout le monde a entendu parler de l’opticien Charles Chevalier. Sa boutique était située sur le quai de l’Horloge. Un jour, — c’était vers la fin de l’année 1825 — comme Charles Chevalier était seul, il voit entrer un jeune homme, pauvrement vêtu, à l’air souffrant et timide, et dont l’extérieur dénotait la misère. Le jeune homme désirait connaître le prix d’une des nouvelles chambres obscures que Charles Chevalier venait de construire, en remplaçant l’objectif ordinaire, par un objectif à ménisque convergent.
Le prix qui lui fut demandé fit pâlir le visiteur ; car si son désir était grand de se procurer le précieux appareil optique, ses goussets étaient absolument vides.
En sa qualité de marchand, Charles Chevalier ne pensa pas une minute à offrir à crédit la chambre obscure à un pauvre diable dont la mine et l’extérieur plaidaient peu en faveur de sa solvabilité. Cependant il pouvait donner ce qui ne lui coûtait rien, c’est-à-dire un conseil. Il demanda donc au jeune homme ce qu’il voulait faire d’une chambre noire.
« Je suis parvenu, lui répondit l’inconnu, à fixer sur le papier l’image de la chambre obscure. Mais je n’ai qu’un appareil grossier, une espèce de caisse de bois de sapin, garnie d’un objectif, que je place à ma fenêtre, et qui me sert à obtenir des vues de l’extérieur. Je voudrais me procurer votre nouvelle chambre noire à prisme, afin de continuer mes essais avec un appareil optique plus puissant et plus sûr. »
Charles Chevalier resta frappé d’étonnement. Il savait que le problème consistant à fixer les images de la chambre obscure, était poursuivi, en ce moment, par bien des expérimentateurs, entre autres par M. Talbot, en Angleterre, et par Daguerre, à Paris. Mais lui, Chevalier, regardait ces tentatives comme des entreprises chimériques, bonnes tout au plus à lui procurer, de temps en temps, l’occasion de vendre des objectifs et des appareils optiques à ces chercheurs de l’impossible. L’assurance et la tranquillité avec laquelle l’inconnu lui annonçait une découverte aussi capitale, bouleversaient notre opticien. Il aurait cru que son interlocuteur était fou, s’il n’eût été rassuré à cet égard par sa contenance et par ses paroles. Il se borna donc à lui répondre :
« Je connais plusieurs physiciens qui s’occupent de cette question. Mais ils ne sont encore arrivés à aucun résultat. Auriez-vous été plus heureux ? Je serais charmé d’en avoir la preuve. »
Pour toute réponse, le jeune homme tira de sa poche un vieux portefeuille usé et rapiécé. Dans ce portefeuille, il prit une feuille de papier enveloppée avec soin ; puis, la dépliant, il la plaça sur la vitrine de l’opticien :
« Voilà ce que je puis obtenir, » dit-il avec simplicité.
La surprise de l’opticien fut alors à son comble. Ce qu’il avait sous les yeux n’était rien moins qu’une photographie sur papier, et non une image imparfaite, mais une véritable épreuve positive, comme on l’appela plus tard. Le dessin, quoique confus sur les bords, en raison de l’imperfection de l’objectif employé, représentait une vue de Paris, celle que le pauvre inventeur avait devant ses fenêtres : une réunion de cheminées et de toits, avec le dôme des Invalides au second plan. Cette image prouvait que le pauvre jeune homme habitait quelque grenier des environs de la rue du Bac.
« Pourrai-je vous demander, dit l’opticien, avec quelle substance vous opérez pour obtenir un tel résultat ? »
Le jeune homme fouilla encore dans sa poche. Il en tira une fiole pleine d’un liquide noirâtre, et la posant sur la vitrine, à côté de l’épreuve photographique :
« Voilà, dit-il, la liqueur avec laquelle j’opère ; et vous pourrez, ajouta-t-il, en suivant mes instructions, obtenir le même résultat que moi. »
Après avoir donné à l’opticien les indications nécessaires pour opérer avec sa liqueur, l’inconnu se retira, emportant son épreuve photographique, et lui laissant sa fiole.
Resté seul, Chevalier se hâta de mettre à profit les indications de l’inconnu. Il exécuta les opérations prescrites. Seulement, telle était alors l’ignorance générale en fait de photographie, qu’il fit maladresses sur maladresses, et par exemple, qu’il n’eut pas l’idée de préparer son papier impressionnable, dans l’obscurité. Il opéra en pleine lumière. Toute réussite était impossible, car, nous n’avons pas besoin de le dire, pour qu’un papier photogénique puisse fournir une épreuve dans la chambre noire, il faut qu’il ait été préparé dans une obscurité complète. Charles Chevalier ne pouvait donc obtenir aucun résultat en opérant comme il le fit, en plein jour.
Il attendait une seconde visite de l’inconnu ; mais ce dernier ne reparut pas, et on ne le revit jamais.
Que devint ce pauvre inventeur ? La misère et la maladie se lisaient sur son visage. Quoique jeune encore, il était pâle et amaigri ; les privations matérielles et les angoisses de recherches passionnées, avaient altéré son organisation ; la lame avait usé le fourreau, Povreté empesche les bons espritz de parvenir, a dit Bernard Palissy[13]. L’hiver était triste et froid ; la vie était dure et difficile aux malheureux abandonnés sans ressources, dans la grande et égoïste capitale. La Seine fut-elle le dernier et sinistre refuge du malheureux ? Alla-t-il languir et expirer sur un lit d’hôpital ? Ou bien, — fin tout aussi déplorable, pour un homme voué à la poursuite ardente d’une idée, — alla-t-il s’ensevelir et vivre obscurément dans quelque place infime d’employé ou de commis ? Toutes les suppositions peuvent se faire sur ce personnage mystérieux, qui n’a laissé à l’histoire d’autre trace que l’apparition fugitive que nous venons de raconter.
Charles Chevalier, qui a fait connaître cette intéressante anecdote dans une de ses brochures : Guide du photographe, ajoute :
« J’attendis le retour de mon inconnu, mais jamais il ne revint, jamais personne n’en entendit parler ! Je ne sais autre chose de cet inventeur ignoré, sinon qu’il demeurait rue du Bac.
« Aujourd’hui je ne puis penser à cette singulière apparition sans éprouver un remords. Lorsque ce pauvre jeune homme me témoigna le regret de ne pouvoir se procurer une chambre obscure à prisme, j’aurais dû, j’en conviens, dans l’intérêt de l’art, lui faciliter les moyens de réaliser son désir ; mais tout en confessant le tort grave que j’eus en cette circonstance, j’ajouterai que je n’étais pas alors maître de disposer d’un appareil, et puis, j’avais aussi une marotte ! le perfectionnement du microscope étant l’unique but de toutes mes pensées, je n’accordai pas à cette intéressante communication l’attention qu’elle méritait[14]. »
Oui, Charles Chevalier, vous auriez dû, sinon faire cadeau à ce pauvre jeune homme de l’instrument qu’il désirait, du moins le lui prêter pour quelque temps, sur l’annonce de la découverte extraordinaire qui, d’après votre propre témoignage, vous frappa d’une si vive admiration. Ainsi vous auriez contribué à hâter l’apparition de l’une des plus curieuses découvertes des temps modernes, et vous auriez donné à la postérité le moyen de prononcer avec reconnaissance le nom de l’inventeur ignoré, qui, le premier, parvint à remporter ce beau triomphe sur la nature.
Tout ce que fit Charles Chevalier, après avoir essayé, tant bien que mal, la liqueur de son inconnu, et quand il ne le vit plus reparaître, ce fut de remettre la fiole à un peintre qui s’occupait de recherches sur le même sujet, c’est-à-dire qui travaillait à fixer les images de la chambre obscure.
Ce peintre s’appelait Daguerre.
Daguerre venait souvent voir l’opticien Chevalier, pour faire l’acquisition d’instruments, ou pour s’entretenir de son idée favorite : la fixation des images de la chambre obscure.
« Vous n’êtes pas le seul, lui dit l’opticien, la première fois qu’il vit Daguerre, à chercher la pierre philosophale. On marche sur vos brisées. Vous avez un rival, et un rival heureux. »
Lui racontant alors la visite de l’inconnu et les choses merveilleuses qu’il avait apprises de lui, Charles Chevalier dit à Daguerre, en lui remettant la fiole de l’inventeur :
« Voici l’or potable ! Essayez cette liqueur. Il est vrai que je n’en ai retiré rien de bon ; mais vous êtes plus expert que moi, et peut-être réussirez-vous. »
Daguerre emporta la fiole. Il la garda deux mois, et revint au bout de ce temps, chez l’opticien :
« Tous mes essais avec cette liqueur ont échoué, dit-il à l’opticien. Le secret de votre jeune homme n’était pas dans sa bouteille. »
Mais il est temps de faire plus ample connaissance avec Daguerre, dont le nom vient d’apparaître incidemment dans notre récit. Daguerre était un artiste ; il n’était rien moins qu’un savant. Il appartenait à cette classe d’infatigables chercheurs, qui, sans trop de connaissances techniques, avec un bagage des plus minces, s’en vont loin des chemins courus, par monts et par vaux, cherchant l’impossible, appelant l’imprévu, invoquant tout bas le dieu Hasard : Daguerre, pour tout dire, était un demi-savant.
La race des demi-savants est assez dédaignée, l’ignorance surtout aime à l’accabler de ses mépris ; cependant il est peut-être bon de n’en pas trop médire. Les demi-savants font peu de mal à la science, et de loin en loin, ils font des trouvailles inespérées. Précisément parce qu’ils sont malhabiles à apprécier d’avance les éléments infinis d’un problème scientifique, ils se jettent du premier abord, au travers des difficultés les plus ardues ; ils touchent intrépidement aux questions les plus élevées et les plus graves, comme un enfant insouciant et curieux touche, en se jouant, aux ressorts d’une machine immense. Et parfois ils arrivent ainsi à des résultats si étranges, à de si prodigieuses inventions, que les véritables savants en restent eux-mêmes confondus d’admiration et de surprise. Ce n’est pas un savant qui a découvert la boussole, c’est un bourgeois du royaume de Naples. Ce n’est pas un savant qui a découvert le télescope, ce sont deux enfants qui jouaient dans la boutique d’un lunetier de Middlebourg. Ce n’est pas un savant qui a réalisé les applications pratiques de la vapeur, ce sont deux ouvriers du Devonshire, le serrurier Thomas Newcomen et le vitrier Jean Cawley ; et l’illustre James Watt, qui porta la machine à vapeur à un si haut degré de perfection, n’était, dans sa jeunesse, qu’un pauvre fabricant d’instruments de la ville de Glasgow. Ce n’est pas un savant qui a découvert la vaccine, ce sont des bergers du Languedoc. Ce n’est pas un savant qui a imaginé la lithographie, c’est un chanteur du théâtre de Munich. Il est donc prudent de ménager un peu cette race utile des demi-savants. C’est parce que Daguerre n’était qu’un demi-savant, que la photographie existe. Assurément, s’il eût été un savant complet, il n’eût pas ignoré qu’en se proposant de créer des images par l’action chimique de la lumière, il se posait en face des plus graves difficultés de la science ; il se fût rappelé qu’en France, le physicien Charles, en Angleterre l’illustre Humphry Davy, et le patient Wedgwood, après mille essais infructueux, avaient regardé ce problème comme insoluble. Le jour où cette pensée audacieuse entra dans son esprit, il l’eût donc reléguée aussitôt à côté des rêveries de Cyrano Bergerac ; il eût tout au plus poussé un soupir de regret et passé outre. Heureusement pour la science et les arts, Daguerre n’était qu’un artiste, un amateur de sciences.
Louis-Jacques-Mandé Daguerre était né ne 1787, à Cormeilles, village des environs de Paris[15]. Ses premières études furent négligées, comme celles de tous les hommes venus à cette époque pleine d’agitation et de gloire. Ses parents l’avaient laissé libre de travailler à sa guise, et comme il ressentait une véritable vocation pour la peinture, il s’y livra avec ardeur dès sa jeunesse. Mais il se trouvait à l’étroit sur une toile de chevalet, et il avait une prédilection marquée pour la peinture à effet. Il excellait à retracer, dans le paysage, les résultats de la perspective. C’est pour cela qu’il se voua à la peinture théâtrale. Il entra chez Degotti, qui était chargé des décors du grand Opéra.
Degotti reconnut bien vite les heureuses qualités de son élève, la promptitude de sa main et le fini de son exécution.
L’art des décorations théâtrales était demeuré, jusque-là, dans un véritable état d’enfance. On ne demandait les effets qu’à l’agencement des couleurs. Daguerre voulut leur ajouter les combinaisons et les jeux de la lumière. Il fut le premier à remplacer les simples châssis des coulisses, par de grands tableaux de fond, peints avec recherche et avec étude, et qui empruntaient une valeur nouvelle aux artifices d’un éclairage puissant, distribué avec art.
C’est au théâtre de l’Ambigu-Comique que Daguerre se produisit, pour la première fois, comme décorateur hors ligne. La lune mobile, du Songe ; le soleil tournant, de la Lampe merveilleuse ; l’effet de nuit, du Vampire ; le décor du second acte de Calas, du Belvédère, des Machabées, etc., firent une révolution dans l’art de la peinture théâtrale.
Outre cela, Daguerre était excellent danseur ; il avait la passion de l’art qui illustra Vestris. Il aimait à se mêler, pendant les répétitions, et même les représentations de l’Opéra, aux groupes chorégraphiques, et plus d’une fois on put l’admirer sans que son nom fût sur l’affiche. Il paraissait incognito dans les féeries ; il dansait par amour de l’art, et recueillait pour son plaisir les applaudissements de la salle. Il était même excellent acrobate, et aimait à faire son entrée dans un salon d’artiste, la tête en bas, en marchant sur les mains. C’était, on le voit, un homme de fantaisie.
Cependant son esprit ne pouvait se contenter longtemps des travaux de peintre décorateur, ni de ces amusements de jeunesse. Il y avait alors, à Paris, un peintre aujourd’hui tout à fait oublié, mais qui fut un moment le rival d’Horace Vernet : c’était Bouton. Daguerre s’associa à lui, et tous deux inventèrent une véritable merveille, qui reçut le nom de Diorama.
Le 1er juillet 1822, le public se rendait en foule à l’ouverture d’un établissement nouveau situé sur les boulevards, et dont quelques personnes privilégiées, qui avaient pu en jouir par avance, avaient raconté les surprises merveilleuses. Pendant plusieurs années ce spectacle fut l’objet d’une admiration universelle. C’étaient d’immenses toiles, d’un fini d’exécution parfait et qui représentaient la nature avec une prodigieuse vérité.
Mais ce n’était là que l’une des faces de ce spectacle nouveau. L’intérêt particulier et la nouveauté de ce spectacle, c’était le changement graduel de scènes, qui se fondaient, pour ainsi dire, les unes dans les autres, pour se remplacer sous les yeux du spectateur, sans aucun changement apparent. On entrait, et l’on se voyait, par exemple, devant la vallée de Sarnen, en Suisse. Un instant après, grâce à un simple changement dans la manière d’éclairer le tableau, changement dont le spectateur n’avait aucunement conscience, on se trouvait en face d’une chapelle, aux vitraux gothiques, dont la cloche, tintant avec régularité, invitait à la prière. Ce n’était plus un paysage, c’était une chapelle : la chapelle d’Holyrood et le tombeau de Charles X.
Apparaissait ensuite une tranquille vallée de la Suisse : la vallée de Goldau. C’était un lac paisible, dormant au-dessous d’une montagne couverte de sapins et baignant les dernières maisons d’un village. La tranquillité de cette scène champêtre, l’harmonie et la vérité du tableau, transportaient le spectateur au milieu des plus riantes scènes de la nature. Mais tout à coup, le ciel s’assombrissait ; une violente secousse ébranlait la montagne, qui s’abattait tout entière sur le malheureux village, et couvrait la moitié du lac de ses débris. Au lieu de la scène paisible et sereine de tout à l’heure, on avait sous les yeux le spectacle confus de la destruction et des ruines : c’était l’éboulement de la montagne dans la vallée de Goldau.
Une autre fois c’était la basilique de Saint-Pierre qui se montrait aux yeux des spectateurs ; puis insensiblement l’église métropolitaine de la chrétienté, disparaissait, pour faire place à une vue de la campagne romaine[16].

La perfection de tous ces tableaux était poussée si loin, que plus d’une fois on vit un spectateur jeter contre la peinture, des boulettes de papier, pour s’assurer si l’espace était devant lui, ou si c’était une simple toile.

Un fait qui a été cité par le secrétaire de la Société des beaux arts, prouve suffisamment la perfection de ces imitations de la nature. Daguerre avait exposé la vue du tombeau de Napoléon à Sainte-Hélène. Le lieu était sauvage, le terrain pierreux, entouré de rochers abrupts ; la mer terminait, au loin, l’horizon. Un jeune élève peintre se présente un jour, sa boîte, à couleurs sous le bras, et demande à Daguerre la permission de travailler et de faire des études, comme devant la nature même. Si ce n’était pas de la naïveté, c’était l’éloge le plus désintéressé que pût rêver un artiste ; mais Daguerre n’en abusa pas :
« Venez me voir, tant que vous voudrez, dit-il au jeune enthousiaste, mais ne travaillez pas ici : on ne copie pas des copies. Pour étudier sérieusement, allez dans la campagne. »
Daguerre faisait ses tableaux de mémoire. Il avait exposé le Diorama de la forêt Noire, prise de nuit, par un clair de lune. Sur le premier plan, était un feu, abandonné sans doute par des voleurs ; et cette vue faisait courir, parmi les spectateurs, un frisson d’effroi. On se croyait en pleine forêt, par une nuit obscure, et l’on s’imaginait que quelque voleur était encore caché dans les taillis. Daguerre était là, entendant les sourdes exclamations qu’arrachait l’admiration, ou la crainte involontaire et vague, d’un danger imaginaire.
« Comment avez-vous pu, lui demanda quelqu’un, peindre vos esquisses la nuit, au milieu d’une forêt.
— Je n’ai pas fait d’esquisse sur les lieux, répondit Daguerre. Je me suis promené une nuit, seul dans la forêt, et de retour à Paris, j’ai peint ma Forêt Noire de souvenir. »
Les peintres voyaient dans cette exécution de mémoire un tour de force, qu’aurait pu seul accomplir Horace Vernet, cet improvisateur extraordinaire, à qui il suffisait d’avoir vu une fois une scène ou une personne, pour les représenter sur la toile.
Le succès de son diorama et la juste réputation qu’il en retirait, auraient suffi à la fortune et à l’ambition d’un autre : Daguerre voulut aller plus loin.
Il faisait un usage constant de la chambre obscure, pour certaines études d’éclairage de son Diorama. Aucun tableau n’est plus ravissant, aucune vue n’est plus harmonieuse, que ceux qui viennent se former sur l’écran d’une chambre obscure. C’est la nature colorée et vivante. Daguerre s’était écrié cent fois, en contemplant les tableaux qui se succédaient sur la glace dépolie de sa chambre obscure :
« Ne réussira-t-on jamais à fixer des images aussi parfaites ! »
Cette idée séduisante, ce désir presque fantastique, ce rêve de l’impossible, avaient fini par s’emparer de son imagination, et par la subjuguer. Il avait assisté aux cours du professeur Charles, et il avait admiré, comme tous les auditeurs de ce physicien si écouté, les silhouettes qu’il exécutait en recevant sur une feuille de papier, enduite de chlorure d’argent, les images formées dans la chambre obscure. Il avait sans cesse devant les yeux ce résultat matériel et visible de la possibilité de fixer les images de la chambre noire, et il se disait ; « J’irai plus loin ! je fixerai définitivement ces fugitives empreintes ! »
Daguerre employait donc tous les instants de loisir que lui laissaient ses occupations et ses travaux du Diorama, à étudier les procédés et les moyens physiques ou chimiques, propres à conserver et à rendre durables les images de la chambre noire. C’est dans ce but qu’il fréquentait, comme nous l’avons vu, l’atelier et la boutique de Charles Chevalier. Aucune semaine ne se passait sans qu’il allât consulter cet opticien, sur les appareils dont il faisait usage, ou sur les moyens de procéder à ses expériences.
« Il était fort rare, dit Charles Chevalier, qu’il ne vînt pas une fois par semaine à notre atelier. Comme on le pense bien, le sujet de la conversation ne variait guère, et si parfois on se laissait aller à quelque digression, c’était pour revenir bientôt, avec une ardeur nouvelle, à la disposition de la chambre obscure, à la forme des verres, à la pureté des images[17]. »
Il était écrit que la boutique de l’opticien du quai de l’Horloge, serait le théâtre de tous les événements qui préparaient la venue et la création de la photographie. On vient de voir que Daguerre y fut mis en rapport avec le mystérieux inconnu, qui avait emporté avec lui son secret. Nous allons dire maintenant comment ce fut dans cette même boutique, que Daguerre connut les travaux de Nicéphore Niépce, avec lequel il devait contracter plus tard une association ayant pour but la poursuite de leurs découvertes respectives.
Pendant que Daguerre s’occupait, à Paris, avec la plus grande ardeur, d’approfondir le problème pratique de la fixation des images de la chambre obscure, Nicéphore Niépce continuait, à Châlon, le même ordre de recherches. Mais ils ignoraient l’un et l’autre cette communauté de travaux. Le peintre parisien, qui se flattait de parvenir à fixer les images de la chambre noire, ne connaissait pas l’existence de l’officier en retraite qui s’occupait du même problème, dans sa maison de campagne des bords de la Saône. Ce fut Charles Chevalier qui les mit en rapport. Peu de temps après la visite du jeune homme que nous avons racontée, c’est-à-dire au mois de décembre 1825, Daguerre revint chez Charles Chevalier, tout rayonnant de joie :
« J’ai réussi, s’écria-t-il, j’ai saisi la lumière au passage, et je l’ai enchaînée. J’ai forcé le soleil à peindre des tableaux ! j’ai fixé l’image de la chambre obscure ! »
Malgré ses exclamations enthousiastes, Daguerre aurait été fort en peine de prouver ce qu’il annonçait. Comme il ne montrait aucun spécimen à l’appui de ses affirmations, on prenait ses dires comme le résultat de son exaltation de chercheur. Peut-être avait-il, en effet, réussi à obtenir une image ; il n’y avait pas de raison sérieuse de douter de ses paroles, mais sans doute il avait échoué pour la fixer à jamais. La captive s’était évanouie ; elle était remontée vers la source suprême d’où elle émanait.
Charles Chevalier avait regardé jusque-là comme assez chimériques toutes les idées de Daguerre ; mais l’aventure du jeune inconnu l’avait fait réfléchir. Dans les derniers jours du mois de janvier 1826, comme Daguerre revenait encore devant lui sur son sujet favori, il lui dit :
« Outre notre jeune homme de la rue du Bac, il y a encore, en province, une personne qui se flatte d’avoir obtenu, de son côté, le même résultat que vous. Peut-être feriez-vous bien de vous mettre en rapport avec elle.
— Et quel est cet heureux émule ? demanda Daguerre
— Voici, reprit Chevalier, ce qui s’est passé ici, il y a peu de jours. Un officier en retraite, le colonel Niépce de Senneçay, qui habite Châlon-sur-Saône, est venu m’acheter un objectif destiné à une chambre obscure. Il a ajouté qu’il faisait cette acquisition pour un de ses cousins, lequel s’occupe de fixer l’image de la chambre obscure, et même y serait parvenu. Plusieurs personnes se trouvaient avec moi, quand cette communication me fut faite. Notre surprise à tous a été grande, vous pouvez le croire ; et il s’est même élevé une discussion assez sérieuse sur la possibilité d’un tel résultat. Quoi qu’il en soit, le colonel acheta et paya la chambre obscure, que j’ai expédiée le lendemain à son parent de Châlon-sur-Saône. Peut-être, je le répète, feriez-vous bien de vous mettre en rapport avec lui et de joindre vos efforts aux siens, pour arriver au but que vous poursuivez chacun de votre côté. »
Comme tous les hommes pénétrés de leur supériorité et confiants en eux-mêmes, Daguerre n’aimait pas les conseils.
« À quoi bon ? répondit-il, et pourquoi me mettre en rapport avec la personne dont vous me parlez ? J’ai déjà trop donné dans les utopies. Votre homme est encore quelque songe-creux. »
Cependant il se ravisa, et demanda l’adresse de l’utopiste de province.
Charles Chevalier prit une plume, et écrivit ces mots sur une carte : « M. Niépce, propriétaire, aux Gras, près Châlon-sur-Saône. »
Daguerre sortit, sans en dire davantage. Il reprit ses expériences et ses recherches, et pendant quelques jours il se laissa totalement absorber par elles. Mais le résultat ne répondait pas à son attente. Il songea alors à ce propriétaire de Châlon-sur-Saône, qui se flattait d’avoir triomphé des difficultés devant lesquelles il se heurtait en vain lui-même, et il se décida à lui écrire.
Niépce accueillit avec défiance les ouvertures de Daguerre. Lui qui, dans sa correspondance avec son frère, évitait de décrire les noms des substances qu’il essayait, de peur que ses lettres ne fussent lues par quelque indiscret, ne pouvait que répondre avec la plus excessive réserve aux demandes d’un étranger. Les provinciaux de la bonne roche nourrissent de grandes défiances à l’endroit des Parisiens : « Bon, disait Nicéphore Niépce, voilà un de ces Parisiens qui veut me tirer les vers du nez[18]. » Il se décida à lui répondre, mais il le fit « avec toute la circonspection d’un homme qui craint de compromettre son secret[19]. »
La première lettre adressée par Daguerre à Nicéphore Niépce, et la réponse de ce dernier, sont des 25 et 26 janvier 1826. Daguerre, après cette première ouverture, laissa s’écouler plus d’un an, sans revenir à la charge. Ce ne fut qu’à la fin de janvier 1827, qu’il écrivit de nouveau à Niépce.
Daguerre annonçait au physicien de Châlon, que, depuis longtemps, il s’occupait, lui aussi, de la fixation des images de la chambre obscure, et qu’il était arrivé à quelques résultats. Il désirait connaître ceux que Niépce avait obtenus de son côté, et le priait, en conséquence, de lui faire parvenir une de ses épreuves.
Devant cette insistance, Nicéphore Niépce, en homme bien avisé, commença par demander à Paris, des renseignements sur Daguerre. Il était en correspondance suivie avec Lemaître, graveur habile, à qui il avait confié les essais pour la gravure de ses planches héliographiques. Dans le post-scriptum d’une lettre qu’il écrivait à cet artiste, le 2 février 1827, il lui demanda des renseignements sur Daguerre. Ce ne fut que sur la réponse extrêmement favorable de Lemaître, que Niépce se décida à répondre à la nouvelle lettre du peintre parisien. Il n’eut garde, toutefois, de lui rien envoyer qui se rapportât à ses travaux. Voici les termes de sa réponse, chef-d’œuvre de laconisme et de prudence :
- « Monsieur,
« J’ai reçu hier votre réponse à ma lettre du 25 janvier 1826. Depuis quatre mois je ne travaille plus ; la mauvaise saison s’y oppose absolument. J’ai perfectionné d’une manière sensible mes procédés pour la gravure sur métal ; mais les résultats que j’ai obtenus ne m’ayant point encore fourni d’épreuves assez correctes, je ne puis satisfaire le désir que vous me témoignez. Je dois sans doute le regretter plus pour moi que pour vous, Monsieur, puisque le mode d’application auquel vous vous livrez est tout différent, et vous promet un degré de supériorité que ne comporterait pas celui de la gravure ; ce qui ne m’empêche pas de vous souhaiter tout le succès que vous pouvez ambitionner. »
Daguerre, qui espérait recevoir une des épreuves de Niépce, et découvrir peut-être la substance impressionnable employée par l’expérimentateur de Châlon, ne fut pas satisfait de cette réponse. Ce fut sans doute pour provoquer l’envoi d’une des épreuves qu’il désirait tant, qu’au mois de mars suivant, il fit hommage à Niépce d’un dessin à la sépia, terminé par un procédé qui lui était particulier.
C’est ce qui résulte d’une lettre de Niépce au graveur Lemaître, lettre citée, comme la précédente, par M. Fouque, à l’ouvrage duquel nous empruntons tous ces documents, précieux pour l’histoire des origines de la photographie.
« J’avais oublié de vous dire, dans ma dernière lettre, écrit Niépce le 3 avril 1827, que M. Daguerre m’a écrit et m’a envoyé un petit dessin très-élégamment encadré, fait à la sépia et terminé à l’aide de son procédé. Ce dessin, qui représente un intérieur, produit beaucoup d’effet, mais il est difficile de déterminer ce qui est uniquement le résultat de l’application du procédé, puisque le pinceau y est intervenu. Peut-être, Monsieur, connaissez-vous déjà cette sorte de dessin que l’auteur appelle Dessin-fumée, et qui se vend chez Alphonse Giroux.
« Quelle qu’ait pu être l’intention de M. Daguerre, comme une prévenance en vaut une autre, je lui ferai passer une planche d’étain, légèrement gravée d’après mes procédés, en choisissant pour sujet une des gravures que vous m’avez envoyées, cette communication ne pouvant en aucune manière compromettre le secret de ma découverte[20]. »
Ce que Niépce envoyait à Daguerre, ne pouvait, en effet, mettre le chercheur parisien sur la voie de ses travaux. C’était simplement une planche d’étain, sur laquelle il avait transporté l’empreinte d’une gravure, la Sainte Famille, et qu’il avait ensuite légèrement attaquée par l’eau-forte, pour en faire une planche en taille-douce. Il avait eu bien soin, d’ailleurs, d’enlever de cette planche toute trace du bitume de Judée qui avait servi à recevoir l’empreinte de la lumière, à travers les blancs de l’estampe à reproduire. Il accompagna cet envoi à Daguerre de la lettre suivante :
- « Monsieur,
« Vous recevrez presque en même temps que ma lettre, une caisse contenant une planche d’étain gravée d’après mes procédés héliographiques, et une épreuve de cette même planche, très-défectueuse et beaucoup trop faible. Vous jugerez par là que j’ai besoin de toute votre indulgence, et que si je me suis décidé à vous adresser cet envoi, c’est uniquement pour répondre au désir que vous avez bien voulu me témoigner. Je crois, malgré cela, que ce genre d’application n’est pas à dédaigner, puisque j’ai pu, quoique étranger à l’art du dessin et de la gravure, obtenir un semblable résultat. Je vous prie, Monsieur, de me dire ce que vous en pensez. Ce résultat n’est pas même récent, il date du printemps passé ; depuis lors j’ai été détourné de mes recherches par d’autres occupations. Je vais les reprendre, aujourd’hui que la campagne est dans tout l’éclat de sa parure, et me livrer exclusivement à la copie des points de vue d’après nature. C’est sans doute ce que cet objet peut offrir de plus intéressant ; mais je ne me dissimule point non plus les difficultés qu’il présente au travail de la gravure. L’entreprise est donc bien au-dessus de mes forces ; aussi toute mon ambition se borne-t-elle à pouvoir démontrer par des résultats plus ou moins satisfaisants la possibilité d’une réussite complète, si une main habile et exercée aux procédés de l’aqua tinta coopérait par la suite à ce travail. Vous me demanderez probablement, Monsieur, pourquoi je grave sur étain au lieu de graver sur cuivre. Je me suis bien servi également de ce dernier métal, mais pour mes premiers essais j’ai dû préférer l’étain, dont je m’étais d’ailleurs procuré quelques planches destinées à mes expériences dans la chambre noire ; la blancheur éclatante de ce dernier métal le rendait bien plus propre à réfléchir l’image des objets représentés.
« Je pense, Monsieur, que vous aurez donné suite à vos premiers essais ; vous étiez en trop beau chemin pour en rester là ! Nous occupant du même objet, nous devons trouver un égal intérêt dans la réciprocité de nos efforts pour atteindre le but. J’apprendrai donc avec bien de la satisfaction que la nouvelle expérience que vous avez faite à l’aide de votre chambre noire perfectionnée a eu un succès conforme à votre attente. Dans ce cas, Monsieur, et s’il n’y a pas d’indiscrétion de ma part, je serais aussi désireux d’en connaître le résultat que je serais flatté de pouvoir vous offrir celui de mes recherches du même genre qui vont m’occuper[21]. »
En adressant à Daguerre un échantillon de ses produits, Niépce manifestait le désir, assez naturel, de connaître le résultat des travaux de son correspondant sur le même sujet ; mais rien ne lui fut envoyé.
Deux mois après, c’est-à-dire au mois d’août 1827, Nicéphore Niépce reçut une affligeante nouvelle : son frère Claude Niépce était dangereusement malade à Kew. Depuis dix ans Claude Niépce se fatiguait l’esprit à la poursuite de toute sorte d’inventions mécaniques ; ce qui avait fini par compromettre sa santé sans retour.
Nicéphore Niépce se hâta de partir pour l’Angleterre, accompagné de sa femme, pour prodiguer à son frère ses soins affectueux. Mais la difficulté de trouver place dans les voitures publiques de Paris à Calais, ou les retards que lui occasionnèrent ses démarches pour obtenir un passe-port, lui firent prolonger son séjour à Paris, plus qu’il ne l’aurait voulu.
Il profita de ce séjour forcé dans la capitale, pour aller trouver Daguerre, ainsi que le graveur Lemaître.
La lettre suivante, écrite par Nicéphore Niépce à son fils Isidore, et citée par M. Victor Fouque, donne d’intéressants détails sur les rapports qui s’établirent alors entre Niépce et Daguerre.
« J’ai eu, écrit Nicéphore Niépce à son fils, de fréquentes et longues entrevues avec M. Daguerre. Il est venu nous voir hier. La séance a été de trois heures ; nous devons retourner chez lui avant notre départ, et je ne sais trop le temps que nous y resterons ; car ce sera pour la dernière fois, et la conversation, sur le chapitre qui nous intéresse, est vraiment intarissable.
« Je ne puis, mon cher Isidore, que te répéter ce que j’ai dit à M. de Champmartin. Je n’ai rien vu ici, qui m’ait plus frappé, qui m’ait fait plus de plaisir que le Diorama. Nous y avons été conduits par M. Daguerre, et nous avons pu contempler tout à notre aise les magnifiques tableaux qui y sont exposés. La vue intérieure de Saint-Pierre de Rome, par M. Bouton, est bien à coup sûr quelque chose d’admirable et qui produit l’illusion la plus complète. Mais rien n’est au-dessus des deux vues peintes par M. Daguerre : l’une d’Edimbourg, prise au clair de lune, au moment d’un incendie ; l’autre d’un village suisse, prise à l’entrée d’une grande rue, et en face d’une montagne d’une hauteur prodigieuse, couverte de neiges éternelles. Ces représentations sont d’une telle vérité, même dans les plus petits détails, qu’on croit voir la nature agreste et sauvage avec tout le prestige que lui prêtent le charme des couleurs et la magie du clair-obscur. Le prestige est même si grand, qu’on serait tenté de sortir de sa loge pour parcourir la plaine et gravir jusqu’au sommet de la montagne. Il n’y a pas, je t’assure, la moindre exagération de ma part, les objets étant d’ailleurs ou paraissant de grandeur naturelle. Ils sont peints sur toile ou taffetas enduits d’un vernis qui a l’inconvénient de poisser ; ce qui nécessite des précautions lorsqu’il s’agit de rouler cette sorte de décoration pour la transporter : car il est difficile, en la déroulant, de ne pas faire quelque déchirure.
« Mais revenons à M. Daguerre. Je te dirai, mon cher Isidore, qu’il persiste à croire que je suis plus avancé que lui dans les recherches qui nous occupent. Ce qui est bien démontré maintenant, c’est que son procédé et le mien sont tout à fait différents. Le sien a quelque chose de merveilleux, et dans les effets une promptitude qu’on peut comparer à celle du fluide électrique. M. Daguerre est parvenu à fixer sur sa substance chimique quelques-uns des rayons colorés du prisme ; il en a déjà réuni quatre et il travaille à réunir les trois autres, afin d’avoir les sept couleurs primitives. Mais les difficultés qu’il rencontre croissent dans le rapport des modifications que cette même substance doit subir pour pouvoir retenir plusieurs couleurs à la fois ; ce qui le contrarie le plus surtout, et le déroute entièrement, c’est qu’il résulte de ces combinaisons diverses des effets tout opposés. Ainsi, un verre bleu, qui projette sur ladite substance une ombre plus foncée, produit une teinte plus claire que la partie soumise à l’impression directe de la lumière. D’un autre côté, cette fixation des couleurs élémentaires se réduit à des nuances fugitives si faibles qu’on ne les aperçoit point en plein jour ; elles ne sont visibles que dans l’obscurité, et voici pourquoi : La substance en question est de la nature de la pierre de Bologne et du pyrophore ; elle est très-avide de lumière, mais elle ne peut la retenir longtemps, parce que l’action un peu prolongée de ce fluide finit par la décomposer ; aussi M. Daguerre ne prétend point fixer par ce procédé l’image colorée des objets, quand bien même il parviendrait à surmonter tous les obstacles qu’il rencontre : il ne pourrait employer ce moyen que comme intermédiaire. D’après ce qu’il m’a dit, il aurait peu d’espoir de réussir, et ses recherches ne seraient guère autre chose qu’un objet de pure curiosité. Mon procédé lui paraît donc préférable et beaucoup plus satisfaisant à raison des résultats que j’ai obtenus. Il sent combien il serait intéressant pour lui de se procurer des points de vue à l’aide d’un procédé également simple, facile et expéditif. Il désirerait que je fisse quelques expériences avec des verres colorés, afin de savoir si l’impression produite sur ma substance serait la même que sur la sienne. Je viens d’en demander cinq à Chevalier (Vincent), qui en a déjà fait pour M. Daguerre. Celui-ci insiste principalement sur la grande célérité dans la fixation des images ; condition bien essentielle, en effet, et qui doit être le premier objet de mes recherches. Quant au mode d’application à la gravure sur métal, il est loin de le déprécier ; mais comme il serait indispensable de retoucher et de creuser avec le burin, il croit que cette application ne réussirait que très-imparfaitement pour les points de vue. Ce qui lui semble bien préférable pour ce genre de gravure, c’est le verre en employant l’acide fluorique. Il est persuadé que l’encre d’impression appliquée avec soin à la surface corrodée par l’acide, produirait sur un papier blanc l’effet d’une bonne épreuve, et aurait de plus quelque chose d’original qui plairait encore davantage. Le composé chimique de M. Daguerre est une poudre très-fine qui n’adhère point au corps sur lequel on la projette : ce qui nécessite un plan horizontal. Cette poudre au moindre contact de la lumière devient si lumineuse que la chambre noire en est parfaitement éclairée. Ce procédé a la plus grande analogie, autant que je puis me le rappeler, avec le sulfate de baryte ou la pierre de Bologne, qui jouit également de la propriété de retenir certains rayons du prisme…
« Nos places sont retenues pour Calais, et nous partons décidément samedi prochain, à 8 heures du matin. Nous n’avons pas pu les avoir plus tôt ; le voyage du Roi à Calais attire beaucoup de monde de ce côté… Adieu, reçois, ainsi que Génie et votre cher enfant, nos embrassements et l’assurance de notre tendre affection[22]. »
Il paraît résulter de cette lettre que le procédé employé par Daguerre pour fixer l’image de la chambre obscure, consistait à projeter sur la plaque du sulfate de baryte calciné, ou plutôt du sulfure de barium, ou pierre de Bologne, qui devient lumineux par l’exposition à la lumière solaire ou diffuse. Mais comment cette impression était-elle ensuite conservée ? Il est probable que Daguerre n’avait pu y parvenir.
Nicéphore Niépce, en arrivant en Angleterre, trouva son frère assez gravement malade. Ce trop ardent chercheur avait fini par trouver le mouvement perpétuel, ce qui veut dire qu’un travail excessif avait altéré les facultés de son intelligence. À cela se joignait une hydropisie grave.
Nicéphore Niépce passa plusieurs semaines auprès de son frère, puis il repartit pour la France.
Pendant son séjour à Kew, il avait fait la connaissance d’un physicien très-instruit, membre de la Société royale de Londres, sir Francis Bauer, et il lui avait communiqué les résultats de ses travaux héliographiques. Sir Francis Bauer l’engagea à soumettre sa découverte à la Société royale de Londres.
En effet, Niépce rédigea une note sur l’héliographie, dont M. Victor Fouque cite le texte[23], et qu’il serait superflu de reproduire, car on n’y trouve mentionnés que les résultats de la méthode de Niépce, et non ses procédés opératoires.
Ce fut précisément cette absence de description des procédés, qui empêcha le mémoire de Nicéphore Niépce d’être accepté par la Société royale de Londres. Dans cette société savante, comme dans l’Académie des sciences de Paris, on n’admet aucun travail, quand l’auteur persiste à tenir ses opérations secrètes. Comme Nicéphore Niépce refusait de donner communication de ses procédés, le mémoire qu’il avait adressé à la Société royale, ainsi que les épreuves qu’il avait présentées, lui furent rendus, et la Société ne s’occupa plus de cet objet.
Niépce, traversant de nouveau Paris, à son retour de Londres, se présenta de nouveau chez Daguerre ; mais il n’emporta que le regret de n’avoir rien acquis sur ses travaux.
Cependant la correspondance ne fut pas interrompue entre eux. Daguerre assurait avoir découvert, de son côté, un procédé pour la fixation des images de la chambre obscure, procédé tout différent de celui de M. Niépce, et qui avait même sur lui un degré de supériorité ; il parlait aussi d’un perfectionnement qu’il avait apporté à la construction de la chambre noire.
Séduit par cette assurance et estimant que ses procédés en étaient parvenus à un point tel qu’il lui serait difficile, en restant livré à ses seules ressources au fond de sa province, de les faire beaucoup avancer, Niépce proposa à Daguerre de s’associer à lui, pour s’occuper en commun des perfectionnements que réclamait son invention.
Après de longs pourparlers, Daguerre se rendit à Châlon. Là, un traité fut passé entre eux, le 14 décembre 1829.
Nous reproduirons ici le texte de cette pièce historique :
« Entre les soussignés, M. Joseph-Nicéphore Niépce propriétaire, demeurant à Châlon-sur-Saône, département de Saône-et-Loire, d’une part ; et
M. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, artiste peintre, membre de la Légion d’honneur, administrateur du Diorama, demeurant à Paris, au Diorama, d’autre part ;
« Lesquels pour parvenir à l’établissement de la société qu’ils se proposent de former entre eux, ont préalablement exposé ce qui suit :
« M. Niépce, désirant fixer par un moyen nouveau sans avoir recours à un dessinateur, les vues qu’offre la nature, a fait des recherches à ce sujet ; de nombreux essais, constatant cette découverte, en ont été le résultat. Cette découverte consiste dans la reproduction spontanée des images reçues dans la chambre noire.
« M. Daguerre, auquel il a fait part de sa découverte, en ayant apprécié tout l’intérêt, d’autant mieux qu’elle est susceptible d’un grand perfectionnement, offre à M. Niépce de s’adjoindre à lui pour parvenir à ce perfectionnement, et de s’associer pour retirer tous les avantages possibles, de ce nouveau genre d’industrie.
« Cet exposé fait, les sieurs comparants ont arrêté entre eux de la manière suivante les statuts provisoires et fondamentaux de leur association :
« Article 1er. Il y a entre MM. Niépce et Daguerre, société, sous la raison de commerce Niépce-Daguerre, pour coopérer au perfectionnement de ladite découverte, inventée par M. Niépce, et perfectionnée par M. Daguerre.
« Art. 2. La durée de cette société sera de dix années, à partir du 14 décembre courant ; elle ne pourra être dissoute avant ce terme, sans le consentement mutuel des parties intéressées. En cas de décès de l’un des deux associés, celui-ci sera remplacé dans ladite société, pendant le reste des dix années qui ne seraient pas expirées, par celui qui le remplace naturellement. Et encore en cas de décès de l’un des deux associés, ladite découverte ne pourra jamais être publiée que sous les deux noms désignés dans l’article 1er.
« Art. 3. Aussitôt après la signature du présent traité, M. Niépce devra confier à M. Daguerre, sous le sceau du secret qui devra être conservé à peine de tous dépens, dommages et intérêts, le principe sur lequel repose sa découverte, et lui fournir les documents les plus exacts et les plus circonstanciés, sur la nature, l’emploi et les différents modes d’application des procédés qui s’y rattachent, afin de mettre par là plus d’ensemble et de célérité dans les recherches et les expériences dirigées vers le but du perfectionnement et de l’utilisation de la découverte.
« Art. 4. M. Daguerre s’engage sous les susdites peines, à garder le plus grand secret, tant sur le principe fondamental de la découverte, que sur la nature, l’emploi et les explications des procédés qui lui seront communiqués, et à coopérer autant qu’il lui sera possible aux améliorations jugées nécessaires, par l’utile intervention de ses lumières et de ses talents.
« Art. 5. M. Niépce met et abandonne à la Société, à titre de mise, son invention, représentant la valeur de la moitié des produits dont elle sera susceptible ; et M. Daguerre y apporte une nouvelle combinaison de chambre noire, ses talents et son industrie équivalant à l’autre moitié des susdits produits.
« Art. 6. Aussitôt après la signature du présent traité, M. Daguerre devra confier à M. Niépce, sous le sceau du secret, qui devra être conservé à peine de dépens, dommages et intérêts, le principe sur lequel repose le perfectionnement qu’il a apporté à la chambre noire, et lui fournir les documents les plus précis sur la nature dudit perfectionnement.
« Art. 7. Les sieurs Niépce et Daguerre fourniront par moitié à la caisse commune, les fonds nécessaires à l’établissement de cette Société »
« Art. 8. Lorsque les associés jugeront convenable de faire l’application de ladite découverte au procédé de la gravure, c’est-à-dire de constater les avantages qui résulteraient pour un graveur de l’application desdits procédés, qui lui procureraient par là une ébauche avancée, MM. Niépce et Daguerre s’engagent à ne choisir aucune autre personne que M. Lemaître, pour faire ladite application.
« Art. 9. Lors du traité définitif, les associés nommeront entre eux le directeur et le caissier de la Société, dont le siége sera à Paris. Le directeur dirigera les opérations arrêtées par les associés ; et le caissier recevra et payera les bons et mandats délivrés par le directeur, dans l’intérêt de la Société.

Après la signature de cet acte d’association, Niépce donna connaissance à Daguerre de son procédé héliographique. Ce procédé était décrit dans une Notice sur l’héliographie, qui fut annexée au traité, et que nous allons reproduire, parce qu’elle renferme l’idée la plus précise que l’on puisse désirer de la méthode de Niépce et des résultats auxquels l’inventeur avait été conduit, résultats assez médiocres, comme on va le voir, malgré les longues années qu’il avait consacrées à ses recherches.
« Notice sur l’Héliographie. — La découverte que j’ai faite et que je désigne sous le nom d’Héliographie consiste à reproduire spontanément, par l’action de la lumière, avec les dégradations de teintes du noir au blanc, les images reçues dans la chambre obscure.
« Principe fondamental de cette découverte. — La lumière, dans son état de composition et de décomposition, agit chimiquement sur les corps ; elle est absorbée, elle se combine avec eux, et leur communique de nouvelles propriétés. Ainsi, elle augmente la consistance naturelle de quelques-uns de ces corps ; elle les solidifie même, et les rend plus ou moins insolubles, suivant la durée ou l’intensité de son action. Tel est, en peu de mots, le principe de la découverte.
« Matière première. — Préparation. — La substance, ou matière première que j’emploie, celle qui m’a le mieux réussi, et qui concourt plus immédiatement à la production de l’effet, est l’asphalte ou bitume de Judée, préparé de la manière suivante :
« Je remplis à moitié un verre de ce bitume pulvérisé. Je verse dessus, goutte à goutte, de l’huile essentielle de lavande, jusqu’à ce que le bitume n’en absorbe plus et qu’il en soit seulement bien pénétré. J’ajoute, ensuite, assez de cette huile essentielle pour qu’elle surnage de trois lignes (0m,007) environ au-dessus du mélange, qu’il faut couvrir et abandonner à une douce chaleur, jusqu’à ce que l’essence ajoutée soit saturée de la matière colorante du bitume. Si ce vernis n’a pas le degré de consistance nécessaire, on le laisse évaporer à l’air libre, dans une capsule, en le garantissant de l’humidité qui l’altère et finit par le décomposer. Cet inconvénient est surtout à craindre dans cette saison froide et humide, pour les expériences faites dans la chambre obscure.
« Une petite quantité de ce vernis appliquée à froid avec un tampon de peau très-douce, sur une planche d’argent plaqué, bien polie, lui donne une belle couleur de vermeil, et s’y étend en couche mince et très-égale. On place ensuite la planche sur un fer chaud, recouvert de quelques doubles de papier, dont on enlève ainsi, préalablement, toute l’humidité ; et lorsque le vernis ne poisse plus, on retire la planche pour la laisser refroidir et finir de sécher à une température douce, à l’abri du contact d’un air humide. Je ne dois pas oublier de faire observer, à ce sujet, que cette précaution est indispensable. Dans ce cas, un disque léger, au centre duquel est fixée une courte tige que l’on tient à la bouche, suffit pour arrêter et condenser l’humidité de la respiration.
« La planche ainsi préparée peut être immédiatement soumise aux impressions du fluide lumineux ; mais même après y avoir été exposée assez de temps pour que l’effet ait eu lieu, rien n’indique qu’il existe réellement ; car l’empreinte reste inaperçue. Il s’agit donc de la dégager, et on y parvient à l’aide du dissolvant.
« Du dissolvant. — Manière de le préparer. — Comme ce dissolvant doit être approprié au résultat que l’on veut obtenir, il est difficile de fixer avec exactitude les proportions de sa composition. Mais, toutes choses égales d’ailleurs, il vaut mieux qu’il soit trop faible que trop fort. Celui que j’emploie de préférence, est composé d’une partie, non pas en poids, mais en volume, d’huile essentielle de lavande, sur six parties, même mesure, d’huile de pétrole blanche. Le mélange, qui devient d’abord laiteux, s’éclaircit parfaitement au bout de deux ou trois jours. Ce composé peut servir plusieurs fois de suite. Il ne perd sa propriété dissolvante que lorsqu’il approche du terme de sa saturation, ce qu’on reconnaît parce qu’il devient opaque et d’une couleur très-foncée ; mais on peut le distiller et le rendre aussi bon qu’auparavant.
« La plaque ou planche vernie étant retirée de la chambre obscure, on verse dans un vase de fer-blanc d’un pouce (0m,027) de profondeur, plus long et plus large que la plaque, une quantité de ce dissolvant assez considérable pour que la plaque en soit totalement recouverte. On la plonge dans le liquide, et en la regardant sous un certain angle, dans un faux jour, on voit l’empreinte apparaître et se découvrir peu à peu, quoique encore voilée par l’huile qui surnage, plus ou moins saturée de vernis. On enlève alors la plaque, et on la pose verticalement pour laisser bien écouler le dissolvant. Quand il ne s’en échappe plus, on procède à la dernière opération, qui n’est pas la moins importante.
« Du lavage. — Manière d’y procéder. — Il suffit d’avoir pour cela un appareil fort simple, composé d’une planche de quatre pieds (1m,30) de long et plus large que la plaque. Cette planche est garnie, sur champ, dans sa largeur, de deux liteaux bien joints, faisant une saillie de deux pouces (0m,054), elle est fixée à un support par son extrémité supérieure à l’aide de charnières qui permettent de l’incliner à volonté, pour donner à l’eau que l’on verse, le degré de vitesse nécessaire. L’extrémité inférieure de la planche aboutit dans un vase destiné à recevoir le liquide qui s’écoule
« On place la plaque sur cette planche inclinée ; on l’empêche de glisser en l’appuyant contre deux petits crampons qui ne doivent pas dépasser l’épaisseur de la plaque. Il faut avoir soin, dans cette saison froide, de se servir d’eau tiède ; on ne la verse pas sur la plaque, mais au-dessus, afin qu’en y arrivant elle fasse nappe, et enlève les dernières portions d’huile adhérentes au vernis.
« C’est alors que l’empreinte se trouve complètement dégagée, partout d’une grande netteté, si l’opération a été bien faite, et surtout si on a pu disposer d’une chambre noire perfectionnée.
« Application des procédés héliographiques. — Le vernis employé, pouvant s’appliquer indifféremment sur pierre, sur métal et sur verre, sans rien changer à la manipulation, je ne m’arrêterai qu’au mode d’application sur argent plaqué et sur verre, en faisant toutefois remarquer, quant à la gravure sur cuivre, que l’on peut sans inconvénient ajouter à la composition du vernis, une petite quantité de cire dissoute dans l’huile essentielle de lavande.
« Jusqu’ici, l’argent plaqué me paraît être ce qu’il y a de mieux pour la reproduction des images, à cause de sa blancheur et de son éclat. Une chose certaine, c’est qu’après le lavage, pourvu que l’empreinte soit bien sèche, le résultat obtenu est déjà satisfaisant. Il serait pourtant à désirer que l’on pût, en noircissant la planche, se procurer toutes les dégradations de teintes du noir au blanc. Je me suis donc occupé de cet objet en me servant d’abord de sulfure de potasse liquide ; mais il attaque le vernis, quand il est concentré, et si on l’allonge d’eau, il ne fait que rougir le métal. Ce double inconvénient m’a forcé d’y renoncer. La substance que j’emploie maintenant avec le plus d’espoir de succès, est l’iode qui a la propriété de se vaporiser à la température de l’air. Pour noircir la planche par ce procédé, il ne s’agit que de la dresser contre une des parois intérieures d’une boîte ouverte dans le dessus, et placer quelques grains d’iode dans une petite rainure pratiquée le long du côté opposé, dans le fond de la boîte. On la couvre ensuite d’un verre, pour juger de l’effet qui s’opère moins vite, mais bien plus sûrement. On peut alors enlever le vernis avec l’alcool, et il ne reste plus aucune trace de l’empreinte primitive. Comme ce procédé est encore tout nouveau pour moi, je me bornerai à cette simple indication, en attendant que l’expérience m’ait mis à portée de recueillir, là-dessus, des détails plus circonstanciés.
« Deux essais de points de vue sur verre, pris dans la chambre obscure, m’ont offert des résultats qui, bien que défectueux, me semblent devoir être rapportés, parce que ce genre d’application peut se perfectionner plus aisément, et devenir par la suite d’un intérêt tout particulier.
« Dans l’un de ces essais, la lumière ayant agi avec moins d’intensité, a découvert le vernis de manière à rendre les dégradations de teintes beaucoup mieux senties ; de sorte que l’empreinte, vue par transmission, reproduit, jusqu’à un certain point, les effets connus du Diorama.
« Dans l’autre essai, au contraire, où l’action du fluide lumineux a été plus intense, les parties les plus éclairées, n’ayant pas été attaquées par le dissolvant, sont restées transparentes, et la différence des teintes résulte uniquement de l’épaisseur relative des couches plus ou moins opaques du vernis. Si l’empreinte est vue par réflexion dans un miroir, du côté verni, et sous un angle déterminé, elle produit beaucoup d’effet ; tandis que, vue par transmission, elle ne présente qu’une image confuse et incolore ; et ce qu’il y a d’étonnant, c’est qu’elle paraît affecter les couleurs locales de certains objets. En méditant sur ce fait remarquable, j’ai cru pouvoir en tirer des inductions qui permettraient de le rattacher à la théorie de Newton, sur le phénomène des anneaux colorés. Il suffirait pour cela de supposer que tel rayon prismatique, le rayon vert par exemple, en agissant sur la substance vernie et en se combinant avec elle, lui donne le degré de solubilité nécessaire pour que la couche qui en résulte après la double opération du dissolvant et du lavage, réfléchisse la couleur verte. Au reste, c’est à l’observation seule à constater ce qu’il y a de vrai dans cette hypothèse, et la chose me semble assez intéressante par elle-même, pour provoquer de nouvelles recherches, et donner lieu à un examen plus approfondi. »
Daguerre demeura quelques jours à Châlon, chez Nicéphore Niépce, qui répéta devant lui les différentes opérations décrites dans la notice que l’on vient de lire. Quand il fut bien initié au secret de cet art nouveau, il repartit pour Paris, chacun des associés ayant pris l’engagement de poursuivre le perfectionnement de cette méthode.
Nous avons rapporté le traité conclu entre les deux associés et la notice de Nicéphore Niépce sur l’héliographie, parce que nous voulons en dégager nettement un fait historique. Ce fait, c’est que dans l’association entre les deux chercheurs, Daguerre n’apporta rien et Niépce que peu de chose.
C’était peu de chose, en effet, que d’avoir substitué au chlorure et au nitrate d’argent, dont faisaient usage Charles et Wedgwood, le bitume de Judée, substance si peu impressionnable à la lumière, qu’il faut huit ou dix heures d’exposition dans la chambre obscure, pour obtenir une image. Quant à la transformation des planches de métal recouvertes de bitume de Judée et impressionnées par la lumière, en planches de gravure, c’était chose impossible, avec les procédés par trop simples dont Niépce faisait usage. C’est ce que le graveur Lemaître reconnut bien vite, et ce que l’on a reconnu bien mieux encore, quand on a été amené, de nos jours, à reprendre les essais de gravure héliographique avec le bitume de Judée. Niépce, d’ailleurs, avait fini par renoncer à cette application à la gravure, car il n’en est pas fait mention dans sa Notice sur l’héliographie, que nous venons de rapporter, ni dans l’acte d’association avec Daguerre. Son objet principal c’était de produire, sur des planches d’étain ou de cuivre plaqué d’argent, des types uniques, dans lesquels les lumières de la nature étaient traduites par la résine oxydée et les noirs par le fond métallique. Comme ces fonds n’étaient jamais assez sombres, Niépce les noircissait avec le sulfure de potasse, qui formait un sulfure métallique noir. Il avait aussi songé à noircir ces mêmes fonds métalliques avec de l’iode. Mais cette substance était singulièrement choisie pour produire un tel résultat ; en effet, l’iodure d’argent, qui se forme par l’action des vapeurs d’iode sur l’argent, n’est pas noir, il est jaune-d’or ; et s’altérant rapidement à la lumière, il passe à des tons divers. Il ne donne d’ailleurs, à la surface du métal, qu’une poussière sans adhérence. Un dessin métallique ainsi renforcé, comme le voulait Niépce, n’aurait eu que la durée et la résistance les plus éphémères.
Ce qui constitue la photographie, c’est, comme nous le verrons bientôt, le développement, c’est-à-dire l’action des substances dites révélatrices, qui, appliquées sur la substance ayant reçu l’action de la lumière, font apparaître subitement une image, qui est formée dans les profondeurs de la couche sensible mais n’est nullement apparente avant l’emploi des agents révélateurs, et ne se manifesterait pas sans leur intervention.
C’est à Daguerre que revient la découverte des agents révélateurs ; c’est pour cela que nous le considérons comme le véritable inventeur de la photographie.
Après leur association, Niépce et Daguerre s’occupèrent, chacun de son côté, de perfectionner l’héliographie, qui en avait grand besoin, comme on vient de le voir. Daguerre s’adonna, avec l’ardeur qui lui était propre, à ces recherches nouvelles.
« Tout à coup, dit M. Charles Chevalier, Daguerre devint invisible ! Renfermé dans un laboratoire qu’il avait fait disposer dans les bâtiments du Diorama, où il résidait, il se mit à l’œuvre avec une ardeur nouvelle, étudia la chimie, et, pendant deux ans environ, vécut presque continuellement au milieu des livres, des matras, des cornues et des creusets. J’ai entrevu ce mystérieux laboratoire, mais il ne fut jamais permis ni à moi ni à d’autres d’y pénétrer. Madame veuve Daguerre, MM. Bouton, Sibon, Carpentier, etc., peuvent témoigner de l’exactitude de ces souvenirs[24]. »
La première découverte de Daguerre, ce fut l’impressionnabilité de l’iodure d’argent, par la lumière. On a vu que Niépce avait fait usage de l’iode, pour essayer de noircir le fond de ses plaques métalliques. Le hasard révéla à Daguerre la propriété dont jouit l’iodure d’argent, de se modifier avec une promptitude extraordinaire sous l’influence de l’agent lumineux. Un jour, comme il avait laissé par mégarde, une cuiller sur une plaque qu’il venait de traiter par l’iode, il trouva l’image de cette cuiller dessinée en noir sur le fond de la lame métallique recouverte d’iodure d’argent (fig. 11.) La cuiller, superposée à la plaque iodurée, avait garanti les parties sous-jacentes de l’action de la lumière, et ainsi s’était produite la silhouette de la cuiller sur la surface de la plaque.

Cette observation fut un trait de lumière. Daguerre, à partir de ce moment, substitua l’iodure d’argent au bitume de Judée, pour obtenir les images photographiques. Il prenait une lame de plaqué d’argent, et la plaçait dans une boîte contenant des cristaux d’iode ; la vapeur qui se dégageait spontanément de l’iode, formait de l’iodure d’argent avec l’argent de la plaque. Ainsi préparée dans l’obscurité, la plaque iodurée servait à recevoir l’image de la chambre obscure.
Dès ce moment le bitume de Judée ne fut plus employé par Daguerre.
Le peintre du Diorama s’empressa de communiquer cette découverte à son associé de Châlon. Mais Niépce n’ajoutait aucune confiance aux vertus de ce nouvel agent héliographique. C’était le 21 mai 1831 que Daguerre avait annoncé à Niépce ce fait nouveau. Ce dernier lui répondait, le 24 juin :
- « Monsieur et cher associé,
« J’attendais depuis longtemps de vos nouvelles avec trop d’impatience pour ne pas recevoir et lire avec le plus grand plaisir vos lettres des 10 et 21 mai dernier. Je me bornerai, pour le moment, à répondre à celle du 21, parce que, m’étant occupé, dès qu’elle me fut parvenue, de vos recherches sur l’iode, je suis pressé de vous faire part des résultats que j’ai obtenus. Je m’étais déjà livré, à ces mêmes recherches antérieurement à nos relations, mais sans espérer de succès, vu la presque impossibilité, selon moi, de fixer, d’une manière durable, les images reçues, quand bien même on parviendrait à replacer les jours et les ombres dans leur ordre naturel. Mes résultats à cet égard avaient été totalement conformes à ceux que m’avait fournis l’emploi de l’oxyde d’argent ; et la promptitude était le seul avantage réel que ces deux substances parussent offrir. Cependant, Monsieur, l’an passé, après votre départ d’ici, je soumis l’iode à de nouveaux essais, mais d’après un autre mode d’application. Je vous en fis connaître les résultats, et votre réponse, peu satisfaisante, me décida à ne pas pousser plus loin mes recherches. Il paraît que depuis vous avez envisagé la question sous un point de vue moins désespérant, et je n’ai pas dû hésiter à répondre à l’appel que vous m’avez fait, etc. J.-N. Niépce. »
Il lui écrivait encore, le 8 novembre 1831:
- « Monsieur et cher associé,
« Conformément à ma lettre du 24 juin dernier, en réponse à la vôtre du 21 mai, j’ai fait une longue suite de recherches sur l’iode mis en contact avec l’argent poli, sans toutefois parvenir au résultat que me faisait espérer ce désoxydant. J’ai eu beau varier mes procédés et les combiner d’une foule de manières, je n’en ai pas été plus heureux pour cela. J’ai reconnu, en définitive, l’impossibilité, selon moi du moins, de ramener à son état naturel l’ordre interverti des teintes, et surtout d’obtenir autre chose qu’une image fugace des objets. Au reste, Monsieur, ce non-succès est absolument conforme à ce que mes recherches sur les oxydes métalliques m’avaient fourni bien antérieurement, ce qui m’avait décidé à les abandonner. Enfin, j’ai voulu mettre l’iode en contact avec la planche d’étain ; ce procédé, d’abord, m’avait semblé de bon augure. J’avais remarqué avec surprise, mais une seule fois, en opérant dans la chambre noire, que la lumière agissait en sens inverse sur l’iode, de sorte que les teintes, ou, pour mieux dire, les jours et les ombres, se trouvaient dans leur ordre naturel. Je ne sais comment et pourquoi cet effet a eu lieu sans que j’aie pu parvenir à le reproduire, en procédant de la même manière. Mais ce mode d’application, quant à la fixité de l’image obtenue, n’en aurait pas été moins défectueux. Aussi, après quelques autres tentatives, en suis-je resté là, regrettant bien vivement, je l’avoue, d’avoir fait fausse route pendant si longtemps, et, qui pis est, si inutilement, etc., etc. »
- « Monsieur et cher associé,
« Aux substances qui, d’après votre lettre, agissent sur l’argent comme l’iode, vous pouvez ajouter le thlaspien décoction, les émanations du phosphore et surtout du sulfure ; car c’est principalement à leur présence dans ces corps qu’est due la similitude des résultats obtenus. J’ai aussi remarqué que le calorique produisait le même effet par l’oxydation du métal, d’où provenait, dans tous les cas, cette grande sensibilité à la lumière ; mais ceci, malheureusement, n’avance en rien la solution de la question qui vous occupe. Quant à moi, je ne me sers plus de l’iode, dans mes expériences, que comme terme de comparaison de la promptitude relative de leurs résultats. Il est vrai que depuis deux mois le temps a été si défavorable, que je n’ai pu faire grand’chose. Au sujet de l’iode, je vous prierai, Monsieur, de me dire d’abord : Comment vous l’employez ? Si c’est sous forme concrète ou en état de solution dans un liquide ? parce que, dans ces deux cas, l’évaporation pourrait bien ne pas agir de la même manière sous le rapport de la promptitude, etc., etc. J.-N. Niépce. »
- « Mon cher associé,
« Depuis ma dernière lettre, je me suis, à peu de chose près, borné à de nouvelles recherches sur l’iode, qui ne m’ont rien procuré de satisfaisant, et que je n’avais reprises que parce que vous paraissiez y attacher une certaine importance, et que, d’un autre côté, j’étais bien aise de me rendre mieux raison de l’application de l’iode sur la planche d’étain. Mais, je le répète, Monsieur, je ne vois pas que l’on puisse se flatter de tirer parti de ce procédé, pas plus que de tous ceux qui tiennent à l’emploi des oxydes métalliques, etc., etc.[25]. »
La découverte des agents révélateurs fut faite bientôt après, par Daguerre. Au lieu de laver la plaque impressionnée par le bitume de Judée, avec de l’essence de lavande, Daguerre trouva que, si on l’expose aux vapeurs de l’huile de pétrole, ces vapeurs font apparaître subitement l’image, qui, jusque-là, n’apparaissait qu’imparfaitement sur le métal. Voici, en effet, ce qu’on lit dans une note relative aux modifications apportées par Daguerre au procédé de Niépce, et rapportée par Daguerre dans la brochure qu’il a consacrée à l’histoire de ses travaux.
« Comme il arrive très-souvent qu’au sortir de la chambre noire on n’aperçoit aucune trace de l’image, il s’agit de la faire paraître. Pour cela, il faut prendre un bassin en cuivre étamé ou en fer-blanc plus grand que la plaque, et garni tout autour d’un rebord d’environ 50 millimètres de hauteur. On remplit ce bassin d’huile de pétrole, jusqu’à peu près un quart de sa hauteur ; on fixe la plaque sur une planchette en bois qui couvre parfaitement le bassin. L’huile de pétrole, en s’évaporant, pénètre entièrement la substance dans les endroits sur lesquels l’action de la lumière n’a pas eu lieu, et lui donne une transparence telle, qu’il semble ne rien y avoir dans ces endroits ; ceux, au contraire, sur lesquels la lumière a vivement agi ne sont point attaqués par la vapeur de l’huile de pétrole.
« C’est ainsi qu’est effectuée la dégradation des teintes, par le plus ou moins d’action de la vapeur de l’huile de pétrole sur la substance.
« Il faut de temps en temps regarder l’épreuve, et la retirer aussitôt qu’on a obtenu les plus grandes vigueurs ; car en poussant trop loin l’évaporation, les plus grands clairs en seraient attaqués et finiraient par disparaître. L’épreuve est alors terminée. Il faut la mettre sous verre pour éviter que la poussière ne s’y attache, et, pour l’enlever, il ne faut employer d’autre moyen que de la chasser en soufflant. En mettant les épreuves sous verre, on préserve aussi la feuille d’argent plaqué des vapeurs qui pourraient l’altérer[26]. »
L’huile de pétrole était un agent révélateur d’une faible puissance, comparée à celle d’une substance nouvelle que Daguerre essaya bientôt après, et qui donna des résultats vraiment merveilleux. Nous voulons parler des vapeurs de mercure dirigées sur la plaque recouverte d’iodure d’argent. Quand on retire de la chambre noire une plaque iodurée, elle ne présente aucun dessin appréciable. Mais si on l’expose à l’action des vapeurs de mercure, l’image apparaît peu à peu, et cela avec une finesse, une perfection incomparables. L’image a alors toute sa fixité, car on pourrait même se passer d’enlever l’excès d’iodure d’argent non impressionné, elle ne s’altérerait qu’après quelques jours. À nos yeux, la découverte des agents révélateurs, et particulièrement de l’action révélatrice des vapeurs de mercure, marque la date de la création de la photographie.
Mais il n’était pas réservé à Nicéphore Niépce de connaître le perfectionnement inattendu apporté à sa méthode primitive. Il mourut subitement, à Châlon, d’une congestion cérébrale, le 5 juillet 1833, à l’âge de 69 ans. Il fut enterré dans le petit cimetière du village de Saint-Loup de Varennes.
« La tombe, dit M. V. Fouque, est surmontée à l’un des bouts, du côté de la tête d’une croix de pierre grise unie ; elle est, comme les autres tombes voisines, enfouie au milieu des grandes herbes qu’il nous a fallu écarter, afin de pouvoir lire et copier l’épitaphe, devenue presque illisible[27].
CHAPITRE IV
Après la mort de Nicéphore Niépce, Daguerre continua ses recherches avec ardeur. Nous venons de dire qu’il avait découvert en 1831, ce fait extraordinaire, que l’image formée par l’action de la lumière sur une plaque recouverte d’iodure d’argent, est invisible, mais qu’elle apparaît subitement si l’on expose la plaque aux vapeurs du mercure. Ce phénomène, absolument ignoré jusque-là, était d’un avenir immense ; en même temps qu’il fournissait les moyens de créer la photographie, il ouvrait à la physique tout un champ nouveau d’observations et de recherches. Avec une habileté remarquable, Daguerre sut tirer parti de ce fait pour la formation des images photographiques. Deux ans après la mort de Niépce, il avait imaginé la méthode admirable qui immortalisera son nom.
En 1835, Daguerre informe le fils de Nicéphore Niépce, Isidore, des perfectionnements qu’il vient d’apporter à l’exécution des épreuves, grâce à l’emploi d’un agent nouveau, et il obtient de ce dernier, un acte additionnel, dans lequel, en raison des perfectionnements réalisés par le peintre du Diorama, on déclare que le moment est venu d’exploiter la découverte de l’héliographie. Par le même acte, le nom d’Isidore Niépce remplace celui de son père, décédé.
Voici le texte de cet acte :
« Acte additionnel aux bases du traité provisoire passé entre MM. Joseph-Nicéphore Niépce, et Louis-Jacques-Mandé Daguerre, le 14 décembre 1829, à Châlon-sur-Saône.
« Entre les soussignés Louis-Jacques-Mandé Daguerre, artiste-peintre, membre de la Légion d’honneurs, administrateur du Diorama, demeurant à Paris ; et Jacques-Marie-Joseph-Isidore Niépce, propriétaire, demeurant à Châlon-sur-Saône, fils de M. feu Nicéphore Niépce, en sa qualité de seul héritier, conformément à l’article 2 du traité provisoire, en date du 14 décembre 1829, il a été arrêté ce qui suit, savoir :
« 1o Que la découverte dont il s’agit, ayant éprouvé de grands perfectionnements par la collaboration de M. Daguerre, lesdits associés reconnaissent qu’elle est parvenue au point où ils désiraient atteindre, et que d’autres perfectionnements deviennent à peu près impossibles.
« 2o Que M. Daguerre ayant, à la suite de nombreuses expériences, reconnu la possibilité d’obtenir un résultat plus avantageux, sous le rapport de la promptitude, à l’aide d’un procédé qu’il a découvert, et qui (dans la supposition d’un succès assuré) remplacerait la base de la découverte exposée dans le traité provisoire, en date du 14 décembre 1829, l’article premier dudit traité provisoire, serait annulé et remplacé ainsi qu’il suit :
« Article 1er. Il y aura entre MM. Daguerre et Isidore Niépce, Société sous la raison de commerce Daguerre et Isidore Niépce, pour l’exploitation de la découverte, inventée par M. Daguerre et feu Nicéphore Niépce.
« Tous les autres articles du traité provisoire, sont et demeurent conservés.
« Fait et passé double entre les soussignés, le 9 mai 1835, à Paris, »
Deux ans après, c’est-à-dire en 1837, Isidore Niépce se rend à Paris, sur l’invitation de Daguerre. Ce dernier lui montre les épreuves obtenues par son nouveau procédé, et la vue de ces épreuves excite l’admiration d’Isidore Niépce. Daguerre l’invite alors à adhérer aux conditions d’un acte nouveau, stipulant la manière dont on procédera à l’exploitation de la découverte.
Il y avait dans cet acte d’association, quelque chose qui blessait Isidore Niépce. Le fils de Nicéphore trouvait qu’il était fait trop bon marché des travaux de son père. Ce ne fut donc qu’après une résistance assez vive qu’Isidore Niépce se décida à signer un acte définitif d’association, conçu dans les termes suivants :
« Je soussigné, déclare par le présent écrit que M. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, peintre, membre de la Légion d’honneur, m’a fait connaître un procédé dont il est l’inventeur ; ce procédé a pour but de fixer l’image produite dans la chambre obscure, non pas avec les couleurs, mais avec une parfaite dégradation de teintes du blanc au noir. Ce nouveau moyen a l’avantage de reproduire les objets avec soixante ou quatre-vingts fois plus de promptitude que celui inventé par M. Joseph-Nicéphore Niépce, mon père, perfectionné par M. Daguerre, et pour l’exploitation duquel, il y a eu un acte provisoire d’association, en date du quatorze décembre mil huit cent vingt-neuf, et par lequel acte il est stipulé que ledit procédé serait publié ainsi qu’il suit :
« Procédé inventé par M. Joseph-Nicéphore Niépce, et perfectionné par M. L.-J.-M. Daguerre.
« Ensuite de la communication qu’il m’a faite, M. Daguerre consent à abandonner à la Société formée en vertu du traité provisoire ci-dessus relaté, le nouveau procédé dont il est l’inventeur et qu’il a perfectionné, à la condition que ce nouveau procédé portera le nom seul de Daguerre, mais qu’il ne pourra être publié que conjointement avec le premier procédé, afin que le nom de M. J.-Nicéphore Niépce figure toujours comme il le doit dans cette découverte.
« Par ce présent traité il est et demeure convenu que tous les articles et bases du traité provisoire, en date du 14 décembre 1829, sont conservés et maintenus.
« D’après ces nouveaux arrangements pris entre MM. Daguerre et Isidore Niépce, et qui forment le traité définitif dont il est parlé à l’article 9 du traité provisoire, lesdits associés ayant résolu de faire paraître leurs divers procédés, ils ont donné le choix au mode de publication par souscription.
« L’annonce de cette publication aura lieu par la voie des journaux. La liste sera ouverte le 15 mars 1838, et close le 15 avril suivant.
« Le prix de la souscription sera de mille francs.
« La liste de souscription sera déposée chez un notaire ; l’argent sera versé entre ses mains par les souscripteurs, dont le nombre sera porté à quatre cents.
« Les articles de la souscription seront rédigés sur les bases les plus avantageuses, et les procédés ne pourront être rendus publics, qu’autant que la souscription atteindrait au moins le nombre de cent ; alors, dans le cas contraire, les associés aviseront à un autre mode de publication.
« Si avant l’ouverture de la souscription, on trouvait à traiter pour la vente des procédés, ladite vente ne pourrait être consentie à un prix au-dessous de deux cent mille francs.
« Ainsi fait double et convenu, à Paris, le 13 juin 1837, en la demeure de M. Daguerre, au Diorama, et ont signé
Après la signature de cet acte définitif, les deux associés s’occupèrent de l’exploitation de la découverte. Comme on vient de le lire dans le traité précédent, on voulait faire appel aux amateurs des beaux-arts et aux capitalistes, pour lancer des actions dans le public. La souscription fut, en effet, ouverte le 15 mars 1838 ; mais elle n’obtint aucun succès, on ne put réunir aucuns fonds.
Il fut alors décidé que le procédé serait cédé au gouvernement. Il était évident, en effet, que l’invention ne pouvait être sauvegardée par un brevet, car, dès que les principes en auraient été connus, chacun pourrait s’en servir. Daguerre s’adressa donc à divers savants, et il s’en ouvrit d’une façon plus particulière, à Arago, à qui il révéla, sous le sceau du secret, toutes les opérations.
Arago fut saisi d’un véritable enthousiasme, à la vue des épreuves obtenues, devant lui, par Daguerre. Il admira surtout la promptitude avec laquelle s’accomplissent les phénomènes du développement de l’image par l’action des vapeurs mercurielles. Arago se fît dès lors l’avocat, ardent et convaincu, de l’invention nouvelle.
Grâce à son entremise, Daguerre fut mis en rapport avec le ministre de l’Intérieur, Duchâtel. Daguerre demandait deux cent mille francs pour la cession de ses procédés photographiques, auxquels il s’engageait à joindre le secret du mode d’exécution des tableaux de son Diorama. Des offres venues des gouvernements étrangers, justifiaient le chiffre de cette demande. Le ministre offrit, au lieu de la somme, l’intérêt viager de deux cent mille francs, c’est-à-dire une rente de dix mille francs.
Cet arrangement ayant été accepté, un traité provisoire, destiné à être soumis à la ratification des chambres, fut conclu entre les associés et le ministre de l’Intérieur. Par ce traité, qui fut signé le 14 juin 1839, les deux associés cédaient leurs procédés à l’État, moyennant ces conditions :
1o Pour Daguerre, une pension annuelle et viagère de six mille francs, dont quatre mille pour les procédés héliographiques, et deux mille pour les procédés de peinture et d’éclairage appliqués aux tableaux du Diorama ;
2o Pour M. Isidore Niépce, une pension annuelle et viagère de quatre mille francs, en raison de l’invention de son père.
Ces pensions étaient réversibles par moitié sur les veuves de MM. Isidore Niépce et Daguerre.
Un projet de loi fut présenté, dès le lendemain, c’est-à-dire le 15 juin 1839, à la Chambre des députés. Le projet de loi, suivant l’usage, était précédé d’un Exposé des motifs présenté par le ministre de l’Intérieur.
Nous reproduirons cette pièce officielle, désireux de ne négliger aucun document dans l’histoire de la belle invention qui nous occupe, et qui a le mérite d’être exclusivement française. Voici donc l’Exposé des motifs qui fut présenté à la Chambre des députés, par le ministre de l’Intérieur.
« Nous croyons aller au-devant des vœux de la Chambre en vous proposant d’acquérir, au nom de l’État, la propriété d’une découverte aussi utile qu’inespérée, et qu’il importe, dans l’intérêt des sciences et des arts, de pouvoir livrer à la publicité.
« Vous savez tous, et quelques-uns d’entre vous ont déjà pu s’en convaincre par eux-mêmes, qu’après quinze ans de recherches persévérantes et dispendieuses, M. Daguerre est parvenu à fixer les images de la chambre obscure et à créer ainsi, en quatre ou cinq minutes, par la puissance de la lumière, des dessins où les objets conservent mathématiquement leurs formes jusque dans leurs plus petits détails, où les effets de la perspective linéaire, et la dégradation des tons provenant de la perspective aérienne, sont accusés avec une délicatesse inconnue jusqu’ici.
« Nous n’avons pas besoin d’insister sur l’utilité d’une semblable invention. On comprend quelles ressources, quelles facilités toutes nouvelles elle doit offrir pour l’étude des sciences ; et, quant aux arts, les services qu’elle peut leur rendre ne sauraient se calculer.
« Il y aura pour les dessinateurs et pour les peintres, même les plus habiles, un sujet constant d’observations dans ces reproductions si parfaites de la nature. D’un autre côté, ce procédé leur offrira un moyen prompt et facile de former des collections d’études qu’ils ne pourraient se procurer, en les faisant eux-mêmes, qu’avec beaucoup de temps et de peine, et d’une manière bien moins parfaite.
« L’art du graveur, appelé à multiplier, en les reproduisant, ces images calquées sur la nature elle-même, prendra un nouveau degré d’importance et d’intérêt.
« Enfin, pour le voyageur, pour l’archéologue, aussi bien que pour le naturaliste, l’appareil de M. Daguerre deviendra d’un usage continuel et indispensable. Il leur permettra de fixer leurs souvenirs sans recourir à la main d’un étranger. Chaque auteur désormais composera la partie géographique de ses ouvrages ; en s’arrêtant quelques instants devant le monument le plus compliqué, devant le site le plus étendu, il en obtiendra sur-le-champ un véritable fac-simile.
« Malheureusement pour les auteurs de cette belle découverte, il leur est impossible d’en faire un objet d’industrie, et de s’indemniser des sacrifices que leur ont imposés tant d’essais si longtemps infructueux. Leur invention n’est pas susceptible d’être protégée par un brevet. Dès qu’elle sera connue, chacun pourra s’en servir. Le plus maladroit fera des dessins aussi exactement qu’un artiste exercé, il faut donc nécessairement que ce procédé appartienne à tout le monde ou qu’il reste inconnu. Et quels justes regrets n’exprimeraient pas tous les amis de l’art et de la science, si un tel secret devait demeurer impénétrable au public, s’il devait se perdre et mourir avec les inventeurs !
« Dans une circonstance aussi exceptionnelle, il appartient au gouvernement d’intervenir. C’est à lui de mettre la société en possession de la découverte dont elle demande à jouir dans un intérêt général, sauf à donner aux auteurs de cette découverte le prix ou plutôt la récompense de leur invention.
« Tels sont les motifs qui nous ont déterminés à conclure avec MM. Daguerre et Niépce fils une convention provisoire, dont le projet de loi que nous avons l’honneur de vous soumettre, a pour objet de vous demander la sanction.
« Avant de vous faire connaître les bases de ce traité, quelques détails sont nécessaires.
« La possibilité de fixer passagèrement les images de la chambre obscure était connue dès le siècle dernier ; mais cette découverte ne promettait aucun résultat utile, puisque la substance sur laquelle les rayons solaires dessinaient les images n’avait pas la propriété de les conserver et qu’elle devenait complètement noire aussitôt qu’on l’exposait à la lumière du jour.
« M. Niépce père inventa un moyen de rendre ces images permanentes. Mais, bien qu’il eût résolu ce problème difficile, son invention n’en restait pas moins encore très-imparfaite. Il n’obtenait que la silhouette des objets, et il lui fallait au moins douze heures pour exécuter le moindre dessin.
« C’est en suivant des voies entièrement différentes, et en mettant de côté les traditions de M. Niépce, que M. Daguerre est parvenu aux résultats admirables dont nous sommes aujourd’hui témoins, c’est-à-dire l’extrême promptitude de l’opération, la reproduction de la perspective aérienne et tout le jeu des ombres et des clairs. La méthode de M. Daguerre lui est propre, elle n’appartient qu’à lui et se distingue de celle de son prédécesseur, aussi bien dans sa cause que dans ses effets.
« Toutefois, comme avant la mort de M. Niépce père, il avait été passé entre lui et M. Daguerre un traité par lequel ils s’engageaient mutuellement à partager tous les avantages qu’ils pourraient recueillir de leurs découvertes, et comme cette stipulation a été étendue à M. Niépce fils, il serait impossible aujourd’hui de traiter isolément avec M. Daguerre, même du procédé qu’il a non-seulement perfectionné, mais inventé. Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que la méthode de M. Niépce, bien qu’elle soit demeurée imparfaite, serait peut-être susceptible de recevoir quelques améliorations, d’être appliquée utilement, en certaines circonstances, et qu’il importe, par conséquent, pour l’histoire de la science, qu’elle soit publiée en même temps que celle de M, Daguerre.
« Ces explications vous font comprendre, Messieurs, par quelle raison et à quel titre MM. Daguerre et Niépce fils ont dû intervenir dans la convention que vous trouverez annexée au projet de loi. »
À la suite de cet exposé des motifs, venait l’énoncé du projet de loi qui attribuait à Daguerre une pension annuelle et viagère de 6 000 francs, à Isidore Niépce une pension annuelle et viagère de 4 000 fr. réversibles toutes deux par moitié, sur les veuves de Daguerre et de Niépce.
Le chiffre mesquin de cette rémunération s’efface devant la pensée qui l’avait dictée. Nul, dans le gouvernement ni dans les Chambres, ne prétendit payer la découverte à sa juste valeur. Le titre de récompense nationale témoigne suffisamment que c’était là surtout un hommage solennel de la reconnaissance du pays, au talent et au désintéressement des inventeurs.
La Chambre nomma, pour faire un rapport sur ce projet de loi, une commission composée de MM. Arago, Étienne, Carl, Vatout, de Beaumont, Tournouër, François Delessert, Combarel de Leyval et Vitet.
Chargé du rapport, Arago en donna lecture à la Chambre, dans la séance du 3 juillet 1839. À la suite de cette lecture, la loi fut votée par acclamation.
Il en fut de même à la Chambre des pairs, où Gay-Lussac, nommé rapporteur de la loi, lut son rapport le 30 juillet.
Après la promulgation de cette loi, rien ne s’opposait plus à la divulgation des procédés du Daguerréotype, c’est le nom que reçut l’invention nouvelle. Arago, en sa qualité de secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, le communiqua à l’Académie le 10 août 1839.

Ceux qui eurent le bonheur d’assister à cette séance, en conserveront longtemps le souvenir. Il serait difficile, en effet, de trouver dans l’histoire des compagnies savantes, une plus belle, une plus solennelle journée, L’Académie des beaux-arts s’était réunie à l’Académie des sciences. Sur les bancs réservés au public, se pressait tout ce que Paris renfermait d’hommes éminents dans les sciences, dans les lettres, dans les beaux-arts. Tous les yeux cherchaient l’heureux artiste qui avait conquis si vite une renommée européenne ; on espérait l’entendre prononcer lui-même la révélation si désirée. Lui, cependant, s’était modestement dérobé à ce triomphe si légitime ; il avait déféré cet insigne honneur à Arago, qui avait pris l’invention nouvelle sous son savant et bienveillant patronage.
Si les rangs étaient pressés dans la salle des séances, au dehors l’affluence était énorme ; le vestibule regorgeait de curieux, gens malavisés qui n’étaient venus que deux heures avant l’ouverture de la séance. Enfin, tout d’un coup la porte s’ouvre, et l’un des assistants arrive, tout empressé de communiquer au dehors le secret si impatiemment attendu. « Le procédé consiste, dit-il, dans l’emploi de l’iodure d’argent et de vapeurs de mercure ! » Je vous laisse à penser l’embarras, la surprise et les mille questions. L’iodure d’argent ! la vapeur de mercure ! Mais que peuvent avoir de commun et l’iodure d’argent et la vapeur de mercure, avec ces charmantes images que nos yeux ne se lassent pas de contempler ! Attendez cependant, voici un autre officieux, et mieux renseigné cette fois : « Il est bien question du mercure ! C’est de l’hyposulfite de soude ! » Comprenne qui pourra. Cependant le mystère finit par s’éclaircir, et la foule se retire peu à peu, encore tout agitée de ces émotions délicieuses, heureuse d’applaudir à une création nouvelle du génie de la France, fière d’accorder à l’Europe un si magnifique présent.
Quelques heures après, les boutiques des opticiens étaient assiégées ; il n’y avait pas assez de chambres obscures pour satisfaire le zèle de tant d’amateurs empressés. On suivait d’un œil de regret, le soleil qui déclinait à l’horizon, emportant avec lui la matière première de l’expérience. Mais, dès le lendemain, on put voir à leur fenêtre, aux premières heures du jour, un grand nombre d’expérimentateurs s’efforçant, avec toute espèce de précautions craintives, d’amener sur une plaque préparée, l’image de la lucarne voisine, ou la perspective d’une population de cheminées. Quelles joies innocentes, quelles ravissantes angoisses ; mais quels désappointements cruels ! Lorsque, après un quart d’heure de mortelle attente, on retirait la plaque de la chambre noire, on trouvait un ciel couleur d’encre ou des murailles en deuil. Cependant, dans ces tableaux informes, il y avait toujours quelque trait furtif d’une délicatesse achevée ; la masse était confuse, mais on pouvait y saisir quelque détail admirablement venu, qui arrachait un cri de surprise et presque des larmes de plaisir. C’était la balustrade d’une fenêtre qui était superbe ; c’était le grillage voisin qui avait imprimé sur le fidèle écran son image de dentelle. Sur cette plaque, où tout paraît confus, vous n’apercevez rien, mais regardez mieux, prenez une loupe : là, dans ce petit coin du tableau, il y a une mince ligne, c’est la tige éloignée de ce paratonnerre que vos yeux aperçoivent à peine ; mais le merveilleux instrument l’a vu, et il vous l’a rapporté.
Au bout de quelques jours, sur les places de Paris, on voyait des daguerréotypes braqués contre les principaux monuments. Tous les physiciens, tous les chimistes, tous les savants de la capitale, mettaient en pratique, avec un succès complet, les indications de l’inventeur.
CHAPITRE V
Les images photographiques obtenues au moyen du procédé de Daguerre, c’est-à-dire sur métal, se forment à la surface d’une lame de cuivre argenté, ou plaqué d’argent. On expose, pendant quelques minutes, une lame de plaqué d’argent aux vapeurs spontanément dégagées par l’iode, à la température ordinaire ; elle se recouvre d’une légère couche d’iodure d’argent, par suite de la combinaison de l’iode et du métal, et le mince voile d’iodure d’argent ainsi formé, présente une surface éminemment sensible à l’impression des rayons lumineux. La plaque iodurée est placée alors au foyer de la chambre noire, et l’on reçoit sur sa surface l’image formée par l’objectif. La lumière a la propriété de décomposer l’iodure d’argent ; par conséquent, les parties vivement éclairées de l’image décomposent, en ces points, l’iodure d’argent ; les parties obscures restent au contraire, sans action ; enfin les espaces correspondant aux demi-teintes, sont influencés selon que ces demi-teintes se rapprochent davantage des ombres ou des clairs.
Quand on la retire de la chambre obscure, la plaque ne présente encore aucune empreinte visible ; elle conserve uniformément sa teinte jaune d’or. Pour faire apparaître l’image, une autre opération est nécessaire : le développement.
Le développement de l’image s’obtient en soumettant la plaque qui sort de la chambre noire, à l’action des vapeurs du mercure. On la dispose donc dans une petite boîte, et l’on chauffe légèrement du mercure, contenu dans un réservoir, qui se trouve à la partie inférieure de la boîte. Les vapeurs du mercure viennent se condenser sur le métal ; mais le mercure ne se dépose pas uniformément sur toute la surface, et c’est précisément cette condensation inégale qui donne naissance au dessin. En effet, par un phénomène étrange, que la science a jusqu’ici vainement tenté d’expliquer, les vapeurs de mercure viennent se condenser uniquement sur les parties que la lumière a frappées, c’est-à-dire sur les portions de l’iodure d’argent que les rayons lumineux ont chimiquement décomposées ; les parties restées dans l’ombre ne prennent pas de mercure. Le même effet se produit pour les demi-teintes. Il résulte de là que les parties éclairées sont accusées par un vernis brillant de mercure, et les ombres par la surface même de l’argent.
Pour les personnes qui assistent pour la première fois à cette curieuse partie des opérations photographiques, le développement est un spectacle étrange et véritablement merveilleux. Sur cette plaque, qui ne présente aucun trait, aucun dessin, aucun aspect visible, on voit tout d’un coup se dégager une image d’une perfection sans pareille, comme si quelque divin artiste la traçait de son invisible pinceau.
Cependant tout n’est pas fini. La plaque est encore imprégnée d’iodure d’argent ; si on l’abandonnait à elle-même en cet état, l’iodure continuant à noircir sous l’influence de la lumière, tout le dessin disparaîtrait. Il faut donc débarrasser la plaque de cet iodure. On y parvient en la plongeant dans une dissolution d’un sel, l’hyposulfite de soude, qui a la propriété de dissoudre l’iodure d’argent non altéré par la lumière, et en opérant dans un lieu obscur. Après ce lavage, l’épreuve peut être exposée sans aucun risque à l’action de la lumière la plus intense. Tout à l’heure on ne pouvait la manier que dans l’obscurité, ou tout au plus à la lueur d’une bougie, on peut maintenant l’exposer sans crainte en plein soleil.
On voit, en définitive, que dans les épreuves daguerriennes, l’image est formée par un mince voile de mercure déposé sur une surface d’argent ; les reflets brillants du mercure représentent les clairs, les ombres sont produites par le fond bruni de l’argent métallique ; l’opposition, la réflexion inégale de la teinte de ces deux métaux, produisent les effets du dessin.
Tel est le procédé de Daguerre ; telle est la série d’opérations qu’exécutait l’inventeur, et que tout le monde put répéter comme lui, après que sa méthode eut été rendue publique, par la communication faite par Arago à l’Académie des sciences, le 10 août 1839.
Une fois tombé dans le domaine public, une fois livré à l’expérience et à l’émulation de tous, le Daguerréotype devait faire des progrès rapides. Nous allons faire connaître, selon l’ordre historique, les perfectionnements qui furent apportés à la méthode originelle.
Les épreuves obtenues d’après le procédé de Daguerre, bien que remarquables à divers titres, avaient pourtant un grand nombre de défauts qui en diminuaient beaucoup la valeur. Les amateurs et les curieux conservent aujourd’hui, avec soin, quelques spécimens de photographie sur plaque remontant à cette époque : la génération des opérateurs actuels ne peut regarder sans un sourire ces témoignages authentiques de l’état de la photographie à sa naissance. Ces épreuves, telles qu’on les obtenait en 1839, offraient un miroitage des plus désagréables ; le trait n’était visible que sous une certaine incidence de la plaque, et quelquefois, ce défaut allait si loin, que l’épreuve ressemblait plutôt à un moiré métallique qu’à un dessin. Le champ de la vue était extrêmement limité. Les objets animés ne pouvaient être reproduits. Les masses de verdure n’étaient accusées qu’en silhouette. Enfin, il était à craindre que, par suite de la volatilisation spontanée du mercure, l’image ne finît, sinon par disparaître entièrement, au moins par perdre de sa netteté et de sa vigueur.
La plupart de ces défauts étaient la conséquence du temps considérable exigé pour l’impression lumineuse : en effet, un quart d’heure d’exposition à une vive lumière, était indispensable pour obtenir une épreuve. Aussi les premiers efforts de perfectionnement eurent-ils pour but de diminuer la durée de l’exposition de la plaque dans la chambre obscure.
Ce résultat fut obtenu très-vite par des modifications apportées à l’objectif de la chambre noire. Daguerre avait fixé avec beaucoup de soin les dimensions de l’objectif correspondant à la grandeur de la plaque ; mais on reconnut bientôt que les règles qu’il avait posées à cet égard, excellentes pour la reproduction des vues et des objets éloignés, ne pouvaient s’appliquer aux objets plus petits ou plus rapprochés. On imagina alors de raccourcir le foyer de la lentille. Par cet artifice, on condensa sur la plaque une quantité de lumière beaucoup plus grande, et la plaque étant ainsi plus vivement éclairée, on put diminuer d’une manière notable la durée de l’exposition dans la chambre noire.
Bientôt l’opticien Charles Chevalier, le même qui a joué, dans l’invention de la photographie, le rôle accessoire que nous avons fait connaître, imagina une modification de l’objectif, qui en doubla, pour ainsi dire, la puissance. La chambre noire qu’avait employée Daguerre, n’avait qu’un objectif. Charles Chevalier eut l’idée de réunir et de combiner deux objectifs achromatiques, pour en faire la lentille de l’instrument. Cette disposition permit tout à la fois, de raccourcir les foyers, pour concentrer sur le même point une grande quantité de lumière, d’agrandir le champ de la vue, et de faire varier à volonté les distances locales. La disposition et la combinaison de ces deux lentilles sont tellement ingénieuses, que, sans même employer, si on le veut, de diaphragme, on conserve à la lumière toute sa netteté et toute son intensité. Le système du double objectif permit de réduire de beaucoup la durée de l’exposition lumineuse ; on put dès ce moment opérer en deux ou trois minutes.
Toutefois ce problème capital d’abréger la durée de l’exposition lumineuse ne fut complètement résolu qu’en 1841, grâce à une découverte d’une haute importance. Claudet, artiste français qui avait acheté à Daguerre le privilége exclusif d’exploiter en Angleterre les procédés photographiques, découvrit, en 1841, les propriétés des substances accélératrices.
On donne, en photographie, le nom de substances accélératrices à certains composés qui, appliqués sur la plaque préalablement iodée, en exaltent à un degré extraordinaire, la sensibilité lumineuse. Par elles-mêmes, ces substances ne sont pas photogéniques, c’est-à-dire qu’employées isolément elles ne formeraient point une combinaison capable de s’influencer chimiquement au contact de la lumière ; mais si on les applique sur une plaque déjà iodée, elles communiquent à l’iode la propriété de s’impressionner en quelques secondes.
Les composés capables de stimuler ainsi l’iodure d’argent, sont nombreux. Le premier, dont la découverte est due à Claudet, est le chlorure d’iode ; mais il le cède de beaucoup en sensibilité aux composés qui furent découverts postérieurement. Le brome en vapeur, le bromure d’iode, la chaux bromée, le chlorure de soufre, le bromoforme, l’acide chloreux, la liqueur hongroise, la liqueur de Reiser, le liquide de Thierry, sont les substances accélératrices les plus actives. Avec l’acide chloreux on a pu obtenir des épreuves irréprochables dans une demi-seconde.
La découverte des substances accélératrices permit de reproduire avec le daguerréotype l’image des objets animés. On put dès lors satisfaire au vœu universel formé depuis l’origine de la photographie, c’est-à-dire obtenir des portraits. Déjà, en 1840, on avait essayé de faire des portraits au daguerréotype ; mais le temps considérable qu’exigeait l’impression lumineuse avait empêché toute réussite. On opérait alors avec l’objectif à long foyer, qui ne transmet dans la chambre obscure qu’une lumière d’une faible intensité ; aussi fallait-il placer le modèle en plein soleil et prolonger l’exposition pendant un quart d’heure. Comme il est impossible de supporter si longtemps, les yeux ouverts, l’éclat des rayons solaires, on avait dû se résoudre à faire poser les yeux fermés. Quelques amateurs intrépides osèrent se dévouer, mais le résultat ne fut guère à la hauteur de leur courage. On voyait en 1840, à l’étalage de Susse, à la place de la Bourse, une triste procession de Bélisaires, sous l’étiquette usurpée de portraits photographiques.
Grâce aux objectifs à court foyer, on put réduire l’exposition à quatre ou cinq minutes ; alors le patient put ouvrir les yeux. Néanmoins il fallait encore poser en plein soleil. Ce soleil, qui tombait d’aplomb sur le visage, contractait horriblement les traits, et la plaque conservait la trop fidèle empreinte des souffrances et de l’anxiété du modèle. On s’asseyait avec cet air agréable que prend toute personne ayant la conscience de poser pour son portrait, et l’opérateur vous apportait l’image d’un martyr ou d’un supplicié. Pendant six mois, avec la prétention d’obtenir des portraits photographiques, on ne fit guère que multiplier les copies d’un même type : la tête du Laocoon. Rien qu’à voir ces traits crispés, ces faces contractées, ces spécimens cadavéreux, on eût pris en horreur la photographie. C’est là qu’ont trouvé leur source la plupart des préventions défavorables que les productions daguerriennes eurent longtemps à combattre. Les artistes passaient en ricanant devant ces déplorables ébauches.
Cependant toutes les préventions durent disparaître, tous les préjugés durent tomber, en présence des résultats qu’amenèrent la découverte et l’emploi des substances accélératrices. Dès ce moment, la physionomie put être saisie en quelques secondes, et reproduite avec cette continuelle mobilité d’expression qui forme le signe et comme le cachet de la vie. C’est à partir de cette époque que l’on vit paraître, de jour en jour perfectionnés, ces admirables portraits où l’harmonie de l’ensemble est encore relevée par le fini des détails. C’est alors que put être pleinement réalisé le rêve fantastique du conteur d’Hoffmann : « Qu’un amant, voulant laisser à sa maîtresse un souvenir durable, se mire dans une glace, et la lui donne ensuite, parce que son image s’y est fixée. »

Après la découverte des substances accélératrices, le perfectionnement le plus important que reçut la photographie sur métal, consista dans la fixation des épreuves. Les images daguerriennes obtenues à l’origine, étaient déparées par un miroitement des plus choquants. En outre, le dessin ne présentait que peu de fermeté, puisque le ton résultait seulement du contraste formé par l’opposition des teintes du mercure et de l’argent. Enfin (et c’était là un inconvénient des plus graves), l’image était extrêmement fugitive ; elle ne pouvait supporter le frottement : le pinceau le plus délicat, promené à sa surface, l’effaçait en entier. Un physicien français, M. Fizeau, fit disparaître tous ces inconvénients à la fois, en recouvrant l’épreuve photographique d’une légère couche d’or. Il suffit, pour obtenir ce résultat, de verser à la surface de l’épreuve, une dissolution de chlorure d’or mêlée à de l’hyposulfite de soude, et de chauffer légèrement : la plaque se recouvre aussitôt d’un mince vernis d’or métallique.
La découverte du fixage des épreuves, faite par M. Fizeau, est le complément le plus utile qu’ait reçu la photographie sur métal. Elle permit, tout à la fois, de rehausser le ton des dessins photographiques, de diminuer beaucoup le miroitage, et de communiquer à l’épreuve une grande solidité, c’est-à-dire une résistance complète au frottement et à toutes les actions extérieures.
Comment la dorure d’un dessin photographique peut-elle communiquer à celui-ci la vigueur de ton qui lui manquait, et faire disparaître en grande partie le miroitage ? C’est ce qu’il est facile de comprendre. L’or vient recouvrir à la fois l’argent et le mercure de la plaque ; l’argent, qui forme les noirs du tableau, se trouve bruni par la mince couche d’or qui se dépose à sa surface : ainsi les noirs sont rendus plus sensibles, et le miroitage de l’argent n’existe plus ; au contraire, le mercure, qui forme les blancs, acquiert, par son amalgame avec l’or, un éclat beaucoup plus vif, ce qui produit un accroissement notable dans les clairs. Le ton général du tableau est, d’ailleurs, singulièrement rehaussé par l’opposition plus vive que prennent les teintes des deux métaux superposés. Tous ces avantages ressortent d’une manière surprenante, si l’on compare deux épreuves daguerriennes, dont l’une est fixée au chlorure d’or, et l’autre non fixée. La dernière, d’un ton gris-bleuâtre, paraît exécutée sous un ciel brumeux et par une faible lumière ; l’autre, par la richesse de ses teintes, semble sortir de la chaude atmosphère et du beau ciel des contrées méridionales. Quant à la résistance qu’une épreuve ainsi traitée oppose au frottement, elle s’expliquera sans peine, si l’on remarque que le mercure, qui tout à l’heure formait le dessin à l’état de globules infiniment petits et d’une faible adhérence, est maintenant recouvert d’une lame d’or, qui, malgré son extraordinaire ténuité, adhère à la plaque en vertu d’une véritable action chimique.
Les perfectionnements divers apportés au procédé primitif de Daguerre, ont sensiblement modifié ce procédé ; il ne sera donc pas inutile de préciser la méthode actuellement suivie.
Voici la série des opérations qui s’exécutent pour obtenir l’épreuve daguerrienne : Exposition de la lame métallique aux vapeurs spontanément dégagées par l’iode, à la température ordinaire, afin de provoquer à la surface de la plaque, la formation d’une légère couche d’iodure d’argent ; — exposition aux vapeurs fournies par la chaux bromée, le brome ou toute autre substance accélératrice ; — exposition à la lumière, dans la chambre obscure, pour obtenir l’impression chimique ; — exposition aux vapeurs mercurielles, pour faire apparaître l’image ; — lavage de l’épreuve dans une dissolution d’hyposulfite de soude, pour enlever l’iodure d’argent non attaqué ; — fixage de l’épreuve par le chlorure d’or.
La daguerréotypie est très-rarement mise en usage aujourd’hui, bien qu’elle fournisse un dessin d’une finesse prodigieuse, et vraiment sans rivale. Comme elle ne permet d’obtenir qu’un type unique, très-difficile à multiplier, et que les opérations à accomplir sont assez délicates ; comme le miroitage de la plaque est d’un effet peu agréable, et que l’image est renversée, si l’on n’opère pas avec une glace disposée devant l’objectif pour redresser l’image et la placer dans sa position naturelle, elle est universellement remplacée de nos jours, par la photographie sur papier. Cependant, nous décrirons sommairement ses procédés.
Préparation de la plaque. — Le commerce fournit des lames de cuivre recouvertes d’argent (au 30e environ d’argent), connues sous le nom de plaqué, et qui sont de la dimension nécessaire pour être placées dans la chambre obscure des photographes. Ce sont des plaques de cuivre recouvertes, par la pression du laminoir, d’une lame d’argent pur. On prépare aussi par la galvanoplastie du plaqué d’argent, qui est excellent pour la photographie.
Ces plaques sont conservées dans des boîtes à rainures, afin de les défendre de la poussière et des corps étrangers, qui pourraient les rayer.
Avant de nettoyer et de polir une plaque, il faut courber légèrement ses quatre côtés, afin que ses vives arêtes ne déchirent pas le polissoir. À cet effet, on pose la plaque sur le bord d’une table ; puis, on passe avec force, sur chacun des côtés, une baguette de fer ronde. Quand les quatre côtés sont ainsi légèrement renversés, on courbe les quatre coins, avec une pince ; on engage alors ces quatre coins ainsi pliés sous les quatre vis de pression de la planchette à polir.

La planchette à polir (fig. 14.) se compose d’une petite planche de bois, recouverte de drap, et pourvue, à ses quatre angles, de petites vis de pression, destinées à maintenir la plaque bien fixe pendant le nettoyage et le polissage. Cette planchette est assujettie sur une table, au moyen d’une vis de pression en bois ou en fer.
Le nettoyage, ou décapage, de la plaque, se fait avec du coton cardé imbibé d’alcool et saupoudré de tripoli en poudre très-fine. On commence par jeter du tripoli sur la plaque ; puis on imbibe d’alcool un tampon de coton cardé, et l’on frotte, en traçant des cercles sur toute la surface de la plaque. On la frotte ensuite avec du coton sec, et sans employer de tripoli.
On reconnaît que cette première préparation de la plaque est bonne, lorsque la vapeur de l’haleine qu’on y projette, y produit une couche d’un beau blanc mat, qui disparaît d’une manière régulière, sans laisser de taches. S’il en est autrement, on recommence le décapage avec du coton sec et un peu de tripoli, jusqu’à ce que la vapeur de l’haleine ne laisse aucune tache en s’évaporant.
La surface métallique étant ainsi bien décapée, bien nettoyée, on procède au polissage, qui se fait avec le polissoir, composé d’une peau de daim tendue sur une planche munie d’une poignée (fig. 15).

On se sert de deux polissoirs : avec le premier, on polit la plaque rapidement ; avec le second, on termine l’opération. Le premier polissoir est imprégné de rouge d’Angleterre, le second n’en contient que des traces provenant d’un usage prolongé. Prenant le polissoir au rouge, on frotte vivement la plaque, jusqu’à ce qu’elle prenne l’aspect d’une glace bien nette : on frotte dans le sens de la longueur de la plaque. On prend ensuite le polissoir sans rouge. On reconnaît que la plaque est suffisamment polie, lorsque la vapeur de l’haleine, en s’évaporant, n’y laisse aucune tache.
Une plaque qui a déjà servi à recevoir une image, doit être polie avec plus de soin et demande plus de temps qu’une plaque neuve.
Ainsi polie, la plaque est prête à recevoir la couche sensible.
Préparation de la couche sensible. — Pour revêtir la plaque de la couche d’iodure d’argent, sur laquelle doit s’imprimer l’image de la chambre obscure, il faut la placer dans la boîte à iode. Dans l’origine, ces boîtes ne renfermaient que de l’iode. Elles se composaient d’une cuvette de porcelaine, contenant des cristaux d’iode, et recouverte d’une lame de verre dépolie. En tirant ce couvercle de verre, la plaque recevait l’action de la vapeur d’iode. Depuis la découverte des agents accélérateurs, c’est-à-dire depuis l’emploi du bromure ou du chlorobromure de chaux, on se sert de boîtes dites jumelles, réunissant la cuvette à iode et la cuvette à chaux bromée.

La boîte jumelle à iode (fig. 16), se compose donc d’une boîte de sapin, renfermant deux cuvettes en porcelaine, dont l’une contient de l’iode à l’état solide, et l’autre de la chaux bromée. La plaque est posée sur un cadre de bois A, qui peut glisser dans une rainure, pour être soumise d’abord à l’action de l’iode, ensuite à celle du brome. Dans la première cuvette sont des cristaux d’iode, recouverts d’une feuille de papier buvard ; dans l’autre est le bromure de chaux. La plaque polie étant déposée sur le cadre de bois A, d’abord au-dessus de la cuvette d’iode, on tire au dehors la lame de verre B, et les vapeurs d’iode se dégagent ainsi librement sur la plaque, à l’intérieur de la boîte, dont on a préalablement abaissé le couvercle D.
La durée de l’exposition aux vapeurs d’iode est d’environ une demi-minute. La nuance que doit prendre la plaque est celle du jaune d’or. La durée de cette exposition dépend, d’ailleurs, de la température de l’atelier.
On fait ensuite glisser la plaque dans la rainure horizontale, pour l’amener sur la cuvette à bromure de chaux, que l’on découvre à son tour, en tirant la lame de verre C. L’exposition aux vapeurs de brôme doit être très-courte. Elle ne doit pas dépasser 10 secondes en moyenne. La couleur de la plaque doit alors tourner au violet.
On termine en passant la plaque une seconde fois, sur l’iode, et l’y laissant le tiers du temps qu’on a employé pour la première exposition. Après ce second iodage, la plaque a pris une teinte bleu d’acier.
Nous n’avons pas besoin de dire que toutes ces opérations doivent être faites dans un lieu obscur. Pour examiner et manier la plaque, il faut se servir d’une bougie entourée de verres jaunes, car telle est la sensibilité de la couche photogénique, que la faible lumière d’une bougie pourrait l’impressionner.
Exposition dans la chambre obscure. — La plaque ainsi sensibilisée, pourrait se conserver plusieurs heures sans altération, avant d’être introduite dans la chambre obscure. Cependant on fait d’ordinaire ces opérations successives dans un court intervalle.
La plaque sensibilisée étant placée sur un châssis fermé par un couvercle mobile, on introduit ce châssis dans la chambre obscure. Quand on veut opérer, on commence par faire arriver l’image du modèle sur une plaque de verre dépoli. Quand l’image paraît bien à point, on remplace le verre dépoli par le châssis contenant la plaque sensible. À cet effet, on tire une planchette verticale qui couvre la plaque, et l’on reçoit sur sa surface sensible l’image du modèle.
La durée de l’exposition de la plaque daguerrienne dans la chambre noire, ne peut être fixée que par l’expérience de chaque opérateur. Elle varie suivant la température de l’atelier et l’intensité de la lumière. Il suffit habituellement, d’une demi-minute d’exposition pour le portrait, et de trois minutes pour une vue extérieure, un monument, etc.
Développement de l’image. — Quand la plaque daguerrienne sort de la chambre obscure, elle ne présente aucune modification visible ; c’est aux vapeurs de mercure qu’appartient la mystérieuse puissance de faire paraître, c’est-à-dire de développer l’image.

La boîte à mercure (fig. 17), est une petite caisse de noyer, portant à l’intérieur une rainure inclinée à 45 degrés, dans laquelle on engage le châssis porteur de la plaque qui a été impressionnée dans la chambre obscure. Au-dessous de la plaque et vers le milieu de la boîte, se trouve une cuvette en fer contenant du mercure. Une lampe à alcool placée à l’extérieur et au-dessous de la cuvette de mercure (c’est-à-dire à la place indiquée par la lettre A), permet de chauffer ce métal, et de le réduire en vapeurs, qui doivent venir se condenser sur la plaque. Un thermomètre à mercure B, dont la tige est coudée, de telle sorte que sa boule plonge dans le mercure chauffé, et que la tige soit apparente à l’extérieur, permet de surveiller la température que l’on communique au métal, par la lampe à alcool. Cette température doit être de 50 à 60 degrés. Ce n’est, d’ailleurs, qu’au moment où le thermomètre indique cette température, qu’on introduit dans la boîte la plaque daguerrienne. La surface sensible se trouve exposée aux vapeurs mercurielles, sous un angle de 45 degrés.
On laisse réagir les vapeurs de mercure pendant deux minutes. On peut suivre les progrès de l’opération, grâce à un carreau de vitre, de couleur jaune, C, qui se trouve sur un côté de la boîte, et qui permet de regarder à l’intérieur, à l’aide d’une bougie approchée du carreau D. L’image se développe peu à peu, sous les yeux de l’opérateur. Si le temps de l’exposition aux vapeurs du mercure est insuffisant, les blancs de l’image apparaissent en bleu, ils s’effacent, au contraire, si l’exposition aux vapeurs de mercure a été trop longue.
La manière dont l’image se développe, permet aussi à l’opérateur de reconnaître si la durée de l’exposition à la lumière a été convenable. Si l’exposition dans la chambre obscure a été trop courte, l’image est noire ; si elle a été trop longue, elle est blafarde et ses contours sont effacés : on dit alors que l’épreuve est solarisée, ou brûlée.
Quand l’image a atteint la perfection désirée, on la retire de la boîte à mercure pour la fixer.
Fixage. — Au sortir de la boîte à mercure, l’image pourrait se conserver pendant quelques heures, à une faible lumière ; mais comme elle demeure imprégnée, dans sa masse, d’iodure d’argent, ce composé finirait par noircir par l’action de la lumière. Il faut donc la débarrasser de cet iodure d’argent. On y parvient à l’aide d’une dissolution d’hyposulfite de soude, contenant un gramme de ce sel, pour dix grammes d’eau. La dissolution d’hyposulfite de soude est placée dans une cuvette de porcelaine, dans laquelle on introduit la plaque. Cinq minutes suffisent pour dissoudre l’iodure d’argent, quand on a la précaution d’agiter la plaque au sein du liquide.
On termine en lavant la plaque sous un courant d’eau, ou en la jetant dans une cuvette pleine d’eau.
Avivage. — L’image est alors fixée ; mais elle est grise, et de plus, elle s’effacerait au moindre frottement. C’est pour cela qu’on procède à l’avivage, c’est-à-dire à la dorure de toute sa surface, au moyen d’un composé d’or. Le composé d’or employé par les photographes est un hyposulfite d’or et de soude, connu sous le nom de sel d’or, ou sel de Fordos et Gélis. On le trouve tout préparé chez les marchands de produits chimiques. On dissout un gramme de ce sel dans un kilogramme d’eau.

Voici comment on opère pour dorer la plaque au moyen de cette dissolution. La plaque bien lavée à l’eau claire, et encore humide, est placée sur le pied à chlorurer (fig. 18). C’est un support métallique, sur lequel on dépose la plaque. On arrose cette plaque avec la dissolution du sel d’or, et l’on chauffe par-dessous, au moyen d’une lampe à alcool, la plaque, couverte de cette dissolution. On voit alors, sous l’influence de la chaleur, de petites bulles de gaz se dégager de toute la masse du liquide. Le sel d’or se décompose, le mercure se dissout à la place de l’or, qui se dépose sur l’argent. Les parties claires de l’épreuve, qui présentaient une teinte bleuâtre, deviennent d’un blanc éclatant, tandis que les parties sombres se renforcent. C’est ainsi que le dessin s’avive, prend le ton et la vigueur qui lui manquaient »
On saisit alors la plaque chaude avec une pince ; on rejette le sel d’or qui la couvre, et on la fait tremper dans de l’eau distillée. On la lave ensuite sous un robinet d’eau claire. On finit ce lavage par de l’eau distillée ; enfin on sèche la plaque à la flamme d’une lampe à alcool.
L’épreuve est alors terminée : elle est inaltérable à la lumière, et résiste à un certain frottement. On peut l’encadrer.
Telle est, avec les modifications qu’elle reçut peu de temps après sa divulgation dans le public, la méthode qui reçut, à juste titre, le nom de daguerréotypie.
Nous devons ajouter quelques mots, en terminant ce chapitre, sur l’auteur de cette invention admirable.
Daguerre se tenait un peu à l’écart des progrès que nous venons de rappeler. Il s’était retiré dans une maison de campagne, à Bry-sur-Marne, recevant, par intervalles, la visite de quelques savants, désireux de connaître l’auteur d’une découverte qui avait fait si rapidement le tour du monde. Son Diorama avait été consumé par un incendie en 1839, quelques mois avant la communication faite par Arago à l’Académie des sciences. Dès lors il s’était consacré tout entier à l’art nouveau qu’il venait de créer.
Il aurait pu réaliser une grande fortune, en attachant son nom à quelque établissement photographique ; mais il avait refusé toute exploitation de ce genre. La vente de son brevet en Angleterre, et la pension qu’il recevait du gouvernement, lui donnaient une honnête aisance, dont il jouissait avec le calme d’un sage. Il composa, pour l’église du village où il s’était retiré, un tableau à grand effet, comme son pinceau savait les rendre, et qui donnait à la petite église la profondeur et la physionomie d’une cathédrale. Ce peintre de théâtre avait voulu, pour son dernier ouvrage, peindre une église de hameau[28].
Daguerre est mort à Bry-sur-Marne, le 10 juillet 1851, au moment où la photographie, abandonnant la voie qu’il lui avait tracée, allait s’élancer vers des horizons nouveaux. Sa mort passa assez inaperçue en France. Seulement la Société des beaux-arts fit décider l’érection d’un monument à sa mémoire.
Ce mausolée modeste fut inauguré le 4 novembre 1852, dans le petit cimetière de Bry-sur-Marne. Une grille en fer entoure un socle de granit, servant de piédestal à un pilastre tumulaire, à la partie inférieure duquel se voit un médaillon reproduisant les traits de l’artiste. Sur l’une des faces du piédestal, on lit :
La cérémonie de l’inauguration de ce monument se fit en présence de toute la population de la commune, et sous les auspices d’une commission de la Société des beaux-arts. On se rendit à l’église, où fut célébré un requiem en l’honneur de l’illustre défunt. Ensuite, on se rendit processionnellement au cimetière, escorté de quelques congrégations religieuses du voisinage, et du clergé paroissial, en habits sacerdotaux. Quand le cortège fut arrivé dans le cimetière du village, et après la cérémonie religieuse, le secrétaire de la Société des beaux-arts lut un Éloge de Daguerre.
Voilà le seul hommage public qui ait été accordé à l’inventeur de la photographie.
Un témoignage touchant lui a été rendu en Amérique. À New-York, les photographes, sur l’annonce de la mort de Daguerre, portèrent pendant quinze jours, un crêpe au bras, en signe de deuil ; et ils réunirent, par souscription, une somme de 50 000 francs, pour élever un monument à sa gloire. Cette noble initiative contraste avec notre indifférence. L’Amérique s’est montrée reconnaissante envers notre compatriote, alors que la France demeurait oublieuse envers lui. Puisque tant de nos illustrations nationales ont aujourd’hui leur statue, serait-ce trop demander que d’exprimer le vœu que le même hommage soit rendu un jour, à l’inventeur de la photographie, dans cette ville de Paris aux portes de laquelle il a vu le jour ?
CHAPITRE VI
Lorsqu’un amateur de Lille, M. Blanquart-Évrard, publia, au commencement de l’année 1847, la description d’un excellent procédé pratique pour la photographie sur papier, cette communication fut accueillie par les amateurs et les artistes avec un véritable enthousiasme, car elle répondait à un vœu qui avait été formé depuis longtemps et qui était resté jusque-là stérile.
On comprend sans peine les nombreux avantages que présentent les épreuves photographiques obtenues sur papier, et leur supériorité sur les produits de la plaque. Elles n’ont rien de ce miroitage désagréable qu’il est impossible de bannir complètement dans les épreuves sur métal, et qui a l’inconvénient de rompre toutes les habitudes artistiques ; elles présentent l’apparence ordinaire d’un dessin : une bonne épreuve sur papier ressemble à une sépia faite par un habile artiste. L’image n’est pas simplement déposée à la surface, comme dans les épreuves sur argent, elle fait corps jusqu’à une certaine profondeur avec la substance du papier, ce qui lui assure une durée indéfinie et une résistance complète au frottement. Grâce à l’épreuve positive succédant à l’épreuve négative, le trait n’est point renversé, comme dans les dessins du daguerréotype ; il est au contraire parfaitement correct pour la ligne, c’est-à-dire que l’objet est reproduit dans sa situation absolue au moment de la pose. En outre, un dessin-type une fois obtenu, on peut en tirer un nombre indéfini de copies, ce qui constitue un avantage extraordinaire, et suffirait pour établir la supériorité de cette méthode sur celle qui l’a précédée. Enfin, la faculté de pouvoir substituer une feuille de papier aux plaques métalliques, d’un prix élevé, d’une détérioration facile, d’un poids considérable, d’un transport incommode ; l’absence de tout ce matériel embarrassant, si bien nommé bagage daguerrien, qui rendait difficiles aux voyageurs les opérations photographiques ; la simplicité du procédé, le bas prix des substances chimiques dont on fait usage, tout se réunit pour assurer à la photographie sur papier une utilité pratique véritablement sans limites.
Il est donc facile de comprendre l’intérêt avec lequel le monde des savants et des artistes accueillit, en 1847, les premiers résultats de la photographie sur papier. Le nom de M. Blanquart-Évrard, qui n’était qu’un marchand de draps de Lille, conquit rapidement les honneurs de la célébrité.
Cependant, il se passait là un fait étrange, et qui compte peu d’exemples dans la science. Les procédés publiés par M. Blanquart-Évrard, n’étaient, à cela près de quelques modifications secondaires dans le manuel opératoire, que la reproduction d’une méthode qui avait été publiée six années auparavant, par un amateur anglais, M. Fox Talbot, méthode dont M. Blanquart-Évrard avait eu connaissance, à Lille, par un élève de M. Talbot, M. Tanner. Or, dans son mémoire, M, Blanquart-Évrard n’avait pas même prononcé le nom du premier inventeur, et cet oubli singulier ne provoqua, au sein de l’Académie, ni ailleurs, aucune réclamation. M. Talbot lui-même ne prit pas la peine d’élever la voix pour revendiquer la gloire de l’invention qui lui appartenait. Il se borna à adresser à quelques amis de Paris, deux ou trois de ses dessins photographiques.
En effet, depuis l’année 1834, alors que l’art photographique était encore à naître, M. Talbot avait essayé de reproduire sur le papier, les images de la chambre obscure.
Déjà d’ailleurs, et longtemps avant cette époque, d’autres physiciens, comme nous l’avons dit dans le premier chapitre de cette notice, avaient abordé cette question ; car c’est un fait à remarquer, que les premiers essais de photographie eurent pour objet le dessin sur papier. En 1802, Humphry Davy s’en était occupé, après Wedgwood. Ces deux savants avaient réussi à obtenir, sur du papier enduit d’azotate ou de chlorure d’argent, des reproductions de gravures et d’objets transparents. Ils avaient essayé de fixer également les images de la chambre obscure ; mais la trop faible sensibilité lumineuse de l’azotate d’argent leur avait opposé un obstacle insurmontable. Mais on n’obtenait de cette manière que des silhouettes ou des images inverses, dans lesquelles les noirs du modèle étaient représentés par des blancs, et vice versa. En outre, l’épreuve obtenue, ni Wedgwood ni Davy n’avaient pu réussir à la préserver de l’altération consécutive de la lumière.
Heureusement M. Talbot n’eut point connaissance des essais de Wedgwood et de Davy ; il ignora l’échec que ces grands chimistes avaient éprouvé dans leur tentative. Il avoue que, devant l’insuccès de tels maîtres, il eût immédiatement abandonné ses recherches, comme une poursuite chimérique. Cependant, par un travail de plusieurs années, il parvint à surmonter tous les obstacles. Il résolut complètement la double difficulté de fixer sur le papier les images de la chambre obscure et de les préserver de toute altération consécutive.
Mais la découverte capitale de M. Talbot, celle qui constitue dans son entier la photographie sur papier, ce fut celle du meilleur et du plus puissant agent révélateur que l’on connaisse, c’est-à-dire de l’acide gallique. L’effet de la lumière sur l’iodure d’argent qui recouvre le papier, n’est pas plus appréciable quand on le retire de la chambre obscure, que ne l’est l’image formée sur la plaque daguerrienne. Ces deux images sont également latentes, et il faut un agent révélateur pour les faire apparaître, pour les tirer des profondeurs de la masse où elles sont ensevelies. Daguerre a découvert dans les vapeurs de mercure, l’agent révélateur des images formées sur le métal ; Talbot découvrit dans l’aride gallique, l’agent révélateur propre aux images formées sur le papier. Le nom de l’amateur anglais doit donc venir après celui de Daguerre, dans l’ordre d’importance des découvertes qui ont créé la photographie.

M. Talbot continuait ses recherches, lorsqu’il fut surpris par la publication des travaux de Daguerre. Quelques mois après, il fit connaître en Angleterre, l’ensemble de sa méthode. La Société royale de Londres en reçut la communication, et le Philosophical Magazine du mois de mars 1839, publia un article de M. Talbot, contenant la description de ses procédés et de sa méthode générale, que l’auteur appelait Calotypie.
Le 7 juin 1841, dans une lettre adressée à M. Biot, et présentée par ce savant à l’Académie des sciences de Paris, M. Talbot donna la description de son procédé pour obtenir des reproductions photographiques sur papier.
On a peine à comprendre comment la publication faite en Angleterre, de la méthode de M. Talbot, en 1839, et la communication de cette même méthode faite par Biot, à l’Académie des sciences de Paris, en 1841, n’attirèrent pas davantage l’attention. Mais on était alors au milieu de l’enivrement causé par la découverte de Daguerre, et la communication de M. Talbot à l’Académie des sciences de Paris, confondue avec une foule de procédés sans intérêt, qui surgissaient de toutes parts, à cette époque, ne fut pas appréciée à sa juste valeur. Quelques personnes essayèrent d’obtenir des images en suivant les indications fournies par M, Talbot ; mais elles ne réussirent qu’imparfaitement, ce qui fit croire que l’inventeur n’avait dit son secret qu’à moitié.
La photographie sur papier tomba donc parmi nous dans un délaissement complet. Seulement quelques artistes anglais, munis de quelques renseignements plus ou moins précis, empruntés à la communication faite par M. Talbot à la Société royale de Londres, parcouraient la France, vendant aux amateurs le secret de cette nouvelle branche des arts photographiques, et dans Paris circulaient un certain nombre d’épreuves représentant des modèles inanimés, obtenues par un employé du ministère des finances, M. Bayard, qui toutefois cachait avec grand soin le procédé dont il faisait usage.
C’est dans ces circonstances que M. Blanquart-Évrard, qui avait eu connaissance, comme nous l’avons dit, des procédés de M. Talbot par M. Tanner, fit paraître son mémoire. Ce travail reproduisait, avec peu de changements, la méthode de M. Talbot, seulement, les descriptions qu’il renfermait étaient plus précises et plus complètes que celles qu’avait données le physicien anglais dans sa communication à l’Académie des sciences de Paris, car après leur lecture chacun était en état de mettre en pratique le procédé nouveau.
Les changements apportés par M. Blanquart-Évrard au manuel opératoire de M. Talbot, consistaient : 1o à plonger le papier dans les liquides impressionnables, au lieu de déposer les dissolutions sur le papier, à l’aide d’un pinceau, comme le faisait M. Talbot ; 2o à serrer entre deux glaces le papier chimique exposé dans la chambre obscure, au lieu de l’appliquer contre une ardoise. Tout le reste de l’opération : l’emploi de l’iodure d’argent comme agent impressionnable, pour obtenir l’épreuve positive sur papier, et du chlorure d’argent sur le papier négatif, l’action fondamentale de l’acide gallique employé comme agent révélateur pour faire apparaître l’image, l’idée capitale de préparer une image négative, et de s’en servir pour obtenir une image directe ; en un mot, tout l’ensemble de l’opération de la photographie sur papier, appartient incontestablement au physicien anglais.
Nous avons prononcé plus haut, le nom de M. Bayard, comme l’auteur de dessins photographiques sur papier, qui étaient déjà connus en France à l’époque où M. Blanquart-Évrard popularisa parmi nous la découverte de M. Talbot, Nous nous souvenons, en effet, qu’en 1846, M. Despretz, dans son cours de physique à la Sorbonne, montrait des épreuves de photographie sur papier, que les auditeurs du cours admiraient beaucoup. L’Académie des beaux-arts avait déjà remarqué ces intéressants produits, et les avait fait connaître dans un de ses rapports. Mais M. Bayard persistait à tenir secret le procédé dont il faisait usage ; ce qui nuisait aux progrès de cette branche nouvelle de la photographie, comme à sa propre renommée.
M. Bayard, employé au ministère des finances, n’est point de ces artistes amoureux de la renommée et du bruit, toujours impatients de jeter leur nom aux échos de la publicité. C’est un praticien modeste, qui ne vit que pour la photographie, et qui se montre toujours surpris et presque gêné quand on le proclame habile entre tous dans cet art merveilleux. Mais parce que M. Bayard ne tient pas à être distingué du reste de ses laborieux confrères, ce n’est pas une raison pour que l’historien passe son nom sous silence. M. Bayard a été l’un des créateurs de la photographie sur papier. Au moment où cette découverte n’existait encore que dans les limbes de l’avenir, c’est-à-dire avant les publications de M. Talbot, il avait déjà trouvé la manière de fixer sur le papier les images de la chambre obscure.
Ce fait est très-peu connu. C’est pour cela que nous raconterons, par forme de digression, comment M. Bayard fut conduit à découvrir la photographie sur papier, et comment sa découverte demeura un secret pour tous. Le récit n’est point long, d’ailleurs ; ce n’est guère, on va le voir, que l’histoire d’une pêche.
M. Bayard est le fils d’un honnête juge de paix, qui exerçait ses fonctions dans une petite ville de province. Pour occuper ses loisirs, le magistrat cultivait un jardin. Dans ce jardin était un petit verger, où des pêches admirables mûrissaient au soleil d’automne. M. Bayard père se plaisait, chaque année, à envoyer à ses amis quelques corbeilles de ces beaux fruits, et dans son naïf orgueil de propriétaire, il tenait, en les envoyant, à indiquer, par un signe irrécusable, que ces fruits sortaient de son verger. Il avait imaginé, pour cela, un moyen singulier, et qui n’était, à l’insu de son auteur, qu’un véritable procédé photographique. Sur l’arbre, en train de mûrir ses produits, il choisissait une pêche. C’était, comme bien vous pensez, la plus belle, une de ces pêches à trente sous, qui étaient destinées plus tard, grâce à M. Alexandre Dumas fils, à jouer un si grand rôle dans le monde, ou plutôt dans le demi-monde dramatique. Pour la préserver de l’action du soleil, notre juge de paix avait soin d’envelopper de feuilles cette pêche prédestinée. Lorsque, ainsi abrité des rayons solaires, le fruit avait acquis les dimensions voulues, il le dépouillait de son enveloppe de feuilles, et le laissait alors librement exposé à l’influence du soleil. Seulement, il collait sur le fruit les deux initiales de son nom, artistement découpées en caractères de papier. Au bout de quelques jours, quand on venait à enlever ce papier protecteur, les deux initiales se détachaient en blanc sur le fond rouge de la pêche, qu’elles marquaient ainsi d’une estampille irrécusable dont le soleil avait fait les frais.
Ce phénomène, dont il était témoin chaque année, avait naturellement frappé le jeune esprit de M. Bayard fils. Enfant, il s’était amusé à répéter ce même jeu de la lumière docile, sur des morceaux de papier rose tressés en forme de croix. Les parties du papier cachées par la superposition d’autres bandes, conservaient leur couleur rose, tandis que les autres étaient promptement décolorées.
Plus tard, ayant essayé, comme tant d’autres, de fixer les images de la chambre obscure, M. Bayard eut l’idée d’employer, pour arriver à ce résultat, ce papier rose de carthame qui avait servi aux distractions de son enfance. Mais, placé dans la chambre noire, ce papier rebelle ne s’impressionnait point par l’agent lumineux. C’est alors que M. Bayard eut l’idée de remplacer cette matière paresseuse par le chlorure d’argent, c’est-à-dire par l’agent photographique dont on fait usage aujourd’hui. Il parvint ainsi à obtenir de véritables épreuves de photographie sur papier, avec cette condition, si remarquable pour l’époque, d’être des images directes, c’est-à-dire qui n’exigeaient point la préparation préalable d’un type négatif. Sur l’épreuve obtenue dans la chambre noire, les clairs correspondaient aux lumières du modèle, et les noirs aux ombres.
Le procédé de M. Bayard consistait à exposer le papier imprégné de chlorure d’argent, à l’action de la lumière, mais seulement jusqu’à un certain degré, que l’expérience lui avait appris à connaître. Quand on voulait s’en servir pour obtenir l’image photographique, on faisait tremper ce papier imprégné d’avance de chlorure d’argent, dans une dissolution d’iodure de potassium et on l’exposait, dans la chambre obscure, à l’action de la lumière. Les rayons lumineux avaient pour effet de blanchir, ou, pour mieux dire, de jaunir faiblement le sel d’argent dans les parties éclairées. Il ne restait plus qu’à fixer l’épreuve, au moyen de l’hyposulfite de soude.
Tel est le procédé de photographie sur papier qu’avait imaginé M. Bayard, et qu’il eut, pour sa réputation future, le tort de vouloir garder secret. C’est ainsi qu’étaient obtenues ces belles épreuves que M. Despretz nous montrait, en 1846, dans son cours de physique à la Sorbonne, et que nous nous faisions passer de main en main, sans pouvoir deviner par quels procédés magiques se réalisaient de telles merveilles. Comment deviner aussi que ces beaux effets ne dérivaient que de l’observation attentive de l’action du soleil sur une pêche !
Cette histoire d’une pêche étiquetée par le soleil d’automne, excitera peut-être un sourire d’incrédulité chez quelques lecteurs. Pour convaincre les sceptiques de la réalité de cette action chimique de l’astre solaire, nous emprunterons aux traditions de l’Orient une autre histoire, tout à fait analogue, et qui s’explique par les mêmes influences.
Deux juifs arrivent, un jour, à Constantinople, pour faire fortune. Comme leur religion était un obstacle à leurs projets, ils en font bon marché, et se déclarent prêts à embrasser le mahométisme.
Ce n’est pas une grande affaire que deux juifs se disposant à abjurer leur religion ; on n’y aurait donc pas fait grande attention dans la bonne ville de Constantinople. Aussi nos deux personnages voulurent-ils donner plus d’éclat à leur conversion. Ils invoquèrent un miracle que le prophète aurait daigné accomplir sur leur personne. Ils firent savoir que Mahomet était apparu à l’un d’eux ; qu’il l’avait appelé à haute voix, et après l’avoir éveillé, lui avait ordonné de se rendre à Constantinople, pour y embrasser la religion du Dieu des musulmans.
Les ulémas de Constantinople ne brillent point par la crédulité ; ils aiment, avant de prendre un parti, ou de croire aux paroles d’un inconnu, que cet inconnu fournisse la preuve de ce qu’il avance ; les ulémas demandèrent donc à nos deux juifs la preuve de cette apparition divine.
« Je porte sur mon corps, cette preuve, dit l’un des deux juifs. Quand la main du prophète s’est posée sur moi, pour me tirer du sommeil ; cette main a laissé sa trace sur ma poitrine, et cette marque persiste encore. »
Et découvrant aussitôt sa poitrine, le juif montre en effet, imprimée sur sa peau brune, la silhouette d’une main, qui s’y découpait en une teinte plus claire.

On examina avec soin la peau du juif ; on la soumit à tous les lavages, à toutes les frictions possibles. Aucune supercherie ne fut découverte, aucune substance ne fut reconnue comme ayant été appliquée frauduleusement sur la peau, pour produire cet étrange stigmate. Le miracle fut donc tenu pour authentique, et les deux nouveaux convertis furent, à partir de ce jour, en grande vénération à Constantinople.
Si les bons musulmans avaient été mieux inspirés, ils auraient reconnu que la marque de la main imprimée sur la poitrine de l’un des juifs, était la reproduction exacte, par ses dimensions et sa structure, de la main de l’autre juif.
Voici, en effet, comment s’y étaient pris nos deux fripons. L’un s’était couché au soleil, la poitrine nue, et l’autre avait tenu sa main ouverte sur la poitrine du premier. Ils avaient eu la patience, tout orientale, de passer ainsi trois semaines. Au bout de ce temps, le soleil avait répandu sur la peau du juif couché, une teinte brun foncé, tandis que la partie protégée par la main ouverte, était demeurée blanche.
Ce stigmate miraculeux n’était qu’une impression photographique, dans laquelle la peau était la substance impressionnée, et le soleil la substance impressionnante. Après cette digression, nous reviendrons à l’histoire de la photographie, que nous terminerons en revendiquant pour un savant anglais, pour l’astronome John Herschell, la découverte de l’un des plus importants agents de la photographie sur papier.

Ce n’est pas tout, en effet, de posséder, avec l’acide gallique, un excellent agent révélateur. Il faut aussi un réactif chimique d’une efficacité certaine pour obtenir la fixation de l’image, pour la rendre absolument inaltérable à l’action ultérieure de la lumière. L’agent fixateur universellement en usage, et le meilleur pour cette opération, c’est l’hyposulfite de soude.
Selon M. Van Monckhoven, auteur d’un excellent Traité de photographie, l’œuvre la plus sérieuse qui ait paru sur cette matière, on doit la découverte de l’efficacité de l’hyposulfite de soude comme fixateur des images sur papier, au physicien astronome John Herschell.
Il nous reste à décrire le procédé de photographie sur papier découvert par M. Talbot et vulgarisé en France par M. Blanquart-Évrard.
Avant de faire connaître ce procédé pratique, exposons la théorie générale de l’opération.
Tout le monde sait que les sels d’argent, naturellement incolores, particulièrement le chlorure, le bromure et l’iodure d’argent, étant exposés à l’action de la lumière solaire ou diffuse, noircissent promptement, par suite d’une décomposition chimique provoquée par l’agent lumineux. D’après cela, si l’on place au foyer d’une chambre obscure, une feuille de papier imprégnée d’iodure d’argent, l’image formée par l’objectif s’imprimera sur le papier, parce que les parties vivement éclairées noirciront la couche sensible, tandis que les parties obscures, restant sans action, laisseront au papier sa couleur blanche.
L’impression produite par la lumière sur le chlorure d’argent, n’est pas appréciable quand on retire le papier de la chambre obscure : cette image est latente. Il faut la faire apparaître, par l’action d’un agent révélateur. Cet agent révélateur, c’est l’acide gallique. Comment l’acide gallique produit-il cet effet ? En se combinant avec l’oxyde d’argent rendu libre par l’action de la lumière. Il se forme ainsi un sel d’une coloration noire très-intense, le gallate d’argent. Les parties que la lumière a touchées se chargent de gallate d’argent, les parties restées dans l’ombre demeurent exemptes de ce sel coloré. Ainsi se produit et apparaît sous les yeux de l’opérateur, un dessin qui reproduit l’image du modèle avec des tons inverses de ceux de la nature.
Maintenant, si, grâce à l’action dissolvante de l’hyposulfite de soude, on débarrasse le papier de l’excès du chlorure d’argent non impressionné par la lumière, on obtiendra une sorte de silhouette, dans laquelle les parties éclairées du modèle seront représentées sur l’épreuve, par une teinte noire, et les ombres par des blancs. C’est ce que l’on nomme une image inverse, ou négative, selon l’expression consacrée.
Enfin, si l’on place cette image sur une feuille de papier imprégnée de chlorure d’argent, et qu’on expose le tout à l’action directe du soleil, l’épreuve négative laissera passer la lumière à travers les parties transparentes du dessin et lui fermera passage dans les portions opaques. Le rayon solaire, allant ainsi agir sur le papier sensible placé au contact de l’épreuve négative, donnera naissance à une image sur laquelle les clairs et les ombres seront placés dès lors dans leur situation naturelle. On aura donc formé ainsi une image directe, ou positive.
Le procédé pratique de la photographie sur papier se compose, d’après cela, de deux séries distinctes d’opérations : la première ayant pour effet de préparer l’image négative ; la seconde, de former l’épreuve redressée ou positive.
On obtient l’épreuve négative en recevant l’image de la chambre obscure sur un papier enduit d’iodure d’argent mélangé d’une petite quantité d’acide acétique ; ce papier sensible est appliqué contre un carton léger, auquel il adhère par son humidité.
Au bout de trente à cinquante secondes, l’effet chimique provoqué par la lumière est produit ; l’iodure d’argent se trouve décomposé dans les parties éclairées, et dans tous les points sur lesquels a porté la lumière, l’oxyde d’argent est devenu libre.
La faible altération chimique qui vient d’avoir lieu, n’est en aucune façon, accusée à la surface du papier, qui n’offre encore aucune trace visible de dessin. Il faut pour la faire apparaître, pour la développer, selon le terme consacré, un agent chimique spécial. Si l’on arrose l’épreuve avec une dissolution d’acide gallique, ce composé forme, avec l’oxyde d’argent qui existe à l’état de liberté à la surface du papier, un sel, le gallate d’argent, d’une couleur noir foncé, et l’image apparaît subitement. Il ne reste plus qu’à enlever l’excès du composé d’argent non influencé, afin de préserver le dessin de l’action ultérieure de la lumière. On y parvient en lavant l’épreuve avec une dissolution d’hyposulfite de soude ou de sel marin qui dissout immédiatement l’iodure d’argent non altéré par la lumière.
Pour obtenir l’image positive, on place l’épreuve négative obtenue par les moyens qui viennent d’être indiqués, sur un papier imprégné de chlorure d’argent ; on les serre tous les deux entre deux glaces, l’épreuve négative en dessus, et l’on expose le tout au soleil, ou à la lumière diffuse. La durée de cette exposition varie depuis une demi-heure jusqu’à huit heures à la lumière diffuse, et au soleil depuis quinze jusqu’à vingt-cinq minutes. Au reste, comme on peut suivre de l’œil la formation du dessin, en le portant pendant quelques instants dans un lieu obscur et en se servant d’une bougie, on est toujours le maître de s’arrêter quand on juge le trait suffisamment renforcé.
Pour fixer l’image positive, c’est-à-dire pour enlever l’excédant du composé chimique qui, sans cette précaution, continuerait de noircir en présence de la lumière, on opère comme pour l’image négative, c’est-à-dire que l’on place l’épreuve dans une dissolution d’hyposulfite de soude ou de sel marin qui dissout l’excès de chlorure d’argent non influencé. En prolongeant plus ou moins la durée de son séjour dans le bain d’hyposulfite de soude, on peut communiquer à l’épreuve une couleur qui varie, en parcourant toute l’échelle des tons bruns et des bistres, jusqu’au violet foncé et au noir intense.
Nous n’avons pas besoin d’ajouter que l’épreuve négative peut servir à donner un très-grand nombre d’autres épreuves positives, et qu’une fois obtenu, ce type peut fournir des reproductions en nombre indéfini.
CHAPITRE VII
En dévoilant au public les procédés de la photographie sur papier, avec un désintéressement et une libéralité assez rares parmi ses confrères, M. Blanquart-Évrard rendit aux arts photographiques un immense service. De toutes parts on s’empressa de mettre en pratique ces moyens, si simples dans leur exécution, si intéressants dans leurs résultats, et la photographie sur papier reçut bientôt une impulsion extraordinaire. Aussi ne fut-il pas difficile de prévoir dès ce moment, qu’elle ne tarderait pas à s’enrichir de modifications importantes et à marcher rapidement vers le degré de perfection qui lui manquait.
Obtenus en effet par les procédés décrits en 1847, par M. Blanquart-Évrard, les dessins photographiques étaient encore fort au-dessous des produits de la plaque daguerrienne. On y cherchait en vain la rigueur, la délicatesse du trait, l’admirable dégradation de teintes qui font le charme des épreuves métalliques. Le motif de cette infériorité est, d’ailleurs, facile à comprendre. La surface plane et polie d’un métal offre, pour l’exécution d’un dessin photographique, des facilités sans pareilles ; au contraire, la texture fibreuse du papier, ses aspérités, la communication capillaire qui s’établit entre les diverses parties de sa surface inégalement impressionnées, sont autant d’obstacles qui s’opposent à la rigueur absolue des lignes, comme à l’exacte dégradation des lumières et des ombres. Les défauts des images obtenues par les procédés de M. Talbot, ne tenaient donc qu’au papier lui-même. La nature fibreuse du papier, l’inégalité de son grain, l’impureté de sa pâte, son extension variable et irrégulière pendant son immersion dans les différents liquides, telles étaient les causes des difficultés que rencontraient les opérateurs. Le problème du perfectionnement de cette nouvelle branche de la photographie, consistait à remplacer la surface inégale et rugueuse employée à recevoir l’épreuve négative, par une surface homogène et parfaitement plane, imitant le poli si parfait des plaques métalliques.
Ce problème capital fut résolu par la découverte des négatifs sur verre. Au lieu de former sur le papier l’image négative, on la forme sur une lame de verre ou de glace que l’on a préalablement revêtue d’une couche d’albumine ; le dessin négatif produit sur cette glace sert ensuite à obtenir sur le papier, l’image positive.
Les moyens pratiques sont les suivants. Sur la glace qui doit recevoir l’image négative, on étend une légère couche d’albumine liquide, ou de blanc d’œuf, dans laquelle on a dissous un peu d’iodure de potassium. Une fois sèche, cette couche d’albumine forme une surface homogène et d’un poli parfait, éminemment propre à donner aux lignes du dessin un contour arrêté. Ainsi recouverte d’albumine, la lame de verre est imbibée d’iodure d’argent ; pour cela on immerge la plaque dans une cuvette contenant une dissolution de ce sel. Ensuite on l’expose au foyer de la chambre obscure, et l’on exécute sur sa surface, les opérations ordinaires que l’on fait sur le papier quand on veut obtenir une image négative. Celle-ci, une fois obtenue, constitue un cliché, ou épreuve négative sur verre, qui sert à produire l’image directe. Cette dernière image se forme sur une feuille de papier en se servant des moyens habituels. Le verre ne sert donc qu’à préparer l’image négative ; c’est là un point qu’il importe de bien faire remarquer, pour éviter une confusion que commettent beaucoup de personnes.
Les épreuves obtenues par l’intermédiaire de la glace albuminée, se reconnaissent à la rigueur extraordinaire, à la correction du dessin, à ses contours admirablement arrêtés : elles peuvent presque rivaliser, sous ce rapport, avec les produits de la plaque daguerrienne.
Ce perfectionnement fondamental dans la manière d’obtenir les négatifs, a été l’œuvre de M. Niépce de Saint-Victor, cousin de Nicéphore Niépce, et non son neveu, comme nous l’apprend M. Victor Fouque, qui a établi avec grand soin toute la généalogie des Niépce[29].
M. Niépce de Saint-Victor, que son nom prédestinait aux études et aux recherches sur la photographie, ne se voua pas, dès le début, à cette carrière. Il entra à l’école de cavalerie de Saumur, d’où il sortit en 1827, avec le grade de maréchal des logis instructeur. En 1842, il fut admis, en qualité de lieutenant, au premier régiment de dragons.
À cette époque, le goût lui vint des manipulations scientifiques, et il commença de s’adonner aux expériences de physique et de chimie.
En 1842, le ministre de la guerre manifesta l’intention de changer en couleur aurore, la couleur distinctive rose des premiers régiments de dragons : on désirait n’être pas obligé de défaire les uniformes confectionnés. La question des moyens à employer pour remplir cet objet délicat, ne laissait pas que d’embarrasser l’administration, lorsqu’on apprit qu’un lieutenant de dragons de la garnison de Montauban s’offrait à remplir cette condition difficile. Le lieutenant fut mandé à Paris ; on soumit à une commission le moyen qu’il proposait, et qui consistait à passer avec une brosse un certain liquide qui opérait la réforme désirée, sans qu’il fût même nécessaire de découdre les fracs. L’exécution de ce procédé expéditif épargna au trésor un déboursé de plus de 100 000 fr. Après avoir reçu, avec les compliments de ses chefs, une gratification de 500 francs du maréchal Soult, le lieutenant reprit le chemin de Montauban.
Ce lieutenant était M. Abel Niépce de Saint-Victor, cousin de Nicéphore Niépce, le Christophe Colomb de la photographie.
Pendant son séjour à Paris, M. Abel Niépce de Saint-Victor avait senti s’accroître son goût des manipulations scientifiques. La découverte de son parent avait jeté sur le nom qu’il portait une gloire impérissable, et, comme par une sorte de piété de famille, il se sentait instinctivement poussé dans les voies de la science. Il commença donc à s’occuper de physique et de chimie, et s’attacha particulièrement à l’étude des phénomènes daguerriens. Mais une ville de province offre peu de ressources à une personne placée dans la situation où se trouvait M. Niépce. Convaincu que la capitale lui offrirait plus d’avantages pour continuer ses recherches, il demanda à entrer dans la garde municipale de Paris.

Il y fut admis, en 1843, avec le grade de lieutenant, et fut caserné, avec sa brigade, au faubourg Saint-Martin. C’est alors que M. Niépce de Saint-Victor découvrit les curieux phénomènes auxquels donne naissance la vapeur d’iode quand elle se condense sur les corps solides. Il démontra, en 1847, que l’inégale absorption de la vapeur d’iode par les différents corps qui la reçoivent, se trouve liée à la couleur des corps absorbants, phénomène physique singulier, dont l’explication soulève beaucoup de difficultés, et qui mériterait d’être étudié d’une manière approfondie.
À la suite de ce premier travail, qui commença à attirer sur lui l’attention, M. Niépce de Saint-Victor imagina le négatif photographique sur verre, dont nous venons de parler, découverte qui sera pour lui un titre de gloire durable.
Ces intéressantes recherches, qui apportaient un puissant secours aux progrès de la photographie, M. Niépce les exécutait dans le plus étrange des laboratoires. Il y avait à la caserne de la garde municipale du faubourg Saint-Martin, une salle toujours vide : la salle de police des sous-officiers ; c’est là qu’il avait installé son officine. Le lit de camp formait sa table de travail, et sur les étagères qui garnissaient les murs, se trouvaient disposés les appareils, les réactifs et tout le matériel indispensable à ses travaux. C’était un spectacle assez curieux que ce laboratoire installé en pleine caserne ; c’était surtout une situation bien digne d’intérêt que celle de cet officier poursuivant avec persévérance des travaux scientifiques, malgré les continuelles exigences de sa profession. Nos savants sont plus à l’aise d’ordinaire ; ils ont, pour s’adonner à leurs recherches, toute une série de conditions favorables, entretenues et préparées de longue main par un budget clairvoyant. Ils ont de vastes laboratoires, où tout est calculé pour faciliter leurs travaux ; après avoir eu des maîtres pour les initier, ils ont des disciples auxquels ils transmettent les connaissances qu’ils ont acquises ; Quand le succès a couronné leurs efforts, ils ont le public qui applaudit à leurs découvertes, l’Académie qui les récompense, et au loin la gloire qui leur sourit. M. Niépce était seul ; comme il avait été sans maître, il était sans disciples ; sa solde de lieutenant formait tout son budget ; une salle de police lui servait de laboratoire. Le jour, dans tout l’attirail du savant, il se livrait à des recherches de laboratoire, entrecoupées des mille diversions de son état ; la nuit, il s’en allait par la ville, le casque en tête et le sabre au côté, veillant en silence à la tranquillité de la rue, et s’efforçant de chasser de son esprit le souvenir inopportun des travaux de la journée.

En dépit des obstacles d’une position si exceptionnelle, M. Niépce de Saint-Victor avançait dans la voie scientifique, et tout faisait, espérer qu’une réussite brillante viendrait couronner ses efforts. Mais il avait compté sans la révolution de février. Les révolutions sont impitoyables ; elles n’épargnent pas plus l’asile du savant que le palais des rois. Le 24 février 1848, l’insurrection triomphante entra dans la caserne du faubourg Saint-Martin ; elle commença par la saccager, puis elle y mit le feu. Ce laboratoire élevé avec tant de soins et de sollicitude, les produits, les spécimens de ses travaux, le modeste mobilier du lieutenant, tout périt dans ce désastre.
Nous eûmes occasion de voir M. Niépce après cette journée. Il s’était retiré dans le haut du faubourg Saint-Martin, chez un ecclésiastique de ses parents : peu de jours auparavant, sur la place de l’Hôtel-de-Ville, quelques gardes municipaux, reconnus, avaient manqué d’être victimes de la fureur d’un peuple égaré. Il vivait donc chez son parent, attendant des jours meilleurs ; et c’était, je vous l’assure, un spectacle pénible que cet homme de cœur contraint de suspendre à son chevet son épée devenue inutile à la défense des lois, que ce savant réduit à pleurer la perte de son sanctuaire dévasté. Cependant, comme à la fin tout devait reprendre sa place, M. Niépce de Saint-Victor fut incorporé dans la garde républicaine, au moment de son organisation. Quand elle prit le nom de Garde de Paris, M. Niépce de Saint-Victor reçut le grade de capitaine, et en 1854 celui de chef d’escadron.
En 1855 il fut appelé par l’Empereur, au poste de commandant du Louvre, où il continue de poursuivre ses travaux. Mais en acceptant ce poste de confiance, M. Niépce de Saint-Victor dut renoncer à son avancement dans l’armée et à une partie notable de son traitement, par suite d’une décision du ministre de la guerre, qui prescrit que les commandants des résidences impériales ne peuvent entrer en fonction qu’après avoir été mis en non-activité.
Grâce à ses nouvelles fonctions, M. Niépce de Saint-Victor trouve plus de loisirs qu’autrefois, pour s’adonner aux études concernant la photographie. Nous aurons souvent à citer son nom dans cette notice, particulièrement en ce qui concerne l’application de la photographie à la gravure et les essais de fixation des couleurs des images de la chambre noire. Mais son invention des négatifs sur verre a été l’une des plus utiles, en ce qu’elle a rendu à la photographie un service pratique d’une valeur incontestable. Malgré tous les progrès qu’a faits la photographie, tous les opérateurs s’en tiennent aujourd’hui à l’usage des clichés négatifs sur verre, dont M. Niépce de Saint-Victor eut le premier l’idée en 1848.
Cependant la préparation d’un cliché négatif sur verre avec l’albumine, est une opération assez délicate. Il faut que l’albumine soit étendue avec soin sur la glace, et séchée avec précaution. En outre, l’enduit albumineux a l’inconvénient de diminuer la sensibilité du sel d’argent à l’action de la lumière ; de telle sorte que, pour la rapidité d’impression, la glace albuminée laissait beaucoup à désirer.
On s’efforça donc de perfectionner ce procédé, en cherchant à diminuer le temps de l’impression lumineuse. Une heureuse découverte vint répondre, sous ce rapport, à tous les désirs des photographes.
Dans une brochure qui parut en janvier 1851, M. Gustave Le Gray annonçait avoir fait usage du collodion, pour remplacer l’albumine, dans la photographie sur verre ; mais il ne donnait aucun renseignement sur son mode d’emploi. Pendant la même année, un photographe de Londres, M. Archer, publia une description très-complète des procédés et moyens qui sont nécessaires pour faire usage du collodion en photographie. Les procédés publiés par M. Archer furent aussitôt mis en pratique, et l’on reconnut promptement toutes les ressources que cette matière nouvelle fournit aux opérateurs.
Le collodion est le produit de l’évaporation d’une dissolution de coton-poudre dans l’éther sulfurique mélangé d’alcool. En s’évaporant, cette dissolution laisse un enduit visqueux, qui s’obtient en quelques minutes. Or, cette pellicule organique se prête merveilleusement aux opérations photogéniques. Elle s’imprègne très-bien du composé d’argent, et s’impressionne au contact des rayons lumineux avec une rapidité étonnante. Le collodion active à un tel point l’impression photogénique, que l’on peut reproduire, par son emploi, l’image des corps animés d’un mouvement rapide, tels que les vagues de la mer soulevées par le vent, une voiture emportée sur un chemin, un cheval au trot, un bateau à vapeur en marche avec son panache de fumée et l’écume qui jaillit au choc de ses roues.
On comprend sans peine, dès lors, que le collodion ait été accueilli avec une grande faveur par les photographes. Le portrait, qui ne pouvait s’obtenir qu’à grand’peine sur la glace albuminée, en raison de la lenteur d’impression de la matière sensible, s’exécute au moyen du collodion, avec la plus grande facilité ; aussi cette matière est-elle aujourd’hui la seule en usage pour l’exécution des portraits.
Un jeune physicien enlevé prématurément aux sciences, Taupenot, donna le moyen de communiquer aux plaques de verre recouvertes de collodion, la propriété de conserver pendant plusieurs jours leur sensibilité. Quand on opère avec le collodion, il faut agir extemporanément ; car la sensibilité de l’enduit disparaît au bout de peu de minutes, par sa dessiccation, ce qui prive le paysagiste et le photographe voyageur, de l’avantage d’emporter au loin, avec lui, des lames de verre collodionnées préparées d’avance. C’était là un grave inconvénient pour la pratique de la photographie. Taupenot a parfaitement obvié à cette difficulté en ajoutant au collodion ioduré un peu d’albumine. Grâce à cette addition, la plaque sèche conserve toute la sensibilité de la plaque humide, et on peut l’employer après plusieurs jours de préparation.
Il a été reconnu depuis, que le miel et quelques autres substances agglutinatives qui s’opposent au fendillement qu’éprouve par la dessiccation, la couche de collodion, produisent le même effet, c’est-à-dire permettent de conserver pendant plusieurs jours aux plaques collodionnées, leur sensibilité à la lumière.
Le collodion étendu sur une lame de verre, est donc le meilleur moyen que l’on possède aujourd’hui pour la production des négatifs. Le cliché négatif sur verre donne des images d’une finesse presque égale à celle de la plaque daguerrienne.
CHAPITRE VIII
Nous négligeons plusieurs perfectionnements de détail, — tels que la manière d’obtenir les épreuves positives directes, — l’artifice qui consiste à détacher du verre la couche de collodion transformée en positif direct, et à la rapporter sur toile ou sur papier, etc., — pour arriver à la découverte la plus importante qui ait été faite dans ces derniers temps. Nous voulons parler des observations de M. Auguste Poitevin concernant la modification chimique qu’éprouvent, par l’action de la lumière, les chromates, mélangés de substances gélatineuses ou albumineuses. Les découvertes de M. Poitevin ont donné le signal d’une foule d’applications nouvelles, et ont conduit, en particulier, à la solution du grand problème de la photographie, c’est-à-dire à la transformation des épreuves photographiques en gravures semblables aux gravures en taille-douce.
C’est en 1855 que M. Poitevin fit la découverte de la propriété que possèdent les matières gommeuses, gélatineuses, albumineuses, ou mucilagineuses, quand on les a mêlées avec du bichromate de potasse, et qu’on les a exposées à l’action de la lumière, de pouvoir prendre et retenir l’encre d’impression. Cette observation était fondamentale ; elle devint le signal d’une foule de recherches.
Elle donna d’abord le moyen de tirer des épreuves positives en excluant les sels d’argent. On n’a pas, en effet, tardé à reconnaître que les épreuves photographiques positives, quand elles ne sont pas tirées avec les soins nécessaires, surtout quand elles sont mal lavées et retiennent encore de l’hyposulfite de soude, s’altèrent, pâlissent, et finissent, au bout de quelques années, par disparaître en partie. De là le précepte théorique qui avait été posé, d’effectuer le tirage avec l’encre ordinaire d’impression, qui sert à tirer les gravures et les lithographies. Le fait découvert par M. Poitevin, de l’impressionnabilité d’un mélange de bichromate de potasse et de gélatine par la lumière, de telle sorte que la gélatine ainsi modifiée peut retenir l’encre d’imprimerie, vint répondre à cette indication de la théorie, et la gélatine chromatée fut appliquée au tirage des positifs. Ainsi fut créée la méthode du tirage des positifs inaltérables au charbon.
Mais là ne se sont pas bornées les applications de la découverte de M. Poitevin. La gravure des épreuves photographiques en a été la conséquence.

M. Poitevin lui-même est entré le premier avec éclat dans cette voie, qui a ouvert un horizon imprévu à la photographie. Il a, le premier, donné la solution du problème général de la gravure héliographique. M. Poitevin créa la photo-lithographie, c’est-à-dire l’art de transporter sur pierre une épreuve photographique, et de la tirer avec l’encre lithographique, comme une lithographie ordinaire.
Sur une pierre convenablement grainée, on dépose un mélange d’albumine et de bichromate de potasse ; on place par-dessus le cliché négatif sur verre, d’une épreuve photographique, et on expose le tout à la lumière. La lumière modifie les parties de la pierre gélatinée qu’elle touche, de telle façon que l’encre ne pourra adhérer que sur les parties éclairées. L’encrage et le tirage s’opèrent ensuite comme pour une lithographie ordinaire.
M. Poitevin fit aussi cette autre découverte importante, que la gélatine mélangée de bichromate de potasse, ne peut plus se gonfler par l’eau, lorsqu’elle a été frappée par la lumière, tandis que les parties non influencées par l’agent lumineux, se gonflent rapidement en absorbant l’eau. En prenant une empreinte de cette gélatine ainsi gonflée inégalement, et reproduisant ce moulage de gélatine en une planche de cuivre, grâce aux procédés galvanoplastiques, on arrive à former d’assez bonnes planches pour la gravure ou la typographie.
La méthode de M. Poitevin, pour la gravure photographique, repose donc sur la propriété que possède la gélatine imprégnée de bichromate de potasse, et soumise ensuite à l’action de la lumière, de perdre la faculté de se gonfler dans l’eau, tandis que la gélatine ainsi préparée, mais non impressionnée par l’action lumineuse, se gonfle considérablement (au point d’augmenter d’environ six fois son volume), quand on la plonge dans l’eau.
La curieuse modification subie, dans cette circonstance, par la gélatine imprégnée de bichromate de potasse, tient à ce que les sels d’acide chromique, et surtout les bichromates, quand ils sont mêlés à des substances organiques, s’altèrent chimiquement au contact des rayons lumineux, l’acide chromique passant, sous cette influence, à l’état d’oxyde de chrome. L’acide chromique, réduit par l’action de la lumière et changé en oxyde de chrome, transforme la gélatine en une substance particulière, qui diffère de la gélatine ordinaire en ce qu’elle n’est pas pénétrable par l’eau et, par conséquent, n’est pas susceptible de se gonfler par l’absorption de ce liquide.
Grâce à la propriété du mélange qui vient d’être décrit, M. Poitevin transporte à volonté une épreuve photographique sur une pierre lithographique ou sur une lame de cuivre, pour en tirer des épreuves lithographiques sur papier ou des gravures sur cuivre.

Pour le premier cas, c’est-à-dire pour la litho-photographie, le procédé de M. Poitevin consiste à déposer à la surface d’une pierre lithographique, de la gélatine mêlée avec une solution de bichromate de potasse ; on laisse sécher, puis on recouvre cette pierre avec un cliché négatif, et on l’expose à l’influence de la lumière solaire : sous cette influence, le bichromate passe à l’état d’oxyde de chrome et devient insoluble. Au moyen de lavages à l’eau, on enlève la gélatine qui n’a pas été altérée ; on passe sur la pierre le rouleau lithographique ou le tampon, et l’encre s’attache seulement aux endroits où il est resté de l’oxyde de chrome.
Voici maintenant la manière d’obtenir avec une épreuve photographique, une planche de cuivre propre à fournir des gravures sur papier.
On applique une couche plus ou moins épaisse de dissolution de gélatine sur une surface plane, sur une lame de verre par exemple ; on la laisse sécher et on la plonge ensuite dans une dissolution de bichromate de potasse ; on laisse sécher de nouveau, et l’on impressionne, soit à travers un négatif photographique sur verre, soit à travers un dessin positif. Après l’impression lumineuse, dont la durée doit varier selon l’intensité de la lumière, on plonge dans l’eau la couche de gélatine ; alors toutes les parties qui n’ont pas reçu l’action de la lumière, se gonflent et forment des reliefs, tandis que celles qui ont été impressionnées, ne prenant pas d’eau, restent en creux. On transforme ensuite cette surface de gélatine gravée, en planches métalliques, en la moulant, au moyen du plâtre, avec lequel on obtient immédiatement, par la galvanoplastie, des planches métalliques, ou bien on la moule directement par la galvanoplastie, après l’avoir métallisée.

Par ce procédé, les dessins négatifs au trait fournissent des planches métalliques en relief, pouvant servir à l’impression typographique tandis que les dessins positifs donnent des planches en creux pouvant être imprimées en taille-douce.
Tel est le principe du procédé qui a servi à créer, entre les mains de M. Poitevin, la photo-lithographie et la gravure héliographique. Le procédé primitif de M. Poitevin a été singulièrement perfectionné, mais il est juste de proclamer les droits du véritable créateur de cet art.
Nous donnons à titre de spécimens historiques (fig. 25 et 26), deux figures gravées par M. Poitevin, par les procédés que nous venons de décrire. Ces gravures sont imparfaites, sans doute, mais elles ont l’avantage de mettre sous les yeux du lecteur les premiers résultats des tentatives ayant pour objet la création de la gravure héliographique.
Une autre découverte importante de la branche des arts scientifiques qui nous occupe, est celle des émaux photographiques due à M. Lafon de Camarsac, qui permet de transformer en médaillons sur porcelaine les épreuves de photographie, lesquelles peuvent alors remplacer les émaux obtenus par les procédés de peinture sur porcelaine ou sur émail.
C’est dans le brevet pris par l’auteur, en 1854, que l’on trouve très-nettement formulé le principe sur lequel les opérateurs ont fondé plus tard la production de toutes sortes d’épreuves vitrifiées. Ce principe consiste à renfermer des matières colorées inaltérables et réduites en poudre impalpable, dans une couche de substance impressionnable à la lumière, et adhésive. M. Lafon de Camarsac obtenait ce résultat soit en mélangeant la poudre colorée à l’enduit avant son exposition à la lumière, soit après cette exposition. Dans les deux cas, toute la matière photogénique est éliminée après l’exposition au feu, et il ne reste à la surface de la porcelaine que des couleurs inaltérables.
L’inventeur avait eu recours à toutes les couleurs employées en céramique, et obtenu, dès l’origine de cet art nouveau, des épreuves photographiques vitrifiées de la plus belle intensité de ton.
L’exploitation a suivi de près l’invention scientifique. En 1856, M. Lafon de Camarsac produisait déjà un nombre considérable d’émaux photographiques pour la bijouterie. Depuis ces périodes de début, des clichés de ce genre ont été envoyés dans toutes les parties du monde, et plus de quinze mille émaux ont été répandus dans le public. Cette production paraîtra immense, si l’on réfléchit aux difficultés attachées au maniement des matières céramiques, et aux soins qu’il faut apporter à chaque épreuve pour en faire une petite œuvre d’art. L’auteur a dû tout créer dans cette voie, puisque ses recherches ne pouvaient s’appuyer sur aucune découverte antérieure.
Toute une industrie nouvelle est sortie des travaux de M. Lafon de Camarsac. Pour en donner une idée, il suffira de dire que l’émailleur formé dès l’origine par l’inventeur a déjà fabriqué plus de cent mille plaques d’émail destinées à la photographie.
Si nous signalons maintenant la découverte des procédés d’agrandissement des épreuves photographiques, qui permet d’amplifier à volonté ces épreuves, découverte à laquelle a pris une très-grande part un des physiciens photographes les plus distingués de notre temps, M. Van Monckhoven ; si nous citons enfin l’application de la lumière électrique, et de celle de l’éclairage par la combustion du magnésium, au tirage des épreuves positives, nous aurons terminé cette revue historique de la photographie, ces sortes d’éphémérides de l’art merveilleux créé par la persévérance et le talent de Daguerre.
CHAPITRE IX
Nous venons de présenter l’histoire de la photographie, et d’exposer ses perfectionnements successifs. Est-il nécessaire d’ajouter que, pour clore la série de ces créations remarquables, un dernier pas reste à franchir ? Tous nos lecteurs l’ont dit avant nous, car c’est là le problème que l’impatience des gens du monde ne cesse de poser à la sagacité des savants : il reste à reproduire les couleurs. Aux remarquables produits de l’appareil de Daguerre, à ces images d’une si admirable délicatesse, d’une fidélité si parfaite, il faut ajouter le charme du coloris. Il faut que le ciel, les eaux, toute la nature inanimée ou vivante, puissent s’imprimer sous nos yeux en conservant la richesse, la variété, l’harmonie de leurs teintes. L’action de la lumière nous donne aujourd’hui des dessins, il faut que ces dessins deviennent des tableaux.
Mais, avant tout, le fait est-il réalisable, et la reproduction spontanée des couleurs ne dépasse-t-elle point la limite des moyens dont la science dispose de nos jours ?
Si l’on eût adressé cette question à un savant initié aux lois générales de l’optique, il n’eût guère hésité à condamner une telle espérance. « Rien n’autorise, aurait-il dit, rien ne justifie l’espoir de fixer un jour les images de la chambre obscure en conservant leurs teintes naturelles ; aucune des notions que nous avons acquises sur les propriétés et les aptitudes de l’agent lumineux, n’a encore dévoilé de phénomène de cet ordre. On comprend, au point de vue théorique, l’invention de Daguerre et le parti qu’on en a tiré. Il a suffi, pour en venir là, de trouver une substance qui, au contact des rayons lumineux, passât du blanc au noir ou du noir au blanc. Il n’y avait dans cette action rien de très-surprenant en fin de compte, rien qui ne fût en harmonie avec les faits que l’optique nous enseigne ; mais de là à l’impression spontanée des couleurs il y a véritablement tout un monde de difficultés insurmontables. Remarquez, en effet, qu’il s’agit de trouver une substance, une même substance qui, sous la faible action chimique des rayons lumineux, puisse être influencée de telle manière que chaque rayon inégalement coloré provoque en elle une modification chimique particulière, et de plus que cette modification ait pour résultat de donner autant de composés nouveaux reproduisant intégralement la couleur propre au rayon lumineux qui les a frappés. Il y a dans ces deux faits, et surtout dans l’accord de ces deux faits, des conditions tellement en dehors des phénomènes habituels de l’optique, que l’on peut affirmer sans crainte qu’un tel problème est au-dessus de toutes les ressources de l’art. »
Ainsi eût parlé notre physicien, et certes il eût trouvé peu de contradicteurs. Cependant quelques observations intéressantes, et que nous allons rapporter, sont venues faire concevoir à cet égard quelques légères espérances.
En 1848, M. Edmond Becquerel a réussi à imprimer sur une plaque d’argent, l’image du spectre solaire. On sait ce que les physiciens entendent par spectre solaire. La lumière blanche, la lumière du soleil, résulte de la réunion d’un certain nombre de rayons diversement colorés, dont l’impression simultanée sur notre œil, produit la sensation du blanc. Si l’on dirige, en effet, un rayon de soleil sur un verre transparent taillé en prisme, les différents rayons composant ce faisceau de lumière, sont inégalement réfractés dans l’intérieur du verre ; au sortir du prisme, ils se séparent les uns des autres, ils divergent en éventail, et viennent former, sur l’écran où on les reçoit, une image oblongue dans laquelle on retrouve isolées toutes les couleurs simples qui composent la lumière blanche ; on y voit assez nettement indiqués le rouge, l’orangé, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo et le violet. On donne le nom de spectre solaire à cette bande colorée qui provient de la décomposition de la lumière.
C’est là l’image que M. Edmond Becquerel est parvenu, en 1848, à imprimer sur une plaque d’argent préalablement exposée à l’action du chlore. Ce fait démontre que la reproduction photogénique des couleurs n’est pas impossible, puisqu’il existe des agents chimiques capables de s’impressionner au contact des rayons lumineux, de manière à conserver les teintes des rayons qui les ont frappés.
Antérieurement, le physicien Seebeck et sir John Herschell, avaient vu le chlorure d’argent prendre quelques nuances analogues à celles de la région du spectre qui le frappait ; et M. Hunt, en 1840, avait vu la même substance, exposée au soleil sous des verres colorés, se revêtir de nuances rappelant celles de ces verres.
De l’ensemble de ces faits, on pouvait conclure que la production photogénique des couleurs n’est pas impossible, puisqu’il existe des substances capables de s’impressionner diversement au contact des rayons lumineux différemment colorés.
Voici comment opérait M. Edmond Becquerel. Il plongeait une lame de plaqué d’argent dans une dissolution aqueuse d’acide chlorhydrique, où elle se recouvrait d’une couche de sous-chlorure d’argent, d’un violet rose, sous l’action d’une faible pile de Bunsen. La plaque ainsi préparée, exposée aux rayons du spectre solaire, ne tardait pas à s’impressionner de teintes correspondantes. Quand cette exposition était prolongée, les teintes se prononçaient davantage, mais, en même temps, elles s’assombrissaient. Recuite dans l’obscurité, à une température de 80 à 100 degrés, la plaque prenait une couleur de bois ; mais dès qu’elle s’était refroidie, le spectre s’y imprimait avec des nuances vives et claires.
L’expérience de M. Becquerel, tout en présentant une valeur théorique très-grande, ne fournissait malheureusement aucun moyen pratique d’arriver à la reproduction des couleurs. En effet, cette image colorée ne peut être fixée par aucun agent chimique ; lorsqu’on l’expose à la clarté du jour, le chlorure d’argent continuant de s’impressionner, la surface entière de la plaque devient noire, et toute image disparaît ; pour l’empêcher de se détruire, il faut la conserver dans une obscurité complète.
Une autre circonstance défavorable, c’est l’extrême lenteur avec laquelle s’accomplit l’impression lumineuse. L’action directe du soleil s’exerçant pendant deux heures, est indispensable pour obtenir un effet : aussi les images de la chambre obscure sont-elles trop faiblement éclairées pour agir ainsi sur la plaque ; des journées entières n’y suffiraient pas.
Il faut mentionner enfin une circonstance plus grave. Les couleurs simples, les teintes isolées du spectre, sont jusqu’ici les seules que l’on ait pu fixer par le procédé qui vient d’être décrit ; les teintes composées, c’est-à-dire toutes celles qui appartiennent aux objets éclairés par la lumière ordinaire, ne s’impriment jamais sur le chlorure d’argent : les objets blancs, par exemple, au lieu de laisser cette couleur sur la plaque, s’y impriment en noir.
Néanmoins, en choisissant convenablement les modèles, M. Edmond Becquerel a pu obtenir la reproduction de certaines estampes coloriées. Ayant appliqué une estampe enluminée sur la couche métallique traitée comme on l’a dit plus haut, et exposé le tout au soleil, M. Becquerel a vu l’estampe s’imprimer avec ses couleurs. Il a reproduit de la même manière, les images de la chambre obscure.
Toutefois, aucune de ces images photo-chromatiques n’a pu être fixée. Toutes les dissolutions, tous les vernis, qu’on a essayés, font disparaître ces couleurs trop délicates, ne laissant qu’une image en noir.
Ainsi, le fait découvert par M. Becquerel est loin de justifier toutes les espérances que l’on avait conçues un moment. Il démontre seulement que le problème de la reproduction photogénique des couleurs pourra recevoir un jour quelque solution, et que les personnes qui s’adonnent à ce genre de recherches ne trouveront plus, comme autrefois, dans les principes de la science, la condamnation anticipée de leurs tentatives. Quelque limitée qu’elle soit dans ses conséquences actuelles, cette observation n’en conserve pas moins son importance. On peut espérer, en effet, que des travaux bien dirigés feront découvrir d’autres agents chimiques jouissant des propriétés du chlorure d’argent et répondant mieux que ce composé aux exigences de l’application pratique.

Déjà M. Niépce de Saint-Victor, se vouant avec persévérance à ces difficiles recherches, a été conduit à quelques résultats intéressants. M. Edmond Becquerel a découvert, avons-nous dit, qu’une lame de plaqué d’argent immergée dans une dissolution de chlore, acquiert la propriété de reproduire les couleurs du spectre solaire. Poursuivant l’examen de ce phénomène, M. Niépce de Saint-Victor a reconnu que la coloration du chlorure d’argent en diverses teintes, sous l’influence de la lumière, dépend de la proportion de chlore qui existe dans les bains où l’on plonge la lame d’argent, de telle manière que l’on peut voir apparaître telle ou telle couleur, selon la quantité de chlore contenue dans le bain. Ainsi, selon M. Niépce, lorsque la quantité de chlore est la plus petite possible, la couleur dominante est le jaune ; à mesure que le chlore devient plus abondant, la couleur dominante est tour à tour le vert, le bleu, l’indigo, le violet, le rouge, l’orangé : ces deux dernières couleurs n’apparaissent que lorsque la solution est entièrement saturée de chlore. M. Niépce de Saint-Victor a encore reconnu que certains chlorures métalliques, et particulièrement le chlorure de cuivre et le deutochlorure de fer, donnent beaucoup plus facilement naissance à des images colorées que la simple dissolution aqueuse de chlore employée par M. Becquerel.
Partant de ces remarques, M. Niépce de Saint-Victor a pu reproduire sur une plaque chlorurée certaines couleurs naturelles. Pour obtenir telle ou telle couleur, le jaune, par exemple, M. Niépce prend une dissolution de chlorure de fer ou de chlorure de cuivre, contenant à peu près la quantité de chlore nécessaire pour faire apparaître la teinte jaune dans le spectre solaire ; pour donner naissance, sur une même plaque, à toutes les couleurs à la fois, il se sert d’une dissolution de chlorure contenant à peu près la quantité de chlore qui correspond aux rayons jaunes ou verts, c’est-à-dire aux rayons moyens du spectre.
Voici comment opère M. Niépce pour obtenir des reproductions de gravures coloriées. Il prépare, avec une quantité convenable de chlorure de fer ou de cuivre, une dissolution, dans laquelle il immerge, pendant huit à dix minutes, une plaque de cuivre argentée ; cette plaque se recouvre de chlorure d’argent, par suite de la réaction du chlorure sur le métal. Chauffée légèrement, au sortir du bain, à la flamme d’une lampe à esprit-de-vin, elle est propre à recevoir l’image colorée. Si l’on applique, en effet, contre cette lame métallique, une de ces gravures sur bois grossièrement enluminées que le commerce fournit à bas prix, et qu’on expose le tout à l’action directe du soleil, au bout d’un quart d’heure la gravure se trouve reproduite sur le métal, avec des teintes qui ne s’éloignent pas trop de celles du modèle.
Le fait découvert par M. Niépce, de la reproduction spontanée de certaines couleurs, offre beaucoup d’intérêt ; cependant il ne faudrait pas vouloir en pousser trop loin les conséquences, ni prétendre qu’il doive conduire à la reproduction photogénique des couleurs. De graves considérations, empruntées aux principes les mieux établis de la physique, démontreraient sans peine la proposition contraire. Ces considérations, nous les présenterons en peu de mots.
L’image colorée que l’on obtient sur le chlorure d’argent n’est point le résultat final de l’action chimique de la lumière, ce n’est qu’une période, qu’un degré transitoire de cette action. Si l’influence des rayons lumineux continue de s’exercer, les couleurs primitivement obtenues ne tardent pas à disparaître, et la plaque revêt, dans toutes ses parties, une teinte uniforme. Aussi, pour conserver intacte cette impression colorée, faut-il, en quelque sorte, la saisir au passage, arrêter à un certain moment l’exposition à la lumière, et conserver ensuite dans un lieu obscur, la plaque ainsi modifiée. Si on l’abandonnait plus longtemps à l’action des rayons lumineux, le chlorure d’argent continuerait de s’altérer, et tout disparaîtrait. Pour rendre permanente l’impression colorée, il faudrait donc posséder un moyen de la fixer, comme on fixe l’image ordinaire du daguerréotype sur plaque. Mais ici les difficultés naissent en foule. En effet, la matière à laquelle on pourrait recourir pour fixer les couleurs formerait, à la surface de la plaque, une couche qui serait ou translucide ou opaque. Si la couche était translucide, la lumière, la traversant, irait agir sur l’image, et, par son action chimique, détruirait en quelques instants ses couleurs. Si la couche fixante était opaque, elle ne pourrait reproduire les teintes de l’image primitive qu’à la condition de revêtir, aux différents points de la plaque, des tons correspondants aux parties de l’image photogénée qu’elle recouvrirait. On voit à quelles impossibilités on se trouve conduit par là. Il ne faut point oublier, en effet, que dans les images obtenues sur plaque par les procédés de Daguerre, rien ne subsiste de la substance primitive qui a reçu l’impression de la lumière ; les différents composés dont on a fait usage, l’iodure, le bromure d’argent que la lumière a modifiés, sont remplacés par un dépôt de mercure, de telle manière que les sels d’argent n’ont servi que d’intermédiaire, et qu’en fin de compte et toutes les manipulations terminées, il ne reste plus sur la plaque daguerrienne que du mercure et de l’argent. De même, sur une épreuve positive de photographie sur papier, il ne reste plus qu’une couche inaltérable d’argent métallique. Ce sont des opérations du même genre qu’il faudrait pouvoir accomplir pour rendre permanentes les images colorées de M. Niépce de Saint-Victor. Mais rien jusqu’à ce moment n’a donné l’espoir d’atteindre un tel résultat.
Une seconde considération concourt à enlever beaucoup de leur valeur pratique aux faits observés par M. Niépce de Saint-Victor. On démontre en physique, que la lumière colorée qui émane des différents objets, est toujours mêlée d’une certaine quantité de lumière blanche. Le rouge le plus vif, le bleu le plus intense, émettent, en même temps que les rayons colorés qui leur sont propres, une notable quantité de lumière blanche. Par conséquent, toutes les fois que l’on essayera de reproduire par le daguerréotype les couleurs naturelles, cette lumière blanche, venant se mêler aux rayons colorés qui émanent de chaque objet, introduira, dans les résultats de l’action chimique, des effets complexes et dont il sera impossible de tenir compte par avance. Cette circonstance explique le fait que jusqu’à ce moment M. Niépce de Saint-Victor ait toujours échoué, lorsque, au lieu de reproduire simplement des gravures coloriées par l’action de la lumière solaire, il a essayé de fixer une image prise dans la chambre obscure. Dans ce cas, l’impression, au lieu d’être revêtue de diverses couleurs, présente une teinte uniforme.
Poursuivies dans leurs dernières conséquences, ces réflexions amèneraient à rejeter tout espoir de fixer par un agent photographique l’image colorée des objets extérieurs ; elles conduiraient à regarder pour ainsi dire ce genre de recherches comme la pierre philosophale de la photographie. On pourrait cependant ne pas laisser ces objections sans réponse ; on pourrait dire que l’étude chimique de la lumière est féconde en surprises, que la lumière est encore aujourd’hui le moins connu de tous les agents physiques, et que l’on a vu depuis quelques années, se succéder, dans les phénomènes de cet ordre, tant de faits extraordinaires, qu’il se pourrait bien que quelque observation soudaine vînt renverser l’échafaudage de nos raisonnements théoriques. Cette réplique aurait sa justesse, et nous la laissons subsister comme un encouragement aux physiciens qui continuent à s’adonner à l’examen des faits curieux que nous avons signalés.
Parmi les expérimentateurs qui persistent dans les tentatives de la fixation des couleurs des images de la chambre obscure, il faut citer M. Poitevin, à qui l’on doit la grande découverte de l’action réductrice de la lumière sur les chromates mélangés de matières organiques. M. Poitevin, a fait, en 1866, une série d’expériences intéressantes dans le but d’arriver à la fixation des couleurs naturelles, et cette fois, non sur une plaque métallique, mais sur le papier.
M. Poitevin a cherché si l’action de la lumière ne serait pas facilitée et rendue plus complète sur le chlorure d’argent violet, par le mélange de ce produit avec différentes autres substances sensibles. L’emploi des corps réducteurs, c’est-à-dire ceux qui absorbent le chlore, n’a donné à M. Poitevin aucun résultat avantageux ; mais il en a été autrement des corps qui fournissent soit de l’oxygène, soit du chlore, pourvu qu’ils n’exercent aucune action directe sur le chlorure d’argent. Les composés qui ont donné les meilleurs résultats, sont les bichromates alcalins, l’acide chromique et l’azotate d’urane.
Le fait essentiel constaté par M. Poitevin, c’est que le chlorure d’argent violet qui, sur papier, ne se colore que très-lentement et très-incomplètement lorsqu’il est exposé à la lumière solaire, à travers un dessin transparent ou colorié, est, au contraire, modifié, même à la lumière diffuse, lorsqu’on l’a préalablement recouvert de la dissolution d’une des substances indiquées plus haut. Le chlorure d’argent prend alors les teintes propres aux rayons colorés qui agissent sur lui.
Cette action simultanée des sels oxygénés et de la lumière sur le chlorure d’argent violet, est très-importante, en ce qu’elle permet d’obtenir sur papier, des images colorées qui se rapprochent beaucoup de celles obtenues sur les plaques.
Décrivons maintenant le procédé employé par M. Poitevin.
Sur du papier recouvert préalablement d’une couche de chlorure d’argent violet, obtenu lui-même par l’exposition à la lumière du chlorure blanc, en présence d’un sel réducteur, on applique un liquide formé par le mélange d’un volume de dissolution saturée de bichromate de potasse, un volume de dissolution saturée de sulfate de cuivre et un volume de dissolution à 5 pour 100 de chlorure de potassium ; on laisse sécher le papier ainsi préparé et on le conserve à l’abri de la lumière. Le bichromate de potasse pourrait être remplacé par l’acide chromique ou par l’azotate d’urane. Avec ce papier, pour ainsi dire supersensibilisé, l’exposition à la lumière directe n’est que de cinq à dix minutes, lorsqu’elle a lieu à travers des peintures sur verre, et on peut très-bien suivre la venue de l’image en couleur. Ce papier n’est pas assez impressionnable pour qu’on puisse l’employer utilement dans la chambre noire ; mais, tel qu’il est, il donne des images en couleur dans l’appareil d’agrandissement qu’on appelle mégascope solaire.
On peut conserver ces images photo-chromatiques dans un album, si l’on a eu la précaution de les laver à l’eau acidulée par de l’acide chromique, de les traiter ensuite par de l’eau contenant du bichlorure de mercure, et de les laver encore à l’eau chargée de nitrate de plomb, et enfin à l’eau pure. Dans cet état, elles ne s’altèrent pas à l’abri de la lumière.
Malheureusement, ces nouvelles images photogéniques ne sont guère plus stables à la lumière que les images que MM. Edmond Becquerel et Niépce de Saint-Victor, avaient obtenues en 1848, sur des plaques chlorurées. M. Edmond Becquerel affirme que les impressions ne lui ont pas paru se faire plus rapidement sur papier que sur plaques ; il y aura probablement peu de différence sur ce point. Mais comme les images sur papier s’obtiennent avec beaucoup plus de facilité, les recherches de M. Poitevin permettent d’étendre l’étude de ces phénomènes curieux, et peut-être de faire un pas de plus vers la solution du grand problème de la fixation des couleurs par la photographie.
On voyait à l’Exposition universelle de 1867, les spécimens de l’état actuel de la question de la fixation des couleurs en photographie. M. Niépce de Saint-Victor avait présenté ses photographies colorées obtenues sur plaque métallique. Seulement, on ne pouvait jeter sur ces images qu’un coup d’œil rapide, car elles ne peuvent, hélas ! être fixées par aucun moyen ; de sorte que si on les laissait exposées à la lumière, elles ne tarderaient pas à s’altérer et à disparaître. Aussi étaient-elles renfermées dans un album tenu sous clef, qui ne s’ouvrait que grâce à une requête adressée au gardien.
M. Niépce, avait disposé, dans un stéréoscope, une de ces images colorées. Tout le monde pouvait les voir dans l’instrument ; on était seulement prié de remettre, après avoir vu, les deux tampons, qui, dans l’état ordinaire, bouchaient les lentilles du stéréoscope.
Un album d’héliochromie sur papier présentant des images de couleurs assez peu variées et toujours rougeâtres, composé par M. Poitevin, figurait également à l’Exposition ; Mais il était enfermé sous serrure et cadenas, pour conserver ses fugitives couleurs.
Nous venons de signaler les études sérieuses et les travaux scientifiques qui ont eu pour objet la fixation photogénique des couleurs naturelles. Nous mentionnerons, en quittant ce sujet, un célèbre puff américain, qui se rapporte à ce même problème. Cette mystification qui, hardiment conduite, a valu à son auteur un bénéfice net de deux cent mille francs, vaut la peine d’être racontée.
Les États-Unis sont sans aucun doute le pays de la terre où la photographie compte le plus d’adeptes : on y trouve dix mille photographes. De ce nombre était M. Hill, pasteur retraité à New-York. Le problème de la reproduction des couleurs par les agents photographiques, avait séduit l’imagination de ce praticien ; il s’occupa quelque temps avec zèle et conscience de recherches sur ce sujet. Mais, comme tant d’autres, il échoua dans cette entreprise. Seulement M. Hill, qui connaît le prix du temps, ne voulut pas avoir perdu son année en essais inutiles, et ne pouvant, avec les résultats de son travail, s’élever à la gloire, il résolut de s’en servir pour arriver à la fortune. Voici comment il y parvint.
Au mois de janvier 1851, un journal de New-York spécialement consacré à la photographie, le Photographic art Journal, annonça que, par de longues et minutieuses recherches, un photographe américain venait de découvrir le moyen de reproduire avec leurs couleurs naturelles, les images de la chambre obscure ; cet heureux inventeur, c’était M. Hill, qui affirmait avoir en sa possession un grand nombre d’épreuves colorées obtenues par le daguerréotype. L’auteur de cet article du journal n’avait pu obtenir encore la faveur d’examiner les épreuves, mais un gentleman honorablement connu dans la ville, et dont il citait le nom, les avait tenues entre ses mains et se portait garant de la découverte.
Cette annonce ayant produit tout l’effet qu’il en attendait, M. Hill expédia à tous les photographes des États-Unis, une circulaire, dans laquelle il promettait de publier prochainement un ouvrage qui fournirait des éclaircissements sur sa découverte. L’auteur ajoutait qu’un exemplaire de ce livre serait envoyé à toutes les personnes qui lui feraient parvenir, avec leur adresse, la somme de cinq dollars (25 francs). Au bas de la circulaire, se trouvait un certificat signé de plusieurs noms, attestant que M. Hill était un respectable ecclésiastique à qui toute confiance pouvait être accordée.
Le volume annoncé ne tarda pas à paraître ; il contenait cent pages d’impression, et pouvait avoir coûté à l’auteur 30 centimes l’exemplaire. Il y a, avons-nous dit, dix mille photographes aux États-Unis, trois mille au moins achetèrent le livre : M. Hill retira donc de sa spéculation environ 14 000 dollars. Il est bien entendu que l’ouvrage ne disait pas un mot de la reproduction des couleurs ; il ne renfermait que quelques descriptions banales des procédés ordinaires du daguerréotype.
Peu de temps après, M. Hill adressait au Photographic art Journal une lettre pour expliquer les motifs qui l’avaient détourné de donner, dans sa brochure, la description de son procédé. Ces raisons étaient sans réplique. Il lui restait à découvrir le moyen de fixer la couleur jaune, et dans l’intérêt de sa découverte, il ne voulait rien publier avant d’avoir terminé son œuvre. Une maladie avait interrompu ses travaux, mais il allait avant peu les reprendre, et publier une nouvelle brochure où ses procédés seraient fidèlement décrits.
La seconde édition annoncée parut au bout d’un mois. Elle coûtait trois dollars, et rapporta à l’auteur la moitié de ce que la première édition avait produit, 35 000 francs environ.
Cependant ce n’était pas tout encore, car bientôt un nouveau livre fut promis, qui devait dévoiler « les quatre grands secrets de l’art photographique. » Prix : cinq dollars. Cette brochure fut aussi discrète que ses aînées sur les procédés chromotypiques de M. Hill. Seulement on lisait l’avis suivant sur la couverture :
« Plusieurs années d’expériences et d’études nous ont amené à la découverte de quelques faits remarquables qui touchent à l’obtention des couleurs naturelles dans la photographie : par exemple, nous pouvons produire le bleu, le rouge, le violet et l’orangé ensemble sur une même plaque. Nous pouvons aussi reproduire un paysage avec ses couleurs parfaitement développées, et cela dans un espace de temps trois fois moindre que pour obtenir une image ordinaire : le grand problème est résolu, bientôt le résultat en sera confié à tous ceux qui voudront payer un prix modéré. »
En même temps, le Daguerrian Journal, autre recueil américain consacré aux arts photographiques, se répandait en éloges sur la découverte de M. Hill. L’éditeur de ce journal se présentait comme le confident secret de l’inventeur, et fatiguait sa plume de descriptions enthousiastes. Il écrivait dans son numéro de mai 1851 : « Si Raphaël avait vu une seule de ces épreuves avant de terminer la Transfiguration, il eût jeté sa palette et pour jamais renoncé à peindre. » Il baptisait du nom de Hillotype un instrument que personne n’avait vu, et publiait le portrait de M. Hill, qu’il considérait comme « l’un des plus grands hommes qui aient vécu. »
Le résultat de ces manœuvres était facile à deviner. Un véritable enthousiasme éclata pour le nouveau révélateur. Au milieu des élans de l’admiration générale, on ne remarquait aucune des contradictions qui éclataient à chaque assertion nouvelle émise par l’inventeur. Sa maison était assiégée de personnes qui venaient lui offrir une association ou lui proposer d’acheter son brevet. À toutes ces offres, M. Hill répondait, avec beaucoup de calme, que, pour bien s’entendre, il fallait commencer par étudier avec lui les éléments de la photographie ; il recueillait ainsi des élèves au prix de 50 dollars pour quelques leçons.
Bientôt le nombre des visiteurs et des élèves devint si grand, que M. Hill fit annoncer qu’à dater de ce jour il fermait sa porte à tout le monde.
Cependant quelques personnes douées de pénétration n’hésitèrent pas à prédire que le révérend trouverait quelque autre moyen d’exploiter l’enthousiasme public, et qu’à cet effet, une nouvelle brochure ne tarderait pas à voir le jour. On ne se trompait pas. Les photographes reçurent le prospectus d’une quatrième édition du même ouvrage, au prix de trois dollars. Ce prospectus reproduisait les articles pleins d’éloges publiés jusque-là par les différents journaux, et citait les noms de plusieurs personnes honorables qui avaient visité l’auteur, ce qui semblait placer l’invention sous leur patronage. En même temps le lecteur était informé que le meilleur moyen de prendre place dans les souvenirs de M. Hill, était de lui adresser la demande d’un exemplaire au prix indiqué.
Cette quatrième publication parut au mois de mai, avec les fleurs et les beaux jours. Comme la précédente, elle procura un bénéfice considérable à son heureux auteur.
Mais les plus belles choses ont leur terme en ce monde, et, si bien ourdie qu’elle fût, cette mystification ne pouvait pas toujours durer. Elle se termina par la circonstance même qui l’avait produite ; née de l’intérêt particulier, elle s’évanouit par la résistance des intérêts qu’elle menaçait. Les fabuleuses annonces de M. Hill portaient un immense préjudice aux photographes de New-York et des États environnants. Partout leurs travaux étaient suspendus : chacun voulait attendre la mise en pratique du nouveau système, et traitait fort cavalièrement les anciens procédés. L’inventeur se trouva donc assailli de réclamations, et sommé, sous toutes les formes, de s’expliquer, sans plus de détours, sur la réalité de sa découverte.
Le directeur du Photographic Journal, qui avait plus particulièrement prôné et patronné M. Hill, fatigué de ses réponses évasives, voulut le mettre en demeure de s’expliquer d’une manière catégorique. Il lui proposa donc de désigner dix à douze photographes auxquels il se contenterait de montrer ses épreuves, avec toutes les précautions qu’il jugerait nécessaires, et en exigeant d’eux toutes les garanties de discrétion qu’il pourrait imaginer. Cette proposition si modérée, puisque tout se bornait à constater le fait de sa découverte, M. Hill la rejeta, sous ce prétexte qu’il avait juré de ne montrer ses spécimens à personne, de peur que la vue d’une seule épreuve ne fit découvrir son procédé.
Comme l’inventeur ne paraissait arrêté que par la crainte de perdre le bénéfice qu’il attendait de ses travaux, un praticien de New-York résolut de lui enlever ce dernier genre de scrupules. Le Photographic Journal publia une lettre d’un photographe, M. Anthony, qui proposait d’ouvrir, dans toutes les villes des États-Unis, une souscription, dont le chiffre serait fixé par M. Hill même. Une fois ce chiffre atteint, la somme demandée par l’inventeur lui serait remise, après constatation, par un jury compétent, de la réalité de sa découverte. En acceptant cette proposition, M. Hill pouvait tout à la fois s’assurer une grande fortune et contribuer au progrès de son art. Or, il la déclina catégoriquement.
À dater de ce jour, les photographes des États-Unis se sont tenus pour rassurés, et, s’applaudissant d’avoir échappé au danger qui avait paru un moment menacer leur industrie, ils ont repris le chemin de leurs ateliers, en répétant entre eux le titre de la pièce de Shakespeare : Much ado about nothing (Beaucoup de bruit pour rien).
CHAPITRE X
Le lecteur a été suffisamment initié, par ce qui précède, à l’historique et aux principes généraux de la photographie. Il nous reste à décrire les moyens qui sont suivis aujourd’hui pour obtenir les épreuves.
Nous parlerons d’abord des opérations à exécuter, ensuite des appareils optiques qui sont employés en photographie.
Nous avons dit, plusieurs fois, que les sels d’argent, naturellement incolores, particulièrement le bromure, le chlorure et l’iodure d’argent, étant exposés à l’action de la lumière solaire ou de la lumière diffuse, noircissent, par suite d’une modification chimique ou physique provoquée dans leur substance, par la lumière. D’après cela, si l’on place au foyer d’une chambre noire, une surface imprégnée d’iodure d’argent, une feuille de papier, par exemple, l’image formée par l’objectif s’imprimera sur le papier, parce que les parties éclairées noirciront, et noirciront d’autant plus qu’elles recevront plus de lumière, tandis que les parties obscures, soustraites à l’influence lumineuse, laisseront au reste du papier sa blancheur.
L’empreinte, ainsi obtenue, n’est que très-peu visible au moment où l’on retire la feuille de papier de la chambre obscure. On la fait apparaître à l’aide de certains agents chimiques, qu’on nomme, pour cette raison, révélateurs : tels sont l’acide gallique, l’acide pyrogallique et le sulfate de fer.
Une pareille image ne pourrait être conservée en plein jour, car le papier est encore imprégné d’iodure d’argent non décomposé, qui noircirait à la lumière. Il faut donc le débarrasser de ce sel d’argent. On y parvient en plongeant l’épreuve dans une dissolution d’hyposulfite de soude ou de cyanure de potassium ; le sel d’argent non impressionné par la lumière est dès lors enlevé. Cette opération s’appelle fixage.
On obtient ainsi une espèce de silhouette (fig. 28) dans laquelle les parties éclairées du modèle sont représentées par une teinte noire, et les ombres par des blancs ; c’est ce que l’on nomme une image négative.

Maintenant, si l’on place cette image négative sur une feuille de papier imprégnée de chlorure d’argent, et que l’on expose le tout à l’action du soleil, ou de la lumière diffuse, l’épreuve négative laissera passer le jour à travers les parties transparentes du dessin, et lui fermera passage dans les portions opaques. Les rayons lumineux allant ainsi agir sur le papier sensible, placé au contact de l’épreuve négative, donneront naissance à une image sur laquelle les clairs et les ombres seront placés dès lors dans leur situation naturelle. On aura formé ainsi une image directe ou positive (fig. 29). Bien entendu qu’il faut fixer cette image définitive, comme on l’a fait pour le cliché négatif, à l’aide des agents fixateurs déjà employés pour l’image négative.

Les procédés qui servent à obtenir les épreuves positives, sont très-nombreux. On peut les diviser en quatre groupes principaux : Procédé au collodion humide, — procédé au collodion sec, — procédé à l’albumine, — procédé au papier sec ou humide.
Procédé au collodion humide. — Nous décrirons d’abord le procédé au collodion humide, qui est le plus généralement employé, tant à cause de la sensibilité des agents employés que de la simplicité des opérations.
Le collodion est le produit de la dissolution de coton-poudre dans un mélange d’alcool et d’éther. En s’évaporant, cette dissolution laisse un enduit visqueux, qui se forme en quelques minutes. Cette pellicule organique se prête merveilleusement aux opérations photographiques. Elle s’imprègne très-bien des sels d’argent ; et quand elle est mélangée d’un de ces sels, elle s’impressionne au contact des rayons lumineux avec une rapidité étonnante.
Le collodion est, disons-nous, le résultat de la dissolution du coton-poudre dans un mélange d’alcool et d’éther. Pour le préparer, on prend deux tiers en volume d’éther sulfurique et un tiers d’alcool, tous deux parfaitement purs. Il ne serait pas indifférent de changer ces proportions. Si l’éther est en excès, la fluidité augmente ; si, au contraire, c’est l’alcool qui prédomine, la viscosité est plus grande. Ce dernier cas serait d’ailleurs préférable, car l’éther, étant en plus grande quantité et s’évaporant plus rapidement que l’alcool, produirait des raies sur la plaque, par la dessiccation irrégulière du collodion. On prend 1 gramme de coton-poudre pour 100 centimètres cubes du mélange spiritueux.
Il s’agit maintenant d’introduire dans le collodion ainsi formé, les iodures et les bromures, destinés à fournir plus tard, par voie de double décomposition, des iodures et des bromures d’argent, à l’aide de l’azotate d’argent qui sera déposé à sa surface, comme nous le dirons bientôt.
Les iodures de potassium, d’ammonium et de cadmium, sont généralement préférés. On pourrait, au point de vue théorique, prendre des iodures et des bromures solubles quelconques ; mais les iodures de potassium, d’ammonium et de cadmium, offrent de nombreux avantages. Si l’on employait l’iodure de potassium seul, ce sel étant très-peu soluble dans l’alcool, le collodion en contiendrait peu, et de plus, on ne pourrait y ajouter de l’eau sans altérer le liquide. Quant à l’iodure d’ammonium, pris en grande quantité, il provoque la coloration en rouge et la décomposition du collodion. L’iodure de cadmium ne présente aucun de ces inconvénients, il donne seulement un collodion un peu moins fluide.
L’expérience indique que le meilleur collodion ioduré s’obtient en faisant un mélange de trois quarts d’iodures de potassium, d’ammonium et de cadmium, avec un quart de bromure de potassium. On ajoute ce dernier sel parce que le bromure d’argent qu’il fournit est mieux impressionné par certaines couleurs. On prend pour 100 centimètres cubes de collodion, 1gr,25 de ce mélange de sels composé comme il vient d’être dit.
Le collodion s’altère avec le temps : il rougit ou se décolore. La coloration en rouge est due à une certaine quantité d’iode mis en liberté par l’acide qui peut exister dans le coton-poudre employé, ou à certaines réactions qui se produisent entre ces corps ; mais on peut y remédier facilement. Il suffit de plonger dans le collodion ainsi altéré, des lames de zinc ou de cadmium, qui en se combinant avec l’iode libre, ramènent le liquide à son état normal.
Quant à la décoloration, sans en bien connaître la cause, on a trouvé le moyen de la faire disparaître : il suffit d’ajouter au liquide quelques cristaux d’iode et une nouvelle quantité de coton-poudre.
Le collodion ainsi préparé contient toujours quelques traces de matières solides ; il est donc nécessaire de le filtrer. Seulement, il faut, pendant la filtration, couvrir l’entonnoir avec une plaque de verre. Si la filtration s’effectuait à l’air libre, l’éther et l’alcool, en se volatilisant partiellement, changeraient la composition et les propriétés du mélange.
Le collodion préparé et filtré, doit être renfermé, en raison de la volatilité des liquides spiritueux qu’il renferme, dans des flacons bouchés avec soin.
Pour étendre le collodion et préparer le cliché négatif, on prend une lame de verre ou de glace. La glace est préférable, parce que sa surface est exempte d’aspérités et parfaitement plane, condition qui n’est pas toujours remplie par les lames de verre.
La plaque étant choisie, il faut la nettoyer. Si elle n’a pas encore servi, elle est recouverte de matières organiques, dont on la débarrasse en la lavant avec une dissolution concentrée de carbonate de potasse. Si elle a déjà servi, on enlève le vieux collodion dont elle est encore recouverte, puis on la lave avec de l’acide azotique.


Toutes ces manipulations se font dans des cuvettes de gutta-percha, de porcelaine ou de verre, à recouvrement (fig. 30) ou plates (fig. 31).
Quand le nettoyage de la plaque est terminé, on procède à son polissage. Cette opération se fait à l’aide d’une planchette de forme particulière, sur laquelle on assujettit fortement la glace. On voit cet appareil représenté ici (fig. 32). Sur la planche AB, plate et munie d’un manche, on place la glace ab, que l’on maintient fixe contre le rebord B, au moyen d’un arrêt mobile e. Cet arrêt e peut glisser dans la coulisse cd. Quand il touche la plaque, on le fixe à l’aide de la vis de fer f, qui est placée derrière la planchette, et que nous représentons à part.
La glace étant ainsi assujettie, on la frotte avec un tampon de papier de soie, enduit d’une pâte, composée de terre pourrie, imbibée d’alcool et d’ammoniaque.

Lorsque la plaque est suffisamment polie, on la détache de la planchette, pour la placer sur des feuilles de papier ; puis on l’essuie parfaitement avec un linge sec, ou une peau de daim. On reconnaît qu’elle est bien nettoyée, lorsqu’en y projetant l’haleine, la vapeur aqueuse se condense uniformément à sa surface, sans laisser à découvert ni points ni lignes.
Les glaces ainsi polies, sont conservées à l’abri de l’air et de la poussière dans des boîtes à rainures, en zinc ou en fer-blanc (fig. 33).

L’application du collodion sur la glace est une opération délicate, qui exige quelque habileté de la part de l’opérateur. Voici comment on l’effectue. On place la glace horizontalement, sur un tampon d’étoffe, ou sur une ventouse en caoutchouc ; ou bien, on la tient dans une main, puis de l’autre main, on verse le collodion dans un coin de la glace comme le représente la figure 34. En inclinant légèrement cette dernière, on fait descendre le collodion vers la partie inférieure de la plaque, de façon à la recouvrir entièrement. Il faut éviter les temps d’arrêt, car, si petits qu’ils soient, ils suffisent pour produire à la surface de la couche de collodion, des stries qui seraient nuisibles à la pureté du cliché.

La glace étant entièrement recouverte de liquide, on reçoit l’excédant dans un flacon, en le faisant écouler par l’angle opposé à celui sur lequel on l’a versé (fig. 35). Puis, en agitant légèrement, on favorise l’évaporation du liquide spiritueux. La glace reste recouverte d’une couche bien égale de collodion et prend une apparence terne et mate.

Il s’agit maintenant de rendre cette couche de collodion qui recouvre la plaque, impressionnable à la lumière, en d’autres termes de la sensibiliser. Le collodion est déjà imprégné, comme nous l’avons dit, d’un mélange d’iodures alcalins ; il faut maintenant la plonger dans la dissolution d’un sel d’argent, qui puisse transformer l’iodure, que renferme le collodion, en iodure d’argent.
On forme donc un bain, en dissolvant de 5 à 10 grammes d’azotate d’argent dans 100 grammes d’eau distillée.
Il est essentiel de prendre pour dissoudre le sel d’argent, de l’eau parfaitement pure, car l’eau ordinaire contient des carbonates et des chlorures alcalins, qui précipiteraient l’argent de ses combinaisons. Ce qui importe surtout, c’est que l’eau ne renferme pas de matières organiques, qui se combinent très-facilement avec l’azotate d’argent, et donnent des produits insolubles dans l’eau.
On a remarqué depuis longtemps, qu’un bain un peu acide donne plus de netteté aux épreuves, parce qu’il ralentit leur production. L’azotate d’argent cristallisé a, par lui-même, une réaction acide qui serait favorable à l’opération. Cependant les photographes n’emploient pas ce sel cristallisé, à cause des matières organiques qu’il renferme presque toujours. On emploie l’azotate d’argent fondu. Seulement, comme ce sel subit, par la fusion, un commencement de décomposition chimique, et qu’il devient ainsi alcalin, il faut ajouter à la dissolution d’azotate d’argent fondu quelques gouttes d’acide azotique ou acétique, qui lui donnent une réaction légèrement acide. La neutralité parfaite du bain serait certainement la condition la plus favorable ; mais comme il serait impossible, dans la pratique, d’arriver à cette parfaite neutralité chimique, on donne au bain une réaction un peu acide, comme il vient d’être dit.
La dissolution aqueuse d’azotate d’argent a la propriété de dissoudre l’iodure d’argent ; de sorte que si l’on plongeait la glace collodionnée dans un tel bain, l’iodure d’argent, au fur et à mesure de sa formation, au lieu de rester sur la plaque, mêlé au collodion, se dissoudrait dans le liquide. Il faut donc avoir soin de saturer à l’avance, le bain d’azotate d’argent avec de l’iodure d’argent. Pour cela, on ajoute au bain quelques centimètres cubes du collodion qui a servi à sensibiliser la plaque, et qui renferme, comme on le sait, un iodure soluble. Il se forme de l’iodure d’argent qui se dissout dans l’azotate d’argent en excès, à mesure qu’il se forme et sature le bain de ce composé, de telle manière qu’il ne pourra plus en dissoudre d’autre. Il ne reste plus qu’à filtrer, pour pouvoir employer le bain.
Avec le temps et l’usage, le bain d’azotate d’argent peut s’altérer. En effet, si ce bain n’a pas été entièrement saturé d’iodure d’argent, il se charge d’une nouvelle quantité de ce sel, en même temps que d’alcool et d’éther provenant de glaces collodionnées, et de poussières organiques qui tombent de l’atmosphère. De plus, le collodion employé peut contenir de l’ammoniaque ou, de l’iode, ce qui rend le bain, alcalin dans le premier cas, acide dans le second. On remédiera à cet inconvénient, en ajoutant au bain usé, quelques gouttes d’acide azotique, si le bain est alcalin, et s’il est acide, un peu d’ammoniaque ou d’acétate d’ammoniaque.

Pour sensibiliser la plaque collodionnée, on la plonge dans le bain d’azotate d’argent. Il faut avoir soin de la recouvrir entièrement de liquide. Pour cela (fig. 36), on appuie l’un des bords de la plaque contre un des coins de la cuvette pleine de liquide ; de la main gauche A, on soulève cette cuvette du côté opposé, pour faire descendre le liquide de ce côté ; puis de la main droite B, et à l’aide d’un crochet d’argent, on plonge la glace i, sur le fond de la cuvette ; enfin, on ramène brusquement cette dernière dans la position horizontale, et le liquide se répand ainsi uniformément à la surface de la plaque.
On fait quelquefois usage d’un double crochet en baleine (fig. 37) entre les extrémités duquel on place la glace, la couche collodionnée en dessus. On plonge alors la plaque d’un seul coup dans le liquide.

Il est bon de laisser la glace séjourner quelques minutes dans le bain, afin qu’elle soit mouillée en tous ses points. Lorsque ce résultat est obtenu, on peut procéder à l’exposition dans la chambre obscure.
Il faut empêcher que la glace sensibilisée ne subisse l’influence de la lumière dans le trajet du laboratoire à l’atelier de pose, ainsi que dans la chambre noire, tant que le sujet à reproduire n’est pas disposé pour cette opération. On se sert, dans ce but, d’un appareil qui porte le nom de châssis à épreuves (fig. 38).

C’est une boîte plate en bois, dont les deux fonds sont mobiles ; l’un b s’ouvre comme une porte, l’autre a (c’est celui qui se trouve sur le côté sensible de la glace collodionnée), glisse entre deux rainures et peut être tiré de bas en haut, de façon à découvrir, quand on le veut, entièrement la glace.
La glace (fig. 39), au sortir du bain d’argent, est donc placée dans ce châssis, que l’opérateur tient fermé. Puis il emporte le tout dans la chambre noire. Au moment voulu, il tire, de bas en haut, le couvercle a du châssis (fig. 38), et l’image de l’objet à reproduire vient impressionner le côté sensible de la glace.

Après cette exposition on la rapporte dans le laboratoire, où l’on s’occupe de développer l’image à l’abri de la lumière. En effet, l’image produite par la lumière, n’est pas encore visible au sortir de la chambre noire, il faut la faire apparaître à l’aide d’un bain révélateur, dont nous allons maintenant décrire la préparation.
Il existe un grand nombre de matières susceptibles de développer les images. Nous citerons, entre autres, l’acide gallique et l’acide pyrogallique, le sulfate de protoxyde de fer, le sulfate double de fer et d’ammoniaque.
Le révélateur le plus employé aujourd’hui, est le sulfate de fer en dissolution dans l’eau acidulée par l’acide acétique. L’addition de cet acide a pour but de ralentir le développement, et de donner par là une plus grande intensité aux teintes noires du cliché. Si le sulfate de fer était employé seul et en dissolution saturée, l’image apparaîtrait immédiatement ; mais les parties foncées seraient dénuées de vigueur. La dissolution dont on fait usage ordinairement, est ainsi formée : dans un litre d’eau pure, on verse 100 centimètres cubes d’une dissolution aqueuse saturée de sulfate de fer, à laquelle on ajoute 20 centimètres cubes d’acide acétique et d’alcool.
L’alcool est destiné à permettre au liquide du bain de mouiller uniformément la plaque. En sortant du bain d’argent, elle est encore, en effet, recouverte d’une couche liquide d’éther et d’alcool, qui ne se laisserait pas mouiller par les dissolutions aqueuses.
On emploie, depuis quelque temps, de préférence au sulfate de fer simple, le sulfate double de fer et d’ammoniaque, car ce dernier sel se conserve mieux que le sulfate ordinaire, qui se décompose assez vite, en abandonnant du sesquioxyde de fer insoluble. De plus, le sulfate double de fer et d’ammoniaque, en ralentissant le développement, donne des épreuves plus vigoureuses.
L’acide acétique a été quelquefois remplacé par l’acide citrique ; seulement ce réactif donne aux clichés une teinte bleu foncé, qui, si elle n’est pas assez intense, est perméable à la lumière.
Quelques expérimentateurs ont employé, comme révélateur, l’acide pyrogallique additionné d’acide formique. Ce mélange a l’avantage d’exiger une exposition moins longue à la chambre noire ; mais d’un autre côté, il est très-difficile de se procurer l’acide formique pur. Cet inconvénient limite beaucoup l’usage de ce dernier agent révélateur.

L’opération pratique du développement de l’image par l’emploi du liquide révélateur, est fort simple. Si la glace est de dimensions assez grandes pour ne pouvoir être maniée facilement, on la plonge tout entière dans une cuve de gutta-percha contenant la dissolution (fig. 40) ; l’image apparaît alors graduellement. Si l’épreuve est de petites dimensions, on se contente de verser à sa surface la dissolution de sulfate de fer, et d’en recevoir l’excédant dans le même verre (fig. 41).

Si elle n’est pas assez vigoureuse, on la renforce en la recouvrant d’une dissolution étendue d’acide pyrogallique, puis on la soumet à un lavage parfait à l’eau.

Ce lavage s’opère à l’aide d’une pipette. La figure 42 montre comment on procède à ce lavage. Cependant le renforçage peut s’effectuer sans inconvénient après le fixage.
Après son développement, l’image doit être fixée, c’est-à-dire débarrassée de l’iodure et du bromure d’argent, qui n’ont pas été impressionnés par la lumière ; car ces sels d’argent noirciraient par l’action du jour et empêcheraient de conserver l’épreuve.
L’hyposulfite de soude et le cyanure de potassium, sont les composés employés pour le fixage. Cependant, il est prudent de s’abstenir, le plus possible, de l’emploi du cyanure de potassium, car ce sel est un des plus violents poisons que l’on connaisse. La plus légère écorchure aux mains, expose aux accidents les plus graves les opérateurs qui se servent de ce sel. D’ailleurs, le cyanure de potassium détruit facilement les demi-teintes des épreuves sur lesquelles on prolonge son action. Il faut donc lui préférer l’hyposulfite de soude, dont le seul inconvénient est d’occasionner quelquefois des taches.
Il existe un sel exempt de tous ces défauts ; c’est le sulfocyanure de potassium ou d’ammonium. Il jouit, au point de vue de la photographie, de toutes les propriétés des deux composés précédents, sans avoir les propriétés toxiques du cyanure de potassium. Le seul obstacle qui s’oppose encore à son emploi, c’est son prix trop élevé.
Le développement et le fixage doivent se faire dans l’obscurité. Comme il serait difficile de procéder à tâtons, on a d’abord toléré une bougie dans le cabinet obscur du photographe. Cependant, cet éclairage, si faible qu’il fût, avait des inconvénients, et l’on a fait l’heureuse découverte, qu’un cabinet obscur éclairé par des carreaux de couleur jaune, permet d’opérer en toute sécurité. La lumière transmise à travers les carreaux jaunes, étant absolument sans action sur les couches sensibles, permet de supprimer la bougie.
Nous représentons (fig. 43) le cabinet noir du photographe éclairé par des carreaux de vitre de couleur jaune. Afin de pouvoir augmenter ou diminuer, selon les besoins et selon l’état du temps, l’intensité de la lumière ou du jour, on place devant la fenêtre éclairée par les vitres jaunes, un châssis, que l’on peut élever ou abaisser à la distance que l’on désire, au moyen d’une corde.

Après avoir exécuté toutes les opérations qui viennent d’être décrites, on a entre les mains un cliché négatif sur verre, qui peut servir au tirage des épreuves positives. Il faut seulement avoir le soin de le recouvrir d’un vernis qui maintienne l’adhérence parfaite de la couche de collodion sur la glace.
Si le cliché ne doit pas être conservé, on se contente de le vernir avec une dissolution de gomme arabique dans l’eau. Dans le cas contraire, il faut un enduit plus résistant. On obtient ce dernier enduit en dissolvant dans de l’alcool, un mélange de gomme laque et de gomme élémi. On peut encore se servir du vernis copal du commerce, auquel on ajoute de la benzine rectifiée.
Nous n’avons rien dit jusqu’ici, du temps de la pose. Il est, en effet, très-difficile d’en fixer la durée. Cette appréciation est excessivement délicate, et ne peut se faire qu’après une longue pratique, de la part de chaque opérateur. On ne peut donner que quelques conseils généraux ; le reste dépend de l’expérience du praticien.
Le temps de la pose doit varier selon l’intensité de la lumière et surtout la température ; l’exposition est beaucoup plus courte en été qu’en hiver, et en hiver, dans un lieu chaud que dans un atelier froid.
Si le sujet à reproduire présente des couleurs rouges, qui sont, au point de vue photogénique, dépourvues d’activité, il faut augmenter la durée de la pose.
Quand le temps de pose a été trop court, les parties noires du cliché sont à peine accusées, et l’on ne distingue aucun détail dans les ombres. On reconnaît, au contraire, que la pose a été trop longue, au ton rouge et uniforme du cliché, ainsi qu’au voile gris qui le recouvre. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a aucun remède : il faut refaire un nouveau cliché négatif.
Le cliché négatif sur verre obtenu comme il vient d’être dit, sert à tirer les épreuves positives sur papier.
Les moyens qui servent à tirer les épreuves positives sur papier, sont plus simples et plus faciles à exécuter que ceux qui fournissent le cliché négatif sur verre. On tire les épreuves positives sur des feuilles de papier imprégnées de sel marin, qu’on plonge dans un bain d’azotate d’argent : il se fait, par double décomposition chimique, du chlorure d’argent impressionnable à la lumière, qui reste incorporé dans la pâte du papier, et de l’azotate de soude, qui se dissout dans le bain argentifère. En exposant à la lumière une pareille feuille recouverte d’un cliché négatif sur verre, on obtient une image positive, au bout d’un certain temps, que l’expérience apprend à déterminer.
Cette image présente généralement une belle couleur rouge, mais excessivement fugace et qui passe dans le bain de fixage. Avant cette dernière opération, on en effectue donc une autre, qu’on appelle virage, qui sert à donner à l’image positive une coloration plus riche et plus stable, et lui permet de résister aux agents fixateurs. On emploie pour ce virage une dissolution aqueuse de chlorure d’or. Il ne reste plus, après cela, qu’à fixer l’épreuve, c’est-à-dire à dissoudre le chlorure d’argent non influencé qu’elle contient encore.
Nous allons entrer dans le détail pratique des opérations successives, que nous venons d’indiquer sommairement.
Les feuilles de papier dont on se sert pour le tirage des épreuves positives, ne sont pas prises arbitrairement ; elles doivent avoir certaines qualités qu’on ne rencontre pas dans toutes les espèces de papier. Il faut que leur surface soit parfaitement unie et exempte de taches. Il ne faut pas que la pâte contienne, comme cela se rencontre parfois, des parcelles métalliques. L’encollage du papier doit être bien fait et abondant. Cette dernière condition influe beaucoup sur la vigueur et la finesse des images ; aussi est-on quelquefois obligé de faire subir un second encollage aux papiers du commerce.
On a observé que si l’on emploie pour cet encollage, la gélatine, l’image prend, après le virage, une coloration rouge-pourpre. L’encollage fait avec l’amidon, donne aux images une couleur rouge orangé, et l’encollage à l’albumine une couleur pourpre foncé.
Le papier étant choisi, on commence par l’imprégner de chlorure de sodium, en le plongeant dans une dissolution de ce sel. On prend 30 grammes de sel par litre d’eau distillée. Les feuilles doivent séjourner environ deux minutes dans ce bain ; après quoi on les laisse sécher à l’air. Les photographes se dispensent quelquefois de faire ces opérations, car on trouve dans le commerce des papiers encollés et salés, mais leur préparation est toujours moins bonne que celle qu’on fait soi-même.

Pour sensibiliser le papier, on le plonge (fig. 44) dans le bain d’argent, qu’on prépare en dissolvant 200 grammes d’azotate d’argent dans un litre d’eau distillée. Comme la quantité de sel d’argent diminue très-rapidement par l’emploi du bain, on est bientôt obligé d’en ajouter une nouvelle dose.
Lorsque la feuille ainsi imprégnée de chlorure d’argent, est sèche, on la recouvre du cliché à reproduire, et on la place dans le châssis à reproduction à fond de verre. Cet appareil peut affecter différentes formes. La figure 45 représente celui qui est le plus généralement employé. C’est un cadre de bois au fond duquel est placée une glace. Sur cette glace, on pose le cliché de verre, par sa face non couverte de collodion, puis on met le papier sensibilisé.

Il est nécessaire de pouvoir juger, à chaque instant, de la formation de l’image, afin de pouvoir arrêter l’exposition à la lumière au moment convenable. Pour cela, le fond du châssis, comme le montre la figure 45, est formé de deux parties, reliées entre elles par une charnière. De cette manière, tandis que l’une de ces moitiés est comprimée par une pointe ou une vis en bois, et maintient ainsi la feuille de papier dans une position fixe, on peut ouvrir l’autre moitié, et aller observer la venue de l’image dans une chambre à l’abri de la lumière.

La figure 46 représente un modèle de châssis employé en Angleterre et très-recommandé par M. Monckhoven[30]. Un cadre, ABCD, garni, au fond, de sa glace, est recouvert d’une planchette EE, divisée, par deux charnières, en deux portions que viennent presser deux ressorts o, o. La planchette repose sur le papier posé contre le cliché, et le cliché sur la glace du cadre. Le tout est maintenu et pressé par deux fermoirs de bois R, R, que l’on fait entrer dans les échancrures de deux pièces de bois S, S, portées sur le cadre ABCD.
Le châssis contenant le négatif et le papier sensibilisé, est exposé à la lumière diffuse ou à la lumière du soleil. Quand on a un grand nombre d’épreuves à tirer, on place les châssis à reproduction sur un portant mobile (fig. 47) qui a l’avantage de faire arriver la lumière selon l’inclinaison que l’on désire, sur un grand nombre de châssis à la fois.

La durée de l’exposition pour le tirage des positifs, varie, non-seulement avec la coloration qu’on veut obtenir, mais encore avec l’intensité de la lumière ambiante. Ainsi, une image qui, par un jour de soleil, peut venir en dix minutes, mettra, au contraire, un jour entier à se produire, si le temps est couvert. Nous avons déjà vu que plus l’épreuve se développe lentement, plus il y a d’opposition entre les blancs et les noirs. Si donc on veut qu’il en soit ainsi, on exposera le châssis à la lumière diffuse. Dans le cas contraire, on opérera au soleil, dont les rayons pénétrants agissent avec rapidité.
La couleur de l’image commence par être bleu très-pâle ; puis la teinte augmente d’intensité, en passant successivement par toutes les nuances intermédiaires, telles que bleu pourpre, pourpre foncé, noir, jusqu’à ce qu’elle atteigne finalement une couleur olive.
Il est bon que la teinte du cliché soit un peu exagérée, c’est-à-dire qu’il ait une coloration très-intense, car le fixage en atténue beaucoup la vigueur.
Lorsqu’il s’agit de portraits, on peut former, à volonté, autour de l’image, un fond blanc, noir ou dégradé.
Pour obtenir un fond blanc, on recouvre le châssis d’un verre jaune à fond blanc ; pour le fond noir, c’est le contraire : le verre est blanc à fond jaune. Quant aux fonds dégradés, on les obtient à l’aide de verres jaunes à teinte dégradée qui produisent autour du portrait une espèce d’auréole d’un effet agréable à l’œil.
Au sortir du châssis à reproduction l’épreuve positive possède, ainsi que nous l’avons dit, une couleur purpurine très-peu stable, qui devient jaune orangé dans le bain de fixage. Avant donc de la fixer on la fait virer dans un bain formé d’un gramme de chlorure double d’or et de potassium dissous dans un litre d’eau. On ajoute quelquefois au sel d’or, un peu de carbonate de chaux pulvérisé, afin de neutraliser l’acide libre. Quelques praticiens remplacent le carbonate de chaux par de l’acétate de soude, par le phosphate ou le borate de la même base ; mais ce ne sont là que des modifications de peu d’importance.
On doit rejeter tous les procédés de virage se produisant par sulfuration de l’argent : tels sont les procédés de virage au sulfure de potassium, à l’hyposulfite de soude acidulé, ou mélangé de sel de fer. Dans tous ces cas, la présence du soufre est nuisible à l’épreuve, qui ne tarderait pas à s’altérer complétement.
On laisse l’image atteindre la couleur bleue, en ayant bien soin de ne pas la toucher avec les doigts, car tous les points qui ont subi le contact des doigts, ne sont plus mouillés par les liquides, probablement par suite d’un dépôt de matières grasses.
On soumet ensuite les épreuves à un lavage prolongé dans l’eau pure, et l’on procède au fixage. Il est essentiel que le lavage soit bien complet, car s’il restait dans le papier des traces de sel d’argent, la dissolution d’or en serait altérée. Il en est de même lorsque l’épreuve est soumise au virage étant encore imprégnée d’un peu de sel d’argent.
On fixe l’épreuve positive comme l’épreuve négative, c’est-à-dire avec une dissolution d’hyposulfite de soude ou de cyanure de potassium. Pour les raisons que nous avons données précédemment, il vaut mieux se servir de sulfocyanure de potassium ou d’ammonium, que de cyanure simple.
On peut encore employer pour le fixage, l’ammoniaque, étendue de 3 fois son volume d’eau. Seulement, dans ce cas, le fixage doit précéder le virage. Cette dernière opération se fait alors à l’aide d’une dissolution de cyanure de potassium à laquelle on ajoute une petite quantité d’iode.
L’action de ce dernier bain de virage ne doit pas être prolongée, car l’épreuve est rongée de plus en plus, et disparaît bientôt entièrement.
Quel que soit le procédé suivi pour fixer les épreuves, ces dernières doivent être soumises à un lavage prolongé, sous l’action d’un courant d’eau continu. Après quoi, on les laisse sécher à l’air.
Il n’y a plus qu’à coller ces épreuves sur des feuilles de carton.
Seulement, comme il existe toujours à la surface de l’épreuve des inégalités, dues soit à son encollage, soit à la pâte du papier, il est bon de faire disparaître ces reliefs, à l’aide de la presse à satiner.

La figure 48 représente la presse à satiner employée par les photographes. Une plaque d’acier poli, ou une pierre lithographique AB, bien plane, reçoit un mouvement horizontal de va-et-vient, au moyen d’une roue à manivelle CD. Sur cette plaque d’acier, on place des feuilles de carton bien unies, entre lesquelles, on dispose les épreuves à satiner. La seconde partie de l’appareil est un rouleau d’acier EF, qui peut monter et descendre dans une rainure, quand il est pressé par les vis G, G, que l’on met en action en tournant les manivelles H, H.
Pour satiner les épreuves, on serre les vis G, G au moyen des manivelles H, H, le rouleau EF presse la plaque d’acier, et quand on fait passer les épreuves entourées de carton sur ce rouleau, au moyen de la manivelle CD, on les soumet à une pression considérable, qui détruit le relief, les inégalités du papier, et produit, en un mot, l’effet connu sous le nom de satinage.

Nous représentons (fig. 49) un autre modèle de presse à satiner les épreuves photographiques. Ce modèle, construit par M. Arthur Chevalier, fonctionne à peu près comme celui dont nous venons de donner la description.
On a aussi l’habitude, pour ajouter à l’effet du satinage, de vernir les épreuves sur papier, avec une couche de vernis, composé d’essence de térébenthine, de cire rouge et de mastic. Les épreuves acquièrent ainsi une surface luisante, qui donne des jeux de lumière agréables, et fait ressortir les images, en leur donnant des tons changeants.
On reconnaît quelquefois que les épreuves positives présentent certains défauts, qui tiennent au négatif lui-même. Il n’y a alors d’autre remède que de retoucher le cliché négatif. Nous terminerons ce chapitre en donnant la description de l’appareil dont se servent les photographes pour effectuer ces retouches.
L’appareil à retouches (fig. 50) est une sorte de table sans couvercle. Ce couvercle est remplacé par une plaque de verre inclinée ABCD. Au-dessous, se trouve un châssis E, garni d’une toile blanche, et ayant, en sens inverse une inclinaison qu’on peut faire varier à volonté, au moyen d’une tige F, garnie de crans. Cette surface blanche sert à renvoyer la lumière sur le cliché négatif de verre, de façon à l’éclairer vivement et à en bien reconnaître les défauts. Pour écarter la lumière diffuse ambiante, on s’entoure d’un rideau noir. Les retouches se font avec un pinceau très-délicat et de l’encre de Chine, mêlée de bleu de Prusse.

CHAPITRE XI
Procédé au collodion sec. — Le procédé au collodion humide, qui est universellement suivi et que nous venons de décrire dans tous ses détails, exige que la plaque de verre recouverte de la couche de collodion sensibilisé, soit presque aussitôt portée dans la chambre obscure. Il arrive, en effet, que l’azotate d’argent qui demeure en excès, mélangé au collodion, finit par se combiner avec l’iodure d’argent, et forme un sel double qui cristallise sur toute la surface de la glace. En développant ensuite l’image formée sur une pareille glace, on obtiendrait des taches blanches, sur tous les points où la cristallisation s’est effectuée. Telle est du moins l’explication théorique donnée par MM. Barreswill et Davanne, dans leur excellent ouvrage, Chimie photographique[31].
Quelle qu’en soit la cause, il est certain que la glace collodionnée et sensibilisée, doit être portée sans aucun retard dans la chambre obscure. Si on la laisse sécher, elle n’est plus impressionnable, ou ne l’est que très-imparfaitement. Il faudrait, en effet, avec une glace sèche une exposition très-longue à la chambre noire, encore n’obtiendrait-on que des images dénuées de vigueur, et présentant une coloration grise uniforme et désagréable à l’œil.
L’obligation de ne laisser aucun intervalle entre la préparation de la couche sensible, et l’exposition dans la chambre obscure, rend le procédé au collodion humide inapplicable dans certains cas, et particulièrement pour les voyageurs, qui, ne pouvant effectuer en plein air toutes les opérations photographiques, doivent se borner à recevoir à l’extérieur l’impression du paysage ou du monument, et terminer l’opération dans leur laboratoire.
Il était donc à désirer que l’on pût modifier le procédé qui vient d’être décrit, de manière à conserver assez longtemps à la glace collodionnée son impressionnabilité à la lumière. Le collodion est, en effet, la seule matière qui réponde à toutes les exigences des opérations photographiques, à savoir : une rapidité prodigieuse pour l’exposition dans la chambre obscure, une extrême simplicité dans les opérations, et une grande finesse dans les épreuves obtenues.
Les expérimentateurs ont donc cherché à obtenir des plaques qui fussent sensibles quoique sèches, et par suite, susceptibles d’être transportées et utilisées à un moment quelconque. De nombreuses tentatives ont été faites dans ce sens. Elles demeurèrent assez longtemps infructueuses, mais on a fini, par trouver un procédé au collodion sec assez avantageux, pour qu’on puisse l’employer avec confiance et obtenir de bons résultats.
Pourquoi la glace collodionnée perd-elle par la dessiccation son impressionnabilité ? Nous avons donné plus haut une explication chimique du fait ; voici une autre explication physique du même phénomène qui a été présentée, et qui a eu l’avantage de conduire à la découverte du procédé cherché.
Quand la couche sensible, formée de collodion mêlé d’iodure d’argent, se dessèche, les molécules du collodion se rapprochent, et emprisonnent, pour ainsi dire, l’iodure d’argent. Dès lors, les réactifs dont l’intervention est nécessaire, n’agissent plus, ou du moins n’agissent que très-imparfaitement sur le sel d’argent ; ce qui explique pourquoi on n’obtient, dans ce cas, aucun résultat satisfaisant.
Le problème à résoudre était donc celui-ci : ajouter au collodion une substance qui, s’interposant entre ses molécules, quand il se dessèche, le laissât dans un état spongieux capable de le rendre perméable aux agents chimiques.
En partant de ce principe, on a ajouté d’abord, au collodion, des matières ne pouvant ni sécher, ni cristalliser, telles que l’azotate de magnésie, qui est un sel déliquescent, le miel en dissolution dans l’eau, la glycérine, la gélatine, la dextrine, etc. Ces modifications, proposées par MM. Spiller et Crookes, Shadbolt, Ziégler, Norris et Maxwell Lyte, ne donnaient pas encore le procédé cherché, car elles avaient pour résultat d’entretenir la couche de collodion dans un état constant d’humidité, qui provoquait sa décomposition. Le problème ne fut résolu que du jour où l’on eut l’idée d’introduire dans le collodion des matières résineuses.
MM. Duboscq et Robiquet ont proposé, comme propres à remplir cette condition, l’ambre jaune ; M. l’abbé Despretz, la résine ordinaire. Le procédé aujourd’hui le plus généralement pratiqué, est celui qui a été indiqué par Taupenot.
Ce physicien eut l’idée d’introduire de l’albumine dans le collodion. Le liquide ainsi obtenu, étendu sur une glace, donne une pellicule qu’on laisse sécher, et qui peut servir à un moment quelconque, en ayant soin de la sensibiliser, quelques instants avant de l’exposer dans la chambre obscure.
Le procédé au collodion sec diffère peu, dans la pratique, du procédé au collodion humide ; aussi n’insisterons-nous que sur les parties de l’opération réellement distinctes de celles que nous avons décrites en parlant du premier de ces procédés.
Le nettoyage de la glace est, dans ce cas particulier, extrêmement important, car il exerce une très-grande influence sur les résultats. Si ce nettoyage est défectueux, il se produit dans la couche sensible, des reliefs qui en altèrent la forme, et nuisent à la production de l’image. On procède au nettoyage et au polissage de la plaque, comme nous l’avons déjà dit, à propos du collodion humide, en apportant, toutefois, le soin le plus scrupuleux à ces deux opérations.
On étend ensuite le collodion ioduré. C’est ici que se place une précaution toute particulière pour l’application de l’albumine. On place dans un vase, un certain nombre de blancs d’œufs, auxquels on ajoute de l’iodure et du bromure d’ammonium, de l’ammoniaque et du sucre candi. Ce dernier corps est employé pour rendre le liquide plus fluide et faciliter son extension sur la plaque. On bat le mélange, jusqu’à ce qu’on l’ait transformé en une mousse épaisse. Cette mousse, abandonnée à elle-même pendant un jour, se réduit en un liquide filant, qu’on décante, et qui est alors prêt à servir. On l’étend sur la glace, comme on l’a fait pour le collodion, et on fait sécher dans une pièce à l’abri de l’humidité.
Le bain d’argent est toujours formé par la dissolution d’azotate d’argent, additionnée de quelques gouttes d’acide acétique. Dans l’immersion de la glace, on évite le moindre temps d’arrêt, dont le résultat serait la production de stries à la surface de l’albumine.
Le développement de l’image, après sa production dans la chambre noire, se fait dans un bain formé d’eau, d’acides gallique, pyrogallique et acétique, le tout additionné d’alcool. Quant au fixage, il se fait à l’hyposulfite de soude.
Les clichés qu’on obtient ainsi, servent à donner des épreuves positives sur papier, par le procédé habituel que nous avons déjà décrit.
Le major Russell a obtenu d’excellents résultats en remplaçant l’albumine par une dissolution aqueuse de tannin.
Le procédé au collodion sec est plus lent, il est vrai, que le procédé au collodion humide ; mais il est beaucoup plus rapide que les autres procédés à l’albumine seule, ou au procédé sur papier sec, qu’il nous reste à décrire. Il rend les plus grands services au paysagiste, au photographe voyageur, en permettant de fixer rapidement, et d’une manière définitive, les vues les plus diverses et les effets les plus variés. C’est, du reste, la seule application que l’on fasse aujourd’hui du procédé au collodion sec.
Procédé à l’albumine. — Dans l’exposé que nous faisons des différents procédés photographiques, nous ne suivons pas l’ordre historique de leur découverte. Nous avons déjà parlé des plus récents, parce que ce sont les plus employés aujourd’hui : il nous reste, en traitant du procédé à l’albumine, ainsi que du procédé au papier ciré ou albuminé, à passer en revue quelques procédés particuliers qui présentent de l’intérêt plutôt comme recherches scientifiques que comme méthodes opératoires.
Les photographes avaient, depuis longtemps, été frappés des propriétés remarquables de l’albumine. Cette matière, étendue en couche mince, sur une glace, donne, en se desséchant, une pellicule insoluble dans l’eau, mais qui se laisse pénétrer par tous les réactifs usités en photographie. M. Niépce de Saint-Victor, comme nous l’avons dit dans la partie historique de ce travail, a donné le premier le procédé à suivre pour obtenir de bonnes épreuves sur une lame de verre recouverte d’albumine. Ce procédé fut suivi jusqu’au jour où le collodion fut découvert. C’est ce même procédé, c’est-à-dire le procédé à l’albumine, sur lequel nous avons maintenant à revenir, et que nous allons décrire.
Pour préparer l’albumine destinée à être étendue en couche mince sur la lame de verre, on prend des blancs d’œufs, et on y ajoute de l’iodure de potassium ; puis on bat ce mélange, jusqu’à ce qu’on l’ait entièrement transformé en mousse épaisse. Cette mousse, abandonnée à elle-même pendant vingt-quatre heures, se réduit en un liquide qu’on peut employer après l’avoir décanté.
Avant d’étendre l’albumine sur la glace, il faut nettoyer cette dernière avec le plus grand soin, pour les raisons que nous avons données en parlant du procédé au collodion sec.
L’application de l’albumine est une opération délicate, qui exige quelque attention de la part de l’opérateur. Voici comment on y procède. On place la glace sur une table ; puis, avec une pipette pleine d’albumine, on va d’un bord à l’autre en laissant écouler le liquide successivement, et en ne mettant aucun intervalle entre deux traînées d’albumine. On avance peu à peu, et bientôt la glace est entièrement recouverte.
On peut encore verser, au centre de la glace, une quantité d’albumine suffisante pour la recouvrir entièrement ; puis, avec une baguette, on l’étend dans tous les sens. L’important est que la couche d’albumine se dessèche promptement, afin qu’elle ne soit pas altérée par les poussières atmosphériques qui feraient corps avec elle.
On fait usage, pour obtenir le double résultat d’étaler bien régulièrement la couche liquide et d’activer son évaporation, de l’artifice suivant. On place la glace B (fig. 51) entre quatre crochets supportés par quatre fils de soie a, a, réunis en une torsade cb, que l’on tient à la main. En l’abandonnant, à elle-même, cette torsade de fil se détend, et imprime à la plaque B un mouvement de rotation très-rapide, qui a pour effet d’égaliser la couche liquide et de la répartir uniformément sur la glace. Si, en même temps, on approche la glace d’un fourneau A contenant quelques charbons allumés, on active son évaporation.

Les photographes qui font un grand usage du procédé à l’albumine, ont un petit appareil, qu’ils appellent tournette (fig. 52), et qui sert à étendre rapidement l’albumine en couche mince sur la glace. C’est un disque de bois, qui porte la lame de verre A, et que l’on fait tourner rapidement à l’aide d’un autre disque, B, muni d’une poignée. Un écran, C, met la couche liquide, déposée sur la plaque, à l’abri des poussières contenues dans l’appartement, et que l’opérateur pourrait diriger vers sa surface. Seulement, avec cet appareil, il faut enlever la glace quand la couche liquide est bien étalée, pour la sécher à une douce chaleur.
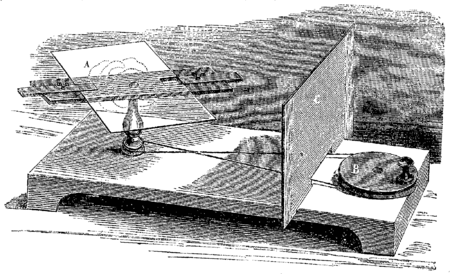
La glace étant ainsi recouverte, il faut la sensibiliser. Pour cela, on la plonge dans un bain d’acétonitrate d’argent, c’est-à-dire dans le bain d’azotate d’argent acidulé par l’acide acétique, puis on l’expose dans la chambre noire.
Le développement de l’image se fait en versant d’abord une dissolution d’acide gallique, puis une dissolution du même composé, additionnée d’azotate d’argent. Quant au fixage, il se fait à l’hyposulfite de soude.
Le cliché est alors propre au tirage des épreuves positives sur papier. Nous ne dirons rien de cette dernière opération, c’est-à-dire du tirage des positifs, que nous avons décrite plus haut (pages 88-90) et qui est toujours la même, quelle que soit la méthode dont on fasse usage.
À côté de nombreux avantages, le procédé à l’albumine présente divers inconvénients. Il est presque impossible de s’en servir pour les portraits, à cause de la longue exposition à la chambre noire qu’il nécessite. Il faut, en outre, une demi-heure pour développer l’image après sa production. Aussi la découverte du collodion a-t-elle fait généralement abandonner l’usage du procédé à l’albumine. On ne s’en sert plus aujourd’hui que pour la reproduction de dessins, de tableaux, de paysages, en un mot de tous les objets sur lesquels la durée de pose n’a pas d’influence.
L’albumine offre des qualités précieuses pour ces applications particulières de la photographie. Elle donne des images d’une finesse merveilleuse et d’un ton excessivement agréable à l’œil. De plus, on peut l’employer indifféremment à l’état humide ou à l’état sec.
Procédé au papier ciré ou albuminé. — Ce procédé a pour but de remplacer la lame de verre des épreuves négatives, par du papier, et de se servir de ce cliché de papier pour le tirage des épreuves positives, La fragilité du verre est, en effet, un grand inconvénient, et il serait important de pouvoir composer des négatifs avec une autre substance que le verre, qu’un accident ou une distraction suffit à mettre en pièces.
Le papier que l’on prend pour en faire le cliché négatif, peut être enduit de cire, — et dans ce cas l’opération se fait à sec, — ou bien il peut être recouvert de matière organique, et le procédé s’exécute alors par voie humide ; nous décrirons l’un et l’autre.
Le papier ciré pour en faire un négatif, a été employé pour la première fois par M. Legray, l’habile praticien français auquel on doit la découverte du collodion. Le papier doit être pur, ni trop épais, ni trop mince. Trop épais, il est peu transparent, et exige trop de temps pour la venue des images positives ; trop mince, il n’est pas assez résistant. On doit préférer le papier collé à la gélatine à celui qui est collé à l’amidon, car sa texture est plus uniforme.
Le rôle de la cire se comprend d’ailleurs sans peine. Ce corps gras a l’avantage de séparer les sels d’argent de la substance du papier, de donner une couche d’un poli parfait, de communiquer au cliché négatif toute la transparence du verre, enfin d’assurer la conservation du papier.
L’application de la cire se fait en chauffant au bain-marie, de la cire vierge, et immergeant le papier dans la cire fondue. Mais la cire se trouvant toujours en excès, il faut procéder à un décirage partiel. Pour cela, on interpose chaque feuille cirée entre des feuilles de papier buvard, et l’on passe un fer chaud sur le tout. Le papier en se refroidissant, conserve une surface luisante. Il faut éviter, quand on le conserve, d’y produire des cassures, qui se traduiraient par des défauts sur l’épreuve.
Après cette préparation, on plonge le papier dans une dissolution aqueuse de bromure et d’iodure de potassium. Pour que ce liquide puisse mouiller la surface cirée, on ajoute au bain ordinaire d’iodure, du petit-lait clarifié et du sucre de lait, qui, par leur viscosité, permettent l’imbibition du papier par les liquides. On peut remplacer le petit-lait par de l’eau de riz, comme le faisait M. Legray.
Quand le papier a séjourné deux heures dans ce bain, on le laisse sécher à l’air. Les feuilles de papier ont alors un aspect différent de celui qu’elles avaient avant leur immersion dans le bain d’iodure. Pénétré par le liquide ioduré, le papier ciré est devenu spongieux, grenu ; il a perdu le luisant, la fermeté et la transparence qu’il avait primitivement. Il se passe quelquefois, entre l’encollage et l’iodure de potassium, une réaction particulière, dont le résultat est la mise en liberté d’une certaine quantité d’iode, qui donne au papier une coloration caractéristique.

La sensibilisation de ce papier, c’est-à-dire la transformation de l’iodure de potassium qu’il contient, en iodure d’argent, se fait avec le bain ordinaire d’acéto-nitrate d’argent. La coloration que le papier avait prise dans le bain ioduré, disparaît dans ce second bain, après un séjour de deux minutes au plus. À ce moment, on retire, à l’aide d’une pince en corne, les feuilles, qui sont devenues très-blanches. On les laisse égoutter et on les lave ; puis on les presse entre des doubles de papier buvard, auquel elles abandonnent l’excédant du liquide dont elles sont recouvertes, et on les laisse sécher.
Ces feuilles sensibilisées peuvent être conservées huit ou dix jours avant d’être portées dans la chambre obscure.
Il est bon de développer l’image le jour même de sa production ; cependant on peut mettre un intervalle de quelques jours entre ces deux opérations.
Le bain révélateur est une dissolution d’acide gallique, additionnée de quelques gouttes d’acéto-nitrate d’argent. Si l’opération a été bien conduite, on doit voir l’image se former graduellement.
La manière dont cette image apparaît dans le bain révélateur, permet de reconnaître si la durée de la pose a été convenable. En effet, si l’exposition à la lumière a été trop longue, l’image se montre instantanément, et elle prend une coloration grise uniforme, contre laquelle il n’y a aucun remède. Si l’exposition a été trop courte, les noirs seuls apparaissent rapidement ; les demi-teintes viennent, au contraire, avec lenteur ; de sorte qu’il n’y a aucune transition entre les clairs et les ombres, qui forment, par leur contraste, un effet désagréable à l’œil.
Lorsque l’image est bien développée, on lave l’épreuve sous un courant d’eau.
Le fixage, qui se fait, comme à l’ordinaire, avec l’hyposulfite de soude, peut s’effectuer immédiatement, ou se faire au moment qu’on le veut. Cette facilité offerte aux opérateurs, est précieuse en voyage.
On a proposé de remplacer l’hyposulfite de soude, comme fixateur, par le bromure de potassium ; mais ce sel n’est pas un fixateur à la manière ordinaire : il ne dissout pas le sel d’argent non impressionné, il ne fait que le mettre momentanément dans l’impossibilité d’être influencé par la lumière.
Après le fixage, l’épreuve prend, par la dessiccation, un ton gris, qu’on fait disparaître en soumettant la face enduite de cire à l’action de la chaleur.
Les clichés négatifs ainsi préparés, doivent être conservés avec soin, afin qu’il ne se produise pas, à la surface de la couche de cire, des cassures, qui donneraient, sur l’image définitive, des raies nuisibles à la pureté et à la netteté de l’épreuve.
Avec ce cliché négatif, composé d’une simple feuille de papier, on tire les positifs à la manière ordinaire.
Quelques habiles opérateurs, parmi lesquels nous devons citer M. le comte Vigier, MM. Baldus, Roman, etc., ont modifié le procédé précédent, en supprimant le cirage du papier ; mais la méthode qu’ils emploient est très-délicate et ne peut être suivie que par des praticiens très-exercés.
Cette méthode consiste à tremper la feuille de papier dans une liqueur composée d’iodure d’argent dissous dans l’iodure de potassium. Le papier qui contient ces sels n’est pas impressionnable à la lumière, à cause de la présence de l’iodure de potassium ; mais quand on vient à plonger les feuilles qui contiennent ce mélange, dans le bain d’azotate d’argent, il ne reste plus à leur surface, que de l’iodure d’argent, et la couche est impressionnable à la lumière. Le reste de l’opération se fait comme dans le cas précédent.
Tel est le procédé du comte Vigier.
M. Roman dissout l’iodure de potassium dans de l’albumine, qui se coagule au moment de l’immersion dans l’azotate d’argent. On obtient par cette méthode, un négatif susceptible de donner des épreuves positives qui se distinguent, comme celles sur verre albuminé, par la vigueur extraordinaire, la correction du dessin et les contours admirablement arrêtés de l’image.
Les épreuves négatives sur papier, préparées par les procédés que nous venons de décrire, sont obtenues à sec, et c’est là un des grands avantages de cette méthode pour les photographes en campagne et les voyageurs. Mais on peut aussi les obtenir par voie humide. Il suffit d’exposer dans la chambre noire, les feuilles de papier immédiatement après leur sensibilisation. Le papier employé est soumis aux mêmes préparations que dans le cas précédent, sauf le cirage qui n’aurait ici aucune utilité.
C’est en faisant usage de ce procédé, c’est-à-dire du procédé sur papier sec ou humide que M. Baldus, l’un de nos photographes les plus renommés, a obtenu les admirables reproductions de paysages et de monuments que chacun a pu admirer chez les marchands d’estampes. Mais pour obtenir d’aussi remarquables résultats avec le seul emploi du papier, il faut toute l’habileté et la science qui distinguent cet opérateur.
CHAPITRE XII
Les épreuves photographiques, telles qu’on les obtient aujourd’hui, sont entachées d’un vice fondamental. Longtemps exposées à la lumière, ou mal défendues contre l’humidité, elles pâlissent, s’altèrent, et semblent menacées de disparaître entièrement. Les photographes se sont émus, à juste titre, d’un danger qui menaçait les bases mêmes de leur art, et ils ont cherché la cause de cette grave altération. On a ainsi reconnu que cette demi-disparition des images tient à ce que l’argent métallique qui les constitue, est sujet à s’altérer chimiquement au contact de l’air : le gaz hydrogène sulfuré qui existe toujours, en faible proportion, dans l’atmosphère, transforme l’argent métallique en sulfure ; lequel, par l’oxygène de l’air, passe plus tard à l’état de sulfate, et disparaît par l’action de l’humidité atmosphérique, car ce composé est soluble dans l’eau. Il faut ajouter que les sels d’argent sont d’un prix assez élevé.
Par ces diverses considérations il était essentiel de chercher à remplacer les sels d’argent, pour le tirage des épreuves positives, par des substances tout à fait inaltérables à l’air.
Il n’est guère qu’une substance vraiment inaltérable : c’est le charbon. La typographie et la gravure ne font usage que de charbon pour leurs impressions ; l’encre d’imprimerie, ainsi que l’encre des graveurs, n’est autre chose que du charbon délayé dans des corps gras ; et, comme on le sait, les livres et les gravures bravent l’injure du temps et les outrages de l’air. C’était donc au charbon qu’il fallait s’adresser pour tirer les épreuves photographiques positives. Pour assurer la durée indéfinie des épreuves, il fallait substituer aux anciens systèmes des positifs par les sels d’argent, le tirage avec une encre à base de charbon.
C’est M. V. Regnault, de l’Institut, qui signala cette voie nouvelle à la photographie : elle ne tarda pas à réaliser ce perfectionnement utile.
La méthode qui est en usage pour tirer les positifs au charbon, est une application des découvertes de M. Alphonse Poitevin. Elle repose sur le principe de l’insolubilité dans l’eau, d’un mélange de gélatine et de bichromate de potasse, quand ce mélange a été touché par la lumière.
Le procédé pratique pour le tirage des positifs au charbon, consiste à tirer l’épreuve positive sur du papier enduit, au lieu de chlorure d’argent, de gélatine et de bichromate de potasse, le cliché négatif ayant été obtenu, d’ailleurs, par un procédé quelconque. Les parties de la gélatine qui sont soumises à l’action de la lumière, sont devenues insolubles dans l’eau ; dès lors, si l’on recouvre de charbon en poudre, de noir de fumée par exemple, le papier qui vient d’être impressionné, et que l’on soumette une pareille épreuve à un lavage par l’eau, les parties solubles de la gélatine se dissoudront, entraînant avec elles les particules de charbon qui s’y étaient déposées, tandis que celles qui sont devenues insolubles resteront sur le papier, retenant le charbon qui les recouvrait. Inutile d’ajouter que l’altération que subit la gélatine est d’autant plus profonde, que la lumière l’a plus vivement frappée ; de sorte que les parties de gélatine insoluble, et par suite les parcelles de charbon qui les couvrent, dépendent de l’intensité des lumières ou des ombres, et reproduisent ainsi les nuances, les oppositions de teintes, en un mot les ombres, les clairs et les demi-teintes. Sur des épreuves positives tirées au charbon, les nuances et les dégradations sont presque aussi exquises que sur les positifs tirés au chlorure d’argent.
Le tirage des positifs au charbon est employé aujourd’hui par un certain nombre de photographes, tant à cause de l’économie de ce système, que parce qu’il assure la conservation perpétuelle des images.
On doit à MM. Garnier et Salmon un autre procédé, qui dispense également de l’emploi des sels d’argent. On forme un mélange de bichromate d’ammoniaque et de sucre. À ce mélange, préalablement dissous dans l’eau, on ajoute de l’albumine. C’est ce composé définitif qu’on étend sur le papier, et qu’on recouvre ensuite de charbon extrêmement divisé. On soumet le papier, ainsi préparé, à l’action de la lumière à travers une épreuve négative ; on obtient ainsi l’image positive, qu’il n’y a plus qu’à laver. Comme dans le cas précédent, les parties non impressionnées se dissolvent, entraînant avec elles le noir qui les recouvre. Quant aux parties influencées, elles restent, en formant l’image à l’aide du charbon dont elles sont couvertes.
MM. Garnier et Salmon ont indiqué une autre matière, le citrate de fer, pour servir à l’impression photographique. La dissolution aqueuse de ce sel est de consistance sirupeuse ; de sorte qu’une feuille de papier, qui en est enduite, s’imprègne facilement d’une matière réduite en poudre. Mais si ce sel a subi l’influence de la lumière, il fixe d’autant moins de poudre colorante qu’il a été plus vivement impressionné par l’agent lumineux. Pour obtenir une image positive sur un papier soumis à une pareille préparation, il faut donc le recouvrir d’un positif, et non d’un négatif, comme dans les autres cas.
M. Alphonse Poitevin a indiqué un second procédé de tirage des positifs sans sels d’argent. Ce procédé a pour base la modification que la lumière fait subir aux sels de fer, particulièrement au mélange de perchlorure de fer et d’acide tartrique.
À l’état ordinaire, la dissolution de ce mélange est parfaitement fluide. Mais si on l’étend sur une plaque de verre et qu’on la soumette à l’action de la lumière, elle devient gommeuse, sirupeuse, et, par suite, susceptible de s’imprégner de corps réduits en poudre, tels que le charbon très-divisé ; de plus, elle devient insoluble dans l’eau. Pour obtenir le positif d’un cliché, il suffit donc de recouvrir avec ce cliché, une glace préparée comme nous venons de le dire, et après l’impression lumineuse, de la saupoudrer de charbon en poudre. On transporte les images qu’on obtient ainsi, sur des feuilles de papier albuminé, pour éviter le miroitage désagréable occasionné par la surface luisante de la plaque de verre.
M. Niépce de Saint-Victor a fait connaître un procédé de tirage avec les sels d’urane ; mais il faut encore ici avoir recours aux sels d’argent.
L’azotate d’urane a la propriété de réduire les composés d’argent, lorsqu’il a été soumis à l’influence lumineuse. On enduit le papier de ce sel, en ayant soin de faire cette opération à l’abri de la lumière ; puis on l’expose à la lumière, après l’avoir recouvert du cliché à reproduire. Il se forme ainsi une image, qu’il est nécessaire de développer dans un bain d’azotate d’argent, et de fixer dans une dissolution de chlorure d’or acidulée par l’acide chlorhydrique.
M. Niépce de Saint-Victor a donné aussi le moyen d’obtenir des épreuves de couleurs diverses. Si l’on plonge le papier à l’azotate d’urane, après l’impression lumineuse dans la chambre obscure, dans une dissolution de ferrocyanure de potassium, on obtient une image présentant une belle coloration rouge-pourpre. La même épreuve peut prendre une couleur verte, si on la plonge dans une dissolution d’azotate de cobalt.
Le chlorure d’or communique à ces épreuves la couleur violette. Si le papier est imprégné de prussiate rouge de potasse, et qu’après l’impression lumineuse on le plonge dans une dissolution de bichlorure de mercure, l’épreuve prendra une coloration bleue par l’action de l’acide oxalique.
Nous pourrions citer un très-grand nombre d’autres procédés pour le tirage des positifs sans sels d’argent. Tous ces procédés reposent sur les modifications que la lumière fait subir à certains sels métalliques. Nous venons de décrire les principaux : pour ne pas sortir des limites de cette notice, nous nous contenterons de mentionner les autres. Signalons, en conséquence, par un seul mot, le procédé aux sels de mercure inventé par sir John Herschell ; par les sels de cuivre, dû à M. Robert Hunt ; par les sels de manganèse, de platine, etc., etc.
CHAPITRE XIII
Après les chapitres consacrés à la description des opérations pratiques de la photographie, nous placerons quelques mots sur la théorie qui permet d’expliquer ces divers phénomènes. Il est, en effet, plus d’une de ces opérations dont l’explication est difficile, et sur laquelle physiciens et chimistes sont en dissidence complète. Il n’est donc pas hors de propos de toucher, en passant, à cette question.
Il y a, comme on vient de le voir, deux ordres bien distincts de phénomènes, dans les opérations photographiques : l’action des réactifs qui servent à développer ou à fixer l’image, et l’action de la lumière qui provoque sa formation sur la surface sensible. Les chimistes sont généralement d’accord sur l’explication à donner de l’action des réactifs, et nous avons présenté cette explication à mesure que nous parlions de chacun de ces réactifs. Le développement de l’image, par exemple, tient à ce que l’acide gallique forme avec l’oxyde d’argent un gallate d’argent noir et insoluble. Le fixage par l’hyposulfite de soude, ou le cyanure de potassium, s’explique par la solubilité de l’iodure, du bromure et du chlorure d’argent, dans l’hyposulfite de soude et dans le cyanure de potassium, etc.
Il est, au contraire, difficile d’expliquer d’une manière satisfaisante la formation de l’image dans la chambre obscure ; en d’autres termes, de dévoiler la véritable action de la lumière sur l’iodure et le bromure d’argent déposés sur le papier. Les théoriciens sont ici partagés en deux camps. Les uns admettent que la lumière agit chimiquement sur le corps sensible soumis à son influence ; les autres voient dans ce phénomène une action purement physique.
Les partisans de la première théorie expliquent la modification que le chlorure d’argent subit par l’action de la lumière, en disant que le chlorure d’argent passe d’abord à l’état de sous-chlorure, et que, la réduction continuant, il reste de l’argent réduit. Cet argent métallique n’est pas d’abord visible ; mais il le devient par l’emploi des réactifs spéciaux. Il se dépose par l’action de la lumière des molécules d’argent en quantité infiniment petite, ce qui explique pourquoi l’image n’est pas visible au sortir de la chambre obscure. Ensuite, les réactifs employés fournissent de nouvelles molécules d’argent, qui, en venant s’ajouter aux premières, rendent l’image visible.
Si cette théorie est exacte, Une exposition à la lumière plus longue qu’à l’ordinaire, doit rendre l’image visible avant le développement, et rendre inutile l’opération du développement. L’expérience suivante, due à M. Young, dépose en faveur de cette explication. On produit une image sur une glace albuminée et imprégnée d’un sel d’argent ; puis, sans développer cette image à l’aide d’aucun agent révélateur, on la fixe à l’hyposulfite de soude, et elle apparaît aussitôt. Voici l’explication de ce fait. L’exposition à la lumière étant assez longue par le procédé à l’albumine, la lumière provoque la réduction d’une plus grande quantité d’argent qu’à l’ordinaire ; dès lors, l’intervention des agents révélateurs, pour ajouter une nouvelle quantité d’argent, n’est plus nécessaire, l’image est immédiatement visible. Si l’on plonge l’épreuve dans la dissolution d’hyposulfite de soude, ce sel dissolvant la combinaison d’argent non altérée, respecte l’argent déposé par l’action de la lumière, et l’image apparaît sans l’intervention d’aucun révélateur.
À cette expérience, qui paraît convaincante, les partisans de l’action physique opposent une objection excellente. C’est qu’une glace collodionnée soumise à une exposition aussi longue qu’on le désire, ne donne jamais d’épreuve, sans l’intervention de l’agent révélateur. L’expérience de M. Young s’expliquerait donc par cette circonstance, qu’il se ferait, dans le cas d’une longue exposition à la lumière, c’est-à-dire avec la glace albuminée, une combinaison entre l’argent et l’albumine, combinaison qui noircirait sous l’influence de la lumière, en se décomposant et formant un sous-sel d’argent, de couleur noire.
Ce n’est pas là, d’ailleurs, la seule objection que l’on puisse faire à la théorie chimique. S’il y a réellement de l’argent métallique déposé dans l’image par l’action de la lumière, en traitant cette image par l’acide azotique, on doit dissoudre ce métal, et l’agent révélateur ne pourra plus alors développer aucune image. Or, si l’on soumet cette image à un lavage à l’acide azotique étendu, on obtient néanmoins, après le développement, une image, quoique plus faible que dans les autres cas.
On peut encore présenter cette autre remarque, que si le phénomène était purement chimique, l’action de la lumière devrait être d’autant plus intense, que l’on ferait usage d’une plus grande quantité d’iodure d’argent. Or il n’en est pas ainsi.
Les partisans de l’action physique expliquent donc la modification subie par les sels d’argent au contact de la lumière, en supposant qu’il se produit un simple changement dans la constitution moléculaire de l’iodure d’argent, une disposition différente de ses molécules, disposition qui leur permet d’exercer une attraction plus grande sur l’argent fourni par les bains révélateurs.
Comme preuve à l’appui de cette dernière hypothèse, on invoque les expériences suivantes, dues au physicien Moser.
Si l’on soumet à l’action de la lumière, une glace, préalablement recouverte d’un papier noir découpé, et qu’ensuite on projette sur la glace ainsi impressionnée, la vapeur de l’haleine, la vapeur aqueuse se dépose seulement sur les parties que la lumière a touchées. C’est, d’ailleurs, seulement ainsi que l’on peut expliquer le développement de l’image par les vapeurs de mercure, dans le procédé de Daguerre. En effet, une lame d’argent, après avoir été exposée à la lumière, recouverte d’un papier noir découpé, donnera un résultat identique, soit avec la vapeur d’eau, soit avec la vapeur de mercure ; c’est-à-dire, que le mercure ou la vapeur d’eau ne se déposeront que sur les parties qui auront été touchées par la lumière.
En résumé, d’après cette théorie, la lumière n’agirait sur l’iodure d’argent que d’une manière purement physique, en changeant les dispositions moléculaires de ce composé. Si dans quelques cas, comme dans l’expérience de M. Young, on voit se produire une image sans l’emploi d’aucun agent révélateur, elle est due à une combinaison organo-métallique, qui se fait entre l’albumine et l’argent. Mais il n’y a jamais de décomposition chimique proprement dite, provoquée par la lumière dans les sels d’argent.
Telles sont les deux théories qui divisent les savants pour l’interprétation du phénomène général de l’action de la lumière. Nous laisserons à nos lecteurs le soin de se prononcer entre ces deux systèmes, tout en estimant que la théorie des physiciens est la plus exacte expression des faits.
CHAPITRE XIV
Dans tous les procédés de photographie que nous avons décrits, on se sert toujours des mêmes appareils optiques. C’est pour cela que nous avons renvoyé à un chapitre particulier la description de ces appareils : cette description doit maintenant nous occuper.
Au point de vue théorique, l’appareil optique employé en photographie, se réduit à l’objectif et à la chambre noire. Les instruments accessoires qu’on a successivement introduits dans le matériel du photographe, n’ont pour but que de simplifier et d’accélérer les opérations. Nous n’avons donc à parler que de l’objectif et de la chambre noire.
L’objectif est une lentille convergente, enchâssée à l’extrémité d’un tube de cuivre. Cette lentille a pour effet de produire l’image renversée et réduite des objets extérieurs, sur un écran de verre dépoli, disposé au foyer de la lentille. La chambre noire sert à défendre l’écran intérieur de la lumière du dehors, et à permettre à l’opérateur d’apercevoir facilement cette image.
La grandeur de l’image dépend évidemment de la grandeur de la lentille, et des distances relatives des différentes parties de la lentille et du modèle. Il est donc important de faire choix d’un objectif approprié à la grandeur de l’image que l’on désire former, et de disposer les différentes parties de l’appareil, de façon à obtenir cette grandeur, enfin de placer le modèle à une distance convenable, pour arriver à une netteté parfaite dans l’image.
La figure 54 représente les tuyaux de deux objectifs adaptés à une chambre noire. Le tuyau porteur de l’objectif peut avancer ou reculer, grâce à une crémaillère mue par un bouton ; ce qui permet d’arriver assez vite à donner à l’image la plus grande netteté désirable, en la plaçant bien au foyer de l’instrument.
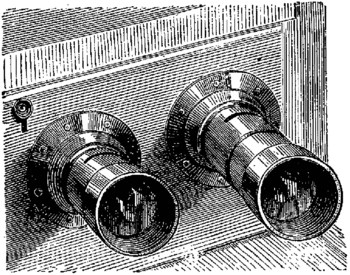
Cette dernière opération se nomme mise au point, dénomination parfaitement juste, car il n’y a qu’un seul point auquel l’image présente une netteté parfaite ; et c’est ce point ou foyer, que l’on recherche par tâtonnement, en déplaçant graduellement l’objectif ou le verre dépoli, de la chambre obscure, au lieu de changer la position du modèle.
On distingue deux sortes d’objectifs : l’objectif simple et l’objectif double. Le premier, malgré ce que pourrait faire croire son nom, est formé de deux lentilles juxtaposées, l’une concave et l’autre convexe, la partie saillante de cette dernière s’emboîtant exactement dans le creux de la première, ce qui ne fait, en réalité, qu’une lentille et ce qui permet de conserver le terme d’objectif simple. L’emploi de deux lentilles accolées, l’une concave, l’autre convexe, mais faites de deux espèces de verres différents, de crown et de flint, a pour but de rendre le système achromatique, c’est-à-dire d’empêcher la coloration de l’image sur les bords. Cette coloration est due, comme on le sait, à la sphéricité imparfaite de la lentille convergente, défaut qui fait que les rayons qui constituent la lumière blanche ne vont pas tous converger au même point.
L’objectif simple a l’inconvénient d’exiger une très-grande distance entre l’appareil photographique et le modèle ; aussi n’est-il employé que pour les reproductions de paysages et de monuments, en un mot des objets pour lesquels la distance n’altère en rien la netteté de l’image.

L’objectif double découvert par Charles Chevallier, se compose du système précédent, auquel on en joint un second formé par la réunion d’une lentille convergente et d’une lentille concave-convexe. La figure 55 montre les rapports des deux lentilles convergentes qui constituent l’objectif double.

Les deux lentilles achromatiques sont placées en A (fig. 56) ; le tuyau qui les porte est mobile à l’aide d’un pignon et d’une crémaillère B. Quand l’appareil ne doit pas recevoir de lumière, il est fermé par l’obturateur D. À l’intérieur se trouve le diaphragme H, que l’on introduit par le tuyau L, quand on veut obtenir une image plus petite, et par conséquent plus nette.
L’objectif double est employé pour les portraits, parce qu’il n’exige pas, comme l’objectif simple, un éloignement considérable du sujet à reproduire. L’objectif simple ne donne pas une image aussi éclairée, aussi lumineuse que celle que fournit l’objectif double ; aussi exige-t-il une plus longue durée d’exposition que ce dernier. C’est une raison de plus pour que l’objectif double soit préféré à l’objectif simple. Dix secondes suffisent, avec l’objectif double, pour obtenir un portrait.
On sait que plus une image a d’étendue, moins elle est nette et lumineuse, ce qui se comprend très-aisément, puisque c’est la même quantité de lumière qui s’étale sur une plus grande surface. Cette circonstance oblige quelquefois à recouvrir l’objectif double d’un second diaphragme, évidé au centre de façon à diminuer encore le champ de l’objectif. On obtient de la sorte une image plus lumineuse et plus nette, parce qu’elle est devenue plus petite ; mais on perd un peu de la rapidité des opérations. Les diaphragmes se placent donc ou se retirent, au gré de l’opérateur.
La chambre noire est une boîte hermétiquement fermée, pour ne laisser aucun passage à la lumière ; elle porte à sa partie antérieure, l’objectif, et à sa partie postérieure, le verre dépoli destiné à recevoir l’image formée par l’objectif.
L’objectif est placé sur une planchette de bois, laquelle est mobile dans le sens vertical, c’est-à-dire glisse dans des rainures pratiquées aux parois de la chambre. Il en est de même de la plaque de verre, qui est mobile dans le même sens, et qui est remplacée, au moment d’opérer, par le châssis à glace contenant la plaque sensible.

Le corps de la chambre noire se compose de deux parties, rentrant l’une dans l’autre de façon à pouvoir approcher ou éloigner l’écran de l’objectif.
On a réalisé d’une manière très-ingénieuse, la mobilité des deux parties de la chambre obscure, grâce à la disposition que représentent les figures 57 et 58. Les deux parties de la boîte constituant la chambre noire, sont réunies à l’aide d’un soufflet qui, par une dilatation ou une compression convenables, peut amener les différentes parties de l’appareil dans la position cherchée.
Tantôt la base de la chambre noire est fixe (fig. 57) et la partie mobile glisse dans une rainure pratiquée sur cette base ; tantôt elle est pliante et munie d’une charnière (fig. 58). Dans ce dernier cas, la chambre noire est portative ; car les deux parties de la base se referment après qu’on a comprimé le soufflet.

La chambre noire est portée sur un pied que nous représentons (fig. 59). Voici l’explication de ses différentes parties. A, est la table pour supporter l’appareil ; E, la vis pour l’incliner ; C, B, sont les pièces à coulisses pour fixer fortement cette table lorsque la vis E a marché ; F, H, sont les pièces de bois à crémaillère pour hausser et abaisser la table, à l’aide de la vis sans fin, et du pignon PO ; IJ, KLM, est le trépied qui porte le tout.

Les châssis qu’on emploie pour l’exposition des plaques sensibles, ont déjà été décrits à propos de la préparation de ces plaques, aussi n’y reviendrons-nous pas.
Lorsque l’appareil est mis au point, et la glace prête à recevoir l’image, l’objectif est fermé par un couvercle. Quand on veut recevoir la lumière, on lève la planchette qui recouvre le côté sensible de la glace, et l’image se produit au moment où l’on enlève l’opercule de l’objectif, Cependant cette opération n’est jamais instantanée ; de plus on risque de déranger l’appareil en agissant trop brusquement. Un constructeur, M. Dallmeyer, a imaginé un obturateur instantané, qui se lève entièrement par la simple rotation d’une vis.

Cet appareil est représenté par la figure 60.
Une autre forme d’obturateur instantané est représenté par la figure 61. Il suffit de tourner la tête de la vis b pour que l’obturateur OR s’abaisse devant les deux objectifs.

La figure 60 représente une chambre noire munie de deux objectifs. Cet appareil est, en effet, destiné à prendre deux vues du même objet au même instant ; il sert surtout pour les images stéréoscopiques. Le châssis à glace dont il est muni peut être disposé de deux manières différentes. La planchette qui le recouvre peut se lever tout entière, ou en deux parties, de manière à prendre les deux images à la fois, ou l’une après l’autre. Dans ce but, la glace dépolie qui sert à mettre l’appareil au point, est mobile. Elle glisse dans deux rainures horizontales, ce qui lui permet de se placer, successivement, derrière l’un des deux objectifs.

La figure 62 représente le châssis porteur de la glace dépolie. Il est muni d’une coulisse, pour faire glisser la glace dépolie, et d’un petit ressort, pour la maintenir en place. Quand on a pris une épreuve, on lève le ressort, et l’on pousse la glace dépolie dans sa coulisse, pour prendre la seconde épreuve. Le châssis à épreuves, qui remplace la glace dépolie, au moment de recevoir l’image sur la glace collodionnée, est représenté par la figure 63.

Les chambres noires que nous venons de décrire, servent toutes à la production de grands portraits ou de vues d’après nature, dont quelques exemplaires suffisent. Quand il s’agit de portraits-cartes de visite, il faut avoir à sa disposition plusieurs clichés, de façon à opérer plus rapidement le tirage des positifs. Les chambres noires pour les cartes de visite, sont munies de quatre objectifs. On obtient ainsi sur une plaque quatre images.
Les figures 64, 65 et 66, représentent la chambre noire employée par les photographes pour les portraits-cartes.

On voit sur la première l’ensemble de l’appareil, c’est-à-dire le support mobile et le pied, muni d’un cran, qui permet de placer la chambre noire à la hauteur que l’on désire.

La figure 65 fait voir la partie antérieure de la chambre noire, avec ses quatre objectifs ; la figure 66, la partie postérieure, du côté du verre dépoli.

Sur le côté de la chambre noire (fig. 64 et 66) on voit une petite fente qui permet d’introduire la main dans la boîte, pour régler les quatre objectifs, de telle manière que les quatre images soient toutes bien au point ; car il est rare que les objectifs aient tous la même distance focale, et leur hauteur n’est pas la même pour les quatre lentilles. On ferme cette petite porte quand la mise au point est obtenue.
On prend les images deux à deux : à cet effet, on abaisse l’obturateur qui cache une paire d’objectifs, et on laisse libre l’autre paire. On voit sur la figure 65, cet obturateur, qui consiste en une sorte de rideau de bois, que l’on abaisse en tirant le bouton.
Nous terminerons ce chapitre en parlant des appareils optiques qui permettent d’obtenir de grandes vues d’ensemble, ou des panoramas.
On entend en photographie, par appareil panoramique, les chambres obscures munies d’un objectif disposé de manière à embrasser une vaste étendue d’horizon et à donner, par conséquent, la reproduction du plus grand espace possible de la vue extérieure.
Les vues que l’on peut prendre avec les appareils ordinaires en usage en photographie, sont limitées par un angle de 32 à 36 degrés d’amplitude ; il en résulte que, pour reproduire un monument de 100 mètres de façade, il faut se placer à une distance d’au moins 175 mètres. Pour un ouvrage d’art de grande étendue, tel, par exemple, que le viaduc de Nogent-sur-Marne, qui a 800 mètres de longueur, il faudrait se placer à 1 400 mètres. Mais, dans les reproductions photographiques de ces vastes étendues obtenues avec la chambre obscure ordinaire, on remarque toujours sur les bords une absence de netteté et une déformation visible des lignes, surtout des lignes verticales, qui sont toujours infléchies vers le centre, et qui, dans leurs parties supérieures, inclinent vers le milieu du tableau. Ce dernier défaut est surtout très-sensible dans les vues de monuments qui offrent des aiguilles ou des clochers élancés ; c’est ainsi que dans les vues de la Sainte-Chapelle, de l’église Sainte-Clotilde, de l’église de la Trinité, etc., les clochers paraissent tous incliner vers le centre de l’image.
Ces inconvénients n’existeraient pas dans un appareil panoramique dont l’objectif serait mobile et viendrait se présenter successivement vers tous les points de l’horizon à reproduire. En effet, en opérant de cette manière, on ne recevrait sur la couche sensible que les rayons émanés du milieu de l’objet reproduit, et dès lors nulle déformation de lignes ne serait à craindre.
En 1846, M. Martens, imagina son appareil panoramique, qui repose sur le principe suivant. Si l’on courbe une plaque daguerrienne en forme de demi-cylindre posé verticalement ; que dans l’axe de ce demi-cylindre on place l’objectif, que l’on donne ensuite à la plaque daguerrienne un mouvement vers tous les points de l’horizon, l’objectif restant d’ailleurs fixe, on pourra amener successivement sur la couche sensible, les divers plans qui composent l’horizon total embrassé par l’instrument.
Ce système constituait un grand progrès en photographie, et l’appareil de M. Martens a rendu de sérieux services. Mais il avait nécessairement l’inconvénient de ne pouvoir s’appliquer qu’aux plaques métalliques, car les lames de verre dont on se sert aujourd’hui pour produire les clichés photographiques, ne peuvent nécessairement se prêter à une courbure quelconque.
Un ingénieur des Ponts et chaussées, mort en 1858, Garella, a imaginé une disposition qui permet de prendre une vue panoramique avec une lame de verre collodionnée. Voici quelles sont les dispositions de cet appareil.
L’instrument entier est mobile autour d’un axe vertical, placé à une distance de la plaque sensible égale à la distance focale de l’objectif. L’appareil, reposant sur son axe de rotation et sur deux galets, tourne, en entraînant avec lui l’objectif, qui est par conséquent dirigé ainsi, successivement, vers tous les points de l’horizon à reproduire. Le mécanisme qui imprime le mouvement de rotation, se compose d’une roue dentée horizontale engrenant avec une vis sans fin, mise en mouvement elle-même par l’opérateur à l’aide d’une manivelle.
Le châssis portant la plaque sensible est entraîné dans le mouvement général de l’appareil. Ce châssis a en même temps un mouvement rotatif destiné à assurer la netteté des images, et qui est calculé de manière qu’un point quelconque du paysage vienne se reproduire toujours sur le même point de la plaque.
Avec cet appareil, il n’y a d’autre limite à l’étendue de l’horizon à reproduire, que les dimensions que l’on peut donner à l’appareil. Comme, au delà de certaines limites, ils deviendraient d’un transport embarrassant, on a borné les appareils construits jusqu’à ce jour à une étendue de 100°. Garella a fait connaître les diverses conditions à observer, selon le développement des vues qu’on veut obtenir, les dimensions du plateau, celles de l’objectif, la distance focale, les positions respectives, etc. Si l’on voulait reproduire un panorama complet de 360 degrés d’amplitude, la glace devrait avoir en longueur le développement d’un cercle ayant la distance focale pour rayon. Mais les appareils à panorama complet ne seraient guère qu’une simple curiosité qu’on ne ferait exécuter que pour montrer aux yeux ce que permettrait d’obtenir le système imaginé par l’auteur. Une étendue angulaire de 90° (le quart de la circonférence) est plus que suffisante dans la plupart des cas.
Nous avons vu une photographie des bords de la Seine aux environs du Louvre, prise par M. Baldus, avec l’appareil panoramique de Garella, et embrassant un horizon de 100°. La rectitude des lignes, même jusque sur les bords extrêmes de l’image, était parfaite, sans la moindre déformation, et montrait bien avec quelle rigoureuse précision sont conservées, avec cet appareil, les proportions naturelles des diverses parties de l’image, quelle que soit leur situation sur cette vaste étendue d’horizon.
En 1868, M. Silvy, photographe français établi à Londres, a perfectionné encore cet appareil panoramique, en remplaçant la lame de verre destinée à recevoir l’image panoramique par une simple feuille de papier. On comprend les avantages pratiques qui doivent résulter de la possibilité de recevoir l’image panoramique sur une feuille de papier qui peut prendre toutes les courbures de l’instrument, et en simplifier singulièrement le mécanisme, L’appareil panoramique de M. Silvy rendra donc de grands services à la photographie.
CHAPITRE XV
Ce n’est pas seulement sur le métal, sur le verre et sur le papier, que l’on peut former des épreuves héliographiques ; on peut également les obtenir sur porcelaine ou sur émail. Si l’on transporte sur la porcelaine ou sur l’émail, une image positive mélangée de substances pouvant être vitrifiées au feu, on obtient, en les cuisant dans le four à porcelaine, de véritables émaux photographiques, qui ont une précieuse qualité : une indestructibilité absolue.
C’est à M. Lafon de Camarsac qu’est due l’invention des émaux photographiques. M. Alphonse Poitevin a, de son côté, fait beaucoup avancer cette branche spéciale de l’héliographie ; mais il faut reconnaître que le premier de ces deux artistes a eu le mérite de se consacrer, pendant une longue suite d’années, à l’application spéciale dont il est l’inventeur et de la porter à son degré de perfection.
M. Lafon de Camarsac s’occupe de cette question depuis l’année 1854. Il s’était proposé, dès cette époque, de fixer sur les matières céramiques des images obtenues par la lumière, et rendues absolument inaltérables, afin de former des collections de portraits et de scènes historiques destinés à décorer l’intérieur des monuments.
C’est dans le brevet pris, en 1854, par M. Lafon de Camarsac, que l’on trouve très-nettement formulé le principe sur lequel les opérateurs ont fondé plus tard la production de toutes sortes d’épreuves vitrifiées. Ce principe consiste à renfermer des matières colorées inaltérables et réduites en poudre impalpable, dans une couche de substance impressionnable à la lumière et adhésive. L’auteur obtenait ce résultat, en mélangeant la poudre colorée à l’enduit, soit avant son exposition à la lumière, soit après cette exposition. Dans les deux cas, toute la matière photogénique est éliminée après l’exposition au feu, et il ne reste à la surface de la porcelaine que des couleurs inaltérables.
Nous croyons devoir rapporter les termes du mémoire dans lequel M. Lafon de Camarsac faisait connaître les principes de sa découverte.
« C’est aux procédés de la décoration céramique, écrivait M. Lafon de Camarsac, que je demande les moyens d’atteindre le but que je me suis proposé ; c’est par eux que je transforme les dessins héliographiques en peintures indélébiles ; je profite à la fois de l’éclat des couleurs vitrifiables et de leur inaltérabilité.
« Je compose un enduit sensible susceptible de recevoir l’application du cliché sans y adhérer et d’être rendu facilement adhésif après l’exposition à la lumière. L’exposition terminée et le dissolvant ayant formé l’image, qui est parfaitement nette et visible, je procède à la substitution des couleurs céramiques à cet enduit qui doit être détruit par le feu.
« Les matières colorantes vont être fixées par la fusion ; il faut les approprier aux subjectiles qui doivent les recevoir ; les métaux, le verre, le cristal, la porcelaine, les plaques d’émail recevront ces couleurs ; l’or, l’argent, le platine fourniront leur éclat ; les émaux seront appliqués sur la porcelaine, les émaux de grand feu eux-mêmes. Il suffit d’accorder entre elles les matières qui doivent se trouver en présence ; mais c’est là l’objet d’arts spéciaux dont je n’ai pas à m’occuper ici.
« Quel que soit le subjectile, l’or, l’argent, le platine et leurs fondants, les oxydes métalliques purs ou mélangés de fondants seront réduits en poudre impalpable par un broyage parfait.
« Le subjectile qui porte l’image est soumis à une égale et douce chaleur, qui restitue à l’enduit la propriété qu’il avait perdue en séchant.
« Avec un fin tamis de soie, je dépose bien également à la surface les poudres colorées que j’y promène doucement, soit avec un pinceau, soit par un mouvement rapide, en augmentant progressivement la chaleur. Ces poussières d’émail ou de métal viennent suivre avec une grande délicatesse tous les accidents du dessous, qu’elles pénètrent en partie et dont elles traduisent fidèlement les vigueurs et les finesses ; après refroidissement, j’époussette avec soin pour débarrasser les blancs de l’image des parcelles de couleurs qui peuvent y demeurer faiblement attachées.
« La pièce est prête alors pour le feu ; le degré de chaleur à donner ici dépend seul des matières employées. Le mode nouveau d’application des couleurs change peu de chose aux précautions usitées dans les ateliers pour la cuisson des porcelaines peintes.
« Le feu détruit les matières organiques, l’image formée de matières indestructibles demeure fixée sur le subjectile par la vitrification.
« Un des caractères remarquables de ces images, c’est l’aspect de sous-émail qu’elles présentent et qu’aucune autre peinture ne saurait fournir avec ce degré de délicatesse. Cette circonstance prouve bien que la poussière d’émail est venue prendre exactement la place de la matière organique, car il faut reconnaître que cette apparence est due à la remarquable finesse du dépôt photographique, qui procède par des dégradations d’épaisseur inappréciables à l’œil, etc.
« On voit qu’il n’est point de coloration que ne puisse prendre l’image héliographique, et qu’elle peut être transformée en or et en argent aussi facilement qu’en bleu et en pourpre. »
Les procédés de vitrification des épreuves photographiques, ont été appliqués depuis plusieurs années, à l’ornementation des bijoux. On sait que les arts industriels font une consommation considérable d’émaux peints, que l’on enchâsse dans des bracelets, des bagues, des broches, des bijoux. À ces peintures toujours coûteuses et souvent détestables, la photographie sur émail est venue substituer des reproductions, monochromes ou coloriées, qui luttent d’éclat avec les anciens bijoux, et qui l’emportent sur eux par la perfection du dessin, mais surtout par la modicité du prix. Il ne serait pas sans importance, pour l’éducation des masses, pour le développement du sentiment artistique, que ce genre de bijoux se généralisât.
En raison de leur inaltérabilité absolue, les photographies céramiques peuvent braver l’action du temps et des agents atmosphériques. Rien ne serait donc plus facile que d’enrichir nos musées de collections de types et de portraits contemporains, qui fourniraient à l’histoire des documents irrécusables. De grandes épreuves photographiques sur porcelaine, formeraient un des plus intéressants ornements des musées publics.
Les émaux photographiques ne sont pas, d’ailleurs, demeurés de purs objets d’art. L’industrie de la décoration des porcelaines s’en est emparée dans plus d’un pays. On voyait à l’Exposition universelle de 1867, beaucoup de vases de porcelaine portant ce genre de décor. La manufacture de porcelaine de M. Poyard, à Paris, celle de MM. Pinel et Perchardière, présentaient un assez grand nombre de vases décoratifs en porcelaine, portant des émaux photographiques. Un fabricant du Havre, M. Kaiser ; un manufacturier de Berlin, M. Grün, s’étaient distingués dans la même voie.
Depuis quelques années la photographie sur émail s’applique avec succès au portrait photographique. Ces portraits obtenus sur une plaque de cuivre couverte d’émail, et peints d’harmonieuses couleurs, sont remarquables par la douceur des contours, la transparence et l’éclat du ton, qualités dues à la fusion des matières. Ces petits objets d’art ont, en outre, l’avantage d’être d’une durée indéfinie, comme les émaux peints et les peintures sur porcelaine. On encadre ces portraits comme des miniatures, ou bien on les monte en bijoux, à nu ou en relief, à la manière des camées et des pierres gravées.
M. Lafon de Camarsac et M. V. Deroche se sont fait, à Paris, une juste réputation pour leurs portraits photographiques sur émail.
Le premier de ces opérateurs a publié, en 1868, sous ce titre : Portraits photographiques sur émail, une brochure dans laquelle on cherche en vain une description précise du procédé qui sert à obtenir ces nouveaux produits. L’auteur, n’ayant pas voulu sans doute divulguer ses méthodes particulières, ne cite aucune des substances dont il fait usage, et se tient dans des termes vagues et généraux.
Après avoir rappelé le procédé général en usage pour obtenir les épreuves de photographie sur papier, M. Lafon de Camarsac s’exprime ainsi :
« Dans les opérations ordinaires de la photographie sur papier, c’est toujours la matière sensible elle-même, plus ou moins modifiée, qui constitue l’image définitive.
« Il semblerait que l’on dût facilement obtenir, par les procédés ordinaires de la photographie, une épreuve vitrifiée, en produisant une image sur la plaque d’émail et en l’y incorporant par la fusion ; mais il s’en faut de beaucoup qu’aucun des corps sensibles dont serait formée cette image puisse résister au feu d’émailleur : ils sont tous volatilisés, brûlés, anéantis, bien avant que la chaleur ait même ramolli les surfaces émaillées.
« Le problème ne pouvait donc pas être résolu avec les procédés ordinaires ; et aucun fait, en photographie, ne devait même autoriser à considérer cette solution comme possible.
« Ce n’est donc pas en cherchant dans les diverses matières sensibles les éléments de la vitrification de l’épreuve, que nous avons atteint le but ; c’est au contraire en leur substituant les couleurs vitrifiables dans la formation de l’épreuve elle-même. Deux méthodes, reposant sur ce principe, peuvent être pratiquées :
« 1o La couleur d’émail, celle-là même employée dans la peinture, est mélangée intimement à une solution de matière sensible à la lumière, qu’on étend en couche mince. Le cliché superposé à cette surface ainsi composée, on laisse agir la lumière : tous les points atteints deviennent insolubles.
« Il suffit donc, pour dégager l’image vitrifiable, de faire agir le dissolvant de la matière sensible sur toute la surface de la couche : les parties non attaquées par la lumière seront dissoutes et disparaîtront, entraînant avec elles la couleur d’émail qui leur était mêlée ; les parties insolées demeurent seules et forment l’image qui se trouve ainsi composée de matière sensible et de couleur vitrifiable. Le feu détruit la matière sensible et vitrifie la couleur d’émail, qui seule a subsisté après ces diverses opérations.
« 2o Une couche sensible est formée ; cette fois, elle ne contient pas de couleur d’émail. Après l’exposition sous le cliché, on la traite par un dissolvant dont l’action puisse être facilement conduite et ménagée. Sous cette action, les parties non insolées s’amollissent ou s’imprègnent d’abord du dissolvant : on arrête l’opération, et l’on procède à l’inclusion de la couleur vitrifiable. Cette couleur, broyée en poudre impalpable, est promenée au pinceau sur toute la couche ; elle prend et adhère partout où le dissolvant a agi ; elle ne s’attache point ailleurs. L’image est donc encore formée de couleur vitrifiable et de matière sensible ; le feu élimine cette dernière et fixe la poudre d’émail par la fusion.
« Dans les deux cas, la lumière a en quelque sorte sculpté la matière molécule par molécule, et la couleur d’émail s’est modelée et comme moulée sur cette matrice ; elle en traduit absolument toutes les finesses.
« Cette propriété qu’acquièrent certaines substances de devenir insolubles dans les parties où la lumière les a frappées, est connue depuis l’origine de la photographie, depuis Talbot, depuis Niépce et Daguerre eux-mêmes ; on voit comment elle a été utilisée pour l’inclusion des matériaux qui doivent former l’image inaltérable.
«… Nous n’entrerons point dans les détails infinis des opérations pratiques : elles donnent lieu à des manipulations trop nombreuses et trop spéciales pour être décrites dans un exposé sommaire. »
Nous suppléerons au silence de M. Lafon de Camarsac, en décrivant le procédé qui est suivi par le plus grand nombre des opérateurs pour la préparation des photographies sur émail. On va voir que ce procédé est extrêmement curieux, extrêmement délicat, et qu’il présente de grandes difficultés, dont on ne peut triompher que par une longue pratique et la connaissance exacte des procédés du peintre décorateur sur porcelaine et sur émail.
On prend un cliché positif sur verre, du portrait, ou du modèle à reproduire. D’autre part, on prépare une surface sensible, en versant sur une lame de verre (fig. 67) une couche impressionnable, consistant en une dissolution de bichromate de potasse mélangée de gomme.

Sur la lame de verre qui a reçu cette couche sensible, on applique le cliché positif du modèle à reproduire, et on l’expose à l’action de la lumière, dans un châssis à reproduction. Nous avons déjà dit plusieurs fois que la lumière frappant le mélange d’un bichromate alcalin et d’une matière gommeuse ou mucilagineuse, modifie de différentes manières les propriétés de ce mélange. Ici, la lumière frappant à travers les transparents du cliché positif, le mélange de bichromate de potasse et de gomme donne aux parties ainsi touchées par la lumière la propriété de happer, de saisir, de retenir les matières pulvérulentes, telles que le charbon. Si donc on retire, après un temps d’exposition convenable, la lame de verre du châssis à reproduction, et que l’on saupoudre la couche sensible impressionnée par la lumière, soit avec un pinceau, soit avec un léger tamis de soie, de poudre de charbon (charbon de pêcher), la fine poussière charbonneuse s’attachera seulement aux parties que la lumière a touchées, c’est-à-dire aux noirs, et ne se fixera point sur les parties claires non touchées par la lumière à travers les transparents du cliché. On verra dès lors apparaître une image positive. Rien n’était visible sur la surface impressionnée par la lumière, avant qu’on y promenât le pinceau chargé de poudre de charbon ; mais à mesure qu’on y promène cette poudre, on voit l’image apparaître, absolument comme si le pinceau d’un artiste invisible crayonnait cette surface.
Rien n’est plus curieux que cette opération, qui correspond au développement dans la photographie ordinaire : la poudre de charbon développe l’image latente sur la couche de bichromate de potasse et de gomme, comme l’acide gallique développe et fait apparaître l’image latente sur la glace collodionnée sortant de la chambre noire. Ce qu’il y a d’extraordinaire, c’est la finesse et la fidélité avec lesquelles les demi-teintes apparaissent dans cette opération. Ce qui est vraiment merveilleux dans les propriétés du mélange dont nous parlons, c’est que ce ne sont pas seulement les grandes masses d’ombre et de lumière, mais encore les nuances et dernières dégradations des demi-teintes, qui l’impressionnent. Cette dernière circonstance est ce qui fait la grande portée, ce qui a permis les applications si nombreuses de la découverte de M. Alphonse Poitevin.
L’épreuve photographique ainsi développée par la poudre de charbon, n’aurait pas une stabilité suffisante. Pour la consolider et lui donner la résistance nécessaire, on y passe, à l’aide d’un pinceau, une couche de collodion normal, c’est-à-dire de collodion ne renfermant ni sel d’argent, ni aucun autre produit étranger. Le collodion, en s’évaporant, laisse un enduit transparent, qui fixe et maintient les particules du charbon composant le dessin.
C’est alors qu’on exécute une opération fort délicate, et qui exige une main exercée. Il s’agit de détacher de la lame de verre, toute la pellicule organique qui compose l’épreuve, de la séparer du support, comme une feuille de papier qui s’y trouverait appliquée. On a trouvé dans l’acide azotique un peu étendu, un intermédiaire qui permet d’exécuter avec une assez grande facilité, cette séparation de l’épreuve. Quand on l’a laissée quelque temps séjourner dans l’acide azotique, on peut détacher un ou deux coins de la pellicule organique, et, avec quelque précaution, l’enlever tout d’une pièce.
On applique alors cette pellicule sur une plaque d’émail.
Ces plaques que l’industrie fabrique, pour la bijouterie, en quantités considérables, se composent d’une lame de cuivre légèrement bombée, et couverte, sur ses deux faces, d’une couche d’émail blanc. On choisit une de ces plaques de la dimension nécessaire pour l’épreuve que l’on a à traiter, et l’on y applique la pellicule organique détachée de la lame de verre.
Il faut maintenant obtenir, avec cette épreuve, un émail noir. À cet effet, on promène sur sa surface, un pinceau imprégné d’un fondant, dont la composition peut varier, et qui n’est autre que le fondant employé par les émailleurs et les peintres sur porcelaine. Par l’action du feu, ce fondant fera corps avec le charbon qui compose l’épreuve, et provoquera ainsi la vitrification du dessin.
On place donc dans le moufle d’un four à porcelaine, convenablement chauffé, les plaques d’émaux qui ont subi les différentes opérations que nous venons de décrire. Par l’action de la chaleur rouge, toutes les matières organiques sont détruites ; tandis que le fondant retient le charbon qui forme le dessin ; ce qui laisse, en définitive, une épreuve noire sur l’émail retiré du four.
Voilà comment s’obtiennent les photographies sur émail, en dessin noir. Elles rappellent les teintes ordinaires des photographies sur papier. Quand on veut obtenir une épreuve coloriée, ressemblant aux miniatures ou aux peintures sur porcelaine, on a recours aux procédés ordinaires de la peinture sur porcelaine. Ce qui veut dire que l’on peint ce dessin noir avec les couleurs vitrifiables employées pour la décoration des porcelaines. Ensuite on porte au four la pièce ainsi préparée. Comme pour les peintures sur porcelaine ou sur émail, il faut quelquefois deux ou trois cuissons consécutives, pour obtenir toutes les couleurs cherchées, le point de fusion de chacune des couleurs n’étant pas le même, ou bien la réaction qu’elles exercent les unes sur les autres, obligeant à les appliquer séparément et à des températures différentes.
On voit, en définitive, que la photographie sur émail consiste à produire, avec un cliché positif, une image, positive elle-même, grâce aux propriétés bien connues du bichromate de potasse ; ensuite à transporter cette épreuve positive sur une plaque d’émail, et à en faire un dessin noir sur émail, grâce aux procédés de l’art de l’émailleur ; enfin, si l’on veut obtenir une peinture coloriée, à traiter ce dessin noir par les procédés ordinaires du décorateur de porcelaine.
On doit à M. Alphonse Poitevin la découverte d’une autre couche sensible destinée à former l’épreuve céramique. Au lieu de bichromate de potasse et de gomme, M. Poitevin fait usage de perchlorure de fer et d’acide tartrique. Ce mélange, impressionné par la lumière à travers un cliché positif, a la propriété, comme le mélange de bichromate de potasse et de gomme, de happer, de retenir la poudre de charbon. Le mélange de perchlorure de fer et d’acide tartrique, présente certains avantages sur le bichromate de potasse, pour la photographie céramique. Le reste du procédé pour la préparation de l’émail noir ou coloré, s’opère, d’ailleurs, comme il a été dit plus haut.
C’est par une méthode de ce genre qu’opère M. V. Desroche, photographe et peintre parisien d’un grand mérite. Les portraits coloriés sur émail et sur porcelaine qu’il exécute, sont de véritables œuvres d’art, justement appréciés des amateurs et des artistes. M. V. Desroche ressuscite ainsi le genre charmant, et presque oublié, de la miniature. Ses portraits ont toute la douceur des miniatures anciennes, avec le cachet et la certitude de ressemblance que leur assure la photographie. La mode se prononce de plus en plus en faveur de cette nouvelle et intéressante application des arts photographiques.
Un autre artiste peintre et photographe, M. Félix Lochard, exécute sur émail des portraits photographiques, mais il s’adonne plus spécialement à la fabrication des émaux photographiques pour la bijouterie, branche du commerce parisien qui tend à prendre une grande extension.
Une des nouveautés qui ont été les plus remarquées à l’Exposition de 1867, comme application de la photographie, c’est la vitrification, transparente ou opaque, des épreuves photographiques. Dans l’élégant pavillon où MM. Tessié du Motay et Maréchal avaient réuni leurs diverses inventions, la foule se pressait, pour admirer de magnifiques vitraux obtenus, non par les anciens procédés de l’art du verrier, mais par de véritables méthodes photographiques.
La méthode au moyen de laquelle messieurs Maréchal et Tessié du Motay produisent des images photographiques, transparentes ou opaques, sur le verre, l’émail, la lave, la porcelaine ou la faïence, consiste en principe à faire usage de caoutchouc et de collodion, pour former des surfaces que l’on rend impressionnables à la lumière par de l’iodure d’argent. Après avoir fait apparaître l’image latente, avoir développé et fixé cette image par des lavages dans des bains contenant des cyanures alcalins et des iodocyanures, on arrive à produire des vitraux de teintes pures et éclatantes.
La méthode de M. Tessié du Motay s’applique à la décoration de toutes les matières siliceuses, et d’une façon spéciale, sur le cristal et sur le verre ; car on obtient sur ces deux substances des images vitrifiées, visibles soit par réflexion, soit par transparence.
À côté des vitraux de M. Tessié du Motay, se voyaient, à l’Exposition universelle, des produits du même genre, exécutés par M. Moisson. Le procédé qui permet de les obtenir a été décrit par l’inventeur dans le Bulletin de la Société française de photographie[32].
Il est une autre catégorie de vitraux photographiques qui produit les plus doux effets, grâce au jeu de la lumière, et que nous ne pouvons manquer de signaler. Il ne s’agit pas ici de photographies vitrifiées proprement dites, c’est-à-dire obtenues par l’action du feu. Ce n’est autre chose qu’une épreuve positive obtenue sur verre, par le procédé à l’albumine, épreuve que l’on interpose entre la lumière et l’œil, à la manière des vitraux.
Assurément, la durée, la résistance au frottement, ne sont point assurées par ce système, et sous ce rapport, ce genre de produits est infiniment au-dessous des émaux photographiques. Mais leur charme et leur douceur sont infinis, et la blancheur mate de la lumière qui traverse la substance du verre donne de ravissantes sensations. Il faut dire aussi que l’habileté spéciale de l’artiste est peut-être pour beaucoup dans ce séduisant résultat. Les vitraux sur albumine que l’on remarquait le plus à l’Exposition, sortaient des mains de M. Soulier. Or, nous ne connaissons pas aujourd’hui, dans ce que l’on peut appeler les œuvres générales de la photographie, d’artiste supérieur à M. Soulier, à qui l’on doit de véritables chefs-d’œuvre en fait de monuments et de vues.
Les mêmes remarques peuvent s’appliquer à M. Ferrier, qui présentait également des vitraux sur albumine. M. Ferrier, ce photographe cosmopolite qui a fait défiler devant son objectif toutes les parties du monde, et qui a toujours cherché et souvent atteint la perfection, s’est appliqué, comme M. Soulier, à produire des vitraux sur albumine, et nous n’avons pas besoin de dire qu’il y a réussi.
CHAPITRE XVI
Nous terminerons cet exposé des procédés de la photographie, en parlant des appareils portatifs de M. Dubroni, qui permettent de faire des épreuves photographiques sans aucun cabinet noir, c’est-à-dire dans une chambre ou dans un salon. Un grand nombre de personnes désireuses de pratiquer elles-mêmes la photographie, à titre de distraction, n’avaient pu y parvenir à cause du nombreux matériel et de l’aménagement tout particulier qu’exige un laboratoire. Il était donc à désirer qu’on imaginât un appareil qui fût à la portée de tout le monde, tant par la simplicité que par le bas prix.
Un jeune ingénieur, élève de l’École polytechnique, et qui cache, sous l’anagramme de Dubroni, le nom de Bourdin, honorablement connu dans le commerce de la librairie, a résolu ce problème. Aujourd’hui, dans une boîte de 23 centimètres de long sur 20 de large, légère, et qui ne tient pas plus de place qu’un Dictionnaire des adresses de Didot, on emporte avec soi son laboratoire, ses produits, sa chambre noire et son objectif.
M. Dubroni, appliquant les propriétés qu’a le verre coloré en brun jaunâtre, d’empêcher le passage des rayons chimiques de la lumière, qui agissent seuls sur la plaque sensibilisée, a fait souffler, avec ce verre, de petites bouteilles de 10 centimètres de diamètre environ. Il renferme une de ces bouteilles de verre jaune dans une boîte en bois, de forme rectangulaire, dans laquelle on a pratiqué un trou, à la partie antérieure et un autre à la partie supérieure. Le premier orifice est destiné à recevoir l’objectif, le second, c’est-à-dire celui qui est placé au haut de la boîte, doit permettre l’introduction des liquides dans la bouteille de verre jaune.

Cette dernière porte aussi deux trous circulaires, correspondant à ceux de la boîte, et, de plus, sa paroi postérieure est complètement enlevée, de façon qu’on peut la remplacer, soit par une plaque de verre dépoli pour la mise au point, soit par la glace sensibilisée, sur laquelle doit se former l’image négative. La boîte contient, en outre, un flacon d’alcool, un autre flacon renfermant du collodion préparé à l’iodure de cadmium ; un troisième contient une solution de nitrate d’argent, le quatrième du sulfate de fer, le cinquième des cristaux d’hyposulfite de soude, le sixième du vernis. Dans la boîte se rangent encore, un petit blaireau pour épousseter les plaques nettoyées à l’alcool, — une plaque de verre dépoli pour prendre le point, — une petite presse pour tirer les épreuves. Dans le couvercle s’ouvre un portefeuille où s’entassent une provision de papier non collé, pour dessécher les épreuves tirées, et du papier blanc mince et non collé pour les différents nettoyages. — Un compartiment renferme un petit cône en bois qui se visse dans une petite planchette de bois à rainures ; on met ce cône de bois dans le premier chandelier venu, qui sert alors de pied au petit appareil que l’on pose sur la planchette.
Voici comment on procède à l’opération. On nettoie parfaitement la glace destinée à recevoir le collodion. Cette précaution est très-importante, car la réussite des épreuves en dépend. Nous avons déjà indiqué, à propos du procédé au collodion humide, la méthode à suivre. Cela fait, on procède à la mise au point.
Pour cela, on assujettit le pied de l’instrument, et l’on y place cet appareil. On dirige l’objectif vers le sujet qu’on veut reproduire ; on l’éloigne, on le rapproche à l’aide d’une crémaillère, comme dans une lorgnette, en regardant sur la plaque de verre dépoli jusqu’à ce que l’image se présente parfaitement nette. Il faut pour mettre au point s’entourer la tête d’un voile noir, comme on le fait pour la pose du modèle, dans les cas ordinaires. On enlève alors le verre dépoli et on le remplace par la glace nettoyée et recouverte de collodion.
Le collodionnage de la plaque exige une certaine expérience pour être fait convenablement. On tient la glace horizontalement et on verse le liquide par un des angles, en inclinant doucement la plaque, le liquide descend vers le coin opposé à celui par lequel on a versé, en recouvrant toute la glace (fig. 69 et 70).


Cela fait, on place la glace dans l’appareil, on le ferme, en ayant soin de mettre l’obturateur sur l’objectif. On prend alors une ventouse en caoutchouc, terminée par un tube d’ivoire et l’on enfonce le tube dans le flacon de nitrate d’argent, après avoir comprimé la ventouse ; on ouvre les doigts, et le bain de nitrate d’argent monte dans la ventouse (fig. 71).

On plonge alors le tube d’ivoire dans la bouteille de verre jaune de l’appareil, et en pressant la ventouse avec le doigt, on fait écouler le liquide (fig. 72).

On renverse ensuite l’appareil en arrière, et d’un seul coup (fig. 73), de façon à ce que la glace soit entièrement et instantanément recouverte par le bain d’argent. On remue légèrement pour éviter à la surface de la plaque le dépôt des impuretés qui pourraient se trouver dans le liquide. On redresse l’appareil, après une ou deux minutes, on retire le bain avec la ventouse, et on le remet dans le flacon qui contient ordinairement ce liquide (fig. 74).


La plaque est dès lors prête à être impressionnée par la lumière. Après un temps de pose variable suivant l’intensité du jour, on remet l’obturateur.
Il ne s’agit plus que de faire apparaître et de fixer l’image.
Au moyen d’une seconde ventouse semblable à la première, on coule le sulfate de fer dans l’appareil, qu’on renverse de nouveau et qu’on vide au bout de deux minutes. L’épreuve est alors développée. On enlève la plaque portant son empreinte. On la lave et on la couvre d’une solution très-concentrée d’hyposulfite de soude pour la fixer.
Quand la plaque est sèche, on la vernit, et on se sert de ce négatif sur verre pour tirer les épreuves positives sur papier.
Pour tirer ces épreuves sur papier, il suffit de placer bien exactement la glace dans la petite presse, d’appliquer le papier sensible sur le côté collodionné de la glace et de l’exposer au soleil pendant une demi-heure environ ; cela fait, on retire l’épreuve de la presse et on la plonge dans un verre d’eau pendant trois quarts d’heure, jusqu’à ce que les blancs soient bien venus. Les clichés vigoureux demandent une plus longue exposition.
Avec cet appareil, toute personne, pourvu qu’elle soit adroite et soigneuse, peut obtenir des résultats assez satisfaisants : seulement les épreuves sont toujours de très-petite dimension.
Nous terminerons ce chapitre en disant quelques mots des photographies magiques, sorte de jouet que l’on vend chez quelques opticiens.
On vous donne une feuille de carton blanc, sur laquelle l’œil ne découvre aucune tache ; mais il suffit d’y appliquer une feuille de papier blanc, et de verser de l’eau sur cette feuille de papier, pour y faire apparaître une photographie. L’épreuve s’améliore encore beaucoup et acquiert plus de stabilité, si on la laisse séjourner quelque temps dans l’eau.
Voici le procédé employé pour produire ces images, qui n’apparaissent qu’à la volonté de l’opérateur.
Une épreuve photographique obtenue à la manière ordinaire sur papier albuminé, est traitée comme il suit.
Dès qu’elle sort du négatif, on la lave avec soin dans une chambre obscure, pour enlever tout l’azotate d’argent. Ensuite, au lieu de la faire virer au chlorure d’or, on la plonge, dans une chambre noire, au sein d’un bain formé de 8 parties d’une solution saturée de bichlorure de mercure (sublimé corrosif) et d’une partie d’acide chlorhydrique. Ce bain blanchit l’épreuve et fait disparaître l’image, mais sans la détruire ; il change simplement la substance qui compose les parties obscures en un sel double incolore de mercure et d’argent. Dès que cet effet a été produit, on lave parfaitement le papier sur lequel est l’image maintenant invisible, et on le fait sécher à l’obscurité.
Comme sa surface est encore légèrement sensible, on la conserve entre des feuilles de papier d’une nuance orangée, pour la protéger contre l’action de la lumière.
Avec ces épreuves latentes, on vend du papier blanc non collé, qui a été également préparé d’une manière spéciale. Ce papier est imprégné d’une solution d’hyposulfite de soude. Lorsqu’on l’applique sur le papier albuminé préparé comme il vient d’être dit, et qu’on plonge les deux feuilles ensemble dans une assiette remplie d’eau, l’hyposulfite de soude du papier buvard agit instantanément sur le sel de mercure de l’épreuve, et il se forme un sulfure de mercure brun, qui accuse les lignes du dessin primitif. On voit donc alors reparaître ce dessin dans tous ses détails, avec une teinte de sépia très-riche et vigoureuse. On peut le faire disparaître de nouveau en plongeant l’épreuve encore une fois dans un bain de sublimé corrosif, puis l’évoquer de nouveau par l’application d’un nouveau buvard humecté d’eau, et ainsi de suite.
Cette expérience est d’un charmant effet ; malheureusement, elle n’est pas sans danger. On sait que le bichlorure de mercure est un poison terrible. Les photographies magiques ne devront donc pas être confiées aux très-jeunes enfants, toujours prêts à porter à la bouche ce qu’ils ont entre les mains. Le danger que pourraient offrir ces photographies est tout aussi sérieux que celui des jouets peints avec des couleurs arsenicales.
M. Édouard Delessert a indiqué un autre procédé qui permet de se passer du bichlorure de mercure. Le papier, imprégné d’un mélange de bichromate de potasse et de gélatine, est exposé sous un cliché négatif ; on le lave d’abord dans un bain d’acide sulfurique étendu d’eau, puis dans l’eau pure, et on le fait ensuite sécher. L’image disparaît quand le papier est sec ; elle reparaît quand le papier est mouillé dans l’eau.
Ce procédé donne un produit tout à fait exempt de danger ; mais ses effets ont moins de magie, puisque magie il y a !
CHAPITRE XVII
Un des principaux objets que doit se proposer la photographie, pour répondre à des conditions assez diverses, c’est l’agrandissement des petites images qu’elle fournit.
Cette branche de la photographie ne s’est développée que longtemps après les autres. Il semble pourtant, au premier abord, qu’étant donné un cliché, il n’était rien de plus facile que de l’amplifier à l’aide du mégascope. Cette idée est juste en théorie ; mais la pratique a révélé des obstacles qu’il n’était pas facile de prévoir.
La méthode générale de l’amplification des épreuves photographiques, consiste à faire passer une vive lumière à travers un cliché négatif, à agrandir cette image, en lui faisant traverser la lentille d’un mégascope, c’est-à-dire d’une lanterne magique, et à fixer sur le papier sensible cette image amplifiée. Cette opération exige des appareils optiques particuliers, destinés à l’agrandissement du négatif. Nous commencerons par faire connaître ces appareils spéciaux.
Pour éclairer le cliché de verre destiné à subir l’amplification, on reçoit sur un miroir plan, la lumière du soleil ou de la lampe électrique, et, par une puissante lentille convergente, on concentre cette lumière sur le cliché, en ayant soin que le faisceau de rayons lumineux qui le traverse, soit divergent, c’est-à-dire aille en s’élargissant à mesure qu’il s’éloigne de ce cliché. Si l’on interpose sur le trajet de ces rayons, une feuille de papier sensibilisée, il s’y formera une image agrandie et positive du cliché.
La figure 75 montre théoriquement le mécanisme physique de cet agrandissement.

Supposons un miroir plan AB, recevant les rayons solaires, et les réfléchissant de manière à les rendre parallèles après cette réflexion. Les rayons r, r, tombant sur le miroir plan AB, prendront la direction rectiligne et parallèle r′r′. Plaçons sur le trajet de ces rayons une puissante lentille convergente CI ; les rayons solaires, qui traversent cette lentille, se réuniront, par l’effet de la réfraction, en un point unique, ou foyer, E, et éclaireront très-vivement ce point. Si un peu en avant de ce foyer E, on place un cliché négatif de verre, DH, ce cliché sera très-vivement éclairé, puisque presque tous les rayons solaires qui sont réfléchis par le miroir, viendront traverser ce verre. Maintenant, plaçons au delà de cette glace DH, une lentille convergente achromatique E ; cette lentille formera une image redressée de cet objet, par des rayons qui iraient en divergeant jusqu’à l’infini. Mais si, à une distance convenable, on interpose sur le passage de ces rayons, un écran FG, l’image se formera sur cet écran, et elle sera plus ou moins grande, selon que l’on écartera davantage l’écran FG, de la lentille convergente E.
Tel est le mécanisme physique du mégascope, celui de la lanterne magique et de la fantasmagorie, appareils qui servent à amplifier les images d’un objet, préalablement très-éclairé par une source lumineuse. Sur le même principe est basé l’appareil qui a reçu d’un photographe américain, M. Woodward, le nom de chambre solaire, et qu’il a appliqué à l’agrandissement des épreuves photographiques.
Après cette idée générale sur l’ensemble de l’appareil pour l’agrandissement des épreuves photographiques, arrivons aux détails de chacune de ses parties, c’est-à-dire au miroir plan, ensuite à la chambre solaire proprement dite.

La figure 76 représente le miroir plan, ou porte-lumière, employé pour projeter un faisceau de lumière sur la lentille du mégascope. C’est une surface plane, en cuivre argenté, portée sur un cadre de bois et fixée à une demi-roue dentée, K. La tige G, qui aboutit à l’intérieur du cabinet noir, dans lequel est placé l’opérateur, commande une seconde tige aa, à l’aide d’une roue d’angle H. Cette tige a porte à sa partie supérieure une vis sans fin qui met en action la petite roue dentée I, et celle-ci fait tourner la grande roue K, pour mouvoir le miroir de bas en haut. L’opérateur placé dans le cabinet noir, n’a donc qu’à tourner la poignée qui termine la tige G pour imposer au miroir un mouvement vertical.
Quant au mouvement horizontal, il est produit par la tige AC, à l’extrémité de laquelle se trouve une vis sans fin, qui fait tourner la roue dentée B. Celle-ci porte les deux tiges E, E, qui à leur tour portent les axes des roues I et K. Cette roue B est percée à son centre, pour donner passage à la tige a, et tourne à frottement doux dans la pièce de fer circulaire CC, qui porte tout l’appareil sur trois pattes D, D.
En mettant en mouvement les deux tiges A et G, qui sont parallèles, l’opérateur, de l’intérieur de son cabinet noir, peut donc imprimer au miroir toutes les positions possibles.

L’appareil de Woodward est représenté par la figure 77. Dans le côté exposé au midi, d’une chambre entièrement fermée et privée de toute autre lumière, on fait une entaille carrée. On place dans cette ouverture un châssis de bois, contenant une puissante lentille convergente O, destinée à concentrer à son foyer les rayons du faisceau de lumière horizontale, réfléchie par le miroir plan, ou porte-lumière, établi au dehors. La hauteur de cette ouverture au-dessus du parquet, doit être, selon M. Monckhoven, de 1m,25. À 3 ou 4 mètres de la lentille convergente O, on place un large écran de bois, A, recouvert d’une feuille de papier blanc, placée parallèlement à l’ouverture O. On prend ensuite un pied à support mobile, I, sur lequel on place une chambre noire ordinaire, CD. Seulement, on remplace le verre dépoli qui, dans les opérations photographiques, sert à mettre au point l’image de cette chambre noire, par le cliché de verre négatif qu’il s’agit d’amplifier. La lumière solaire, arrivant par le miroir plan, traverse la lentille O, ensuite le cliché placé en D, qu’elle éclaire avec puissance. L’objectif B de la chambre obscure, qui se trouve sur le passage des rayons lumineux venant de traverser le cliché D, forme une image amplifiée de ce cliché, qui vient se peindre sur l’écran A.
Si l’on reçoit sur une plaque de verre collodionnée, l’image qui vient se peindre sur l’écran A, on obtiendra un cliché négatif sur verre, qu’il n’y aura plus qu’à fixer par les moyens ordinaires et qui servira ensuite à tirer des épreuves positives sur papier.
L’appareil que nous venons de décrire est connu sous le nom d’Appareil de Woodward, du nom de l’inventeur américain à qui l’on doit cette application à la photographie, du mécanisme physique du mégascope ou de la lanterne magique. Mais l’appareil de Woodward présente, selon M. Monckhoven, quelques inconvénients. La forme des lentilles dont on se sert, influe sur la netteté de l’image. Cette dernière est, en effet, trouble sur les bords, par suite du phénomène d’optique connu sous le nom d’aberration de sphéricité. De plus, la lumière s’étalant sur une grande surface, il passe une certaine quantité de lumière diffuse qui ternit les blancs de l’image, en y décomposant légèrement le sel d’argent. Enfin, la lumière étant inégalement répartie sur le cliché, ce dernier est inégalement chauffé dans ses différentes parties ; il en résulte le fendillement de la couche de collodion, et quelquefois la rupture du cliché de verre[33].
M. Monckhoven a légèrement modifié cet appareil en y adaptant une seconde lentille destinée à corriger l’aberration de sphéricité. La figure 78 montre la disposition adoptée par M. Monckhoven, ainsi que le mode de suspension du cliché, qui permet d’éviter un échauffement inégal de ce cliché par les rayons solaires et le danger de sa rupture.

Un miroir plan semblable à celui qui est représenté par la figure 76 est fixé dans le volet d’une chambre tenue dans l’obscurité. Une manivelle et sa tige font mouvoir ce miroir de manière à lui donner la position convenable pour que le faisceau lumineux se réfléchisse horizontalement à l’intérieur de l’appareil. La lentille destinée à concentrer les rayons solaires est placée dans l’ouverture pratiquée au volet de la fenêtre.
La lentille AA (fig. 78) est donc le condensateur de lumière. À cette première lentille M. Monckhoven en ajoute une seconde, BB, très-mince et de la forme d’un verre de montre, qui a pour but de remédier complètement à l’aberration de sphéricité de la première lentille. Le cliché est placé dans le châssis EF ; l’objectif destiné à produire l’amplification du cliché se trouve dans le tube G, porté par le châssis DH. L’image amplifiée vient se peindre sur un écran placé à quelques mètres au delà de l’objectif amplificateur G.

La figure 78 montre à découvert les éléments de l’appareil d’agrandissement de M. Monckhoven ; la figure 79 fait voir ce même appareil en action. Le condensateur de lumière, ou lentille éclairante, est enchâssé dans l’ouverture B, pratiquée au volet de la fenêtre A. La chambre solaire, C, est portée sur un pied DE. L’image agrandie se forme sur l’écran LM. La distance entre la chambre solaire et l’écran doit être de 3 mètres pour des feuilles de 1m,20 de haut, et de 2 mètres pour des feuilles de 0m,90.
Nous mentionnerons, pour terminer, le mégascope héliographique de M. Bertsch, qui est fondé sur les mêmes principes que les précédents appareils, et dont le lecteur s’expliquera facilement la construction et l’emploi, à l’aide de la figure 80.

AB est le miroir destiné à réfléchir les rayons solaires, S. Il reçoit les deux mouvements, horizontal et vertical, à l’aide de deux boutons, D et D′, qui agissent alternativement sur une vis et une roue C, de manière à amener les rayons du soleil dans l’axe de l’instrument. Ce porte-lumière est fixé dans le volet d’une chambre bien obscure. Le cliché, qui ne peut avoir plus de 8 centimètres de côtés est fixé dans un petit cadre E, introduit, par l’orifice M, dans le tube de l’instrument, et placé ainsi entre les deux lentilles. Ces deux lentilles achromatisées, H et I, qui peuvent, à l’aide de vis, se rapprocher ou s’éloigner du cliché, forment l’image sur un écran convenablement distant. Un diaphragme K, qui termine l’instrument, écarte la lumière diffuse.
Dans tous les appareils d’amplification des photographies à l’aide de la lumière solaire, le miroir réflecteur doit être mû à la main, à cause de la variation continuelle de direction des rayons lumineux, produite par la marche de la terre. On y substituera donc, avec grand avantage, un héliostat, c’est-à-dire un miroir mobile grâce à un mouvement d’horlogerie, et qui, suivant le soleil au fur et à mesure de son déplacement dans le ciel, envoie toujours ses rayons parallèles dans la même direction. Seulement, nous n’avons pas besoin de le dire, cet appareil de physique n’est pas à la portée de tous les acheteurs, en raison de son grand prix.
Il nous reste à parler de la préparation du cliché. Cette opération est assez délicate ; elle doit être faite habilement et promptement. On choisit d’abord un verre très-mince et offrant une surface parfaitement unie et polie ; le peu d’épaisseur est indispensable à la réussite de l’opération, parce qu’elle permet à la plaque de se dilater également dans tous les sens. On emploie le collodion humide, parce que c’est le seul corps qui donne une couche suffisamment transparente : c’est là, en effet, le point capital. Le collodion employé pour préparer ces clichés, n’a pas la même composition que celui qui sert aux opérations ordinaires de la photographie ; il ne contient que de l’iodure de cadmium. Ce collodion est un peu épais, mais il a l’avantage de se conserver très-longtemps. Le bain d’argent est le bain ordinaire ; il faut seulement éviter au sein de ce liquide, la présence de toute matière solide, organique ou minérale.
Le cliché, devant être parfaitement transparent, ne doit pas être vigoureux, ni fortement accusé ; il faut, au contraire, qu’il soit très-faible, quoique parfait dans les détails. On évitera donc, pour la formation du bain révélateur, l’emploi des acides citrique, tartrique ou acétique, en un mot de toutes les substances destinées à augmenter l’intensité du cliché.
Le bain révélateur est la dissolution ordinaire de sulfate de fer dans l’eau alcoolisée. Lorsqu’on le verse sur le cliché, il faut avoir soin de recouvrir ce dernier complétement et instantanément.
On reconnaît que le cliché est propre à l’amplification lorsqu’il ne laisse presque pas apercevoir au jour les détails ; on doit pouvoir lire à travers les noirs. S’il remplit ces conditions, on peut l’employer, mais sans le recouvrir d’une couche de vernis, qui pourrait, sous l’influence de la chaleur des rayons solaires, altérer l’image.
CHAPITRE XVIII
En 1858, un photographe de Manchester exécuta des photographies excessivement réduites, en adaptant à la chambre obscure un objectif qui produisait une toute petite miniature du cliché. Les photographies microscopiques furent la merveille de l’Exposition de photographie qui se tint, en 1859, au palais de l’Industrie. Elles attiraient l’attention générale, car elles donnaient la plus prodigieuse idée de la délicatesse des impressions photographiques, et confondaient véritablement l’imagination. C’était un imperceptible fragment de papier, de la grosseur d’une tête d’épingle, collé sur une lame de verre. À la vue simple on ne distinguait qu’un carré de papier, avec une tache noire au milieu ; mais si l’on regardait cette tache noire à travers un microscope grossissant deux à trois cents fois, une véritable photographie, très-nette et très-nuancée, apparaissait dans l’instrument.
L’une de ces photographies microscopiques renfermait le texte imprimé de la proclamation de l’empereur Napoléon III à l’armée d’Italie. Vue à l’œil nu, elle était comme un atome ; si on la regardait au microscope, on lisait : Soldats ! je viens me mettre à votre tête, etc.
Outre le photographe de Manchester, M. Wagner, M. Bernard et M. Nachet avaient présenté à l’Exposition de 1859, des échantillons de photographies microscopiques.
Mais la nécessité d’employer un microscope aurait empêché les photographies réduites de prendre aucune extension. Vers 1860, un photographe de Paris, M. Dagron, aborda cette question en face, et parvint à triompher de toutes les difficultés qu’elle présentait. Aujourd’hui, on trouve dans le commerce, en quantités considérables, des lorgnettes lilliputiennes, dans lesquelles on aperçoit des portraits, des monuments, des vues, quand on les interpose entre l’œil et la lumière. Ces petits bijoux se placent également dans une bague ou dans un porte-plume. Quand on dévisse la minuscule lorgnette, pour en examiner l’intérieur, on n’y voit qu’un point noir : c’est l’épreuve photographique, appliquée elle-même sur une petite tige de verre bombée, longue de 5 à 6 millimètres, et grosse comme une allumette de cire. C’est ce bout de baguette de verre qui fait fonction de microscope, pour agrandir et rendre visible l’épreuve photographique.
Par quel procédé s’obtient cet infiniment petit, qu’il faut obtenir parfait du premier coup, parce qu’ici toute retouche est impossible ? C’est ce que nous allons expliquer.
Les épreuves s’obtiennent par le procédé à l’albumine, qui, seul, donne les grandes finesses indispensables au cliché.
Le cliché que l’on prépare pour le réduire à des dimensions microscopiques, est à peu près de la grandeur d’une carte de visite photographique ; on le réduit à l’état microscopique au moyen d’une lentille biconvexe à très-court foyer. L’image reçue dans une chambre noire, vient impressionner une plaque de verre collodionnée, de 2 centimètres de hauteur sur 7 centimètres ½ de longueur, sur laquelle se produisent à la fois, 20 photographies microscopiques, comme il sera expliqué plus loin. On fixe, par les procédés ordinaires, cette image qui, obtenue avec un cliché négatif, est positive. C’est ce petit cliché positif qui, découpé ensuite en petits fragments, fournit les bijoux photographiques.
Le mérite de M. Dagron, c’est d’avoir appliqué le microscope Stanhope à rendre visible cette miniature.
On appelle microscope Stanhope une demi-lentille obtenue simplement en coupant en deux un globule de cristal de crown. En appliquant sur une baguette de verre cette demi-sphère de cristal de crown, on obtient un microscope dont l’effet grossissant est de trois à quatre cents fois. M. Dagron eut donc l’idée de placer ces petites images microscopiques devant un microscope Stanhope, composé simplement d’une baguette de verre portant à l’un de ses bouts la petite calotte de crown. Il suffisait dès lors d’appliquer entre l’œil et la lumière la photographie ainsi disposée, pour agrandir et permettre de voir très-nettement l’épreuve lilliputienne.
Tel est le principe général des photographies microscopiques de M. Dagron. Seulement, la préparation de ces clichés en miniature est tellement en dehors des opérations habituelles de la photographie, qu’il a fallu créer tout un matériel et tout un outillage spécial. Autant il est facile de mettre l’image au foyer, dans la chambre obscure ordinaire. autant il est difficile d’y parvenir avec une épreuve de la dimension d’un grain de sable. Pour cette mise au point, l’œil ne suffit pas, il faut un microscope. C’est ainsi que M. Dagron a dû modifier complétement les appareils photographiques, pour les appliquer à ce cas spécial. Voici en quoi ses appareils consistent.
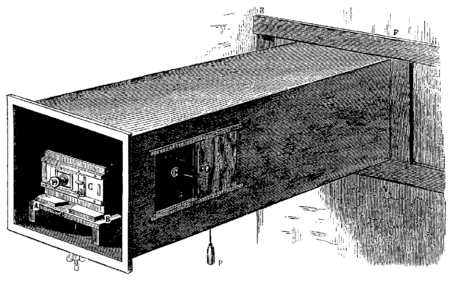
Le châssis qui, dans la chambre obscure ordinaire des photographes, doit recevoir la glace collodionnée, est remplacé par un support métallique AB (fig. 81), qui, outre la glace collodionnée, porte 20 petits objectifs devant produire à la fois vingt réductions microscopiques de ce cliché ; ces vingt épreuves seront séparées plus tard, en coupant avec un diamant, la lame de verre en vingt fragments. Sur ce même support A B, sont les verres et le tuyau d’un microscope composé, D, destiné à diriger la mise au point.
Les objectifs qui doivent produire les réductions microscopiques, sont placés, à l’intérieur de la chambre obscure, en regard et à une assez grande distance du cliché à reproduire. Après ces objectifs, vient la petite glace collodionnée, sur laquelle se peint l’image réduite formée par les objectifs. Des diaphragmes, qui diminuent la quantité de lumière, donnent une grande netteté à l’image. Une crémaillère et des roues dentées permettent de faire avancer ou reculer les objectifs pour exécuter la mise au point.
Tous ces petits organes, c’est-à-dire les objectifs formant les épreuves réduites, la glace collodionnée, qui doit recevoir les images microscopiques, sont à l’intérieur de l’appareil. C’est au dehors que se trouve, le microscope D, qui sert à effectuer la mise au point.
Quand on veut opérer, on dispose l’appareil en face d’une fenêtre, et l’on place le cliché négatif à l’extrémité EF de la chambre obscure, on lève l’obturateur, et l’on reçoit, pendant deux ou trois secondes, la lumière qui traverse le cliché, et vient peindre sur la plaque de verre collodionnée, les vingt images microscopiques.
Pour exécuter la mise au point, on introduit la main dans l’ouverture latérale X, qui est pratiquée sur une des parois de la chambre noire, et en manœuvrant la crémaillère qui fait avancer ou reculer les objectifs, on met l’image bien au foyer. Quand la mise au point est obtenue, on ferme cette ouverture latérale, en tirant la porte X, qui se meut dans une coulisse.
Après cette explication générale de la figure 81, qui représente la chambre obscure microscopique de M. Dagron, le lecteur comprendra mieux la figure 82, qui donne une coupe intérieure du même appareil.

| A | photographie servant de modèle. |
| B | 20 objectifs microscopiques opérant à la fois. |
| CE | emplacement de la glace collodionnée sur laquelle se produisent les images microscopiques. |
| D | microscope et micromètre servant à mettre au point |
| E | support de l’appareil maintenu par une vis. |
| F | diaphragme. |
| G | interrupteur mobile au moyen d’une corde à poids, P (fig. 81), pour arrêter les rayons lumineux pendant le changement de glace. |
Dans son ensemble l’appareil de M. Dagron consiste, comme il vient d’être dit, en une caisse de bois formant une chambre noire très-allongée ; car, pour donner une image microscopique, le cliché doit être placé à une grande distance de l’objectif. Le cliché qu’il s’agit de réduire, se place donc à l’extrémité de cette chambre obscure, dans le cadre A, que l’on dispose au grand jour, en face d’une fenêtre. Les rayons lumineux parallèles, qui traversent ce cliché, après avoir été arrêtés en partie, par le diaphragme G, à l’intérieur de la chambre noire, viennent se réfracter dans chacun des vingt objectifs portés par la pièce B. La glace collodionnée est placée derrière le châssis CE, à l’intérieur de la boîte. D est le microscope composé qui sert à mettre l’image au point.
Cette mise au point ne se fait pas avec l’image même qu’il s’agit de reproduire, mais en regardant, à travers le microscope D, un micromètre, c’est-à-dire une lame de verre sillonnée de raies microscopiques égales et parallèles. Lorsque, après avoir fait convenablement avancer ou reculer la pièce B, qui porte les vingt objectifs, on voit distinctement les raies du micromètre, on est certain que l’on est bien au foyer. Alors on remplace le micromètre par la glace collodionnée, et en enlevant l’obturateur on laisse arriver la lumière sur la plaque sensible.
Après une très-rapide exposition à la lumière on retire du châssis la glace impressionnée et on la porte dans le laboratoire, pour développer l’image.
Ce développement se fait à la manière ordinaire, dans un bain composé d’acides gallique et pyrogallique, dissous dans de l’eau alcoolisée. On place dans une cuvette contenant le bain révélateur, les glaces sortant de la chambre obscure ; pour faciliter le développement, on ajoute quelques gouttes d’une dissolution d’azotate d’argent.
On ne pourrait suivre à l’œil nu le développement de l’image, il faut faire usage d’une loupe, c’est-à-dire d’une lentille simple, garnie d’une monture (fig. 83). Il faut suivre le développement à la loupe, sur chaque glace et sur chaque image.

Quand l’épreuve est satisfaisante, on la lave et on la fixe à la manière ordinaire, c’est-à-dire à l’hyposulfite de soude. L’épreuve, après avoir été convenablement lavée, est terminée ; c’est ce petit cliché de verre qui formera le bijou microscopique.
La loupe ne suffirait pas pour s’assurer que l’image est parfaite et peut être conservée ; il faut la regarder avec un microscope composé : on place donc la glace portant les vingt épreuves sur le porte-objet d’un microscope composé (fig. 84), et l’on choisit ainsi celles qui paraissent irréprochables.
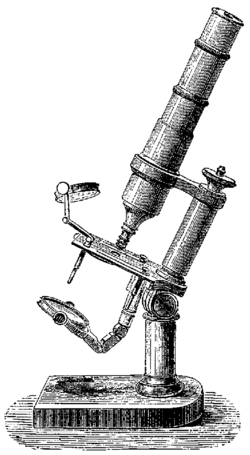
Les épreuves étant choisies, on découpe, avec un diamant : la lame de verre de 2 centimètres de hauteur sur 7 centimètres ½ de longueur sur laquelle sont formées les 20 épreuves, en petits carrés portant chacun une épreuve.
Il s’agit maintenant d’appliquer ces petits carrés de verre porteurs de l’image, sur le microscope Stanhope ou le Stanhope, comme on l’appelle plus simplement, et qui consiste, comme nous l’avons dit, en une baguette de verre portant une petite calotte de cristal de crown, pour produire un effet grossissant. Le baume de Canada qui, en raison de sa parfaite transparence, est employé par les opticiens pour coller ensemble les verres des lentilles achromatiques, est la substance adhésive dont se sert M. Dagron pour fixer à l’autre bout du stanhope les petits carrés de verre porteurs de l’épreuve photographique.
On place le stanhope au bord d’un fourneau un peu chaud, on dépose une goutte de baume de Canada sur cette surface ainsi légèrement chauffée, puis, prenant avec des pinces le petit carré de verre, on le presse, doucement d’abord, fortement ensuite, contre la base enduite de baume, et on l’abandonne à lui-même.
Pour s’assurer que l’opération a bien réussi, que le contact est parfait et sans bulles d’air interposées, on regarde par l’extrémité arrondie de la baguette de verre, qui, faisant fonction de microscope, montre, agrandie et distincte, l’image fixée à sa base. Si des bulles d’air se montrent encore, c’est qu’on n’a pas assez appuyé le verre, ou qu’on ne l’a pas pressé assez également contre la base du stanhope ; on le place donc un instant près du fourneau, pour rendre au baume de Canada un peu de fluidité, et l’on recommence le collage avec plus de précaution.
Alors le stanhope et l’épreuve photographique ne font plus qu’un seul tout. Il ne reste, pour terminer ce travail, qu’à arrondir les points de jonction du stanhope et de l’épreuve. La meule de l’opticien peut suffire pour cet usage ; mais quand on a un grand nombre de verres à user, il faut se servir, au lieu d’une simple meule, du tour de l’opticien, qui est infiniment plus commode et plus efficace.
Il est peut-être nécessaire d’ajouter que M. Dagron a presque toujours le soin, quand il s’agit d’un bijou à enchâsser sur une bague, un porte-plume, de faire usage de deux microscopes Stanhope et de deux épreuves photographiques. On aurait pu, en effet, se tromper de côté, et alors n’apercevoir aucune image. En plaçant une photographie avec son microscope de chaque côté de la bague ou du porte-plume, on est certain, de quelque manière que l’on regarde, qu’on apercevra toujours une image.
Tels sont les procédés, bien intéressants, on le voit, qui ont permis à M. Dagron de créer les petites merveilles que chacun connaît, d’exécuter ces photographies qui se portent sur le chaton d’une bague, qui s’enchâssent dans un crayon ou un porte-plume. Rien de plus curieux que le petit musée que possède M. Dagron. Le mystère joue un certain rôle dans ces miniatures imperceptibles : il y a plus d’un secret, il y a plus d’un roman, dans ces portraits qui se cachent dans une broche ou sous le chaton d’une bague.
On a pensé qu’en temps de guerre, les généraux pourraient écrire de cette manière, leurs ordres et messages secrets. L’envoyé n’aurait aucune peine à cacher cette imperceptible dépêche, que le général qui la recevrait, pourrait lire, en connaissant la manière de s’y prendre.
Voilà une application de la photographie microscopique à laquelle la guerre a fait songer ; mais ne doutez point, cher lecteur, qu’il n’y en ait de plus utiles et de plus importantes pour le bien de l’humanité.
CHAPITRE XIX
Après avoir présenté l’histoire de la photographie et décrit ses procédés pratiques, il nous reste à signaler les applications principales qu’elle a reçues.
Au premier rang de ces applications se place la gravure.
La transformation en planches propres à la gravure, des épreuves photographiques, obtenues sur métal, comme le faisait Daguerre, ou formées sur verre et sur papier, comme on l’a fait après lui, est, au fond, le véritable objet de la photographie. Cet art n’aura atteint son véritable degré d’importance et d’utilité, que lorsqu’il aura fourni le moyen de préparer, avec une épreuve obtenue par l’action de la lumière, une planche propre à servir à de très-nombreux tirages sur pierre ou sur métal, avec de l’encre d’impression. La photographie aura touché ses colonnes d’Hercule lorsqu’elle aura trouvé le moyen de transporter ses négatifs sur cuivre ou sur acier, de manière à faire mécaniquement le tirage des épreuves positives sur papier, comme on le fait pour la lithographie et la gravure.
Cette vérité a été comprise de très-bonne heure. Aussi, depuis l’origine de la photographie, un grand nombre d’expérimentateurs sont-ils entrés dans cette voie. Ce n’est pourtant qu’après de très-longs efforts que le problème a pu être résolu. Il n’a pas fallu moins de dix-huit années de travaux pour arriver à transformer avec économie et facilité, les négatifs de la photographie en planches propres au tirage à l’encre d’impression. Encore ne peut-on dire que le problème soit aujourd’hui résolu d’une manière absolument satisfaisante et pratique.
L’idée de transformer les plaques photographiques en planches à l’usage des graveurs, était si naturelle, que ce vœu fut exprimé dès les premiers temps de la découverte de Daguerre. Chacun regrettait de voir ces merveilleuses images condamnées à rester à jamais à l’état de type unique ; tout le monde comprenait l’importance que devait offrir la transformation des plaques de Daguerre en planches propres à la gravure, et susceptibles, par conséquent, de suffire, grâce à l’impression typographique, à un tirage illimité. Savants, industriels et artistes, appelaient de leurs vœux ce perfectionnement.
Il y avait alors, dans la presse scientifique de Paris, un savant distingué et un écrivain habile : c’était le docteur Donné, aujourd’hui recteur de l’Académie de Montpellier. Comme nous tous, qui, par profession et par goût, surveillons le mouvement des choses scientifiques, M. Donné suivait avec l’intérêt le plus vif la marche et les progrès de l’invention admirable qui préoccupait alors le monde savant tout entier. Il essaya le premier de transformer les plaques daguerriennes en planches propres à la gravure. À l’aide de l’acide chlorhydrique convenablement étendu, il parvenait, en opérant sur une plaque daguerrienne, à attaquer le métal, de manière à obtenir une planche susceptible de fournir des épreuves sur papier, par le tirage en taille-douce.
Il y avait pourtant, dans la nature même d’une telle opération, des conditions qui devaient mettre obstacle à toute réussite. Le mercure, déposé inégalement sur la plaque de Daguerre, y forme une couche d’une ténuité infinie ; le calcul seul peut donner une idée des faibles dimensions de ce voile métallique. Les inégalités de surface que l’acide a pour effet de produire en agissant sur la plaque daguerrienne, ne peuvent donc montrer qu’un très-faible relief, et cette circonstance fait comprendre les défauts que devaient présenter, sous le rapport de la vigueur, les gravures obtenues par ce moyen. D’ailleurs, la mollesse de l’argent limitait extraordinairement le tirage ; on ne pouvait obtenir ainsi plus de quarante ou cinquante épreuves, et la gravure était toujours fort imparfaite.
M. Fizeau réussit à perfectionner ce moyen par trop élémentaire. Voici un aperçu du procédé, assez compliqué, qui fut imaginé par ce physicien, pour la gravure des plaques daguerriennes.
On commence par soumettre la plaque à l’action d’une liqueur légèrement acide, qui attaque l’argent, c’est-à-dire les parties noires de l’image, sans toucher au mercure, qui forme les blancs. On obtient ainsi une planche gravée d’une certaine pureté, mais d’un très-faible creux. Or, la condition essentielle d’une bonne gravure, c’est la profondeur du trait ; car si les creux sont trop légers, les particules d’encre, au moment de l’impression, surpassant en dimension la profondeur du trait, ne peuvent pénétrer dans les creux, et l’épreuve, au tirage, est nécessairement imparfaite. Pour creuser plus avant, M. Fizeau frottait la planche gravée et peu profonde d’une huile grasse, qui s’incrustait dans les cavités et ne s’attachait pas aux saillies. On dorait ensuite la plaque à l’aide de la pile voltaïque. L’or venait se déposer sur les parties saillantes, et ne pénétrait pas dans les creux, abrités par le corps gras. En nettoyant ensuite la planche, on pouvait l’attaquer profondément par l’eau-forte, car les parties saillantes recouvertes d’or étaient respectées par l’acide. On creusait ainsi le métal à volonté. Enfin, comme la mollesse de l’argent aurait limité singulièrement le tirage, on recouvrait la planche d’une couche de cuivre, par la galvanoplastie. Le cuivre, métal très-dur, supportait donc seul l’usure déterminée par le tirage.
M. Fizeau obtint de cette manière des gravures offrant beaucoup de qualités. Cependant les moyens qu’il mettait en usage étaient trop compliqués pour être adoptés dans la pratique. Son procédé demeura donc infructueux dans les mains du cessionnaire de son brevet.
Sur ces entrefaites, un événement de la plus haute importance dans l’histoire de la photographie vint détourner les esprits de ce genre de recherches : ce fut la découverte de la photographie sur papier. Cette découverte imprima aux idées des opérateurs une direction toute différente, et suspendit un moment les travaux entrepris pour la transformation des épreuves daguerriennes en planches de gravure. La singulière perfection des produits de cette branche nouvelle des arts photographiques, et les efforts qu’il avait fallu exécuter pour y atteindre, absorbèrent longtemps l’attention des amateurs et des artistes. D’ailleurs, la photographie sur papier, une fois connue, parut devoir rendre inutile la gravure des épreuves. Elle permet, en effet, d’obtenir, avec un premier type, l’épreuve négative, un nombre presque indéfini d’épreuves positives. Le problème de la gravure photographique semblait donc avoir perdu une grande partie de son utilité.
Il ne manquait pas néanmoins de bonnes raisons à opposer aux personnes qui prétendaient que la photographie sur papier permettrait de se passer de la gravure photographique. Le tirage d’une épreuve positive est toujours une opération délicate, et malgré tous les perfectionnements apportés à cette partie du manuel photographique, il est bien difficile qu’elle puisse jamais devenir industrielle. Aussi les bonnes épreuves sur papier sont-elles maintenues, dans le commerce, à un prix assez élevé pour leur faire perdre une partie de la supériorité qu’elles présentent sur les produits de la lithographie ou de la gravure.
Une autre raison à invoquer, c’est le défaut de stabilité des épreuves photographiques. On sait que les images sur papier, si l’on en excepte celles qui ont été tirées par le procédé au charbon, pâlissent manifestement, par une exposition de plusieurs années à la lumière, et qu’elles pourraient disparaître en entier par suite d’une exposition plus prolongée à la même influence. Ce genre d’altération provient de ce que, malgré la continuité des lavages à l’eau distillée, qui doivent terminer l’opération, le papier retient toujours une certaine quantité d’hyposulfite de soude : la présence de quelques traces de ce sel suffit pour provoquer, au bout d’un temps plus ou moins long, la transformation de l’argent en sulfure, puis en sulfate, et finalement la disparition de l’image.
Mais toutes ces raisons n’auraient peut-être que médiocrement touché la laborieuse tribu des photographes, sans une autre circonstance, qui vint contribuer, plus que toute autre, à ramener l’attention vers la gravure.
La photographie sur papier est parvenue aujourd’hui à une telle perfection, qu’il est bien difficile qu’elle aille beaucoup plus loin ; il est permis de dire que cet art merveilleux a atteint son apogée. La certitude de ce fait était, pour les photographes, l’incitation la plus puissante à chercher quelque création nouvelle. Dire à la photographie, l’art progressif par excellence, qu’elle a atteint ses limites dernières, qu’elle n’a plus rien à inventer, et qu’elle doit se borner à l’avenir à répéter docilement les pratiques que l’expérience a consacrées, c’était la pousser à de nouvelles conquêtes. Quand une fois il fut bien démontré que la photographie n’avait plus rien à demander à ses laborieux adeptes, tout aussitôt on décida, d’une voix unanime, qu’il fallait attaquer le dernier problème, c’est-à-dire la gravure des épreuves.
Ce problème présentait de grandes difficultés. On ne pouvait songer à graver avec la plaque daguerrienne ; la non-réussite de M. Fizeau montrait qu’il n’y avait rien à attendre de ce côté. Mais il restait les épreuves sur papier. Il n’était pas impossible de transporter sur le cuivre ou l’acier, l’empreinte d’un cliché sur verre, et cette empreinte, si elle était composée d’une substance inattaquable par l’eau-forte, pouvait permettre d’obtenir une planche gravée sur métal.
C’était là une idée excellente. Aussi vint-elle en même temps à deux habiles praticiens, à M. Talbot et à M. Niépce de Saint-Victor. En faisant usage de bichromate de potasse comme matière impressionnable à la lumière, M. Talbot parvint à graver sur acier, au moyen d’une épreuve photographique, des objets transparents. Mais il ne put obtenir ainsi que des silhouettes d’objets laissant tamiser la lumière, tels que feuilles d’arbre, découpures, dentelles, etc. ; il ne réussit point à reproduire les ombres. Son procédé ne pouvait donc s’appliquer à la gravure des images photographiques.
M. Niépce de Saint-Victor fut plus heureux ; seulement il n’eut pas besoin de se mettre en frais d’imagination. Nicéphore Niépce, son parent, avait, comme nous l’avons raconté, réussi à graver sur étain les images formées dans la chambre obscure. M. Niépce de Saint-Victor se borna à appliquer le même procédé pour graver, sur acier, une épreuve de photographie. Voici donc le procédé que fit connaître, en 1853, M. Niépce de Saint-Victor, pour transporter sur acier un cliché photographique.
On étend sur la surface bien polie d’une plaque d’acier, une couche de bitume de Judée, dissous dans l’essence de lavande. Ce vernis, exposé à une chaleur modérée, se dessèche ; on le maintient ensuite à l’abri de la lumière et de l’humidité. Pour obtenir sur la plaque ainsi préparée, la reproduction d’une épreuve photographique, on prend une épreuve positive obtenue sur verre, ou bien sur papier ciré, et par conséquent transparente. On applique cette épreuve positive contre la plaque métallique, et l’on expose le tout à la lumière solaire ou diffuse, pendant un quart d’heure pour le premier cas, une heure pour le second. Au bout de ce temps, la lumière, traversant les parties diaphanes du dessin, a modifié la substance résineuse qui recouvre la plaque. Si on lave alors cette plaque avec un mélange formé de trois parties d’huile de naphte et d’une partie de benzine, on fait disparaître, en les dissolvant, les parties de l’enduit résineux que la lumière n’a pas touchées, c’est-à-dire les parties qui correspondent aux noirs de l’épreuve photographique.
On a produit de cette manière, une planche d’acier, sur laquelle le dessin de l’image photographique est retracé à l’aide d’une légère couche de bitume de Judée, qui correspond aux parties éclairées de l’image. Par conséquent, si l’on traite cette planche par l’eau-forte, on attaque l’acier dans les parties non abritées par le corps résineux, et l’on obtient une planche en creux qui, plus tard, encrée et soumise au tirage, donne un nombre indéfini d’épreuves sur papier, parfaitement identiques avec le modèle photographique.
Les premières gravures obtenues par le procédé de M. Niépce de Saint-Victor, étaient loin d’être parfaites. Si elles présentaient quelquefois une certaine délicatesse dans les traits, elles offraient beaucoup d’empâtements grossiers dans les ombres. Ce n’étaient guère que des ébauches, qui exigeaient, pour être terminées, le secours du burin.
M. Niépce de Saint-Victor a perfectionné ses premiers essais, en modifiant la nature et les proportions des dissolvants employés pour enlever les parties du bitume non impressionnées par la lumière. En ajoutant à ce bitume divers composés organiques, tels que l’éther sulfurique ou diverses essences, il est parvenu à abréger le temps de l’exposition à la lumière. C’est ainsi qu’il a réussi à impressionner, dans la chambre obscure même, la plaque d’acier revêtue de l’enduit sensible de bitume de Judée.
Toutefois, le but que s’était proposé l’auteur de ces recherches, et qu’il a poursuivi pendant plusieurs années, n’a pas été atteint d’une manière complète. Le problème de la gravure photographique exige que la planche métallique gravée, s’obtienne par le seul concours de la méthode chimique, et sans que l’on ait recours au travail ultérieur du graveur, à l’action du burin, pour corriger ou terminer la planche. Or, c’est là un résultat qui ne put être atteint par M. Niépce de Saint-Victor, Les planches sur acier, qu’il obtenait en suivant le procédé que nous venons de décrire, avaient toujours besoin, pour être terminées et pouvoir servir au tirage, de subir de longues retouches, un travail pénible et compliqué de la part du graveur. Les frais qui en résultaient, rendaient très-dispendieux ce procédé de gravure.
C’est en 1856 que le problème de la gravure photographique reçut sa véritable solution. Le peu de succès pratique obtenu par la méthode de M. Niépce de Saint-Victor, avait jeté sur ce genre de recherches une défaveur marquée, lorsque la découverte de M. Alphonse Poitevin, relative à l’action de la lumière sur les chromates mélangés de substances gommeuses ou gélatineuses, vint prouver que les difficultés, regardées jusque-là comme insurmontables, pouvaient être levées. La gravure photographique entra, dès ce moment, dans une phase toute nouvelle.
C’est à partir de l’année 1856 que commence, on peut le dire, la troisième époque historique de la gravure photographique, car les essais primitifs de l’ancien Niépce, et les efforts tentés, en 1853, par son neveu, M. Niépce de Saint-Victor, peuvent constituer les deux premières de ces trois périodes historiques.
C’est, en effet, en 1856, comme nous l’avons dit dans un précédent chapitre, que M. Alphonse Poitevin fit connaître la propriété que possède le mélange de matières gommeuse, gélatineuse, albumineuse ou mucilagineuse, quand on les a mêlées avec du bichromate de potasse, et qu’on les expose à l’action de la lumière, de pouvoir prendre et retenir l’encre d’impression. Cette observation était fondamentale ; elle devint le signal d’une foule de recherches, qui donnèrent la solution du problème général de la gravure héliographique. M. Poitevin en fit, lui-même, le premier l’application, en créant la photo-lithographie, c’est-à-dire l’art de transporter sur pierre une épreuve photographique, et de tirer les épreuves avec l’encre lithographique, comme une lithographie ordinaire.
Sur une pierre convenablement grainée, on dépose un mélange d’albumine et de bichromate de potasse ; on place par-dessus, le cliché négatif d’une épreuve photographique sur verre, et on expose le tout à la lumière ; l’agent lumineux modifie les parties de la pierre qu’elle touche, de telle façon que l’encre n’adhère que sur les parties éclairées. Le tirage s’opère ensuite comme pour une lithographie ordinaire.
M. Poitevin, comme nous l’avons dit dans l’histoire générale de la photographie, fit cette autre découverte importante, que la gélatine mélangée de bichromate de potasse, ne peut plus se gonfler par l’eau lorsqu’elle a été frappée par la lumière ; tandis que les parties non influencées par l’agent lumineux, se gonflent rapidement, en absorbant l’eau. En prenant une empreinte de cette gélatine ainsi gonflée inégalement, et reproduisant ce moulage de gélatine en une planche de cuivre par la galvanoplastie, on arrive à former d’assez bonnes planches pour la gravure en taille-douce ou la typographie.
Tel est le principe des procédés qui ont servi à créer, entre les mains de M. Alphonse Poitevin, la photo-lithographie et la gravure héliographique, et tel fut le point de départ de l’invention qui nous occupe. Le procédé primitif de M. Poitevin a été singulièrement perfectionné, mais il est juste de proclamer les droits du véritable créateur de cet art.
M. Ch. Nègre est un autre inventeur, longtemps admiré à juste titre, et qui pourtant a fini, comme M. Poitevin, par se laisser distancer. Pendant dix ans on a admiré des gravures héliographiques dues à M. Nègre, vraiment magnifiques comme finesse et comme grandeur ; mais la persistance de cet artiste à tenir ses procédés secrets, son peu de désir de rendre son œuvre publique pour la voir s’améliorer en d’autres mains, l’ont privé des avantages qu’il aurait pu recueillir en suivant une autre voie.
Le procédé de M. Nègre consiste dans l’emploi de certains agents chimiques dont l’auteur s’est réservé le secret. Il se sert aussi de bitume de Judée, mais cette substance ne joue ici qu’un rôle accessoire : elle ne sert qu’à ménager une réserve transitoire, qui permet de dorer, par la pile, toutes les parties qui ne doivent pas être attaquées par les acides. Cette dorure étant faite, on enlève le bitume avec de l’essence de térébenthine, et la planche présente alors l’apparence d’une damasquinure, dans laquelle les parties dorées forment les blancs, tandis que les parties mises à nu, restent seules exposées à la morsure des acides. La planche d’acier ainsi obtenue sert ensuite au tirage en taille-douce.
M. Baldus s’applique, depuis longtemps, à la solution du problème de la gravure héliographique, et il l’a parfaitement résolu, si l’on en juge par les spécimens de gravure photographique qui accompagnent ces pages des Merveilles de la science (fig. 85, 86, 87, 88), et qui ont été préparées par M. Baldus, en cuivre de relief, nécessaire pour le tirage typographique.




M. Baldus a fait usage de plusieurs procédés dans les recherches qu’il a consacrées, pendant plus de quinze ans, au problème de la gravure photographique. Il s’est d’abord servi de la galvanoplastie, qu’il supprime complétement aujourd’hui.
C’est en 1854 que M. Baldus avait recours à la galvanoplastie pour reproduire les finesses des épreuves photographiques. Comme nous avons, à cette époque, aidé M. Baldus de nos conseils scientifiques, dans ses opérations de galvanoplastie, nous pouvons décrire avec exactitude, le procédé dont il faisait alors usage. Voici donc ce procédé.
On prend une lame de cuivre, sur laquelle on étend une couche de bitume de Judée. À cette lame de cuivre recouverte de la résine impressionnable, on superpose une épreuve photographique sur papier transparent, de l’objet à graver. Cette épreuve est positive, et doit, par conséquent, se traduire en négatif sur le métal, par l’action de la lumière. Au bout d’un quart d’heure environ d’exposition au soleil, l’image est produite sur l’enduit résineux ; mais elle n’y est point visible. On la fait apparaître, en lavant la plaque avec un dissolvant, qui enlève les parties non impressionnées par la lumière, et laisse voir une image négative, représentée par les traits résineux du bitume.
Cependant le dessin est formé d’un voile si délicat et si mince, qu’il ne tarderait pas à disparaître en partie, par le séjour de la plaque au sein du liquide. Pour lui donner la solidité et la résistance convenables, on l’abandonne pendant deux jours, à l’action de la lumière diffuse. Le dessin ainsi consolidé, on plonge la lame de métal dans un bain galvanoplastique de sulfate de cuivre, et voici maintenant les merveilles de ce procédé. Attachez-vous la plaque au pôle négatif de la pile, vous déposez sur les parties du métal non défendues par l’enduit résineux, une couche de cuivre en relief ; la placez-vous au pôle positif, vous creusez le métal aux mêmes points, et formez ainsi une gravure en creux. Si bien qu’on peut à volonté, et selon le pôle de la pile auquel on s’adresse, obtenir une gravure en creux ou une gravure en relief ; en d’autres termes, une gravure à l’eau-forte, pour le tirage en taille-douce, ou une gravure de cuivre en relief, analogue à la gravure sur bois, pour le tirage à l’encre d’impression.
Aujourd’hui, disons-nous, M. Baldus a complétement supprimé la galvanoplastie. Quelques minutes lui suffisent pour rendre les planches de cuivre dont il se sert, en état de servir au tirage en taille-douce.
C’est au moyen d’un sel de chrôme, sans aucun emploi de bitume de Judée, que M. Baldus rend impressionnable à la lumière la lame de cuivre. Sur une lame de cuivre ainsi rendue impressionnable, on applique le cliché de verre portant la photographie à reproduire, et on expose le tout à l’action de la lumière. Après l’exposition lumineuse, on place la lame de cuivre portant la couche impressionnée dans une dissolution de perchlorure de fer, qui attaque la lame de cuivre dans les points qui n’ont pas été influencés par la lumière ; et l’on obtient ainsi un premier relief.
Comme ce relief ne serait pas suffisant, on l’augmente, en replaçant la lame de cuivre dans le mordant de perchlorure de fer, après avoir passé sur le métal un rouleau d’encre d’imprimerie. L’encre s’attache aux parties en relief et les défend de l’action du mordant. On peut, en répétant ce traitement, donner aux traits de la gravure la profondeur que l’on désire.
Si l’on a fait usage d’un cliché photographique négatif, on obtient une impression en creux, nécessaire pour le tirage en taille-douce. Pour obtenir une planche de cuivre en relief, destinée au tirage typographique, dit sur bois, on prend un cliché positif, et les traits du métal sont en relief.
C’est par un procédé du même ordre que celui que nous venons de décrire, qu’opère M. Garnier.
Le jury de l’Exposition universelle de 1867 a décerné à M. Garnier le grand prix de photographie pour les gravures héliographiques qu’il avait présentées.
M. Garnier n’avait pas soumis au jury un grand nombre, une grande variété d’échantillons de gravures héliographiques, mais il avait produit un chef-d’œuvre ; c’était la Vue du château de Chenonceaux, véritable gravure provenant d’une simple épreuve de photographie d’après nature. Rien ne pouvait faire distinguer, à l’aspect, cette héliographie, d’une gravure ordinaire.
M. Garnier a bien voulu préparer, pour les Merveilles de la science, une planche de cuivre en relief, faite d’après nature (fig. 89), et que nous donnons comme spécimen des résultats que peut obtenir cet éminent opérateur. Il ne s’agit pas ici de la simple reproduction d’une gravure, mais de la transformation directe en gravure de la vue photographique d’un monument, prise dans la chambre noire.

M. Drivet est un autre graveur qui s’est attaché à la même question. Il s’est préoccupé surtout de la manière d’exécuter le grain, qui lui paraît indispensable dans toute gravure, et voici le procédé qui permet à M. Drivet d’obtenir, avec un cliché photographique, des gravures en taille-douce.
On impressionne, à travers un cliché photographique, une planche métallique, sensibilisée au moyen d’un sel de chrôme, mélangé d’une matière organique soluble, mucilagineuse ou gommeuse, et de glycérine, cette dernière substance étant destinée à former le grain de la gravure. Le cliché photographique reçoit ainsi, en même temps que l’image de l’objet, le grain destiné à retenir l’encre sur la planche gravée.
L’opération totale consiste : 1o à étendre sur le métal le mélange impressionnable de sel de chrôme, de matière albumineuse et de glycérine ; — 2o à exposer à la lumière sous le cliché ; — 3o à faire dissoudre dans l’eau chaude les parties non impressionnées par la lumière ; — 4o à placer la lame de métal, rendue conductrice de l’électricité par la plombagine, dans un bain galvanoplastique, pour la couvrir de cuivre ; — 5o l’épaisseur nécessaire de cuivre une fois obtenue, à enlever avec de l’eau et en frottant avec une peau, la matière qui a servi à former le grain de la gravure et qui était restée dans le creux. La planche est alors prête à servir à l’impression.
Les deux genres de gravure employés dans l’industrie, c’est-à-dire l’impression en taille-douce et l’impression en relief, peuvent être obtenus indifféremment, par ce procédé. Pour la gravure en taille-douce, il faut que le cliché photographique soit négatif ; pour la gravure typographique, il faut que le cliché soit positif.
Nous avons encore à signaler un procédé de transformation des photographies en gravures, imaginé par M. Tessié du Motay. L’auteur avait envoyé de nombreux spécimens de ses produits à l’Exposition universelle de 1867.
M. Tessié du Motay n’opère pas en prenant pour support des images à reproduire, les pierres lithographiques ou les métaux. En effet, dit M. Tessié du Motay, la pierre et le métal doivent être revêtus, pour commencer les opérations, d’une couche de substance impressionnable ; or, cette couche, quelque mince qu’on puisse la supposer, donne nécessairement lieu à une déviation des rayons lumineux, et par suite à une déformation de l’image, qui se transmettra au papier par l’intermédiaire des encres grasses. En outre, les métaux et les pierres ne peuvent happer les encres grasses qu’à la condition d’être grainés chimiquement ou mécaniquement. Or, le grainage, si fin qu’il puisse être, met à nu les parties cristallines du métal ou de la pierre, dont les dimensions dépassent de beaucoup celles des points dont sont formées les photographies au sel d’argent, et changent, par conséquent, en image discontinue, mal venue, confuse, l’image si parfaite dessinée par la lumière.
Quoi qu’il en soit de cette théorie, M. Tessié du Motay remplace les métaux et les pierres par des substances d’une autre nature, permettant, en raison de la ténuité et de la continuité de leurs pores, une impression aux encres grasses, sans grain, naturel ou artificiel. Un mélange de colle de poisson, de gélatine et de gomme, étendu en couche uniforme sur une plaque métallique bien dressée, additionné, préalablement, d’un sel de chrôme impressionnable à la lumière ; tel est le mélange que M. Tessié du Motay emploie pour recevoir l’influence lumineuse.
L’effet de la lumière sur ce mélange, c’est de rendre insolubles les parties touchées par les rayons lumineux. Cet effet se produit d’autant mieux, que la couche impressionnable est portée à une température plus élevée au-dessus de celle du milieu ambiant. Il faut donc chauffer, pendant une ou plusieurs heures, les plaques métalliques recouvertes du mélange impressionnable, dans une étuve, dont la température soit maintenue à 50 degrés environ. Sans cette opération, les couches de colle de poisson, de gélatine et de gomme ne soutiendraient pas l’action du rouleau imprimeur.
Lorsque les planches métalliques recouvertes de la couche sensible, ont été exposées, pendant un temps suffisant, à une température de 50 degrés, on les soumet à l’action de la lumière, sous un cliché négatif. Le temps de pose varie avec l’état du jour et de la saison. Le temps de production des images par la lumière est le même que pour les images au chlorure d’argent.
Quand les plaques ont été impressionnées, elles sont soumises d’abord à un lavage prolongé, puis desséchées à l’air libre ou à l’étuve. Ainsi préparées, elles sont aptes à recevoir l’impression aux encres grasses, soit par le tampon, soit par le rouleau.
Dans cet état, la planche destinée à recevoir l’impression ressemble, dit M. Tessié du Motay, à un moule à surface ondulée ; on dirait une planche gravée à l’aqua-tinta, mais sans grains comme dans ces sortes de planches. Pour remplacer le grain absent, c’est l’eau contenue dans les pores de la couche non insolée qui éloigne les corps gras des blancs restés à nu ; tandis que les parties devenues insolubles, c’est-à-dire les creux de la planche, retiennent les encres grasses. Ces planches participent donc tout à la fois des propriétés de la gravure et de la lithographie, et elles se trouvent produites par la synthèse des deux phénomènes, l’un physique, l’autre chimique, « dont l’invention est due, dit M. Tessié du Motay, rendant une justice éclatante à deux de ses devanciers, au double génie de Senefelder et de M. Poitevin. »
Les planches ainsi préparées peuvent, en moyenne, fournir un tirage de soixante-quinze épreuves. Passé ce nombre, les reliefs s’affaissent, les épreuves tirées sur papier deviennent moins vigoureuses et moins parfaites.
Cette limitation du tirage à un si petit nombre d’exemplaires, serait le côté défectueux de la nouvelle méthode d’impression, si, d’une part, le prix d’une couche peu épaisse, composée de colle de poisson, de gélatine, de gomme et de quelques milligrammes de sels de chrôme, n’était fort minime ; si, d’autre part, on ne suppléait sans peine à ce faible tirage par la possibilité, au moyen d’un clichage très-rapide, de multiplier indéfiniment les planches destinées à l’impression.
Voici comment on opère le clichage.
On étend sur verre, sur papier ou sur tout autre support, une couche de collodion additionnée de tannin. On impressionne par superposition sur un cliché négatif ou positif. Cette impression est instantanée à la lumière solaire, elle peut durer de une à quelques secondes à la lumière artificielle. L’image est ensuite relevée, développée et fixée au moyen des agents révélateurs et fixateurs aujourd’hui connus et employés en photographie. On prend une feuille et on la fait adhérer avec soin au collodion, sur lequel l’image du cliché est reproduite. La gélatine se colle au collodion et devient assez adhésive pour qu’on puisse enlever au verre ou au papier ce collodion, qui fait corps avec la gélatine desséchée.
Le cliché sur gélatine, ainsi produit, sert à son tour d’image positive ou négative pour reproduire de nouveaux clichés sans l’intermédiaire du verre ou de tout autre objectif transparent. Par cette méthode, on peut obtenir en un jour, soit à la lumière naturelle, soit à la lumière artificielle, plusieurs centaines de clichés, qui peuvent servir à la multiplication indéfinie des planches photographiques.
Le procédé de M. Tessié du Motay n’est pas entré dans la pratique, comme celui de MM. Baldus et Garnier. L’extrême complication et la longueur de ce procédé, l’expliquent suffisamment.
Nous venons de signaler, en parlant des travaux de MM. Poitevin, Nègre, Baldus, Drivet, Garnier et Tessié du Motay, les méthodes les plus récentes de gravure héliographique, celles qui sont appelées à introduire un jour ce procédé dans l’industrie. Mais à côté de ces résultats décisifs, définitifs, il est juste d’en signaler quelques-uns qui, pour être d’une importance secondaire, ne méritent pas moins d’être connus. Ils sont surtout l’œuvre des opérateurs étrangers, dont les produits ont pu être appréciés à l’Exposition universelle de 1867.
M. Pretsch, de Londres, disputa dans l’origine, c’est-à-dire en 1856, la découverte de la photo-lithographie par les chromates, à M. Alphonse Poitevin. Cette question de priorité n’a maintenant aucune importance. Contentons-nous de dire que M. Pretsch avait envoyé à l’Exposition universelle de 1867, de nombreux spécimens de gravures héliographiques obtenues par des procédés analogues à ceux de M. Poitevin.
M. Asser, d’Amsterdam, avait présenté des gravures héliographiques obtenues par un procédé qui lui est propre. Ce procédé consiste à faire agir la lumière sur un mélange de bichromate de potasse, d’amidon et de cellulose, mélange qui devient impénétrable à l’eau quand il a été frappé par la lumière. Le papier amidonné et chromaté, ayant reçu l’action de la lumière à travers le cliché photographique, est lavé, séché à une haute température, et remis en présence de l’eau, qui pénètre partout où le bichromate n’a pas été influencé par la lumière. Si l’on passe sur ce papier un rouleau chargé d’encre d’imprimerie, l’encre n’adhère qu’aux parties sèches, et laisse en blanc celles qui sont humides. Si l’on a employé une encre de report, il suffit de placer ce papier sur la pierre lithographique, pour y fixer un dessin, qui peut être tiré à un très-grand nombre d’exemplaires. Ce procédé diffère peu de celui de M. Alphonse Poitevin, qui emploie directement la pierre ; il est plus compliqué, et le report ne se fait pas sans altérer les finesses de l’image.
Nous n’avons pas vu, à l’Exposition, d’œuvres présentées personnellement par M. Asser, mais on pouvait les juger d’après les spécimens envoyés de Belgique par MM. Simonneau et Toovey, qui sont, si nous ne nous trompons, les cessionnaires du brevet de M. Asser, et qui ont fait subir au procédé de cet artiste des modifications pratiques et secondaires dans le détail desquelles nous n’entrerons pas.
S’il n’y a rien d’original dans les méthodes de ces deux artistes belges, on ne saurait en dire autant d’un système imaginé par un savant anglais, M. Woodbury, et qui apporte une donnée toute nouvelle dans le mode de tirage des épreuves photographiques.
M. Woodbury commence par se procurer une lame de gélatine présentant des reliefs et des creux, par le système de M. Alphonse Poitevin, auquel il joint l’artifice ingénieux, dû à M. l’abbé Laborde et à M. Fargier, qui consiste à laver la lame de gélatine du côté opposé à celui qui a reçu l’impression de la lumière. La lame de gélatine ainsi préparée est d’une dureté considérable. Elle est assez dure pour marquer son empreinte sans se briser et donner un moulage en creux, sur une feuille de plomb, par l’action de la presse.
On pouvait voir à l’Exposition, dans la vitrine de M. Woodbury, une de ces lames de plomb dans laquelle s’était incrustée, par la pression, la feuille de gélatine portant l’image photographique, et à côté, cette même feuille de gélatine, qui n’avait subi aucune dégradation.
C’est la feuille de plomb portant cette empreinte, qui sert directement au tirage des gravures photographiques. En plaçant sur cette feuille de plomb, de la gélatine mélangée de charbon, et tirant les épreuves sur papier, on obtient des images très-fines, très-nuancées, et qui ressemblent tout à fait à des épreuves photographiques ordinaires.
Il y a un effet physique bien extraordinaire dans cette plaque uniformément recouverte d’un enduit, lequel, étant transporté sur le papier, produit les effets de lumière, par la transparence de la gélatine noircie, là où elle n’existe qu’à une faible épaisseur, et l’effet des ombres là où la gélatine colorée existe en plus grande proportion.
Quoi qu’il en soit de cette explication du phénomène, le résultat est constant, et constitue un mode tout nouveau et très-ingénieux de tirage sur papier. Ce n’est ni de la gravure, ni de la lithographie. Nous croyons seulement que, comme on ne fait pas usage d’encre d’imprimerie, mais de gélatine simplement, mélangée de charbon, l’inaltérabilité et la longue durée d’épreuves ainsi obtenues, ne sont nullement garanties.
Nous venons de passer en revue les systèmes divers qui traduisent les efforts très-nombreux entrepris pour la solution du problème consistant à transformer une épreuve photographique en une planche gravée. Nous n’avons pas à nous prononcer sur la supériorité accordée à tel ou tel système. La question de la valeur comparative des méthodes aujourd’hui connues est sans intérêt pour le public. Ce qui est essentiel, ce qu’il importe de constater, c’est que la gravure des épreuves photographiques est un point à peu près résolu aujourd’hui.
Il résulte de là qu’une révolution complète se prépare en ce moment, non dans le principe de la photographie elle-même, à laquelle il faudra toujours recourir pour obtenir l’épreuve originale prise sur la nature, mais dans le mode de tirage des épreuves. Désormais, on pourra obtenir, grâce à la gravure héliographique, autant d’épreuves que l’on voudra, et ces épreuves seront aussi inaltérables que nos gravures sur cuivre ou sur acier, puisqu’elles seront tirées de la même façon. Au lieu de ces épreuves obtenues péniblement, une à une et à la main, avec un sel d’argent, on produira de véritables gravures. Alors le prix des photographies sera sensiblement diminué, puisqu’elles seront obtenues à très-grand nombre, à peu de frais. En même temps, résultat capital, ainsi tirées à la manière ordinaire des gravures, c’est-à-dire avec l’encre d’impression, elles seront absolument inaltérables et, comme les gravures ordinaires, d’une durée et d’une conservation illimitées. Le grand desideratum de la photographie est donc aujourd’hui presque entièrement réalisé.
Au moment où cette découverte, fruit de tant d’années de travaux, dus à divers opérateurs égaux en mérite et en zèle, va peut-être révolutionner toute une branche des arts, il est juste de rendre à tous ceux qui ont concouru à cette œuvre utile, l’hommage de reconnaissance qui leur est dû. Dans le récit qui précède, nous n’avons pas trouvé l’occasion de citer le nom d’un pauvre artiste, dont les travaux ne furent point sans influence sur la découverte de la gravure photographique, et qui s’occupa particulièrement de l’application de la galvanoplastie à la reproduction des planches héliographiques. Or, la galvanoplastie trouve une grande part dans quelques-uns des procédés que nous avons décrits concernant la gravure héliographique. En conséquence, nous ne devons pas négliger d’inscrire dans les dernières pages de ce récit le nom de cet artiste, aujourd’hui complètement oublié.
Si, au lieu d’enregistrer modestement les chroniques de la science du jour, nous aspirions à l’honneur d’écrire de beaux récits ou d’intéressantes histoires, nous aurions intitulé celle-ci : Hurliman, ou le Graveur à la jambe de bois.
En effet, Hurliman était graveur, et il avait une jambe de bois. Cette jambe de bois, on ne savait pas précisément où il l’avait gagnée, mais ni lui ni ses amis ne l’auraient donnée pour beaucoup. Elle servait d’interprète aux sentiments de son âme ; elle était comme le confident et le moyen d’expression de sa pensée. Hurliman était-il heureux, la jambe de bois s’en allait, bondissante et joyeuse, sur le pavé sonore, exprimant sa gaieté par toutes sortes de pas étranges et de sauts désordonnés. Était-il, au contraire, en proie à quelque sombre humeur, à quelque noire mélancolie, elle se traînait languissamment, morne et silencieuse, trahissant, par son allure désolée, les secrets sentiments de l’âme de son maître.
Ces jours de tristesse n’étaient d’ailleurs que trop fréquents, car Hurliman était pauvre de cette pauvreté qui touche à la misère ; et c’est là sans doute ce qui lui avait attiré l’amitié et la mélancolique sympathie de Charles Müller, graveur éminent, mort aussi, de son côté, du mal sinistre de la misère.
Ce dont Hurliman souffrait le plus en ce triste état, c’était d’être sevré des plaisirs communs de l’artiste. Il ne connaissait que par leurs titres, ces beaux livres et ces beaux recueils que le riche parcourt d’un œil distrait. En fait de jouissances artistiques, il ne connaissait guère que celles qui ne coûtent rien : les musées, les expositions publiques de peinture, aux jours non payants, et surtout ces grandes expositions gratuites que l’éclat de la nature offre chaque jour à l’admiration et à l’étude d’un artiste consciencieux.
Hurliman tenait dans ce groupe d’élite une place distinguée. Il exerçait avec un talent remarquable cet art aux mille formes qui s’appelle la gravure ; et comme tous les artistes qui, par état, sont obligés de faire l’éducation de leurs doigts, il était d’une adresse rare. Il ne connaissait point d’égal dans le manuel pratique des divers procédés de sa profession. D’un esprit inventif, il était plein de ressources. Aussi, lorsque, vers 1846, la tentative fut faite de reproduire, au moyen de la gravure, les planches daguerriennes, ce fut à lui que M. Fizeau, auteur de la découverte de ce procédé, songea pour se l’adjoindre en qualité de graveur.
Hurliman se dévoua avec passion aux travaux de cette œuvre difficile. Il ressentit la satisfaction la plus vive, lorsque, dans la séance où les procédés de M. Fizeau furent communiqués à l’Académie des sciences, les félicitations et les éloges du savant aréopage vinrent en accueillir l’exposé.
Mais où sa joie fut sans bornes, où son bonheur parut véritablement toucher au délire, ce fut lorsque, quelques mois après, l’Académie, pour encourager ces recherches et fournir à M. Fizeau un témoignage de l’intérêt qu’elles avaient inspiré, décida de confier à MM. Fizeau et Hurliman la reproduction en gravure, d’une série importante de planches daguerriennes.
Ce jour-là, lorsque Hurliman sortit de la réunion académique, sa joie dépassait toutes limites. Il ne pouvait tenir en place, il n’en finissait pas de témoigner son bonheur à ses amis. Sa jambe de bois semblait avoir le vertige ; elle sautillait çà et là comme une folle, exprimant à sa manière la joie qui inondait l’âme de son maître, ordinairement si triste.
Pour lui, encore tout bouleversé de cette émotion inattendue, au sortir de la séance académique, il se mit à courir dans tous les quartiers de Paris, afin d’acheter chez les divers marchands, les objets nécessaires à l’exécution de son grand travail. Il fit ainsi, en quelques heures, dix lieues dans la ville, traînant sa pauvre jambe de bois, qui avait grand’peine à suffire à ce service extraordinaire et désordonné.
Il ne suspendit sa course que le soir, quand l’émotion, la fatigue et les mille anxiétés de sa situation nouvelle le forcèrent de s’arrêter à demi brisé. Il monta avec effort le haut escalier de sa froide mansarde de la rue du Four Saint-Germain. Arrivé chez lui, il tomba épuisé. Bientôt il se sentit saisi à la poitrine d’une douleur aiguë ; il se coucha en proie à une fièvre violente.
Les forces du pauvre artiste n’avaient pu suffire à tant d’émotions ; la nature, trop faible, succombait à tant d’assauts.
Le lendemain, une fluxion de poitrine se déclarait. Le mal marche d’un pas rapide dans l’asile solitaire de la détresse. Deux jours après, Hurliman rendait le dernier soupir, entre son jeune enfant et sa femme, atterrée d’un coup si subit. On le porta, non loin de sa demeure, au cimetière du Mont-Parnasse.
Mais, nouveau malheur ! le jour même, sa pauvre femme, épuisée par tant d’émotions terribles, se sentit, à son tour, frappée aux sources de la vie. Elle se coucha dans ce même lit, encore tout glacé du contact du corps de son mari ; et elle sentit bien, à cette impression funèbre, que le terme de ses tristes jours était arrivé. On la pressait de se rendre à l’hospice voisin :
« Non, dit-elle, je veux mourir dans le lit où il est mort. »
Elle expira, en effet, le jour suivant ; elle alla rejoindre, sous les cyprès du Mont-Parnasse, le pauvre Hurliman, qui ne l’avait pas longtemps attendue. Dans cette chambre, remplie de tant de bonheur, quatre jours auparavant, il ne restait plus qu’un orphelin.
Le lendemain, mon ami Baldus venait rendre visite au graveur, pour le féliciter de la décision que l’Académie avait prise, et examiner les premiers résultats de son travail. Il monta les six étages du pied leste de ses vingt ans, et sonna joyeusement à la porte de l’artiste. Personne ne répondit ; seulement une vieille voisine, attirée par le bruit, se montra sur le carré. La bonne femme avait recueilli chez elle le jeune orphelin, en attendant que l’on prît quelque décision à son égard. Elle raconta les tristes événements qui venaient de s’accomplir, et introduisit le visiteur dans la chambre déserte des époux.
La pièce était complètement vide ; le graveur n’avait laissé pour tout héritage que la magnifique planche de Charles Müller, la Madone de Raphaël, que l’artiste lui avait offerte. Tout son mobilier avait peu à peu disparu sous la terrible aspiration de la misère ; mais il n’avait jamais consenti à se séparer de ce dernier souvenir de son ami.
Baldus emporta la gravure ; il la mit en loterie auprès des artistes, et en retira une somme de deux cents francs, qui servit à faire entrer l’orphelin comme apprenti chez M. Lerebours, opticien.
On s’est demandé plusieurs fois pourquoi le procédé de gravure héliographique, breveté au nom de M. Fizeau, et dont M. Lerebours commença l’exploitation, avait tout d’un coup cessé de répandre ses produits. C’est qu’à cette époque les procédés de la galvanoplastie, encore fort peu connus en France, exigeaient, pour être appliqués avec succès à la gravure, une main habile et délicate. Et cette main qui manqua, on le comprend maintenant, c’était celle du graveur à la jambe de bois.
CHAPITRE XX
L’application des procédés photographiques a déjà rendu aux sciences physiques un grand nombre de services, d’ordre varié. Nous nous occuperons ici des principales de ces applications.
Les procédés empruntés à la photographie ont été employés pour enregistrer d’une manière continue, les indications de quelques instruments météorologiques, tels que l’aiguille aimantée et le baromètre. Aujourd’hui, grâce à cet admirable artifice, dans plus d’un observatoire de l’Europe, les instruments de météorologie enregistrent eux-mêmes les observations.
Les dispositions qui permettent de réaliser ce résultat remarquable, varient ; mais la suivante est le plus en usage. L’aiguille indicatrice de l’instrument vient se peindre sur la surface d’un cylindre, qui tourne sur son axe d’un mouvement uniforme et qui exécute une révolution dans l’espace de vingt-quatre heures. Le cylindre, étant recouvert d’un papier chimique impressionnable à la lumière, conserve, dans une traînée continue, la trace de l’aiguille indicatrice, et présente ainsi une courbe, dont chaque ordonnée indique l’état de l’instrument à l’heure marquée par l’abscisse correspondante.
Dans l’observatoire de Greenwich, en Angleterre, des instruments fondés sur ce principe sont employés depuis assez longtemps : le gouvernement a honoré d’une récompense de 500 livres sterling le docteur Brooke, qui réalisa le premier cette belle application des procédés photographiques.
C’est surtout pour enregistrer l’inclinaison et la déclinaison de l’aiguille aimantée, que l’appareil de M. Brooke est en usage à Greenwich. Voici sa disposition exacte. L’extrémité de l’aiguille aimantée porte un miroir, et l’on fait réfléchir à ce miroir la lumière d’une petite lampe. Lorsque ce miroir se meut, par suite des mouvements divers que subit l’aiguille aimantée dans les différentes variations qu’il s’agit de noter, la lumière de la lampe réfléchie dans ce miroir, décrit, sur l’écran où on la reçoit, un arc d’autant plus grand que cet écran est plus éloigné. Or, cet écran, placé dans un lieu obscur, porte un papier photographique. On obtient donc ainsi, sur une surface impressionnable, la trace du mouvement angulaire accompli dans un certain intervalle par l’aiguille aimantée. On comprend que si le papier sensible, est fixé à un cylindre tournant horizontalement sur son axe une fois en vingt-quatre heures, la marche du point lumineux réfléchi sera indiquée par l’espace influencé sur le papier. Il n’y a donc plus qu’à rendre permanente, à l’aide des procédés ordinaires, l’impression laissée sur la surface sensible. Les épreuves photographiques sur papier ainsi obtenues conservent et représentent l’indication des différents mouvements de l’aiguille magnétique pendant le cours de vingt-quatre heures.
Un appareil du même genre est employé à Greenwich, pour enregistrer les indications du baromètre.
On a suivi à l’observatoire de Kew, près de Londres, un procédé analogue pour la construction d’un photo-électrographe, c’est-à-dire d’un appareil destiné à inscrire les variations de l’état électrique de l’atmosphère. Voici la description de cet instrument, dont les figures 91, 92, 93 et 94, représentent les divers organes.
Un électroscope à feuilles d’or mis en communication avec un paratonnerre placé sur l’observatoire, fait connaître l’état électrique de l’air. La quantité d’électricité libre que contient l’atmosphère, est accusée par l’écartement, plus ou moins grand, de ces deux feuilles d’or. On éclaire fortement ces feuilles au moyen d’une lampe, et l’on reçoit leur image sur une feuille de papier enduite d’iodure d’argent, qui se déroule de haut en bas, d’un mouvement régulier et continu, à l’aide d’un système d’horlogerie. On obtient ainsi deux courbes sinueuses, s’écartant ou se rapprochant l’une de l’autre, qui permettent de constater l’état électrique de l’atmosphère à une heure quelconque du jour.

La figure 91 montre la plus grande partie de cet instrument, qui a été imaginé par sir Francis Ronald, et établi en 1845, dans l’observatoire de Kew. L’extrémité inférieure de la tige du paratonnerre, et la tige A, parfaitement isolée, qui lui fait suite, communiquent, au moyen de la tige horizontale B, avec les feuilles d’or, ou l’électromètre C. Cet électromètre est contenu dans une cage de verre, qui n’est pas représentée sur la figure, et qui met les feuilles d’or à l’abri des ébranlements causés par les courants d’air extérieur. Ces mêmes feuilles d’or sont éclairées par une lampe à huile, D, dont la lumière traverse, pour les éclairer, une ouverture pratiquée dans la paroi de la boîte. La lumière passant ainsi à travers la boîte, et éclairant les feuilles d’or de l’électroscope, rend possible leur reproduction par les moyens photographiques.
Cette impression photographique s’exécute par l’intermédiaire de l’objectif, E, qui vient éclairer un disque de verre dépoli, F, percé d’une fente courbe.

Fig. 92. — Disque de verre dépoli éclairé par l’objectif.Nous représentons ce disque à part, sur une plus grande échelle dans la figure 92. Sur cette figure, l’image des feuilles d’or éclairées par la lampe et amplifiées par l’objectif, est représentée par les lettres n, n, et l’ouverture par les lettres r, r.
Le papier sensible est impressionné par l’image des feuilles d’or en passant au-devant de ce disque éclairé qui reçoit l’image des feuilles d’or. À cet effet, la boîte qui contient ce système, est munie d’un long châssis vertical, mobile de bas en haut, et d’une porte à ressort GH (fig. 91), dans laquelle glisse le porte-plaque, c’est-à-dire l’appareil qui contient le papier impressionnable à la lumière.

La figure 93 représente ce porte-plaque, glissant. C’est un châssis, IJ, muni sur un côté, de deux roulettes, qui lui permettent de monter et de descendre à l’intérieur de la boîte, et qui, d’un autre côté, est pressé par deux ressorts r, r. Une planchette, L, peut glisser dans ce châssis, de manière à découvrir le papier impressionnable à la lumière, lorsqu’on tire cette planchette par le haut du châssis. 
Fig. 94. — Traînée linéaire produite sur le papier photographique.Le déplacement du châssis est déterminé quand l’appareil est mis en fonction par le mouvement d’une horloge H, mue par un poids, P.
Voici donc ce qui se passe quand l’appareil est en fonction. Quand l’électricité atmosphérique varie d’intensité, les feuilles d’or de l’électromètre se rapprochent ou s’éloignent, suivant les variations de cette électricité atmosphérique, et interceptent la lumière de la lampe, qui a pour effet de noircir le papier sensible. Comme le châssis qui porte le papier photographique se meut de bas en haut avec lenteur et régularité, il en résulte la formation, sur le fond noirci du papier, de deux lignes blanches affectant différentes courbures.
Nous représentons à part (fig. 94) le châssis contenant le papier photographique ainsi que la traînée linéaire formée sur ce papier par le déplacement des feuilles d’or. Une échelle divisée, placée au-devant de ces deux courbes, permet de connaître leur écartement, et par suite celui des feuilles d’or à un instant quelconque.
Le photo-électrographe de Ronald sert, dans l’observatoire de Kew, à enregistrer d’autres phénomènes que ceux de l’électricité atmosphérique. Les indications du baromètre, du thermomètre, et celles de la boussole de déclinaison, peuvent être notées avec le même appareil, grâce à des modifications dans le détail desquelles nous ne saurions entrer ici.
Le papier chimique qui sert à recevoir ces impressions, est préparé en le trempant dans un bain d’iodure et de bromure de potassium ; mais ce n’est qu’au moment de s’en servir qu’on le rend impressionnable à la lumière en le plongeant dans la dissolution d’acétonitrate d’argent. Il noircit directement à la lumière de la lampe de l’appareil ; mais comme l’image manque habituellement d’intensité, on la développe au moyen d’une dissolution d’acide gallique, puis on la fixe à la manière ordinaire.
Les papiers, porteurs de ces courbes blanches, qui retracent les variations d’intensité des phénomènes météorologiques ou physiques, sont conservés dans les archives de l’Observatoire, et peuvent toujours être consultés
Une des parties importantes de la physique, la photométrie, qui traite de la comparaison de l’intensité des diverses sources lumineuses, trouve dans les procédés photographiques de précieuses ressources d’expérimentation. Avant la découverte du daguerréotype, les physiciens ne pouvaient déterminer avec rigueur l’intensité comparée de deux sources lumineuses, que lorsque celles-ci brillaient simultanément : les moyens de mesure perdaient la plus grande partie de leur valeur, quand les deux lumières n’étaient pas visibles à la fois. C’est ainsi que l’intensité relative de la lumière solaire et de la lumière des étoiles ou de la lune n’avait pu jusque-là être fixée avec exactitude. L’emploi des moyens photographiques a permis de procéder avec rigueur à cette détermination délicate. Un papier sensibilisé, étant exposé à l’influence chimique de l’image formée au foyer d’une lentille par un objet lumineux, le degré d’altération subie par la couche sensible sert de mesure à l’intensité de la lumière émise. On a pu comparer ainsi avec précision les rayons éblouissants du soleil et les rayons trois cent mille fois plus faibles de la lune.

MM. Fizeau et Foucault ont eu recours au même moyen pour étudier comparativement les principales sources lumineuses, naturelles ou artificielles, en usage dans l’industrie et dans l’économie domestique.
Plusieurs physiciens ont cru reconnaître que la lumière solaire émise deux ou trois heures avant midi diffère, par quelques caractères, de celle qui est émise aux périodes correspondantes après le passage au méridien. Il était donc utile de chercher à apprécier les caractères propres à la lumière solaire aux différentes heures du jour. M. Herschell, M. Edmond Becquerel et quelques autres physiciens, ont construit, en s’aidant du secours de la photographie, un instrument nommé actinomètre, qui permet d’arriver à ce résultat.
L’étude de l’action chimique de la lumière est devenue, dans ces dernières années, l’objet des recherches et des travaux assidus de divers physiciens, entre autres de MM. Edmond Becquerel en France, Herschell en Angleterre, Moser en Allemagne, Draper en Amérique. Les papiers photographiques ont été les moyens et les instruments naturels de ces recherches.
Mais, de toutes les sciences d’observation, l’astronomie est celle qui a reçu du secours de la photographie les applications les plus intéressantes. Nous allons donner une idée générale des moyens nouveaux qui ont fondé, dans les grands observatoires de l’Europe, l’astronomie photographique ou ce que l’on pourrait appeler la photographie transcendante.
Les procédés photographiques adaptés aux instruments d’observation astronomique, c’est-à-dire aux lunettes et aux télescopes, ont permis d’arriver aux résultats suivants :
1o Noter les instants des passages des astres au méridien ;
2o Obtenir l’image photographique des étoiles fixes et celle des planètes ;
3o Obtenir l’image photographique des astres à déplacement rapide, tels que la lune et les comètes ;
4o Obtenir l’image photographique du soleil et des diverses particularités de la surface de l’astre radieux.
Enregistrement des passages des astres au méridien. — Si l’on dispose, au foyer de l’objectif d’une lunette méridienne (non à son foyer optique, mais à son foyer chimique), un papier sensibilisé, la planète en arrivant dans le champ de la lunette méridienne, y marquera son empreinte ; et si la pendule, qui accompagne la lunette méridienne, est mise en rapport avec les rouages qui font dérouler le papier chimique d’une manière uniforme, on pourra déterminer ainsi l’heure à laquelle s’est produite l’impression lumineuse sur le papier sensible, et par conséquent, l’heure du passage de l’astre au méridien.

La figure 96 représente la lunette méridienne de l’Observatoire de Paris. C’est près de l’objectif, c’est-à-dire du petit levier circulaire A, que devrait se placer, au moyen de dispositions spéciales, le papier photographique.
Hâtons-nous de dire pourtant que ce n’est là qu’une vue presque entièrement théorique, car on n’a pu réussir jusqu’ici à exécuter convenablement cette opération. La cause de cet insuccès tient au très-faible pouvoir photogénique des planètes. Tandis que les étoiles fixes laissent sur les papiers sensibles une impression très-nette, et qui se fait avec une grande rapidité, les planètes ne laissent qu’une traînée peu appréciable. La photographie n’a donc pu, jusqu’à ce jour, justifier sa prétention de remplacer l’œil de l’observateur pour noter les instants des passages des astres au méridien.
Reproduction photographique des étoiles et des planètes. — Plusieurs astronomes étrangers, MM. Bond, Crookes, Warren de la Rue, Hartnup, Hodgson, le P. Secchi, se sont distingués, de nos jours, par les résultats admirables auxquels ils sont parvenus, en fixant, au moyen des procédés photographiques, l’image amplifiée des corps célestes, et en dévoilant, dans l’aspect de ces astres, des particularités qui auraient échappé aux plus puissants instruments de vision.
Pour reproduire les astres par la photographie, on peut se servir de la lunette astronomique ou du télescope. Il est essentiel de rappeler ici la différence entre ces deux instruments d’observation céleste.
La lunette astronomique permet d’examiner les astres à travers des verres grossissants, c’est-à-dire au moyen d’un objectif et d’un oculaire, qui produisent une image amplifiée de l’astre lointain. Dans les télescopes, les astres sont vus simplement par la concentration sur un miroir concave, de leurs rayons lumineux, qui viennent former, au foyer du miroir, une image de cet astre. Cette image formée au foyer du miroir, on la regarde avec un simple verre grossissant. La lunette astronomique et les télescopes sont employés tour à tour dans les observatoires astronomiques, selon les phénomènes à étudier.
La lunette astronomique a rarement servi à photographier les corps célestes ; ce n’est guère que pour les photographies du soleil qu’on en fait usage. C’est que l’objectif d’une lunette astronomique est la cause d’une dépense considérable, et que, d’autre part, l’achromatisme de ces lunettes, excellent pour les effets optiques, n’est pas calculé pour les effets chimiques, car l’achromatisme n’existe pas, par exemple, pour les rayons bleus et violets. On peut, au contraire, construire, sans trop de frais, un télescope à réflexion, surtout depuis que Steinheil nous a appris à substituer au miroir métallique un simple miroir de verre argenté, et que Léon Foucault a popularisé ce nouveau télescope en donnant le moyen de travailler facilement le verre concave et de l’argenter, ainsi qu’en perfectionnant son oculaire. Il faut ajouter que le télescope à réflexion n’a point de foyer chimique, ou si l’on veut, que son foyer chimique coïncide avec son foyer optique ; de sorte que la mise au point ne présente aucune difficulté. Sauf les exceptions que nous aurons à signaler plus loin, le télescope à miroir de verre argenté, ou télescope de Foucault, est donc l’appareil que les physiciens préfèrent pour photographier les corps célestes. La grande quantité de lumière réunie au foyer par un miroir de 30 à 60 centimètres de diamètre, permet de donner aux images une grande netteté.
Le télescope de Foucault n’est pas d’ordinaire monté équatorialement ; il est indispensable, quand on veut le faire servir aux applications photographiques, de lui donner cette disposition.
Qu’est-ce qu’un télescope monté équatorialement ? C’est ce qu’il est nécessaire d’expliquer. Les étoiles se déplacent d’une quantité inappréciable pour nous, pendant le temps qu’exige une opération photographique : un télescope, monté sur un pied ordinaire, pourrait donc suffire pour prendre l’image photographique d’une étoile fixe. Mais les planètes et leurs satellites, se déplacent dans le ciel, et traversent avec rapidité le champ des instruments d’observation. Une image photographique prise dans un télescope, ou dans une lunette astronomique ordinaires, ne serait donc pas représentée sur la plaque collodionnée d’une façon nette et déterminée, mais bien par une traînée lumineuse, résultant de son déplacement dans le champ de l’observation. De là, la nécessité de donner au télescope ou à la lunette un mouvement de translation, qui coïncide d’une manière absolue, pour sa durée, avec les mouvements de ces corps célestes, et qui, en outre, s’exécute dans le même plan, c’est-à-dire dans le plan désigné sous le nom d’équateur céleste. Une lunette, ou un télescope, sont montés équatorialement lorsqu’ils sont munis d’un mécanisme qui les fait se déplacer de la même quantité que les astres mobiles que l’on considère, et qui les maintient dans le plan de l’équateur céleste. La figure 97 représente la belle lunette équatoriale, qui a été construite par M. Secrétan, pour l’Observatoire de Paris. Ce n’est qu’avec un appareil de ce genre que l’on peut observer tout à son aise un astre mobile, comme les planètes et leurs satellites, et maintenir leur image dans le champ de vision aussi longtemps qu’on le désire.


La figure 90 fait voir le télescope de Léon Foucault, monté équatorialement, tel qu’il est construit par M. Secrétan à Paris. La figure 98, fait voir le même télescope tel qu’on le construit à Munich. L’enveloppe hexagonale en bois qui sert à enfermer le miroir et l’oculaire, est remplacée par une enveloppe cylindrique renforcée de métal.

AB est le tube du télescope ; le miroir de verre argenté, que l’on ne peut apercevoir dans la figure que le lecteur a sous les yeux, puisqu’il est caché par le tube de bois, est placé à l’extrémité du tube, vers le point B. L’oculaire latéral au moyen duquel on regarde, grâce à un prisme réflecteur, l’image formée au foyer du miroir, se voit à l’autre extrémité, C. Le mécanisme destiné à produire le déplacement du télescope, conformément au déplacement de l’astre et dans le plan de l’équateur céleste est le cercle horaire, PQ, muni de sa vis, ab. D est le cercle de déclinaison.

Pour appliquer ce télescope à la reproduction photographique des planètes ou des groupes d’étoiles, on enlève le système oculaire et le prisme, qui servent pour les observations astronomiques ordinaires, et l’on encadre dans l’ouverture C (fig. 98) un anneau double, que nous représentons à part (fig. 100). Dans l’anneau central a, on fixe un petit châssis, contenant la glace collodionnée, destinée à recevoir l’impression chimique de l’astre dont on veut obtenir l’image. Pour mettre à point l’image, on fixe sur l’anneau central a, un pas de vis, que l’on peut faire tourner de l’extérieur, de manière à faire avancer ou reculer le châssis porteur de la glace collodionnée. Quand la mise au point est obtenue, c’est-à-dire quand l’image est bien formée sur le verre dépoli, qui couvre et cache la glace collodionnée, on tire ce verre dépoli, et on laisse ainsi à découvert la surface impressionnable à la lumière. Une simple loupe suffit pour observer la mise au point. Lorsque l’impression lumineuse a été produite, ce qui exige un temps variable selon l’astre considéré, on retire la plaque collodionnée qui a reçu l’impression lumineuse, et on fixe l’image par les moyens ordinaires. Le cliché ainsi obtenu sert à obtenir des épreuves positives sur papier.
Tels sont les moyens qui servent à obtenir les images photographiques des planètes, comme aussi celles des étoiles fixes. M. Warren de la Rue a copié, de cette manière, le groupe des Pléiades. Les Nébuleuses ne donnent pas d’impression.
Les planètes laissent une traînée noire, assez nettement terminée, si le temps est beau, mais en tous cas, peu prononcée, le pouvoir photogénique des planètes étant très-faible. Les étoiles fixes laissent une traînée bien distincte, car elles s’impriment avec une grande rapidité ; mais pour peu que l’atmosphère soit troublée, la traînée est extrêmement irrégulière. Il y a plus, c’est au microscope qu’il faut chercher la trace des étoiles sur l’épreuve photographique, car à l’œil nu on ne voit rien.
M. Warren de la Rue a indiqué un moyen simple de rendre plus apparente l’image des étoiles, c’est de ne pas les mettre exactement au point, ce qui les étale en cercles, mais alors le temps de pose est plus long et les perturbations atmosphériques beaucoup plus funestes à la régularité de leurs images.
Il est plus difficile d’obtenir les photographies des planètes, dont le pouvoir photogénique est très-faible, comme nous l’avons déjà dit. M. de la Rue y est pourtant parvenu, grâce à une réunion de circonstances favorables, c’est-à-dire une atmosphère parfaitement calme, et à un mécanisme équatorial assez bien réglé pour maintenir pendant plusieurs minutes l’image de l’astre immobile au centre du télescope. C’est ainsi que M. de la Rue a obtenu l’image photographique de la planète Jupiter, avec ses bandes, celle de la planète Saturne, avec son anneau, et celle de Mars, avec sa surface irrégulière.
Le même expérimentateur a pu obtenir des épreuves stéréoscopiques de ces planètes ; si bien, résultat merveilleux, que ces images apparaissent dans le stéréoscope, avec le relief qu’elles ont dans la nature. Pour atteindre ce résultat, M. de la Rue a pris deux épreuves de ces planètes après qu’elles avaient tourné d’une faible quantité par leur mouvement de translation. Deux images de Mars par exemple, prises à deux heures d’intervalle, correspondent, pour cette planète, à une rotation de 30 degrés ; et deux images de Saturne, prises à trois ans et demi d’intervalle, donnent une image stéréoscopique, par rapport à l’anneau et à la planète.
M. de la Rue a ainsi exécuté à la main, d’après ses photographies, des dessins stéréoscopiques, qui ont excité un juste étonnement.
Photographies de la lune. — Le déplacement des planètes est, relativement, peu considérable, pendant le court espace de temps nécessaire à la production d’une épreuve photographique. Mais il n’en est pas de même de la lune, ainsi que des comètes, dont la marche dans le ciel est très-rapide. En outre, le mouvement de la lune n’est pas parallèle à l’équateur céleste, mais incliné sur cette ligne, de sorte qu’un télescope monté équatorialement à la manière ordinaire, ne peut servir dans ce cas. Il faut donc faire usage de dispositions particulières : connaître le mouvement en ascension droite de la lune, au moment où l’on opère, et régler là-dessus le pendule de l’horloge ; et de plus, modifier le cercle de déclinaison que porte la monture équatoriale, de manière à faire parcourir au télescope précisément l’arc que parcourt la lune en déclinaison.
Tout cela n’est pas sans présenter de grandes difficultés. Elles ont pourtant été vaincues par différents astronomes, tels que le P. Secchi, à Rome, MM. Warren de la Rue et Airy en Angleterre, M. Schmidt à Athènes, M. Rutherford, à New-York. Il faut de deux à cinq secondes pour obtenir une épreuve de la pleine lune. Pour la lune à l’état de croissant, au premier et au troisième quartier, le temps de pose est de vingt à trente secondes.
On sait que la surface de la lune, vue au télescope, présente un aspect volcanique : elle est percée d’immenses trous, qui ressemblent à des cratères aux bords évasés. Elle présente en d’autres points, des espaces sans relief, qu’on a appelés mers. Quand on prend à un intervalle déterminé deux épreuves photographiques de la lune, ces épreuves diffèrent par suite du déplacement de notre satellite, et si l’on calcule bien l’intervalle à laisser entre ces deux images, on peut obtenir des épreuves qui, vues dans le stéréoscope, font apparaître la surface de cet astre avec la profondeur de ses cratères et la saillie de ses montagnes, de manière à vivement impressionner le spectateur.
Les images photographiques de la lune formées au foyer du miroir du télescope de Foucault, sont très-petites, mais au lieu d’en tirer directement des épreuves positives, on les soumet à la méthode d’agrandissement suivant les procédés que nous avons décrits.
« Le temps nécessaire à la production d’une image de la lune varie beaucoup, dit M. de la Rue. Il dépend de la sensibilité du collodion, de l’altitude de la lune et de sa phase. J’ai obtenu récemment une image instantanée de la pleine lune ; ordinairement il faut de deux à cinq secondes pour obtenir une bonne et forte épreuve de la pleine lune. Il est très-important que le collodion soit aussi parfait que possible, que l’opérateur ait les mains très-propres, que les appareils soient entièrement débarrassés de la poussière. Pour la lune à l’état de croissant, au premier et au troisième quartier, et dans les mêmes circonstances atmosphériques, le temps de pose varie de vingt à trente secondes. Dans un temps plus court les détails du limbe obscur ne s’impressionneraient pas ou ne deviendraient pas visibles.
« Les portions de la lune situées près du limbe obscur se photographient avec une grande difficulté ; et il faut souvent six fois plus de temps pour obtenir les portions éclairées très-obliquement que pour obtenir d’autres portions moins lumineuses en elles mêmes, mais plus favorablement éclairées. Les régions élevées dans le voisinage de la portion sud de la lune sont copiées plus facilement que les régions basses appelées communément mers, et je me suis hasardé à dire ailleurs que la lune peut avoir une atmosphère très-dense, mais très-peu étendue ou haute ; il me semble que cette opinion reçoit quelque confirmation d’une observation faite récemment par le R. P. Secchi, et qui tend à prouver que la surface de la lune polarise plus la lumière sur les régions basses et au fond des cratères, que sur les sommets ou sur les crêtes des montagnes où la polarisation n’est pas appréciable[34]. »

La figure 101 représente une vue photographique de la lune, prise par M. Warren de la Rue. Cette gravure a été exécutée d’après une épreuve stéréoscopique. Pour que le lecteur puisse se rendre compte des parties de notre satellite rendues par la photographie dans la figure 101, nous avons mis sous ses yeux (fig. 99), un très-beau dessin de la pleine lune, d’après l’astronome Bullard.

Photographie du soleil. — Il nous reste à parler de la reproduction photographique du soleil. Cette importante et merveilleuse opération s’exécute tous les jours, depuis l’année 1858, dans l’observatoire de Kew (à moins que le ciel ne soit couvert), et ces épreuves, que l’on conserve avec soin, seront des matériaux précieux pour l’histoire physique de l’astre central de notre monde.
Pour prendre une photographie du soleil, on ne peut pas recevoir directement l’image de son disque sur la plaque collodionnée, en raison de sa trop grande intensité lumineuse. Il faut, comme le faisait Galilée, au dix-septième siècle, et comme le firent, à son exemple, les astronomes du dix-huitième siècle, faire réfléchir le disque solaire sur un miroir plan et recevoir les rayons de cette image réfléchie dans une lunette de 2 à 3 pouces d’ouverture, munie d’un oculaire grossissant. Au foyer de cette lentille on place, dans une petite chambre noire, la plaque collodionnée qui doit recevoir l’image.
Il faut monter le miroir équatorialement, et placer la lunette dans le plan du méridien, incliné à l’horizon d’un angle égal à la latitude du lieu dans lequel on opère. Le temps d’exposition à la lumière doit être prodigieusement court, Il suffit de savoir, pour le comprendre, qu’une plaque collodionnée s’influence par la lumière directe du soleil, et donne une bonne image après le développement par l’acide gallique, quand elle a été exposée à la lumière de seconde seulement. Comme on opère sur une image réfléchie, et non avec les rayons directs du soleil ; comme cette image est, en outre, agrandie par l’oculaire de la lunette, et qu’ainsi une partie de la lumière est absorbée par la réflexion et l’absorption du miroir et des lentilles, le temps de l’exposition est nécessairement plus long. On calcule le temps qui doit être accordé à la pose, d’après les dimensions de l’objectif et celles que doit avoir l’image.
On appelle photo-héliographe, le remarquable appareil qui sert à prendre les photographies du soleil. Il existe, avons-nous dit, un appareil de ce genre, dans l’observatoire de Kew, en Angleterre. Un opticien, M. Dallmeyer, en a construit un autre pour l’observatoire de Wilna en Russie, qui est analogue à celui de Kew. M. Monckhoven, dans son Traité général de photographie, a donné la description de ce bel instrument, d’après les dessins qui lui avaient été fournis par M. Dallmeyer. Nous emprunterons à l’ouvrage de M. Monckhoven, la description, ainsi que les figures que ce savant physicien a données du photo-héliographe de l’observatoire de Wilna.

« Le photo-héliographe de l’observatoire de Wilna, dit M. Monckhoven (analogue à celui de Kew), se compose essentiellement d’une lunette avec oculaire et chambre noire montée équatorialement.
« La figure 102 représente la monture équatoriale, dont voici la légende :
« NO, piédestal en fonte sur lequel se trouve le gnomon XOR qui porte l’axe polaire S. Les ajustements en latitude et azimuth se font à l’aide de vis p, p, n.
« S, axe polaire en acier reposant dans le gnomon à sa partie inférieure, sur un pivot d’acier poli, et à sa partie supérieure dans un coussinet en Y où deux roulettes c atténuent la friction par des ressorts e, f ; de cette façon l’axe polaire peut tourner avec une grande facilité.
« La construction du cercle horaire est très-ingénieuse. Il s’ajuste librement sur l’axe polaire et porte deux systèmes de verniers, l’un fixé au gnomon, l’autre à l’axe horaire lui-même (le cercle étant divisé sur ses deux faces). Le mouvement de l’horloge est indiqué par l’un celui de l’axe polaire par l’autre.
« Le cercle horaire peut se fixer à l’axe polaire par la vis Z qui y est attachée d’une manière permanente. Un rappel h travaille sur des dents taillées dans la partie supérieure du cercle, immédiatement au-dessous de la lettre V, et peut se désengrener à l’aide d’un excentrique ; il sert à l’ajustement fin des verniers.
« MD représente le mouvement d’horlogerie, (Nous ferons observer que la forme du gnomon est très-bien combinée pour lui donner place et que le poids de l’horloge se trouvant dans l’axe du piédestal, concourt à en assurer la stabilité). Ce mouvement se communique par des roues dentées à la vis sans fin g qui travaille dans des dents taillées dans la périphérie du cercle horaire. Cette vis g est portée sur une plaque glissante T qui permet de la désengrener. Un second mouvement de rappel m peut corriger le mouvement d’horlogerie ou l’excentricité des oculaires, sans toucher aux verniers.
« Le mouvement d’horlogerie étant en marche et réglé, on peut malgré cela diriger la lunette sur un objet quelconque sans l’interrompre, en lisant l’ascension droite donnée par les catalogues directement sur le cercle en mouvement.
« Sur la tête y de l’axe horaire s’ajuste une pièce C en métal dans laquelle se trouve l’axe G de déclinaison. Un niveau peut s’y adapter pour faire servir la lunette comme instrument des passages.
« FE est le cercle de déclinaison avec son rappel H attaché à la pièce C ainsi que les verniers b, b.
« AB représente le corps de la lunette, attaché à l’axe G par des anneaux K, L et des vis I, J. Un contre-poids i équilibre le système.
« Ajoutons pour finir, qu’outre les verniers, les cercles portent chacun un microscope micrométrique, et en un mot, tous les accessoires des équatoriaux ordinaires.

« Chambre noire télescopique. — La chambre noire télescopique est représentée figure 103. Elle se fixe sur la monture équatoriale (fig. 102) par deux anneaux K, L ; mais elle porte deux poignées (non représentées sur la figure) qui permettent de la tourner de 90° sur son axe, ce qui est utile pour amener une tache solaire à parcourir un des fils du réticule (dont nous parlerons tout à l’heure).
« L’objectif se trouve dans un tube en cuivre D ; il a trois pouces de diamètre et quatre pieds anglais de distance focale, et est achromatisé pour les rayons chimiques.
« Ce tube se fixe au corps du télescope par un collet E dans lequel il glisse et peut se fixer à volonté par une vis de pression, afin de faire aisément tomber l’image solaire sur le réticule. D’ailleurs, un tube E à crémaillère (fig. 104) sert au mouvement fin.
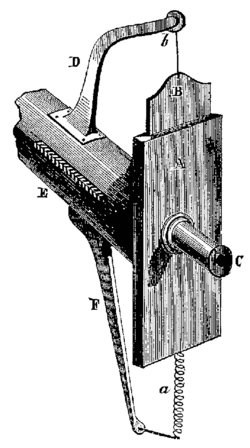
« Là où l’image solaire se forme, se trouve une lame de cuivre à deux ouvertures circulaires, l’une libre, l’autre portant un réticule, de sorte que l’on peut obtenir une image avec ou sans fils en avançant plus ou moins la lame. (Ces fils servent de repère pour les mesures, par rapport aux cercles d’ascension droite et de déclinaison).
« Un chercheur, constitué par une petite lentille au foyer de laquelle se trouve un verre dépoli, se trouve sur la chambre noire A.
« L’image solaire se forme au foyer de l’objectif, en ba à peu près, où elle est agrandie par un oculaire. La chambre noire en métal A, de 20 pouces de long à peu près, porte un châssis carré en acajou pouvant contenir des glaces de 6 pouces de côté, dimension que Warren de la Rue trouve convenable.
« L’oculaire est fixé sur la boîte A (fig. 104) dans laquelle glisse une lame B à la partie inférieure de laquelle s’attache un ressort a dont on fait varier la puissance suivant la vitesse que l’on désire donner à l’obturateur B. Un bras D à poulie sert de soutien au fil bc (fig. 103) qu’on brûle ou qu’on détache à un moment convenable.

« La figure 105 montre l’intérieur de l’obturateur. L’anneau ADBC représente l’espace qui existe entre le tube à crémaillère E (fig. 104) et le tube B (fig. 103). L’espace blanc indique l’ouverture du tube E (fig. 104).
« La lame glissante KE porte une seconde lame intermédiaire I dont on peut faire varier la longueur, afin de régler très-exactement la course de l’obturateur KE, qui porte d’ailleurs une rainure à sa partie supérieure dans laquelle s’engage une vis non représentée sur la figure. L’obturateur est donc sollicité par un ressort retenu par un cordon, et empêché de faire une course égale à sa longueur par une vis qui s’engage dans une rainure. Voilà donc la description de l’instrument dont nous devons maintenant décrire l’usage.
« Disons tout d’abord que l’objectif est beaucoup trop grand et qu’on peut le réduire à la moitié de son diamètre, ce qui permet encore une pose très-courte (1/20e à 1/30e de seconde). Mais on a donné à cet objectif cette dimension, afin de pouvoir s’en servir pendant les éclipses de soleil.
« Cet instrument étant destiné à reproduire le soleil d’heure en heure ou à des moments quelconques, il suffit pour cela de l’ajuster (à l’aide des cercles divisés de la monture équatoriale et des positions fournies par les catalogues) et de s’en servir comme d’un appareil photographique ordinaire, sans avoir recours au mouvement d’horlogerie qui n’est destiné à opérer que pendant les éclipses. La mise au point doit nécessairement se faire une fois pour toutes et se vérifier de temps à autre[35]. »
Le soleil examiné au télescope, avec un grossissement d’une puissance moyenne, et des verres colorés qui en atténuent la lumière trop vive, présente l’aspect d’un disque, parsemé de taches plus ou moins nombreuses, et qui changent lentement de place. Ces taches sont sombres. Outre ces taches sombres, il en est de lumineuses, que l’on a nommés facules (de facula, torche), Avec un grossissement plus puissant, on a remarqué que la surface du soleil est rugueuse comme la peau d’une orange.

La figure 106 que nous empruntons à l’ouvrage de M. Monckhoven, représente une tache du soleil, obtenue au moyen de la photographie, par M. Nasmyth, physicien anglais. M. Monckhoven a fait graver cette figure d’après un dessin fait par M. Nasmyth. « Elle peut servir, dit M. Monckhoven, à ceux qui cherchent à perfectionner les moyens de reproduire photographiquement cet astre, car les épreuves solaires que l’on a obtenues jusqu’ici, sont loin d’en atteindre la beauté et l’exactitude[36]. »
L’éclipse totale du soleil du mois de juillet 1851 et celle du 18 juillet 1860, ont fourni une preuve intéressante du secours que la photographie peut apporter à l’étude des phénomènes astronomiques. Un grand nombre d’opérateurs fixèrent sur une plaque collodionnée, les différentes phases de l’éclipse de 1851. L’une des épreuves les plus remarquables en ce genre, obtenue à Rome, en moins d’une seconde par le P. Secchi, au moyen d’une lunette astronomique, fut mise sous les yeux de l’Académie des sciences de Paris. Ses dimensions étaient considérables ; les bords du disque de la lune s’y trouvaient nettement accusés. En présentant cette épreuve à l’Académie, M. Faye fit remarquer que de semblables reproductions de l’image solaire par les moyens photographiques, pourraient rendre de grands services à l’astronomie. Obtenues par séries, à des intervalles de temps égaux, elles permettraient, selon ce savant académicien, de calculer le diamètre de l’astre autour duquel gravite notre système planétaire, aussi bien que la position exacte des taches qu’il présente, et sur la nature desquelles tant de discussions se sont élevées. Il serait facile d’avoir dans les cabinets d’astronomie des images du soleil prises dans toutes les saisons ; on pourrait ainsi, ajoute M. Faye, déterminer plus exactement qu’on ne l’a fait jusqu’ici, par l’action chimique de ses rayons, la nature de cet astre et son état solide ou gazeux.
L’éclipse totale du soleil du 18 juillet 1860, fut relevée dans presque toutes ses phases, par M. Warren de la Rue, qui a exécuté, d’après les photographies qu’il prit au moment de l’éclipse, des dessins représentant les différentes phases du passage de l’ombre sur le disque du soleil, à des intervalles de temps parfaitement déterminés.
Aujourd’hui aucune éclipse de lune partielle ou totale, aucune occultation partielle du soleil, n’arrivent sans qu’un grand nombre d’observateurs s’attachent à prendre une série d’épreuves photographiques de chacun de ces astres, au fur et à mesure des progrès de l’ombre qui les envahit. Grâce à l’emploi de cette méthode d’enregistrement on peut conserver dans les archives, de manière à pouvoir les consulter à volonté, les témoignages authentiques des phases de chaque éclipse.
Toutes ces épreuves s’obtiennent par les moyens et dans les instruments que nous avons décrits.
Nous terminerons ce chapitre, consacré aux applications de la photographie aux sciences physiques, en parlant de l’emploi qui en a été fait pour la levée des plans. On doit cette nouvelle application de la photographie à M. Chevallier, ancien chirurgien militaire.
L’appareil que M. Chevallier désigne sous le nom de planchette photographique, permet de faire très-rapidement tous les relevés et toutes les opérations graphiques nécessaires à la détermination complète de la topographie d’une contrée. Un appareil répondant à ces conditions, peut rendre de grands services, car les ingénieurs ont ainsi entre les mains le moyen de dresser rapidement et avec précision, le plan des localités, et ils ont surtout la possibilité de multiplier les copies de ces plans, pour les distribuer à divers opérateurs.
Dès que la chambre obscure a été connue, les géomètres ont songé à appliquer cet instrument à la levée des plans, en y ajoutant des cercles, des niveaux, etc. Mais l’instrument qui fut construit dans cette vue, au commencement de notre siècle, et qui reçut le nom de tachygoniomètre, était volumineux et embarrassant ; il fallait dessiner la perspective au crayon, sur une glace gommée, ce qui prenait beaucoup de temps. La rapidité que l’on croyait obtenir avec cet appareil n’ayant pu être réalisée, le tachygoniomètre ne reçut que fort peu d’emploi. Plus tard, la découverte de la chambre claire permit de diminuer le volume de l’appareil ; aussi ce problème fut-il repris par plusieurs ingénieurs, et de nos jours notamment par M. Laussedat, commandant du génie à l’École polytechnique, qui obtint de bons résultats en combinant d’une manière ingénieuse la chambre claire avec la planchette. Mais M. Laussedat n’appliqua ce principe qu’à la levée expéditive des plans pour les opérations militaires.
La découverte de la photographie, qui permet de relever en un très-court espace de temps, de grandes étendues de terrains, est enfin venue apporter l’élément de rapidité qui avait fait défaut jusqu’ici pour la levée des plans. Cependant, malgré les promesses de la théorie, la pratique a rencontré de grandes difficultés pour cette application de la photographie aux opérations géodésiques. On sait que les parties de l’image de la chambre obscure qui sont situées sur les bords de l’objectif, éprouvent toujours des déformations qui amènent de grandes inexactitudes quand on fait embrasser plus d’une dizaine de degrés au champ de l’instrument. Cette difficulté avait arrêté les opérateurs, et amené l’abandon de tout procédé de ce genre ; M. Chevallier a eu le mérite d’en triompher. Son appareil permet de relever avec la plus grande exactitude les points situés sur presque toute l’étendue de l’horizon, en conservant à ce relevé toute sa précision géométrique.
La planchette photographique de M. Chevallier se compose essentiellement d’une chambre noire, placée sur une planchette pareille à celle qu’on emploie dans le levé des plans. Cette chambre noire est mobile autour d’un axe vertical. L’objectif peut, de cette façon, faire un tour complet, c’est-à-dire se placer en regard de tous les points de l’horizon.
La partie optique de l’appareil est formée d’un prisme à réflexion totale, qui renvoie l’image des objets extérieurs sur la planchette. On interpose sur le passage des rayons lumineux venant du prisme, une lentille convexe, qui, en diminuant la divergence de ces rayons, permet d’obtenir des images plus nettes.
On adopte quelquefois une autre disposition. C’est la lentille convergente qui se trouve en regard de l’horizon et qui donne une image des objets extérieurs. Cette image est alors reçue sur un miroir incliné à 45 degrés, qui renvoie les rayons verticalement sur la planchette où se forme l’image définitive. Si l’on place sur la planchette une feuille de papier ou une feuille de métal, sensibilisée par un sel d’argent, les images viennent s’y imprimer d’une façon permanente.
Mais si l’on se contentait de faire tourner l’objectif pour fixer les différents points de l’horizon, les images que ces divers points formeraient, se superposant et persistant sur la plaque sensible, amèneraient une entière confusion. M. Chevallier par un ingénieux artifice a écarté cet obstacle. Voici en quoi consiste cet artifice : la glace collodionnée sur laquelle se forment les images, a une forme concave, elle est recouverte entièrement par un écran opaque, dans lequel on a pratiqué une fente très-étroite, s’étendant également de part et d’autre du plan vertical contenant l’axe optique et l’axe de rotation. Par cette disposition on ne laisse passer que les rayons lumineux venant des objets situés dans le plan vertical ; et l’on n’obtient alors que des images distinctes et séparées des objets que vient envisager successivement l’objectif.
En faisant tourner le système optique autour de son axe, la plaque sensible restant fixe, on peut donc obtenir une série de tableaux partiels dont l’ensemble constitue une sorte de panorama de la localité.
Nous ne saurions donner ici les détails des opérations nécessaires pour exécuter le levé d’un plan au moyen de la planchette photographique. Les personnes qui désireraient des explications plus étendues et plus complètes, pourront consulter les traités techniques de MM. Benoît, d’Abbadie, Jouart, etc., où la question se trouve traitée.
L’appareil de M. Chevallier peut rendre de nombreux services aux ingénieurs et aux officiers du génie. Il permet d’effectuer la reconnaissance d’une contrée, de tirer des plans, d’obtenir les dimensions d’un édifice accessible ou non, de faire les études pour le tracé des routes et des canaux, pour l’hydrographie, etc. Ces opérations si diverses nécessitaient autrefois autant d’instruments distincts.
Indépendamment de ses avantages sous le double rapport de la promptitude et de la précision, ce nouveau système permettant d’obtenir avec l’image photographique négative autant d’épreuves positives qu’on le désire, on peut mettre simultanément à la disposition de divers opérateurs les vues que l’on a ainsi obtenues.
Ces vues, non-seulement conservent aux objets leurs dispositions relatives, mais encore font connaître la configuration du sol, la nature des cultures et des constructions, en un mot une foule de détails que le lever ordinaire des plans laisse ignorer.
Avec quelques modifications fort simples, la planchette photographique peut servir à reproduire les divers épisodes, presque simultanés, d’une action générale se passant autour de cet instrument. Une bataille, un engagement, le passage d’un fleuve par une armée, en un mot, tous les incidents d’une campagne dont on veut conserver l’image précise et rigoureuse, sont aisément fournis par cet instrument, qui répond ainsi à une indication qui n’avait jamais pu être remplie jusqu’à ce jour. L’appareil de Garella pour la photographie panoramique[37] donne bien, en effet, des vues panoramiques, mais il ne saurait fournir en même temps, comme la planchette de M. Chevallier, les mesures géométriques des différentes parties de cette vue.
Le système de M. Chevallier a été appliqué au levé des plans militaires et des cartes panoramiques du théâtre des opérations d’une armée. C’est pendant la guerre d’Italie, en 1859, qu’on en fit l’essai pour la première fois. La brièveté de cette campagne empêcha d’approfondir cette méthode, dont on ne se rendait généralement pas compte, car on ne comprenait pas bien comment une image photographique, dans laquelle la perspective est toujours rendue d’une manière infidèle, peut être ramenée à l’exactitude d’un plan géométrique. Cependant, le génie militaire avait su apprécier toutes les ressources que pouvait fournir aux manœuvres des armées et à la stratégie une méthode qui donne, en un si court espace de temps, un relevé exact des plus vastes étendues de terrain.
D’autre part, un opérateur instruit et très-exercé aux mesures sur le terrain, M. Civiale fils, avait exécuté un travail extrêmement remarquable, par le secours combiné de la photographie et de la géométrie. M. Civiale, chargé d’une mission de l’Académie des sciences, avait fait servir les épreuves photographiques qu’il avait prises, de la chaîne des Pyrénées, à relever le plan géométrique de cette région montagneuse. Avec le secours de M. Charles Chevallier, M. Civiale avait adapté à la chambre noire un ingénieux appareil, à l’aide duquel on peut facilement obtenir les angles horizontaux et verticaux, qui permettent de calculer les hauteurs et les distances. Dès lors, la photographie put fournir des renseignements certains et étendus sur la configuration, les coupures, les dispositions des chaînes de montagnes et les formes générales du pays. Cette donnée était de la plus grande importance pour l’exécution des cartes géographiques militaires, elle prêtait une grande fidélité au plan géométrique, que l’on pouvait compléter par l’examen visuel des localités ainsi doublement représentées.
La certitude ainsi acquise d’obtenir rapidement un plan géométrique par la photographie, a décidé le gouvernement français à établir la photographie dans les camps. Aux termes d’un arrêté du ministre de la guerre, rendu en 1865, un service photographique est organisé dans notre armée. Chaque régiment doit avoir, en campagne, une petite escouade de photographes, dirigée par un capitaine, et pourvue du matériel nécessaire à la levée des plans au moyen de la chambre obscure et des procédés photographiques.

La figure 107 représente des photographes militaires occupés à relever le plan du terrain aux abords d’une ville.
CHAPITRE XXI
Des soins infinis, des sommes incalculables sont consacrés, depuis des siècles, à reproduire, par la main du dessinateur et du graveur, les objets qui servent aux études ou aux descriptions des naturalistes. Or, ces images ne sont presque jamais traduites par le burin que d’une manière incomplète ou infidèle. Il est impossible, en effet, que l’artiste fasse assez abnégation de son propre jugement, pour que, dans un grand nombre de cas, il ne remplace point ce que la nature lui présente par ce qu’il voit lui-même, ou par ce qu’il croit voir. Or, la photographie est venue apporter les moyens d’empêcher cette interprétation individuelle de l’artiste, en retraçant les objets d’histoire naturelle avec une fidélité absolue.
L’emploi de la photographie pour la représentation des formes zoologiques, par exemple, présente les animaux sous leur aspect absolument vrai et indépendant de toute interprétation particulière à l’auteur. Quand un naturaliste exécute lui-même ses dessins, il lui est impossible de faire abstraction de ses idées personnelles. Bien souvent ses prédilections théoriques lui ferment involontairement les yeux sur des détails qu’apercevrait pourtant et que traduirait un autre zoologiste, imbu d’idées différentes. Aussi les dessins d’un zoologiste peuvent-ils rarement profiter aux études de ses successeurs, qui y cherchent en vain les particularités de structure dont le premier iconographe n’avait pas tenu compte, parce que son attention ne se portait pas sur ces détails, ou parce que son système scientifique écartait la considération de ces particularités. La photographie, par l’impartialité absolue de sa représentation graphique, met à l’abri de cet inconvénient.
Ajoutons une seconde considération. Les parties du corps des animaux que le dessinateur doit représenter, offrent, le plus souvent, une foule de détails qu’il est important d’exprimer, mais que leur ténuité ne permet pas toujours de mettre en évidence. Il est dès lors indispensable d’exécuter à part, une image de ces parties, vues au microscope. Pour donner une idée exacte de l’objet, il faut donc presque toujours que le dessinateur exécute deux sortes d’images : une figure d’ensemble, non grossie, et les figures de certaines parties caractéristiques, amplifiées. Cette nécessité n’existe plus avec la reproduction photographique ; car l’épreuve donne à elle seule la figure d’ensemble et la figure grossie. En effet, si l’on examine à la loupe l’épreuve photographique, on y découvre tous les détails que cet instrument ferait voir dans l’objet lui-même. Une seule et même image peut donc tenir lieu des deux sortes de figures qui sont généralement nécessaires dans les planches de zoologie.
Ces considérations expliquent l’empressement avec lequel les photographes se sont occupés d’appliquer leurs procédés aux études de l’histoire naturelle. C’est, en effet, de l’origine de la photographie, c’est-à-dire de l’époque où l’on en était encore réduit à la plaque daguerrienne, que datent les premières applications de la photographie à l’histoire naturelle.
La possibilité d’obtenir en quelques instants, avec la plaque daguerrienne, des dessins parfaits d’animaux, de plantes et d’organes isolés, frappa tout de suite les naturalistes voyageurs, comme leur offrant la faculté d’accroître indéfiniment les richesses de leurs collections d’études.
Les premières applications de la photographie par les naturalistes voyageurs, furent réalisées par M. Thiessen, dans les portraits daguerriens que ce savant rapporta en France en 1844, des Botocudos, naturels de l’Amérique du Sud, ainsi que dans les études de types africains qui furent recueillis par le même naturaliste, dans un voyage postérieur.
M. Rousseau, aide-naturaliste au Jardin des Plantes de Paris, publia quelques portraits photographiques de Hottentots, qui étaient venus se montrer dans la capitale.
Vint ensuite le voyage du prince Napoléon dans les mers du nord de l’Europe, effectué en 1856. Ce voyage permit aux naturalistes de l’expédition de recueillir une série de types vivants de Groënlandais, d’Islandais, etc. Tous les spécimens obtenus par M. Rousseau, sont déposés au Muséum d’histoire naturelle de Paris, où l’on a formé une collection de types d’individus vivants, recueillis en divers points du monde, au moyen de procédés photographiques.
À la même époque un médecin de la Salpêtrière, en publiant une série de types d’idiots et de crétins, composée au moyen de la photographie, donna un exemple des avantages que peut offrir la photographie, pour la description et l’étude de ces tristes affections de l’espèce humaine.
Dès les premières années de la découverte de Daguerre, MM. Donné et Léon Foucault réalisèrent une autre application de la photographie à l’histoire naturelle, aussi curieuse qu’utile. Ils eurent l’idée de daguerréotyper les objets microscopiques, et de rendre ainsi permanentes les images éphémères formées par la lentille de l’instrument. L’image que donnent au microscope solaire, les globules du sang, par exemple, était reçue sur une plaque iodurée, et y laissait son empreinte, qu’il ne restait plus qu’à rendre fixe par les moyens ordinaires. Les épreuves ainsi obtenues ont servi de modèle aux dessins de l’atlas qui accompagne l’ouvrage publié par M. Donné, en 1844, sur les applications du microscope à l’étude physique des sécrétions animales[38].
Ces résultats intéressants n’étaient cependant qu’un prélude. La découverte de la photographie sur papier vint donner beaucoup d’extension à l’emploi des procédés photographiques dans les études relatives aux sciences naturelles.
Une observation particulière contribua beaucoup à faciliter la reproduction des objets d’histoire naturelle par la photographie. L’imperfection des résultats qui avaient été obtenus jusque-là dans ce genre d’applications, tenait surtout à ce que l’on avait fait usage de l’objectif double. L’emploi de ces volumineuses lentilles permet d’obtenir l’instantanéité dans la production de l’image ; mais il a l’inconvénient de déformer considérablement les objets. Cette combinaison de verres, qui a pour résultat de concentrer en un seul foyer une quantité considérable de rayons lumineux, permet sans doute d’accélérer beaucoup l’impression photogénique, et elle donne ainsi les moyens de saisir rapidement les objets, ou les êtres, dont la mobilité constitue un obstacle sérieux pour la reproduction photographique : tels sont, par exemple, les animaux vivants. Mais cette rapidité d’impression ne s’obtient qu’aux dépens de l’exactitude de la copie : l’image du modèle est sensiblement altérée par suite de la trop courte distance focale de l’objectif. C’est ce qui explique les imperfections que présentent toutes les reproductions d’animaux vivants obtenues avant l’année 1855. Pour réussir entièrement, dans ce nouvel ordre de travaux photographiques, il fallait opérer avec des lentilles simples, qui ont l’avantage de n’occasionner aucune déformation dans l’objet reproduit ; ou bien, si l’on voulait conserver les lentilles à verres combinés, augmenter la longueur de leur foyer.
M. Louis Rousseau, préparateur au Muséum d’histoire naturelle de Paris, imagina une disposition très-ingénieuse dans la manière de disposer la chambre obscure pour reproduire les pièces d’histoire naturelle. Par suite de la position verticale que présente l’objectif dans la chambre obscure ordinaire, on n’avait pu jusque-là recevoir l’image d’un objet qu’autant qu’on le plaçait dans une position verticale. Or, cette situation obligée mettait obstacle à la reproduction de la plupart des spécimens qui se rapportent à l’histoire naturelle, pour les pièces anatomiques par exemple, et surtout pour celles qui ne peuvent être étudiées que sous l’eau. M. Louis Rousseau parvint à surmonter cette difficulté. Au lieu de conserver la situation verticale à la lentille, il plaça cette lentille horizontalement ; c’est-à-dire, qu’il disposa la chambre obscure au-dessus de l’objet à reproduire, en plaçant cet objet lui-même horizontalement à la manière ordinaire, sur une table ou sur un support. Avec cette chambre obscure renversée, on peut prendre l’impression photographique des pièces anatomiques et autres dans les conditions qu’exige leur reproduction.
Grâce à l’emploi des lentilles simples et de l’appareil renversé, M. Rousseau a pu obtenir des résultats d’une certaine importance pour l’application de la photographie aux études scientifiques. Mais c’est à un savant français, M. Bertsch, qu’appartient le mérite d’avoir créé la méthode qui sert à reproduire par la photographie, les détails de l’organisation des tissus végétaux ou animaux vus au microscope.
On sait quelle importance a prise, dans notre siècle, la connaissance de la structure intime des tissus des animaux et des plantes, dispositions qui ne sont visibles qu’au microscope. Il était de la plus grande utilité de pouvoir fixer sur le papier ces images fugitives que l’on aperçoit quand on soumet au microscope un tissu organique, pour reconnaître sa structure, ou quand on examine à l’aide des mêmes instruments, les corps organisés qui flottent dans les divers liquides physiologiques. La photographie est venue donner le moyen de fixer et de conserver ces images, de composer des tableaux, pris sur nature, des différents aspects que présentent tous les tissus de l’économie animale ou végétale, dans l’état normal ou pathologique.
La méthode qui sert à obtenir ces spécimens instructifs, est toujours, en principe, la méthode générale d’agrandissement, qui consiste à éclairer très-fortement l’objet lui-même, ou une épreuve photographique, déjà obtenue en petite dimension ; puis à amplifier cette image, en lui faisant traverser la lentille d’une sorte de lanterne magique, enfin à fixer par les procédés photographiques ordinaires, cette image amplifiée.
Pour obtenir cette amplification, et pour fixer sur le papier les images amplifiées, il faut des appareils d’optique particuliers et très-délicats. C’est à M. Bertsch, avons nous-dit, qu’est due la création de tout le système de reproduction des objets microscopiques. Non-seulement M. Bertsch a réalisé le premier cette belle et utile application de la photographie, mais c’est à lui que l’on doit l’invention des instruments d’optique et des dispositions opératoires qui permettent, en général, de photographier les infiniment petits.
C’est en 1851 que M. Bertsch présenta à l’Académie des sciences de Paris, les premières épreuves microscopiques sur papier, faites à des grossissements forts et avec netteté. Voici les principes optiques que M. Bertsch posa, dès cette époque, comme indispensables à la réussite de ce genre de travail, et sur lesquels il fonda la construction de ses instruments.
1o Le faisceau de lumière solaire est reçu, au moyen d’un prisme à réflexion totale, sur un condensateur convergent ; grâce à un système optique divergent interposé sur son trajet, ce faisceau lumineux est ensuite converti en rayons parallèles, comme s’il venait directement de l’infini.
2o Ces rayons sont reçus dans un appareil de polarisation chromatique, donnant à volonté toutes les couleurs simples du spectre, afin que le champ et l’objet soient éclairés, quel qu’en soit le ton, par de la lumière homogène.
Par ce mode d’éclairage, les objectifs amplifiants se trouvent achromatisés également pour l’œil et pour les rayons photographiques. Avant l’application de ce système, on n’avait pu tirer parti du microscope solaire, instrument imparfait au point de vue de l’application dont il s’agit, et qu’il fallait d’abord réformer. En effet, entre le foyer de l’image optique visible et celui de l’image chimique invisible, la différence pouvait être de 20, de 30 centimètres, ou même de 50 centimètres, sans qu’on s’en aperçût.
Voici ce que fit M. Bertsch pour les agrandissements microscopiques. L’application aux objectifs de la loi des foyers conjugués donnant lieu à des déformations et à des fautes de perspective déjà choquantes dans les épreuves ordinaires, on ne pouvait y songer pour ces agrandissements. M. Bertsch appliqua le principe du foyer principal, en vertu duquel les images sont rigoureusement en perspective. Pour cela, il a imaginé une toute petite chambre noire, d’un décimètre de côté, dont l’objectif invariable est au point pour toutes les distances, à partir de 7 ou 8 pas de vis. On n’a donc qu’à la placer devant la scène à reproduire, pour que tous les plans soient rendus en proportion mathématique sur la glace sensible. On obtient ainsi un petit type de 6 centimètres de côté, sans aucune déformation, avec les premiers plans et les horizons bien nets et en perspective. Dans ces conditions, cette épreuve supporte de forts agrandissements.
Placés dans le mégascope de M. Bertsch, qui n’admet que des rayons parallèles (voir la figure 80), ces types donnent directement sur papier, en quelques secondes, des épreuves positives, qui peuvent atteindre les dimensions d’un mètre. Leur régularité est telle que les peintres n’ont qu’à les décalquer pour avoir des paysages, des monuments, des intérieurs bien mis en place pour tous les plans. C’est par cette méthode qu’a été fait le Panorama de la bataille Solférino, qui épargna dix-huit mois d’un travail de perspective ingrat et pénible.
Après ces considérations générales, nous donnerons la description du microscope héliographique de M. Bertsch, que représente la figure 108.

La plaque AB est fixée au volet d’une fenêtre. Le prisme réflecteur, CD, placé au dehors, produit l’effet du miroir-plan dans le microscope solaire ordinaire : il envoie un faisceau de rayons lumineux parallèles, dans l’intérieur de l’appareil. À l’intérieur du tube EF, se trouve le système optique dont nous avons expliqué plus haut le rôle et l’utilité. Cet appareil est ensuite placé devant une chambre noire, installée sur un pied solide. Cette chambre noire est sans objectifs, mais munie de son châssis à glace. Elle porte à sa partie antérieure, une ouverture circulaire, dont on réduit le diamètre au champ de lumière suffisant pour que l’objet à reproduire y soit contenu. Au moyen de deux boutons qui font marcher le mouvement du prisme réflecteur CD, on amène les rayons solaires dans l’axe du microscope EF. L’image agrandie formée par le jeu des lentilles du microscope G, est reçue sur la glace collodionnée de la chambre obscure qui fait suite à l’instrument représenté par la figure 108, et l’on obtient instantanément, sur cette glace collodionnée, des clichés remarquables par leur éclat et leur netteté.
Le faible volume de cet instrument et la simplicité de son mécanisme permettent de le manœuvrer sans peine.
M. Bertsch, avons-nous dit, a donné le moyen de reproduire par la photographie des objets qui avant lui, n’avaient pu être rendus à cause de leur couleur, qui n’est point photogénique. À cet effet, il joint à son microscope héliographique, un appareil de polarisation, qui fournit un champ de lumière homogène, depuis le rouge jusqu’au violet, en passant par l’orangé et le jaune. Avec cet éclairage, on reproduit les objets dont les tons sont le moins photographiques. S’il s’agit, par exemple, d’un objet d’un ton vert, le champ de lumière, qui est blanc, sera détruit bien avant qu’on ait obtenu même une silhouette. Il convient alors d’employer l’appareil de polarisation chromatique : on tourne la molette H de cet instrument (fig. 108) jusqu’à ce que le champ de lumière soit à peu près du ton de l’objet ; en sorte que l’on peut sans danger prolonger le temps de pose et avoir une reproduction très-harmonieuse. Il en est ainsi pour tous les autres tons.
L’instrument de M. Bertsch, met l’opérateur à l’abri des phénomènes de diffraction, des franges et des anneaux colorés, ce qui permet d’obtenir des contours très-nets avec de très-forts grossissements.
Grâce à l’emploi du microscope solaire ou héliographique de M. Bertsch, on peut obtenir des épreuves avec un grossissement de 600 fois les dimensions de l’objet, qui représentent tous les détails, invisibles à l’œil nu, des liquides ou des tissus organiques, la contexture des os, des parasites de différents animaux et les parties intéressantes de l’organisation des insectes et des plantes.
Par l’emploi des procédés photographiques instantanés, M. Bertsch est parvenu à écarter une grande cause d’insuccès dans ce genre d’opérations. L’instabilité des appareils, et les vibrations qu’ils éprouvent au moindre mouvement produit dans le voisinage, ne permettent d’obtenir des images nettes qu’autant que ces images sont saisies instantanément. Avec de si forts grossissements, une vibration, si petite qu’elle soit, devient quelques centaines de fois plus considérable. Il en résulte que l’image n’est jamais fixe sur l’écran, et qu’il faut la saisir, pour ainsi dire, au passage et produire le cliché en une petite fraction de seconde. Cette instantanéité dans la production de l’image est réalisée par l’appareil de M. Bertsch.
On a vu, à l’Exposition universelle de 1867, plusieurs collections de photographies représentant les détails d’anatomie microscopique végétale et animale. Rien n’était plus curieux, par exemple, que la série d’amplifications microscopiques des solides et des liquides de l’économie animale, et des différents éléments des tissus végétaux, vus à divers grossissements, qui composaient l’exposition de M. Lakerbauer, dessinateur de talent qui est entré, avec succès, dans la voie tracée par M. Bertsch, Ici, c’était le sang des différents animaux avec leurs globules caractéristiques, dont les formes étaient aussi nettement arrêtées et aussi reconnaissables que lorsqu’on les aperçoit dans le champ du microscope ; là, c’étaient les différents tissus anatomiques, avec leur structure toute spéciale ; ailleurs, des fibres végétales, des filaments de vins atteints de maladie, des trichines enkystées et non enkystées, etc., etc. On passait en revue, dans cette intéressante exhibition, tout ce que la micrographie représentait de curieux ou d’instructif.
Il est, à l’étranger, un photographe qui paraît suivre les traces de M. Bertsch : c’est M. Neyt, de Bruxelles. M. Neyt avait présenté à l’Exposition universelle de 1867, une série de photographies microscopiques des liquides et des tissus de l’organisme, d’après le système de M. Bertsch, et représentant à peu près les mêmes modèles qu’avait reproduits M. Lakerbauer.
L’emploi de la photographie, pour fixer les images amplifiées du microscope solaire, et représentant les particularités de l’organisation des animaux, est précieuse à tous les titres, car aucun autre procédé connu de reproduction ne pourrait fixer ce genre d’images avec autant de fidélité. Le moment n’est pas éloigné où le naturaliste confiera presque exclusivement à la photographie l’exécution de ses dessins. Au lieu de se condamner à relever péniblement au crayon, les détails principaux des objets qu’il étudie, il en obtiendra en quelques instants, sur le papier, une image rigoureuse, sans même avoir recours au microscope solaire. Le travail du graveur deviendra ainsi inutile, car les épreuves positives tirées sur papier avec l’épreuve négative, fourniront un grand nombre de reproductions du premier type, qui rendront superflue toute intervention de la gravure.
Le lecteur a sous les yeux trois figures gravées (fig. 109, 110 et 111) qui représentent des objets d’histoire naturelle grossis par le microscope et fixés, par la photographie, d’après les procédés et les appareils de M. Bertsch, que nous venons de décrire : les globules du sang humain vus à un grossissement de 500 diamètres, un pou vu à un grossissement de 200 diamètres, les antennes et les palpes d’un moucheron.



Ajoutons que tout fait espérer que la botanique pourra invoquer à son tour le secours de la photographie. Seulement, il faudra employer des moyens de grossissement assez puissants pour que, dans les parties végétales reproduites, on puisse faire ressortir ce qui échappe à la vue simple. Les corps opaques ne pouvant être examinés et grossis au microscope qu’en dirigeant sur eux, par des lentilles convergentes, un grand foyer de lumière, les opérateurs devront disposer des appareils particuliers d’éclairage et de grossissement pour les objets opaques. Ce sujet exige donc des études nouvelles[39].
D’ailleurs, sans faire usage de l’appareil micrographique, la photographie peut rendre des services considérables à l’histoire naturelle. L’anthropologie, par exemple, ne pourra faire de sérieux progrès que lorsque les voyageurs naturalistes auront rapporté de tous les coins du monde des images authentiques, prises par les procédés héliographiques, des différents types humains. L’étude, si intéressante, mais si peu avancée encore, des races humaines, trouvera dans l’usage de la photographie, la source de ses progrès. L’imperfection de l’anthropologie tient surtout à l’absence d’un riche musée de types authentiques des variétés des races humaines et des individus qui peuvent servir de type à ces races. On conçoit dès lors l’utilité que présenterait une collection ethnologique obtenue par la photographie.
L’anatomie descriptive pourra également demander à la photographie la reproduction des objets de ses études. Déjà, dans quelques publications, on a essayé de représenter l’ostéologie humaine, la névrologie et la myologie, c’est-à-dire l’étude des os, celle des nerfs et celle des muscles. On peut donc espérer qu’il sera permis un jour de remplacer par des photographies prises sur nature, les planches gravées d’anatomie humaine destinées aux études, qui sont si dispendieuses.
Pendant bien longtemps on a désespéré de fixer sur le papier photographique les divers organes des végétaux, et surtout les fleurs. Le problème a fini pourtant par être résolu, et en 1855, à l’Exposition de photographie, ce que l’on admirait le plus parmi les nouveautés de cet art, c’était une série d’épreuves représentant des fleurs de grandeur naturelle. Elles avaient été présentées par M. Braun, de Dornach (Haut-Rhin). On retrouva le même artiste dans le salon de photographie de 1859, apportant des épreuves de fleurs et de fruits.
Dans cette application intéressante et nouvelle de l’héliographie, il faut citer M. Jeanrenaud, qui marche sur les traces de M. Braun, en ce qui concerne la reproduction de fleurs d’après nature.
M. Jeanrenaud a aussi exécuté des études d’animaux ; mais il a été moins heureux dans cette dernière tentative, dans laquelle personne, d’ailleurs, n’a encore réussi. On peut dire, en effet, que la reproduction fidèle, et en même temps artistique, des animaux, est encore aujourd’hui l’un des desiderata de l’héliographie.
CHAPITRE XXII
Les opérations photographiques peuvent se combiner très-utilement avec les travaux de la cosmographie, de l’archéologie et de l’architecture.
« Pour copier les millions et millions d’hiéroglyphes qui couvrent, même à l’extérieur, les grands monuments de Thèbes, de Memphis et de Karnak, a dit Arago, dans son rapport, fait en 1839, à la chambre des députés, il faudrait des vingtaines d’années et des légions de dessinateurs. Avec le daguerréotype, un seul homme pourrait mener à bonne fin cet immense travail. Munissez l’institut d’Égypte de deux ou trois appareils de M. Daguerre, et, sur plusieurs des grandes planches de l’ouvrage célèbre, fruit de notre immortelle expédition, de vastes étendues d’hiéroglyphes réels iront remplacer des hiéroglyphes fictifs ou de pure invention, et les dessins surpasseront partout en fidélité, en couleur locale, les œuvres des plus habiles peintres ; et les images photographiques, étant soumises dans leur formation aux règles de la géométrie, permettront, à l’aide d’un petit nombre de données, de remonter aux dimensions exactes des parties les plus élevées, les plus inaccessibles des édifices. »
La méthode des agrandissements est venue singulièrement accroître les services que la photographie peut rendre à l’étude de l’architecture. L’amplification, par la photographie, des dessins d’architecture, présente une grande importance pratique. Les détails d’un monument ainsi agrandi, constituent pour l’artiste, pour l’architecte, pour l’élève, un enseignement précieux.
Nous citerons, comme exemple, une très-belle page qui se voyait à l’Exposition universelle de 1867. C’était la vue agrandie de la Cathédrale d’Amiens, exécutée par un photographe de cette ville, M. Duvette. Cette photographie, qui se composait de quatre parties seulement, n’avait pas moins de 2m,50 de hauteur sur 2 mètres de largeur. Il est de toute évidence que des œuvres de ce genre, si elles pouvaient se généraliser, rendraient de grands services aux études des architectes et des dessinateurs.
En 1849, M. le baron Gros, ministre plénipotentiaire de France en Grèce, qui se délassait de ses fonctions diplomatiques par des travaux de photographie, eut par devers lui une preuve assez curieuse de l’utilité des arts photographiques en matière d’archéologie. Il avait fixé au moyen de la photographie, un point de vue de l’Acropole d’Athènes. De retour à Paris, à la fin de sa mission, il eut la fantaisie d’examiner à la loupe les détails de cette épreuve. Or, à sa grande surprise, la loupe lui fit reconnaître sur cette image, une particularité qu’il n’avait point aperçue sur la nature. Sur une pierre située au premier plan, et parmi les débris antiques amoncelés et jonchant le sol, se trouvait, esquissé en creux, un lion dévorant un serpent. Le dessin de cette figure était d’un âge si reculé, que ce monument dut être rapporté à l’époque égyptienne. Ainsi, à sept cents lieues de la Grèce et hors du théâtre de l’observation, la photographie avait révélé l’existence d’un document utile, inaperçu jusque-là, et qui apportait quelque éclaircissement à la connaissance d’un fait historique !
Une singularité du même genre, c’est-à-dire une révélation faite par la photographie, de signes ou traits invisibles à l’œil, a été mise en évidence par une autre application de cet art. Nous voulons parler de la reproduction des manuscrits anciens.
Quand on voit avec quelle perfection les plus fines gravures, les corps d’écriture les plus compliqués, sont reproduits par la photographie, perfection telle qu’il est quelquefois difficile de distinguer le modèle de l’original, on comprend de quel avantage serait la photographie pour composer des fac-simile de manuscrits, pour multiplier ces spécimens et les répandre dans le commerce. Les amateurs pourraient ainsi se procurer, à peu de frais, des copies de manuscrits qui demeurent aujourd’hui consignés dans les bibliothèques, et dont l’existence même est souvent ignorée. Des échanges pourraient s’établir par le même moyen. Grâce au nombre illimité d’exemplaires que fournit le tirage photographique, des documents précieux seraient répandus et vulgarisés ; les travaux des érudits seraient singulièrement facilités ; en un mot, on verrait se briser le cercle étroit dans lequel ces trésors de la science et de l’art semblaient condamnés à rester.
C’est ce qu’a compris un de nos photographes les plus habiles et en même temps les plus instruits, M. Camille Silvy, qui a dirigé à Londres un des plus importants établissements de photographie. C’est là que lui vint l’idée de s’adonner à la reproduction des manuscrits, dans le but de faire une réalité pratique des avantages que nous énumérions plus haut, mais qui ne peuvent exister qu’à la condition d’une entreprise régulière et bien conduite.
M. Vincent, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, présenta à cette académie, en 1860, le premier fac-simile de manuscrit publié par M. Silvy ; c’était le manuscrit Sforza, appartenant à M. le marquis d’Azeglio, ambassadeur du Piémont à Londres. L’initiative et la générosité éclairée de M. le marquis d’Azeglio seront sans doute imitées par les établissements publics qui possèdent de précieuses collections de ce genre, et l’œuvre inaugurée à l’étranger par notre compatriote, pourra trouver des imitateurs.
La reproduction photographique du manuscrit Sforza est identique au modèle par ses dimensions ; les dessins et ornements marginaux sont rendus dans toute leur perfection naïve. Dans un petit livre joint à la copie de ce manuscrit, M. le marquis d’Azeglio a donné l’histoire et l’explication, page par page, de ce manuscrit.
Fait étrange ! Il s’est trouvé que la copie était plus lisible que l’original, et que certains passages qui ne pouvaient se déchiffrer sur le précieux parchemin, étaient mis parfaitement au jour par cette révivification des caractères. De telle sorte que la reproduction photographique d’un manuscrit donne non-seulement un fac-simile exact de l’écriture, mais peut même, habilement dirigée, servir d’instrument de restauration. Ce fait est particulièrement appréciable à la dernière page du manuscrit Sforza, où une note, écrite en allemand, au-dessous de la signature, a été rappelée du sein même du parchemin, qui l’avait absorbée dans sa substance, et est devenue visible sur la copie, alors qu’elle ne l’était plus sur l’original.
Pour s’expliquer ce résultat extraordinaire, il faut considérer que sur les vieux parchemins, l’encre, altérée par le temps, prend une teinte jaunâtre, souvent identique à la teinte même du parchemin, ce qui en rend la lecture très-difficile. Or, il arrive, pendant la reproduction photographique, que les parties brillantes et polies du parchemin réfléchissent beaucoup mieux la lumière que celles où a été déposée l’encre, qui est mate et sans reflet. Si faible et si décolorée en apparence, que soit la nuance de cette encre, elle n’en a pas moins conservé ses qualités anti-photogéniques, opposées aux qualités photogéniques de la surface du parchemin. Grâce à cette opposition, on peut obtenir sur la surface sensible, des caractères parfaitement noirs et se détachant bien sur un fond légèrement teinté, tandis que l’original ne présentait plus qu’une écriture pâle sur un fond très-foncé et de même couleur.
De ce principe que la photographie peut servir à la restauration des écritures anciennes, M. Camille Silvy a donné, en 1865, une preuve nouvelle. Il a fait reparaître sur une vieille estampe, des caractères d’écriture que personne n’avait jamais aperçus. Ce que nul œil humain n’avait vu, la photographie l’a dévoilé, M. Silvy a présenté, à la Société de photographie de Paris une gravure, et la reproduction qu’il en avait faite par la photographie. Cette gravure représente le portrait du prince-cardinal Emmanuel-Théodore de la Tour d’Auvergne, duc d’Albret. Au bas, était une note écrite à la main, indiquant le lieu et la date de la mort du personnage, mais tellement illisible qu’elle échappait entièrement aux regards. Le baron Marochetti, à qui appartient la gravure, ne l’avait pas lui-même aperçue avant qu’elle vînt se révéler dans la reproduction photographique. Les caractères en avaient été grattés, sans doute par une personne qui croyait que cette ligne d’écriture gâtait la gravure ; les dernières lettres seules étaient encore apparentes, et le peu d’encre restée dans le papier, était tellement décolorée qu’elle ne se détachait plus du fond. Cependant, la copie photographique rendit très-distinctement l’écriture effacée, et l’on put lire cette note, ainsi conçue : « Mort doyen des cardinaux à Rome le 3 mars 1715, âgé de 72 ans[40]. »
M. Silvy proposait d’appliquer le même procédé à la restauration des palimpsestes, c’est-à-dire des parchemins anciens qui ont reçu successivement plusieurs écritures. Le parchemin étant une substance assez chère, il arrivait assez souvent, au moyen âge, que les copistes grattaient d’anciens manuscrits, pour en consacrer le parchemin à recevoir de nouvelles écritures. Plus d’une fois on a réussi, en ravivant les caractères effacés, à reconstituer le texte primitif. C’est ce qui advint pour les fragments du dialogue de Cicéron, De Republica. Le cardinal Angelo Mai fit reparaître ces fragments, qui avaient été grattés pour recevoir une copie des Commentaires de saint Augustin. Le cardinal Angelo Mai a publié, en 1822, ces fragments de Cicéron.
Mais la méthode employée pour faire revivre les caractères effacés, est pleine d’inconvénients. C’est avec une dissolution de tannin étendue sur le papier, que l’on fait reparaître ces écritures. Or la dissolution de tannin endommage les manuscrits et les expose à une détérioration complète. M. Silvy propose donc de soumettre à des opérations photographiques les palimpsestes conservés à la bibliothèque du Vatican, à Rome, pour essayer d’y découvrir les anciens corps d’écriture effacés. Nous ignorons si cette curieuse proposition a eu quelque suite. Nous la citons seulement comme une preuve des services que la photographie peut rendre aux sciences historiques et archéologiques.
Nous signalerons encore, dans le même ordre d’idées, le travail éminemment curieux d’un savant russe, M. de Sévastianoff, qui a reproduit, en 1848, le fac-simile complet du manuscrit de la Géographie de Ptolémée, manuscrit grec du quatorzième siècle, composé de 112 pages, avec un grand nombre de cartes de géographie, coloriées dans le style naïf de cette époque. Pour doter la science de cet ouvrage, d’une grande valeur historique, et dont le seul exemplaire connu se trouve dans un couvent du mont Athos, M. de Sévastianoff alla s’enfermer des années entières, dans ce pays reculé, et il parvint, à force d’art et de patience, à obtenir le fac-simile héliographique des 112 pages du manuscrit et des nombreuses cartes qui raccompagnent, qu’il revêtit ensuite de teintes coloriées, conformément au modèle.
Il n’est pas sans intérêt de dire comment ont été obtenus les clichés qui devaient servir au tirage de tous ces positifs. Comme plus de cent clichés de verre auraient été bien difficiles à conserver et même à se procurer en ces lointaines régions, M. de Sévastianoff trouva le moyen d’exécuter tous ses clichés positifs avec sept à huit lames de verre seulement. Après avoir obtenu sur le verre la couche de collodion formant l’épreuve négative, il détachait cette couche du verre et la transportait sur du papier ciré, pour obtenir un cliché négatif sur papier ciré. M. de Sévastianoff put de cette manière, reproduire tout le manuscrit avec les huit ou dix lames de verre dont il pouvait disposer.
Grâce au dévouement et à la patience de ce savant moscovite, nos bibliothèques pourront posséder une copie fidèle d’un manuscrit unique au monde et du plus grand prix pour la science. Il est évident que ce qui a été fait par M. de Sévastianoff pour le manuscrit de la Géographie de Ptolémée, pourra se répéter pour un grand nombre d’autres manuscrits rares et tout aussi précieux. Quelle belle et utile application de la photographie ! Avec de tels moyens, la science ne peut plus périr.
La reproduction des manuscrits et des corps d’écritures, dont nous venons de parler, nous amène à dire quelques mots, en terminant ce chapitre, de la reproduction des tableaux et autres œuvres d’art.
Bien que la photographie ait été créée et mise au monde pour retracer et multiplier tout ce qui est visible à nos yeux, la reproduction des œuvres d’art a présenté longtemps de réelles difficultés. Nous ne parlons ni de la sculpture ni de la gravure, dont la reproduction n’a été qu’un jeu pour la photographie dès l’époque de ses débuts ; mais la copie héliographique des tableaux, surtout celle des tableaux anciens, a paru longtemps impossible. Désespérant même d’y parvenir, certains photographes s’étaient décidés à opérer comme les graveurs, c’est-à-dire à travailler d’après un dessin très-exact du tableau. C’est ainsi que M. Baldus composa une belle reproduction de la Sainte Famille, de Raphaël, et qu’un autre artiste nous donna, par le même procédé, la Nativité, d’Esteban Murillo. Mais ce n’était là qu’un à-peu-près. Grâce à des procédés spéciaux d’éclairage, on est bientôt parvenu à reproduire les tableaux, quels que soient le nombre et la variété de leurs tons. Ce genre de reproduction ne présente plus aujourd’hui de difficultés que pour les tableaux très-anciens et qui ont fortement poussé au noir.
Le maître en ce genre spécial, est assurément M. Bingham, artiste anglais, mais qui réside à Paris. M. Bingham a reproduit une grande partie de l’œuvre de Paul Delaroche, plusieurs tableaux d’Ary Scheffer et de Meissonnier. La Rixe, de Meissonnier, est la reproduction la plus fidèle de ce tableau qui ait paru jusqu’à ce jour ; elle l’emporte sur la gravure qui en a été faite ; elle est, pour ainsi dire, le tableau même.
La plus intéressante des reproductions des tableaux de Paul Delaroche, est le célèbre Hémicycle de l’École des Beaux-Arts. Tout le monde connaît la magnifique gravure qui a été faite de cette œuvre, par un artiste de génie, Henriquel Dupont. Or, si l’on compare cette gravure avec la reproduction photographique du même tableau, due à M. Bingham, on demeurera convaincu que ce qui a traduit avec le plus de vérité, tant pour le détail matériel que pour la pensée de l’artiste, l’œuvre de Paul Delaroche, ce n’est point le burin, mais l’objectif. Et quand on y réfléchit, ce résultat s’explique. Plus un graveur a de talent, d’inspiration ou de génie, moins il se montre fidèle dans son imitation du maître, parce qu’il ajoute involontairement à la pensée de son modèle ; parce qu’il l’étend ou la modifie d’après l’impulsion irrésistible de sa pensée propre. Pour graver Raphaël, il faudrait un génie égal au génie de ce maître ; encore n’est-il pas bien sûr que cet imitateur sublime d’un peintre sublime n’ajoutât point à son travail des idées de son propre fonds. Quel graveur a surpassé Marc-Antoine Raimondi ? Peut-on dire pourtant que l’œuvre de Raimondi soit l’œuvre de Raphaël, et que le graveur ait rigoureusement reflété la pensée du peintre ? Ces considérations justifieront sans doute l’appréciation qui précède.
Après M. Bingham, MM. Bisson frères, M. Micheletz, MM. Jugelet, Collard, Richebourg et Bilordeaux, tiennent un rang distingué pour la reproduction des œuvres d’art.
M. Bilordeaux s’est fait une grande réputation par son Calvaire, une des plus belles, et peut-être la plus belle des reproductions héliographiques.
Puisque la photographie donne le moyen de reproduire tous les tableaux, une de ses applications les plus utiles serait de composer, en parcourant les différents musées de l’Europe, des fac-simile des œuvres des grands maîtres, pour en former une sorte de collection populaire, que chacun pût acquérir. Ce que la gravure n’a jamais pu faire, c’est-à-dire reproduire la série complète des œuvres d’un grand peintre, avec des conditions de bon marché pouvant seules assurer le succès de cette entreprise, la photographie peut le tenter. On commence, en effet, à entrer dans cette voie, bien qu’une entreprise commerciale de ce genre présente bien des difficultés et des chances contraires.
M. Fierlants, de Bruxelles, s’est proposé de reproduire héliographiquement les plus célèbres tableaux des maîtres du quinzième siècle, qui enrichissent les églises et les musées de la Belgique. On trouve dans la riche et abondante collection de M. Fierlants, plus de cent épreuves représentant des tableaux de Hemling, Le Maître, van Eyck, Hugo van der Goers, Mostaert et Roger van der Weyden. La Châsse de sainte Ursule, de Eyck, est le morceau le plus saillant de cette collection, qui décèle, par son ensemble, un véritable sentiment artistique et une grande habileté dans le maniement du procédé. M. Fierlants a joint à chaque planche d’ensemble, la reproduction, en grandeur naturelle, des figures les plus intéressantes du tableau ; ce qui donne une idée complète de la manière du peintre, et fait de cette collection le plus précieux document pour l’étude des anciens maîtres flamands.
Cette copie héliographique des œuvres de l’art ancien dans les Flandres avait déjà été essayée par un photographe français, M. le chevalier Dubois de Néhaut.
Un photographe de Milan, M. Sacchi, est entré avec succès dans la même voie, en reproduisant, sur une petite échelle, une suite de fresques et de tableaux de vieux peintres italiens. C’est là un grand service rendu aux arts, car ces fresques, aujourd’hui dans le plus triste état, sont bien près de disparaître. Le Mariage de la sainte Vierge, d’après Raphaël, qui se trouve dans le Musée de Milan, et différentes fresques par Bernardino Luini, ont été exécutés par M. Sacchi. Malheureusement, les fresques originales sont dans un déplorable état ; l’artiste n’a donc pu parvenir à empêcher l’inexorable objectif de retracer avec la même précision les plus petits accidents de la dégradation du mur et les traits les plus exquis de la peinture.
Mais l’œuvre capitale dans ce genre de reproduction, c’est la photographie des cartons de Raphaël, qui sont conservés à Hampton-Court. Publiée par deux photographes de Londres, MM. Caldesi et Montechi, sous le patronage du prince Albert, cette magnifique collection a produit en Angleterre une grande sensation. Combien n’a-t-on pas vu d’artistes, peintres ou dessinateurs, passer des heures entières en contemplation devant ce reflet authentique et fidèle de l’œuvre du maître des maîtres ! Raphaël semble revivre là tout entier, et ceux à qui il n’a pas été donné d’admirer à Hampton-Court, ces merveilles de dessin, ont pu, pour la première fois, en jouir et les comprendre. Plusieurs de ces reproductions sont de la grandeur des originaux, d’autres sont d’un format réduit. La Pêche miraculeuse, Elymas le sorcier frappé de cécité, Paul prêchant à Athènes, la Mort d’Ananias, tous ces dessins, qui doivent être pour l’artiste un sujet perpétuel d’étude, sont reproduits dans cette collection, avec toutes les qualités que l’héliographie réclame. Quels précieux services cette publication ne rendra-t-elle pas aux dessinateurs et aux peintres ! Ces œuvres que l’on ne connaissait que par des gravures plus ou moins fidèles, ces originaux que quelques privilégiés avaient seuls le droit de contempler, il sera maintenant permis à tout artiste de se les procurer pour un prix modique, de les conserver constamment sous sa main et sous ses yeux. Cette réunion des plus beaux dessins qui soient au monde, ainsi popularisée, est un des plus beaux résultats dont puisse se glorifier la photographie.
On trouve aujourd’hui, dans le commerce, un assez grand nombre de gravures de grands maîtres reproduites par la photographie. M. Delessert eut le premier l’heureuse pensée de faire servir la photographie à répandre au milieu du public et des artistes les gravures des anciens maîtres. Celles de Marc-Antoine Raimondi sont, en ce genre, les plus estimées et les plus coûteuses. M. Delessert, après en avoir rassemblé la collection, en a exécuté par la photographie des reproductions identiques ; de telle sorte que l’on peut aujourd’hui, pour un prix minime, posséder l’œuvre tout entière du graveur bolonais : la Vierge aux nues, la Descente de croix, le Massacre des Innocents, la Sainte Cécile, les Deux femmes au Zodiaque, et tous les autres chefs-d’œuvre dus au génie de Raphaël et transportés sur le cuivre par l’admirable burin de Raimondi.
Ce premier essai a donné naissance à d’autres publications du même genre. Des éditeurs intelligents ont livré au public l’œuvre de Rembrandt et celle d’Albert Durer, photographiées par MM. Bisson frères. MM. Baldus et Nègre ont, de leur côté, reproduit une partie de l’œuvre de Lepautre ; M. Aguado a exécuté le même travail pour Téniers.
Enfin, M. Baldus publie depuis quelque temps, non sous la forme de simples photographies, mais en véritables gravures héliographiques, exécutées d’après le procédé que nous avons décrit dans le précédent chapitre, la collection de l’œuvre de Marc-Antoine Raimondi. Les deux spécimens qui accompagnent les dernières pages de notre notice (fig. 112 et 113) sont empruntés à cette publication. Seulement M. Baldus a bien voulu transporter en cuivre de relief, pour le tirage typographique, les planches en taille-douce qui servent à tirer les gravures héliographiques de sa belle collection de l’Œuvre de Marc-Antoine Raimondi.


CHAPITRE XXIII
Les services que la photographie peut nous rendre ne sont pas limités au domaine des sciences ; elle peut trouver dans la sphère des arts des applications d’un autre ordre, et nous devons examiner jusqu’à quel point et dans quelles circonstances elle peut devenir utile comme moyen d’étude dans les arts de la peinture et du dessin.
La question de la valeur artistique des œuvres photographiques, est encore très-diversement résolue ; il règne à ce sujet des opinions fort opposées. Quelques personnes, considérant l’inimitable perfection de détails que présentent ces dessins, sont disposées à placer les créations de Daguerre au rang des plus belles productions des arts. D’autres contestent d’une manière absolue leur valeur artistique. Il existe enfin une troisième opinion, d’après laquelle, tout en rejetant la valeur des productions daguerriennes comme œuvre artistique, on pense néanmoins que l’étude de ces copies si parfaites de la nature est susceptible de rendre de grands services aux études du dessinateur et du peintre.
Telles sont les opinions assez tranchées qui divisent les artistes sur la valeur des épreuves photographiques. Au point de vue de la métaphysique des arts, en ce qui concerne la pratique de la peinture et du dessin, cette question a son importance, et nous croyons nécessaire de la traiter ici.
Considérées dans leur valeur absolue comme objet d’art, les images photographiques présentent certaines imperfections qu’il est facile de signaler.
Les tons de la nature y sont altérés presque constamment. Si l’on a sous les yeux une épreuve photographique et son modèle, on reconnaîtra sans peine que les tons de la copie et ceux de l’objet reproduit sont loin de correspondre entre eux. Tel ton, vigoureux sur le modèle, est peu sensible sur l’épreuve fournie par l’instrument ; au contraire, une nuance lumineuse d’une faible valeur dans la nature, se trouve accusée sur l’épreuve, avec un éclat tout à fait exagéré. Aussi la plupart des demi-teintes sont-elles en général forcées ; il résulte de là que l’épreuve photographique est habituellement dure. Le regrettable effet dont nous parlons tient, sans doute, à ce que les différentes couleurs des objets extérieurs, ont une action propre et variable sur les substances chimiques qui recouvrent la plaque, action qu’il est aussi impossible de prévoir que de diriger. Personne n’ignore, par exemple, les difficultés que présentent la couleur verte et la couleur rouge pour la reproduction photographique.
En second lieu, dans les images photographiques, la perspective linéaire et la perspective aérienne sont faussées. L’altération de la perspective linéaire est la conséquence presque inévitable de l’emploi d’un appareil optique. Les objets placés à des distances inégales, ont des foyers lumineux distincts les uns des autres, et quelle que soit la perfection de l’objectif, il est impossible qu’il fasse converger en un même point les rayons lumineux émanant d’objets fort éloignés entre eux. Tout le monde a remarqué, par exemple, que dans un portrait, si les mains se trouvent placées sur un plan sensiblement antérieur au plan du visage, elles viennent toujours d’une dimension exagérée et tout à fait hors de proportion. C’est par la même raison que sur les portraits photographiques, les nez sont toujours amplifiés.
L’altération de la perspective aérienne est aussi la conséquence presque forcée du procédé photographique. La substance qui reçoit l’impression de la lumière est, relativement, plus sensible que notre œil même ; il en résulte que les aspects lointains, les objets situés à l’extrémité de l’horizon, sont reproduits avec plus de netteté qu’ils n’en présentent à nos yeux, c’est-à-dire contrairement aux effets de la perspective aérienne.
Un autre vice de la photographie réside dans son défaut absolu de composition. Le daguerréotype ne compose pas, il donne une copie, un fac-simile de la nature ; cette copie est admirable d’exactitude jusque dans ses derniers détails, mais c’est précisément là qu’est l’écueil. Une œuvre d’art vit tout entière par la composition. Le travail du peintre consiste surtout à atténuer un grand nombre d’effets secondaires, qui nuiraient à l’effet général, et à mettre en relief certaines parties qui doivent dominer l’ensemble. Quand un artiste exécute un portrait, il n’a garde de reproduire avec un soin minutieux, tous les plis des vêtements, tous les dessins de la draperie, toutes les enjolivures du fond ; il éteint ces détails inutiles, pour concentrer l’intérêt sur les traits du visage ; à cette idée capitale il sacrifie toutes les autres, volontairement et en connaissance de cause. Ne demandez à la photographie aucun de ces artifices salutaires qui sont l’indispensable condition de l’art. Elle est inexorable et presque brutale dans sa vérité. Elle accorde une importance égale aux grandes masses et aux imperceptibles accidents. Si elle prend une vue du Pont-Neuf, elle vous donnera un minutieux inventaire de tout ce qui est visible à la surface du Pont-Neuf. Vous pourrez y reconnaître toutes les pierres, tous les pavés et jusqu’aux écornures des pavés. Dans un portrait, elle se plaira aux arabesques infinies des draperies et des fonds ; elle donnera une valeur égale au point lumineux de l’œil et aux boutons d’un gilet. Mais du moment que tout a de l’importance, dans un tableau, rien n’a plus d’importance, et c’est ainsi que s’évanouit tout l’intérêt de la composition pittoresque ; car l’intérêt, dans une œuvre d’art, naît seulement de l’unité de la pensée.
Il serait puéril d’insister sur cette considération, qui est l’évidence même. Il faut seulement faire remarquer que ce défaut de composition a pour résultat de donner une représentation fausse de la nature. Lorsque nous recevons l’impression d’une vue quelconque, celle d’un paysage par exemple, tous les détails de la vue extérieure viennent sans doute s’imprimer au fond de notre œil ; cependant il est certain que ces mille sensations particulières ne sont aucunement perçues ; elles sont pour notre âme comme si elles n’existaient pas. Nous ressentons, non pas l’impression isolée des divers aspects du paysage, mais seulement l’effet général qui résulte de leur ensemble. Or, la photographie reproduit impitoyablement les plus inutiles détails de la scène extérieure ; il est donc vrai qu’elle donne une traduction inexacte des sensations que provoque en nous l’aspect de la nature.
Mais j’entends à ce propos se récrier quelques lecteurs :
« Eh quoi ! dira-t-on, la copie mathématique d’un objet peut-elle donner de cet objet une représentation inexacte ? L’identité est-elle un mensonge ? Je monte sur la terrasse de Meudon, un miroir à la main, et arrivé là, je dispose le miroir en face des perspectives séduisantes qui m’environnent. N’ai-je pas ainsi l’image la plus parfaite du paysage qui se déroule autour de moi ? Quel peintre, quel artiste vivant pourra s’élever jamais à la perfection d’une telle copie ? Or, que fait la photographie ? Elle fixe pour toujours cette image fugitive ; de ce miroir fidèle elle fait un fidèle tableau. Que venez-vous donc nous parler de représentation fausse et d’inexacte reproduction ! »
Cet argument n’est pas sans réplique. Évidemment toute la question se réduit à savoir si l’art réside ou non dans la stricte imitation de la nature. Or, l’erreur, si commune et si répandue, qui consiste à voir la perfection de la peinture dans la perfection de l’imitation matérielle, ne peut provenir que d’une confusion manifeste entre le but et le moyen de l’art. Qu’est-ce, en effet, que la nature ? Les réalités qui nous environnent, sont-elles les mêmes pour nous tous ? Ne changent-elles pas pour des individus différents, et même pour chaque individu, selon les dispositions de son âme ? Plaçons deux hommes en présence d’un grand spectacle naturel, en face d’un beau site, devant la tête d’un homme de génie : assurément tous les éléments de cette scène viendront identiquement affecter leurs yeux ; cependant chacun d’eux les verra d’une manière différente ; bien des effets de cet ensemble échapperont à l’un des spectateurs, que l’autre pourra saisir, et certaines particularités inaperçues de tous deux leur deviendront immédiatement sensibles, si l’on y dirige spécialement leur attention. Admettons maintenant que l’un de ces deux hommes soit peintre : comment pourra-t-il communiquer à son compagnon l’impression que ce spectacle lui fait ressentir ? Par quel moyen pourra-t-il la traduire avec son pinceau ? Certes, s’il se borne à tracer de cette vue un calque mécaniquement exact, une copie mathématique, il n’aura pas gagné grand’chose, car son compagnon aura toujours sous les yeux ce même spectacle dont il est impuissant à démêler la beauté. Pour exprimer l’impression qu’il a reçue, il faut donc que le peintre exécute une traduction plus compréhensible de l’original ; qu’il exagère certains effets, qu’il en atténue, qu’il en supprime d’autres ; il faut qu’il transforme pour rendre saisissable, qu’il altère le texte pour le rendre lisible ; il faut qu’il mente, en un mot, et ce n’est que par ce salutaire mensonge qu’il entrera dans les vraies conditions de l’art.

J’ai entendu raconter, à ce propos, une petite histoire, qui trouve ici sa place marquée. Il s’agit d’une compagnie de touristes, qui, pendant une excursion dans les Alpes, se trouvent tout à coup en face d’un site naturel d’un effet pittoresque. C’est une haute montagne, sur le penchant de laquelle un chalet se détache en silhouette déliée (fig. 114). La compagnie admire tout à son aise et se retire. Un artiste, resté seul, prend à la hâte un croquis de la vue ; il présente ensuite son dessin à ses amis. Il n’y a qu’un cri pour trouver l’œuvre détestable, et la copie bien différente de la réalité. La montagne était bien plus haute et le chalet bien plus petit ! « Notre montagne était une bonne et grosse montagne, dont le sommet semblait atteindre aux nues ; notre chalet, une étroite maisonnette à peine visible. La montagne que vous nous faites n’est qu’une colline efflanquée, et votre chalet est si grand, qu’il logerait sans peine toutes les vaches de la contrée ! » Cependant l’artiste, sûr de son fait, tient bon et maintient l’exactitude de son esquisse. On revient sur ses pas, on prend la peine de mesurer les hauteurs, et l’on reconnaît que la copie est mathématiquement fidèle.
L’artiste avait donc raison ? Non, l’artiste avait tort. Il ignorait comment, devant tous les grands spectacles naturels, notre imagination altère et dénature les sensations primitives. Il était étranger à une règle essentielle de son art ; sans cela il eût exagéré la hauteur de la montagne et diminué, relativement, les dimensions du chalet : ainsi il aurait exactement traduit l’impression qu’avait laissée dans l’imagination des spectateurs, le contraste de ce petit chalet et de cette montagne immense[41].
Il est donc vrai que l’art n’imite pas, qu’il transforme ; que pour traduire la nature, il s’en écarte ; que pour copier, il invente ; que pour reproduire, il crée. L’identité n’est pas le problème de la peinture ; sans cela le trompe-l’œil serait le nec plus ultra de la peinture, et les raisins de Zeuxis qui tentaient les abeilles, seraient la dernière page et la plus haute expression de l’art. Ce qui ressemble dans un tableau n’est pas précisément ce qui est semblable à la nature, mais seulement ce qui rappelle à notre âme l’impression que la nature y a laissée. Si l’on m’offrait de me montrer sur l’heure la tête de Louis XIV vivant, l’offre me toucherait peu. J’ai mon Louis XIV sous la main ; il vit dans les galeries du Louvre, il respire sous le pinceau de Mignard. Je préfère contempler le grand roi à travers l’âme d’un peintre de génie, qu’à travers le miroir même d’une trop fidèle réalité. Louis XIV pourrait avoir la colique, — il prenait tant de médecines ! comme nous l’apprend le Journal de la santé du roi[42] — ou sa grande perruque être mal accommodée ; au lieu du vainqueur de la Hollande, je trouverais peut-être l’esclave ridé de madame de Maintenon !
Ainsi, l’imitation n’est que le moyen des arts plastiques ; leur but, c’est de rappeler à notre âme les sentiments qu’éveille en nous la vue de la réalité. Dans un tableau, ce qui nous touche, ce qui nous émeut, ce n’est point la reproduction fidèle des objets qui nous entourent, mais bien cet ensemble de confuses pensées mystérieusement attachées à leur forme extérieure, et qui s’échappent du cœur à leur souvenir, comme à la vue de leur image. Le plus grand peintre est celui qui réalise le mieux cette harmonie secrète de nos sensations intimes et de la forme des objets extérieurs.
Avec les moyens les plus simples un artiste de génie sait émouvoir nos cœurs. Avec un coin de prairie, une chaumière à demi cachée sous de grands arbres, quelques vaches aux alentours d’un ruisseau, Claude Lorrain, Ruysdaël et Corot ont le privilége d’agiter profondément nos âmes, de nous plonger dans un monde de rêveries. L’impression provoquée par le pinceau du peintre, ne résulte pas de la vérité avec laquelle les objets sont reproduits sur la toile : elle naît seulement des ressouvenirs et des sentiments poétiques qu’éveille en nous l’heureuse et habile disposition des divers éléments de la scène champêtre. Le toit fumant de la maisonnette nous rappelle les joies tranquilles de la famille et du foyer ; le ruisseau qui murmure doucement sous les grands arbres, nous apporte comme un écho affaibli et lointain des harmonies rurales ; les fleurs à demi ensevelies sous l’herbe et la rosée de la prairie, nous rendent les parfums oubliés et les senteurs de nos champs ; le troupeau qui, à l’horizon, gravit péniblement la colline, nous envoie le grave enseignement du labeur fécond et béni de Dieu ; et tous les éléments de cette scène heureuse semblent se rassembler, pour nous offrir comme une représentation animée et vivante, où viennent se confondre toutes les harmonies, toutes les délices, toutes les félicités paisibles de la vie des champs.
Mais si, dans les arts, l’imitation, au lieu d’être un but, est seulement un moyen ; si les œuvres des grands maîtres vivent par la pensée qu’elles expriment et non par la vérité de la reproduction matérielle ; si le secret de la peinture, c’est de représenter, non l’aspect réel des objets, mais l’impression poétique dont ces objets sont pour nous l’occasion, il faut reconnaître qu’au point de vue des beaux-arts, les images daguerriennes sont d’une bien faible valeur. Obligé par la nature même du procédé dont il fait usage, de rassembler pêle-mêle sur sa glace collodionnée, et sans qu’il lui soit permis d’éliminer ou de choisir, tous les objets qu’embrasse le champ de sa lentille, l’opérateur doit forcément renoncer à cet artifice de la composition, qui est la condition nécessaire et la base des arts plastiques. Aussi quand elle reproduit les scènes changeantes du monde qui nous entoure, la photographie nous donne-t-elle des copies admirables ; mais c’est là tout. Le seul sentiment que ces calques merveilleux puissent exciter en nous, est celui d’une curiosité stérile, sentiment qui renaît à chaque exhibition nouvelle, et qui, par conséquent, renaît affaibli. L’admiration qu’ils inspirent parle à nos sens et ne va pas au delà : ils charment les yeux armés de la loupe, non l’esprit. L’œil est ravi, l’âme est muette. Il est donc permis de dire que la photographie ne saurait prétendre à nous donner des œuvres empreintes d’un véritable caractère artistique.
Il y a plus, les œuvres des photographes sont éminemment propres à mettre en évidence les principes qui viennent d’être rappelés. Ces principes sont, en effet, ou contestés par beaucoup d’artistes, ou bien mis par eux en pratique d’une manière purement intuitive. La photographie permet de trancher cette question. Si, en effet, un artiste, un philosophe, dans l’impuissance où il se trouvait de démontrer péremptoirement le principe de spiritualisme artistique qui nous occupe, se fût proposé d’imaginer quelque artifice propre à fournir de cette idée une preuve ou une représentation matérielle, il n’eût certes pas rencontré de moyen plus heureux ni plus décisif que l’instrument de Daguerre. Le problème en effet était celui-ci : Créer un instrument, une machine, un automate, capable d’accomplir toutes les opérations manuelles de la peinture, susceptible d’exécuter tout ce que comporte l’imitation absolue de la réalité ; puis, quand cette machine aurait accompli son œuvre, demander aux artistes si c’est à un tel résultat que s’employait leur génie ; demander à la foule si elle peut confondre ces produits mécaniques avec les sublimes créations de l’art. Cet artifice, la science l’a trouvé : la photographie a permis d’opérer dans les œuvres de l’art une analyse qui jusque-là avait paru impossible. Ce qui était intimement uni dans un tableau de Raphaël, si bien qu’on ne pouvait dire où commence la poésie, où finit le procédé, où commence la composition, où l’imitation s’arrête, le voilà nettement séparé. Sur une épreuve photographique on trouve réalisés, avec une perfection sans égale, tous les tours de force du dessin, toutes les subtilités du clair-obscur, tout ce que peuvent, en un mot, l’habileté technique et le procédé manuel ; mais la poésie, mais l’inspiration, mais ce divin reflet de l’âme humaine qui prête seul aux créations de l’artiste la vie, le sentiment et la pensée, tout cela manque à ces tableaux. C’est le corps moins l’esprit, c’est l’enveloppe d’une âme absente. Un simple regard jeté sur une image photographique suffit donc pour mettre hors de contestation le grand fait esthétique de la prééminence de la pensée sur l’imitation matérielle, de la poésie sur le procédé.
C’est en vain que, pour corriger les défauts des épreuves photographiques, on a recours au procédé de la retouche. On ne fait ainsi que changer les défauts primitifs de l’œuvre, en y surajoutant des imperfections d’un autre genre. Il faut s’élever avec d’autant plus de force contre l’emploi de ce moyen, qu’il est souvent mis en pratique avec une entière bonne foi, par des artistes qui ne craignent pas d’y consacrer un talent réel. Ces retouches faites après coup aux images photographiques, sont une dérogation aux règles de l’art. La première des qualités d’une œuvre plastique, c’est l’homogénéité. Deux manières différentes, deux procédés d’une nature opposée, ne peuvent se superposer, se marier dans une œuvre quelconque, sans en détruire l’harmonie. Chaque couleur appliquée sur une épreuve en diminue la valeur, et la détérioration est d’autant plus grave que le pinceau est entre des mains moins habiles. Remarquez de plus, qu’un premier pas fait dans une mauvaise route amenant forcément à parcourir la voie tout entière, la première rectification d’une épreuve conduit à retoucher, à recomposer, presque de toutes pièces, le dessin primitif. Un trait ajouté faisant tache sur l’ensemble, l’artiste est peu à peu conduit à harmoniser son tableau, non plus avec les tons de l’image photographique, mais avec ceux du crayon ou de la couleur surajoutés.
Une anecdote que M. Francis Wey a racontée, à ce propos, dans le journal la Lumière rendra ce raisonnement plus clair.
Le peintre Courbet remontait le Rhin entre Coblentz et Manheim, lorsqu’il fit rencontre, sur le bateau à vapeur, d’un jeune Prussien, qui s’en revenait tout joyeux de rapporter son portrait exécuté en Flandre, par M. Van Schaëndel. Ce portrait avait pour fond un rideau de velours bleu. Or, ce rideau bleu de ciel contrariait beaucoup le possesseur du portrait, qui aurait préféré, pour le fond de son tableau, un paysage des bords du Rhin. Il alla conter sa peine à Courbet, qu’il avait reconnu.
« Ce rideau me chagrine, lui dit-il ; je suis un peu poëte, je préférerais un ciel orageux. D’ailleurs j’ai peu de goût pour les rideaux, et j’en ai beaucoup pour le vin de Johannisberg. Nous passerons dans deux heures devant cet illustre coteau ; ne pourriez-vous le croquer au passage, pour en faire le fond de mon portrait ? »
Notre compatriote essaya en vain de résister ; il fut contraint d’attendre le coteau de Johannisberg, et d’en fixer, de son pinceau réaliste, les contours azurés sur l’arrière-plan de l’œuvre de Schaëndel. Mais voyez le résultat ! Ce beau travail accompli, le portrait se voila d’une teinte funèbre et s’évanouit, à demi effacé, dans les profondeurs du cadre. L’œil placé vers le fond avait perdu ses lueurs, en présence de la peinture violente de Courbet.
Le Prussien était consterné ; il fallut remettre l’œil en harmonie avec le fond. Mais, ainsi retouché, l’œil prit une saillie énorme ; il avait sur l’autre une avance de trois pieds, et chacun de s’écrier : « Le bel œil ! »
Effrayé de son œuvre, Courbet refusa de collaborer davantage avec le peintre flamand. Il débarqua à Manheim. Mais le Prussien, qui avait payé son portrait fort cher, ne pouvait se consoler de cet œil si mal accommodé. Il se précipita sur les traces du peintre français, le suivit à travers la ville, et l’entraînant dans un hôtel, le força de terminer l’arrangement du tableau. Le pauvre Courbet ne put y parvenir qu’en recouvrant la toile entière, sans y laisser subsister le plus léger accessoire. L’ouvrage terminé ;
« Voilà qui est parfait ! dit le Prussien ; ces petites retouches étaient bien nécessaires. »
Puis contemplant avec complaisance l’œuvre remaniée :
« Ah ! reprit-il en soupirant, si l’illustre Van Schaëndel pouvait revoir son chef-d’œuvre !
— Hélas ! dit Courbet en s’esquivant, il ne le reconnaîtrait guère ! »
Ces moyens malencontreux qui avaient défiguré l’œuvre de Van Schaëndel, nous les voyons mis en pratique par les photographes qui tapissent nos boulevards et nos rues d’images maculées par un absurde pinceau. Sous l’annonce de portraits, certains photographes présentent quelquefois des produits étranges, métis barbares croisés de la photographie et de l’aquarelle, dessins créés par le soleil, refaits par le fusain, silhouettes commencées par l’instrument de Daguerre, terminées par un pointillé au crayon de couleur, et qui, par la roideur et l’affectation de la pose, par le contraste heurté et la fausseté des tons, ne ressemblent à rien, sinon à l’aquarelle peignée d’une jeune demoiselle.
Cependant, si l’on doit refuser aux produits photographiques le caractère d’une œuvre d’art proprement dite, ce n’est pas à dire pour cela qu’ils soient inutiles aux progrès des beaux-arts. Ce serait aller contre l’évidence et être démenti par la pratique de tous les jours, que de refuser à la photographie toute espèce de rôle dans les arts. Quelle est donc son utilité propre ? C’est de servir de document à consulter pour les travaux des dessinateurs et des peintres.
Le peintre trouve chaque jour, des enseignements utiles en consultant la photographie, qui tantôt, procédant par masses à la façon d’un grand artiste, sacrifie, avec une merveilleuse intelligence, les détails secondaires au résultat final ; tantôt, s’appliquant à la reproduction minutieuse, rappelle, par son incomparable délicatesse, les plus fines pages de Miéris et de Gérard Dow. Le dessinateur trouve, pour la reproduction des monuments, des édifices et des paysages, un précieux auxiliaire dans l’épreuve photographique, qui lui montre comment les ombres et les lumières de son modèle se traduisent sur une surface plane. La photographie est encore d’un incontestable secours pour l’exacte reproduction de la figure et du détail anatomique. Un instant suffit pour arrêter sur le papier photographique, certains mouvements instantanés du corps humain dont le modèle vivant est inhabile à fournir le type fugitif : les images de ces mouvements, presque insaisissables par les moyens ordinaires, donnent au dessinateur des leçons autrement utiles que celles du modèle vivant ou de l’écorché anatomique. Dans le portrait, ce caractère essentiellement mobile de la physionomie, qui s’évanouit sur les traits de la personne qui pose, avec une rapidité désespérante pour l’artiste, cet air particulier, cette attitude, etc., dont l’ensemble heureusement reproduit constitue la ressemblance, sont saisis en un clin d’œil par l’instrument de Daguerre, et peuvent ensuite rester sous les yeux du peintre, comme un guide assuré dans l’exécution de son travail.
Il n’est aucun dessinateur qui voulût aujourd’hui se charger d’exécuter un portrait, sans avoir entre les mains la photographie du modèle. Combien de fois nous est-il arrivé, en demandant un dessin à l’habile artiste qui enrichit de portraits de savants ou d’inventeurs les Merveilles de la science, de le voir préférer, à la vue du personnage, son portrait photographique !
Ajoutons qu’une épreuve photographique donne l’aspect vrai du modèle ; cet auxiliaire est donc d’une grande utilité pour arrêter la main d’un artiste trop disposé à reproduire sans cesse le même type dont son crayon a pris l’habitude. Tous les portraits de Couture, de Dubuffe et de Winterhalter, tous les paysages de Diaz et de Corot, nous représentent la nature sous un même aspect, propre à l’esprit de chacun de ces artistes ; et, depuis trente ans, le caricaturiste Daumier refait chaque semaine, dans le Charivari, la même tête de bourgeois, incorrecte et hideuse. Il ne saurait en être ainsi avec la photographie prise pour guide ; il n’y aurait plus de manière en peinture, il n’y aurait que la vérité.
Si, comme moyen d’étude, la photographie est utile pour la représentation plastique du modèle vivant, elle est encore d’un grand secours pour l’étude des draperies, des vêtements et de tout l’accessoire obligé d’un tableau. Quelles difficultés n’éprouve pas un peintre à saisir les motifs si changeants des vêtements et des draperies, qui varient de situation, de forme et de rapports selon les mouvements du modèle, et qui, grâce à la photographie, peuvent être fixés en un moment dans une conformité absolue avec une pose donnée. Une fois ces draperies, ces accessoires, arrêtés dans leur spontanéité, l’artiste conserve ce type pour en faire un élément exact et rigoureux de la composition de son tableau.
Ainsi la photographie est un auxiliaire indispensable pour les études du peintre et celles du dessinateur. La chambre noire est un moyen nouveau qui est venu s’ajouter à ceux que les artistes possédaient déjà, un procédé de plus pour traduire matériellement l’impression que fait sur nous l’aspect de la nature. Jusqu’ici, l’artiste a eu à sa disposition le pinceau, le crayon, le burin, la surface lithographique ; il a de plus, maintenant, l’objectif de la chambre obscure. L’objectif est un instrument, comme le crayon ou le pinceau ; la photographie est un procédé, comme le dessin et la gravure ; car ce qui fait l’artiste, c’est le sentiment et non l’instrument. Tout homme heureusement et convenablement doué peut obtenir les mêmes effets avec l’un ou l’autre de ces procédés.
Aux personnes que cette assimilation pourrait surprendre, nous ferons remarquer qu’un photographe habile a toujours sa manière propre, tout aussi bien qu’un dessinateur ou un peintre ; de telle sorte qu’avec un peu d’habitude on reconnaît toujours, au premier coup d’œil, l’œuvre de tel ou tel opérateur. Bien plus, le caractère propre à l’esprit artistique de chaque nation, se décèle avec une singulière et frappante évidence, dans les œuvres sorties des différents pays. Vous devineriez d’une lieue un paysage photographique dû à un artiste anglais, à sa couleur froide, guindée et monotone, à la presque identité qu’elle présente avec une vignette anglaise. Jamais un photographe français ne pourra être confondu, sous ce rapport, avec un de ses confrères d’outre-Manche.
Nous ajouterons que l’individualité de chaque photographe demeure toujours reconnaissable dans son œuvre. Faites reproduire par différents opérateurs, un même site naturel ; demandez à différents artistes le portrait d’une même personne ; et aucune de ces œuvres, reproduisant pourtant un modèle identique, ne ressemblera à l’autre : dans chacune d’elles, tout ce que vous reconnaîtrez, c’est la manière, ou plutôt le sentiment de celui qui l’a exécutée.
Si donc l’objectif n’est qu’un instrument de plus dont nous disposons pour traduire l’aspect de la nature ; si le photographe conserve dans ses œuvres son individualité, sa manière propre, le sentiment qui le distingue et l’anime, on est bien forcé de reconnaître que la photographie peut rendre quelques services aux beaux-arts. Au lieu de n’y voir qu’un simple mécanisme à la portée du premier venu, il faut donc s’efforcer de la pousser plus avant encore dans la direction artistique ; il faut applaudir aux efforts de ceux qui travaillent dans cet esprit élevé, et souhaiter que leur exemple trouve beaucoup d’imitateurs.
Il faut d’autant moins dédaigner les documents que la photographie fournit aux études des élèves, comme à celles des maîtres, que cet art, bien compris, produit, on doit l’avouer, une échelle de tons infiniment étendue. Depuis la touche vaporeuse de Diaz jusqu’aux sombres intérieurs de Granet, tous les genres de peinture s’y trouvent représentés ; on y reconnaît avec surprise les manières opposées de différentes écoles qui ont tour à tour captivé l’admiration du public. Depuis les molles et vagues teintes du Corrège, jusqu’aux effets contrastés et audacieux de Rembrandt, les procédés si divers adoptés par les peintres de toutes les époques, se trouvent ainsi justifiés par la nature elle-même. Dans une suite de vues photographiques, on rencontre tour à tour un Metzu et un Decamps, un Titien et un Schœffer, un Ruysdaël et un Corot, un Van Dyck et un Delaroche, un Claude Lorrain et un Marilhat. Ainsi la photographie est venue consacrer les chefs-d’œuvre, si opposés dans leur manière, que l’opinion publique avait successivement exaltés ; et elle concilie, en les justifiant, nos prédilections respectives pour le style opposé des grands maîtres de l’art.
Pour peu qu’elle offre certaines qualités qu’il est facile de lui prêter, l’épreuve photographique d’un monument, d’un édifice historique, etc., sera toujours préférée à une lithographie, qui représente le même sujet avec une infidélité choquante, et sans aucun mérite comme objet d’art. Un portrait doux et ressemblant obtenu par la photographie, sera toujours supérieur à un médiocre portrait à l’huile, d’une ressemblance douteuse.
Les dessins, les gravures ou lithographies qui représentent des villes, des églises, des ruines, des statues, des bas-reliefs et des sujets d’architecture, ne peuvent entrer en lutte avec l’épreuve photographique, qui leur est mille fois supérieure sous le rapport de la vérité, de la précision et du fini. Quand on peut, pour un prix modique, posséder l’image fidèle du paysage préféré, du monument antique dont on a curieusement interrogé les vestiges, de l’édifice auguste dont on a admiré les proportions et l’harmonie, on laisse de côté les mauvaises gravures, les lithographies grossières, et tous les produits imparfaits sortis des bas étages de l’art.
Les œuvres photographiques, en se vulgarisant, auront pour résultat d’épurer le domaine des beaux-arts, en ce qu’elles rendront l’existence impossible à tout dessinateur médiocre. Les gens de métier, les hommes qui ne vivent que sur les pratiques du procédé manuel, seront contraints de disparaître ; les hommes supérieurs, ceux dont les travaux s’élèvent au-dessus du niveau des conditions communes, résisteront seuls à la révolution salutaire que nous verrons s’accomplir. En même temps, la comparaison des beaux produits photographiques avec les ouvrages de la peinture et du dessin, d’une part rectifiera le goût du public, et d’autre part, forcera les grands artistes à se dépasser eux-mêmes. En effet, la photographie traduit et représente les objets extérieurs avec une vérité admirable ; pour faire mieux qu’elle, l’artiste devra donner à l’interprétation plus d’importance qu’il ne lui en accorde d’ordinaire. Il faudra que l’individualité de l’artiste, il faudra que l’âme du peintre, passent plus profondément et brillent encore plus dans ses œuvres, pour qu’elles remportent sur les résultats d’un instrument qui réalise si bien à lui seul certaines de ces qualités. En forçant ainsi le peintre à imprimer davantage son cachet personnel à ses travaux, en l’amenant à placer l’interprétation et la poésie bien au-dessus de l’imitation matérielle, la photographie aura heureusement concouru à l’avancement des beaux-arts, et fourni un exemple aussi noble qu’imprévu, de la science offrant à l’art une main secourable, pour s’élever avec lui vers ce type de perfection idéale où tend l’humanité, et qui part de l’homme pour aboutir à Dieu.

- ↑ Description d’un procédé pour copier les peintures sur verre et pour faire des silhouettes par l’action de la lumière sur le nitrate d’argent (Journal de l’Institution royale de Londres, 1802, t. I, p. 170).
- ↑ Voici ce rapport de Carnot :
« Le combustible employé ordinairement par MM. Niépce est le lycopode, comme étant de la combustion la plus vive et la plus facile ; mais comme cette matière est coûteuse, ils la remplaceraient en grand par la houille pulvérisée, et mélangée, au besoin, avec une très-petite portion de résine, ce qui réussit très-bien, ainsi que nous nous en sommes assurés par plusieurs expériences.
« Dans l’appareil de MM. Niépce aucune portion du calorique n’est dissipée d’avance ; la force mouvante est un produit instantané, et tout l’effet du combustible est employé à produire la dilatation qui sert de force mouvante.
« Suivant une autre expérience, la machine placée sur un bateau qui présentait une proue d’environ deux pieds de largeur sur trois pieds de hauteur, réduite dans la partie submergée, et pesant environ neuf quintaux, a remonté la Saône par la seule action du principe moteur, avec une vitesse plus grande que celle de la rivière dans le sens contraire ; la quantité de combustible employée étant d’environ cent vingt-cinq grains par minute, et le nombre de pulsations de douze ou treize dans le même temps.
« Les commissaires pensent donc que la machine proposée sous le nom Pyréolophore par MM. Niépce est ingénieuse, qu’elle peut devenir très-intéressante par ses résultats physiques et économiques, et qu’elle mérite l’approbation de la classe. »
- ↑ La Vérité sur l’invention de la photographie ; Nicéphore Niépce, sa vie, ses essais, ses travaux, In-8, Paris, 1867, p. 42.
- ↑ V. Fouque, la Vérité sur l’invention de la photographie ; Nicéphore Niépce, sa vie, ses essais, ses travaux. In-8, Paris, 1867, p. 62-65.
- ↑ V. Fouque, la Vérité sur l’invention de la photographie ; Nicéphore Niépce, etc. In-8o , Paris, 1867, p. 67-69.
- ↑ Fouque, ouvrage cité, p. 69-71.
- ↑ La Vérité sur l’invention de la photographie, p. 71-72.
- ↑ La Vérité, etc. p. 77, 81.
- ↑ Ibidem, p. 81, 82.
- ↑ V. Fouque, la Vérité, etc., p. 87-90.
- ↑ Ibidem, p. 93.
- ↑ V. Fouque, la Vérité, etc., p. 94.
- ↑ Telle était la devise du célèbre potier, qui prouva pourtant, par l’exemple de sa vie, que la pauvreté peut gêner les bons esprits dans leur voie, mais qu’elle ne les empêche pas de parvenir. Bernard Palissy avait gravé sur son cachet cette douloureuse devise, que l’on trouve également inscrite autour d’un plat ovale de faïence émaillée, sorti des mains de l’immortel artiste. Le dessin représente un homme à moitié vêtu qui tend à s’élancer vers le ciel, ou vers Dieu, mais qui en est empêché par le poids d’une lourde masse de pierre, qu’il porte à sa main droite. C’est le symbole du pénible poids que traîne avec elle la pauvreté et qui l’empêche de parvenir.
- ↑ Guide du photographe. Paris, 1854, grand in-8, page 21.
- ↑ Cormeilles-en-Parisis est situé dans le département de Seine-et-Oise, canton d’Argenteuil, non loin de Franconville, sur la rive droite de la Seine.
- ↑ Les deux sujets qui devaient se remplacer sous les yeux du spectateur, étaient peints de chaque côté de la même toile, et c’est en éclairant cette même toile par devant, ensuite par derrière, que la première scène, devenant invisible, laissait apparaître la seconde seulement. Là était le secret de l’invention de Bouton et Daguerre.
Nous avons pensé qu’on ne lirait pas sans profit ni sans intérêt la description de la manière d’exécuter et d’éclairer ces tableaux. Nous allons donc reproduire la notice que Daguerre publia pour divulguer son procédé, après la récompense nationale qu’il reçut, en 1839, du gouvernement français, et qui s’appliquait à la découverte du diorama en même temps qu’à celle de la photographie.
Voici donc cette notice qui a pour titre : Description des procédés de peinture et d’éclairage inventés par Daguerre, et appliqués par lui aux tableaux du diorama.
procédé de peinture« La toile devant être peinte des deux côtés, ainsi qu’éclairée par réflexion et par réfraction, il est indispensable de se servir d’un corps très-transparent, dont le tissu doit être le plus égal possible. On peut employer de la percale ou du calicot. Il est nécessaire que l’étoffe que l’on choisit soit d’une grande largeur, afin d’avoir le plus petit nombre possible de coutures, qui sont toujours difficiles à dissimuler, surtout dans les grandes lumières du tableau.
« Lorsque la toile est tendue, il faut lui donner de chaque côté au moins deux couches de colle de parchemin.
premier effet« Le premier effet, qui doit être le plus clair des deux, s’exécute sur le devant de la toile. On fait d’abord le trait avec de la mine de plomb, en ayant soin de ne pas salir la toile, dont la blancheur est la seule ressource que l’on ait pour les lumières du tableau, puisque l’on n’emploie pas de blanc dans l’exécution du premier effet. Les couleurs dont on fait usage sont broyées à l’huile, mais employées sur la toile avec de l’essence, à laquelle on ajoute quelquefois un peu d’huile grasse, seulement pour les vigueurs, que du reste on peut vernir sans inconvénient. Les moyens que l’on emploie pour cette peinture ressemblent entièrement à ceux de l’aquarelle, avec cette seule différence que les couleurs sont broyées à l’huile au lieu de gomme, et étendues avec de l’essence au lieu d’eau. On conçoit qu’on ne peut employer ni blanc, ni aucune couleur opaque quelconque par épaisseurs, qui feraient, dans le second effet des taches plus ou moins teintées, selon leur plus ou moins d’opacité. Il faut tacher d’accuser les vigueurs au premier coup, afin de détruire le moins possible la transparence de la toile.
deuxième effet« Le second effet se peint derrière la toile. On ne doit avoir, pendant l’exécution de cet effet, d’autre lumière que celle qui arrive du devant du tableau en traversant la toile. Par ce moyen, on aperçoit en transparent les formes du premier effet ; ces formes doivent être conservées ou annulées.
« On glace d’abord sur toute la surface de la toile une couche d’un blanc transparent, tel que le blanc de Clichy, broyé à l’huile et détrempé à l’essence. On efface les traces de la brosse au moyen d’un blaireau. Avec cette couche, on peut dissimuler un peu les coutures, en ayant soin de la mettre plus légère sur les lisières dont la transparence est toujours moindre que celle du reste de la toile. Lorsque cette couche est sèche, on trace les changements que l’on veut faire au premier effet.
« Dans l’exécution de ce second effet, on ne s’occupe que du modelé en blanc et noir, sans s’inquiéter des couleurs du premier tableau qui s’aperçoivent en transparent ; le modelé s’obtient au moyen d’une teinte dont le blanc est la base et dans laquelle on met une petite quantité de noir de pêche pour obtenir un gris dont on détermine le degré d’intensité en l’appliquant sur la couche de derrière et en regardant par devant pour s’assurer qu’elle ne s’aperçoit pas. On obtient alors la dégradation des teintes par le plus ou moins d’opacité de cette teinte.
« Il arrivera que les ombres du premier effet viendront gêner l’exécution du second. Pour remédier à cet inconvénient, et pour dissimuler ces ombres, on peut en raccorder la valeur au moyen de la teinte employée plus ou moins épaisse, selon le plus ou moins de vigueur des ombres que l’on veut détruire.
« On conçoit qu’il est nécessaire de pousser ce second effet à la plus grande vigueur, parce qu’il peut se rencontrer que l’on ait besoin de clairs à l’endroit où se trouvent des vigueurs dans le premier.
« Lorsqu’on a modelé cette peinture avec cette différence d’opacité de teintes, et qu’on a obtenu l’effet désiré, on peut alors la colorer en se servant des couleurs les plus transparentes broyées à l’huile. C’est encore une aquarelle qu’il faut faire ; mais il faut employer moins d’essence dans ces glacis, qui ne deviennent puissants qu’autant qu’on y revient à plusieurs reprises et qu’on emploie plus d’huile grasse. Cependant, pour les colorations très-légères, l’essence seule suffit pour étendre les couleurs.
éclairage« L’effet peint sur le devant de la toile est éclairé par réflexion, c’est-à-dire seulement par la lumière qui vient du devant, et le second reçoit sa lumière par réfraction, c’est-à-dire par derrière seulement. On peut dans l’un et l’autre effet employer à la fois les deux lumières pour modifier certaines parties du tableau.
« La lumière qui éclaire le tableau par devant doit, autant que possible, venir d’en haut ; celle qui vient par derrière doit arriver par des croisées verticales ; bien entendu que ces croisées doivent être tout à fait fermées lorsqu’on voit le premier tableau seulement.
« S’il arrivait qu’on eût besoin de modifier un endroit du premier effet par la lumière de derrière, il faudrait que cette lumière fût encadrée de manière à ne frapper que sur ce point seulement. Les croisées doivent être éloignées du tableau de deux mètres au moins, afin de pouvoir modifier à volonté la lumière en la faisant passer par des milieux colorés, suivant les exigences de l’effet ; on emploie le même moyen pour le tableau du devant.
« Il est reconnu que les couleurs qui apparaissent des objets en général ne sont produites que par l’arrangement des molécules de ces objets. Par conséquent, toutes les substances employées pour peindre sont incolores ; elles ont seulement la propriété de réfléchir tel ou tel rayon de la lumière qui porte en elle-même toutes les couleurs. Plus ces substances sont pures, mieux elles réfléchissent les couleurs simples, mais jamais cependant d’une manière absolue, ce qui, du reste, n’est pas nécessaire pour rendre les effets de la nature.
« Pour faire comprendre les principes sur lesquels ont été faits et éclairés les tableaux du Diorama ci-dessus mentionnés, voici un exemple de ce qui arrive lorsque la lumière est décomposée, c’est-à-dire lorsqu’une partie de ses rayons est interceptée :
« Couchez sur une toile deux couleurs de la plus grande vivacité, l’une rouge et l’autre verte à peu près de la même valeur, faites traverser à la lumière qui devra les éclairer un milieu rouge, tel qu’un verre coloré, la couleur rouge réfléchira les rayons qui lui sont propres et la verte restera noire. En substituant un milieu vert au milieu rouge, il arrivera au contraire que le rouge restera noir, tandis que le vert réfléchira la couleur verte. Mais ceci n’a complètement lieu que dans le cas où le milieu employé refuse à la lumière le passage de tous ses rayons, excepté un seul. Cet effet est d’autant plus difficile à obtenir entièrement, qu’en général les matières colorantes n’ont pas la propriété de ne réfléchir qu’un seul rayon ; néanmoins, dans le résultat de cette expérience, l’effet est bien déterminé.
Pour en revenir à l’application de ce principe aux tableaux du Diorama, bien que dans ces tableaux il n’y eût effectivement de peints que deux effets, l’un de jour peint par devant, et l’autre de nuit peint par derrière, ces effets, ne passant de l’un à l’autre que par une combinaison compliquée des milieux que la lumière avait à traverser, donnaient une infinité d’autres effets semblables à ceux que présente la nature dans ses transitions du matin au soir, et vice versa. Il ne faut pas croire qu’il soit nécessaire d’employer des milieux d’une couleur très-intense pour obtenir de grandes modifications de couleur, car souvent une faible nuance suffit pour opérer beaucoup de changement.
« On comprend, d’après les résultats qui ont été obtenus au Diorama par la seule décomposition de la lumière, combien il est important d’observer l’état du ciel pour pouvoir apprécier la couleur d’un tableau, puisque les matières colorantes sont sujettes à des décompositions si grandes. La lumière préférable est celle d’un ciel blanchâtre, car lorsque le ciel est bleu, ce sont les tons bleus et en général les tons froids qui sont les plus puissants en couleur, tandis que les tons colorés restent ternes. Il arrive au contraire, lorsque le ciel est coloré, que ce sont les tons froids qui perdent de leur couleur, et les tons chauds, le jaune et le rouge par exemple, qui acquièrent une grande vivacité. Il est facile de conclure de là que les rapports d’intensité des couleurs ne peuvent pas se conserver du matin au soir ; on peut même dire qu’il est physiquement démontré qu’un tableau ne peut pas être le même à toutes les heures de la journée. C’est là probablement une des causes qui contribuent à rendre la bonne peinture si difficile à faire et si difficile à apprécier, car les peintres, induits en erreur par les changements qui s’opèrent du matin au soir dans l’apparence de leurs tableaux, attribuent faussement ces changements à une variation dans leur manière de voir, tandis qu’ils ne sont souvent causés que par la nature de la lumière. »
- ↑ Guide du photographe. Paris, 1854, in-8 « (Souvenirs historiques, page 18).
- ↑ Historique de la découverte improprement nommée Daguerréotype, précédé d’une notice sur son véritable inventeur, feu M. Joseph-Nicéphore Niépce, de Châlon-sur-Saône, par son fils, Isidore Niépce, Paris, Astier, août 1841, in-8o, p. 21.
- ↑ Ibidem.
- ↑ La Vérité sur l’invention de la photographie, p. 132.
- ↑ La Vérité sur l’invention de la photographie, p. 136-138.
- ↑ Victor Fouque, la Vérité sur l’invention de la photographie, p. 140-144.
- ↑ Ibidem, p. 149-151.
- ↑ Guide du photographe (Souvenirs historiques, p. 23).
- ↑ Historique et découverte du Daguerréotype, par Daguerre, in-8. Paris, 1839, p. 53-56.
- ↑ Historique et découverte du Daguerréotype, par Daguerre, in-8. Paris, 1839, p. 749.
- ↑ La Vérité sur l’invention de la photographie, p. 177.
- ↑ M. Dumas, dans un Discours sur l’invention, lu devant la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, a rendu pleine justice à Daguerre, qu’il avait connu, parce qu’il lui avait donné accès dans son laboratoire de la rue Cuvier. M. Dumas loue Daguerre de ne pas s’être contenté de produits imparfaits, d’une solution du problème par à peu près, mais de s’être appliqué pendant quinze ans à perfectionner ses procédés, jusqu’au moment où il put obtenir des épreuves irréprochables au point de vue de l’art. M. Dumas peint avec énergie les angoisses et les inquiétudes de tout genre qui tourmentèrent Daguerre à cette époque de sa vie : il le compare à un alchimiste du moyen âge. Il raconte même que vers 1824, il fut consulté confidentiellement par un membre de la famille de Daguerre, qui s’était émue de ses allures étranges, et qui craignait que sa raison fût menacée. (Bulletin de la Société d’encouragement, 1864, p. 198-199.)
- ↑ « …De cette union, dit M. Fouque, est né à Saint-Cyr, le 26 juillet 1805, M. Abel Niépce de Saint-Victor.
« Son père, afin de pouvoir être distingué de ses frères, avait ajouté à son nom, celui de sa femme ; et naturellement, M. Abel signe : Niépce de Saint-Victor.
« De cet exposé, il résulte que M. Abel Niépce de Saint-Victor est cousin issu de germain de Nicéphore Niépce, et non son neveu, ainsi qu’il en prend volontiers la qualification. Il est vrai qu’en Bourgogne, ainsi que dans d’autres provinces de la France, on donne habituellement, comme une marque de déférence et de respect, le titre d’oncle aux grands cousins : c’est ce que fait M. Niépce de Saint-Victor à l’égard de son illustre parent. » (La vérité sur l’invention de la photographie, p. 202.)
- ↑ Traité général de photographie, 5e édition, in-8, Paris, 1865, p. 169.
- ↑ 4e édition. Paris, 1864, in-8o, p. 203.
- ↑ Avril 1865.
- ↑ Monckhoven, Traité général de photographie, 5e édition, p. 356.
- ↑ Cosmos, 1860.
- ↑ Monckhoven, Traité général de photographie, 5e édition, pages 390-393.
- ↑ Ibidem, page 387.
- ↑ Voir page 109.
- ↑ Cours de microscopie complémentaire des études médicales, in-8o. Paris, 1844.
- ↑ On consultera avec fruit pour ce genre d’applications de la photographie l’ouvrage de M. Moitessier intitulé : La photographie appliquée aux recherches microscopiques, in-12. Paris, 1866.
- ↑ L’obligeant et distingué secrétaire de la Société de photographie, M. Martin Laulerie, m’a raconté un fait semblable. Il vit un jour arriver chez lui un photographe tout rayonnant de joie. Chargé de reproduire une vieille estampe, notre homme avait découvert, avec surprise, sur sa reproduction photographique, quelques lignes d’écriture manuscrite qui n’existaient point sur l’estampe. Ce succès inattendu exaltait outre mesure son orgueil. « Je suis tellement fort, disait-il, que je photographie non-seulement ce que je vois, mais encore ce que je ne vois pas : je suis le photographe du visible et de l’invisible. » Il était loin cependant de compter parmi les habiles de sa profession ; c’était un photographe de sixième catégorie, un photo-gnaf, comme on dit en termes d’atelier. Il faisait honneur à sa prétendue habileté de ce qui n’était que le résultat et l’accident heureux de l’art lui-même.
- ↑ Ce n’est pas sans surprise, et ce n’est pas sans plaisir que nous avons trouvé une confirmation de ce qui précède dans un écrit purement scientifique, dans l’ouvrage d’un géologue, que la nature de ses études et la direction de son esprit, ont tenu éloigné de tout ce qui se rapporte aux théories et à la pratique des arts. Dans ses Leçons de géologie pratique (t. I, p. 116), M. Élie de Beaumont rend, dans les termes suivants, un hommage involontaire à la vérité du principe qui nous occupe :
« Si le géologue n’est pas suffisamment exercé au dessin, il peut faire exécuter le paysage par un dessinateur. Mais il y a une grande différence entre un dessin dont les points principaux sont déterminés rigoureusement, et un dessin fait simplement à vue. Le dessin exécuté sans le secours d’aucun instrument est ordinairement plus pittoresque que le dessin levé rigoureusement, mais beaucoup moins fidèle. Quand on voit une montagne ; on se la figure toujours plus élevée qu’elle ne l’est ; on en dessine une véritable caricature. Quand on fait un croquis, pour indiquer les angles mesurés, on lui donne une forme géométriquement aussi semblable que possible à celle que l’on a devant les yeux, mais on fait involontairement la hauteur trop grande. Lorsqu’on réduit plus tard ce dessin, on est conduit à lui donner une forme beaucoup plus aplatie. Cela tient à une illusion d’optique qu’on n’est pas maître d’éviter, et qui fait que lorsqu’un dessin est exécuté rigoureusement, on ne le reconnaît presque pas ; il paraît beaucoup trop plat. Lorsqu’on veut faire un dessin que l’on reconnaisse bien, il faut doubler ou tripler les hauteurs données par les mesures.
- ↑ Journal de la santé du roi Louis XIV écrit de 1647 à 1711, par Valot, Daquin et Fagon, ses premiers médecins, Paris, in-8o, 1862. Voir aussi : Les Médecins au temps de Molière, par le Dr Maurice Raynaud, Paris, in-8o, 1862.

