Débauchées précoces/Texte entier

I
Dans la salle de départ de la gare, à Dijon, les voyageurs, prenant leur ticket pour le train de Paris, remarquaient un homme d’une cinquantaine d’années, qui allait et venait, avec au bras une fillette, fort jolie et fort élégante, de taille déjà assez élancée, pour qu’on s’étonnât des jupes courtes qu’elle portait encore.
Quelques personnes les connaissaient, car on les saluait fréquemment, et l’on finit par savoir que c’était l’oncle et la nièce, l’oncle, monsieur Paul Pleindinjust, président de tribunal, la nièce, mademoiselle Agathe Luneterre, âgée de quatorze ans, orpheline de père et mère, dont il était le tuteur.
Le tuteur accompagnait sa pupille à la gare pour la confier à un ami, qui acceptait de la ramener à un pensionnat, et cet ami n’apparaissait pas.
Une affaire importante obligeait le magistrat à s’en remettre à autrui d’un soin qu’il avait toujours rempli lui-même, et il éprouvait un vif chagrin à cette séparation avec une enfant qu’il aimait exagérément, et que la crainte des malins propos contraignait seule à faire instruire loin de lui.
Paul Pleindinjust était veuf, et une fillette aux yeux éveillés, à l’allure hardie, s’épanouissant sous son toit, dans la maison solitaire qu’il occupait à Saint-Abime, lieu de son siège judiciaire, n’eût pas manqué d’attirer l’attention sur sa sévère personne.
On dit qu’il n’y a de pires vertueux que les plus austères fripouilles, cet homme prêtait au dicton.
Sa nièce au bras, il la laissait se presser câlinement contre son épaule, il abaissait de temps en temps un regard aigu sur les yeux qu’elle levait, et on devinait qu’à l’émotion de l’oncle pouvait bien s’en joindre une plus intime, se rattachant à des rapports plus ou moins avouables avec la fillette.
Et leur étrange attitude éveillait aussitôt les curiosités !
Enfin, l’ami attendu arriva, et on l’accueillit avec la politesse cérémonieuse qui convient à des gens bien appris.
Célestin de Kulaudan, rentier et voyageur infatigable, domicilié à Paris, était cet ami. Possesseur de quelques biens dans les environs de Dijon, il réintégrait ses pénates, le jour même où, après ses vacances, Agathe devait repartir pour rentrer à son pensionnat ; il accepta sans difficulté la mission de la ramener, lorsque monsieur Pleindinjust, avec lequel il entretenait des relations, déjà anciennes, l’en sollicita.
Les billets pris, les bagages enregistrés, on passa sur le quai du départ : la nièce devenant plus affectueusement tendre pour son oncle, celui-ci eut sur le visage toutes les teintes des émotions violentes. Célestin, qui avait retenu un coupé, arrangea les petits objets de sa compagne de route et échangea quelques derniers mots avec le président ; le signal de monter dans les wagons fut donné, Agathe se jeta au cou de son oncle, et, non sans étonnement, Célestin, qui s’était penché à la portière ouverte pour lui tendre la main lorsqu’elle grimperait les marches, vit que ce baiser s’égarait jusqu’à réunir la bouche de l’homme mûr à celle de l’enfant.
— Tu me renvoies à Paris pour la dernière fois, oncle chéri, dit Agathe, tu me feras élever près de toi.
— Oui, pour la dernière fois.
Elle s’installa dans le compartiment ; la portière refermée par l’employé, elle sortit le buste au dehors de la vitre, l’oncle se tenait sur le marchepied, murmurant :
— Sois sage, ma mignonne, travaille bien, et je te garderai, je te le promets.
— Tu me l’avais déjà promis l’an dernier.
— Tu étais encore trop enfant, ma chérie, pour t’occuper de bien des détails domestiques, dont tu auras la charge.
Le sifflement de la locomotive ébranla la voûte.
— Adieu, au revoir.
— À bientôt.
Le train roulait. Célestin avait échangé un rapide salut avec l’oncle ; la nièce envoyait des signes avec la main ; la vitesse s’accentuait ; elle cessa les signes, sans quitter la portière, les yeux fixés sur les maisons qui fuyaient. Célestin l’étudia.

II
Debout près de la portière, elle demeurait, les yeux vagues maintenant, errant vers l’horizon ; elle ne s’apercevait pas de l’examen dont elle était l’objet ; le premier tunnel qui surgit la rejeta en arrière, l’arrachant aux pensées qui l’obsédaient. Célestin ferma la vitre pour empêcher la fumée de pénétrer et lui dit :
— Vous avez eu peur, Mademoiselle ?
— Non, j’ai été surprise.
Elle s’assit dans le coin qu’il lui abandonnait et se secoua la chevelure, le visage redevenu calme et souriant. Il reprit :
— Vous éprouvez du chagrin à retourner à la pension ?
— De quitter mon oncle surtout, il est si bon pour moi.
— Il vous témoigne une sincère affection.
— Oh oui, dit-elle avec un hochement de tête, il m’aime bien.
Elle se redressa pour regarder la campagne, le tunnel franchi, reportant de temps en temps les yeux sur son compagnon, qui avait déplié un journal.
Un nouveau tunnel la rassit et elle dit :
— Vous lisiez votre journal ?
— J’y jetais un coup d’œil.
— Les champs ne vous intéressent pas ?
— Oh ! j’en ai tant vu !
— Vous avez voyagé partout, à ce que m’a conté mon oncle ; vous devriez me dire des histoires.
Elle s’était rapprochée, tout contre lui, avec des yeux non timides. Il eut un frémissement en se rappelant le baiser surpris entre l’oncle et la nièce et répondit :
— Volontiers, Mademoiselle, tout à l’heure, quand nous en aurons fini avec les tunnels ! Je chercherai un point de comparaison entre les paysages que j’ai entrevus et la campagne que nous traversons, et je tâcherai de vous amuser.
— Oui, c’est cela, de m’amuser !
— Vous n’êtes plus triste !
— Oh, je ne le reste jamais longtemps.
Elle se leva, posa son chapeau sur le filet, et, debout, ramassant les jupes comme une petite femme, dont elle était bien comme un joli bouton de rose s’entr’ouvrant, elle ne s’occupa pas si elle le frôlait et l’embarrassait de ses frôlements.
Le dernier tunnel, surgissant brusquement, la fit trébucher par un mouvement de surprise effarée, et elle se laissa choir sur les genoux de Célestin, en disant :
— Que c’est bête, je n’y pensais plus, je croyais qu’il n’y en avait plus et j’ai eu peur.
Elle voulait se relever, Célestin la retint, elle n’insista pas et ajouta :
— Y en a-t-il encore beaucoup ?
— Nous sommes sous le dernier.
Que se passait-il dans l’esprit de Célestin ? Il n’aurait pas pu l’expliquer. Ce baiser, saisi entre l’oncle et la nièce, lui soufflait dans le sang des ardeurs incompréhensibles ; et cette enfant, assise sur ses genoux, excitait ses appétits sensuels : il bandait, il bandait, se demandant s’il n’allait pas se précipiter sur elle et assouvir la fougue furieuse qui s’emparait de son être.
Il en était le maître ! Nul n’interviendrait. Il n’existait pas encore entre les compartiments les hublots protecteurs qui imposent la sagesse aux amateurs de luxure sur les rails.
Un de ses bras avait glissé à la taille d’Agathe, elle lui sourit, et soudain, lui pinçant le menton, en gamine, elle s’écria :
— Vous avez des yeux qui regardent comme ceux de mon oncle.
Cette exclamation le rappela au sang-froid, il la tint moins serrée et répondit :
— Je n’ai pas cependant les mêmes yeux que votre oncle.
— Les mêmes, non ! Les vôtres sont noirs et les siens bleus ; mais ils ont la même expression, c’est drôle.
Elle posa la main sur celle avec laquelle il l’enlaçait, il dit :
— Qu’y a-t-il de drôle ?
— Ah, je ne sais pas ! Ce n’est pas à moi à expliquer !
Elle remuait la tête en personne de bon sens, qui entend être comprise, il reprit :
— Et si je vous embrassais, ma petite amie, m’expliqueriez-vous ce que vous trouvez de drôle dans mes yeux !
— Embrassez, pour voir.
Elle se pencha sur sa poitrine ; il l’embrassa sur le front : elle ne bougea pas ; il descendit le baiser sur le nez : elle ferma les yeux ; ses lèvres arrivèrent aux siennes : elle souleva les paupières et dit :
— Oh, vous pensez comme mon oncle !
Elle quitta ses genoux, il ne s’y opposa pas. Il sentait le rouge qui le brûlait aux oreilles, il commençait à s’effrayer de l’aventure qu’il prévoyait.
Elle était revenue à la portière : la campagne se déroulait dans ses coteaux bourguignons ; elle tourna légèrement la tête et lui dit :
— Il n’y a plus de tunnels ; vous ne comparez pas la campagne à celles que vous avez vues ; et les histoires que vous m’avez promises ?
Il se rapprocha du coin, ses jambes entourant les siennes, il répondit :
— Votre oncle vous conte-t-il des histoires ?
Elle eut un rire qui la secoua, et elle appuya la tête sur le rebord de la portière, développant ainsi la rotondité de ses hanches ; s’écria :
— Oh, des histoires ! Il passe son temps à m’en conter !
Célestin voyait trouble. L’enfant le provoquait. Il n’y avait pas à douter. Agathe demeurait immobile dans sa courbe penchée. Une dernière timidité le fit se reculer et dire :
— Eh bien, sitôt que j’aurai parcouru mon journal, je commencerai mes récits.
Elle releva la tête, avec une petite moue, et répliqua :
— Lisez, Monsieur, puisque votre journal vous amuse plus que ma conversation ! Je vais dormir, et je ne veux plus de vos histoires.
Elle s’installa dans le coin en personne digne et sage, les bras croisés, les yeux fermés.
C’était la femme dans toute sa coquetterie instinctive, dans toute sa science d’attirances sensuelles, qui s’offrait, sous les traits de cette fillette de quatorze ans, étalant, grâce à la position adossée qui ramenait les jupes courtes à hauteur des genoux, tout un bas de jambe, déjà correct dans sa structure.
Célestin se baissa sur un coude, envoya une main aux mollets et murmura :
— Oh, les jolis bas que vous avez, Mademoiselle.
Les yeux se rouvrirent, elle répondit :
— Et votre journal ?
Il paraissait absorbé dans l’étude du bas de la jupe, qu’il tenait du bout des doigts ; et peu à peu, il se coucha, la tête sur ses genoux.
Elle la lui prit des deux mains, l’appuya sur ses jambes et dit en riant :
— Voulez-vous faire nono et être mon petit bébé ?
Faire nono ! Sa tête aspirait les jeunes chairs de la fillette à travers l’étoffe ; une même chaleur les envahissait, il dit :
— Vous jouez au bébé avec votre oncle ?
— Quelquefois.
Sa tête s’était soulevée pour venir s’appuyer à la poitrine d’Agathe : elle la laissait approcher, sans s’alarmer ; elle se trouvait aguerrie ; elle sentit la tête près de ses épaules, près de la sienne ; elle lui tapota les joues avec les mains ; elle écarta les cuisses tout naturellement, quand les doigts de Célestin lui ayant ouvert le pantalon, touchèrent sa chair, et elle referma les yeux, quand tout doucement, ils lui chatouillèrent le bouton.
Le vertige dominait cet homme de quarante ans, jusqu’alors maître de ses passions ; il avait toujours aimé la femme, et les occasions de satisfaire ses goûts ne lui manquèrent pas : il avait voyagé les cinq parties du monde, usant des plaisirs en homme dont la bourse permettait toutes les folies ; il pouvait presque se considérer comme un blasé, et une gamine, une débauchée précoce infusait dans ses veines une effervescence inconnue.
Il tenait la main collée entre ses cuisses, se fermant à peine ; il donnait à l’enfant une sensation de doux émoi qui rejaillissait en lui et l’excitait à des luxures, non encore jamais caressées ; quelques poils follets attiraient ses doigts au ventre. Il devinait qu’il vivait une minute inoubliable où la destinée, s’arrêtant dans son évolution, livre l’être à des extases qui effacent tout ce qui fut auparavant.
Il buvait cet abandon de la fillette, comme on boit un verre d’excellent vin, agissant sur l’estomac et sur l’esprit par une chaleur pénétrante qui porte à trouver tout bien, tout beau.
Agathe, pour le faciliter dans son entreprise, avait posé un pied sur la banquette, et lui avait passé un bras autour du cou, le tenant ainsi mieux contre elle ; et l’éternité leur semblait conquise dans cette muette et voluptueuse caresse de la main masculine au joyau féminin aspirant à sortir des limbes.
Une brusque impulsion lui fit pincer la chair qu’il pelotait. Agathe serra les jambes d’abord, puis les lança en avant, et avant qu’il ne l’en eût empêchée, elle se retrouva droite, disant :
— Oh, le méchant !
Le sang bourdonnait à ses tempes ; il faillit bondir sur la fillette et la violer ; le bruit de la portière voisine qu’on refermait lui rendit sa raison.
— Qu’est-ce, interrogea-t-il ?
Agathe avait regardé au dehors après son exclamation et avait vu, elle répondit :
— C’est un employé.
En effet, leur portière s’ouvrait quelques instants après, et un inspecteur contrôlait les billets, sans rien remarquer de suspect chez cette fillette debout, en contemplation devant le paysage ; chez ce Monsieur, les yeux sur son journal.
De nouveau la solitude entourait les deux voyageurs.
Elle s’était assise à l’autre coin, et, enfant pour le moment, elle s’amusait à peler une orange, faisant des grimaces en dessous à Célestin.
— Vous avez faim, demanda-t-il ?
— Quelle bêtise ! Parce que je pelle une orange ? Non, monsieur, je suis gourmande et j’aime ce fruit.
— Gourmande de fruit !
Il déposa son journal et la rejoignit, pour la regarder de plus près, sans la déranger dans son importante occupation.
Elle avait le visage et l’attitude d’une femme arrêtée dans sa croissance ; mais les détails de la physionomie révélaient l’enfant, l’enfant qui n’est plus innocente et qui s’étudie à encourager le vice.
Les lèvres dessinaient des plis de moquerie et de câlinerie, qui se succédaient rapidement, les narines se dilataient comme à l’approche d’un désir sûr d’atteindre sa satisfaction ; et les yeux, oh les yeux, ils jouaient sous les cils avec les paupières et faisaient un poème de toute la tête.
Des instincts de brutalité harcelaient Célestin, il se sentait enveloppé d’un fluide extraordinaire qui le soudait à ce corps d’enfant !
Il avait cru aimer d’amour à son adolescence, il s’était battu pour celle qu’il aimait, elle était morte peu après, il avait estimé la blessure inguérissable, il avait surmonté cette sentimentalité du début dans toutes sortes d’aventures, il en riait à cette heure, et voilà qu’il suivait avec impatience ces petits doigts qui séparaient les tranches de l’orange, se demandant s’il allait les baiser ou les mordre, ou simplement les guider avec bestialité dans son pantalon.
On aurait dit qu’elle pressentait ce qui s’accomplissait dans son âme : elle souriait, gaminait de la tête, essuyait d’un coup de lèvre une goutte de jus qui tombait sur ses doigts, et elle lui dit soudain, tendant la main :
— Êtes-vous gourmand ? À vous de lécher cette petite goutte.
Il prit la main, la lécha, et elle lui introduisit dans la bouche une tranche.
— Mangez, Monsieur, s’écria-t-elle.
Elle retira la main, et d’un mouvement fou, brusque, il se déboutonna la culotte.
Il demeura indécis devant la tranquillité avec laquelle elle continua à absorber ses tranches d’orange, sans paraître apercevoir ce qu’il venait de faire, ni le blanc de la chemise qui se montrait à l’entrebâillement du pantalon.
— Oh oui, vous aimez bien les oranges, dit-il avec un peu d’humeur !
— Et vous ? Je vous en ai offert une tranche, si vous en voulez d’autres, demandez et dépêchez-vous.
Elle en suçait deux à la fois, savourant avec délices le jus sucré qui descendait dans son gosier.
La brutalité courait dans son sang : il ouvrit en plein son pantalon, releva la chemise jusqu’à la ceinture, exhibant son ventre poilu, et sa queue, d’une longueur moyenne, très pointue à l’extrémité et très droite.
— Et ce fruit-là, l’aimez-vous dit-il, en la saisissant à la taille et l’obligeant à regarder.
D’un mouvement sec et nerveux, plus fort qu’il ne l’eût supposé chez une fillette de son âge, elle se dégagea, lui tourna le dos et murmura :
— Oh, Monsieur, et si l’employé revenait.
Il en ressentit l’effroi, et il se rajusta tout sot, tout penaud. Elle tourna la tête par dessus l’épaule, une tranche d’orange encore sur la bouche, et fit signe qu’elle approuvait cette sagesse.
Il se leva pour se secouer les membres et à l’autre portière regarda la campagne, en aspira l’air pur, essaya de se reprendre, comprit que sa folie ne cesserait que devant un acte quelconque de satisfaction, se rassit, voulut se replonger dans la lecture de son journal. Elle avait fini son orange, s’était essuyé les doigts et, debout plaqua une main sur la gazette.
— Mademoiselle, murmura-t-il d’une voix rauque.
Il rejeta le journal sur la banquette, il saisit la fillette par la taille, elle se tordit comme un serpent, se baissant, se haussant, disant :
— Racontez-moi des histoires, monsieur, et dites-moi quel est votre prénom.
— Célestin. Quel est le vôtre ?
— Agathe.
— Gentil petit nom.
— Et il y a longtemps que vous connaissez mon oncle ?
— Assez longtemps. Ne luttez pas ainsi, petite folle, asseyez-vous sur mes genoux et causons.
— Non. Je veux m’asseoir à votre côté et je ne veux pas que vous me teniez.
— Ah, quelle nature !
Il la laissa ; elle donna un coup à ses jupes comme pour enlever les faux plis et lui tira la langue.
— Nous sommes fâchés ? reprit-il.
— Oui, brouillés. Vous n’êtes pas gentil !
— Que faut-il faire pour être gentil ?
— Être bien aimable.
— Et qu’appelez-vous être aimable ?
— Ne pas trop remuer et me raconter des histoires.
— Fi, de la vilaine camarade, qui commence à jouer, et qui, ensuite, ne veut plus jouer !
— Je veux bien jouer, mais je ne veux pas que vous me fassiez mal.
— Je vous ai fait mal ?
— Vous m’avez pincée.
— Ah !
— Et puis aussi vous ne faites pas attention si on vient ou si on ne vient pas.
— On est venu, on ne viendra plus.
— Vous croyez ?
— J’en suis certain.
Elle s’était installée près de lui et lui abandonnait la main qu’il caressait dans la sienne, et doucement elle obéit à son impulsion qui l’attirait contre son épaule ; elle ne retira pas la main quand il la posa sur sa culotte, près des boutons, qu’il défit de nouveau, et elle la glissa sous la chemise sans qu’il eût besoin de la relever comme tantôt, et d’elle-même elle prit la queue qu’elle pressa quelques secondes dans sa paume.
La tête à demi penchée pour voir le membre viril, elle lui présentait ses cheveux d’un blond fauve, et il les embrassa.
Ce baiser, elle le rendit par une tendre pression de main sur la queue, puis lui souleva la chemise comme il l’avait fait tantôt et appuya le visage sur son ventre, lui laissant ainsi supposer qu’elle allait le sucer.
Elle n’en fit rien. Elle ne bougeait pas plus qu’il n’avait bougé lorsqu’il se trouvait penché sur sa poitrine. Sa main ne lâchait pas la queue, et ses yeux l’étudiaient, fouillant l’homme dans sa masculinité.
Il respectait son immobilité, pour ne pas l’effaroucher, comprenant que c’était encore le meilleur moyen d’en obtenir ce qu’il voudrait, et l’impression infinie de béatitude qu’il éprouva en la chatouillant pour la première fois, il la ressentit de nouveau, emporté par une félicité d’attente qui dépassait de beaucoup les âcres délices de la possession.
Y avait-il une jouissance cérébrale ? Qu’était cette jouissance ?
Ah, les fous, qui se figurent avoir tout aspiré d’une femme après l’acte de possession ! Ils en dédaignent les plus délicats plaisirs ; ceux où les sexes en contact se tâtent au moral comme au physique, pour se pénétrer de leurs dissemblances, et de ce qu’elles comportent de mystérieux et de subjuguant.
L’homme désire la femme ! Il tourne autour d’elle, prêt à en accepter les caprices les plus idiots, et il devient le jouet de la femme, parce qu’il espère dans la domination de l’acte possessif pour la réduire. L’homme a glacé les effluves féminines qui ne s’échauffent plus que pour le serpent, et il ignore le plus petit mot de la volupté.
Cependant quand il désire, un baiser, une hardiesse, le moindre pelotage, lui apparaissent mets divins ; il ne sait pas intéresser la femme au plaisir qu’elle procure et il la fatigue de phrases creuses, inutiles. Il la possède, il ne parle plus.
Dans ce jeune corps féminin, contre lequel il se heurtait, Célestin, rompant avec ses habitudes, se laissait guider par ses impressions et, à son profond étonnement, il jouissait d’esprit plus que de corps, non pas que celui-ci ne participât pas à la fête, loin de là, mais parce qu’il demeurait dans son rôle d’affirmation vécue d’un désir courant à la satisfaction matérielle.
La tête de la fillette, plaquée sur le ventre de l’homme, s’incrustait à travers les muscles dans l’organisme entier du mâle, et cet organisme se concentrant dans la queue, celle-ci, en pleine érection, s’extasiait sous la main qui la tenait, semblant lire dans les yeux qui la contemplaient, l’ardeur de la femme, et tressaillait à la communion intellectuelle qui s’opérait entre ces deux êtres.
Peu à peu la tête d’Agathe se rapprocha, et elle déposa un baiser sur l’extrémité de la queue : l’étincelle électrique les secoua l’un et l’autre, elle se souleva pour lui passer les bras autour du cou et l’embrasser, il l’attira, elle se rendit à sa pression et se trouva à cheval sur ses genoux, ayant entre les cuisses la queue toute chaude et toute vibrante.
Qu’allait-il se produire ? Déjà il la ployait, déjà les jeunes cuisses pressées contre le gland de la queue en subissaient l’impérieux vouloir, le conin ne refusait pas l’attaque qui le menaçait. Célestin se déroba à la folie qui paralysait ses facultés, il la releva de ses genoux et dit :
— Veillons à ce que rien ne nous trahisse, quitte ton pantalon, ma petite.
Un peu lourde, elle s’empressa d’obéir sans plus de fausses manières.
Le pantalon ôté, fille de nature précautionneuse, elle le plia, le roula et l’enferma dans un sac.
Cette simple action apporta un calme relatif, et, sous prétexte de surveiller si le contrôleur ne revenait pas, il se reculotta, vint examiner par la portière.
Elle s’approcha par derrière, lui prit la main, la baisa et dit :
— Nous sommes comme de vieux amis, tu m’as tutoyée et je te tutoie.
Voulant s’amuser, il se retourna, s’agenouilla, et l’enlaçant, répondit :
— Tu es jolie comme une des plus belles fleurs de la création, ma chère petite Agathe, il convient que je te déclare mon amour.
— Ne te moque pas de moi, mon grand Célestin, je ne suis pas une bête, tu es content de me tripoter et moi aussi de te le faire.
À genoux, il avait fourré les mains sous les jupes et lui pelotait les fesses.
— Ah, Mademoiselle ! s’exclama-t-il, vous êtes bien rondelette là-dessous.
— Rondelette ! Oh oui, mon oncle adore mon cucu.
— Vraiment, vraiment ! Et comment en est-il arrivé à le voir, ton oncle ?
— Tu es trop curieux ! Tu fais comme lui, je te l’accorde, tu n’as pas à te plaindre.
— Oh, la petite cochonne qui sait jouer du cucu quand on l’embrasse !
Elle se mit à rire et répondit :
— On n’a pas besoin d’être embrassée pour le bouger. Puis, les filles entre elles s’instruisent.
— Tu t’instruis avec tes camarades ?
— Avec mes camarades, non ; avec une amie, oui.
Elle poussa un soupir.
— Tu penses à cette amie ?
— Hélas, elle est bien malheureuse.
Comme si l’évocation de l’amie avait jeté un froid, elle retira son cul des lèvres de Célestin et se rassit. Il l’imita et demanda :
— Pourquoi est-elle malheureuse. ?
— C’est toute une histoire, et c’est moi, qui alors en raconterai une ! Tu m’as fait parler d’elle, tant pis, causons-en. Tu as ravivé mon chagrin sans le vouloir, tu me consoleras.
— Un chagrin, mignonne, nous voici redevenus sérieux, quelle est ton amie ?
— La plus jolie fille de Paris, et le sort n’est pas juste pour elle. Nous nous sommes toujours aimées à la pension ; elle est mon aînée de six mois, s’appelle Rita Merrydoine. Son père et sa mère sont partis pour l’Australie, ils y sont morts. Nous sommes toutes les deux des orphelines, mais elle n’a plus un seul parent. Son père et sa mère sont morts sans rien lui laisser : on avait payé sa pension jusqu’aux vacances de cette année, on la gardait. Cependant, si rien ne survient pour elle d’ici au Jour de l’An, on s’en remettra à l’administration pour décider de ce qu’on en fera.
Des larmes perlèrent à ses yeux.
— C’est épouvantable ce que tu m’apprends-là ! s’écria Célestin.
— N’est-ce pas ? J’en ai parlé à mon oncle. Lui, il a peur, il dit qu’il a déjà bien assez d’une fillette comme pupille. Il paierait bien la pension, mais il prétend que ça aboutirait à semer de l’ingratitude et il m’a conseillé de choisir une autre amie.
— Il ne veut pas payer la pension ?
— À aucun prix ; il assure qu’ensuite, plus tard, ça prêterait à de mauvais propos.
— Quels mauvais propos ?
— On devinerait que nous sommes comme amant et maîtresse, il se perdrait et il me perdrait.
— Et depuis quand êtes-vous ainsi ?
— Tu me garderas le secret ? D’abord nous le sommes un peu tous les deux à présent. Voilà : c’est l’an dernier, aux vacances. Une nuit j’avais été malade et il m’avait veillée. Le lendemain, il assista à mon coucher, afin de se rendre compte si mon indisposition était bien passée, et sans y attacher d’importance, je changeai de chemise devant lui, riant toute nue. Il me prit le cucu dans ses deux mains, dit que j’avais l’air d’une petite femme. Ça me fit plaisir et je m’amusai beaucoup parce qu’il me regarda de tous les côtés, puis parce qu’il m’embrassa, je compris bien vite qu’il cherchait les cochonneries, je fus toute heureuse de la chose. Ce soir-là, il se contenta de me caresser, le reste vint ensuite tout naturellement.
La pensée des voluptés enseignées par son oncle, avait chassé de son esprit l’image de son amie ; attirée par Célestin, elle se réinstalla sur ses genoux.
— Petite femme, petite femme, dit-il, tu es une vraie petite femme.
— Tu as raison, amusons-nous, ça dissipera les idées tristes.
Il cherchait ses lèvres, elle les tendit, une longue caresse les secoua jusqu’à la moelle des os, les colla l’un à l’autre.
— Dis, comment veux-tu t’amuser ? murmura-t-elle.
— Eh, de toutes les manières.
Elle rit, les lèvres sur sa bouche et répliqua :
— Moi aussi.
— Ton oncle, comment s’amuse-t-il ?
— Il me met toute nue sur ses genoux, et lui est aussi tout déshabillé ; nous ne pouvons pas faire ça en chemin de fer.
— Replace-toi comme tout à l’heure.
— À cheval ?
— Oui.
Elle y fut promptement et sentit de suite la queue de Célestin qui la chatouillait aux cuisses. Elle se pressa tout contre sa poitrine, la queue glissa jusqu’à la raie de son cul, mais l’exaltation de Célestin était telle cette fois, qu’il la tint serrée dans ses bras, s’agitant au-dessous pour se masturber par le frottement de ses chairs.
Elle avait sans doute l’expérience de la chose, elle exécuta elle-même la manœuvre, et tout d’un coup, l’éjaculation se produisit, l’éclaboussant jusqu’au nombril.
En femme, qui en connaît la valeur, elle la laissa se terminer, la tête cachée sur les épaules de Célestin, ne remuant plus pour ne pas le gêner ; quand il eut achevé de jouir, elle releva les yeux humides de plaisir, et dit :
— Oh, le fusil est parti, donne-moi ton mouchoir pour m’essuyer.
— Dans un instant.
— Attends que je remonte ma chemise, tu m’as mouillée bien haut.
Il ne la contraria pas dans cette précaution ; pendant quelques secondes il savoura son étrange bonheur. Puis, il lui passa son mouchoir, elle se dressa, il la vit se nettoyer avec une habileté consommée, effaçant les moindres taches de sperme qui pourraient la compromettre. Ainsi séchée, elle ouvrit un sac de voyage, en sortit un flacon de Lubin, en versa plusieurs gouttes sur le mouchoir, et s’en imbiba les chairs.
Toute gaie ensuite, elle le rendit, en disant :
— Tu auras un souvenir de moi.
La femme s’affirmait dans la connaissance de son individualité chez cette fillette.
Elle reboutonna le pantalon de Célestin et ajouta :
— J’aurais cru que ce serait plus long !
— Ce n’est pas fini, s’écria-t-il.
— Je sais bien que si.
— Tu le verras ! Tu voudras bien encore !
— Encore ! Bien vrai ?
— Oui, après la station.
— Moi, je ne demande pas mieux.

III
Le temps ne suspendait pas sa marche, le train avançait au milieu de ces séduisants exercices.
À cette époque, on s’arrêtait à Tonnerre assez longuement pour le repas ; on arrivait à cette station.
Célestin et sa petite amie descendirent de leur compartiment, en personnes graves, et se dirigèrent vers le buffet. On prit place à table, on mangea.
Le quadragénaire admira la parfaite aisance de la fillette, qui bien équilibrée sous le rapport du rôle de son sexe, afficha la plus incontestable candeur du monde. Elle sut observer le maintien qui convenait à son âge, répondre avec discrétion aux quelques lambeaux de phrases de son compagnon.
Ils se retrouvèrent dans leur coupé, et sitôt le train en route, elle s’assit sur ses genoux, s’appuya sur son épaule, les yeux implorant, murmura :
— Il m’est venu une idée !
— Laquelle, mignonne ?
— Tu es maintenant mon amant, par conséquent je puis te parler sans crainte.
— Je te le recommande, ma charmante.
— Sais-tu ce que tu devrais faire ?
— Apprends-le moi vite.
— Retirer Rita de pension et la prendre avec toi.
— Hein !
— Juge comme ça arrangerait les choses ! Tu voudras recommencer ce que nous avons fait : si tu as Rita avec toi, tu pourras me prendre les jours de sortie, et tu devines ! ! !
— Et Rita, qu’est-ce qu’elle fera ?
— Bêbête, vous vous amuserez ensemble, et quand j’y serai, nous nous amuserons tous les trois.
Il resta sans trouver un mot devant cette assurance.
— Tu la retireras, dis, reprit-elle ?
— À quel titre ?
— On ne veut pas la garder à la pension, n’est-ce pas ? Tu diras que tu es un de ses parents : au besoin, j’écrirai à mon oncle qui l’assurera, et tu l’emmèneras.
— Mais, ça ne se passe pas ainsi ?
— Je t’assure que si. Je commencerai par prévenir ces dames et Rita : tu leur conteras que tu arrives d’Amérique, que tu es son cousin. Le père et la mère te l’ont confié en mourant.
— Que faisaient-ils ?
— Le père s’occupait d’agriculture, la mère de rien, elle était toujours malade.
— L’enfant est peut-être maladive ?
— Rita ! Elle est superbe ! Tu l’aimeras, j’en suis sûre.
— Tu es folle.
— Je le suis, d’elle.
Connaissait-elle déjà l’argument irrésistible, elle se replaça à cheval sur ses genoux, tendit les lèvres qu’il ne refusa pas.
— Aventure qui peut devenir dangereuse, murmura-t-il.
— Comment dangereuse ! Rita prévenue, et qui ne demandera pas mieux que de quitter la pension, te sautera au cou comme à un vrai parent, dès qu’elle te verra, personne ne doutera de vos liens de famille.
— Qu’en ferai-je ? Je vis seul, et je voyage beaucoup.
— Vous vivrez à deux, vous voyagerez ensemble. Puis, tu la marieras, si elle t’embête. Quel homme, d’hésiter à prendre une jolie petite fille !
Elle le câlinait, le baisotait, sentant que, comme il l’avait dit, la partie, loin d’être terminée, commençait à peine.
— Tu as le diable dans les veines, dit-il, mais il y a une difficulté à ton beau plan.
— Laquelle ?
— Je dois te remettre en gare à la personne envoyée du pensionnat, pour te recevoir.
— Il n’y aura personne à la gare.
— Allons donc.
— J’ai gardé la lettre de mon oncle, prévenant ces dames de mon retour ; j’en ai mis une autre à la place, l’enveloppe et le papier en blanc.
— Dans quelle intention ?
— Parce que… parce que, je savais que tu me raccompagnais et que j’étais décidée… à tout, pour te parler de mon amie.
— Tu ne m’en as causé que par occasion.
— Le penses-tu ! Oh que…
— Oh que ?
— Si tu le veux, je resterai toute la nuit avec toi.
— Tu dis !
— Oui, oui : demain, tu me mettrais en voiture pour me renvoyer à la pension, et je conterai que nous sommes arrivés ce matin, que tu n’as pas eu le temps de me ramener.
— Et si ton oncle l’apprend ?
— Mon oncle ! Il n’a qu’à m’obéir.
Le ton était très ferme, Célestin observa :
— Cela ne l’a pas empêché de te refuser ce que tu lui demandais pour ton amie.
— Il avait quelque raison au fond. Elle l’enveloppait de ses cajoleries, lui tirait la moustache, l’embrassait, se balançait même sur ses genoux, s’amusait même à lui serrer les jambes entre ses cuisses ; et toute son ardeur le ressaisissait, le troublant dans son jugement, lui dévoilant des lubricités inappréciables avec de telles fillettes.
Elle était femme et elle était enfant, elle jouissait d’un attrait de fruit défendu qui le bouleversait, il lui envoya la main au cul sous les jupes, elle lui appliqua un gros baiser sur les lèvres, en disant :
— Ah, tu y retournes ! Dis, tu me garderas toute la nuit : nous nous mettrons nus, comme je fais avec mon oncle, tu m’assoieras sur tes genoux, tu me gâteras bien, tu verras comme c’est bon.
— Te garder, te garder ! Nous commettrions une grosse sottise.
— De quoi as-tu peur ? Je prends tout sur moi ; tu retireras mon ami, dis ?
Elle pressait les fesses sous la main qui les manipulaient, elle arrangeait sa robe et ses jupes pour qu’elles n’entravassent pas le pelotage, elle posait ses genoux sur la banquette, par dessus ses jambes, pour encore mieux le faciliter, elle se soulevait pour qu’il la carressât sur tous ses charmes ; il suspendit son jeu pour répondre :
— Voyons, réfléchissons à cette détermination, et causons.
Elle quitta de suite ses genoux, s’assit près de lui, et répliqua :
— Tu veux ou tu ne veux pas.
— Premier point, je te garde cette nuit, mauvais sujet de fille ; je te conduirai dans un hôtel, il n’est pas nécessaire que ma domestique te connaisse avant l’heure.
— À l’hôtel ! Je ne demande pas mieux, ça me paraîtra drôle, comme si j’étais tout à fait libre.
— Tout à fait libre ! Quand tu le seras, je plains ton mari.
— Je ne me marierai pas.
— Pourquoi ça ?
— Je veux être cocotte.
Il demeura encore une fois abasourdi et s’exclama :
— Cocotte ! Sais-tu seulement ce que c’est ?
— Certainement, c’est s’amuser à sa fantaisie avec les hommes.
— Qui t’enseigne cette morale ?
— Personne. On se doute de bien des choses : à la pension, il y a la fille d’une de ces femmes, elle a toujours les plus beaux cadeaux.
— Ton oncle t’a mise dans une institution suspecte.
— Suspecte, oh non ! Les demoiselles Maupinais sont des personnes pieuses et sévères, qui ne soupçonnent rien. On parle entre élèves : la fille de la cocotte, Bernerette de Cœurvolant bavarde quelquefois avec Rita et avec moi ; elle sait par la servante de sa mère les amants qu’elle a. Elle est rigolboche lorsqu’elle nous conte ces histoires. J’en étais un peu jalouse pour Rita, parce que Rita l’aimait presque autant que moi, mais depuis des mois, elle me préfère.
— Revenons à nos projets : donc, je te garde cette nuit, et demain tu rentreras seule à la pension. Si ton oncle l’apprend, que lui dirons-nous ?
— Que nous n’avons trouvé personne à la gare pour me recevoir, que tu t’es foulé le pied en descendant de wagon, que je n’ai pu te laisser seul. Ce n’est pas malin, on n’ira pas voir.
Il eut une telle admiration à une si prompte réponse, qu’il la prit à bras-le-corps et l’embrassa avec frénésie sur tout le visage.
Toute souriante, elle reprit :
— Tu retireras Rita !
— Eh bien oui, je la retirerai, par curiosité de l’aventure ! Tu aviseras ton oncle pour le cas où j’aurais besoin de son concours, mais tu ne préviendras que ton amie, afin qu’elle joue bien son rôle : il faut que j’emporte la situation auprès de tes maîtresses, par la surprise que je leur procurerai.
— Bien combiné, tu es un brave camarade.
— Maintenant, ne faisons plus de sottises, pour ne pas nous exposer bêtement à des désagréments, regarde par la portière, si ça te distrait, je vais fumer une cigarette.
— Puis-je remettre mon pantalon ?
— Non.
Elle s’approcha crânement de la portière, esquissant une révérence en passant devant lui, et demanda :
— Veux-tu que je t’éclaire une allumette ?
— Petit démon !
— Si tu touches mes mollets, tu triches, puisqu’il est défendu de faire des sottises !
— Et ton cucu !
— Il n’est pas permis non plus de le toucher.
— Ne pas le toucher non plus.
Il déposa sa cigarette, et, agenouillé derrière la fillette, il fourra la tête sous ses jupes.
Elle ne résista pas ; il la tourna, la retourna, disant :
— Lève haut tes jupes, que je te voie partout et que je t’embrasse ; je fumerai après.
Elle obéit, il lui baisa le nombril, le ventre, les cuisses, le conin, les genoux, puis toute la jambe et tout le cul.
— Ça sent-il le lubin, interrogea-t-elle ?
— Un lubin mitigé, qui n’est pas désagréable.
Il se redressa et alluma sa cigarette.
La nuit était survenue, on ne voyait plus la campagne, ils devisèrent de choses et autres, cherchant à s’intéresser à tout sujet qui ne leur rappelait pas la luxure ; mais, insensiblement, on y revenait, ils s’échauffaient par de petits baisers, de petits attouchements, de rapides visions de leurs sexualités.
— Montre-moi ton gros machin, dit-elle, rien qu’à travers un bouton.
— La tête même n’y passerait pas.
— Défais-en deux.
— Il sortit juste le gland, qu’elle toucha et voulut embrasser.
— Que faisais-tu avec ton oncle questionna-t-il ?
— On rêvait beaucoup, on se regardait partout, sur tout le corps, on se touchait.
— Il t’embrassait sous tes jupes ?
— Oui, de tous les côtés.
— Tu l’embrassais ?
— Moins souvent. Il aimait de m’asseoir sur ses genoux, de me tenir couchée dans ses bras, de me fouetter le cucu ; puis, quand ça lui venait, nous nous étendions sur le tapis, il se mettait tout de son long contre mon dos, glissait son rouleau dans mes fesses, les frottait avec, et tout d’un coup, il me mouillait.
— Il ne te faisait pas mal ?
— Non, c’était très, très doux.
— Il n’essayait jamais de te l’entrer ?
— Où ?
— Dans le petit trou.
— Ça ne se peut pas ?
— Qui te l’a dit ?
— Oh, ça ferait crier.
— Tu ne seras jamais une femme.
— Aux femmes, on l’entre dans le trou ?
— Dans celui du cul et dans celui du devant, en les dépucelant.
— Sors-le tout à fait de ta culotte, que je juge si c’est possible…
Il se déboutonna, de nouveau exhiba sa queue en érection. Elle la soupesa dans la main, hocha la tête et murmura :
— Tu me dis des bêtises, ça ne peut pas entrer.
— Viens vite à cheval par dessus, comme tantôt ça veut pleurer.
— Bien vrai ! Attends que je relève ma chemise.
Elle se troussa, se dégagea toutes les jambes et, cette fois, s’assit en conscience sur la queue de Célestin, dont le gland courut la chatouiller au nombril.
— Ne le monte pas si haut, dit-elle, il me mouillerait à la ceinture.
Elle le rangea elle-même dans ses cuisses et refit le jeu de la masturbation que certainement elle avait dû apprendre de son oncle.
— Ça te chatouille, dit-il !
— Oh, ça fait bon, ça fait bon, et toi, quel effet ressens-tu ?
— Ça m’arrache du jus !
— Oh oui, on dirait que tu me frottes avec un velours humide, et quand tu approches du petit bouton, j’ai la tête qui tourne. Oh, oh, ça te vient, oh, ça y est.
Elle se pressa contre son ventre, lui attrapant ses lèvres pour les baiser, elle sursauta sous l’ondée qui la polluait.
Elle fermait les yeux. Elle dit dans un souffle :
— Ce que tu mouilles bien !
Il achevait à l’aise son éjaculation ; il lui repassa le mouchoir, elle se nettoya avec la même sérénité que la première fois, ressortit le flacon de lubin, s’en réimbiba les chairs, et souriante, dit :
— Et si tu mouillais en dedans, comment je le nettoierais ?
— Avec de l’eau parfumée.
— Il n’y en a pas ici : ça resterait dans mon cucu, ou dans le devant ; où, ça ferait l’effet d’un lavement, et alors…
Elle partit d’un grand éclat de rire et ajouta :
— Oh, le vilain, il voulait m’obliger à faire caca devant lui !
Elle était mignonne au possible dans l’arrangement de sa chemise dans son exclamation, il l’attira pour l’embrasser, et comme il n’avait pas encore enfermé sa queue, elle crut qu’il allait recommencer, se troussa en s’écriant :
— Tu veux encore mouiller ?
— Non, non, plus tard, reviens sur moi que je sente tes chairs et ta chaleur.
— C’est toi qui brûles !
Célestin ne se rendait pas compte du vertige qu’il subissait. Il jouissait du contact de cette chair, après avoir joui de l’entente voluptueuse amenant l’éjaculation, éprouvant une joie extrême à l’étroit enlacement qui maintenait la fillette sur ses genoux, leurs bras autour du cou.
Le train filait, filait, en approchant de Paris, ils se séparèrent pour réparer le désordre de leurs vêtements, elle remit son pantalon, chantonna un petit air guilleret, toute au plaisir qu’elle se promettait pour sa nuit, au triomphe obtenu pour son amie.
Descendant du train, ils étaient calmes, comme si rien d’extraordinaire ne se fût accompli entre eux, et il donna au cocher, dans la voiture duquel ils grimpèrent, l’ordre de les conduire à l’hôtel du Dauphin d’or.
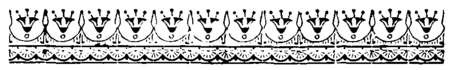
IV
Ils s’installèrent dans deux chambres communiquant et il la mena souper pour bien la préparer à leur duo.
Que se tramait-il dans son esprit ! Voulait-il endormir ses défiances, pousser l’aventure à ses extrêmes limites, jusques et y compris la possession ! Ses yeux flamboyaient : il la faisait boire, on aurait dit que la tunique de Nessus le travaillait, tant il manifestait de l’agitation.
Cette enfant lui portait à la peau.
Ses sourires, ses regards, ses jeux de physionomie, rappelant sans cesse le secret de luxure qui existait entre eux, lui piquaient le sang, émoustillaient ses désirs. Il éprouvait des tressaillements, où il évoquait des images du marquis de Sade, et où il lui semblait possible, dans son effervescence charnelle, de se délecter du sang de cette débauchée précoce, au milieu d’une pâmoison, où il la trouerait d’un coup de poignard.
Il y a de ces folies dans les dépravations excessives.
Le chasseur qui court le sanglier, le cerf, ne se contente pas du coup de feu qui abat la bête, il se réjouit à la scène de la curée, se plaît au spectacle des chairs de l’animal déchirées par la meute ; le luxurieux, à l’affût d’une fantaisie, tuera sa bien-aimée, pour se repaître de ses yeux mourants, de ses plaintes, de ses reproches, de ses souffrances.
Inconsciemment, Agathe allumait un incendie dont elle pouvait être la victime. Le souvenir de l’oncle, du magistrat de Pleindinjust, la protégeait. Il avait remis sa charge à Célestin, Célestin devait restituer son dépôt sous peine des gendarmes.
Mais, la possession l’exposait-elle aux gendarmes, avec cet oncle facile à réduire au silence !
Il étudiait cela au restaurant, où il soupait en tête-à-tête avec la fillette, et en rentrant au Dauphin d’Or, où ils s’étaient inscrits comme le père et la fille.
Il avait su choisir la chambre à l’abri des indiscrétions des murs percés, à l’extrémité d’un couloir, n’ayant d’autre voisine que celle réservée à Agathe. On ne pouvait passer dans le couloir sans qu’il entendît ; on ne pouvait voir à travers les serrures, grâce aux tentures, puis, on ne pouvait le soupçonner.
Un grand feu pétillait dans la cheminée ; Agathe, non encore dévêtue, s’y chauffait les pieds ; il se promenait de long en large, fumant un cigare, ne disant rien.
Elle rêvait de son côté, quelle nuictée s’apprêtait !
Son jeune corps vibrait à mille désirs impérieux, elle pressentait que son horizon de félicités allait s’élargir.
À quoi bon se presser ! Elle comprenait cette attente d’un plaisir assuré ; elle se comparait à une petite souris dont un gros chat ferait bientôt sa proie, sa proie de bonheur, en lui procurant une bonne partie.
Elle guignait du coin de l’œil, elle souriait dans toute sa personne, elle guettait le chat.
Les yeux échangèrent les premières attaques, s’entrecroisèrent, trahirent l’afflux du fluide mâle et du fluide femelle s’élançant l’un à l’autre pour inciter aux folles ardeurs.
L’œil de la fillette brillait d’une malice endiablée, celui de Célestin, d’une volonté froide d’aller aussi loin que possible.
L’homme et l’enfant se mesuraient dans la valeur de leurs moyens, ils étaient de force à la lutte.
Acceptait-elle, et n’ignorait-elle pas ce qui pouvait lui arriver ! Il n’y a plus de fille ignorante, si toutefois il en existât jamais ! Une fille sait bien que le plaisir des sens se sanctionne dans la possession de sa personne, que cette possession est la page d’un danger de maternité et d’une souffrance lorsqu’elle est vierge. Elle sait aussi que le mâle est de chair et d’os comme elle ; elle a vu dans les musées, ou sur les enfants, ou même en rêve, sa queue, et tout en elle la guide vers l’absorption interne de cette queue.
Célestin commençait à suspendre ses bouffées de fumée ; un canapé se trouvait vis-à-vis du fauteuil sur lequel Agathe, assise au coin du feu, rêvassait ; il vint s’y étendre et, sans jeter son cigare, se déboutonna le pantalon, sortit la queue, fit un signe à la fillette, qui, de suite, quitta le fauteuil, s’agenouilla devant lui, prit dans la main la queue qu’il lui tendait.
La fête débutait.
Il lançait maintenant de longs jets de fumée, la laissant libre d’agir à sa guise. Il voulait l’étudier dans ses audaces ; il voulait qu’elle attaquât d’abord, afin de mesurer le degré de résistance qu’elle opposerait s’il la violait ; car, cela entrait dans son esprit, dans ses désirs.
Ce jeune corps, non encore formé, il pressentait que, les voiles le recouvrant tombant à terre, il se précipiterait dessus pour assouvir le rut qui lui brûlait le sang, depuis que par deux fois il l’avait pollué sous les jupes.
Agathe s’était accroupie sur les talons, la tête près de la queue ; elle l’examinait avec grande curiosité, la tenant droite dans sa main, lui pinçant le gland, et par moments, mue par une passion instinctive, elle se penchait, la baisait, frottait les joues contre les couilles tirées hors de la culotte.
Il ne la troublait en rien.
Elle aspirait l’odeur mâle avec ce gonflement des narines qui dénote la surexcitation maîtresse de l’être, elle se serrait de plus en plus contre les cuisses de Célestin, elle entr’ouvrait toute la culotte, relevait la chemise jusqu’au dessus du nombril, et, dominatrice du ventre, des parties sexuelles, baisotait un peu partout, au hasard des lèvres, entourant la queue de mignardes caresses, ne l’abordant pas encore franchement.
Tout à coup, comme elle approchait la bouche, pour la sucer enfin, elle s’arrêta, pâlit, se recula et poussa un gémissement.
Étonné, il descendit des régions sublunaires, dans lesquelles errait son esprit et s’informa :
— Qu’est-ce, qu’y a-t-il ?
— Rien, rien.
Elle ressaisit la queue, y porta gloutonnement la bouche ; elle ne la garda pas longtemps ; elle la laissa échapper de ses lèvres, se dressa debout et balbutia en se sauvant vers sa chambre :
— Ah, c’est embêtant, c’est embêtant, j’ai des coliques !
Il l’entendit sortir dans le couloir ; il se rajusta en souriant, ne concevant aucune crainte de ce contretemps ; une colique imprévue n’était pas pour le paralyser dans ses espérances. D’ailleurs, il fallait bien s’y attendre avec l’extra de table qu’il avait fait faire à la fillette.
Il reprit sa promenade à travers la chambre, son cigare tirait sur la fin ; elle revint ; il avait eu soin de pousser la porte de communication pour lui laisser toute sa liberté : il la suivit en pensée dans le travail de toilette auquel elle se livra, et la vit reparaître, un peu pâlie, les yeux cernés, mais l’attitude très crâne.
La soulevant à bras-le-corps, il la jucha sur une table, troussa ses jupes, la renifla sur toutes ses parties féminines, malgré une légère résistance, et murmura :
— Tu as une précieuse ressource dans le lubin ; cela s’est bien terminé ! La colique a eu son plein effet ?
Elle répondit bravement :
— Oh oui, j’ai cru que ça ne s’arrêterait plus ! j’avais bien peur que cela nous gênât !
— Tu as donc bien envie de t’amuser !
— Oh, oui ! Plus qu’avec mon oncle !
La coquine n’avait pas oublié de se débarrasser de son pantalon, et comme il continuait à la renifler, elle ajouta :
— Est-ce que ça sentirait ?
— Le lubin, rien que le lubin !
Il la plaça à quatre pattes sur cette table, les jupes sur les reins, la dévora de feuilles de roses, pour lui témoigner qu’il ne redoutait aucun inconvénient.
Elle tortillait, aplatissait le ventre à sa fantaisie.
Dans cette furie de baisers dont il lui abreuvait le cul, la langue fouillant les replis de la raie ; dans ses mains fureteuses qui couraient des cuisses à la ceinture, aux mollets, palpant les chairs, scrutant la fermeté des membres, il poursuivait son délire de possession, en favorisant la possibilité par le mol abandon qu’il procurait à la fillette, par la complicité des muscles féminins se rendant à l’appel des muscles masculins.
La tête sur les bras, le cul bien en évidence, elle ne cessait de le manœuvrer dans la béatitude des caresses qu’elle recevait ; elle l’enrageait par des courtes interjections, par des mots tendres, des propos d’approbation, où elle s’ingéniait à pénétrer dans ses plus secrètes pensées, afin de les encourager.
Prétendre qu’il avait là une femme à sa disposition, il ne pouvait en avoir l’illusion : les gras manquaient, les arêtes s’affichaient encore vives, mais il se dégageait de cette nature une telle précocité, une telle inspiration de débauches, que le plaisir ne se souciait plus des charmes de la femme, et recherchait l’anéantissement des sexes, avec la mort au bout s’il le fallait, dans une étreinte monstrueuse où l’on se broierait l’un et l’autre.
Et plus il faisait, plus il caressait, plus il léchait, davantage la folie augmentait dans son cœur.
Ses doigts s’accrochaient aux chairs, les marquaient de leurs ongles à certains instants, et la fillette exultait, criait :
— Vilain, vilain chat, tu griffes ta petite souris, mais c’est bon, c’est bon quand même ! Griffe, griffe, bois la goutte de sang qui perle.
Il la soulevait avec le front, pour envoyer la langue au hasard, n’importe où ; sa bouche s’ouvrait pour mordre, pour déchirer les chairs. Un craquement de la table les rappela à eux : ce meuble était-il assez solide pour la convertir en un tel champ de bataille !
Il l’enleva comme une plume, la remit sur ses jambes ; ses cheveux ébouriffés se dénouant lui noyèrent tout le buste : Elle allait les arranger, il lui dit d’une voix rauque :
— Non, laisse-les ainsi, viens par là, comme tout à l’heure.
Il se recoucha sur le canapé ; et de nouveau la culotte ouverte, lui présenta la queue, elle s’y jeta dessus, les cheveux flottant sur les épaules ; il les saisit, s’en servit comme d’une bride et commanda :
— Enfonce-le dans ta bouche, ou je t’arrache les cheveux.
D’un seul coup de lèvres, elle happa la queue, glissa les mains dans la culotte, vers les fesses, pour les pincer, murmura, la queue allant et venant sur les lèvres :
— Si tu m’arraches les cheveux, je te pince le cul et je tire la peau.
Cette chevelure soyeuse et fine, avec sa jolie nuance blond fauve, qu’il caressait de ses mains, l’enrageait encore plus.
— Ah, dit-il, déshabillons-nous, viens faire ta gâtée, si tu ne veux pas que je te tue.
Elle éclata de rire et répliqua :
— Me tuer ! Pourquoi, puisque je fais tout ce que tu veux, que je ferai encore plus, je ne sais pas quoi, si tu l’exiges.
Se déshabiller ! Elle avait, malgré la difficulté de l’opération avec ses cheveux dans les mains de Célestin, défait le pantalon de son cavalier, l’avait sorti des jambes. Elle vautrait la tête sur ses cuisses, le fourrageait de la langue autour des couilles et dessous, s’essayait à conquérir la ligne des fesses : elle multipliait les caresses, les suçons ; à son tour elle le dominait ; il lâcha la chevelure et dit :
— Petite coquine, petite coquine, tu es plus forte que moi : arrête-toi.
Elle en jouait comme d’un fétu de paille ; le claquait sur les fesses et les cuisses, lui mordillait le ventre, le cul, avalait la queue et la recrachait, se tenant tantôt agenouillée, tantôt accroupie, se courbant pour frapper les mollets, les jambes.
— Je suis le chat et tu es la souris, s’écria-t-elle !
Elle s’était redressée pour appuyer un genou nu sur la queue, il la saisit par la taille, voulut l’asseoir par dessus lui.
— Non, non, dit-elle, pas comme dans le train ; tout nus, si tu veux mouiller.
Elle croyait en l’éjaculation décisive ; il la retint, la caressa et répondit :
— Déshabille-toi, je te le répète, et viens faire ta petite gâtée.
Sans aucune honte, elle se dépouilla de ses vêtements, comme il faisait de son côté, et il eut en face du sien ce corps de fillette, où les seins pointaient imperceptiblement, où quelques poils clairsemés garnissaient le bas-ventre.
Ainsi, elle apparaissait sans le stimulant des jupes courtes, sans la séduction de l’élégante toilette enfantine, sans l’attrait des mille enjolivures de la robe, des jupes, des bas : mais sa chevelure opulente la recouvrait au dessous de la ceinture, elle s’en servait comme d’un manteau, soulignant les chairs blanches et satinées.
Elle n’était pas maigre, à proprement parler ; elle était gracile dans ses formes, féminisée déjà dans sa contexture générale, ne prêtant à aucun doute sur le sexe.
Nue, elle se sentait toute petite par rapport à lui, d’assez haute taille ; il tournait autour d’elle comme une bête en furie, les yeux fixes, se demandant s’il allait la dévorer.
— Vilain chat, dit-elle, gâtez vite votre petite souris.
Elle le poussa sur le fauteuil, s’assit en travers sur ses genoux, lui passa les bras autour du cou et murmura :
— Oh, comme on est heureux ainsi !
L’extatique béatitude cérébrale qu’elle recherchait en cette minute, il la désira aussi, et comme elle appuyait sa bouche ouverte sur sa poitrine assez velue, près de la pointe des seins mâles, il pressa de la main sur son épine dorsale, pour mieux la serrer contre lui.
Ils vécurent de la sorte quelques secondes, savourant leurs pensées intimes, sans qu’il fût nécessaire de les exprimer, se délectant des effluves magnétiques de leur peau, des battements de leur cœur, des frissons de leur épiderme.
Emporté par cette fièvre d’attente, il descendit la main vers ses fesses et dit :
— Sais-tu, ma petite amie, qu’entre un homme et une femme, il y a plus que ces caresses, si délicieuses qu’elles soient !
— Oui. Un homme prend une femme. Mon oncle m’a raconté qu’il enfonçait son machin dans le ventre, qu’ainsi il la dépucelait et risquait de lui faire un enfant.
— Fi de la rouée qui, cet après-midi, simulait ne pas savoir qu’on entrait le machin dans le trou !
— Cet après-midi, j’avais oublié, répliqua-t-elle avec calme.
— On l’enfonce aussi dans le cul ! Ton oncle ne te l’a-t-il pas appris ?
— Non, il aurait craint me voir souffrir.
— Et toi, aurais-tu peur ?
Elle quitta la position penchée sur sa poitrine, et sans abandonner ses genoux, très sérieuse demanda :
— Dis, tu voudrais me l’enfoncer ?
— Le voudrais-tu ?
— Je ne sais pas.
— Refuserais-tu ?
— Non : rien de ce qui te plaira : mais je te prierais de ne pas me dépuceler ; je suis trop jeune pour avoir des enfants.
— Alors, tu me donneras ton cul.
— Tu essaieras, après l’avoir bien caressé.
Il la pressa sur son cœur, l’embrassa avec passion. Il avait toute latitude. Il voulut cependant tâter de son pucelage, et lui plaçant le médium entre les cuisses, vers le conin il murmura :
— Si on essayait par là, sans aller jusqu’au bout.
— Tu t’arrêterais, bien vrai !
— Je te le jure.
— Eh bien, tu essaieras.
Elle acceptait tout, cette gamine, inconsciente de la douleur, ignorante de la perturbation qui pouvait en résulter pour sacroissance, pour son corps.
Comme une enfant, il la porta sur le lit, la coucha et se glissa près d’elle, pour la reprendre dans ses bras, la baiser, la caresser, la peloter, disant :
— Tu es ma femme, nous sommes mariés, je vais te posséder.
— Oh oui, je suis ta petite femme, possède-moi.
— Étends-toi sur le dos.
— De cette manière ?
— Oui, oui, écarte les cuisses.
— Tu veux essayer, à présent, par devant ?
— Prête-toi bien, prête-toi bien. Quand il fut sur elle, elle lui apparut si peu de chose, quoiqu’elle fût de taille plutôt grande pour son âge, qu’il éprouva une certaine honte et se contenta d’effleurer le conin avec le bout de sa queue ; il glissa ensuite entre ses cuisses, lui fit minettes. Elle s’abandonna avec ivresse à ses caresses, il murmura :
— Tu es trop jeune pour être dépucelée, nous allons essayer ton cul, tourne-toi.
Elle obéit, offrit les fesses à ses chaudes lippées, après lesquelles elle sentit qu’il grimpait sur son dos, la recouvrait de son corps, et elle tressaillit à la queue qu’il pointait au milieu de la raie, mais ne regimba pas.
Il ne remua pas d’un instant pour l’apprivoiser, dirigeant insensiblement le gland vers le trou. Elle se pelotonnait. Il la chatouilla au clitoris, et la voyant émue, il sépara les cheveux qui cachaient son buste, appuya légèrement le gland.
— Oh, oh, dit-elle, penses-tu que ça entrera.
Elle ne se révoltait pas, cela l’encouragea : le bout pénétrait, écartant les chairs, brisant les plis sans les déchirer, il répondit :
— Un morceau est déjà dedans.
— Je le sens : ne pousse pas fort, il me semble que tout s’écrase en moi. Oh, arrête-toi, une seconde, cela devient bien bon.
Il se maîtrisait à grand peine : mais il avait le respect de cette fillette qui s’affirmait si résolue prêtresse de volupté, il n’avançait que peu à peu.
Malgré cela, comme la queue grossissait en remontant vers les couilles, il survint un moment où une douleur assez aiguë arracha un cri étouffé à Agathe.
Il demeura immobile, elle-même le rappela à l’œuvre en disant :
— Le plus difficile est fait, je le sens, tu as enfoncé la moitié, ne te retiens plus.
Il continua néanmoins à opérer avec modération, gagnant sa victoire, sans aucune défaillance de la part de la fillette ; et, quand il eut mis toute la queue dans son cul, il lui prit la main, dit :
— Vois, elle y est.
— Oh, c’est vrai !
— Nous allons passer à la contre-partie ; la retirer doucement pour ne pas te faire de mal ; puis, nous recommencerons jusqu’à ce que ça mouille en dedans.
— Oui, oui, tout ce que tu voudras.
Elle ressentit quelques petites douleurs, mais elle était tout à fait disposée lorsque l’attaque amoureuse se produisit : elle fut bel et bien enculée avec éjaculation, se trouvant ainsi possédée par l’honnête homme auquel la confia son digne oncle.
Les secousses les satisfirent l’un et l’autre et la fatigue agissant enfin après le dernier assaut, elle se retira dans sa chambre pour y goûter le repos nécessaire après de tels ébats.

V
Le lendemain, elle retournait seule chez les demoiselles Maupinais, où l’aînée, une sèche personne de cinquante ans, la directrice, la mandait dans son cabinet et l’admonestait en ces termes :
— Mademoiselle, la rentrée était hier au soir et non ce matin. Comment se fait-il que votre oncle l’ait oublié et ne nous ait pas avisées de votre arrivée.
— Mon oncle a été indisposé, Madame.
— Est-ce pour cela que vous avez cette figure de papier mâché ?
— Le voyage de nuit m’a brisée.
— Vraiment ! Eh bien, Mademoiselle, votre retour, cette année, nous semble très louche, sans l’avis de votre oncle, et vous présentant ainsi toute seule, sans la personne chargée de vous accompagner. Nous avons écrit dès ce matin.
— Vous avez écrit ! Vous avez bien fait.
— Votre approbation importe fort peu, Mademoiselle. Jusqu’à plus ample information, vous serez punie pour votre retard.
Agathe s’en moquait pas mal. Elle avait déjà embrassé Rita et lui avait soufflé dans l’oreille qu’elle lui apportait une bonne nouvelle.
À la récréation, elle éprouva cependant de l’ennui, parce qu’au lieu de causer seule avec son amie, ainsi qu’elle en avait l’habitude, elle vit Bernerette de Cœurvolant se joindre à elles, avec une certaine autorité qui ne déplaisait pas à Rita, et ne pas s’éloigner quand elle prévint son amie qu’il s’agissait d’une confidence.
— Parle devant Bernerette, répondit Rita, elle est restée ses vacances ici, sa mère n’ayant pas voulu l’emmener en voyage, et nous nous sommes consolées mutuellement.
Surprise, Agathe considéra avec plus d’attention son amie et constata qu’elle portait les mêmes rubans, qu’elle observait les mêmes attitudes que Bernerette ; dépitée elle dit :
— Je crains, Rita, de m’être trop avancée à ton sujet.
— Pourquoi cela ?
— Te rappelles-tu ce que nous avions convenu, lorsque je suis partie ?
— Parfaitement : tu devais demander à ton oncle de nous retirer toutes les deux de la pension, pour nous élever ensemble. Ton oncle n’a pas consenti.
— En effet, mais j’ai trouvé quelqu’un qui te retirera, si tu veux.
— Tu dis !
— C’est embarrassant à raconter.
— Ne crains pas de parler, intervint Bernerette, je suis devenue la bonne amie de Rita et je ne demande qu’à devenir la tienne, si cela ne te déplaît pas. Je conseillais à Rita de nous sauver toutes les deux de la pension : tu vois, tu n’as rien à craindre, je te fais la confidence.
Jamais Agathe n’avait rapporté à son amie les scènes de luxure auxquelles elle se livrait avec son oncle : parlant de Célestin, elle n’éprouvait pas les mêmes besoins de discrétion, elle comptait tout avouer pour la décider ! Elle modifia son idée devant cette amitié nouvelle et répondit :
— Vous sauver de la pension, vous commettriez une folie ! Que Rita accepte ce que j’ai à lui proposer, notre intérêt à toutes les trois y est.
— Propose, Agathe, tu ne doutes pas de mon affection, et du moment que tu assures que tu es intéressée à ce que j’accepte, je ne refuserai pas.
— Comment es-tu avec ces dames ?
— Toujours la même chose ! Elles me ficheront dehors au mois de janvier, comme un chien trouvé, si on ne les paye pas.
— Les gueuses !
— Bah, il paraît maintenant que l’argent est tout ! Bernerette l’a entendu dire à sa mère.
— L’argent et l’amour.
— Oh, l’amour ! Entre nous, oui. Avec les hommes, ils se moquent des femmes. Bernerette l’a encore entendu dire à sa mère.
— Eh bien, c’est un homme qui te tirera d’embarras, qui sera notre ami, si tu consens, et à Bernerette aussi, si elle veut en être.
— Je marcherai avec Rita, avec toi, partout où il vous plaira.
Agathe raconta alors son voyage de Dijon à Paris avec Célestin, en taisant son aventure libertine. Elle dit que son compagnon de route retirant Rita, elle était certaine qu’il aimerait ses amies, et ajouta d’un air assez pédant :
— Je l’ai étudié, il fera ce que nous voudrons et il nous apprendra des plaisirs que nous ignorons.
— Quelle chance, s’exclama Bernerette !
— Tu accepterais, demanda Rita ?
— D’aller vivre avec un homme qui me sortirait du pensionnat, qui m’enseignerait le plaisir à moi et à mes amies, je te crois ! Quelle tête ferait maman, s’il nous entretenait toutes les trois !
Agathe sourit et reprit :
— Nous entretenir toutes les trois, on nous embêterait ! Puis, nous ne sommes pas majeures ! Il y a mon oncle qui se fâcherait et ta mère qui te causerait du tourment ! Qui peut prévoir ce qui en résulterait ! Nous irons chez lui pour voir Rita, ça, c’est différent, ça arrange tout. Un jour il épousera Rita.
— Quel âge a-t-il ?
— Quarante ans.
— Hum !
— Un bel homme, très riche, qui aime les voyages.
— S’il m’emmène en voyage, comment nous verrons-nous ?
— Eh non, bête, il ne t’emmènera pas avant qu’il se soit bien amusé avec toutes tes amies.
— Es-tu bien sûre de ce que tu avances, Agathe ?
Agathe rougit, mais répondit :
— Je l’ai bien étudié, va, et puis voilà, ne regarde pas plus loin. Je suis arrivée avec lui hier au soir et nous sommes restés ensemble jusqu’à ce matin.
— Oh !
Ce fut plutôt un cri d’admiration des deux autres fillettes, qu’un cri de réprobation ; lancée cette fois, Agathe brûlant ses vaisseaux, ajouta avec une petite moue de suprématie.
— Je puis te le recommander en toute confiance, Rita, il a été mon amant.
— Ton amant !
— Oui.
Elle murmura tout bas :
— Il m’a enfoncé dans le cul sa machine.
— Tu n’as pas eu peur ?
— Oh non, et ce que j’étais heureuse ! Tu vois, Rita, tu peux être la sultane du sérail.
Rita ne disait plus rien ; elle remuait la tête en signe approbatif ; Bernerette lui poussant le coude, appuya :
— Vas avec lui, Rita, vas avec lui, tu seras notre salut, car, je le sais, Agathe, tu n’aimes pas plus les demoiselles Maupinais que moi, et ce n’est certainement pas Dijon que tu choisiras pour y habiter.
— Jamais de la vie !
Bernerette, la plus petite des trois amies, en était aussi la plus âgée. Elle atteignait ses quinze ans et s’annonçait comme une nature très vivace, avec des rondeurs de corps attestant l’adolescence. Elle avait les cheveux blonds-châtains, tandis que Rita, qui était de la même taille qu’Agathe les avait bruns.
Rita, ainsi que l’avait dit Agathe à Célestin, était vraiment une très jolie fille, avec ses quatorze ans et demi, elle en paraissait au moins dix-sept, tant elle était avancée.
Cet épanouissement chez la fillette, enrageait les demoiselles Maupinais qui prétendaient y décerner une cause de précocité dangereuse, et s’en targuaient dans leur volonté de se défaire au plus vite d’une élève qui leur coûtait et ne leur rapportait plus rien.
À l’exclamation de Bernerette, Rita répondit :
— J’irai, soyez tranquilles, et je ferai tout ce qu’il dépendra de moi pour vous attirer hors de cette vilaine maison, que nous voudrions avoir déjà quittée.
Tu me mettras au courant de la chose, Agathe.
— Ne t’inquiète pas. Tu le reconnaîtras comme ton cousin. Nous en reparlerons une autre fois, ne laissons rien soupçonner à ces dames et à leurs espionnes.
— À propos, Bernerette, es-tu toujours très bien avec la petite Antonia Lapers ?
— Elle se charge de mes petites commissions en ville.
— Justement, c’est à ce sujet que je te le demande. Elle est externe et très libre. Ne pourrais-tu lui demander de jeter cette lettre à la poste pour mon oncle ?
— Donne-moi cette missive, elle y sera ce soir.
— Tu comprends, ma petite Bernerette, il s’agit d’arranger mes craques avec ces dames.
— Tu crois que ton oncle ne se fâchera pas !
— Ah, par exemple, il m’aime bien trop !
Elle en était tellement certaine qu’elle lui écrivait avec cette belle insouciance de son âge :
« Mon oncle chéri,
» J’ai bien pleuré en te quittant et j’ai été bien triste tout le long de la route, si triste que monsieur de Kulaudan a fait l’impossible pour me distraire, et que n’y parvenant pas, il a voulu me mener au théâtre et ne me laisser rentrer que ce matin.
» Ces dames n’avaient envoyé personne pour me recevoir. Le théâtre ne m’a pas amusée ; je me suis couchée bien affligée, dans la petite chambre d’hôtel où m’avait conduite monsieur de Kulaudan pour que je fûsses plus à l’aise.
» Ah, comme j’ai pensé à toi avant de m’endormir ; que j’eusse été heureuse de te savoir près de moi !
» J’ai été très mal accueillie à la pension ; ces dames veulent me punir, pour ne pas en perdre l’habitude. Écris-leur bien vite que c’est toi qui es cause de mon retard, car autrement je pleurerai tout le temps et je me ferai mourir de chagrin, si tu n’interviens pas en ma faveur.
» Je t’embrasse de tout mon cœur.
» Ta petite nièce qui t’aime bien beaucoup.
Agathe. »

VI
L’institution des demoiselles Maupinais était l’une des plus sévères et des mieux tenues de Paris, malgré l’échantillon de fillettes présentées en ces pages.
On y avait le respect de la sainte morale, et on y pratiquait l’instruction religieuse, tout comme dans les couvents, ce qui engageait un certain nombre de pères de famille à y mettre leurs enfants.
Rien n’y laissait à désirer dans les études et dans la surveillance : la masse des fillettes et des jeunes filles suivaient les cours avec attention, ne pensant pas encore aux attraits de la chair ; les cas d’Agathe, Rita et Bernerette, s’y trouvaient très rares.
Dans tout arbre, il y a un ver qui ronge ; dans toute réunion masculine ou féminine, il y a une perversité qui sommeille.
Le ver pullule dans l’arbre, à mesure que l’arbre vieillit ; la perversité s’affirme dans la réunion, à mesure que la réunion semble gagner en austérité.
Polluée par son oncle, Agathe, l’année précédente, en revenant des vacances, éprouva, peu après la reprise des études, le besoin d’une amitié complaisante, où elle retrouverait, dans le saphisme, les délices vécues à la superficielle étreinte du mâle.
Malheureusement pour ses désirs, les avances qu’elle fit à quelques camarades, même à Rita, avec qui elle sympathisait déjà, ne lui valurent que des disgrâces : on chuchota à son sujet, on la considéra comme une brebis galeuse, elle faillit être mise en quarantaine.
Nature assez vigoureuse, elle imposa le respect à ses adversaires les plus résolues, et apporta tout son art à séduire Rita.
Séduire n’était pas trop difficile ; satisfaire le but de cette séduction apparaissait impossible.
L’institution Maupinais avait cette supériorité sur bien d’autres, c’est qu’on n’y laissait jamais les élèves livrées à elles-mêmes ; même la nuit, la surveillance s’y exerçait incessante, grâce à ce que les trois demoiselles Maupinais dormant très peu, passaient presque à tous les instants dans les chambrées.
Un seul point était faible, le point punition.
Ces punitions se divisaient en trois degrés : 1o la privation de récréation ou de sortie ; 2o cette privation, aggravée d’un travail à faire ; 3o la claustration dans une chambrette noire au grenier, pour un certain nombre de jours.
Pour ces trois sortes de punitions, les élèves relevaient de la surveillance d’une servante-maîtresse, appelée Tinette, fille de trente à trente-cinq ans, pas jolie, mais petite, robuste, prête à frapper si on l’asticotait, sûre de l’impunité auprès de ses patronnes, lesquelles s’appliquaient à en faire le Croquemitaine de ces demoiselles.
Privée de récréation, avec ou sans travail, on demeurait enfermée dans une salle, sous la surveillance de cette fille, toujours revêche et colère, cherchant noise à tout propos, et attirant des ajouts de punition avec une joie non dissimulée.
Aussi jouissait-elle de l’exécration générale ; de plus, comme elle avait la haute main sur les trois pièces noires réservées à la claustration diurne et nocturne, il n’était vexations dont elle n’accablât les prisonnières, dont la moindre consistait à les réveiller une heure avant tout le monde, à les obliger à se promener pendant une demi-heure à travers un long couloir, sous le prétexte de leur chasser tout à fait le sommeil.
Sur ce point elle avait bien reçu quelques observations des demoiselles Maupinais, redoutant un refroidissement chez les coupables ou une plainte à leurs parents ; elle promit de n’y recourir qu’à la dernière extrémité, et elle en usait encore deux nuits sur trois, chiffre de la punition qu’on imposait d’ordinaire.
Ce fut à la conquête de cette fille que se décida Agathe, afin de parvenir à ses fins avec Rita, convaincue qu’elle ne pourrait nouer de rapports avec son amie que dans les chambres de claustration, si Finette les laissait ouvertes, ou dans la salle de privations de récréation, si elle fermait les yeux.
Il faut le dire : la luxure a besoin d’un corps robuste et sain pour se satisfaire dans toute son ampleur, corps dirigé par un esprit subtil et déterminé.
Les mièvreries apparentes des constitutions, sauf quelques exceptions, ne signifient rien. Pour faire un gros feu, on doit bourrer la cheminée de bois ou de charbon ; pour constituer un foyer de libertinage, il importe d’avoir des idées, de l’imagination et des organes physiques en état de servir l’imagination.
Agathe, assez souvent punie, avait remarqué les yeux canailles de Finette, des négligences voulues d’attitudes, des alternatives de furie et d’apaisement, elle en conclut que cette fille nourrissait des envies. Cette conclusion intuitive dénotait la science d’observation acquise au contact de son oncle. Elle en tira parti dès la première punition qu’on lui infligea, punition qu’elle sut s’attirer un jour où il n’y en avait point d’autres, et elle se trouva seule sous la férule de Finette.
Finette allait et venait dans la salle, tandis qu’elle lisait, ayant été punie sans l’obligation de travail : maugréant, accusant une humeur encore plus acariâtre que de coutume, elle apportait cependant moins d’âcreté dans ses diatribes, car depuis quelques jours elle étudiait la fillette, la fixait souvent à la dérobée, en récoltait un sourire lorsqu’elle était ainsi surprise et éprouvait de l’émotion.
Si Agathe pensait à cette conquête vicieuse, elle ne représentait pas ici le ver de l’arbre. Ce ver, c’était Finette.
Une chose de particulièrement curieuse, veut que les gens les plus rigides, les plus dévots, les plus scrupuleux, aient dans leur entourage un être d’absolue dépravation, capable de tout et ayant eu parfois de nombreux désagréments avec la société.
Finette, entrée depuis cinq ans dans l’institution Maupinais, avec les meilleurs certificats, avait passé par toutes les phases de la débauche, et ne s’était amendée que par le chagrin violent, ressenti à la mort d’une jeune fille, qu’elle avait enlevée à sa famille pour vivre avec elle dans le saphisme.
Amendée, non ! Frappée de stupeur, oui.
Appréciée par les demoiselles Maupinais, désireuse de se créer une position d’avenir, de s’assurer une retraite dorée, elle eut la force de dompter son tempérament pendant des années, le détournant sur les sévices dont elle accablait les coupables.
Et une de ces morveuses, Agathe, la tâtait visiblement !
Toutes les deux, dans la salle de punition, Finette laissa échapper cette exclamation !
— Bonté du ciel, être obligée de garder une seule de ces mômes ! Vous êtes donc incorrigible, vous ! On vous voit presque toujours par ici.
— Peut-être que je m’y plais, répondit Agathe, levant les yeux de dessus son livre.
— Ah ! vous en avez un foutu goût ! Elle avait licence de langage, Finette, cela terrorisait davantage les élèves.
Elle s’assit sur un fauteuil en paille, et battant le parquet avec les bottines, elle ajouta :
— Je comptais sans cette punition, j’avais congé pour l’après-midi, et me voici collée ! Ah, vous me la paierez, celle-là !
— Si je l’avais su, j’aurais choisi un autre jour.
— Ah ça donc, vous y déambulez après les punitions !
— Ça se peut !
— Je vous en ferai fourrer !
— Tant mieux !
Soudain elle se rappela le manège de l’enfant, et, comme par enchantement sa colère disparut : elle l’examina avec curiosité, murmura :
— Est-il possible, quand on est si gentille, de s’attraper des punitions !
Agathe avait repris sa lecture, mais du coin de l’œil, elle suivait le changement qui s’opérait en Finette ; constatant que si son pied ne battait plus le parquet, en revanche le corps s’agitait sur le fauteuil dans de très fébriles mouvements, elle eut le talent de couler un regard et ostensiblement de le montrer courant sur toute sa personne.
Finette tressaillit, et, voulant s’assurer de la bonne volonté de la fillette, elle froissa sa robe sur les genoux. Elle aperçut la tête d’Agathe qui se dressait pour voir ce jeu de la robe ; croisant alors les jambes, elle attira les jupes à hauteur des genoux.
— Finette, murmura Agathe dans un souffle !
— Je ne me trompe pas, vous pensez à la chose ?
— Oui.
— Ah bah, approchez donc par ici.
Agathe tremblait de joie ; elle triomphait. Elle accourut et, debout devant Finette, dit :
— Me voici.
Les yeux de Finette brillaient comme du feu. La banalité de son visage, qui la faisait paraître laide, n’existait plus. Agathe, surprise de cette si subite transfiguration, s’écria :
— Oh, vous êtes belle, Finette, je m’en doutais bien !
— Tu t’en doutais, mon petit amour, et tu as pensé à… m’aimer !
— Il y a déjà quelque temps.
— Que désires-tu, en m’aimant ?
— Te connaître sous les jupes.
— Oh, la coquine, la coquine, qui devine les bonnes choses… à moins qu’on les lui ait apprises ! Les as-tu apprises, dis ?
— Non, j’ai envie, voilà tout.
— Tu as envie, chérie, et nous bavardons. Vite, vite, vite, ton joli museau là-dessous.
Rapidement accroupie entre les cuisses de Finette, Agathe en prit connaissance, s’émerveilla de sa chair blanche et satinée, de la joliesse du conin, discrètement entrebâillé, des poils bruns et très fournis, de la propreté des dessous, qu’elle appréhendait un peu de ne pas rencontrer.
Elle embrassait partout avec forces gentillesses, Finette lui dit :
— Lèche, lèche, petite, c’est encore meilleur ! Mais, je te préviens, je vais te faire flanquer à la chambre noire, pour t’avoir cette nuit.
Agathe s’empressa de suivre la recommandation ; l’heure de punition s’écoula dans la plus parfaite des délectations.
Le soir, elle apprit que, pour avoir menacé Finette de lui jeter un livre à la tête, elle était punie de deux jours et de deux nuits de claustration.
Couchée sur un lit, n’ayant qu’un seul matelas, elle attendit, l’oreille au guet. Finette, en chemise apparut et lui dit :
— Viens.
Elle s’élança à sa suite, pénétra dans sa chambre, simplement mais très confortablement meublée avec un luxe de menus objets, témoignant d’un certain goût chez la fille.
Alors, la femme faite enseigna à la fillette les raffinements de la luxure la plus savante ; elle en sollicita les caresses les plus lascives, son corps en feu ayant besoin de chauds suçons pour rattraper les longs jeûnes supportés.
Elle s’était poudrée et parfumée, elle ne se lassait des minettes que pour exiger des feuilles de roses ; la langue d’Agathe, agile, experte, courut partout où elle le désira.
Elle la garda plus de deux heures et dit :
— Dors bien, Agathe, personne ne monte ici, je ne te ferai lever qu’à dix heures, pour que nous recommencions demain soir.
Agathe venait de conquérir la qualité de gougnotte de Finette.
Cela ne se soupçonna pas, la servante outrant sa mauvaise humeur à son égard et lui valant des augmentations de punition pour l’avoir plus souvent à sa disposition.
Mais la fillette acquérait l’expérience qui lui manquait ; initiée au saphisme, elle entreprit avec plus d’habileté Rita.
Elle ne doutait pas que Finette encouragerait sa fantaisie et, de fait, l’affaire se présenta naturellement.
Une nuit où elle semblait un peu lasse, après une forte séance de léchage, Finette, la voyant ainsi, soupira et murmura :
— Ah, pauvre petite, pauvre amour, je te tuerai ! Je ne suis pas raisonnable, j’ai le corps en feu ! Quel dommage que tu n’aies pas une camarade pour te soutenir, te remplacer lorsque je deviens par trop folle !
Agathe répondit ;
— Une camarade ! Oh, il y en aurait bien une.
— Vrai !
— Demain, Rita se fera punir de prison : laisse ouvertes nos deux portes, je commencerai avec elle, puis tu surviendras ; tu menaceras de nous conduire chez ces demoiselles : je te supplierai à genoux, je suis sûre que Rita m’imitera.
La fillette annonçait cette précocité dans la débauche, qu’elle devait montrer dans sa rencontre avec Célestin.
Finette en conçut la même admiration que Célestin et dit :
— Marche, gougou (nom d’amour qu’elle lui prodiguait), je te défendrai de toutes les manières, s’il t’arrive des ennuis.
Agathe était parvenue à émouvoir Rita.
À la dernière récréation, elle lui avait dit :
— Ah, Rita, je t’ai parlé assez clairement ; il n’y a pas de plus grand bonheur en ce monde que celui de se caresser sous les jupes, lorsqu’on s’aime comme nous nous aimons ! Je serai punie ce soir, fais-toi punir de prison demain, je m’arrangerai pour te rejoindre dans ta cellule, nous nous caresserons à en mourir.
— Agathe, Agathe, depuis que tu me causes de ces choses, j’ai l’esprit à l’envers, je crois comme toi à ce bonheur ! Oh, te caresser, recevoir tes caresses, m’apparaît un délice inexprimable. Arrive ce qu’arrive ! Moi, si on nous surprend, on me chassera ! N’importe, je t’aime, j’ai envie de ces caresses, je te promets de me faire punir.
Et, le plan s’exécutant, les yeux effarés, ne distinguant rien, les cellules et le couloir de punition étant plongés dans la plus complète obscurité, Rita entendit le grincement de la porte qui s’ouvrait, un pas léger qui s’approchait, sentit une main qui courait sur son lit, elle saisit cette main et murmura :
— Est-ce toi, Agathe ? Oh, mon Dieu !
— Oui, mets ma main à tes cuisses.
— Oh, j’ai peur !
— Nigaude, vite, ouvre tes cuisses ! Là, elles brûlent ! Ah, comme je les baiserais !
Mais Rita, profitant de ce qu’Agathe était debout devant le lit, envoya les mains à ses fesses, l’attira brusquement, l’assit par dessus elle, lui embrassant avec passion le cul.
Agathe se laissa faire et dit :
— Que tu as envie, que tu as envie, presque autant que moi !
L’obscurité qui les entourait, les excitait encore davantage ; Rita, la plus novice, par cela même la plus assoiffée, enveloppait de ses bras la plus grande partie du corps de son amie, pour assouvir sa luxure sur tout ce qui constituait la délicatesse de sa féminité naissante.
Agathe s’abandonnait. Habituée avec Finette à être la caressante, elle éprouvait un charme infini à changer de rôle, à être cette fois la caressée. Aussi, cédait-elle à la moindre impulsion de Rita, et lui présentait-elle aux lèvres, aux mains, le conin, le cul, selon son désir.
Le plaisir régnait en maître dans cette cellule ; soudain une lanterne sourde se démasqua, Finette se dressa aux regards épouvantés de Rita.
Pour la vérité de la comédie, Agathe se fourra prestement sous les draps ; Finette les retira, et, la lanterne posée à terre, les bras croisés, dit :
— En voilà du propre !
Déjà Rita à deux genoux embrassait les pans de sa chemise et murmurait :
— Grâce…
— Baise dessous, répliqua Finette se troussant, je déciderai ce que j’ai à faire.
La fillette se jeta sur le conin, le couvrit de caresses, le lécha, disant :
— Vous ne nous dénoncerez pas ! Finette se tourna, lui présenta le cul et répondit :
— Voyons, si tu marcheras aussi bien de ce côté.
Rita s’apprêtait à faire des merveilles.
— C’est bon, reprit Finette, venez toutes deux dans ma chambre, nous causerons et nous nous entendrons.
L’entente fut scellée. Finette eut deux gougnottes, qu’elle favorisa de son mieux pour leurs caprices réciproques.
On ne pouvait abuser des punitions : elle trouva une combinaison qui multiplia leurs entrevues. En dehors de cette surveillance des coupables, elle avait la charge du linge, et tous les samedis soirs, il en résultait pour elle un grand travail, à cause de l’échange avec le blanchisseur, du placement dans les casiers personnels. Elle se faisait assister, sous le prétexte d’accoutumer ces demoiselles à la conduite d’une maison, d’une ou plusieurs élèves, suivant les circonstances. Elle demanda, cela n’exigeant pas beaucoup de difficulté à être su, à s’adjuger toujours les mêmes, et elle eut ainsi Agathe et Rita, dont les feuilles de punition prenaient une tournure fantastique.
Ce fut le Paradis : les deux fillettes pendues à ses jupes l’asticotaient de mille manières : elle prêtait le con à l’une, le cul à l’autre, perdant l’esprit dans le jeu de leurs langues, s’instruisant l’une par l’autre. Elle échappait au vertige, les plaçait en soixante-neuf sur une table, pour courir expédier son linge, revenait, attrapait un brin de chair ici, un brin de chair là, joignait ses caresses aux leurs : elles se séparaient, se jetaient sous ses jupes pour s’y disputer les charmes du devant et du derrière : afin de les mettre d’accord, elles les installait demi-nues sur ses genoux et elle leur révélait la science des baisers sur les lèvres et dans la bouche.
Elle avait les nénés assez fermes, elles aimaient à les téter ; et alors, l’une sur le gauche, l’autre sur le droit, elle leur patouillait le cul, tandis que leurs mains s’unissaient pour lui chatouiller le bouton. Elle jouissait, elle jouissait et s’étonnait de ne pas voir pousser leurs poils, naître leurs tétés.
Ces séances ne laissaient pas que de l’énerver : la possession masculine manquait ; plus elle s’énamourait avec ses gougnottes, plus elle inventait des raffinements lascifs, moins elle se déclarait satisfaite. Ayant dévissé un conduit en caoutchouc pour le gaz, elle le travailla de si adroite façon, qu’elle en fabriqua presque un godmichet, dame, très primitif, mais pouvant encore produire son effet dans un paroxysme d’hystérie passionnée ; Agathe, qu’elle traitait en amant de cœur, demeura chargée de le manœuvrer.
Pour cette séance mémorable du début, il fallait la nuit, on recourut à la punition d’incarcération ; elle alla sur les onze heures quérir ses deux complices.
Elle commença par choyer ses pouponnes, manœuvra les deux fillettes pour bien les mettre en train, les poussant à s’aimer, à se délecter entr’elles par dessus ses cuisses, leur servant d’oreiller, avec la permission de renifler son con, de le lécher pour se donner du piment. Quand elles furent bien lancées, elle appela Rita à ses fesses ; attirant Agathe, elle lui montra ce joujou qu’elle avait caché sous le traversin, et lui indiqua la manière de l’utiliser.
— Lèche-moi bien fort, dit-elle, enfonce bien ta languette dans le trou ; puis, quand ça mouillera un peu, vite tu entreras et sortiras ce joujou, en m’appelant des plus jolis noms qui te viendront à l’esprit.
Il n’est nul besoin d’insister sur les merveilleuses dispositions d’Agathe, ni sur l’éveil de son intelligence, on l’a déjà jugée.
Finette avait retourné à demi les fesses, écrasant sous leurs rotondités Rita qui ne s’en plaignait pas, et trouvait régal exquis à les combler de suçons. Apercevant son amie qui se plaçait pour les minettes, elle lui tendit par dessous la langue, et Agathe envoyant la sienne, toutes les deux s’en chatouillèrent le bout, puis retournèrent à leurs caresses, s’entrecroisant les jambes pour se donner mutuellement des coups de ventre.
L’œuvre du joujou s’exécuta ; Finette en eut une telle émotion, qu’elle appliqua de violents coups de cul sur le visage de Rita, agrippa le bras d’Agathe en murmurant :
— Plus vite, plus vite, ça vient, je jouis.
Agathe enfonçait tout l’objet, le retirait, elle eut l’intuition de le bouger dans l’intérieur du con et la jouissance survint, affolant les trois luxurieuses.
La pâmoison les saisit : elles demeurèrent immobiles, prostrées sur place, en face de leurs sexualités, où elles bavaient d’extase : elles rêvèrent plus de dix minutes, se complaisant à l’afflux de leurs béates félicités.
En cette nuit de folle volupté, elles avaient atteint l’apogée de leurs relations. Il était impossible qu’elles se prolongeassent dans ces conditions, sans attirer une catastrophe.
Aux vacances du Jour de l’an, où monsieur Pleindinjust fit sortir sa nièce, il lui exprima son chagrin de la voir si souvent punie et si peu travailleuse. Elle dut promettre de changer de conduite.
Elle ne s’engageait pas beaucoup ; elle pensait bien que Finette inventerait quelque moyen de se satisfaire, où l’on n’aurait plus recours à la claustration.
Finette, de son côté, avait subi une transformation complète dans son caractère : elle se montrait moins sèche, moins acariâtre, on la redoutait moins, et de plus, ne persévérant pas dans sa malveillance envers Agathe et Rita, elle trahit parfois l’affection qui les liait. Elle risquait d’être devinée, si les élèves de l’Institution Maupinais n’avaient pas été de vertueuses fillettes. Une d’entr’elles cependant soupçonnait la vérité, c’était Bernerette.
Bernerette n’ambitionnait pas de plaire à Finette : elle cherchait à disputer Rita à Agathe : l’œuvre était impossible pour le moment.
Il y eut un coup de foudre : deux mois après le jour de l’an, Rita et Agathe apprirent avec grande peine que Finette quittait la pension pour se marier.
Violemment secouée par les plaisirs charnels goûtés avec ses deux gougnottes, la servante se rendant compte de la funeste voie où elle s’égarait, ne résista pas plus longtemps aux sollicitations du blanchisseur qui lui proposait le mariage, et y consentit.
Elle agit sagement : la santé des fillettes menaçait de s’altérer et les demoiselles Maupinais émettaient quelque défiance sur ce changement de caractère de leur Croquemitaine.
Finette partie, les occasions devenaient rares : Rita et Agathe ne s’aimaient qu’à la dérobée, plutôt platoniquement que matériellement. Les grandes vacances arrivèrent, Rita resta seule avec Bernerette et eut plus de facilité avec celle-ci.
Rita et Bernerette jouissaient de la réputation d’être les brebis galeuses de la maison, des brebis auxquelles on pouvait ouvrir la porte de l’étable, pour en être plus vite débarrassées. On les surveilla à peine durant les vacances, elles en profitèrent. Elles étaient plus intimes que jamais Rita ne le fut avec Agathe, lorsque cette dernière revint de Dijon et parla de Célestin.
Célestin, la délivrance, le salut !

VII
Rita, d’abord réservée, finit par rêver à sa sortie de pension, avec un Monsieur riche, aimant le plaisir, et qui la favoriserait pour se retrouver avec ses amies.
Bernerette appuya Agathe pour dorer ce rêve de mille et une illusions, et Agathe écrivit enfin à Célestin de se présenter chez les demoiselles Maupinais pour retirer son amie.
La lettre partie, Agathe en ressentit de la tristesse ! Était-ce la séparation avec Rita qui la chagrinait, était-ce l’ennui de ne pas revoir Célestin, lorsqu’il viendrait la prendre : il y avait de l’un et de l’autre, avec une nuance de jalousie de ne pas être l’heureuse libérée.
Célestin, emporté par la folie que lui avait infusée Agathe, ne demeurait pas inactif. Il occupait un bel appartement avenue de Friedland, où une domestique de son pays, le servait, se faisant aider par les concierges dans certaines circonstances. Il prenait ses repas au dehors.
Il annonça à Félicité, cette servante, qu’il allait recevoir une petite cousine dont il était le tuteur, qu’elle eût à se pourvoir d’une femme de chambre pour l’assister dans son travail, et d’une cuisinière, car on déjeunerait avenue de Friedland et quelquefois on y dînerait.
À côté de sa chambre se trouvait son cabinet de travail. Il se rendit chez un tapissier, afin de modifier de fond en comble son logis ; il désirait la chambre de Rita à la place de ce cabinet. Cette chambre fut une merveille d’installation, non banale, où le blanc le disputa à des nuances assombries, propres à flatter le teint d’une brune, où le lit ne rappela en rien la couche innocente d’une pensionnaire en vacances, mais celle d’une nymphe retenue en cage, par son peu d’élévation, par les sujets incrustés sur les bois. Rien n’y clochait, tout y était disposé pour la plus grande joie, le plus grand bonheur de la plus séduisante coquette. Les nuances sombres furent noyées sous des satins blancs, pour n’émerger qu’après la prise de possession de la fillette.
La lettre d’Agathe, confiée aux bons soins de la petite Antonia Lapers, survint comme tout était prêt. Il prit de l’argent et se rendit de suite à l’Institution des demoiselles Maupinais.
Mademoiselle Maupinais, l’aînée, faillit tomber de surprise, quand il lui communiqua le motif de sa visite.
— Vous êtes le parent de mademoiselle Rita, s’écria-t-elle.
— Son seul parent, à qui ses père et mère l’ont confiée en mourant ; je n’ai pu venir plus tôt, ni donner signe de vie, mon voyage dans l’Asie Centrale m’ayant tenu loin de tout centre civilisé. Je vous remercie des bons soins prodigués à cette chère enfant, et de l’avoir aimée dans la cruelle situation où on l’a laissée. Je vais vous indemniser des frais qu’elle vous a coûtés ; je ne vous la retirerai peut-être que pour quelques mois, le temps de reconstituer son moral, de lui procurer les distractions nécessaires à ce qu’elle oublie son double deuil. Je sais la bonne éducation qu’on reçoit dans votre maison ; si je vous la rends, comme externe, je suis certain qu’elle rattrapera vite le retard de ses études. Puis-je la voir ?
— On l’a prévenue. Monsieur, elle ne tardera pas à être là.
Mademoiselle Maupinais, toute étourdie, voyant l’argent qu’elle croyait perdu lui rentrer, ne formula aucune objection. Elle dressa ses comptes et dit :
— Il nous revient, Monsieur, huit cent trente-trois francs.
— En voilà mille, Madame, le surplus sera pour vos serviteurs.
— Oh, Monsieur !
Rita apparut en ce moment, et apercevant Célestin, courut se jeter à son cou, en s’écriant :
— Mon cousin Célestin, vous, je n’espérais plus vous revoir !
Mille francs, cette fillette ! Il achetait mille francs cette jolie brune, aux yeux vifs, qui l’embrassait sans embarras, avec cet art de comédienne !
Il n’était pas volé, Agathe ne le fourrait pas dedans.
Une fillette, demi-femme, avec des allures félines, une voix de tendresse, des élans de circonstance, il l’étudiait en rendant le baiser, tout en disant :
— Ne m’en veuillez pas, ma chère Rita, de mon long silence, je vous l’expliquerai. Ces dames vous ont-elles prévenue que je vous emmenais ?
— Oui, je n’ai que mon chapeau à mettre : une de mes amies, Agathe, s’est chargée de ma malle, on l’expédiera.
— Parfaitement !
Une demi-heure en tout et il avait la fillette, près de lui, dans le fiacre avec lequel il était venu.
— Ouf, murmura-t-il, lorsque la voiture s’ébranla, la comédie a réussi !
Rita éprouvait un léger émoi, elle répondit néanmoins :
— J’ai bien joué mon rôle ! Qu’allez-vous faire de moi ?
Il l’examina avec un certain plaisir en souriant et dit :
— Nous étudierons cela plus tard ! Pour le moment vous m’appartenez, je tâcherai de vous amuser.
— Oh oui, de m’amuser !
Elle eut un soupir : une mélancolie glissa sur son esprit : pressentait-elle que son indépendance personnelle était plus en sûreté chez les demoiselles Maupinais ! L’enfant l’emporta, elle lui prit la main, la baisa et ajouta :
— Merci.
Il en fut touché et dit :
— Vous avez le temps de voir notre appartement. Je vais vous promener, nous dînerons ensuite au restaurant et nous passerons la soirée au théâtre. À minuit, heure des crimes, nous foulerons les tapis de nos chambres.
— Je veux bien.
Toute la journée s’écoula dans ces diverses distractions, où ils s’accoutumaient l’un à l’autre, malgré une sorte de gêne subsistant.
Dès l’entrée dans l’appartement, Rita eut des exclamations de joie et d’admiration : la lumière électrique éclairait partout et la solitude était absolue.
Célestin avait pris ses précautions pour se l’assurer. Il réserva la connaissance des deux chambres mitoyennes pour la dernière visite.
Une collation se trouvait servie dans la salle à manger avec du Champagne.
— Rita, dit-il, avant de franchir le seuil de nos intimités (il appuya sur le mot intimités), vous goûterez à ces friandises, boirez un peu de Champagne et vous habituerez à vous considérer comme la petite reine de ces lieux. Il dépend de votre bonne volonté d’y être une reine heureuse.
— Je ferai tout mon possible !
Le bien-être qui se dégageait de ce luxe, la gourmandise qui s’éveillait devant cette table, les distractions de la journée se détachant en relief, tout la disposait de la meilleure façon. Elle avait posé son chapeau dans l’antichambre, elle était à l’aise, elle se laissa aller dans ses bras qu’il ouvrait pour l’embrasser, et lui rendit son baiser, le regardant dans les yeux comme il la regardait dans les siens.
— À table, dit-il.
Elle s’assit gentiment à sa place ; il la servit, excita sa gaieté, quand le bouchon de la bouteille de Champagne, frappant le plafond, il simula la peur.
Les coupes pleines, il se pencha pour trinquer, les verres se heurtèrent, il but, et ayant remis son verre sur la table, il la pria de tenir sa coupe en l’air. Il porta alors la main à sa poitrine, où il lui semblait voir une petite proéminence, il palpa et murmura :
— Je te croyais des seins, ma reine. Elle rougit, faillit laisser tomber la coupe, puis répondit en riant :
— Pas encore, mon roi, ils poussent, ils marquent, et je suis sûre que bientôt… Dans tous les cas, je suis plus avancée qu’Agathe. D’abord, j’ai six mois de plus et je suis presque femme.
— Agathe !
Il évoqua les scènes vécues en chemin de fer et la nuit ; il se rappela sa tentation de la dépuceler ; reportant les yeux sur Rita, brutalement il lui demanda :
— As-tu des poils ?
— Oh !
— As-tu des poils ?
— Oui.
Il lui versa une deuxième coupe et dit :
— À tes poils.
Elle se tordit de rire et répliqua :
— Tu es drôle, mon roi !
— Veux-tu voir les chambres ?
— Je ne demande pas mieux.
Ils commencèrent par la sienne, très belle pièce, où, sur une table, deux boîtes attirèrent son attention.
— Qu’y a-t-il là dedans, s’écria-t-elle, je parie que c’est pour moi.
— Tu as deviné.
— Montre.
— Tout à l’heure. Regarde ta chambre, de la porte seulement, tu n’y entreras qu’avec ce que contiennent ces boîtes.
— Oh, s’exclama-t-elle en admiration devant sa chambre, voilà où je coucherai !
— Oui.
— Pourquoi ne veux-tu pas que j’y entre ?
— Parce que tu n’y entreras que nue ! — Oh !
Elle recula lentement et revint à lui.
— Qu’y a-t-il dans ces boîtes, demanda-t-elle ?
— Déshabille-toi ?
— À présent.
— Puisque je te le dis.
Elle hésitait, il s’agenouilla et murmura :
— Je vais t’aider.
Il la troussa, s’arrêta à la vue du pantalon assez ordinaire, et le secouant, ajouta :
— Tu en auras de plus beaux.
— Tu veux que je l’ôte, pour commencer.
— Non, laisse-moi voir à travers les rideaux baissés.
— Les rideaux baissés, c’est ma chemise que tu appelles les rideaux !
Il souleva la chemise, aperçut les poils les baisa et murmura :
— Eh, eh, il y en a en effet ! Voyons ton cul. Très bien, très bien, on fera quelque chose de ta personne.
Les baisers qu’il lui donnait, l’échauffant, elle défit son corsage, sa robe, ses jupes et se trouva en chemise.
Il était sous elle, l’embrassant, la chatouillant, et à mesure que tombaient la robe, les jupes, il les sortait des jambes, les lançait par derrière lui, ramenait ensuite les parties génitales de la fillette à ses lèvres.
Se sentant de moins en moins maître de ses sens, il la déchaussa, lui enleva la chemise, et toute nue devant lui, il l’examina des pieds à la tête, la palpa, tel un maquignon s’assurant de la marchandise qu’il a achetée.
Les épaules étaient bien celles qu’on a à cet âge : les seins marquaient, ils poussaient comme elle l’avait dit ; le ventre était encore étroit ; les fesses, assez rondelettes ; les cuisses grassouillettes ; les mollets légèrement accentués : en somme, il n’existait pas dans la structure du corps une grande différence avec Agathe, mais ici, il n’éprouvait plus les mêmes scrupules.
Il la manipulait, la contemplait dans toutes ses moindres parties, Rita se prêtait, attendant ses instructions.
— Il ouvrit les boîtes : de l’une, il retira un long voile, tel qu’en portent les mariées, et le lui posa sur la tête ; de l’autre, il sortit une couronne d’oranger et la plaça par dessus le voile en disant :
— C’est le jour de tes noces, Rita, dans un instant, tu seras ma femme, te voilà revêtue des insignes d’une jeune mariée.
La fantaisie, loin de lui déplaire, l’amusa, elle s’enveloppa du voile, arrangea la couronne et répondit :
— Je veux bien, tu es mon mari, que faut-il faire ?
— Tu vas rentrer dans la chambre, tu t’asseoiras sur le bord de ton lit et tu m’attendras.
— Viens vite.
— Le temps de me déshabiller.
— Ah !
— À petite femme nue, grand mari nu.
— Je ne suis pas petite !
Il la poussa vers la porte, elle posa le premier pied dans cette chambre qui devenait la sienne.
Elle était encore plongée dans la plus vive admiration de ce qui l’entourait, lorsqu’il apparut à ses yeux dans sa nudité masculine. Elle voyait l’homme, elle en eut une peur instinctive. Elle s’enroula dans le voile, il s’élançait à ses pieds, lui écartait les jambes et disait :
— Allons, allons, étends-toi sur le lit.
— Avec la couronne ?
— Glisse-la sous ton cul.
— Elle me fera mal.
— Pose-la où tu voudras, mais couche-toi.
La bête fauve était déchaînée : un simulacre de possession ne pouvait plus le satisfaire : Rita, jetée sur le lit, plaça la couronne sur l’oreiller ; le voile qui la recouvrait demeura sous elle ; entre ses jambes, entre ses cuisses, elle sentit la queue qui approchait du conin ; elle entendit avec émoi, le souffle rauque de Célestin ; il lui entoura le cou de ses bras, elle ferma les yeux, elle crut qu’il s’apprêtait à la tuer, tant ses yeux devenaient hagards, elle eut un cri d’angoisse, de douleur ; ce cri s’étouffa sous les lèvres de Célestin, qui se plaquaient sur les siennes, il commanda :
— Tais-toi donc, tu deviens femme.
— Je ne veux pas, je ne veux pas, tu me tues, tu m’assassines.
Elle s’arqueboutait sur les reins, lui griffait le visage, la terreur l’envahissait ; il l’enserra de ses bras, de son buste, la collant sous lui.
Elle voulut hurler, il s’arrêta, effrayé, murmurant :
— Rita, Rita, mais c’est naturel cela, Agathe me provoquait à ce que tu ne veux pas.
— Je ne veux plus rester ici, je veux retourner chez les demoiselles Maupinais. J’irai mendier, mais je ne veux pas ça, pas ça.
— Folle, folle, le plus difficile est fait.
— Non. Une rage froide le saisit : cette fille, qu’il se payait mille francs, sans compter les dépenses antérieures faites pour l’installer dans sa vie, allait-elle manquer aux espérances suscitées par Agathe, il dit brutalement :
— Que tu le veuilles ou nom, tu seras ma femme, car tu m’appartiens, tu es à moi, et je t’ai préparé ce luxe pour que tu sois ma femme.
— Méchant, bandit, infâme !
Il courut à sa chambre et en revint avec sa canne.
— Oui ou non, s’écria-t-il, veux-tu être raisonnable ?
— Je veux m’en aller.
— Tu ne t’en iras que morte.
D’un brusque mouvement, il la vira, et sa canne s’abattit en deux coups forcenés sur ses reins, sur ses fesses, tandis qu’il ajoutait :
— Crie, si ça te plaît, tu m’appartiens et tu te soumettras.
Elle ne criait pas. Une réaction se produisait. Elle comprenait que la lutte s’offrait impossible, son sens féminin s’éveillait : étonné de son mutisme, il ne frappa pas le troisième coup, elle murmura :
— Ne me bats pas, je serai raisonnable.
— Cela vaut mieux.
Il jeta à terre la canne et la replaça en posture : il vit ses yeux secs qui le regardaient fixement, il posa un baiser sur ses lèvres, elle le rendit mollement. Sa queue arriva de nouveau au conin, elle suivit sa recommandation de bien écarter les cuisses pour moins souffrir, il recommença l’œuvre de dépucelage. Elle eut des sursauts, des demi-révoltes, elle essaya encore de résister, elle reçut de grosses claques sur le cul, comme pour lui rappeler que la canne n’était pas loin ; l’acte s’accomplit, elle fut dépucelée. En somme elle était nubile, il y avait moins de danger qu’avec Agathe : il ne recula pas.
Mais que de traces !
Le voile de mariée n’offrait plus qu’une loque, le dessus du lit apparaissait fripé et ensanglanté ; la couronne, lancée en l’air, au milieu du dernier assaut, gisait lamentable sur le tapis.
Après un moment de repos, où elle reprenait ses sens, il lui dit :
— Lève-toi, passons à ta toilette. Passive, soumise, elle quitta le lit, les jambes encore tremblantes, l’accompagna au cabinet de toilette qu’il lui avait fait aménager.
Là, il la nettoya lui-même, la frictionna, la poudra, lui redonna des forces.
— Tu es ma femme, et tu es femme, dit-il. Voulez-vous, Madame de Kulaudan, venir prendre un verre de Champagne, pour fêter cette date inoubliable.
— Je veux bien, répondit-elle simplement.
Ils retournèrent nus dans cette salle, où elle avait laissé les derniers vestiges de son innocence. Peu à peu son anéantissement se dissipa, et trinquant son verre elle lui dit :
— Tu m’as battue ! Tu ne l’aurais pas fait, si j’avais été ta femme et si j’eusse été vraiment en âge de l’être !
— L’âge de l’être, nigaude, on l’a toujours ; Agathe désirait ce qui t’a si fort épouvantée !
— Agathe ! Tu le lui aurais fait, et si tu ne l’as pas fait, c’est que tu avais une raison qui te retenait ! Tandis que moi, une marchandise, une fille achetée, tu t’es cru le maître, tu n’avais pas à te gêner. Cela, ce n’est pas bien. Tu as été le plus fort, je me suis soumise. Je crains de ne pas être ce que tu cherchais.
La femme ergotait.
— Tu le seras, mignonne, répliqua-t-il ! la violence masculine est chose si naturelle, que si les femmes ne la subissaient pas, elles prieraient le bon Dieu de leur envoyer le diable. N’es-tu pas déjà mieux ?
— Je n’en sais rien.
Elle affichait un air résolu qui lui allait très bien ; il l’embrassa avec tendresse, elle rendit les baisers. La voyant plus calme, il la ramena dans sa chambre, arrangea son lit, lui passa sa chemise de nuit qu’elle avait dans sa malle, apportée dans la journée, pendant leur promenade, et lui dit de dormir en paix !
— Si tu as besoin de quoi que ce soit, ajouta-t-il en la quittant, tu n’as qu’à venir me trouver, tu es maîtresse d’entrer dans ma chambre à toute heure de jour et de nuit.
Il lui expliqua encore le mécanisme pour l’électricité, remplaça, en se retirant, la forte lumière par une plus douce, dissimulée au plafond sous un nuage de gazes de différentes couleurs.
Seule dans sa chambre, dans son lit, séparée de l’homme qui venait de la violer, elle pensa pendant quelques secondes, poussa quelques soupirs, et dominée enfin par le plaisir du luxe dans lequel elle vivrait, de l’indépendance qu’elle entrevoyait ; elle s’endormit paisiblement.

VIII
Elle n’avait pas l’habitude de faire la grasse matinée : à huit heures elle s’éveilla et se leva. Aucun bruit ne lui parvenait, sinon ceux de l’avenue Friedland.
Impressionnée de ce calme, elle crut de son devoir de s’occuper de sa chambre ; cet ouvrage terminé, elle passa à sa toilette.
Se rappelant qu’elle avait licence d’entrer chez lui, elle entrouvrit la porte de communication et entendit son souffle régulier, il dormait encore ; elle referma doucement, vint à sa fenêtre aspirer l’air à pleins poumons, et comme neuf heures sonnaient, on frappa à sa porte.
Elle courut ouvrir, Félicité la saluait :
— Bonjour, Mademoiselle, vous êtes la parente de Monsieur, je n’osais entrer. Je supposais que vous dormiez ! Vous avez fait votre lit ? Il ne fallait pas ; il y a le service pour ça ! Que désirez-vous pour votre déjeuner ? Monsieur n’a pas laissé d’ordre. Du thé, du café au lait, du chocolat ?
— Du chocolat.
— Voulez-vous que je vous serve ici, ou à la salle à manger.
— Ici ! J’attendrai que mon cousin soit éveillé !
— Bon, bon, je vais vous porter à manger.
Félicité ne pouvait manquer d’examiner avec curiosité cette jeunesse ! Était-ce une fillette, était-ce une jeune fille, elle ne le définissait pas bien. La robe de Rita n’était pas courte, cela faisait pencher pour l’hypothèse d’une jeune fille. Le visage gracieux et mutin, trahissait une nature sortie de l’enfance ! La brave servante, en allant chercher le déjeuner de Mademoiselle, hochait la tête, ne devinant pas la qualité de cette parente, dont elle ne sût jamais rien, ni de ce qu’elle serait dans la maison.
Elle eut bientôt servi son déjeuner, et malgré son désir de s’instruire, elle se résigna à se retirer, Rita affirmant n’avoir besoin de rien.
Rita se sentait de l’appétit ; elle prit avec grand plaisir ce premier repas ; l’appétit satisfait lui inspira de l’audace, elle pénétra dans la chambre de Célestin et s’avança jusqu’au lit.
Célestin avait le sommeil léger ; le bruissement de la robe l’éveilla, il aperçut la fillette habillée et s’écria :
— Quelle heure est-il donc ?
— Pas loin de la demie de neuf heures !
— Et tu es déjà debout ?
— Je me lève bon matin.
— Il fallait dormir, petite sotte ! Tu t’éreinteras.
— Oh non, je suis très bien.
— Vraiment !
Il s’étirait les bras, se secouait : il la pria d’ouvrir les contrevents, puis ajouta :
— Qu’as-tu fait ma mignonne ?
— J’ai déjeuné.
— Très bien cela ! Tu as demandé ce que tu voulais à Félicité ?
— Elle est venue elle-même.
— Quelle tête a-t-elle eue ?
— Comment quelle tête ?
— Dam, elle ne te connaissait pas, elle devait mourir d’envie de bavarder.
— Je n’y ai pas coupé, je le devinais bien.
— De l’argot, Mademoiselle, du vieil argot ; pas coupé, pas coupé !
Elle eut un joyeux éclat de rire qui ensoleilla son visage : il la saisit par les bras, l’attira près de lui et murmura dans son oreille :
— Le mal ne t’a pas empêchée de dormir ?
— Quel mal ?
— Ton pucelage envolé.
Elle rougit, appuya la tête sur son épaule, pour se cacher le visage.
— Tu n’es plus fâchée ? Tout bas, elle répondit :
— Non.
— Tu es gentille ! Veux-tu voir ce qui t’a écorchée avant que je m’habille, que j’appelle Félicité.
Elle observa le silence, gardant la tête appuyée contre son épaule.
Il rejeta les draps, et, sa chemise soulevée, lui montra sa queue, ses couilles, son ventre et ses poils.
— Regarde, regarde, ce n’est pas bien méchant.
— Je n’ose pas.
— Ah, la petite niaise ! C’est entré dans ton ventre, c’est un ami pour toi.
Elle hasarda un coup d’œil ; il lui guida la main dessus. Elle ne résista pas, et sans aucune indication la caressa, puis l’embrassa à l’extrémité. Il l’arrêta, ne voulant pas s’oublier davantage.
— Là, là, dit-il, c’est bien, tu finiras par l’aimer. Maintenant il s’agit qu’on ne se doute pas de ce qui se passe entre nous. Comprends-moi bien. Je suis ton tuteur, tu es ma pupille, on te respectera à ce titre et tu commanderas au service. Tu ne te confieras à personne sur la nature de nos rapports.
— À personne.
— Sous cette condition, je te promets de te rendre la vie aussi heureuse que possible. Je suis riche, tu ne manqueras de rien, et plus tard, quand tu seras une grande fille, j’assurerai ton avenir. Tu es encore trop jeune pour penser à ces choses. Ce que nous faisons ensemble, je te recommande d’éviter de le faire avec d’autres hommes, on ne sait ce qui en résulterait. Cela s’appellerait une trahison. T’en rends-tu compte ?
— Oui.
— Tu es une fille intelligente, je n’abuserai pas de ta jeunesse, je t’accorderai les repos nécessaires. Retourne à ta chambre, je vais sonner Félicité ; je te rejoindrai dès que je serai vêtu. Si tu t’ennuies, tu n’as qu’à te promener par l’appartement, tu es chez toi.
— Je ne connais encore personne.
— Il n’y a pour le moment que Félicité ! Pour moi seul, elle suffisait : j’étais si peu ici.
Elle revint dans sa chambre et s’installa à une fenêtre : le temps était splendide et doux, une belle journée d’automne.
Elle ne resta pas longtemps seule. Félicité vint la prévenir que monsieur Célestin l’attendait au grand salon. Elle y accourut et le vit avec une jeune brune, coquette et avenante.
— Ma chère enfant, dit Célestin, tu connais Félicité, voici maintenant Annette, fille de chambre, qui sera plus spécialement chargée de s’occuper de ton service. Elle ne demande qu’à être appréciée, j’espère que tu en seras satisfaite.
— Mademoiselle, dit la camériste, peut être sûre de n’avoir jamais un reproche à m’adresser.
— Je ne suis pas difficile, trouva à dire Rita, je tâcherai de me montrer raisonnable dans mes exigences.
Annette sortit, et, comme Félicité, se demanda ce que pouvait bien être cette si jeune parente qu’on installait en maîtresse.
À deux heures de l’après-midi, Célestin et Rita descendirent pour aller au Bon Marché, où Célestin entendait acheter le plus pressé en robes et trousseau à sa jeune amie, en attendant qu’elle complétât sa croissance et qu’elle se choisît une couturière qui l’habillât à son goût.
Dans le vestibule de l’escalier, tout à coup une voix s’écria :
— Je ne me trompe pas, c’est bien Rita !
— Clotilde, répondit Rita, toi, vous !
Une femme, toute jolie et toute jeunette, d’une très grande élégance, à la poitrine bombée, à la tête fine et délicate, au corps souple et onduleux, d’une beauté plus que séduisante, ouvrait les bras à la fillette, tandis que derrière elle, un adolescent, un jeune homme de dix-sept ans, à l’allure gauche et empruntée, demeurait bouche bée.
— Toi, Rita, toi, par quel hasard ?
Célestin grimaçait un sourire et éprouvait une sourde terreur ! Quelle était cette dame ? Une parente, une amie de la famille de Rita ! Diable, diable, et Agathe qui, avait affirmé son amie, était absolument isolée.
Rita sauva la situation ! elle fit les présentations :
— Mon cousin et tuteur. Monsieur Célestin de Kulaudan, qui m’a retirée de pension, pour achever chez lui mon instruction : une ancienne élève de chez les demoiselles Maupinais, des grandes, Mademoiselle Clotilde…
— Aujourd’hui Madame Clotilde Go, intervint gracieusement la jeune femme tendant la main à Célestin ; je suis charmée. Monsieur, de vous rencontrer, je savais que vous habitiez la maison, je ne me doutais pas que j’aurais le plaisir de vous connaître.
— J’ignorais…
— Nous ne sommes ici que depuis trois mois, vous voyagiez quand nous avons loué le quatrième, deux étages au dessous de vous : Je vous présente mon jeune beau-frère. Monsieur Clément Go, qui vient de passer son baccalauréat et qui songe au professorat.
— Vous me voyez, Madame, on ne peut plus heureux !
— Et moi, ce que je suis enchantée ! Vous me la prêterez quelquefois cette chère petite ! Elle était une enfant, lorsque je quittais l’institution Maupinais, mais j’avais déjà remarqué sa gentillesse et je l’aimais beaucoup, n’est-ce pas Rita ?
— Oh oui, Madame !
— Tu ne vas pas me dire, Madame ! Cher Monsieur, vous sortez comme nous, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Demain est mon jour. Il n’y en aura pas pour vous ! Vous seriez bien aimable de monter un moment, vers les cinq heures, si cela ne vous dérange pas, on commencera à être plus intimes, nous aurons l’occasion de faire plus ample connaissance, est-ce dit ?
— Mon Dieu, Madame…
— Pas de refus, je vous en supplie.
— Soit ! Je dois cependant vous prévenir que nous sommes très peu chez nous ! Je tiens énormément à ce que ma cousine prenne des distractions, fasse de l’exercice.
— Je ne vous en empêcherai pas ; mon amitié n’aspire pas à la tyrannie. Dites oui pour demain.
— C’est dit.
Rita et Clotilde s’embrassèrent et on se sépara, Célestin ayant appelé un fiacre. Dans la voiture, il était très rêveur, il murmura enfin :
— Voilà une rencontre qui me contrarie.
— Pourquoi cela ?
— De tiers, en dehors d’Agathe, je n’en voudrais pas.
— Si tu savais comme Clotilde est bonne, gentille.
— Je ne dis pas le contraire ; mais je me méfie de l’amitié d’une femme pour une fillette de ton âge.
— De quoi as-tu peur ? Que je parle ! Je t’ai promis et je le jure, jamais je ne causerai à personne de ce qui est entre nous.
— Bon bon, j’ai confiance en ta discrétion ; de mon côté, je te promets de faire tout ce qui dépendra de moi pour te distraire, afin que tu ne t’ennuies jamais.
— Tu es tout plein gentil, en parlant ainsi, et j’oublie ta méchanceté de cette nuit.
— Ma méchanceté !
En quittant le Bon Marché, Rita rayonnait ; elle eut dévoré de caresses Célestin. Quatre toilettes différentes, des chemises luxueuses, des bas, des jupes, des pantalons, des peignoirs, tout ce qu’elle avait désigné, il le lui avait acheté, la guidant il est vrai de son goût et de son expérience : elle allait se trouver ébouriffante, selon son expression, elle épaterait les camarades de la pension dans ses toilettes, quand elle les verrait.
Dans son plaisir, elle trépignait de rentrer avenue de Friedland, après le dîner, ne voulant pas d’autres distractions pour cette soirée, que celle de placer dans ses armoires, dans ses tiroirs, toutes les belles choses dont elle devenait la propriétaire, et que Célestin recommanda bien au magasin d’expédier de suite.
Le service n’habitait pas l’appartement : il logeait au sixième. Célestin et sa pupille étaient donc libres d’agir à leur guise.
L’agitation, la fièvre de Rita inspirèrent à Célestin la crainte qu’elle ne se fatiguât trop ! En somme, c’était une enfant, quatorze ans et demi, et il avait bien résolu de la respecter cette nuit, de l’engager au repos dès qu’elle aurait terminé le classement de ses achats.
Il s’amusa à lui voir étaler ses linges, ses toilettes, à les étudier pour les placer à tel ou tel endroit, à essayer les robes et les chapeaux, à se faire des grimaces devant la glace en s’appelant Madame, s’adressant des sourires, des révérences et disant :
— Madame salue Monsieur.
Assis sur un large fauteuil, dans cette chambre de jeune fille où, aux nuances assombries de quelques tentures, se révélait l’assaut subi par la virginité, il rêvassait, et dans sa rêvasserie surgissait l’image de madame Go.
— Si tu me parlais de ton amie, de Clotilde, insinua-t-il enfin !
— Mon amie ! J’étais trop petite pour qu’elle le fût ! Elle était toujours gaie et bonne enfant, prodiguant à toutes ce que ses parents lui portaient. Elle quitta la pension elle avait seize ans, on la renvoya.
— On la renvoya ! Pour une grosse faute ?
— Dam, une histoire assez forte. Ma petite amie Bernerette me l’a contée.
— Ta petite amie Bernerette ! il t’en pleut donc des amies ! Je croyais que vous vous aimiez seulement avec Agathe !
— Nous nous aimions aussi avec Bernerette.
— Et de la même façon qu’avec Agathe ?
— Comment ça, avec Agathe ?
— Agathe, en me causant de ta charmante personne, ne m’a rien caché de votre amitié.
— Que t’a-t-elle dit !
— Que vous vous aimiez bien davantage qu’on ne s’aime entre amies ordinaires.
— Elle a eu tort, si elle a avancé des choses qu’on peut toujours nier.
— Oh, Mademoiselle l’audacieuse, nier !
— Il y a des choses qu’on ne doit jamais dire. Eh toi, que penserais-tu si je racontais ce que tu as fait avec moi.
Il comprit le reproche que lui adressait Rita et reprit :
— Donc, tu étais l’amie de Bernerette ?
— L’amie, oui, et celle d’Agathe aussi.
— Cela me suffit. Narre-moi l’histoire de Clotilde, si toutefois ce n’est pas commettre une trahison !
— Non, il n’y a pas trahison, mais c’est… très difficile. Bah, avec toi, c’est comme avec mes amies à présent ! Il faut te dire que les parents de Clotilde sont ce qu’on nomme des athées. Le père détestait l’église, les curés, les prêtres, et appelait puces tous les abbés.
— Puces !
— Oui, parce qu’ils vivent du sang des imbéciles qui les écoutent, à ce qu’il prétendait.
— Oh, Rita !
— Ce n’est pas moi qui dit cela, je te répète ce que disait le père de Clotilde. Elle n’était pas très dévote non plus, mais elle accomplissait ses devoirs religieux comme les autres. Un soir, à l’étude, elle riait et se grattait quelque part ; sa voisine lui demanda ce qu’elle avait. Elle répondit en écrivant sur un bout de papier, tiens, regarde, c’est plus commode à montrer, elle écrivit ces lettres, avec le chiffre i au milieu : G O Q i A B.
— J’ai au cul un abbé ! Fi de la mauvaise drôle !
— La maîtresse vit le papier entre les mains de la voisine, qui se tordait de rire, elle vint le prendre et il y eut une scène épouvantable. On avisa les parents de Clotilde et elle quitta la pension,
— Et toi, qu’as-tu au cul dans ce moment, dit-il en lui saisissant vivement les fesses ?
Elle sursauta à cet attouchement et répondit :
— Tu serais bien attrapé si je te répondais par la onzième lettre de l’alphabet doublée.
— Onzième lettre ! Voyons la onzième lettre : A, B, C… K. Ka, oh, oh, petite sale !
— Il n’y en a pas va, ne t’effraye pas.
Elle s’était arrêtée pour le favoriser dans son pelotage : il retira la main, ne voulant pas s’échauffer, et elle s’occupa à tout enfermer de ses emplettes du Bon Marché.
Quand elle eut terminé, remarquant combien il était tranquille, elle vint subitement s’asseoir sur ses genoux, lui jeta les bras autour du cou et murmura :
— Oh, je n’ai pas pensé à toi, je m’amusais avec toutes ces belles choses que tu m’as achetées, et toi, tu ne disais rien !
Elle le câlinait, ils échangèrent un baiser et elle lui dit :
— Tu as bien fait de t’amuser, je ne suis pas ton bourreau, ma chérie, et je te le dis de nouveau, je dois ménager tes forces.
Elle eut une moue expressive et répondit :
— Je suis forte, je suis forte… et je n’ai plus peur.
Ce : « Je n’ai plus peur », fut comme un coup de fouet, il se leva vivement et dit :
— Ah vraiment ! Eh bien, viens dans ma chambre, nous verrons si tu n’as pas peur !
Elle le suivit sans aucune hésitation, avec un air tout à fait décidé, et là il reprit :
— Allons, ma mignonne, nous allons recommencer, déshabille-toi, comme hier, et, si tu n’as pas peur, tu iras à ton lit, tu m’y attendras ; je jugerai à la réception que tu me feras si vraiment tu ne mens pas et si tu es une petite femme.
En un instant elle fut entièrement nue, et lui se dévêtissant en même temps, elle dit en se dirigeant vers sa chambre :
— Si je m’effraye, porte ta canne, tu me battras encore, comme tu as fait hier.
Il restait pétrifié devant cette attitude ! À peine était-elle sur son lit qu’il l’avait déjà rejointe et, comme la veille, en vrai fauve, il se précipita sur elle.
Mais elle avait les cuisses ouvertes, elle s’arrangeait, elle se prêtait de son mieux et elle répondait à l’attaque. Il la posséda cette fois réellement, non sans encore quelque écorchure et un petit gémissement qu’elle étouffa aussitôt ; il jouit et la prit avec furie. Il retourna ensuite dans sa chambre, ils dormirent chacun dans leur lit.

IX
C’était pour lui une véritable corvée que de monter vers les cinq heures de l’après-midi chez Clotilde : Rita avait endossé la plus belle de ses toilettes, elle exultait à la joie de se montrer, elle l’entraîna.
Cependant il avait des préoccupations.
Le matin même, une lettre de monsieur Pleindinjust, l’oncle d’Agathe, lui était parvenue, lettre contenant des reproches sur la façon incorrecte dont il avait rempli sa mission de confiance.
« Garder toute une nuit une enfant n’était certainement pas condamnable contenait entr’autres aménités la lettre, mais l’enfant révélait déjà la jeune fille, et il existait tant d’esprits méchants qu’on pourrait plus tard reprocher à sa nièce cette imprudence. Je ne vous eusse jamais cru capable d’une telle infraction aux plus simples convenances, etc., etc.
La colère faillit le pousser à répondre du tic au tac, que lorsqu’on débauchait une nièce, on devait bien s’attendre à ce que la nièce débauchée débauchât des hommes, il remit sagement au lendemain toute détermination à ce sujet.
Rita avait coquetté toute cette journée comme une femme experte, et il commençait à s’estimer très heureux de l’avoir sortie de pension.
Clotilde ne s’apercevrait-elle pas de ce qui se passait.
Ainsi qu’elle l’avait annoncée, il ne restait plus que deux à trois personnes chez elle, au moment où ils se présentèrent. Elle les accueillit avec grande affabilité, même avec affection.
— Ah, Monsieur, s’écria-t-elle, que vous êtes aimable de vous être souvenu de ma prière !
— Le plaisir de Rita était le mien, chère Madame.
Merci de cette bonne parole ! Je pense qu’elle ne demande qu’à être prouvée et je vais droit au but. Vous nous resterez à dîner.
— À dîner !
— Sans cérémonie, en tête-à-tête avec mon beau-frère et moi. Mon mari est absent, et il sera enchanté de savoir que j’ai retrouvé dans la maison une ancienne petite amie !
Quel sourire, quel grâce ! Cela dit, la main dans la main, les yeux dans les yeux, par une jeune femme d’une beauté merveilleuse, avec un buste d’un divin modelé, les seins pointant sous un corsage les moulant, ces seins dont manquaient ses petites amies, Agathe et Rita ; une femme d’une élégance recherchée, appliquée à faire un poème d’irrésistible séduction de son corps, de ses allures, de ses moindres gestes, de cette femme renvoyée de la pension Maupinais pour avoir écrit sur un papier : G O Q i A B ! Célestin se sentant mollement bercé par une douce impression de contentement. au contact de cette jolie femme, répondit :
— En effet, en effet, Madame, nous ne pouvons nous dérober.
Quelques secondes d’une conversation banale suivirent, puis les dernières visites cessant, on se trouva en intimité. Rita, tout à fait à l’aise, babillait avec Clotilde et taquinait déjà Clément le sauvage. Célestin plaisantait et riait, subjugué par la nature exubérante de Clotilde ; une apparition provoqua une nouvelle stupeur de Rita, on avait sonné, et dans le salon entra tout à coup Antonia Lapers, la petite externe, amie de Bernerette, qui, lui sautant au coup, s’écria :
— Ah, quelle veine de te rencontrer chez ma cousine !
— Ta cousine ?
— Eh oui, Clotilde.
— Je n’en savais rien.
— Je lui avais conseillé de ne pas trop s’en vanter chez ces demoiselles, dit Clotilde ! Tu es bien en pays d’amies, ma petite Rita.
Déjà Antonia s’emparait de la fillette, après avoir annoncé que ses parents la laissaient à dîner, et l’emmenait pour lui confier un secret sur la pension, ce qui amusait beaucoup tout le monde.
Un moment Clotilde demeura avec Célestin et Clément, puis sortit pour donner divers ordres, et revenant ensuite, dit :
— Ces deux gamines, j’ignore où elles ont passé et ce qu’elles complotent, je ne les ai pas aperçues ; encore une enfant, Rita !
Et voilà que Clément sortant, Célestin et Clotilde se trouvèrent en tête-à-tête, sous la lueur des lampes éclairées, et que l’exclamation de Clotilde, tombée sur le cœur de Célestin, y tinta comme un reproche de sa conduite.
— Une enfant, une enfant, reprit-il après un court silence, une vraie fille, chère Madame, en pleine aspiration d’indépendance, une fille d’Eve cultivant toutes les curiosités.
— Rita, allons donc ! Elle n’a pas quinze ans, autant que je m’en souviens.
— L’âge ne signifie rien.
— Vous relevez donc des éveils d’idée chez Rita ! Oh mais, dans ce cas, vous n’en avez que plus de mérite de vous charger d’une telle tutelle !
Puis, emportée par une pensée follichonne, elle se rapprocha et ajouta :
— Dites, ce serait bien drôlichon si elle allumait une flamme chez mon beau-frère et qu’elle l’apprivoisât !
Célestin fit une grimace qui dépeignit l’ennui qu’il en ressentirait, elle s’en aperçut, eut un accès d’hilarité et dit :
— Ah, par exemple, vous apprêteriez-vous à jouer les Bartholo ! Oh, Monsieur de Kulaudan, vous n’êtes pas encore d’âge et vous êtes trop homme de goût pour ne pas préférer des fruits savoureux à des fruits verts.
Était-ce une attaque, il se rasséréna soudain et répliqua :
— Les fruits savoureux, chère Madame, ne consentent pas toujours à se laisser savourer.
— Des bêtises ! Un homme bien né sait toujours s’assurer le fruit savoureux à l’heure où il convient le mieux de le savourer.
Eh, eh, eh, il y avait de la candeur dans l’audace de la femme : il torturait son imagination pour lancer une pointe de marivaudage, les deux fillettes reparurent, Rita assez rouge, Antonia avec sa mine chiffonnée d’enfant malicieuse et vicieuse.
— Où étiez-vous, interrogea Clotilde ?
— Dans un coin bien caché ; j’avais un gros secret à dire à Rita.
Un gros secret !
Sorties du salon, Antonia qui connaissait les êtres de la maison, avait conduit Rita dans le cabinet de travail de M. Go, où elle savait qu’on n’allait pas, et lui avait remis une lettre d’Agathe.
— J’en ai mis une à la poste pour ton Monsieur, lui dit-elle ! La tienne, elle a tenu à ce que je te la remette et je suis venue pour ça.
— Et si tu ne m’avais pas rencontrée chez ta cousine ?
— Je serais descendue te la porter ! Oh, elle est en colère, Agathe ; elle dit que tu es une oublieuse une ingrate.
— Une ingrate !
— Oui, de ne pas lui écrire ! Elle veut que vous la fassiez sortir dimanche.
— Dimanche ! C’est impossible. Son oncle vient d’écrire une lettre de sottises à Célestin.
— Il lui en a écrit aussi une à elle ; mais elle s’en moque, elle dit qu’il changera d’avis et qu’il donnera l’autorisation d’ici là.
— Tu diras à Agathe qu’il n’y a pas de ma faute si je n’ai pas écrit, qu’elle ne m’en veuille pas ; je ne fais pas mes volontés et j’ai eu bien des ennuis que je lui raconterai ! Oh, je serai bien heureuse lorsque nous pourrons la prendre le dimanche avec nous, mais il faut qu’elle ait un peu de patience. Et Bernerette ?
— Bernerette, elle se console avec moi.
— Avec toi ?
— Oui, moi aussi, tu sais bien !
— Petite mauvais sujet ! Tu n’as pas encore fait ta première communion !
— Ce n’est pas une raison pour se priver de ce qu’on aime ! Dis, puisque je suis votre commissionnaire, tu vas me payer.
— Te payer !
— En étant bien gentille et en te prêtant comme Bernerette.
— Tu n’y penses pas, Antonia !
— Tu consens, eh, et ça me causera tant de plaisir ! Ici, on est plus libre qu’à la pension et je me régalerai vite.
— Non, non, non.
— Alors, tu es une méchante et je dirai du mal de toi à Agathe, à Bernerette ; et puis, à ton Monsieur, tu sais, moi, je n’ai peur de personne.
— Voyons, que me veux-tu ?
— Aller sous tes jupes.
— Ah, que tu es petite saloperie, vas-y vite et retournons au salon ; je lirai ma lettre cette nuit.
L’autorisation obtenue, Antonia se jeta à quatre pattes, fourra la tête sous les jupes de Rita, entrouvrit le pantalon, commença par bécoter le cul, puis glissa entre les cuisses, où elle lança quelques adroites minettes, témoignant de sa vocation un peu prématurée et ne céda qu’avec beaucoup de peine à l’injonction de Rita, lui rappelant l’imprudence qu’il y aurait à rester trop longtemps éloignées du salon.
S’arrachant de dessous les jupes, elle dit :
— Ah ben oui, Rita, c’est autre chose qu’à la pension : tu as du bien beau linge et tu as la peau toute douce, toute douce ; puis, il y a une différence que je ne m’explique pas.
— Rita, devenue rouge cramoisie, s’échappa pour retourner au salon, suivie de l’endiablée morveuse.
Oh, il s’en passe de raides dans bien des maisons, et messieurs les moralistes y perdraient la vue et le raisonnement, s’il leur était accordé d’y examiner de près. Pauvres fous qui s’épuisent à vouloir endiguer le torrent de vie que par l’amour et la volupté la Nature et l’Immensité déversent dans les êtres !
Quelle joie pour un homme du caractère de Célestin, de se trouver à table à côté d’une femme charmante et coquette comme Clotilde, d’une petite amie intelligente et prévenante comme Rita, car il était entr’elles deux.
Clément, placé de l’autre côté de Clotilde, buvait des yeux Rita, dont, par malice, l’avait séparé sa belle-sœur, en mettant entre lui et elle la petite Antonia.
On parla voyages, aventures, et Célestin apprit que monsieur Go voyageait en Russie, chargé d’une mission ; il sut que c’était un homme sérieux et grave, âgé de trente-cinq ans, imbu d’idées autocratiques, quoique affichant des principes républicains, marié par goût et par raison plus que par amour ; il devina que cette jeune femme, remplie d’attraits, éprouvait un besoin impérieux d’agitation, de vie, et il la charma par des récits sur son existence en plein air.
Dans le salon, où l’on servit du thé, vers les dix heures, s’occupait-il encore de Rita !
Il était lancé à fond de train dans le plus délirant des marivaudages, et Clotilde lui fournissait la réplique on ne peut mieux. Antonia était partie avec sa bonne. Clément montrait à Rita de très beaux albums de gravures.
Les choses s’arrangeaient-elles dans de plus convenables proportions !
Clotilde dit à Célestin.
— Une fillette de près de quinze ans, seule avec vous, il y a là un terrible danger en perspective !
— Le danger n’existe que pour ceux qui le craignent.
— Et pour ceux qui le bravent ! Je suis franche, cher Monsieur Célestin, il y a des ombres que je ne m’explique pas, dans cette dernière aventure où vous récoltez une pupille, et l’enfermez chez vous.
— Quelles sont ces ombres ?
— Je le jurerai, Rita n’est plus vierge.
— Ceci est de la psychologie… perspicace !
— L’est-elle ?
— Le sais-je !
— Vos yeux se voilent.
— Vous les regardez donc !
— Ne cherchez-vous pas les miens ?
— Ils reflètent l’azur du firmament, j’y admire une pureté qui n’est peut-être pas dans ceux de Rita.
— Vous les avez donc étudiés !
— N’est-ce pas mon devoir.
— Et… aussi votre droit ! Vous avez dit : de la psychologie… perspicace. Des esprits malveillants traduiraient le mot perspicace pour un aveu… bien dangereux.
Il eut un gros embarras : elle se leva pour resservir du thé, Rita abandonna Clément, Clotilde lui dit :
— Que te montre-t-il ?
— Les vues des pays dont nous a parlé Célestin.
— Il aime beaucoup connaître les diverses régions de notre globe, apprivoise-le.
— Il est tout apprivoisé.
Assis sur le canapé, où il marivaudait avec Clotilde, Célestin s’intéressait à l’échange banal de ces quelques mots, et comparait la joliesse du fruit épanoui que représentait Clotilde, au bouton de fleur entrouvert que représentait Rita.
Il se sondait, il ne se le dissimulait pas, il désirait Clotilde à cette heure, mais il ne renoncerait pas à Rita, et la voyant, après cette recommandation de Clotilde, retourner à Clément et appuyer une main sur son épaule en signe amical, il en ressentit une sourde colère.
— Beau seigneur, lui dit gracieusement Clotilde, une tasse de thé à la main, encore ceci.
— À une condition.
— Vraiment, vous vous sentez à point pour en dicter ?
— À point, pour tout oser ! J’accepte cette nouvelle tasse de thé, mais je vous invite à venir prendre du Champagne chez nous demain soir.
— Chez Rita et chez vous ! Le « chez nous » est caractéristique.
— Ne cherchez pas la petite bête et acceptez.
— Oh, la petite bête ! Est-ce de Rita que vous parlez, ou de celle qui accepterait… votre Champagne.
— Acceptez-vous ?
— Oui, ça m’amusera et cela permettra à Clément de dessiner sa petite cour : il a l’air de marcher.
— Ah ! tant pis pour vous dans ce cas ; je dessine aussi la mienne.
— La vôtre ! Et auprès de qui ?
— Oh, vos yeux, quand ils regardent ainsi, ils trahissent tout ce que cachent vos voiles, ils trahissent cette splendeur…
— Eh bien, eh bien, voilà du joli, buvez, Monsieur de Kulaudan, et laissez les voiles dérober aux regards ce qu’ils ont mission de couvrir.
Rita s’amusait de tout cœur avec Clément, et elle ne dissimulait pas son plaisir comme Clotilde. Elle était encore enfant, et de plus, elle avait dans le sang la débauche qu’elle suça dans ses orgies avec Finette et Agathe, débauche consacrée par son dépucelage.
Démêlant promptement l’impression qu’elle produisait sur le petit jeune homme, lequel n’avait pas encore l’usage des faux détours, elle l’encouragea nettement, mue par le sentiment féminin de coquetterie et par l’espoir instinctif d’assujettir un mâle auquel elle retournerait la domination exercée sur elle par un autre.
Et, dès les premières gravures vues, s’apercevant fort bien de l’attrait que Célestin et Clotilde trouvaient dans leur conversation, elle le tutoya et lui dit :
— Tu es donc bien assommé que tu aimes à voir ce qui est loin !
Ses yeux souriaient, il comprit qu’elle lui faisait une bonne avance de camaraderie et il s’écria :
— Oh, Rita, Rita, tu veux donc que nous soyons amis pour toujours, que tu me tutoies ?
— Oui, mais il ne faut pas qu’on le sache.
— Ne crains rien.
— Tu me feras la cour, tu me diras tout plein de choses gentilles, et je chercherai à t’être agréable.
— Comme la vie va devenir belle !
— Seulement, ne l’oublie pas, devant le monde, nous serons toujours cérémonieux.
— Nous nous dirons vous.
— Nous ferons comme si nous ne pouvions pas nous sentir.
— Ça, ce sera tout de même trop difficile.
— Ne le crois pas, je me charge de t’y forcer. Pas ce soir, nous n’avons pas besoin de nous gêner, parce que mon tuteur raconte des histoires à Clotilde ; mais, après, nous nous verrons en cachette et nous rattraperons le temps perdu.
— Tu me permettras bien de t’embrasser ?
— Oui, et je t’embrasserai.
La soirée ne fut désagréable d’aucun côté : mais, par un effet de contraste, lorsque Célestin et Rita se retrouvèrent chez eux, Rita apparut aux yeux de Célestin pâlote, enfantine, incapable de soutenir la comparaison avec Clotilde ; et au contraire, Célestin apparut aux yeux de Rita, un homme hors ligne, dont on devait s’enorgueillir, qu’il serait délicieux de trahir par cela même, à cause de sa supériorité sur Clément, un être sans consistance, qu’elle élèverait à la dignité d’être son joujou.
Célestin eut une grosse mauvaise humeur en ramassant sur sa table une lettre qu’il devina être d’Agathe : il dit un bref bonsoir à Rita toute surprise et inquiète, se bornant à lui recommander de laisser la porte de communication, entre les deux chambres, ouverte, pour le cas où il l’appellerait dans la nuit.
Le maître ordonnait à l’esclave.
Rita avait aussi gardé sa lettre pour la lire à son aise toute seule.
Les deux amants, chacun dans leur lit, en prirent donc connaissance.
Et voici ces épitres d’une petite fille de quatorze ans.
À Célestin :
« Ah, mon bien chéri ami, j’ai peur d’avoir commis une sottise, en te parlant de Rita ! Quand je pense combien nous étions d’accord dans le chemin de fer, et puis dans la chambre d’hôtel, je regrette bien de ne pas t’avoir conservé pour moi. Tu ne peux t’imaginer combien je pense sans cesse à tout cela et combien je me désole d’avoir consenti à te partager. Te partager, encore si elle, elle le veut bien. Rita est une mauvaise amie, elle ne m’a pas écrit un seul mot depuis qu’elle a quitté la pension, et c’est cependant à moi qu’elle te doit. Ajoute à ce chagrin, que j’ai beaucoup, beaucoup d’ennuis. Mon oncle s’est fâché. J’ai été obligée de lui écrire que tu m’avais gardée la nuit, parce que je pleurais tout le temps en songeant à lui. Il m’écrit pour me dire qu’il est très mécontent de moi, il ne peut s’exprimer autrement, de peur qu’on devine, tu sais quoi, et il me promet de me montrer son mécontentement. Alors, j’ai peur ! S’il allait me faire enfermer comme une enfant perverse et folle. Il m’en a menacée, un jour, si jamais je racontais ce qui se passait entre nous. Tu me défendras, n’est-ce pas. Dis de ma part toutes sortes de vilaines choses à Rita. Je préviens mon oncle que tu l’as retirée de la pension et que je voudrais sortir le dimanche avec vous ; je lui dis que s’il n’envoie pas l’autorisation, j’ai préparé une lettre où je te raconte tout, et que tu la recevras avant la fin de la semaine, nous verrons bien ce qu’il fera. Adieu, petit ami chéri, oh, je serai bien heureuse d’avoir ton machin dans le cucu, comme l’autre soir, et je t’embrasse en y pensant, de toutes les force de mon cœur.
À Rita :
« Tu es une oublieuse, une traîtresse, de ne pas m’écrire ; je ne te pardonnerai jamais. Toutes mes vacances, je n’ai eu que toi dans l’idée, et toi déjà, tu t’amusais avec Bernerette, te moquant de moi, comme tu t’amuses maintenant avec Célestin, en lui contant sans doute des saletés sur mon compte. Ce n’est pas bien et je ne l’aurais jamais cru, surtout de ta part, que j’avais toujours menée à mes plaisirs avec Finette. Mais, il le paraît, les femmes et les filles ne peuvent plus s’accorder entr’elles, lorsqu’il y a un homme au milieu. Rita, Rita, prouve-moi vite que je me trompe et reste ma bonne amie. J’ai besoin de tout le monde, moi : tu me le prouveras en disant à Célestin de me faire sortir dimanche, et jusque-là, je ne t’embrasse pas,
Célestin jeta la lettre au feu qui brûlait dans sa cheminée, avec une mauvaise humeur encore plus accentuée. Puis l’un et l’autre cherchèrent le sommeil, Célestin tournant et retournant, Rita le saisissant vite.
Le silence régnait ; on était au milieu de la nuit, Célestin n’avait pas fermé l’œil. Après avoir évoqué l’image de la jolie madame Go, il espérait que ses sens s’assoupiraient, et voilà que Rita, réveillée sur un rêve plus actif, ayant remué dans son lit, il la revit en pensée, tandis que le désir mordait de nouveau.
En somme, il avait là, à portée de sa main, l’éteignoir voulu à toute impétuosité sexuelles. Il s’accouda, écouta, elle ne bougeait plus.
Il repoussa ses draps dans le dessein de la rejoindre ; il lui naquit une nouvelle fantaisie : se dépouillant de sa chemise de nuit, il se mit tout nu, et toujours accoudé, il appela :
— Rita, Rita.
La fillette ne s’était pas encore rendormie, elle se secoua, se leva et se dirigea vers la chambre, en répondant :
— Tu m’appelles, Célestin ?
Elle l’aperçut ainsi tout nu, la queue en érection ; elle s’approcha, il lui dit :
— Tu vois bien que je suis nu, ôte ta chemise.
Lorsqu’elle eut obéi, il continua en lui montrant ses cuisses :
— Tiens, pose ta tête là-dessus et regarde ton maître.
— Mon maître !
— En douterais-tu ?
— Mon maître, ce bout de chair !
— Oh, ce bout de chair ! Il est long, long et gros.
— Je le regarde, il est tout droit !
— Baise-le tout autour, et puis suce-le.
— Que je le suce !
— Ne sais-tu pas ce que c’est ?
— Je le devine bien.
— Alors, marche.
Elle embrassa, puis suça, avec un peu de maladresse d’abord, avec de l’entrain ensuite et il s’écria :
— Petite cochonne, si jamais tu te laisses aller avec monsieur Clément Go, tu tiendras de moi ta science.
— Avec monsieur Clément !
Elle suspendit son suçage, mais sans quitter des yeux la queue.
— Je t’ai suivie souvent dans ton manège, continua-t-il, avoue que tu cherchais à le débaucher.
— Moi, le débaucher ! Eh bien et toi avec Clotilde, ne lui parlais-tu pas tout près, tout près ! Et elle t’écoutait avec plaisir.
— Clotilde, est une coquette qui se moque du monde.
— Clotilde est une bonne fille qui aime à rire ! Je t’ai conté sa blague à la pension.
— Oh, tu l’as inventée, cette blague, j’en suis presque certain, appartient plutôt à ton imagination ! Or ça, pourquoi ne suces-tu plus ?
— Tu me dis des bêtises et il faut bien que je te réponde.
— Monte sur le lit.
— Tu veux me l’enfoncer ?
— Je ne suis pas encore décidé. Dans tous les cas, tu vas d’abord me présenter ton cul, que je lui fasse un gros bécot.
— Oh, tu voudras ensuite comme avec Agathe et tu me feras encore souffrir ! Si tu veux l’enfoncer, enfonce-le par devant, j’y suis habituée.
— Vraiment ! et ton amie Agathe t’a raconté la chose ; je croyais que vous étiez très discrètes pour toutes ces histoires.
Elle comprit qu’elle avait commis une sottise, elle essaya de la rattraper en disant :
— Ça se devine ; puis, tu me l’as dit toi-même.
— Tu deviens raisonneuse.
— Ça te contrarie : fesse-moi si ça te plaît, mais ne me pose plus des questions.
Il la prit dans ses bras par dessous lui, poitrine contre poitrine, lui toucha les seins à peine marqués, et murmura :
— Ah, ton amie Clotilde doit en avoir une jolie paire !
— On le voit bien à son corsage.
— Tu ne les as pas vus ?
— Et quand ? J’étais petite, lorsqu’elle a quitté la pension et je ne l’ai retrouvée qu’ici.
— C’est dommage, tu m’aurais dit comment ils étaient.
— Pourquoi ne lui demandes-tu pas de te les montrer.
— Sotte, cela ne se demande pas à une femme mariée.
— Veux-tu que je lui demande pour toi ?
— Le ferais-tu, cochonnette.
— Si ça te plaît, oui.
— Ah, c’est d’une bonne petite amie ? Tu n’es pas jalouse comme Agathe, toi !
— Agathe t’a écrit ?
— Elle se plaint de toi.
— À moi aussi ! Elle me dit toutes sortes de méchancetés, comme si j’aurais pu lui écrire ! La ferons-nous sortir dimanche ?
— Il faut d’abord l’autorisation de son oncle.
— Il l’enverra ; elle en fait tout ce qu’elle veut ! Ah, Célestin, Célestin, sois gentil, pas au cul, pas encore, une autre fois, devant, si tu veux, je t’en supplie.
— Et si je veux par là ! Tu n’es pas tout à fait femme, s’il te reste un demi-pucelage.
— Je t’assure… que tu t’amuseras moins. De l’autre côté, c’est tout plein chaud, ça a envie et ça te répondra.
— Ça a envie ! Tu as envie, coquinette, oh, la bonne plante, eh bien soit, on t’écoute, mais tu me céderas dans ma fantaisie.
— Oui, oui, tu es gentil, tiens, tiens, suis-je bien placée ainsi ! Oh, j’aime, quand ton bout me touche à l’entrée, oh, si tu n’allais pas si vite, dis, il me semble que tout mon sang tournerait de bonheur.
— Pas si vite, pas si vite… jouirais-tu par hasard ?
— Jouir, qu’est-ce que c’est ?
— C’est mouiller et perdre l’esprit.
— Oh oui, je mouillerais si tu poussais doucement, comme tu fais à présent ! Ah, Célestin, Célestin, tu entres bien, oh tu es mon vrai amant, ah, je mouille aussi, mon Dieu, est-ce possible ! La félicité m’inonde ; tiens, tiens, déchire-moi, si tu veux, le cul, le ventre, tout t’appartient.
— Ah, mon amour de petite Rita, ah, ma petite colombe parfumée, mon petit satin, tu es un trésor de femme !
— Dis, tu m’aimes pour de bon !
— Oui, oui, je t’aime, et toi ?
— Oh, moi aussi, et je te le prouverai ! Demain matin, pendant que tu dormiras, je monterai chez Clotilde, et je lui dirai de te montrer ses seins.
— Ah, grande nigaude, elle devinera ce qui se passe entre nous et elle te fichera dehors.
— Elle ne devinera rien du tout : je ferai croire que son beau-frère me plaît, et je lui parlerai en ta faveur. Et elle rira, oui d’abord, parce qu’elle pensera que je suis une naïve, une innocente et tu verras que je saurai réussir pour ce que tu désires.
Et cette nuit, il la baisa une seconde fois, reconquérant des forces avec cette jeunesse dont les ardeurs s’éveillaient aux élans de sa chair et qui lui transmettait de ses fluides régénérateurs.
