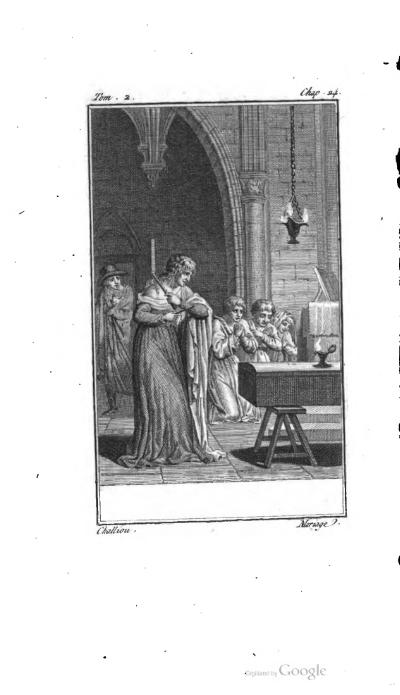La Cloche de minuit/Texte entier
H. Nicolle, An VI — 1798 (1, p. --290).
TRADUIT DE L’ANGLAIS.
TOME PREMIER.
────────────
À PARIS,
Au bureau de librairie, chez H. Nicolle,
rue du Bouloy, n°. 56, ci-devant hôtel de
la Reynie.
──────
An VI.
CHAPITRE PREMIER.
Le comte de Cohenburg descendoit d’une des plus nobles familles de la Saxe. Son château, situé sur un des bras de l’Elbe, étoit un des plus magnifiques de la Germanie ; ses richesses étoient immenses ; il passoit pour l’un des premiers hommes de son siècle.
Jeune encore, il avoit épousé la seconde fille du marquis de Brandenburg, dont il avoit eu cinq fils. L’aîné et le plus jeune avoient seuls survécu à leur mère.
Le comte de Cohenburg, après avoir pleuré sa femme pendant plusieurs années, la suivit dans le tombeau. Alphonse, son fils aîné, étoit alors âgé de vingt-six ans. Frédéric avoit cinq ans de moins.
Le nouveau comte, Alphonse, avoit une physionomie agréable, plutôt que belle. Sa taille étoit moyenne, son esprit bien cultivé, son caractère doux et bienveillant, mais soupçonneux.
Frédéric sembloit être fait pour enchaîner tous les cœurs. Ses traits étoient beaux et réguliers ; sa physionomie étoit expressive et prévenante, sa taille haute et élégante. Il avoit eu, comme son frère, une éducation très-soignée. Mais ne s’étant pas, à beaucoup près, autant livré à l’étude, il étoit moins instruit. Cependant, sa conversation étoit vive et spirituelle. Naturellement violent et emporté, sa colère ne duroit qu’un instant.
Parvenu à sa vingt-deuxième année, Frédéric devint amoureux d’une demoiselle du Luxemburg. Elle étoit belle, mais extrêmement délicate, orpheline, et très-riche. Frédéric acheta une maison dans le voisinage du château de son frère, et lorsqu’il eut épousé sa bien aimée Sophie, il crut s’être assuré, pour toujours, le plus haut degré de bonheur, dont il soit donné à l’homme de jouir.
Avant la fin de la première année de son mariage, la naissance d’un fils vint le combler de joie.
Le comte Alphonse, témoin du bonheur de son frère, désira de le partager. Il résolut de se marier, et choisit parmi toutes les beautés, qui faisaient alors l’ornement des cours de l’Allemagne, Anna, fille unique du duc de Coblentz. C’étoit une femme douée de tous les attraits. Sa taille étoit svelte, ses manières affables et polies. Il y avoit dans sa physionomie une expression, un je ne sais quoi supérieur même à la beauté, et dans sa conversation un charme, auquel il étoit impossible de résister.
Bientôt Alphonse n’eut plus rien à envier à son frère. Au bout de dix mois, son Anna lui donna un fils, précisément le même jour où Sophie accoucha d’une fille, son second enfant.
Le nom de son père fut donné au fils du comte Alphonse.
L’année suivante, Sophie mit au monde un troisième enfant, dont la naissance coûta la vie à sa mère.
La nature avoit fait à Frédéric, le funeste présent d’une sensibilité profonde. Son courage l’abandonna presque entièrement. Cependant ses larmes, essuyées par la main d’un frère, devinrent par degrés moins amères.
Anna, sœur tendre, prodigua aux enfans de Frédéric les soins d’une mère. Elle ne cessoit de les caresser. Elle consoloit leur père, et cherchoit par tous les moyens à le distraire. Enfin, elle parvint à alléger le fardeau de sa douleur.
Le comte Alphonse aimoit son frère avec tendresse ; il compatissoit à son malheur. Il eût voulu l’adoucir au prix de ce qu’il avoit de plus cher, les soins et les assiduités d’Anna exceptés. Il la croyoit incapable d’accorder à un autre la plus petite part de l’amour qu’elle lui devoit. Il se disoit à lui-même que c’étoit cet amour pour lui, qui la portoit à ne pas quitter son frère, afin qu’il ne restât pas seul avec sa douleur. Alphonse d’ailleurs connoissoit son malheureux penchant à la jalousie. Il s’efforçoit sans cesse de le combattre. Mais cette passion faisoit partie de son être. Il ne lui étoit pas donné d’en triompher.
Sans cesse il observoit son frère. Il cherchoit à lire dans les traits de la comtesse, lorsqu’elle étoit avec Frédéric. Il fut convaincu de son erreur. Il fut même sur le point de demander pardon à sa femme de l’injure qu’il lui avoit faite dans son cœur. Mais il pensa que cette démarche ne serviroit qu’à instruire Anna d’un défaut qu’elle ne lui soupçonnoit pas. Il résolut seulement de fermer plus étroitement à l’avenir l’entrée de son âme à la jalousie.
Le dernier des enfans de Frédéric, n’avoit pas survécu à sa mère que quelques heures. Trois ans après, l’aîné rejoignit sa mère et son frère dans la tombe. L’infortuné Frédéric ne se remit de ce coup terrible que pour en éprouver un plus affreux encore. — Sa fille mourut dans ses bras. — Le destin sembloit prendre plaisir à l’accabler. — Il résolut de quitter le théâtre de tous ses malheurs, et de voyager. — Il fit avec précipitation ses adieux à son frère et à sa sœur. Il partit.
Son absence dura quatre ans. À son retour, il étoit entièrement changé. Il n’ouvroit plus la bouche que pour se plaindre, et il étoit devenu rêveur et distrait. En un mot, il ne restoit plus aucune trace du brillant comte Frédéric.
Le comte Alphonse fut touché de son état ; mais la jalousie triompha encore une fois de tous ses efforts. Les soupçons se réveillèrent dans son âme. Il parvint cependant à ne pas les trahir aux yeux de sa femme et de son frère. Au bout de huit mois, Frédéric quitta de nouveau la Saxe.
Alors la pitié l’emporta dans le cœur d’Alphonse. Il crut s’être apperçu que son frère aimoit Anna, et qu’il cherchoit à triompher de son amour par l’absence, ou du moins à le cacher. La comtesse parloit souvent du changement extraordinaire de l’humeur de Frédéric. La manière dont elle s’exprimoit dans ces circonstances, convainquit Alphonse que son frère n’étoit pas aimé. Cette conviction lui causa la satisfaction la plus vive. Cependant il désiroit toujours que Frédéric ne revînt pas.
Cinq années s’écoulèrent, avant qu’il reparût en Allemagne. Il fit un court séjour en Saxe ; après quoi il fut encore absent pendant deux ans. À son dernier retour, l’inquiétude et l’agitation de son esprit, parurent changées en une profonde mélancolie. Il se retira dans sa maison, et annonça le désir d’y mener une vie très-retirée.
Alphonse s’imagina que son frère avoit trouvé quelque moyen de gagner le cœur d’Anna, et que sa retraite n’étoit qu’un prétexte, pour éloigner ses trop justes soupçons. Cependant, il prit de nouveau la ferme résolution de poser toujours le doigt sur ses lèvres ; mais de tenir sans cesse ses oreilles et ses yeux ouverts.
Le fils unique du comte Alphonse, avoit alors atteint sa dix-septième année. De beaux yeux noirs, des sourcils bien arqués, embélissoient sa mâle physionomie. Ses cheveux tomboient en boucles naturelles autour de son col. Son teint frais et animé annonçoit sa robuste santé. Le sourire du bonheur étoit toujours sur ses lèvres. Son esprit, naturellement vif et pénétrant, étoit orné des plus rares connoissances.
Il y avoit déjà un an que Frédéric étoit de retour dans son pays natal, lorsqu’une affaire importante, relative au testament de leur père, appella le comte Alphonse dans la capitale de l’Allemagne.
La veille de son départ, il alla voir son frère. Il fit de tendres adieux à sa femme et à son fils. — « Mon Anna est maintenant au pouvoir de Frédéric. » — Cette idée arrêta un instant ses pas, au moment où il traversa le vaste vestibule du château pour se rendre à la voiture qui l’attendoit. — « Mais n’est-il pas de son honneur de la protéger ? — Sans doute ! — Je ne soupçonnerai pas mon frère. » — Il quitta le château, et se mit en route, suivi d’un vieux et fidèle serviteur.
Le comte Alphonse étoit parti depuis deux mois. Ses affaires ne lui avoient pas encore permis d’annoncer l’époque de son retour. Il avoit souvent écrit à sa femme, et lui avoit exprimé dans toutes ses lettres, le plus vif désir de la revoir bientôt.
À la fin, le moment de son arrivée fut fixé. La comtesse l’attendoit avec toutes les marques extérieures de l’impatience et de l’amour, lorsque le matin du jour où il devoit arriver, le domestique qui l’avoit accompagné, parut seul au château. Les regards inquiets de la comtesse semblèrent lui demander de s’expliquer promptement.
« Le comte vous a-t-il envoyé devant lui, s’écria-t-elle ? »
« Hélas ! non. »
« Oh ! il est mort ! il est assassiné ! »
En prononçant ces mots, elle tomba sans connoissance, sur le plancher.
Ses craintes n’étoient que trop bien fondées. Le vieux serviteur apportoit la triste nouvelle que deux scélérats sortis d’un bois situé à dix lieues du château de Cohenburg, étoient tombés sur son maître, et l’avoient poignardé.
Les larmes vinrent soulager le jeune Alphonse, et dès que sa douleur lui permit de prononcer une parole, il donna l’ordre au vieux domestique d’aller informer son oncle de cet affreux événement, et le prier de se rendre à l’instant au château.
Lorsque la malheureuse Anna fut revenue à elle-même, elle fit signe de la main, aux domestiques qui l’environnoient, de sortir. Restée seule avec son fils, elle lui parla ainsi :
« Alphonse, ton oncle est l’assassin de ton père ! Jure-moi de venger sa mort. »
Alphonse, sans répondre, fixa sa mère avec des yeux égarés.
Anna continua :
« Tu parois étonné ! tu ne peux croire que l’hypocrite Frédéric soit un aussi grand scélérat ; mais jamais ton imagination ne pourra enfanter un monstre aussi noir que lui ! — Oh ! je puis te dire…
Elle s’arrêta.
« Expliquez-vous, de grâce, ô ma mère ! s’écria Alphonse. »
« Non, je ne puis… Je ne veux pas te donner une aussi affreuse idée du frère de ton père… Le tems peut venir ou tu… — Elle s’arrêta encore un instant. — Je ne puis prouver ce que j’ai avancé. Renferme donc ce secret dans ton sein ; mais jure-moi, par le ciel, que lorsque le meurtrier sera connu, tu vengeras la mort de ton père. »
« Oh ! ma mère, pouvez-vous penser que je puisse jamais manquer à un devoir aussi sacré ? Non ! faites-moi connoître le coupable, et je le jure par le ciel, à l’instant méme cette épée lui percera le cœur. »
« Je reconnois mon fils ! Daignent les anges veiller sur mon Alphonse, s’écria la comtesse en l’embrassant ! — Oh ! mon fils, tu ne connois pas le comte Frédéric ; mais le tems t’apprendra à le connoître. »
Ce dernier arriva bientôt. Sa physionomie et son maintien portoient tous les signes d’une douleur feinte. Alphonse put à peine supporter sa présence. Il crut voir la confirmation des conjectures de sa mère. Il fut sur le point de reprocher au comte sa scélératesse. Le désir d’acquérir la preuve de son crime, le détermina enfin à garder le silence. Il ne put cependant pas rester plus long-temps avec celui qu’il regardoit comme l’assassin de son père. Il s’élança hors de l’appartement, en s’écriant d’une voix presque étouffée par les sanglots : « Oh ! mon père !… »
Dans la soirée, le comte retourna chez lui. Le vieux domestique qui avoit apporté l’affreuse nouvelle, eut ordre de retourner sur-le-champ à l’endroit où son maître avoit été tué, et de faire transporter son corps au château, avec toute la diligence possible.
Le comte Frédéric se chargea de faire les préparatifs nécessaires aux obsèques de son frère.
Après le départ de son oncle, Alphonse fit de nouvelles instances auprès de sa mère, pour l’engager à lui faire connoître les raisons qu’elle avoit de soupçonner le comte Frédéric.
« N’insistez pas davantage, répondit-elle, je ne le puis pas. Le tems vous expliquera mes paroles. Oh ! Alphonse, souvenez vous de votre serment ! »
« Je jure de nouveau d’y être fidèle. »
Le lendemain le comte Frédéric revint au château de Cohenburg. Alphonse évita sa présence et se retira, à son arrivée, pour s’abandonner à toute sa douleur dans la solitude. Au bout de quelques heures, croyant son oncle parti, il rentra dans l’appartement, où il avoit laissé sa mère. Quelle fut sa surprise, en la voyant aux genoux du comte, et lui baisant la main ! — Elle se leva et se jeta dans un fauteuil. — Le comte s’appuya sur la croisée près de laquelle il se trouvoit.
« Où suis-je, se dit à lui-même Alphonse, et comment concilier cette conduite avec l’opinion de ma mère sur le comte Frédéric ? »
Anna s’apperçut que son fils la fixoit. Elle leva ses mains suppliantes vers le ciel.
Un instant après, Frédéric partit.
Alphonse rompit le premier le silence.
« Vous m’avez ordonné, dit-il à sa mère, de ne plus vous demander l’explication de vos soupçons… »
Il alloit continuer. La comtesse se leva, et fondant en larmes, elle sortit.
Alphonse, tourmenté d’horribles soupçons, traversa l’appartement, se jeta par terre, se releva, sortit de la chambre où il étoit, entra dans le jardin, s’y promena ; s’y assit ; tout fut inutile ; l’affreuse incertitude s’attachoit à ses pas. Le trait empoisonné avoit pénétré jusqu’à son cœur.
La comtesse lui fit dire qu’elle ne paroîtroit pas au souper. Alphonse ne s’apperçut pas qu’il étoit servi, quoiqu’il eut appuyé sur la table un de ses bras, dont il soutenoit sa tête appesantie par la douleur.
Il se retira de bonne heure dans sa chambre. Il chercha inutilement dans le sommeil l’oubli momentané de ses chagrins. — Il lut les lettres, qu’il avoit reçues de son père, pendant son absence. Ses pleurs ne lui permirent pas de lire long-tems. Il se jeta sur son lit. Sa lampe prête à s’éteindre, ne rendoit plus qu’une lumière pâle et tremblante. L’obscurité de la scène sembloit donner encore une teinte plus lugubre à ses pensées.
Minuit sonna. Tous les habitans du château de Cohenburg étoient ensevelis dans un profond sommeil, excepté le malheureux Alphonse. Étendu sur son lit, il songeait aux événemens du jour précédant, lorsqu’un cri perçant frappa son oreille, et le tira de ses réflexions. Ce cri lui parut partir de la chambre de sa mère. Il écouta ; il n’entendit plus rien.
« Sa douleur lui fait perdre la raison, s’écria-t-il ; ô femme infortunée ! daigne le ciel adoucir ses chagrins ! »
Il soupira, versa quelques larmes, et retomba sur son oreiller.
Après un court intervalle, il s’endormit.. À peine commençoit-il à jouir de ce premier repos, depuis la mort de son père, qu’il fut éveillé par le bruit de la porte de sa chambre, qu’il entendit ouvrir. Le jour commençoit à poindre. Alphonse reconnut sa mère qui entroit dans son appartement. Son air effaré l’alarma. Ses yeux étoient fixes. Tous ses traits exprimoient une douleur profonde. Elle étoit enveloppée dans une longue robe qu’elle retenoit elle-même autour d’elle ; comme un manteau ; ses cheveux épars tomboient en désordre sur ses épaules.
« Alphonse ! dit-elle à son fils, écoutez-moi : obéissez aux ordres de votre mère. Ne me demandez point d’explication ! — Fuyez à l’instant du château. Si vous aimez la vie, si vous craignez le ciel, n’en approchez jamais ! »
Alphonse s’étoit jeté sûr son lit, sans se déshabiller ; il fût bientôt debout.
« Pourquoi cette soudaine alarme ! s’écria-t-il ; craignez-vous que mon oncle ne commette un second forfait, aussi horrible que le premier ? Ne craignez rien pour moi, je remplirai mon serment. »
Anna poussa un cri ; après quoi elle dit :
« Vous m’avez perdue ; vous vous êtes perdu vous-même ! — Votre oncle est innnocent ! — Il ne nous reste à tous les deux qu’un moyen de salut. — Fuyez loin d’ici. — Fuyez-moi. — Fuyez votre oncle. — Prenez cette bourse. — Ne revenez pas au château. — Sellez vous-même le plus rapide coursier de l’écurie, et partez, tandis que la légère obscurité du matin protège encore votre fuite. — Embrassez-moi. — Oh ! non ! non ! non ! — Ce seroit ……»
Un torrent de pleurs l’empêcha un instant de continuer. Enfin elle ajouta :
« Pars ! et puisse le ciel te combler
des bénédictions, qu’il ne m’est plus permis
d’espérer ! »
Elle lui donna la bourse. Sa main étoit tachée de sang ; Alphonse s’en apperçut et frémit. Il n’eut pas la force de prononcer un seul mot. La comtesse lut son trouble dans ses yeux. Elle s’écria encore une fois :
« Oh ! fuyez et sauvez-moi. — Je vous en conjure, fuyez. »
À peine eut-elle prononcé ces derniers mots, qu’elle sortit avec précipitation de la chambre d’Alphonse, et courut s’enfermer dans la sienne.
Étonné, épouvanté de ce qu’il venoit d’entendre et de voir, Alphonse hésita quelque tems sur le parti qu’il prendroit. À la fin, il s’écria :
« Ma malheureuse mère auroit-elle perdu la raison ? — Oh ! non, je ne puis m’y tromper. Ce n’est pas là de la folie. Elle a certainement eu un motif bien pressant, pour m’ordonner de la fuir ; mais alors, pourquoi me le cacher ? — Mon oncle, m’a-t-elle dit, est innocent ! — Je m’y perds. — N’importe, c’est mon devoir d’obéir. »
Il sortit de sa chambre. Au moment où il passa devant celle de sa mère, la porte s’ouvrit, et Anna lui dit :
« Vîte, vîte, mon cher Alphonse ! »
Il s’arrêta, mais la porte fut à l’instant refermée. Il descendit dans la première cour, souleva avec peine les lourdes barres de fer, qui en fermoient les portes, et gagna l’écurie. Il sella lui-même son cheval favori ; et le cœur oppressé, il s’éloigna du château de Cohenburg, après avoir jeté un dernier et douloureux regard sur cette antique demeure de ses pères.
« Si vous aimez la vie, — si vous craignez le ciel, — fuyez-moi, — fuyez ce château. » — Il répétoit sans cesse ces paroles. — Il appuyoit sur les mots en les prononçant. Son esprit se perdoit dans un labyrinthe de conjectures. Entièrement absorbé, il avoit déjà fait environ cinq lieues, sans s’arrêter, et sans se demander à lui-même où il alloit. Ne sachant encore quelle réponse faire à cette question, il apperçut dans l’éloignement sur le sommet d’une coline, un village dont le clocher s’élevoit au-dessus des arbres d’un bois épais qui l’environnoit. Il dirigea ses pas vers cet endroit. Au moment où il y arriva, les paysans alloient à leurs travaux. Ils le regardèrent d’un œil curieux. Alphonse s’apperçut qu’ils ne le connoissoient pas, et qu’il n’étoit pour eux que l’objet d’une curiosité vague. Après avoir fait rafraîchir son cheval, il repartit. Il désiroit quitter promptement cette partie du pays, où il pouvoit être reconnu. Quoiqu’il n’eût aucunes raisons personnelles de se cacher, il sentoit qu’il seroit fort embarrassé s’il rencontroit un ami qui lui demandât où il alloit, ou qui lui fit des questions sur sa famille.
Après s’être éloigné encore de plusieurs lieues, il sentit ses forces morales et physiques également épuisées. Il descendit de cheval, et l’ayant attaché au tronc d’un arbre, dont les branches le mettoient à couvert des rayons du soleil, alors dans son midi, il se coucha lui-même sous son ombre hospitalière.
La réflexion, qui ne peut parvenir à éclaircir l’objet de notre méditation, tout en rendant pénible la durée du tems, l’abrège. — Aussi Alphonse ne quitta-t-il son lit de gazon, que lorsque le soleil fut fort près de son coucher. Il fit encore trois lieues. Il apperçut alors une misérable auberge, dans laquelle il se détermina à passer la nuit. Il but, en y arrivant, un verre de vin, qui lui rendît des forces. C’étoit la première nourriture, excepté un peu d’eau puisée dans un ruisseau avec le creux de sa main, qu’il eut prise de la journée. Il mangea ensuite, mais peu, et sans appétit. Quoiqu’il ne se sentît nullement disposé à goûter les douceurs du sommeil, il se retira de bonne heure dans sa chambre.
CHAPITRE II.
La nuit se passa pour lui, comme le jour s’étoit passé, en lamentations inutiles et en vaines conjectures. Le matin, il s’endormit un instant.
À son réveil, il songea aux moyens de gagner sa vie honorablement. L’armée lui parut être l’asyle qu’il cherchoit.
L’Empire étoit alors en guerre avec la Pologne. Il résolut de se présenter, comme volontaire, dans un des nouveaux régimens qu’on levoit tous les jours. En conséquence, après avoir payé l’hôte de cette pauvre auberge, il monta à cheval, et prit la route de Berlin.
La veille, il avoit suivi une direction opposée à la grande route de cette ville. Il fut obligé de prendre un chemin de traverse pour la rejoindre.
Son voyage ne fut pas long. Le soir du second jour, il fit son entrée dans la ville de Berlin. Il se logea dans une petite auberge. Le lendemain matin, il pria son hôte de lui trouver un acheteur pour son cheval. Déterminé à entrer au service, il n’ignoroit pas que sa paie ne lui donneroit pas les moyens de le nourrir.
Il se promena dans la ville ; il admira la beauté des édifices publics, s’informa du nom de leurs fondateurs et des architectes. Pendant deux jours, il trouva une utile et agréable diversion à ses lugubres pensées ; mais le charme cessa avec la nouveauté. La réflexion ramena les inquiétudes et les chagrins : quelquefois, il formoit la résolution de retourner au château de Cohenburg.
« Mon oncle, se disoit-il, est innocent : ma mère me l’a elle-même déclaré. — Pourquoi donc le craindrai-je ? — Cependant, elle m’a conjuré de ne plus le voir. — Quel peut être le motif de cette étrange conduite ? — Pourquoi me le cacher ? — Seroient-ils tous les deux les meurtriers de mon père ? — Ma mère auroit-elle donné sa main sanglante au comte Frédéric, et ne m’a-t-elle ordonné de quitter le château que pour éloigner un témoin importun, dont elle n’eût pas osé soutenir les regards ? »
Cette idée fut sur le point de troubler sa raison. — « Non, reprit-il, ma mère n’est pas si criminelle. S’il en eût été ainsi, l’aurois-je trouvée aux genoux du comte ? — Cela ne peut avoir été concerté pour me tromper ; car mon arrivée ne pouvoit être prévue. — Quelle est donc la cause de cette mystérieuse conduite, de son apparition, plus extraordinaire encore, le matin du jour où elle m’ordonna de quitter le château ? — Que peuvent signifier les taches sanglantes dont sa main étoit souillée ? — Je m’y perds. — Quelque malheur secret pèse sur son cœur. — Il n’est pas, apparemment, en mon pouvoir d’alléger ce fardeau ; car alors elle eût imploré mon assistance. — Mais du moins je n’aggraverai pas ses maux , en désobéissant à ses ordres. »
Alphonse offrit en ce moment au ciel de ferventes prières, souvent interrompues par ses sanglots, pour le conjurer de rendre à sa mère la paix et le bonheur.
Il étoit depuis trois jours à Berlin, lorsque son hôte lui amena un homme qui lui proposa d’acheter son cheval à un prix assez avantageux. Alphonse hésita avant de conclure le marché. Il n’avoit plus un seul ami sur la terre. Cet abandon lui avoit rendu plus cher son chenal, et il éprouvoit une extrême répugnance à se séparer de cet unique témoin de son bonheur passé.
« S’il m’étoit possible de le garder ! disoit-il en lui-même ; mais le peu d’argent que je possède, sera bientôt dépensé, et alors… — Il est à vous ! s’écria-t-il ; prenez-le ; mais traitez-le doucement. »
Il s’élança dans la maison, et ne voulut plus revoir son cheval. L’objet essentiel étoit alors fort loin de sa pensée. Il ne songea pas à l’argent, jusqu’au moment où l’hôte le tira de sa rêverie, en jetant les florins sur la table.
Cette affaire terminée, sa première démarche fut de s’engager dans l’armée, en qualité de volontaire. Il reçut le prix de son engagement, et endossa l’habit militaire. Il vit avec plaisir que ce nouveau costume le rendoit presque méconnoissable. Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/42 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/43 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/44 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/45 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/46 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/47 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/48 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/49 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/50 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/51 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/52 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/53 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/54 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/55 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/56 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/57 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/58 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/59 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/60 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/61 être son père, ses soupçons se fixèrent sur son oncle. Il chercha ensuite, dans ce qu’il venoit d’entendre, l’explication du meurtre de son père, et de la conduite de sa mère. — Son esprit absorbé dans ces réflexions, recommença à se perdre en vaines conjectures. »
CHAPITRE III.
Avant l’époque où les armées entrent ordinairement en campagne, Arieno reçut l’ordre de l’empereur de rejoindre son régiment. Alphonse et son généreux ami quittèrent à regret la tranquille demeure, où ils avoient joui, pendant un tems trop court, des douces consolations de l’amitié. Arieno remercia Alphonse, et l’invita à renouveller sa visite l’hiver prochain.
Vers le milieu de l’été, dans un combat sur les frontières de l’Empire, Arieno perdit la vie. Le même jour, Alphonse, Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/64 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/65 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/66 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/67 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/68 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/69 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/70 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/71 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/72 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/73 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/74 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/75 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/76 habile. Il le blessa d’un coup d’épée dans le côté.
On le transporta sur-le-champ chez lui. La blessure fut jugée mortelle. Il avoit perdu beaucoup de sang, et il ne retrouva pas l’usage de la parole. Il reconnut Alphonse, et lui donna sa bourse. Celui-ci la reçut, baisa la main de son maître, et se retira, les larmes aux yeux. Le baron tira la manche de son confesseur qui étoit assis auprès de son lit, et lui montra des yeux Alphonse. Le moine comprit parfaitement qu’il recommandoit ce jeune homme à sa protection. Il promit d’en avoir soin. Environ une heure après, le baron expira dans des douleurs affreuses.
Terrible, mais inutile leçon pour les joueurs !
CHAPITRE IV.
jamais l’amour ne fut une mer sans orage. Ici la différence des conditions est une source intarissable de malheurs. Là une disproportion choquante sépare les années, et unit l’automne au printems. Tantôt c’est un choix forcé par l’aveugle complot d’amis imprudens ; ou si la sympathie préside au choix des amans, la guerre, la mort ou la maladie, viennent les assiéger de toutes parts. Le bonheur de l’amour est instantanée comme un son, léger comme une ombre, court comme un songe, rapide comme l’éclair, qui en un clin-d’œil embrasse le ciel et la terre, et avant qu’un homme ait eu le tems de dire : Regardez ! toute la nature est replongée dans les ténèbres. Tout ce qui brille
passe comme l’éclair.
Lorsque le moine eut donné les ordres nécessaires, et fait tous les Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/79 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/80 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/81 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/82 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/83 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/84 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/85 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/86 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/87 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/88 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/89 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/90 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/91 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/92 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/93 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/94 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/95 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/96 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/97 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/98 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/99 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/100 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/101 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/102 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/103 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/104 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/105 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/106 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/107 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/108 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/109 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/110 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/111 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/112 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/113 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/114 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/115 circonstances de son histoire. Les couleurs sous lesquelles ses parens les plus proches lui ont été représentés, ne lui donnent pas le désir d’entrer dans un monde qu’elle ne connoît pas, et dont elle a entendu parler en termes si peu séduisans. Elle se trouve très-heureuse ici, et elle est déterminée à prendre le voile. »
Alphonse soupira. Ses yeux tombèrent sur le sable, qui l’avertit d’aller sonner la cloche du soir.
CHAPITRE V.
Alphonse n’étoit plus occupé que de Lauretta. Tous les jours il se sentoit prévenu davantage en sa faveur. Il commença à soupçonner la nature de ses sentimens pour elle, et à désirer de la tirer de l’obscurité du cloître. Il eût bien voulu pouvoir l’instruire de l’amour qu’elle lui avoit inspirée. Toute communication avec les religieuses et les novices, à l’exception de l’abbesse et de la vieille Perilla, lui étoit interdite. Comment donc lui Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/118 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/119 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/120 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/121 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/122 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/123 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/124 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/125 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/126 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/127 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/128 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/129 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/130 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/131 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/132 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/133 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/134 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/135 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/136 pèlerin, sous lequel sa mère étoit arrivée au couvent. Il la conduisit ensuite dans la grande cour. L’impatient Alphonse les y attendoit.
« Acceptez ce foible témoignage de mon amitié, leur dit le bon vieillard, en leur présentant une petite bourse. Cet or peut vous servir. Il ne peut être pour moi d’aucune utilité. »
Ils baisèrent la main qu’il leur tendit. Il leur donna sa dernière bénédiction. Aidé d’Alphonse, il souleva d’une main tremblante les énormes barres de fer qui défendoient la porte. Lauretta, en la traversant pour la première fois, ne put retenir ses larmes. Alphonse s’écria :
« Adieu, ô le meilleur des hommes, adieu, mon respectable ami. »
Le saint vieillard leva les yeux et les mains vers le ciel, et referma sur eux, pour toujours, les portes du couvent de Sainte-Hélène.
CHAPITRE VI.
Appuyée sur le bras d’Alphonse, Lauretta, après une heure de marche, arriva à Inspruch. Désirant éviter les questions de ceux qui s’appercevroient qu’elle entrait pour la première fois dans le monde, elle cacha prudemment la surprise qu’excitoient dans son âme les scènes nouvelles, auxquelles elle avoit été jusque-là absolument étrangère.
Après un court repos, nos voyageurs se remirent en route. Ils arrivèrent à Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/139 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/140 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/141 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/142 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/143 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/144 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/145 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/146 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/147 aux deux hommes. Ils s’approchèrent de Lauretta. Elle fit un nouvel effort pour se débarasser ; mais cet effort acheva d’épuiser ses forces. Elle tomba dans leurs bras.
CHAPITRE VII.
Lauretta, lorsqu’elle revint à elle-même, se trouva dans une profonde obscurité. Le mouvement lui fit conclure qu’elle étoit dans une voiture. Elle fut quelque tems à se rappeller la situation dans laquelle elle avoit vu la dernière fois la lumière. Alors elle s’écria :
« Oh ! ciel, où suis-je ? »
Personne ne répondit. Elle étendit la main ; elle la posa sur la garde d’une épée, et elle entendit en même tems la voix rauque d’un homme qui, à moitié Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/150 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/151 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/152 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/153 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/154 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/155 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/156 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/157 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/158 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/159 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/160 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/161
Incapable de prendre les rafraîchissemens avec lesquels Bartha revint bientôt, Lauretta se jeta sur le lit. La fatigue lui ferma les yeux ; mais son sommeil ne fut pas paisible. Toutes les scènes de la nuit précédente, se représentèrent à son esprit troublé, sous des couleurs plus effrayantes encore que la réalité.
CHAPITRE VIII.
Toute la journée, la chaleur avoit été étouffante. Vers le soir, le tems devint plus couvert, et les nuages parurent prêts à se fondre en un déluge de pluie. Lauretta observoit leur marche lente avec un triste plaisir. Le sombre vêtement de la nature plaisoit à sa douleur. Elle contempla cette scène imposante, jusqu’à ce que, absorbée par la multitude de ses sensations, elle perdit tout-à-fait le sentiment de sa présente situation. Ses méditations furent interrompues par Bartha, qui lui apporta un vase rempli de lait, quelques fruits et un morceau de pain grossier. Elle la pria de manger, en la prévenant que Kroonser et Ralberg, se proposoient de se remettre en route dans une demi-heure.
Lauretta, par complaisance pour cette bonne femme, plutôt que pour satisfaire son appétit, mangea un fruit, et but un peu de lait, tandis que Bartha employoit toute son éloquence à lui persuader, que puisque Ugo avoit assuré qu’elle n’avoit rien à craindre, elle devoit être tranquille. Mais ce raisonnement, quoiqu’elle ne voulût pas perdre son tems à le réfuter, ne lui parut pas concluant, et ne lui donna pas une bien grande assurance.
La voix de Kroonzer se fit entendre. Il ordonnoit à Lauretta de descendre. La malheureuse savoit trop bien que sa foible résistance eût été inutile. Une prompte complaisance pouvoit au contraire lui concilier ses gardiens. En conséquence elle obéit à l’instant. Ralberg l’attendoit au bas de l’escalier. Il la prit dans ses bras, et la plaçant sur un cheval devant son camarade, il monta lui-même sur un autre, que le paysan tint jusqu’à ce qu’il fut dessus.
Des ténèbres épaisses couvroient l’horizon. Le silence effrayant de la forêt n’étoit troublé que par le bruit sourd des vents précurseurs de l’orage.
Bientôt de pâles éclairs sillonnèrent l’atmosphère. D’épouvantables coups de tonnerre se succédèrent avec rapidité. Après avoir voyagé pendant deux heures, au milieu de cet effrayant combat des élémens et d’une obscurité profonde, l’orage, qui heureusement n’avoit pas été accompagné de pluie, commença à se calmer. La foible lumière de la lune vint éclairer leurs pas.
Lauretta s’apperçut alors qu’ils étoient au fond d’une vallée profonde.
« Oh ! Dieu, s’écria-t-elle, est-ce ici que je dois trouver mon tombeau ? »
Depuis la fin de l’orage, Ralberg et son camarade étoient entrés en conversation ; mais elle n’avoit pu, sur ce qu’ils avoient dit, conjecturer sa future destination.
Une tour qui s’élevoit au dessus des arbres, dont elle étoit environnée, frappa soudain sa vue. Lorsqu’elle fut un peu plus avancée, elle vit que cette tour faisoit partie d’un vaste édifice vers lequel ses conducteurs s’avançoient.
Ses yeux restèrent fixés de ce côté. À mesure qu’elle approcha de la tour, ses alarmes devinrent plus vives. Ses conducteurs ne disoient pas un mot. Elle s’attendit à entendre bientôt prononcer sa sentence.
La lumière de la lune, qui éclairoit le bâtiment, lui fit appercevoir qu’une des ailes étoit entièrement en ruines ; et tout l’édifice en très-mauvais état.
Descendue de cheval, elle ne put se soutenir. Ses genoux trembloient. Elle tomba, presqu’entièrement insensible à ce qui se passoit autour d’elle, dans les bras de Kroonzer.
Ralberg ayant attaché les çhevaux à une colonne à moitié brisée, poussa la porte avec force. Elle s’ouvrit en faisant un bruit sourd. Kroonzer entra alors dans la cour, en portant Lauretta dans ses bras. Il la plaça sur un siège formé par une niche pratiquée dans le mur. Il appella son camarade, lui dit d’allumer promptement un flambeau, et le gronda d’avoir attendu si long-tems à le faire . Ses paroles retentirent dans cet immense édifice. Ces sons lugubres ajoutèrent encore au trouble de Lauretta.
Ralberg ne répondit rien. Il se mit sur-le-champ à battre son briquet. Lauretta attendoit avec impatience la lumière qui devoit la tirer de l’horrible obscurité qui la faisoit trembler. Elle fixa les yeux sur l’endroit où le bruit de l’acier et de la pierre lui indiquèrent la présence de Ralberg. Soudain ils furent frappés de la réverbération d’une lumière qui paroit du côté opposé de la cour. Lauretta se retourna, et apperçut un homme qui portoit une lampe. Il avoit le dos tourné du côté de Lauretta. Il entra dans une porte qu’il referma après lui.
L’état délabré de cet édifice, n’avoit pas permis de douter à Lauretta, qu’il ne fût inhabité. En conséquence elle conclut que l’homme qu’elle venoit de voir étoit Kroonzer, quoiqu’elle ne pût s’imaginer comment il s’étoit procuré de la lumière. Elle se retourna alors du côté de Ralberg. Quelle fut sa surprise en voyant ses deux compagnons de voyage venir à elle avec leur lampe allumée ! Elle poussa un cri involontaire. Elle vit en même tems la même porte se rouvrir. Elle apperçut le bras et la figure d’un homme, dont il lui fut impossible de distinguer les traits. Théodore se présenta tout de suite à son imagination effrayée. Ce souvenir glaça tous ses sens. Elle tomba par terre sans connoissance.
Revenue à elle, elle se trouva couchée sur un lit sans rideaux. La foible lumière d’une lampe, lui montra Ralberg assis auprès de son lit. Elle jeta tout de suite des regards inquiets autour de la chambre, dont l’immense grandeur, mal éclairée par la lampe, ne lui permit pas de s’assurer si celui qu’elle redoutoit par dessus tout s’y trouvoit en ce moment. Se levant alors avec peine sur son lit, elle saisit la main de Ralberg, et le conjura de la sauver, de la protéger contre Théodore. Ralberg, avec l’accent le plus doux que sa voix rauque lui permit de prendre, l’engagea à se tranquilliser et à bannir toute crainte. Elle fixa de nouveau sur lui ses yeux mouillés de pleurs, et lui serrant la main encore plus étroitement, elle s’écria :
« Ayez pitié de mes malheurs ; le ciel vous en récompensera. »
Le bruit des pas d’un homme, tourna son attention d’un autre côté, Kroonzer entra. Il apportoit du vin, des fruits et du pain. Après avoir ramassé la lampe par terre, il la plaça sur une table auprès du lit. Il invita alors Lauretta à se lever et à prendre quelque nourriture. Elle ne répondit que par ses pleurs. Il répéta sort invitation. Elle s’efforça de parler ; mais les sanglots l’empêchèrent d’articuler un seul mot. Elle se précipita de son lit, se jeta à ses pieds, et embrassa ses genoux. Il la repoussa, et ordonna à Ralberg de le suivre. Ils quittèrent ensemble la chambre de Lauretta qui les entendit refermer la porte, et mettre les verroux.
Lorsque la violente agitation de ses esprits fut un peu calmée, elle prit la lampe, et fit le tour de sa chambre, afin de s’assurer que personne n’y était caché. Cette chambre étoit d’une forme ronde, le plafond élevé et voûté ; les murs étoient de pierre, la fenêtre petite, et élevée de terre de plusieurs pieds. Tout la porta à conjecturer qu’elle étoit dans la tour qui avoit attiré son attention pendant qu’elle voyageoit dans la forêt.
Elle reposa la lampe sur la table, et tirant de son sein un petit crucifix d’ivoire, qu’elle plaça sur la même table, elle se mit à genoux. Après avoir exprimé sa reconnoissance pour toutes les douleurs de celui en mémoire de qui elle portoit le gage sacré du salut des hommes, elle le conjura de lui inspirer son courage, afin qu’elle ne succombât pas sous les maux dont elle étoit menacée, de lui accorder sa divine protection, contre les coupables desseins de celui qu’elle craignoit plus que la mort. Elle termina sa prière par la solemnelle déclaration de sa confiance dans les bontés de de Dieu, et de sa résignation sans bornes à ses volontés.
Elle se releva, et en déplaçant le crucifix sur son sein, elle sentit ce calme heureux, effet inévitable de la confiance dans la divine miséricorde. Toutefois elle ne crut pas devoir chercher le repos dans le sommeil. Elle s’assit sur la chaise la plus voisine de son lit. Elle prêta une oreille attentive. Mais n’entendant plus le moindre bruit, ses terreurs diminuèrent un peu, et elle se livra à ses réflexions sur les événemens extraordinaires de cette nuit.
Bientôt la figure de l’homme qu’elle n’avoit fait qu’entrevoir, se représenta à son imagination, et de plus en plus persuadée que c’étoit Théodore, ses craintes redevinrent plus fortes qu’elles ne l’avoient jamais été. — Elle se leva, se promena doucement dans sa chambre, s’arrêtant par intervalles, et fixant les yeux sur le plancher, accablée du passé, effrayée de l’avenir.
Le corps fatigué, l’âme abattue, elle se remit sur sa chaise. Bientôt ses yeux s’obscurcirent, des gouttes de sueurs tombèrent de son front. Elle étendit une main tremblante, et saisit le flacon de vin. Elle le porta avec peine jusqu’à ses lèvres. Enfin elle parvint à en avaler quelques gouttes. Elle cessa de trembler, le sang recommença à circuler dans ses veines, elle sentit la vie se ranimer. Une douce chaleur succéda eu froid mortel qui glaçoit son cœur. Un assoupissement, dont elle s’efforça en vain de triompher, s’empara d’elle par dégré. Bientôt elle tomba dans un profond sommeil.
CHAPITRE IX.
Lauretta, en se réveillant, se leva de sa chaise, et jeta autour d’elle des regards inquiets, ignorant absolument où elle étoit, et ne se souvenant plus du tout des événemens de la nuit précédente. Mais bientôt sa mémoire revint, et avec elle tous ses chagrins. Elle leva les yeux vers l’étroite et haute fenêtre de sa chambre. Les rayons du soleil brilloient de tout leur éclat et pénétroient dans sa prison. Elle conjectura qu’il pouvoit être à-peu-près midi, et s’étonna d’avoir dormi si long-tems et si profondément. Elle s’avança vers la porte qu’elle trouva fermée, et en se rappellant la disposition des différens meubles de sa prison, elle ne vit pas la moindre raison de soupçonner que personne y fût entré pendant son sommeil. Elle examina sa lampe, tout étoit consumé ; et le flacon de vin qu’elle avoit mis par terre étoit au même endroit où elle l’avoit placé.
Dans la soirée, le bruit des verroux annonça Kroonzer. Il entra avec de nouvelles provisions. Il plaça sur la table un nouveau flacon de vin et un autre d’eau, et après avoir mis une autre mèche à la lampe, l’avoir remplie d’huile, il sortit sans dire un mot.
Bientôt la nature eut revêtu le noir manteau de la nuit. La belle prisonnière, craignant de s’abandonner de nouveau à l’insensibilité du sommeil, commença à se promener lentement dans sa chambre. Foible et languissante, elle ne tarda pas à s’arrêter ; elle appuya un de ses bras contre le mur ; sa tête tomba insensiblement sur sa main, et elle resta ainsi absorbée dans ses cruelles réflexions. Tout-à-coup le bruit des pas de plusieurs chevaux frappa son oreille. Elle s’élança du côté de la fenêtre, elle écouta. — Elle entendit alors les sons confus de plusieurs voix. Transportée d’espoir et respirant à peine, elle s’écria :
« Le généreux baron, a prêté son appui à mon Alphonse. Ils viennent me délivrer. »
L’inquiétude revint avec le silence. Elle s’avança vers la porte, et tremblante d’espoir et de crainte, elle crut encore entendre le bruit des pas. Mais la réflexion lui donna bientôt la triste conviction, que ses sens l’avoient trompée.
Cependant elle se flatta encore de la possibilité que ses amis la cherchassent dans quelque partie du bâtiment éloignée de sa prison, et qu’enfin ils la découvriroient.
Un bruit confus de voix et de pas, qui paroissoit s’approcher de sa chambre, fit succéder la crainte à l’espérance. Jusqu’à cet instant, l’espoir d’être délivrée et rendue à son cher Alphonse, avoit seul occupé son imagination. L’odieux Théodore se présenta alors à son esprit, et chaque pas sembloit accroître l’horrible probabilité, que le moment étoit venu, où elle devoit tomber victime de son infâme passion, ou rendre le dernier soupir dans ses bras homicides.
Le bruit augmenta.
« Par ici, par ici, s’écria une voix inconnue, suivez-moi, voilà le chemin. »
Lauretta respiroit à peine. Un coup frappé à sa porte la fit frissonner. La même voix cria :
« La clef n’y est pas ; demandez-la à Kroonzer. »
Lauretta ne faisoit pas le moindre mouvement. Plusieurs voix parlèrent alors en même tems, mais si confusément, qu’elle ne put distinguer un seul mot. Soudain tout s’éloigna, et les sons expirans par degrés, le silence reprit dans ces lieux, son effrayant empire.
Craignant leur retour, Lauretta continua de rester auprès de la porte. Elle ne savoit comment expliquer ce qu’elle avoit entendu. Plus elle y réfléchissoit, plus elle se perdoit dans ses conjectures.
Quelque tems s’étant écoulé, sans qu’elle entendît le moindre bruit, ses alarmes commencèrent à se dissiper ; mais l’espoir d’une prompte délivrance s’évanouit en même tems que ses craintes. Elle fondit en pleurs, tomba sur son lit et s’abandonna au plus violent désespoir.
Le sommeil vint enfin, malgré elle, suspendre ses pleurs et ranimer ses forces épuisées. Le soleil étoit depuis long-tems sur l’horizon lorsqu’elle se réveilla. Elle resta presque toute la journée sur son lit, absorbée dans sa douleur et dans ses vaines conjectures sur le sort qui l’attendoit. Le soir Kroonzer reparut, apportant encore de nouvelles provisions. Il parut très-surpris de ce qu’elle n’avoit pas touché à celles qu’il avoit apporté la veille. Il l’engagea à prendre enfin quelque nourriture. Sans faire attention à ce qu’il disoit, elle le conjura de lui expliquer ce qu’elle avoit entendu le jour précédent. Il ne répondit pas ; mais après avoir préparé la lampe, il l’alluma et sortit de la chambre, en lui répétant l’invitation de manger au moins quelque fruit et un peu de pain.
Pour obéir non à Kroonzer, mais à la voix impérieuse de la nature, Lauretta mangea un peu et but un grand verre d’eau. Elle résolut de ne plus même goûter au vin, persuadée, par l’effet qu’il avoit produit sur elle la première nuit de son emprisonnement, qu’il étoit somnifère ; et quoiqu’elle eut bien désiré pouvoir oublier ses chagrins, elle n’osa pas s’exposer à retomber dans un état d’insensibilité.
Ainsi se passèrent six jours, pendant lesquels personne n’entra dans sa prison que Kroonzer. À l’heure accoutumée, il ne manquoit pas d’arriver. Mais elle ne put jamais en obtenir un seul mot de réponse aux questions qu’elle lui adressa.
Elle n’entendit plus le bruit qui lui avoit d’abord causé tant de plaisir et ensuite tant d’effroi, le second jour de sa captivité. Elle en conclut qu’elle étoit prisonnière pour la vie. Le désespoir commença à céder la place à une tranquille mélancolie.
Vers le milieu de la septième nuit, elle fut tirée du profond sommeil dans lequel elle étoit ensévelie depuis plusieurs heures, par un violent coup de tonnère, qui ébranla la tour. Elle sauta en bas de son lit et se tint un instant debout, se rappellant à peine où elle étoit, ne sachant point ce qu’elle avoit entendu. Un éclair frappa le côté de la tour, contre lequel elle étoit appuyée, la muraille s’écroula à l’instant, et entraîna dans sa chute la tremblante Lauretta.
CHAPITRE X.
Étourdie de sa chute, Lauretta resta quelque tems au milieu des ruines, insensible à sa situation. Enfin la raison revint. La tempête étoit calmée ; mais la pluie tomboit toujours par torrens. Lauretta avoit la tête et le côté droit meurtris, et le bras gauche foulé. Étant heureusement tombée sur la terre humide, elle n’avoit pas eu d’autres blessures. Elle leva la tête et regarda autour d’elle ; mais la foible lumière du crépuscule, obscurcie encore par la pluie, ne lui permit d’appercevoir que la tour sur les ruines de laquelle elle étoit assise.
Déterminée, cependant, à profiter, s’il étoit possible, d’une occasion que la Providence sembloit lui avoir ménagée à dessein, elle se leva avec peine et malgré sa foiblesse extrême, elle résolut de sortir promptement du château, dans l’espoir de gagner quelque couvent avant d’être poursuivie, ou du moins atteinte par ses geôliers, qui probablement n’auroient pas entendu la chute de la tour.
Elle avoit déjà fait une lieue sans s’arrêter, lorsque les premiers rayons du soleil levant, éclairèrent sa route, et lui firent appercevoir un bois épais dans lequel elle étoit prête à entrer. Le chemin qu’elle avoit suivi, étoit raboteux et rempli de bruyères. Toute en sueur et respirant à peine, elle s’appuya sur le tronc du premier arbre. Son bras et son côté étoient extrêmement douloureux. L’eau couloit de ses vêtemens collés, pour ainsi dire sur elle, par une pluie continue. Au bout de quelques instans, d’inaction lui causa un frisson plus insupportable que la fatigue de la marche. Elle voulut se remettre en route. Mais la nature épuisée lui permit à peine de faire encore quelques pas. Elle tomba sur la terre, n’ayant plus devant les yeux que la triste alternative, ou d’expirer dans une lente et cruelle agonie, ou de retomber entre les mains de Kroonzer.
Elle étoit depuis long-tems dans cette désespérante situation, lorsqu’elle entendit une voix prononcer quelques mots dont elle ne comprit pas le sens. Elle leva ses yeux appesantis, et vit debout devant elle un hermite d’une figure vénérable. Un flacon pendoit au bras du saint homme ; dans sa main droite étoit un bâton, appui nécessaire de sa vieillesse.
« Dieu soit loué s’écria-t-il, au moment où Lauretta ouvrit les yeux, heureusement je m’étois trompé. Je vous ai crue morte. »
Lauretta tendit sa foible main. L’hermite l’ayant prise dans la sienne, se mit à genoux.
« Mes forces sont épuisées, dit Lauretta. »
Après une courte pause, elle ajouta :
« Le ciel, dans sa bonté, vous a envoyé. pour fermer mes yeux mourans. »
« Espérez plutôt, répondit l’hermite, qu’il m’a envoyé pour vous arracher à la mort. Vous me paroissez accablée de fatigue. Je vais vous conduire à ma cellule. Elle n’est qu’à quelques pas d’ici ; et fiez-vous à la Providence et à mes efforts, vos forces seront bientôt rétablies »
« Hélas ! mon père, je crains bien de ne pouvoir gagner votre cellule. Je suis trop foible pour marcher. » Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/186 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/187 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/188 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/189 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/190 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/191 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/192 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/193 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/194 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/195 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/196 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/197 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/198 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/199 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/200 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/201 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/202 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/203 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/204 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/205 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/206 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/207 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/208 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/209 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/210 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/211 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/212 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/213 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/214 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/215 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/216 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/217 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/218 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/219 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/220 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/221 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/222 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/223 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/224 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/225 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/226 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/227 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/228 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/229 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/230 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/231 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/232 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/233 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/234 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/235 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/236 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/237 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/238 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/239 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/240 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/241 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/242 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/243 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/244 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/245 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/246 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/247 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/248 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/249 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/250 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/251 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/252 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/253 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/254 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/255 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/256 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/257 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/258 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/259 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/260 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/261 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/262 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/263 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/264 Page:Lathom - La Cloche de minuit v1.djvu/265 s’en apperçut, il courut sur les pas d’Alphonse ; mais il étoit trop tard. Il avoit eu le tems de prendre un cheval dans l’écurie, et il étoit parti sans avoir été vu par personne.
CHAPITRE XIII.
Pendant les deux premiers jours qui suivirent la mort de l’hermite, la solitude de lauretta ne fut point troublée. L’espoir d’être bientôt rendue à son Alphonse, pouvoit seul lui faire supporter la vue du triste spectacle qu’elle étoit forcée de contempler.
Le soir du jour qui devoit précéder celui où elle attendoit le retour du paysan, elle venoit de se jeter sur son lit, lorsqu’elle crut entendre le murmure de plusieurs voix. Tremblante et respirant à peine, elle écouta dans cet état d’angoisse silencieuse, pendant lequel on craint de remuer, de peur de perdre le son que l’on désire d’entendre. Bientôt elle distingua le bruit des pas dans la partie extérieure de la cellule. Au même moment elle entendit ces mots : « Donnez-moi la lumière. » La lumière avança, et le premier objet qui frappa les yeux de Lauretta, fut la figure de Théodore.
Lauretta poussa un cri. Sur-le-champ l’homme qui tenoit la lanterne l’ayant remise à Théodore, s’avança, prit le bras de Lauretta, et l’entraîna hors de la cellule. Théodore cacha la lumière sous son manteau, et les suivit de près.
Le moment si redouté par Lauretta étoit maintenant arrivé. Un froid mortel glaça son cœur, et l’empêcha d’articuler un seul mot. Son guide continua à marcher très-vîte et à l’entraîner avec lui. Il gardoit ainsi que Théodore, le plus profond silence. Quand la faculté de parler revint à Lauretta, elle ne leur adressa pas une seule fois la parole. Elle savoit trop bien que Théodore seroit sourd à ses prières, et elle pensa aussi que l’agent de Théodore, soit qu’il connût ses desseins, ou bien qu’il se fût aveuglément vendu à ses volontés, seroit insensible à la voix du malheur.
La foible lumière des étoiles éclairoit leur marche. Bientôt Lauretta reconnut la forêt qu’elle avoit en partie traversée le matin du jour où elle s’étoit si miraculeusement échappée de sa prison. Lorsqu’ils eurent encore marché pendant quelque tems, elle commença à distinguer le fatal château, situé sur une éminence, qu’ils étoient sur le point d’atteindre.
En ce moment un bruit pareil à celui qui avoit tant occupé Lauretta, la seconde nuit de son emprisonnement, se fit entendre dans l’éloignement. Elle tressaillit, en se rappellant les trompeuses espérances que ces sons lui avoient fait concevoir. Son guide, auquel ce soudain mouvement fit conjecturer qu’elle vouloit se dégager, serra plus étroitement son bras, et tournant en même tems la tête vers Théodore, il dit : « Ils sont là. » — « Eh bien, arrêtons-nous quelque minutes, » reprit Théodore. — « Oh, non, répondit son compagnon, ils seront rentrés long-tems avant que nous arrivions à la caverne. D’ailleurs, quand ils ne le seroient point, ils ne nous verroient pas. » — « Bien, répondit Théodore, marchons. »
« La caverne ! dit en elle-même Lauretta ; et soudain son imagination lui représenta cette caverne comme la tombe qui lui étoit destinée. L’affreuse idée de ne jamais revoir son Alphonse, changea tellement toutes ses résolutions, qu’elle étoit sur le point de se jeter à genoux, et de s’efforcer d’émouvoir la pitié de son guide, lorsqu’une voix, à peu de distance d’elle, s’écria : « Lauretta Byroff ! »
« Oh Dieu ! qu’est-ce que j’entends, dit Lauretta ? »
Ils étoient encore dans la forêt. Théodore dit à l’homme qui conduisoit Lauretta de s’arrêter. Celui-ci obéit. Ils regardèrent de tous côtés, autour d’eux. Ils n’apperçurent personne. Tout étoit tranquille.
« Voilà qui est bien extraordinaire, dit Théodore. Ces paroles vous étoient adressées, ajouta-t-il, en se tournant vers Lauretta. Que signifient-elles ? Je veux le savoir. »
« Je l’ignore, répondit Lauretta. »
« N’est-ce pas là votre nom, reprit Théodore avec vivacité ? »
« Vous savez que mon nom est Lauretta. »
Répondez directement. Je vous demande si Byroff est votre nom de famille. »
« Non. »
« Quel est-il donc ? Ne cherchez point à me tromper. »
« C’est Byroff. »
Un moment de réflexion l’avoit fait ressouvenir de ne pas prononcer un nom, que son mari cachoit avec tant de soin, et elle étoit trop ennemie du mensonge, pour en substituer un faux.
« Vous vous accusez vous-même d’un premier mensonge. Comment puis-je être assuré que vous n’en proférez pas un second ? En conséquence donnez-moi l’explication de cette voix mystérieuse, où vous touchez à votre dernier moment. »
« Cela n’est pas en mon pouvoir. J’en atteste le ciel. »
« C’est donc à moi à en trouver l’explication, s’écria Théodore en tirant du foureau son épée, sur laquelle il avoit porté la main, à l’instant où il avoit commencé à questionner Lauretta ; il ordonna à son compagnon de ne pas la quitter, et s’enfonça dans la forêt, du côté d’où la voix étoit partie.
Lauretta et son guide étonnés, le suivirent des yeux pendant quelques instans. Un coup violent, qui parut porté par une main invisible, étendit le dernier par terre. Il entraîna Lauretta dans sa chute. Aussi-tôt un homme enveloppé dans un manteau, la releva, lui dit à l’oreille : « Silence ! » prit son bras et l’entraîna rapidement avec lui. Ils continuèrent à marcher vers le château en ruines. Cela surprit extrêmement Lauretta ; car, ne pouvant douter que l’inconnu ne s’intéressât à son sort, elle avoit d’abord pensé qu’il chercheroit à l’éloigner le plutôt possible d’un lieu qui recéloit les complices de Théodore. Cependant, comme elle étoit au pouvoir de cet étranger, et comme elle n’ignoroit pas que s’il étoit ennemi, ses questions ne serviroient à rien, et qu’au contraire, s’il étoit ami, elles seroient une désobéissance à un ordre, dont peut-être son salut dépendoit, elle triompha de sa curiosité. Le peu de mémoire que sa mystérieuse situation lui avoit laissé, lui rappella que la voix de son nouveau guide ne lui étoit pas inconnue ; mais elle ne put jamais se rappeller où elle l’avoit entendue.
Arrivé à la distance d’environ une centaine de pas du château, son guide détourna à gauche et entra dans une étroite vallée. Lorsqu’ils eurent encore fait quelques pas, il s’arrêta : il laissa aller le bras de Lauretta, se baissa, et s’étant frayé un passage à travers une touffe de ronces et d’épines, qui bordoient un des côtés de la vallée, il tira d’une de ses poches une lanterne, dont la lumière montra à Lauretta la bouche d’une caverne, assez large pour qu’on pût y entrer en marchant sur ses mains et sur ses genoux.
Son guide se mit à genoux et dit à Lauretta d’une voix basse, de le suivre. — Elle hésita d’abord. — C’étoit certainement là, la caverne dont Théodore et le coquin qui l’avoient tirée de la cellule de l’hermite, avoient parlé. — Elle tressaillit. — « Je vous conjure de me suivre, lui dit son guide. » — Son accent étoit doux et persuasif. Lauretta fit un signe de croix et le suivit.
Après qu'ils eurent fait quelques pas,
ils arrivèrent dans une chambre voûtée.
La foible lumière de la lanterne portée
par son guide, permettoit à peine à Lauretta
de distinguer les objets. Ils traversèrent
cette voûte et entrèrent dans un
long et étroit passage, taillé dans le roc.
Leurs pas retentissoient dans ce sombre
souterrain, et Lauretta ne pouvoit pas
s’empêcher de retourner souvent la tête,
pour s’assurer que personne ne la suivoit.
Parvenu à l’extrémité du passage, ils entrèrent dans une autre chambre voûtée, plus vaste encore que la première. — Le guide de Lauretta ouvrit une porte de côté, qui donnoit sur un escalier en pierre. Il commença à en descendre les marches. — Lauretta s’arrêta. — « Vîte, vîte, je vous en conjure, lui dit-il en la prenant par la main. » — « Le souvenir de cette voix la frappa de nouveau. Elle se laissa conduire dans un passage entièrement semblable à celui qu’ils venoient de parcourir. À droite étoit une petite porte. Le guide l’ouvrit, Lauretta apperçut alors une petite chambre, dans laquelle il y avoit une table, un lit et une lampe. Ils y entrèrent. Aussi-tôt le guide se dépouilla d’un long manteau et d’une espèce de capuchon dont il étoit enveloppé. Lauretta reconnut Ralberg.
Elle resta immobile d’étonnement.
Elle ne savoit ce qu’elle avoit à espérer
ou à craindre.
« Ne vous allarmez pas, lui dit-il, en voyant devant vous celui que vous avez cru votre ennemi. Jamais il ne le fut volontairement, et soyez assuré que maintenant il vous protégera au péril de sa vie. Mais pour votre salut et le mien, il est indispensable que je vous quitte à l’instant. — Ne craignez rien, personne ne troublera ici votre solitude, et comptez que vous me reverrez bientôt. »
Après avoir allumé la lampe, il se disposa à partir.
« Oh ! ne me quittez pas, s’écria Lauretta, en s’attachant à son habit. »
« Au nom du ciel, ne me retenez pas. Il y va de votre vie. — Si par hasard vous entendiez des pas, éteignez la lampe. — Que les anges veillent sur vous ! »
À peine eut-il prononcé ces derniers mots, qu’il se hâta de fermer la porte. Lauretta l’entendit s’éloigner.
Pendant quelques minutes, elle resta à la place où Ralberg l’avoit laissée. — Lorsqu’elle s’étoit vue une seconde fois en son pouvoir, elle n’avoit d’abord éprouvé que le sentiment de la crainte ; ses paroles avoient ensuite ranimé ses espérances ; mais sa conduite mystérieuse l’empêchoit de s’abandonner à la joie à laquelle, sans cela, elle se seroit livrée.
« Pourquoi cet homme, se disoit-elle à elle-même, qui, il y a si peu de tems, a été l’un des artisans de mon malheur, a-t-il tout-à-coup changé de principes ? Je me rappelle encore le son effrayant de sa voix, et son air terrible, la première fois que je le vis. Cependant je me rappelle aussi que sa voix rauque et ses manières me parurent peu naturelles. Ô trompeuse espérance ! pourtant tout semble aujourd’hui confirmer mes conjectures. Sa voix est douce. Sa physionomie n’est plus la même. Les nuages qui obscurcissoient son front, sont dissipés. Ses yeux expriment la pitié et une tendre inquiétude. Le sourire de la satisfaction siège sur ses lèvres. — Et mon nom ! par quels moyens peut-il l’avoir appris ? Comment expliquer tant de mystères ? »
Ses yeux avoient été, pendant ce monologue, fixés sur la terre. Elle les leva alors. Le premier objet qui frappa sa vue fut la lampe, et presqu’aussi-tôt elle apperçut auprès de cette lampe, sur la même table, un poignard !
Son sang se glaça. — « Je me ressouviens parfaitement que ce poignard n’étoit pas sur la table, lorsque je suis entrée dans cette chambre. Ainsi nul doute qu’il n’y ait été placé par Ralberg. — Il m’a déclaré qu’il défendroit ma vie au péril de la sienne. — Il sait donc qu’on doit attenter à ma vie. — Alors pourquoi me laisser dans un lieu, où je suis menacée d’un si grand danger ? — Et si réellement il veut me protéger, pourquoi me laisser sous les yeux cet instrument de mort ? — Je le vois trop, je dois m’attendre à voir bientôt paroître l’infâme Théodore. Bientôt il ne me restera que l’alternative du suicide ou du déshonneur. — Mais si Ralberg est l’agent du chevalier, comment expliquer ce qui s’est passé dans la forêt ? — Peut-être Théodore a-t-il eu des doutes sur la fidélité de l’homme qu’il avoit amené avec lui à la cellule de l’hermite, et a-t-il pris ce moyen de s’en-débarrasser, pour se soustraire aux soupçons. — Oui, cette dernière conjecture est la seule probable. Seule elle explique la conduite d’un homme qui se prétend mon ami, et qui m’enferme dans l’endroit où mon ennemi mortel devoit lui-même me conduire. »
Pendant plusieurs heures, le moindre bruit ne troubla pas le calme profond qui régnoit autour de Lauretta. L’infortunée attendoit, dans des angoisses mortelles, l’affreux moment qui devoit mettre le comble à ses malheurs. — À la fin, elle entendit les pas précipités de quelqu’un qui s’avançoit vers sa chambre. — Elle se rappella sur-le-champ, que Ralberg lui avoit recommendé d’éteindre, sa lampe. Mais elle n’en eut pas le courage. — Elle s’imagina que son meurtrier, craignant de ne pouvoir supporter la vue de sa victime se débattant contre la mort, vouloit consommer son forfait dans les ténèbres.
La clef fut alors mise dans la serrure. Lauretta se jeta en bas du lit sur lequel elle s’étoit assise. La porte s’ouvrit, et Ralberg entra. — Après avoir déposé sur la table un petit panier qu’il avoit apporté, il ferma la porte, et prenant la main de Lauretta, il lui parla ainsi :
« Vous ai-je bien entendue cette nuit dans le bois ? N’avez-vous pas avoué que vous étiez Lauretta Byroff, après que je vous ai en appellée par ce nom ? »
« Je l’ai avoué. »
Ralberg alors tira de sa poche le crucifix d’ivoire que Lauretta portoit ordinairement à son col, attaché au colier de perles, donné à sa mère par son grand père, le jour de son mariage avec le comte Byroff.
« Ceci est donc à vous, dit Ralberg, en le lui présentant. »
« Oui, c’est à moi, répondit Lauretta, avec empressement. Je me souviens que je le laissai dans la tour du château, et depuis j’en ai souvent pleuré la perte. »
« Il vous est donc bien cher ! »
« Autant que doit l’être le dernier présent d’une mère mourante. »
Lauretta ne put prononcer ces derniers mots, sans verser des larmes. Ralberg soupira, et mit un instant ses mains devant ses yeux.
« Où votre mère est-elle morte ? »
« Au couvent de Sainte-Hélène. »
Ralberg reprit la main de Lauretta,
et avec un accent déchirant, il s’écria :
« Quel est votre père ? »
« Le comte Byroff. »
Des pleurs s’échappèrent des yeux de Ralberg.
« Ne me trompez pas sur ce point, s’écria-t-il de nouveau, je vous en conjure. — Je vous l’ordonne. »
Il y avoit quelque chose dans son ton et dans ses manières qui en imposait à Lauretta. Elle répondit :
« Je ne vous trompe pas. Ma mère l’a ainsi déclaré sur son lit de mort. »
« Ma fille ! ma fille ! — Et en embrassant Lauretta, Ralberg ajouta :
« Tu vois ton malheureux père. Je suis celui qui fut le comte Byroff. »
Ces dernières paroles retentirent sur le cœur de Lauretta. Elle trouvoit un protecteur, un ami, et dans cet ami un père. Elle reçut ses embrassemens avec amour et respect. Son père la tint quelque tems pressée contre son sein.
« Cette croix, dit-il enfin, en la lui rendant, fut le premier présent que je fis à votre mère. Oh ! dites-moi ! dites-moi tout ce qui lui est arrivé. — Mais non. — Je ne dois pas m’exposer à entendre ce triste récit en ce moment. Il me retiendroit ici trop long-tems. Il faut que je vous quitte à l’instant, ou peut-être je ne vous reverrois jamais. »
« Hélas ! n’ai-je retrouvé un père, que pour être une seconde fois séparée de lui ? »
« Oh ! ma fille, je rougis de vous avouer l’état dans lequel vous retrouvez votre père. Le malheur m’a réduit au désespoir, et, le désespoir à…… Écoutons ! Serions-nous découverts ?…… Non…… Tout est tranquille. »
« À quoi ? demanda Lauretta. »
« À m’associer à une bande de scélérats, dont les crimes outragent tous les jours l’humanité. — Écoutons ! n’entendez-vous pas le pas des chevaux ? — Il faut que je fuie à l’instant, ou je vous perds pour toujours. — Adieu. Il se passera quelque tems avant qu’il me soit possible de vous revoir. »
Il sortit promptement, ferma la porte sur Lauretta, comme la première fois, et le bruit de ses pas expirant par dégrès, tout rentra dans le silence.
Lauretta eut de la peine à s’assurer si ce qui venoit de se passer n’étoit pas un songe. Lorsqu’elle en fut enfin bien convaincue, elle versa des larmes de joie.
La réflexion revint. Elle commença à méditer sur les dernières paroles de son père. Elle chercha à s’expliquer à elle-même le mystère de sa présente situation. Ses efforts furent inutiles. La déclaration de son père qu’il se passeroit quelque tems avant qu’il lui fût possible de la revoir, ne l’étonnoit pas moins qu’elle ne l’affligeoit.
« Je suis en sûreté, s’écria-t-elle ; mais mon Alphonse l’ignore, et quel tourment n’éprouvera-t-il point, lorsqu’il ne me trouvera pas dans la cellule de l’hermite ? Le cadavre de mon bienfaiteur lui fera croire qu’on a usé de violence envers nous deux. Oh ! pourquoi n’ai-je pas conjuré mon père de chercher quelques moyens de faire cesser les mortelles inquiétudes de mon Alphonse ? Peut-être quand il reviendra, ne sera-t-il plus tems. »
Tourmentée par une foule d’idées contraires, elle ne put fermer l’œil de la nuit. Le lendemain matin elle examina le panier que le comte Byroff avoit déposé la veille sur la table. Il contenoit des provisions pour deux ou trois jours, une bouteille de vin, une d’eau, et de l’huile dans un flacon pour sa lampe.
La journée se passa. Personne ne troubla la solitude de sa prison. La nuit revint. Elle ne dormit pas davantage que la précédente. Elle avoit sans cesse devant les yeux l’image de son Alphonse, au moment où il arriveroit à la cellule. Elle se leva et s’efforça de calmer, par la prière, l’agitation de son esprit ; mais le crucifix devant lequel elle se mit à genoux, ne servit qu’à lui rappeller tous les effrayans mystères dont sa destinée étoit enveloppée.
Le jour suivant s’écoula, sans que le comte Byroff eût visité sa fille. Les craintes de Lauretta changèrent alors d’objet. Elle commença à redouter qu’on ne se fût apperçu de la dernière visite que son père lui avoit faite, comme il avoit paru tant l’appréhender. La seule considération qui lui laissoit encore quelque espoir, étoit que la première démarche de ceux qui auroient fait cette découverte, eût probablement été de rechercher la cause de cette visite.
L’insomnie, l’incertitude et la crainte avoient épuisé ses forces. Plusieurs heures avant minuit, elle tomba dans un profond sommeil qui, malheureusement pour elle, ne fut pas long. Quel fut son chagrin, en se réveillant, de voir que sa lampe étoit éteinte ! Elle avoit négligé d’y mettre de l’huile. L’obscurité profonde dans laquelle elle se trouva, augmenta ses terreurs.
Craignant, sans trop savoir pourquoi, de changer de position, au milieu des ténèbres, elle resta sur son lit. Il étoit alors près de minuit. Tout-à-coup elle entendit marcher à pas mesurés vers la porte de sa chambre. L’espérance et la joie rentrèrent dans son âme. Elle se leva sur son lit, et bientôt le comte Byroff s’offrit à sa vue, revêtu d’un froc.
Lauretta descendit de son lit, et alla au devant de son père. Celui-ci l’embrassa, et, sans faire attention à l’obscurité dans laquelle il la trouvoit, que d’ailleurs il pouvoit prendre pour l’effet des instructions qu’il lui avoit données, il l’aida sur-le-champ à s’envelopper du manteau qu’il avoit laissé la nuit précédente dans cette chambre, et il lui dit de le suivre le plus promptement possible.
Le comte étoit déjà à la porte de la chambre, lorsque, retournant en arrière, il prit le poignard sur la table, l’attacha à sa ceinture, ordonna une seconde fois à Lauretta de le suivre de près et sans bruit, et marcha devant elle.
Lauretta suivit en silence les pas de son père. Elle vit, à la lumière de la lampe, portée devant elle par le comte, qu’il la reconduisoit par le même chemin qu’elle avoit suivie avant d’arriver au triste séjour où elle avoit passé des heures si cruelles. Elle remarqua que la main de son père trembloit, et que sa physionomie exprimoit l’inquiétude et la crainte.
Sorti du souterrain, le comte Byroff jeta la lampe par terre pour l’éteindre, et ayant refermé l’entrée de la caverne, il détacha un cheval qui avoit été attaché au tronc d’un arbre, le conduisit sur un terrein uni, sauta dessus, et après avoir pris sa fille devant lui, il partit au grand galop.
Ils firent environ une lieue, en observant le plus profond silence ; le comte cependant le rompoit quelquefois en s’adressant à son cheval, afin de lui faire hâter le pas. À la fin Lauretta se hasarda à demander à voix basse ; — « Où allons-nous ? » — » Le comte répondit : « C’est vous qui devez diriger ma route ; mais en ce moment ? gardez le silence, je vous en conjure. Quelqu’un peut être caché parmi ces arbres. » — Lauretta obéit. Mais l’idée que son père venoit de lui suggérer augmenta ses craintes. Elle ne pût pas s’empêcher de promener de tous côtés des regards inquiets, et d’observer avec attention toutes les ombres qui lui falloit traverser, tremblant toujours d’appercevoir celle d’un homme. Souvent même son imagination lui faisoit voir ce qu’elle craignoit.
Il faisoit une de ces nuits pendant lesquelles la lune décroissante paroît à l’horison pleine et d’un rouge sanglant, et teint de feu tous les objets sur lesquels la perspective la fait paroître, pour ainsi dire, prête à tomber. Nos voyageurs ayant tourné le coin d’un petit bois qu’ils traversoient, la lune brilla tout-à-coup à leurs yeux. La scène étoit romantique. Lauretta se livra, malgré elle, au plaisir de la contempler. La lune s’enfonça insensiblement sous l’horizon, et, laissa nos voyageurs sans autre guide que la foible et tremblante lumière des étoiles.
Ils étoient partis du château depuis trois heures, lorsque le comte arrêta son cheval devant une chaumière. Il frappa à la porte. On lui ouvrit à l’instant. Les habitans de cette simple demeure, un homme d’un moyen âge et son jeune fils, tous deux bergers, s’empressèrent de faire entrer dans leur cabane le comte et sa fille.
Le comte exigea d’eux la promesse que, sous aucun prétexte, ils ne permettroient à personne d’entrer dans la chaumière, tant qu’il y seroit, et n’avoueroient pas qu’aucun étranger y soit caché, si on leur en faisoit la question. Ils consentirent à faire cette promesse, moins par l’espoir de la récompense dont le comte promit de payer leur discrétion, que par la crainte de son ressentiment, s’ils le trahissoient ; car son habit leur faisoit croire que c’étoit un moine. Le comte s’en apperçut ; et comme il connoissoit la superstition des paysans de ces contrées, il ne douta plus qu’il n’avoit rien à craindre de ses hôtes, pendant tout le tems qu’il jugeroit convenable d’interrompre son voyage.
Après avoir pourvu à ce que le cheval qui lui étoit si nécessaire, ne manquât de rien, le comte demanda à Lauretta si elle se sentoit disposée à se livrer au sommeil ; mais elle lui déclara que l’agitation de son esprit ne lui permettroit pas de fermer un seul instant les yeux. Alors, il lui témoigna le désir d’entendre de sa bouche l’histoire de sa vie. Elle fut intérieurement fâchée de ce qu’il ne lui offroit pas de l’instruire de la sienne auparavant ; cependant, elle s’empressa de se rendre à l’invitation de son père. Elle se retira avec lui dans la seule chambre qui, avec celle occupée par le berger et son fils, formoient toute la chaumière, et là elle lui fit le récit de tous les événemens de sa vie, depuis le premier moment de son entrée dans le monde, jusqu’à celui où il l’avoit arrachée des mains de Théodore et de son complice.
TRADUIT DE L’ANGLAIS.
TOME SECOND.
────────────
À PARIS,
Au bureau de librairie, chez H. Nicolle,
rue du Bouloy, n°. 56, ci-devant hôtel de
la Reynie.
──────
An VI.
CHAPITRE XIV.
Dans le récit des événemens de sa vie, Lauretta n’oublia pas toutes les particularités de celle de sa mère, que le comte ignoroit. Les détails dans lesquels elle entra pour prouver l’innocence de sa mère, malgré ses liaisons avec le comte de Cohenburg, l’objet de son premier, de son unique amour, affectèrent beaucoup son père.
« Oh ! s’écria-t-il, que ne m’a-t-elle fait connoître l’état de son cœur ! Nous serions maintenant, heureux tous les deux ; et moi, je serois encore vertueux. »
Un instant de silence suivit cette exclamation. Le comte reprit alors :
« Maintenant, mon enfant, écoute le triste récit des malheurs de ton père. Il t’apprendra qu’une mauvaise action conduit insensiblement l’homme le plus heureusement né à des crimes affreux, qui d’abord eussent effrayé son imagination.
» Mon père et sa sœur étoient les seuls enfans du comte de Byroff, gentilhomme allemand, qui résidoit dans une petite terre, environ à vingt lieues de Vienne. Comme la naissance ne donne pas toujours la fortune, l’embarras de ses affaires l’avoit obligé de s’éloigner de la cour.
» Ma tante eut le bonheur de plaire à un marquis italien immensément riche, l’épousa, et l’emmena avec lui en Italie.
» Mon père épousa une femme d’une naissance distinguée, mais dont la fortune n’avoit que trop de conformité avec la sienne. Il ne survécut pas un grand nombre d’années à son union avec la bien-aimée de son cœur, et en mourant, il me laissa, ainsi que ma mère, sous la protection de mon grand’père.
» Des malheurs aussi cruels qu’imprévus, avoient insensiblement diminué la petite propriété du vieux comte. À sa mort (j’avois alors dix-huit ans) il me laissa une fortune plus que médiocre ; en conséquence, ma mère et moi, nous résolûmes de vivre retirés du monde, et d’augmenter, par l’économie, mon petit capital, puisque ma naissance m’interdisoit tout autre moyen.
» Que les préjugés par lesquels nous nous laissons gouverner, sont misérables ! »
» Peu de tems après la mort de mon grand’père, nous reçûmes une lettre de ma tante. Elle nous instruisoit de la mort récente de son mari, qui lui avoit laissé par son testament la plus grande partie de ses immenses richesses. Elle nous invitoit, ma mère et moi, à venir en Italie, demeurer avec elle.
» La terre dans laquelle nous résidions étaqt une terre de famille, il eut été déshonorant à un gentilhomme, de la vendre. Nous quittâmes l’Allemagne sans donner aucune raison de notre départ.
» Ma tante, la marquise del Parmo, qui demeuroit à Venise, dans un palais magnifique, nous reçut avec la plus franche cordialité, et nous prodigua toutes les attentions de l’amitié. Ma mère mourut peu de tems après son arrivée en Italie. À sa mort, ma tante parut redoubler de tendresse pour moi ; elle me dit qu’elle étoit résolue à ne pas se remarier, et qu’à l’exception d’un petit nombre de legs, elle me laisseroit toutes ses propriétés. Je lui exprimai ma reconnoissance en termes proportionnés à ces magnifiques promesses. Elle ajouta qu’elle m’avoit choisi un gouverneur avec lequel elle désiroit que je voyageasse pendant deux ans, avant de former aucun plan d’établissement dans le monde. Elle connoissoit dès-lors mon attachement pour votre mère, qui avoit commencé peu de tems après mon arrivée en Italie.
» La jeunesse aime la nouveauté. L’offre de ma tante étoit trop séduisante pour ne pas me faire renoncer pendant quelque tems à la société de ma Lauretta. Je me flatai de revenir de mon voyage, plus digne d’elle ; car la marquise ayant parlé en ma faveur, au comte Arieno, il avoit immédiatement consenti à ma proposition d’épouser sa fille.
» J’étois absent de d’Italie depuis dix-huit mois, lorsque je reçus de l’intendant de la marquise, une lettre par laquelle il m’informoit qu’elle étoit morte subitement, et que j’étois son seul héritier.
» Je retournai sur-le-champ à Venise, prendre possession de ma nouvelle fortune. J’y étois à peine arrivé depuis quelques heures, lorsque le comte Arieno vint me faire une double visite de condoléance pour la perte de ma tante, et de congratulation pour l’acquisition de sa fortune. Avant de me quitter, il me rappela le contrat verbal passé entre nous, relativement à sa fille. En même tems, il me pria, si je remarquois un changement dans ses manières, de n’y pas faire attention, parce que je ne ferois que renouveler une douleur profonde qui s’affoiblissoit tous les jours et qui avoit pour cause la mort d’une amie intime.
» Je ne fis aucune difficulté de me conformer à ses intentions. Elles me parurent n’avoir d’autre but que la tranquillité de celle que j’aimois. À ma première visite, je fus vivement affecté de l’impression de chagrin répandue sur la physionomie de ma Lauretta. Je m’efforçai de détruire l’effet, sans dire un mot de la cause. Je ne pus m’empêcher de lui observer combien elle étoit changée. Elle pleura, et sûrement elle mésinterprêta mes paroles, comme moi la cause de sa douleur.
» Toutes les fois que je la visitai, je remarquai que son père ne quittoit pas l’appartement. Je connois maintenant la cause d’une conduite qui alors me surprit beaucoup.
» Il savoit combien sa fille le craignoit, et il étoit résolu à prévenir, par sa présence, une explication.
» Maudits soient mille fois les pères, dont la sordide avarice fait ainsi le malheur de leurs enfans !
» Je ne voyois jamais le comte Arieno sans qu’il me pressât de hâter mon mariage, que, par égard pour la mémoire de ma tante, j’avois jugé à propos de différer. Bientôt, cependant, ses argumens, d’accord avec mes propre sentimens, l’emportèrent sur mes scrupules, et je fus uni à votre mère.
» Après la célébration de notre mariage, le comte Arieno insista pour que nous passions au moins deux mois dans sa maison. Je crus alors, comme il me le dit, qu’il ne pouvoit se faire à l’idée de se séparer de sa fille. Je vois aujourd’hui qu’il vouloit la retenir auprès de lui, afin de pouvoir plus facilement veiller sur sa conduite, que sa barbarie lui donnoit lieu de soupçonner.
» J’employai tous les moyens imaginables pour rendre à votre mère son ancienne gaîté ; mais une triste mélancolie, qu’il me fut impossible de dissiper, s’étoit emparée de son esprit.
» Six semaines après notre union, un jour que je témoignois à Arieno, comme je l’avois déjà fait souvent, combien le malheureux état de ma femme m’affligeoit, il m’avoua qu’il avoit des raisons de croire que sa fille me préféroit un indigne rival.
» Ce coup fut terrible ; il troubla mon bonheur et offensa mon orgueil. Tout le mystère de la conduite du comte Arieno me fut à l’instant dévoilé, et je ne vis plus qu’avec mépris le misérable qui avoit ainsi trafiqué de sa fille.
» Il me fit part alors de tout ce qui s’étoit passé avant mon mariage, entre votre mère et le comte Frédéric. Il se prodigua à lui-même des éloges pour la fermeté qu’il avoit montrée dans cette affaire. Ainsi il se vantoit devant moi, d’avoir, par sa lâche imposture, fait le malheur de sa fille unique et le mien. Furieux de me voir condamné à d’éternels soupçons, je lui reprochai la bassesse de sa conduite. Il m’écouta tranquillement et en souriant, comme un homme satisfait d’avoir rempli ses désirs, et qui se soucie peu du malheur des autres. Lorsque je cessai de parler,
« Qui vous empêche, me dit-il froidement, de vous débarrasser de ce rival ? »
« Et comment ? Où puis-je fuir ? En quel lieu ne peut-il pas me suivre ? »
« Tuez-le. »
» Jamais mon épée n’avoit été tirée contre un de mes semblables. Je frémis à cette idée.
» Arieno s’en apperçut, et comme pour finir une phrase qu’il n’avoit pas achevée, il ajouta : — « Où souffrez patiemment l’infamie que le monde attache justement à un homme, qui ne sait pas venger son honneur outragé. »
» Ces derniers mots me percèrent le cœur.
« Donnez-moi la preuve de vos soupçons, lui dis-je, et à l’instant je lui envoie un cartel. »
« Vous l’aurez cette preuve, soyez-en assuré. » — Après ces mots il me quitta.
» À quel état misérable cette cruelle révélation me réduisit ! Apprendre que j’étois un objet d’horreur pour la femme sur laquelle j’avois placé toutes mes espérances de bonheur, et qui, comme moi, étoit la victime de l’avarice et de l’orgueil de son père !
» Je résolus cependant de souffrir en silence, jusqu’à ce que la preuve promise m’ait été donnée. Tantôt je doutois de la vérité de l’assertion du comte Arieno, tantôt je craignois de la voir confirmer. Mais quelle que fût l’opinion que j’adoptasse, toujours j’envisageois avec mépris le vil auteur de mes doutes.
» Environ quinze jours après notre dernière conversation sur le sujet de mes inquiétudes, il entra dans mon appartement, une lettre décachetée à la main. Il s’assit et me parla ainsi :
« J’ai annoncé hier matin, que vous et moi nous partirions ce soir pour la campagne, et que nous ne reviendrions pas avant deux ou trois jours. Vous devinerez facilement mon but, lorsque vous saurez, après avoir lu cette lettre, que ce bruit répandu à dessein, a déjà produit son effet.
» En même-tems il me remit la lettre. Je la lus. Concevez mon désespoir. C’étoit une invitation de votre mère au comte Frédéric (écrite de sa propre main) de se rendre ce soir même à un rendez-vous chez sa tante.
» Le comte Arieno, quand j’eus achevé la lecture de la lettre, que je parcourus plusieurs fois avant de pouvoir me convaincre que mes yeux ne me trompoient pas, m’instruisit de quelle manière il l’avoit arraché des mains du domestique, auquel ma femme l’avoit confiée, et des moyens qu’il avoit pris, afin de l’empêcher de retourner vers ses commettans.
» Je l’écoutois sans proférer une parole. J’étois dans un état, dont vous ne pouvez vous faire l’idée. Au moment où j’allois mettre la fatale lettre en morceaux, il se leva précipitamment de son siège, me l’arracha des mains. »
« Arrêtez ! s’écria-t-il. De cette lettre, dépend notre vengeance. »
» Il se mit alors à mon secrétaire, et ayant recacheté la lettre, il appella un domestique dont il étoit sûr, qu’il chargea de la porter à celui auquel elle étoit adressée.
» Toujours absorbé dans ma douleur, mon silence ne fut interrompu que par de profonds soupirs, jusqu’au moment où le domestique ayant quitté la chambre, le comte me demanda si j’avois remarqué ce qu’il avoit fait.
» Je lui répondis qu’oui, et je le priai de me dire quels étoient ses motifs pour en agir ainsi.
« Le comte de Cohenburg, répondit-il, se rendra certainement, ce soir, à cette invitation. Il faut nécessairement qu’il passe dans une rue étroite et obscure, pour se rendre chez ma sœur, lieu du rendez-vous. C’est maintenant votre affaire de chercher des agens qui l’attendront dans cet endroit. Il ne sera pas difficile d’en trouver sur lesquels nous puissions compter. — Nous quitterons la ville à l’heure que j’ai précédemment fixée pour notre départ. Ainsi les soupçons ne pourront tomber sur nous, et le sang de votre rival effacera votre deshonneur. »
» J’entendis prononcer ces derniers mots avec des sentimens bien différens de ceux dont j’aurois probablement été animé, si j’eusse été italien. Lorsqu’il cessa de parler, je m’écriai :
» — S’il mérite la mort, pourquoi craindrai-je de la lui donner moi-même ? S’il peut y avoir une excuse pour celui qui verse le sang d’un homme, elle est sans doute pour celui qu’une injure mortelle force à la vengeance. Pourquoi donc alors charger d’un crime la main d’un autre, et en payant le prix du sang, ajouter à mon propre crime ?
» Je fus beaucoup de tems avant de pouvoir faire comprendre à Arieno, accoutumé aux mœurs d’un pays où la vie des hommes s’achète comme celle des plus vils animaux, que je croyois devoir venger, de mes propres mains, ma propre injure, et sur-tout avant de le déterminer, à m’accompagner jusqu’à la petite rue, où devoit passer le comte Frédéric, pour se rendre à son rendez-vous avec votre mère. À la fin il promit de me suivre. Nous partîmes à l’heure indiquée la veille, par Arieno. Nous nous rendîmes à cheval à une petite maison, située environ à un quart de lieue de Venise ; elle appartenoit à un homme qui avoit autrefois été au service du comte ; nous laissâmes nos chevaux à cet endroit, et à l’approche de la nuit, nous retournâmes à pied à la ville.
» Nous arrivâmes dans la petite rue environ une heure avant le tems marqué pour le rendez-vous, par votre mère. — Je tirai mon épée, et nous nous plaçâmes à l’ombre d’un portique très-bas. Bientôt nous entendîmes le bruit des pas. — Un homme enveloppé dans un manteau s’avança rapidement vers nous. Arieno me dit tout bas : « C’est lui, c’est le comte lui-même. » — Je m’élançai sur-le-champ vers lui, et en le traitant de scélérat, je lui dis de se mettre en garde. Il donna un coup sur mon épée, avec une canne, qu’il tenoit à sa main, et essaya de passer outre. Mais je reculai de quelques pas, et je lui passai mon épée au travers du corps. Il tomba. Au même instant, nous entendîmes le bruit de plusieurs voix, et nous courûmes, moi à la maison du comte, et lui à celle de sa sœur, où il s’attendoit à trouver votre mère.
» Quels tourmens n’éprouvai-je pas pendant cette nuit cruelle, au moment où j’entrai dans l’appartement de votre mère ! Elle avoit été reportée de la maison de sa tante, à Venise, sans connoissance. Je me croyois indignement trahi, et cependant ses cris et ses reproches me déchiroient le cœur. — Elle m’avoua son amour pour le comte Frédéric ; mais au nom du ciel, elle jura qu’elle étoit innocente du crime dont son père et moi nous l’accusions. — Ses protestations ne me convainquirent pas ; et cependant je l’aimois à un tel point que je m’efforçai, par toutes les attentions possibles, et par l’assurance d’un pardon sincère et d’un dévouement sans bornes, de lui faire oublier celui qu’elle avoit perdu.
» Elle ne voulut rien écouter. Je quittai sa chambre, le cœur aussi déchiré que le sien.
» Le lendemain, dans la soirée, pendant que je faisois de nouveaux efforts pour consoler votre mère, on vint m’avertir que le comte Arieno me prioit de me rendre promptement dans son appartement.
» Je m’y rendis sur-le-champ. Il m’apprit en peu de mots que le comte Frédéric nous avoit échappé ; que l’homme tué par moi la nuit précédente, étoit le fils d’un des premiers sénateurs ; que cinq mille sequins étoient promis à celui qui arrêteroit le meurtrier ; et enfin que le sénat avoit prononcé l’exil et la confiscation des biens contre ceux qui, connoissant le coupable, ne le livreroient pas à l’instant entre les mains de la justice.
» Je ne puis vous rendre, et vous ne pouvez concevoir, ce que j’éprouvai en apprenant que j’avois tué un innocent.
» Maintenant continua le comte Arieno, que méririteroit un ami qui entreprendroit de vous tirer du danger, dont vous êtes menacé ?
» Si j’eusse été arrêté, la mort, je le savois, devoit être mon partage. En ce cruel moment, de toute autre main, que de celle du boureau, elle eût été pour moi un bienfait. Mais mourir sur un échafaud ! cette idée me faisoit frémir aussi, je répondis avec empressement : Tout. »
» Eh bien, reprit-il, je serai cet ami. — Occupons-nous, actuellement des moyens : si vous étiez arrêté pour ce crime, vous ne doutez pas que toutes vos propriétés seroient confisquées au profit de l’état.
» J’en suis convaincu, répondis-je.
» Votre vie dépend de votre prompte fuite. Il faut sortir à l’instant des domaines de la république. Il est par conséquent impossible que vous puissiez rassembler la valeur de tous vos biens, en si peu de tems. Tout ce que vous laisserez sous votre nom, sera immédiatement confisqué : faites-moi la cession de tous vos biens-meubles, qui forment la plus grande partie de vos richesses. Abandonnez votre terre à la confiscation. Fuyez, tandis qu’il en est encore tems. Je vous ferai passer le prix de tout ce que vous m’aurez cédé, aussi-tôt que je vous saurai arrivé en lieu de sûreté.
» Je fus si sensible à cette offre du comte Arieno, que j’oubliai entièrement sa conduite passée. J’acceptai sa proposition, et je me hâtai de la mettre à exécution, après lui avoir exprimé toute ma reconnoissance.
» J’avois à peine apposé ma signature et mon cachet à l’acte par lequel je cédois tous mes biens-meubles au comte Arieno, que le médecin de votre mère vint nous informer de sa fuite. Le comte parut recevoir cette nouvelle avec indifférence. J’étois trop occupé de mes dangers, pour donner une grande attention au discours du médecin. Je supposai qu’ayant appris que le comte de Cohenburg n’avoit pas été tué, elle avoit trouvé les moyens de se rendre auprès de lui.
» Quelques heures après, je n’étois plus sur les domaines vénitiens, et en moins de quinze jours, j’arrivai à Paris. C’étoit cette ville que j’avois choisie, pour me soustraire aux poursuites du gouvernement de Venise. Plus près, j’eusse craint d’être découvert par ses nombreux espions, et réclamé comme assassin.
» Le lendemain de mon arrivée, j’écrivis au comte Arieno. Je l’instruisis du lieu de ma retraite. Je ne crus pas nécessaire de l’engager à me faire promptement passer des fonds ; car il savoit très-bien que je n’avois emporté que l’argent que j’avois sur moi ; au moment de mon départ, et quelques bijoux de peu de valeur.
» Au bout de trois semaines, je reçus une lettre de lui. Elle étoit conçue à-peu-près en ces termes :
« On a découvert que vous étiez l’assassin du fils du sénateur ; en conséquence, on a confisqué toutes celles de vos propriétés qui étoient publiquement connues comme vous appartenant. Je suis désolé que cette découverte se soit faite si promptement. Cela m’empêchera de vous rendre les services que je vous ai offerts ; car, en ma qualité de sénateur vénitien, je m’exposerois à la mort, si l’on venoit à découvrir que je fais passer des secours à un homme condamné par les loix. Je ne puis donc vous envoyer que des remerciemens, pour m’avoir, par l’acte passé entre nous le soir de votre départ de Venise, autorisé à toucher une somme d’argent qui, sans cela, appartiendroit actuellement à l’état.
» Indigne sénateur, m’écriai-je, après avoir lu cette lettre infernale, tu observe avec soin en public, les loix de l’état, et tu n’hésite pas à les violer en secret. »
Le comte Byroff se reposa un moment ; puis il reprit ainsi sa narration :
« À quelle situation je me voyois réduit ! Pour toute propriété, quinze sequins, et deux bagues de peu de valeur ; sans aucuns moyens de recouvrer ce qui m’avoit été si bassement arraché ; ne pouvant même chercher à me venger de l’auteur de tous mes malheurs, sans m’exposer au plus grand des dangers ; au milieu d’une ville où j’étois absolument étranger ; sans un ami auquel je pusse avoir recours ; sans une connoissance même, dont la conversation fût du moins une distraction momentanée ; enfin sans espoir de sortir jamais de l’inextricable labyrinthe où m’avoit enfermé, pour satisfaire son avarice, un homme auquel je n’avois jamais témoigné que de l’amitié !
» Néanmoins, je m’occupai d’abord de ma sûreté. Je savois que si ma retraite étoit découverte, le gouvernement de Venise ne manqueroit pas de me réclamer. Quelquefois je craignois qu’Arieno, pour s’assurer encore davantage ce qu’il m’avoit ravi, n’instruisit le gouvernement de l’endroit où je m’étois retiré, et ne cherchât à se débarrasser, par ma mort, de l’appréhension de me voir un jour rentrer dans des biens qui m’appartenoient légalement. Mais je me rassurai en considérant que dans ce cas-là il auroit à redouter ma vengeance, et qu’il me suffiroit pour le perdre, de déclarer que les biens dont il étoit maintenant en possession, étoient à moi, et appartenoient par conséquent à l’état. Cette réflexion me tranquillisa. Mais à tout événement, sentant que j’étois intéressé à vivre ignoré, je changeai mon costume contre celui du pays que j’habitois, et je me fis appeller Montville, résolu de rester à Paris ; cette ville me parut être l’endroit du monde où il me seroit le plus facile d’échapper à l’observation.
» Je pris un logement dans une rue obscure de la Cité. Là, mon unique amusement fut de me rendre habituellement dans un café voisin, fréquenté par des jeunes gens qui, sans être d’une naissance distinguée, étoient cependant bien élevés, et jouissoient d’une fortune honnête.
» Tous les soirs ils se rassembloient en nombre plus ou moins grand, dans ce café, pour y jouer aux échecs. J’étois de la première force à ce jeu. Mon accent étranger me fit bientôt remarquer. On me proposa une partie. J’acceptai avec plaisir l’invitation. Ils jouoient très-petit jeu. Sans cela, quoique connoissant mes forces, je n’eusse pas osé m’exposer. Parmi ces jeunes gens, j’en rencontrai d’aussi forts que moi. Quand je jouois avec eux, j’éprouvois alternativement la bonne et la mauvaise fortune ; mais comme mon habileté étoit en général fort supérieure à celle de ceux avec qui je jouois, et que d’ailleurs l’état de ma bourse m’obligeoit à faire plus d’attention à mon jeu que n’en faisoient communément mes adversaires, je me retirois ordinairement avec du bénéfice. Je regardai cet argent comme un bienfait du ciel. Ma situation précaire m’avoit appris à être économe, et au bout de six mois, je me trouvai avoir cinquante louis devant moi. Le premier obstacle levé, je veux dire le défaut d’argent, je m’occupai alors des moyens de découvrir la retraite de votre mère, et de me venger de celui qui avoit détruit le bonheur de ma vie.
» Après avoir long-tems réfléchi sur ce projet, je finis par cette conclusion : — « La mort du comte de Cohenburg me rendra-t-elle le bonheur ? — Non. — Son sang effacera-t-il le sang dont mes mains sont souillées ? « — Non. — Puis-je espérer que ma femme sera pour moi, à l’avenir, ce qu’elle auroit toujours dû être ? — Non. — Pourquoi donc chercher celle qui me fuit, et percer d’un nouveau trait une conscience déjà blessée, par le meurtre de celui dont la mort ne peut me rendre la tranquillité que j’ai perdue ?
» Une fois convaincu qu’il étoit de mon intérêt de faire tous mes efforts pour oublier celle qui m’avoit été si chère, mon esprit devint plus calme ; car lorsque l’on a une fois adopté une opinion, toutes nos idées semblent ensuite une confirmation des motifs de notre détermination.
Toutes les fois cependant que je songeois à votre mère, au milieu des reproches que je lui adressois, je ne pouvois jamais me défendre d’un sentiment de pitié pour une femme qui avoit été réduite au désespoir par l’avarice de son père. — Quant au comte Arieno, toutes les fois que je pensois à lui, et malheureusement son image ne se présentoit que trop souvent à mon esprit, j’éprouvois une horreur invincible — « Est-il possible, m’écriai-je, que la terre porte un monstre capable de tant de crimes ? » — Il a sacrifié sa fille à son avarice. — Il a trompé l’inexpérience d’un jeune homme pour lui faire épouser sa fille. — Il a armé le bras de ce jeune homme, devenu son gendre. — Il a dirigé ses coups vers le cœur de celui auquel l’amour avoit donné la main de sa fille. — Il a ravi la propriété de ce jeune homme, par une violation de cette foi sacrée, sens laquelle l’homme ne verroit plus dans l’homme qu’un ennemi, et par le même crime, magistrat prévaricateur, il a volé l’état, dont il a solemnellement juré de défendre les droits au péril de sa vie. »
CHAPITRE XV.
Le récit du comte Byroff fut interrompu par le vieux berger qui apporta à nos voyageurs un vase de lait chaud. Le comte le remercia de son attention, et Lauretta après avoir essuyé les pleurs qu’elle avoit donnés aux malheurs de son père, but un peu de lait qui la rafraîchit beaucoup. Le comte en fit autant. Le paysan se retira, enchanté des témoignages de reconnoissance que lui prodiguèrent ses deux hôtes. Le comte Byroff reprit ainsi :
« Je demeurois à Paris depuis deux ans, lorsqu’un jour revenant de me promener, dans un des fauxbourgs de la ville, je fus suivi par deux hommes qui s’introduisirent dans la maison où je demeurois, et montèrent dans mon appartement. Pendant ma promenade, j’avois cru remarquer qu’ils m’observoient. Je me hâtai de leur demander ce qu’ils vouloient de moi. — « Il faut que vous veniez avec nous, monsieur, s’il vous plaît, » dit l’un d’eux. — Et où, messieurs ? — Celui qui avoit porté la parole, répondit à cette question, en tirant de sa poche un papier scellé à l’un des coins, qu’il déploya à mes yeux, en me montrant d’une main le cachet. À la vue de ce papier, je pris ces deux hommes pour des émissaires du gouvernement de Venise ; mais jugez de mon étonnement, lorsque j’appris que ce papier étoit un ordre de me conduire à la Bastille ; en un mot une lettre de cachet.
» Les deux hommes me firent entrer dans une voiture bien fermée ; et bien-tôt j’entendis baisser le fatal pont-levis qui conduit à cet affreux séjour de désespoir. [1]
» La voiture entra dans la première cour. Dès qu’elle s’arrêta, mes deux gardes me firent descendre et me conduisirent au travers d’une grande cour pavée, entourée de hautes murailles, dans le vestibule de cet immense édifice, dont le sombre aspect m’avoit fait souvent frissonner. Hélas ! j’étois loin alors d’imaginer que j’étois destiné à y gémir si long-tems !
» Après avoir encore, traversé deux salles immenses et plusieurs passages obscurs, nous arrivâmes à une énorme porte de fer, qui étoit à l’extrémité d’un long corridor éclairé seulement par une fenêtre étroite. Cette porte nous fut ouverte par une personne que nous avions trouvée dans la seconde salle, et qui depuis nous avoit accompagnés. Je sus par la suite que c’étoit le gouverneur lui-même. On me fit entrer, et la porte fut refermée sur moi. Je me trouvai dans une petite chambre quarrée, dont une table à moitié brisée, une chaise et un matelas composoient tout l’ameublement. Les murailles qui avoient été revêtues de plâtre, étoient dégradées en quelques endroits, et dans d’autres, recouvertes d’une croûte verte qui me confirma dans l’opinion où j’étois de l’humidité de cette prison, car en y entrant, j’avois été saisi de froid.
» Dans cette affreuse solitude, je commençai par me perdre en conjectures sur les causes de mon emprisonnement. En y réfléchissant, il me parut peu probable que le gouvernement de Venise songeât encore à moi, et m’eût réclamé au bout de deux ans. D’un autre côté, quel pouvoit être le motif du Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/50 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/51 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/52 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/53 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/54 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/55 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/56 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/57 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/58 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/59 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/60 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/61 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/62 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/63 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/64 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/65 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/66 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/67 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/68 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/69 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/70 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/71 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/72 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/73 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/74 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/75 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/76 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/77 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/78 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/79 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/80 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/81 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/82 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/83 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/84 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/85 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/86 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/87 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/88 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/89 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/90 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/91 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/92 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/93 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/94 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/95 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/96 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/97 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/98 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/99 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/100 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/101 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/102 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/103 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/104 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/105 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/106 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/107 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/108 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/109 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/110 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/111 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/112 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/113 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/114 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/115 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/116 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/117 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/118 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/119 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/120 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/121 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/122 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/123 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/124 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/125 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/126 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/127 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/128 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/129 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/130 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/131 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/132 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/133 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/134 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/135 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/136 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/137 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/138 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/139 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/140 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/141 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/142 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/143 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/144 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/145 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/146 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/147 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/148 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/149 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/150 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/151 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/152 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/153 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/154 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/155 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/156 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/157 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/158 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/159 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/160 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/161 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/162 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/163 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/164 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/165 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/166 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/167 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/168 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/169 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/170 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/171 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/172 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/173 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/174 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/175 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/176 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/177 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/178 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/179 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/180 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/181 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/182 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/183 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/184 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/185 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/186 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/187 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/188 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/189 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/190 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/191 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/192 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/193 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/194 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/195 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/196 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/197 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/198 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/199 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/200 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/201 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/202 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/203 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/204 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/205 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/206 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/207 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/208 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/209 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/210 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/211 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/212 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/213 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/214 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/215 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/216 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/217 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/218 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/219 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/220 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/221 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/222 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/223 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/224 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/225 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/226 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/227 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/228 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/229 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/230 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/231 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/232 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/233 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/234 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/235 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/236 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/237 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/238 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/239 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/240 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/241 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/242 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/243 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/244 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/245 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/246 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/247 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/248 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/249 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/250 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/251 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/252 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/253 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/254 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/255 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/256 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/257 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/258 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/259 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/260 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/261 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/262 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/263 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/264 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/265 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/266 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/267 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/268 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/269 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/270 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/271 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/272 Page:Lathom - La Cloche de minuit v2.djvu/273 homme s’avancer quelques pas dans la chapelle, et s’enfuir effrayé, dès qu’il l’avoit appercue.
« Ô nuit horrible ! ô cruel souvenir ! Que n’ai-je pas souffert ! »
« Comment êtes-vous parvenu à sortir du château ? » demanda le père Nicolas.
« L’effroi, l’égarement de ma raison, me donnèrent la force de briser la fenêtre qui est à l’extrémité de la grande cour. C’est par-là que je me sauvai. »
« Le comte Frédéric, reprit le moine, se retira immédiatement au monastère de Saint-Paul, et ne survécut pas long-tems à son frère. Depuis la mort de votre père, les moines du monastère du Saint-Esprit, ont, par la permission de votre mère, joui de tous les revenus de la terre de Cohenburg, en reconnoissance de leurs visites nocturnes et de leurs prières. Je l’ai souvent conjurée de vous faire chercher et de vous rétablir dans tous vos droits ; mais l’égarement de sa raison, qui toujours a suivi cette proposition, ne me permettoit pas d’insister.
» Hier matin, je la visitai seul, pour lui faire part des soupçons que m’avoient inspiré votre nom, et quelques mots qui vous étoient échappés. Je lui dis que je croyois son fils dans le voisinage du château. »
« N’est-ce pas entre trois et quatre heures, que vous avez été au château ? demanda le comte Byroff. »
La réponse affirmative du père Nicolas, expliqua au comte, pourquoi il avoit trouvé ouverte la poterne. Le bon père continua :
Votre mère, dont l’esprit est extrêmement affoibli, parut douter que vous fussiez si près d’elle. Elle me pria cependant, si mes conjectures se vérifioient, de vous engager à ne pas chercher à la voir. Ma conversation de ce matin, avec vous, ne m’ayant plus laissé de doute, je suis retourné la visiter cet après-midi. Contre mon attente, elle m’a écouté avec calme. Elle a beaucoup pleuré en apprenant qu’elle vous avoit vu sans vous reconnoître. Elle m’a déclaré que son intention étoit de vous rétablir dans la possession de tous vos droits, en quittant immédiatement le château ; et par-dessus tout, elle m’a recommandé de vous dire, lorsque je vous aurois instruit de sa malheureuse histoire, que la seule preuve d’affection qu’elle désiroit et espéroit de vous, étoit de ne plus chercher à la revoir. »
Alphonse n’eut pas la force de répondre. À peine même entendit-il les derniers mots du père Nicolas.
Le saint homme lui conseilla de prendre du repos, et de tâcher de calmer un peu l’agitation de ses esprits. Alphonse se mit au lit, comme un homme qui sait à peine ce qu’il fait. Il ne proféra pas une seule parole, pendant toute la nuit.
Après avoir adressé quelques mots de consolation à Lauretta, qui fondoit en larmes, et dit au comte Byroff qu’une affaire importante l’obligeoit à les quitter ; mais qu’il reviendroit le lendemain matin, de très-bonne heure. Le père Nicolas quitta l’auberge, en donnant sa bénédiction à tous ceux qui l’habitoient.
La nuit se passa dans un morne silence. Il ne fut interrompu que par quelques réflexions du comte et de sa fille, sur le récit du moine, et par les fréquens et profonds soupirs d’Alphonse.
À dix heures du matin, le bon père arriva. Alphonse étoit depuis deux heures tombé dans un doux sommeil. Le comte Byroff et le moine avoient une ample matière de conversation ; aussi ne tarit-elle pas jusqu’au moment où Lauretta vint les prévenir qu’Alphonse étoit reveillé et demandoit à voir le père Nicolas.
Ils montèrent à sa chambre.
« Mon père, dit Alphonse, aussi-tôt qu’il apperçut le moine, vous ne m’avez pas dit où ma mère s’est retirée. »
« Quand je vous quitai hier, elle étoit encore au château de Cohenburg. Je l’ai conduite cette nuit au couvent de la Vierge-Marie, situé à sept lieues d’ici, et dont les pensionnaires même, quand elles ont une fois pénétré dans ses murs, ne peuvent plus recevoir aucun étranger. »
« Qu’a-t-elle dit en vous quittant ? Seroit-il possible qu’elle ne vous ait pas parlé de moi ? »
« Elle m’a chargé de vous dire qu’elle ne vous donnoit pas sa bénédiction, dans la crainte qu’elle ne vous attirât la malédiction du ciel. Elle se recommande à vos prières, et vous prie de jeter quelquefois un regard de pitié sur ce portrait. »
Le moine mit en même tems dans la main d’Alphonse, un portrait de sa mère, en miniature.
Alphonse le regarda avec empressement, et le baisa.
« Pardonne-lui, grand Dieu ! » s’écria-t-il.
Un petit ruban étoit attaché au portrait. Il le passa autour de son col, et plaça le portrait sur sa poitrine. Puis il reprit :
« Repose ici en paix ; et puissent, ô ! mon père ! ô ma mère ! vos ombres vénérées, être un jour unies dans un monde plus heureux, comme vos images le sont maintenant dans mon cœur. »
CHAP. XXVI et dernier.
Au bout de quelques jours, la santé d’Alphonse lui permit de visiter le château de Cohenburg. Par les ordres du père Nicolas, le cercueil qui renfermoit les restes du dernier comte, avoit été replacé dans le caveau. Mais il se passa bien du tems avant qu’Alphonse pût prendre sur lui d’entrer dans la chapelle et dans la chambre où il étoit couché, lorsque sa mère vint lui donner l’ordre mystérieux de s’éloigner du château.
Le comte Byroff et le père Nicolas, se chargèrent de faire faire les préparatifs que le long abandon du château avoit rendu indispensables.
Dès que Jacques eut appris qu’Alphonse alloit enfin reprendre son rang, et rentrer dans ses biens, il ne fut plus le maître de sa joie. Lorsqu’il ne pouvoit pas l’exprimer au comte, à Alphonse, ou à Lauretta, il se félicitoit lui-même, et ne cessoit de chanter et de danser.
L’hôte, depuis l’arrivée de nos voyageurs, leur avoit prodigué les soins les plus attentifs. Mais il ne sut pas plutôt qu’il avoit l’honneur de posséder chez lui l’héritier du château de Cohenburg, que ses attentions devinrent fatigantes, et perdirent tout le prix que leur donnoit auparavant la naturelle bonté de son cœur. Il avoit l’air continuellement affairé ; et quoiqu’il fût très-bavard, il ne daignoit plus que très-rarement répondre aux questions qu’on lui adressoit.
Les visites fréquentes que le père Nicolas faisoit depuis long-tems au village voisin, en sa double qualité de prêtre et de médecin, lui en avoient fait connoître tous les habitans. Il choisit parmi eux tous les domestiques nécessaires au nouvel établissement d’Alphonse. Il n’oublia pas d’affoiblir par tous les moyens possibles la surprise que la soudaine apparition de l’héritier de la famille de Cohenburg avoit excitée.
Le jour où Alphonse fixa enfin sa résidence au château de ses pères, il reçut les félicitations des moines du Saint-Esprit. Ce n’est pas ici le lieu d’examiner s’ils avoient le cœur sur les lèvres ; toujours est-il certain qu’ils s’expédièrent de bonne grâce.
Lorsqu’ils se retirèrent Jacques étoit dans un coin de la cour. Lorsque ses éclats de rire le lui permirent il s’écria :
« Ah ! mes amis, vous avez bu à la santé de l’esprit fort à propos. S’il plaît à Dieu, vous n’y boirez pas de si-tôt. »
Le père Nicolas n’avoit pas perdu de tems, et avoit écrit immédiatement à l’évêque pour l’instruire des circonstances du serment d’Alphonse, et pour le recommander à l’indulgence de l’église. Il obtint promptement son absolution, à condition qu’Alphonse fonderoit une rente perpétuelle, en faveur d’un couvent de pauvres religieuses, et se soumettroit à une légère pénitence.
Alphonse résidoit déjà depuis trois mois au château de Cohenburg, les scènes ravissantes du bonheur domestique commençoient à lui faire oublier le passé, lorsqu’un jour Jacques hors d’haleine entra dans le salon, et, s’adressant au comte Byroff, lui dit :
_ « Oh ! monsieur, quel bonheur ! Grâces à Dieu, monsieur, nous n’avons plus maintenant d’ennemis dans le monde, que mon oncle Perlet et la Bastille. »
Le comte Byroff s’empressa de lui demander le motif d’une joie si extraordinaire. Jacques fut quelque tems à reprendre haleine, avant de pouvoir répondre. Enfin il dit :
« Je vous apprends, monsieur, que, Kroonzer a été envoyé aux galères avec toute sa bande. »
« Et comment sais-tu cela ? » lui demanda le comte.
« Je vais vous le dire, monsieur. J’ai été me promener jusqu’à la petite auberge. (C’étoit la promenade habituelle de Jacques, devenu l’ami intime de l’hôte.) Pendant que j’y étois, monsieur, il est arrivé un homme, un étranger. — « Quelles nouvelles ? lui a demandé l’hôte. » — L’étranger a répondu qu’on venoit de découvrir une bande de voleurs dans un vieux château, situé à une journée de chemin d’Inspruch. — Vous pensez bien, monsieur, que j’ai su tout de suite ce qu’il vouloit dire. — « Comment les a-t-on découverts ? » ai-je dit. — « Un gentilhomme, répondit l’étranger, voyageant sur cette route, a été attaqué par eux. Ses domestiques sont parvenus à faire prisonnier un des bandits, qui a tout avoué et désigné leur repaire. Ils ont été immédiatement arrêtés et condamnés par l’empereur, à être vendus aux turcs, comme galériens. »
Le comte Byroff prit sur-le-champ des mesures pour s’assurer de la vérité de ce rapport. Les informations en confirmèrent l’exactitude, à la grande satisfaction de Jacques, qui, depuis sa fuite du vieux château en ruines, avoit toujours eu grande peur d’être rejoint par les bandits, et sévèrement punis par eux de sa désertion. Le comte Byroff lui-même ne fut pas fâché de n’avoir plus à craindre la vengeance, dont Kroonzer l’avoit menacé.
À cette époque, Alphonse envoya en Italie une personne recommandée à sa confiance par le père Nicolas, pour s’assurer si le comte Arieno vivoit encore. En cas qu’il ne fut pas mort, son intention étoit d’aller lui-même à Venise avec sa Lauretta, qu’il regardoit comme l’héritière légitime et unique des biens du comte Arieno. Il espéroit la faire reconnoître par son grand-père ; mais son messager revint avec la triste nouvelle que le comte Arieno, après avoir été jugé complice d’un autre sénateur qui avoit diverti les deniers publics, étoit mort sur un échafaud, et que tous ses biens avoient été confisqués au profit de l’état.
Le comte Byroff et sa fille ne purent s’empêcher de donner quelques larmes, au sort affreux, mais bien mérité, de cet homme, dont la vie avoit été un outrage continuel à l’humanité.
La comtesse Anna ne vécut que peu de mois dans la retraite qu’elle avoit choisie, pour y terminer sa déplorable existence. Certain que le Dieu des miséricordes lui avoit pardonné un crime involontaire, Alphonse ne put pas donner des larmes à une mort, qui mettoit un terme aux longues douleurs de sa mère.
Quelques années après, un événement imprévu fit trouver ensemble Alphonse et le baron de Smaldart. Le tems avoit adouci le ressentiment, que la mort du chevalier d’Aignon avoit d’abord excité dans le cœur du baron contre Alphonse. Ce dernier avoit toujours désiré de se réconcilier avec son généreux protecteur. La réconciliation se fit, sans que ni l’un ni l’autre eussent fait pour cela la moindre démarche, mais à leur mutuelle satisfaction.
Le baron accepta l’invitation, que lui fit Alphonse, de venir passer quelque tems au château de Cohenburg. Son cœur sensible fut touché du spectacle dont il y fut témoin. Alphonse et sa Lauretta, vivant dans tout l’éclat de leur rang, et jouissant du premier des biens, le bonheur domestique ; le comte Byroff révéré par son gendre et sa fille, aimé et caressé par ses petits enfans ; ces innocens enfans, heureux de croître sous les yeux d’une mère tendre, plus heureux encore peut-être d’être élevés par un père digne de cette importante fonction.
« Craignez, mes enfans, leur répétoit souvent Alphonse, lorsqu’ils furent plus avancés en âge ; craignez la méfiance et la jalousie, elles enfantent tous les crimes ; elles sont elles-mêmes des crimes ; elles ne savent pas distinguer l’innocent du coupable ; elles font le tourment de celui qui s’y livre ; elles ne meurent qu’avec lui, et trop souvent la malédiction qu’il a encourue s’étend sur sa postérité. La méfiance et la jalousie sont filles de l’enfer ; la charité doit en triompher, elle est fille du ciel. »
- ↑ Seroit-il encore nécessaire d’avertir que
tout ce qu’on va lire est une exagération ridicule ?
Les lettres de cachet sont une des choses sur lesquelles
on a le plus débité d’absurdités en Angleterre
comme en France. À aucune époque de
notre histoire, il ne s’est commis dans les
prisons d’état la millième partie des horreurs
qu’on va lire. Il n’est pas douteux que quelques
ministres n’aient abusé des lettres de cachet ; mais
qu’on cite un seul gouvernement où le roi, le sénat
et sur-tout le peuple, n’aient pas abusé de leurs
droits. Quoi qu’il en soit, toujours est-il certain
que depuis l’extinction des ridicules querelles du
jansénisme, les lettres de cachet ont été une
grâce pour tous ceux contre lesquels il en a été
décerné. Je n’en excepte personne, pas même le
fameux Mirabeau, l’honnête Brissot, le polygame
Trudon, et ce Manuel, qui n’aimoit pas
les rois.
- Rien n’est beau que le vrai ;
- (Note du traducteur.)