La Queste du Saint Graal/VII
VII
La Nef de Salomon
La sœur de Perceval.
epuis le jour où il avait sauvé Perceval attaqué par les routiers, Galaad avait chevauché en tous sens, au gré du hasard, à travers le royaume de Logres. Il y avait trouvé plus d’aventures qu’on n’en saurait conter.
Un jour, dans un tournoi, il s’était rencontré avec Gauvain, et lui avait porté à la tête un coup d’épée qui avait fendu le heaume, la coiffe de fer et tranché la peau jusqu’au crâne. Ainsi se trouva vérifiée la prédication faite à Gauvain devant le roi Artus et ses barons le jour qu’il mit la main à l’Épée plantée dans le perron de marbre. Ce fut pour Gauvain la fin de la Quête, car il mit longtemps à guérir. Il n’avait d’ailleurs rien fait de bon ; semblable à tous les chevaliers trop légers qui, fourvoyés dans la noble aventure du Graal, n’y trouvaient que hontes et déboires. Souvent même, aveuglés d’on ne sait quelle fureur, ils s’étaient entre-tués, et Gauvain, en particulier, avait à se reprocher la mort de plus de dix compagnons de la Table Ronde.
Quelque temps après, comme Galaad se disposait à passer la nuit chez un ermite, une jeune fille inconnue vint lui offrir de le guider vers la plus haute des aventures. Il accepta et repartit aussitôt avec elle. Jour et nuit ils chevauchaient, s’arrêtant à peine pour manger et se reposer dans les châteaux qu’ils rencontraient. Enfin, au matin du second jour, ils atteignirent un rivage, le long duquel glissait la barque qui portait Perceval et Bohort. En se reconnaissant, les trois chevaliers pleurèrent de joie ; puis Galaad et la demoiselle, laissant leurs chevaux, déséquipés et libres, sur les prés de la rive, montèrent dans la barque.
Sans gouvernail et sans pilote, la blanche nef savait où elle devait aller. Elle s’éloigna du rivage, vira vers la haute mer, et là, la voile gonflée, se mit à filer vertigineusement. Cependant les trois chevaliers se racontaient leurs aventures. Quant à la jeune fille, elle se fit connaître d’eux afin, dit-elle, qu’ils eussent plus de confiance en ses paroles : et sachez que c’était la sœur de Perceval.
Dans l’après-midi, vers l’heure de none, ils virent qu’ils allaient droit sur une île déserte ; bientôt après ils y abordaient, au fond d’un bras de mer qu’enserreraient deux longues pointes rocheuses.
« En ce lieu sauvage, leur dit la jeune fille, est l’aventure pour laquelle le Maître nous a réunis. »
En effet, quand ils eurent gravi l’escarpement de la rive, ils découvrirent un autre golfe qui ne communiquait pas avec le premier : un vaisseau y était accosté, beaucoup plus grand et magnifique que leur barque. Ils s’en approchèrent. Sur le bordage, une inscription en lettres antiques disait : « Que nul n’entre ici s’il n’est plein de foi et pur de toute vilenie. »
Sans une hésitation Galaad y entra, suivi de la jeune fille ; les deux autres, après un instant de réflexion, les imitèrent. Ils regardèrent en tous sens, visitèrent le vaisseau de l’avant à l’arrière : nul être vivant. Mais au centre ils avaient trouvé un lit tout couvert d’une somptueuse étoffe. Galaad la souleva : le lit était d’une richesse inouïe ; une couronne d’or était posée au chevet, et au pied une épée à demi tirée du fourreau.
Le pommeau de cette épée était d’une seule gemme mais qui avait en soi toutes les couleurs qu’on peut voir sur la terre ; et chacune de ces couleurs possédait une vertu particulière. La poignée était faite d’os tirés de deux bêtes très étranges : l’une, un dragon, ne vit que dans les monts sauvages de Calédonie, l’autre converse aux rives de l’Euphrate. Et telle était la vertu de cette poignée que quiconque la tenait n’avait garde de souffrance ou de fatigue, et perdait incontinent la mémoire de tout, hormis la chose pour laquelle il avait tiré l’épée. Mais sur le drap vermeil qui entourait la poignée était brodée cette inscription : « Un seul doit me saisir : tout autre qui le tentera sera châtié. » Au fourreau, qui était de cuir de serpent vermeil, pendaient de surprenantes attaches faites de grossières tresses de chanvre ; mais des lettres d’or, frappées dans le cuir du fourreau, annonçaient que le vrai baudrier de l’épée serait mis par une vierge, fille de roi, qui le ferait de ce qu’elle posséderait de plus beau.
Enfin, au-dessus du lit, trois pièces de bois taillées en colonnettes faisaient comme un portique dressé ; deux d’entre elles, fichées dans le bois du lit, l’une devant et l’autre derrière, s’érigeaient verticalement ; la troisième, placée en travers, était chevillée en l’une et en l’autre. La colonnette de devant était plus blanche que la neige fraîchement neigée ; celle de derrière avait la couleur du sang ; la troisième avait la couleur de l’émeraude. Et sachez que c’étaient les couleurs naturelles des bois et qu’aucune main humaine ne les y avait mises. Mais comme ces choses risqueraient d’être tenues par quelques-uns pour des fables, ici le conte se détourne un peu du droit chemin pour en raconter la merveilleuse histoire.

La légende de l’Arbre de Vie.
l est écrit au Livre véridique du Saint Graal qu’Ève la pécheresse, lorsqu’elle eut écouté le Démon, cueillit le fruit mortel de l’Arbre que le Créateur avait interdit, et que le rameau vint avec le fruit qui y pendait, ainsi qu’il arrive souvent. Et puis elle apporta ce fruit à Adam son époux, qui le détacha du rameau et le mangea, pour notre malheur et pour le sien. Il détacha le fruit et le mangea, et le rameau resta dans la main d’Ève, sans qu’elle s’en doutât : maintes fois on tient ainsi une chose en main et l’on n’y pense pas. Dès qu’ils eurent goûté de ce fruit, qu’il faut appeler mortel puisqu’il fit connaître la mort à la lignée humaine, leur nature changea ; et ils s’aperçurent soudain qu’ils avaient un corps et qu’ils étaient nus, eux qui auparavant étaient des substances spirituelles. Ils se regardèrent mutuellement, ils connurent la nudité, les parties honteuses ; et ils en furent remplis de confusion : c’était déjà une punition de leur faute. Lorsqu’ensuite Dieu, ayant vu leur péché, les chassa du Jardin de délices, Ève tenait toujours le rameau en main. Elle n’y prit garde qu’une fois dehors : il était encore frais et verdoyant, car il n’y avait pas longtemps qu’il avait été cueilli, et cependant la destinée de l’homme par lui était déjà changée. Alors elle déclara qu’en souvenir de la grande mésaventure qui leur était venue de cet Arbre, elle en garderait le rameau autant qu’elle le pourrait. Mais elle n’avait ni huche ni étui, car en ce temps-là il n’existait rien de semblable : elle le planta donc en terre ; et par la volonté du Créateur à qui toutes choses obéissent, il y reprit racine.
Ce rameau qu’Ève la Pécheresse portait en arrivant sur la terre était un beau symbole : il signifiait joie et liesse ; comme si, s’avançant vers les hommes des temps futurs, Ève leur eût dit : « Ne vous affligez pas si nous sommes dépossédés de notre splendide héritage : un jour viendra où nous y rentrerons. »
Le rameau planté en terre crût si bien qu’en peu de temps il devint un arbre au vaste ombrage : et branches et feuilles, et le tronc même, tout en lui était blanc comme neige.
Un jour Adam et Ève étaient assis sous cet arbre : et Adam, l’ayant contemplé, se mit à déplorer la douleur de l’exil. Tous deux pleurèrent tendrement l’un pour l’autre. Et Ève dit qu’ils ne devaient pas s’étonner s’ils avaient en ce lieu souvenance de douleur, car l’Arbre la portait en soi ; et nul ne pourrait jamais s’y asseoir, si joyeux fut-il, sans en repartir triste jusqu’à la mort ; c’était l’Arbre de Mort. Or à peine avait-elle prononcé ces paroles que du haut des cieux une voix leur dit « Ô chétifs ! pourquoi parlez-vous ainsi de la mort ? Ne préjugez pas du destin, mais revenez à l’espérance et réconfortez-vous l’un l’autre, car la Vie triomphera de la Mort, sachez-le. »
La voix divine leur avait rendu la joie ; ils appelèrent dès lors le bel arbre, l’Arbre de Vie, et voulurent le multiplier. Or toutes les fois qu’ils en prenaient un rameau et le plantaient en terre, il s’y enracinait et croissait aussitôt, tout en gardant la couleur blanche du premier.
Adam et Ève venaient maintenant se reposer sous l’Arbre de Vie plus volontiers qu’en aucun autre lieu. Un jour qu’ils s’y trouvaient, ― la vraie histoire dit que c’était un vendredi, ― la voix divine leur ordonna de s’unir comme l’époux s’unit à l’épouse. Et comme ils n’osaient, par vergogne, une obscurité profonde les enveloppa… C’est ainsi qu’Abel le Juste fut engendré un vendredi sous l’Arbre de Vie. Et quand l’obscurité se dissipa, Adam et Ève virent une grande merveille : l’Arbre naguère blanc était maintenant verdoyant comme herbe de pré. À partir de ce moment il se mit à fleurir et à porter des fruits, ce qu’il n’avait jamais fait auparavant ; et les boutures qu’ils en tirèrent furent également vertes et fertiles.
Il en fut ainsi jusqu’au temps où Abel devint un homme. Abel était pieux, aimait son Créateur, et lui offrait pour dîmes et prémices les plus belles choses qu’il possédait. Son frère Caïn, au contraire, ne donnait à Dieu que ce qu’il avait de plus vil. Aussi la grâce de Dieu était sur Abel : du tertre où il avait accoutumé de brûler ses offrandes, la fumée de son sacrifice montait droit vers le ciel, belle et claire et d’odeur suave ; mais la fumée de Caïn se traînait sur les champs, laide et noire et puante.
Caïn en conçut contre son frère une haine démesurée et, sans en rien laisser paraître, décida de le tuer. Or un jour Abel s’en alla aux champs avec son troupeau. Les brebis s’arrêtèrent auprès de l’Arbre de Vie, qui était assez éloigné du manoir d’Adam. Le jour était très chaud ; Abel alla s’asseoir à l’ombre de l’Arbre et s’y endormit. Caïn, qui l’avait épié, s’approcha, le salua et puis le tua de son couteau courbe. Ainsi mourut Abel de la main de son frère, au lieu même où il avait été conçu ; et le jour de sa mort, comme celui de sa conception, fut un vendredi, selon le Livre qui ne ment point.
Dès la mort d’Abel, l’Arbre de Vie devint tout vermeil, de la couleur du sang qui dessous avait été versé ; et depuis il ne put ni se multiplier, ni porter fleur et fruit ; pourtant il restait le plus bel arbre du monde. D’âge en âge il embellissait encore ; les descendants d’Adam venaient s’y réconforter et y reprendre l’espérance du Paradis perdu.
Survint le Déluge. Tout fut sur terre abîmé et gâté ; jamais plus les fleurs ni les fruits ne retrouvèrent leur douceur première. Seuls, l’Arbre de Vie et tous ceux qui en provenaient étaient intacts.
Ils durèrent en cet état jusqu’au temps du roi Salomon. Salomon possédait toute la science dont un mortel soit capable ; il connaissait les vertus des gemmes et la force des herbes, le cours des étoiles et toute l’ordonnance du firmament. Et pourtant son savoir ne l’empêchait pas d’être victime des ruses de sa femme, chaque fois qu’elle voulait s’en donner la peine. Ceci du moins n’est pas merveille : quand une femme veut employer son talent à la tromperie, nulle sagesse d’homme n’y peut résister : et il en est ainsi depuis nos premiers parents.
Quand il comprit son impuissance contre les ruses de la femme, Salomon fut rempli d’amertume. C’est pourquoi, en son livre des Paraboles, il écrivit ceci : « J’ai, dit-il, fait le tour de l’univers, et j’ai cherché en tous sens, avec toute la sagesse concédée à un mortel ; et je n’ai pas trouvé une femme au cœur pur. » Une nuit qu’il se demandait pourquoi la femme fait si volontiers le tourment de l’homme, une voix lui répondit : « Salomon, Salomon, si de la femme vint et vient encore aux hommes tant de tristesse, ne t’en afflige pas, car une femme leur apportera un jour cent fois plus de joie, et cette femme naîtra de ton lignage ! »

Salomon étudia et scruta si bien les temps futurs qu’il y découvrit la venue de la Vierge ; et il apprit aussi que sa postérité ne s’arrêterait pas à elle, mais à un chevalier vierge qui passerait tous les autres en prouesse.
Il chercha alors le moyen de faire connaître à cet ultime descendant qu’il avait su quelque chose de lui. Si longtemps il y réfléchit que sa femme s’en aperçut ; et, ayant choisi son moment, elle lui tint ce propos :
« Sire, depuis plusieurs semaines vous avez beaucoup médité : votre esprit n’était jamais en repos. Je vois donc bien que vous pensez à une chose dont vous ne pouvez venir à bout. Je voudrais savoir ce que c’est, car il n’y a, je crois, rien au monde dont nous ne puissions avoir raison, en alliant votre sagesse à ma subtilité. »
Salomon pensait bien, en effet, que si une créature humaine était capable de le tirer d’embarras, c’était elle. Il lui dit donc son souci. Après un moment de réflexion, ― Savez-vous, lui demanda-t-elle, combien de temps s’écoulera jusqu’à la venue de ce chevalier ?
― Deux mille ans au moins.
― Eh bien, voici ce qu’il faut faire. Faites construire un vaisseau du meilleur bois et du plus durable qui se puisse trouver.
― C’est chose facile, répondit Salomon.
Le lendemain il fit venir tous les charpentiers de son royaume et leur commanda de construire le plus beau des navires, et d’un bois tel qu’il ne pût jamais pourrir. Les charpentiers aussitôt allèrent choisir leurs bois et mirent le navire en chantier. La femme de Salomon lui dit encore :
― Sire, puisque ce chevalier doit passer en prouesse tous ceux qui avant lui auront été et qui après lui viendront, ne conviendrait-il pas de lui préparer quelque arme aussi excellente que lui-même ?
― Oui, mais où la prendre ? demanda Salomon.
― Je vais vous le dire. Dans le temple que vous avez bâti en l’honneur de votre Dieu est l’épée du roi David votre père : c’est la plus tranchante qui ait jamais été forgée ; prenez-la, ôtez-en la poignée, et vous, qui connaissez les vertus des pierres, des herbes et de toutes les choses terrestres, mettez à cette lame incomparable une poignée et un pommeau dignes d’elle. Faites ensuite un fourreau aussi merveilleux que le reste ; et quand tout sera terminé, j’y mettrai moi, des attaches de ma façon.
Salomon exécuta tout ce que sa femme avait dit, et fit l’épée telle que le livre l’a décrite. Quand la nef fut achevée et lancée, la reine y fit dresser un lit somptueux avec force courtepointes. Au chevet le roi plaça sa couronne et au pied il voulut mettre l’épée. Mais quand sa femme la lui rapporta, il vit qu’elle y avait mis pour attaches des cordes d’étoupe. Et comme il s’irritait :
― Sire, sachez que je n’ai rien d’autre qui soit digne de soutenir une telle épée.
― Que ferons-nous donc ?
― Si vous m’en croyez, vous la laisserez ainsi. Il n’appartient pas à nous de parfaire cet ouvrage, une vierge le fera un jour, dans le lointain avenir où mon esprit se perd…
Salomon laissa donc l’épée telle qu’elle était, et fit couvrir le lit d’un drap de soie qui n’avait garde de pourrir.
― Est-ce tout ? demanda-t-il à sa femme. Elle examina le lit, la nef :
― Non, il y manque encore quelque chose, dit-elle.
Elle partit avec deux charpentiers et les mena à l’Arbre où Abel avait été tué. Là elle leur dit :
― Coupez-moi, de cet arbre, de quoi faire une colonnette.
― Ha ! Madame, nous n’oserions, répondent-ils ébahis. Ne savez-vous donc pas que c’est l’Arbre que notre première mère Ève a planté ?
― Il faut, répliqua-t-elle, que vous obéissiez, ou bien je vous ferai détruire.
Ils se résignèrent alors et attaquèrent l’Arbre. Mais à peine l’avaient-ils touché qu’ils s’enfuyaient épouvantés, car de l’Arbre coulaient des gouttes de sang. Elle les y ramena de force, et qu’ils le voulussent ou non, ils durent en couper de quoi faire une colonnette. Ensuite elle leur fit de même prendre du bois d’un des arbres verts et d’un des arbres blancs. Et l’on revint vers la nef. Elle fit façonner en colonnettes les trois pièces de bois qu’ils avaient rapportées et les fit placer ainsi qu’il a été dit.
La nef achevée, Salomon la considéra :
― Tu as accompli une œuvre prodigieuse, dit-il à sa femme : si le monde entier venait ici la contempler, personne n’en saurait dire la signification : et toi-même, qui l’a faite, tu l’ignores. Mais, malgré tout, le dernier de mes descendants n’apprendra pas ici que j’ai connu sa venue, à moins que Dieu même n’en prenne soin.
― Laissez cela, Sire ; vous en aurez bientôt d’autres nouvelles, si mon pressentiment ne me trompe.
Ce soir-là Salomon fit dresser sa tente près du rivage où la nef était amarrée. La nuit, tandis qu’il dormait il eut une vision. Du haut des cieux descendait un homme, suivi d’un long cortège d’Anges : il entrait dans le navire, et avec de l’eau qu’un ange lui présentait dans un seau d’argent, il l’aspergeait de l’avant à l’arrière, puis, de son doigt qui semblait un rayon ardent, il traçait des inscriptions sur l’épée, sur le bordage du navire ; enfin il s’étendait sur le lit. Et puis Salomon ne le voyait plus, ni lui ni son escorte d’anges, tout s’évanouissait…
Dès son réveil, à la pointe de l’aube, Salomon courut au vaisseau. Sur le bordage il vit dans l’ombre briller ces mots : « Que nul n’entre ici s’il n’est plein de foi et pur de toute vilenie ! » Il recula d’étonnement. À ce moment les amarres se rompirent d’elles-mêmes et le vaisseau, poussé par une force invincible, fila vers le large, si vite qu’il fut hors de vue en quelques instants.
Salomon était resté sur la rive et méditait, cependant que sur lui, sur la mer où s’envolait la Nef symbolique, sur les terres où il gouvernait le peuple de Dieu, le matin versait sa lumière d’espérance. Et il entendit une voix qui lui disait : « Salomon, le dernier de tes descendants se reposera dans le lit que tu lui as préparé, et il saura comment tu l’as fait. »
Plein de joie, Salomon retourna vers les tentes, éveilla sa femme, ses compagnons, et leur conta son aventure. Et il fit savoir à tous, familiers ou étrangers, comment des conseils de femme l’avaient tiré d’une entreprise où sa science était impuissante.
Ainsi finit l’histoire de la Nef et de l’Arbre de Vie.
L’Épée.
i les chevaliers ni leur compagne ne pouvaient se lasser de contempler la Nef, et le Lit, et l’Épée. À la fin Perceval, ayant soulevé le drap de soie qui couvrait le lit, vit une riche aumônière qui renfermait un parchemin couvert d’écriture. Il le tendit à Bohort, qui savait lire : c’était l’histoire de la construction de la Nef. Ils écoutèrent en grande émotion l’antique et vénérable récit.
― Mais, dit Bohort, il nous faut maintenant chercher la jeune fille qui doit achever l’équipement de l’Épée. Et où la trouver ?
― Vous n’aurez pas à aller bien loin, répondit leur compagne.
Et d’un coffret qu’elle avait apporté elle tira un baudrier fait de cheveux tressés avec des fils de soie et d’or ; et si blonds et si fins étaient les cheveux qu’on avait peine à les distinguer de l’or et de la soie. Des pierres précieuses y étaient serties et les boucles étaient d’or.
― Seigneurs, dit la jeune fille, voici ce qui manquait à l’Épée. Ainsi que le requiert l’inscription du fourreau, j’ai fait ces tresses de ce que je possédais de plus cher, mes cheveux. Car j’avais bien, naguère, la plus jolie chevelure qu’on pût voir, et, seigneur Galaad, je la fis couper pour l’amour de vous, ce même jour de Pentecôte où vous parûtes à la Table Ronde.
― Ô mon amie, dit Galaad avec émotion, pour ce sacrifice le veux être à jamais votre chevalier.
Ce fut elle qui lui ceignit l’Épée du roi David, qui depuis si longtemps l’attendait. On donna à Perceval celle que Galaad avait portée jusque-là. Puis, sur le conseil de la jeune fille, ils quittèrent le vaisseau de Salomon pour retourner à leur barque.
Toute la nuit ils naviguèrent, ne sachant s’ils étaient en haute mer ou près des terres. Au jour ils se trouvèrent le long d’un rivage profondément découpé ; un grand et sombre château se dressait devant eux : ils reconnurent l’Écosse et le château Carcelois.
― Nous arrivons mal, dit la sœur de Perceval : si l’on apprend que nous sommes de la maison du roi Artus, on va se jeter sur nous, car notre maître est ici férocement haï.
― Qu’importe ? dit Galaad.
Et, sautant de la barque, il alla droit vers l’entrée du château. Les autres le suivirent.
Dès qu’il eut passé la porte, un valet parut :
― Seigneurs chevaliers, qui êtes-vous ?
― Nous sommes, répond Galaad, de la maison du roi Artus.
― Par mon chef, vous tombez mal !
Il retourne vers la citadelle, et presque aussitôt on entend un appel de cor résonner à travers tout le château. Galaad continue d’avancer.
Quelques pas plus loin une jeune fille accourut et cria :
― Ah ! Seigneurs, pour Dieu retournez si vous pouvez, car vous allez à la mort ! Retournez, retournez, avant qu’on ne vous surprenne ici !
― Je ne retourne jamais sur mes pas, répondit tranquillement Galaad.
Mais la troisième rencontre qu’ils firent fut d’une autre sorte : ce fut celle d’une dizaine de cavaliers qui dévalaient au galop la grand’rue du château en criant : « Rendez-vous ! » Les trois compagnons, bien qu’à pied, acceptent le combat. En un instant Perceval et Galaad jettent chacun un des cavaliers à terre, prennent leurs chevaux, et courent sus aux autres. Ils ont bientôt un cheval à donner à Bohort, et les assaillants, se voyant si rudement malmenés, tournent bride. Les autres les poursuivent, s’engouffrent derrière eux dans la forteresse principale, pénètrent jusqu’à la grand’salle. Elle était pleine de chevaliers et de sergents qui s’armaient, ayant entendu l’appel du cor. Les trois compagnons fondent sur eux, frappent, taillent, abattent, piétinent le troupeau confus et épouvanté. Galaad surtout les terrifie ; ils croient voir sa stature grandir, grandir de plus en plus ; son épée jette des éclairs surnaturels. Ce n’est pas un homme, s’écrient-ils, c’est un Esprit !… C’est l’Ange exterminateur !
Affolés, les survivants s’écrasent aux portes, sautent par les fenêtres et se fracassent contre le pied des hautes murailles.
Le silence. Seuls debout dans la vaste salle, les trois héros contemplent leur carnage. Que de morts étendus ! Que de sang versé ! Galaad lentement enlève son heaume ; autour de son beau visage penché, ses cheveux blonds descendent en deux bandeaux ondulés. Il murmure :
― Le Père avait dit : Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu’il s’amende et qu’il vive. Hélas ! qu’avons-nous fait !
― Mais, seigneur, répond Bohort, Dieu ne les avait haïs, eût-il permis leur massacre ? D’aventure c’étaient des mécréants qu’Il a châtiés par nos mains !
― Ce n’est pas aux hommes, riposte Galaad, à venger le Maître. Jamais plus je n’aurai la paix du cœur, tant que je ne saurai pas si nous avions le droit d’agir ainsi.
Tandis qu’ils parlaient, un prêtre parut au fond de la salle, vêtu de blanc, le calice à la main. En voyant les cadavres, le sang éclaboussé partout, il fit un mouvement d’effroi. Galaad s’avança, le rassura, puis lui conta toute l’aventure et lui dit son angoisse.
― Oh ! répondit le prêtre, soyez certains que vous n’avez jamais fait d’œuvre meilleure. C’étaient des bandits pires que les Sarrasins, et Dieu vous saura gré de les avoir détruits. Le seigneur de ce château était le vieux comte Ernout. Il avait trois fils et une fille fort belle. Les trois frères s’éprirent d’amour criminel pour leur sœur, la violèrent et, parce qu’elle fit sa plainte au comte, ils la tuèrent. Ensuite ils jetèrent leur père en prison et se livrèrent à leur fureur, massacrant prêtres, moines, abbés, abattant des chapelles commettant des forfaits sans nombre. On s’étonnait qu’ils ne fussent pas encore anéantis du feu du ciel. Quant au comte, il n’a cessé d’espérer la venue d’un Vengeur ; il est à l’agonie, et j’allais, seigneurs, l’aider à bien mourir. »
Galaad fit tirer de la prison le vieux seigneur et le fit porter au palais. Il était près d’expirer
« Ô chevalier, dit-il, soyez le bienvenu ! Nous vous avons si longtemps attendu ! Je vous en prie, prenez-moi dans vos bras, sur votre cœur, afin que mon âme quitte mon corps dans la joie ! »
Galaad l’ayant pris contre sa poitrine, il s’inclina comme un que la mort tient déjà, et au bout de quelques instants il entra dans le Repos.
La lépreuse.
es trois chevaliers et leur compagne reprirent leurs courses aventureuses. Quelques jours plus tard, ils furent assaillis sur la route par des hommes armés qui tentèrent d’enlever la sœur de Perceval. C’étaient les gens d’un château voisin, où l’on avait coutume d’exiger de toutes les jeunes filles qui passaient une pleine écuelle de sang. Il s’ensuivit une bataille furieuse des trois compagnons contre tout ce que le château renfermait de chevaliers. Malgré des prodiges de vaillance ils ne purent venir à bout d’adversaires qui se renouvelaient continuellement. Aussi, lorsqu’au soir un vieillard, s’avançant au milieu de la mêlée, vint leur proposer une trêve, ils l’acceptèrent. Ils furent hébergés avec grande courtoisie par leurs adversaires et leur demandèrent la raison de cette cruelle coutume.
« Notre dame, leur répondit-on, souveraine de ce château, de maint autre et de tout un vaste pays, languit depuis deux ans de la lèpre. Elle a fait venir tous les médecins connus, en vain ; seul un vieillard un jour nous a dit qu’elle guérirait si elle pouvait laver ses plaies dans le sang d’une vierge parfaitement pure, et qui fût fille de roi. Depuis, nous arrêtons toutes les jeunes filles qui passent. Seigneurs, vous savez maintenant la cause de notre coutume ; vous agirez comme il vous plaira. »
La sœur de Perceval tira alors à l’écart ses compagnons et leur dit :
― Ainsi cette femme souffre un martyre affreux ; je l’en puis tirer si je veux, et si je veux elle en mourra. Dites-moi ce que je dois faire.
― Mais, dit Galaad, vous-même, qui êtes faible et tendre, vous y succomberiez.
― Eh bien, j’aime mieux mourir de cette guérison que de laisser recommencer la bataille, qui ne peut finir sans la perte, bien plus déplorable, de beaucoup de vaillants hommes, sans la vôtre peut-être…
Très émus, ils ne savent que répondre. Élevant alors la voix, elle appelle les gens du château :
― Réjouissez-vous, votre bataille de demain est finie : demain je me soumettrai à votre coutume.
Tout le château est dans la joie, et les trois chevaliers sont traités avec plus d’honneur encore qu’auparavant.
Le lendemain on amena la lépreuse : son visage était si ravagé, si profondément rongé par le mal, qu’on se demandait comment elle pouvait vivre en de telles douleurs. Devant elle, la jeune fille présenta son bras à la lancette tranchante ; le sang jaillit et coula dans une écuelle d’argent.
« Madame, dit la jeune fille, voici que je suis à la mort venue pour votre guérison : priez pour moi ! »
Avec le sang sa vie s’écoule : elle se pâme. Puis, rouvrant les yeux à grand-peine, elle dit à Perceval :
« Cher frère, je me meurs. N’enfouissez pas mon corps en cette terre étrangère ; mais déposez-le en une nacelle que vous abandonnerez aux flots. Le Saint Graal me guidera et nous réunira un jour, j’en ai la certitude. Mais écoutez mes dernières paroles. Par moi le Haut Maître vous ordonne de vous séparer et d’aller, chacun suivant sa voie, vers le château de Corbenic, où seul le hasard peut vous conduire et vous rassembler. »
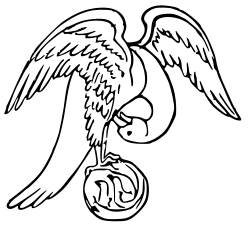
Puis son cœur s’évanouit de nouveau, et elle expira.
Ainsi mourut, en un sacrifice volontaire et sanglant, la pure vierge qui avait achevé l’œuvre millénaire commencée par Ève la pécheresse, et que le sage Salomon lui-même n’avait pu accomplir.
Les trois compagnons, pénétrés de douleur, lui firent des funérailles magnifiques ; ils firent embaumer son corps aussi précieusement que si ce fût le corps de l’Empereur. Selon son désir ils la couchèrent sur un beau lit dans une nef. Au chevet du lit Perceval mit un écrit qui disait ce qu’était cette morte et les aventures qu’elle avait aidé à achever. Puis ils poussèrent la nef vers la haute mer ; et ils la suivirent des yeux jusqu’à ce qu’elle eût été entraînée par les jeux divins des vagues.

