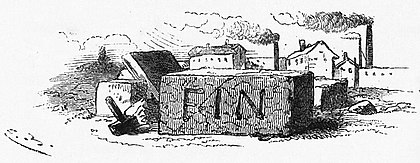Le Mauvais Génie (Comtesse de Ségur)/28

Un jour qu’il visitait un des hôpitaux français, en traversant une des salles, il s’entendit appeler ; il approcha du lit et reconnut Frédéric ; mais ce n’était que l’ombre du vigoureux soldat qu’il avait quitté deux ans auparavant. Maigre, pâle, affaibli, Frédéric pouvait à peine parler. Il saisit la main de son ancien défenseur et la serra dans les siennes.
Quoi tu avais, malheureuse ? Toi étais ici dans l’hôpital ?
J’y suis depuis trois mois, Monsieur ; je suis bien malade de la fièvre, qui ne veut pas me quitter. Si je pouvais changer d’air, retourner au pays, il me semble que je guérirais bien vite.
Il fallait, mon brave Fridric ; il fallait.
Mais je ne peux pas, Monsieur ; c’est difficile à obtenir, et je ne connais personne qui puisse faire les démarches nécessaires.
Et lé brave colonel ?
Le régiment a été envoyé à Napoléonville, Monsieur. J’en suis bien loin.
Et quoi tu es ? brigadier toujours ?
Non, Monsieur, je suis maréchal des logis et porté pour la croix ; mais je crains bien de ne jamais la porter.
La croix ! Maréchal des logis ! C’était joli ! très joli ! Maréchal des logis et la croix à vingt et un ans ! Jé démandais pour toi ; jé obtiendrai ; jé t’emmener avec moi ! Jé té mener à Madme Bonarde. »
Frédéric lui serra les mains ; son visage rayonna de bonheur. Il le remercia chaudement.
Huit jours après, M. Georgey lui apportait un congé d’un an. Il s’occupa ensuite du passage sur un bon bâtiment et des provisions nécessaires pour le voyage. Quinze jours plus tard, M. Georgey et Frédéric débarquaient à Toulon. Ils n’y restèrent que vingt-quatre heures, pour y prendre quelque repos. Frédéric écrivit à sa mère pour lui annoncer son arrivée avec M. Georgey.
Trois jours plus tard, ils entraient dans la ferme des Bonard. L’entrevue fut émouvante. Mme Bonard ne pouvait se lasser d’embrasser, d’admirer son fils et de remercier M. Georgey. Le père ne se lassait pas de regarder ses galons de maréchal des logis. Julien était tellement embelli et fortifié qu’il était à peine reconnaissable. Frédéric fut beaucoup admiré ; il avait grandi d’une demi-tête ; il avait pris de la carrure ; ses larges épaules, son teint basané, ses longues moustaches lui donnaient un air martial que Julien enviait.
« Et moi qui suis resté de si chétive apparence ! dit Julien en tournant autour de Frédéric.
Tu te crois chétif ? Mais tu es grandi à ne pas te reconnaître. Pense donc que tu n’as que dix-sept ans. Tu es grand et fort pour ton âge.
Le fait est qu’il nous fait l’ouvrage d’un homme. Et toujours prêt à marcher ; jamais fatigué.
— Pas comme moi à son âge », dit Frédéric en souriant.
Il devint pensif ; le passé lui revenait.
Allons, maréchal des logis, pas parler dé dix-sept ans. Parlé dé vingt-deux, c’était plus agréable. Voyez, papa Bonarde, combien votre garçon il était superbe. Et ses magnifiques galons ! Et moi qui voyais arriver lé galons sur mon toit.
Comment, sur votre toit ? Quel toit ?
C’était lé toiture du colonel. Jé voyais dé mon lunette. Il sé battait furieusement ! C’était beau ! magnifique ! Fridric il tapait sur les Mauricauds ! Les Mauricauds, ils tombaient, ils tortillaient. C’étaient lé serpents contre les lions. Et Fridric était après brigadier. Et une autre combattement, il était maréchal des logis. »
Frédéric voulut changer de conversation, mais M. Georgey revenait toujours aux batailles, aux traits de bravoure, aux hauts faits de Frédéric ; le père était tout oreille pour M. Georgey ; la mère était tout yeux pour son fils.
Quand on eut bien causé, bien questionné et bien dîné, quand Frédéric eut bien fait connaître ce qu’il devait à son excellent protecteur, sauf l’affaire du conseil de guerre que M. Georgey l’avait engagé à ne confier qu’à sa mère, Bonard voulut faire voir son maréchal des logis dans le bourg. Il lui proposa d’aller chez M. le curé.
Et aussi, jé voulais avoir lé logement pour moi. Quoi faisait Caroline ?
Votre logement est tout prêt, Monsieur ; nous avons une belle chambre pour vous à la ferme ; grâce aux douze mille francs que vous avez laissés à Julien, grâce à votre générosité envers lui et envers nous, nous avons bien agrandi et amélioré la maison. Si vous désirez avoir Caroline, elle viendra très volontiers ; elle est chez sa mère, elles font des gants.
Oh ! yes ! Jé voulais très bien. Jé voulais voir mon logement chez vous. »
M. Georgey fut promené dans toute la maison. Il y avait en haut deux grandes et belles chambres ; Julien en avait une près de lui ; il en restait deux, pour Caroline et pour quelque autre visiteur. En bas demeuraient Bonard et sa femme et Frédéric.
En redescendant dans la salle, Frédéric jeta un regard furtif du côté de l’ancienne armoire brisée ; il vit avec une vive satisfaction qu’elle n’y était plus. M. Georgey, après le départ de Frédéric, avait acheté un beau dressoir-buffet qui avait remplacé l’armoire fatale, brûlée par son ordre.
Pendant plusieurs jours Bonard triomphant mena son fils chez toutes ses connaissances et dans la ville, où il cherchait tous les prétextes possibles pour le faire passer devant la demeure des gendarmes ; les galons de Frédéric lui valaient le salut militaire des simples gendarmes et une poignée de main du brigadier. Le père saluait avec son fils et s’arrêtait volontiers pour causer et dire un mot des combats racontés par Georgey.
Frédéric ne voulut pourtant pas rester oisif : il travailla comme Julien et son père ; ce fut pour Bonard un avantage réel ; il ne prenait plus d’ouvrier, tout le travail se faisait entre eux.
Caroline, qui était rentrée avec joie chez son ancien maître, aidait Mme Bonard dans les soins du ménage et ceux du bétail.
M. Georgey vivait heureux comme un roi, entouré de gens qu’il aimait et qui éprouvaient pour lui autant d’affection que de reconnaissance. Il résolut de se fixer dans le pays. Il acheta tout près des Bonard une jolie habitation au bord d’une rivière très poissonneuse où il pouvait se donner le plaisir de la pêche, et dont il voulut profiter pour y établir une usine. Caroline devint sa femme de ménage sous la direction de sa mère, qui était entrée avec elle au service de M. Georgey.
La fin du congé de Frédéric approchait, il ne restait plus que trois mois de cette bonne vie de famille ; il regrettait souvent de ne pouvoir la continuer jusqu’à la fin de sa vie.
« Mais, disait-il, il faut que je fasse mon temps ; j’ai encore trois années de service. »
Mme Bonard pleurait ; Frédéric cherchait à la distraire, mais plus le moment approchait, plus la tristesse augmentait, et plus Frédéric se sentait disposé à la partager.
« Ah ! si j’avais dix-huit ans, disait Julien, comme je partirais à ta place ! Et avec quel bonheur je vous donnerais à tous ce témoignage de ma reconnaissance.
Tu aimerais donc la vie de soldat ?
Non, pas à présent. Mais si c’était pour t’en débarrasser, je l’aimerais plus que tout autre état. »
M. Georgey ne disait rien ; quelquefois il vantait l’état militaire.
« C’était si magnifique ! disait-il. C’était si glorieux ! »
Un jour, au moment du dîner, M. Georgey présenta une lettre à Frédéric.
C’était lé colonel ; il demandait lé nouvelles de ta santé.
Que c’est bon à lui ! Excellent colonel !
Qu’est-ce qu’il te dit ? Lis-nous cela.
« Mon cher Bonard, je t’expédie ta libération du service et la croix que tu as si bien gagnée. Je veux te donner moi-même cette bonne nouvelle et te dire que je te regrette, toi qui étais une des gloires du régiment ; tes chefs et tes camarades te regrettent comme moi. Mais puisque le médecin déclare, d’après ce que me dit Georgey, que tu ne peux retourner en Afrique sans danger pour ta vie, je n’hésite pas à t’accorder ta libération du service. La voici bien en règle. Adieu, mon ami ; j’espère bien te revoir en pékin un jour ou l’autre.
Frédéric eut de la peine à aller jusqu’au bout ; la joie, la surprise, la reconnaissance lui étranglaient la voix. Quand il eut fini, il regarda M. Georgey qui souriait, et, se levant, il prit une de ses mains, la serra vivement et la porta à ses lèvres. Il voulut parler, mais il ne put articuler une parole ; de grosses larmes coulaient de ses yeux. M. Georgey se leva, le serra dans ses bras,
C’était rien ; ce était rien ! Jé n’avais pas beaucoup de peine à faire lé chose. Seulement, j’avais fait dé écritures. Madme Bonard, il était bien joyeux.
Oh ! Monsieur ! notre cher et respectable bienfaiteur ! Comment vous remercier ? Que faire pour vous témoigner notre reconnaissance ?
Il fallait être bien heureuse et puis donner un pitit portion amitié pour le pauvre Georgey tout seul, sans famille.
— Nous serons toujours vos plus sincères amis, vos serviteurs dévoués ; nous vous ferons une famille, cher, excellent bienfaiteur, répondit Mme Bonard en se jetant à ses genoux. Vous avez rendu le fils à sa mère. La mère n’oubliera jamais ce qu’elle vous doit. »
La joie de Bonard était à son comble ; voir son fils décoré et sergent, le voir rester au pays et jouir sans cesse de sa gloire comblait tous ses vœux.
À partir de ce jour, ce fut un bonheur sans mélange ; jamais M. Georgey n’éprouva le désir de quitter ses amis et de reprendre ses anciennes relations. Il trouvait au milieu des Bonard tout
 |
La joie de Bonard était à son comble.
|
sentiments honorables, des goûts simples, une reconnaissance sans bornes.
Il a augmenté sa maison d’une jeune sœur de Caroline, bonne active et agréable ; elle a dix-neuf ans. Frédéric trouve en elle les qualités nécessaires au bonheur intérieur. Mme Bonard désire vivement l’avoir pour belle-fille. M. Georgey dit sans cesse des paroles qu’il croit fines et qui désignent clairement que ce mariage lui serait fort agréable. Frédéric sourit, Pauline rougit et ne paraît pas mécontente ; tout le monde s’attend à voir une noce avant deux mois.
Frédéric a vingt-quatre ans ; il aura du bien, il est beau garçon, religieux, laborieux. Depuis la mort de son mauvais génie, comme il appelait Alcide, il n’a jamais failli. Il sera bon mari et bon père, car il est bon fils, bon ami et surtout bon chrétien.
Julien compte passer sa vie près de ses bienfaiteurs, qui espèrent le garder toujours. Il parle souvent avec M. Georgey de l’avantage qu’il y aurait à profiter de la petite rivière qui traverse sa propriété, pour établir une fabrique de fil de fer et de laiton. M. Georgey ne dit pas non ; il sourit, il fait des plans qu’il explique à Julien, et ils passent des soirées entières à former des projets qui seront probablement exécutés bientôt.
P.-S. J’apprends que Frédéric est marié depuis huit jours, que M. Georgey a donné en présent de noces à Frédéric la somme de dix mille francs, et cinq mille à Pauline. Il a commencé à construire une manufacture dont il donnera la direction et les produits à pétite Juliène.
Ils sont tous aussi heureux qu’on peut l’être en ce monde.