Une femme m’apparut (1904)/16
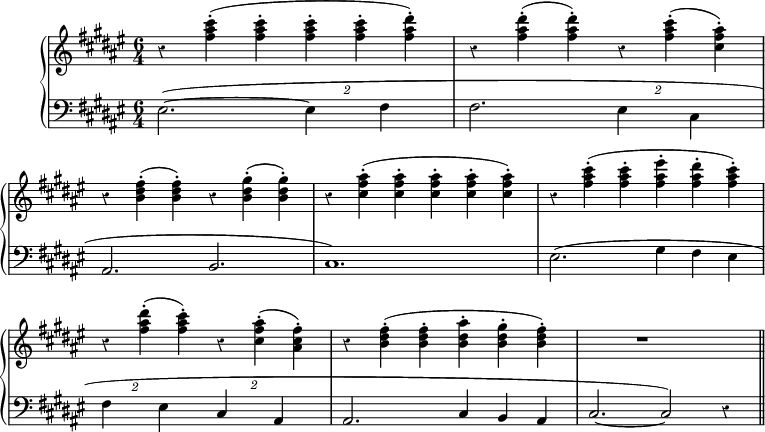
XVI
Vers la fin de l’hiver, je m’arrachai à la ville merveilleuse. Je revins à Paris, avec l’espérance lâche de revoir pour un instant la beauté fuyante de Vally.
La tristesse du printemps était en moi. La révolte des plantes jeunes contre la mort prochaine, l’effort inutile de la vie, m’oppressaient comme une souffrance. Que de souvenirs au cœur des renouveaux !
Je me promenais autour du Lac, les yeux vaguement charmés par les reflets des arbres sur l’onde, lorsqu’une voix limpide me fit tressaillir. C’était une amie de San Giovanni, Dagmar, une petite poétesse que j’avais admirée jadis pour son coloris délicat de vieux Saxe. Ses courts cheveux bouclés l’auréolaient d’une grâce enfantine. Ses yeux, d’un bleu puéril, s’ouvraient largement, comme extasiés d’un conte de fées. Elle semblait l’incarnation juvénile de mai.
« Comme vous êtes sombre, par ce beau soleil ! » sourit-elle de ses lèvres claires.
« La joie des autres attriste mon égoïsme, Dagmar. »
Elle me considéra, avec une compassion étonnée.
« Et Vally ? Vous étiez, il y a un an, son chien de garde, soit dit sans vous blesser.
— Oh ! ne craignez rien. J’ai toujours eu le culte de l’absurde. Je n’ai point oublié Vally : c’est Vally qui a perdu le souvenir de ma modeste existence.
— Vous avez dû beaucoup souffrir. Vous n’avez plus le même visage. Sans rides et sans cheveux blancs, vous donnez une impression de déclin et de vieillesse. J’ai eu un moment d’hésitation avant de vous reconnaître. Je suis très bonne, au fond, malgré mes joies légères d’enfant gâtée. J’écouterai le récit de vos peines, fût-il interminable. C’est le meilleur moyen de guérison. À force de parler d’une chose, on finit par s’en détacher, car on se lasse même de ses plus chères douleurs.
— Peut-être avez-vous raison, petite églantine d’avril. Mais vous m’effrayez un peu : vous ressemblez trop au matin.
— Le matin est parfois très doux, lorsqu’il se lève après une nuit de fièvre, » dit-elle. « Il ne faut pas redouter le matin. Je l’ai vu errer dans les bocages, pour voir si les roses rouges s’étaient ouvertes pendant la nuit. Et, d’un geste délicat infiniment, il apaisait la longue insomnie des fleurs de tabac, qui s’endormaient enfin une à une.
— Le sommeil… » murmurai-je. « Il y a si longtemps que je n’ai dormi d’un véritable sommeil. J’ai appris à aimer les insomnies qui m’apportent les pensées nocturnes, si différentes des pensées du jour, et la perception très nette des Présences Invisibles… Ione revient parfois pendant les longs silences des minuits. Sa robe florentine, sa robe de velours rouge sombre, semble un reflet de couchant au fond des ténèbres. Elle regarde ses mains pâles… Elle avait de si belles et de si douces mains, des mains de sœur et de Consolatrice. Mais ses yeux sont toujours baissés, et jamais elle ne murmure une parole.
— Ne pensez plus aux mortes. Let the dead bury their dead.
— C’est que je suis plus près des morts que des vivants, Dagmar… Que j’aime votre nom de fille du Nord ! un nom plus vigoureux que la brise marine, un nom frais et joyeux comme vous. Les noms de femmes sont parfois étrangement évocateurs. Les Maries ont toutes des paupières douloureuses ainsi que des violettes fanées. Les prunelles des Sibylles sont d’un bleu mystérieusement vague et se perdent dans l’au-delà. Les Éléonores sont pétries de musique et de parfums. Elles ont de profonds cheveux, où se sont effeuillés des daturas. Les Élisabeths sont étrangement impérieuses ; elles ont des regards tenaces comme le souvenir. Le sourire des Lucies est doux à l’égal d’une lueur stellaire. Il faut craindre les Faustines, perverses comme des magiciennes et cruelles comme des impératrices romaines. L’âme des Blanches a la pureté des lys expiatoires. Les Adélaïdes ont les lèvres tragiques des amoureuses prédestinées. Les Hélènes sont aussi belles que les statues.
— Voilà une vérité qui ne m’était point apparue. »
Elle s’arrêta.
« J’adore les contes de fées… Quand j’étais petite, mon cheval de bois m’emportait, coursier aux ailes fabuleuses, vers les lointains où les elfes prennent leur essor au clair de lune. J’ai gardé l’âme attentive d’une enfant qui s’étonne des récits merveilleux qu’on lui égrène par les longs soirs d’hiver.
— Vous êtes charmante, Dagmar. Je viendrai vous voir avec un grand plaisir. Pour votre étincellement, je renie mes solitudes. S’il est vrai que chaque être trouve son image dans le règne animal, vous ressemblez à un colibri.
— À quoi ressemblait Vally ? » demanda la petite curieuse, les yeux brillants.
« À un cygne sauvage. »
Une tristesse lourde ceignit mon front, ainsi qu’un bandeau de ténèbres.
« Vous êtes un être bien incompréhensible, » dit la petite poétesse, pour détourner le cours de mes imaginations. « Combien d’êtres avez-vous aimés sur cette terre ?
— J’ai aimé d’amitié, et ma sœur très blanche est morte. J’ai aimé d’amour, et ce fut le désastre. Aujourd’hui, Dagmar, j’aime la solitude.
— Eh bien vous la délaisserez pour moi. Venez chez moi demain, vous y retrouverez Éva, que vous avez surnommée la Déesse du Couchant, à cause des ors roux et bruns de sa chevelure.
— Je me souviens d’elle, en effet. Elle m’enchante, parce que, lumineusement jeune, elle incarne pourtant toutes les mélancolies de l’Automne. Ses cheveux sont comme une gloire autour de son front pâle. Elle a dû chérir d’une tendresse très douloureuse un passé dont elle n’ose se souvenir.
— Eh bien non ! vous ne la verrez pas. Vous parlez d’elle avec trop de ferveur. Je veux être l’unique idole de mon sanctuaire. »
Je cédai à ce caprice ingénu où je la retrouvais toute.
« Vos désirs sont les ordres solennels du Destin, Divinité Enfant. »
J’allai chez Dagmar le lendemain, un peu moins triste d’avoir vu cette fraîcheur de sourire. Elle avait revêtu une robe d’une fougue barbare. Elle aimait, comme les tout petits, ce qui chatoie et resplendit et s’irise, le printemps, l’arc-en-ciel et les opales. À son cou, un rang de grosses turquoises rondes semblait un collier de fillette sauvage.
« Regardez, » s’écria-t-elle de sa voix cristalline. « Le lilas vient de fleurir dans le jardin. Allons voir la vieille tortue, dont l’antique sagesse se recueille parmi les verdures. Elle est si attentive et si taciturne, qu’elle paraît écouter l’herbe croître et les racines s’enfoncer dans la terre… Parfois, elle me semble harmonieuse…
— Elle l’est sans doute, » répondis-je. « Hermès n’a-t-il point tiré la première lyre d’une écaille de tortue ? Et Psappha n’a-t-elle point dit « Viens, écaille divine, et, sous mes doigts, deviens mélodieuse ?… » J’ai la plus grande vénération pour les tortues. »
Le soleil dorait ses boucles d’enfant. Elle me sourit, et dans mon âme brûla soudain une farouche tendresse pour cet être de sève et de rosée. Je la désirai comme une eau bleue d’aurore.
Et l’envie cruelle de mordre ces lèvres naïvement offertes au baiser, de meurtrir cette chair d’églantines roses, devint si violente en moi, que je pris congé de Dagmar, brusquement.
Elle me dit, très simple
« À demain. »
Le soir, je parlai ainsi à mon âme grave qui me désapprouvait :
« Pourquoi reculer devant la certitude d’une joie et peut-être d’une consolation ? L’espoir est le léger fil qui seul nous guide à travers l’amer labyrinthe. Un fil si frêle, si ténu, si près de se rompre, mais peut-être le salut… Je pourrais boire cette eau bleue d’aurore. Je pourrais respirer cette gerbe d’églantines… Je verrais l’aube sans terreur, et toute la nuit je dormirais… »
À ce moment, je reçus une lettre de Vally :
Chose instable que ton cœur d’amant ! Je croyais que tu m’entrevoyais enfin, que nous pourrions suivre notre chemin commun en sécurité et en confiance. Lève les prunelles, vois mieux, contemple-moi telle que je suis. Ce morne aveuglement ne peut pas être, ne doit pas être ! Je te dis que c’est impossible. Je te le répète, les larmes aux yeux. Ah ! crains de les tarir, ces larmes, de me rendre incapable même de te pleurer ! En vérité, chaque être devient pareil à l’apparence que notre obstination se forme de lui. Crains de me rendre un jour aussi laide que l’image que tu le façonnes de moi. Crains à force de ne pas me comprendre, de me rendre incompréhensible. Crains, à force de me reprocher mes cruautés, de me rendre cruelle, à force de me blâmer de mon indifférence, de me pétrifier. Une pensée nous fait tant de mal, — et ce que tu penses de moi me fait plus de mal que tu ne te l’imagines, plus que je ne le sais moi-même.
Se peut-il que tout se soit ainsi consommé ? Se peut-il que disparaisse le toi que je m’imaginais, tout ce qu’il y avait de sincère et de passionné dans ton être ?
Ne chercheras-tu désormais que de banales amours, afin d’oublier la passion à laquelle tu sacrifiais toute ton existence ?
Tu n’étreins que pour trahir. Quant à moi, je n’ai jamais encore commis de trahison. En m’accusant de toutes les bassesses, crois-tu te rehausser ? En piétinant les Dieux brisés par tes mains, qu’espères-tu ? Leur grâce mutilée te hantera toujours. Jamais ton faux bonheur n’égalera le dégoût que tu auras de toi-même.
Ah ! t’avoir donné cette arme contre moi, ton lâche amour !
Que je sois perfide et froide, je te l’accorde mais alors pourquoi me prendre comme modèle, en me surpassant ? Tes lettres ne sont qu’un écho du toi aveugle et méchant d’avoir trop souffert…
Lorsque tu auras compris quelle erreur nous sépare, reviens auprès de moi…
Je sortis, en proie à toutes les tempêtes. Des iris bleus, que j’entrevis à une montre, m’évoquèrent la beauté fraîche de Dagmar. Je les lui envoyai, avec ces mots :
Des fleurs, plus belles que les contes de fées, pour une enfant qui n’aime que les contes de fées et les fleurs…
Toute la nuit, j’attendis fiévreusement l’approche de l’aurore. Elle vint enfin, laide et solennelle comme une nativité. Elle semblait redouter obscurément la vie inconnue. Mais que m’importait la tristesse de l’aube ? N’avais-je point en moi la lumière de l’espoir ?
Dans la crainte de la voir s’évanouir, je n’osai réfléchir à cette douceur nouvelle et si fragile. Je n’osai m’avouer à moi-même la joie incertaine qui me ravissait. Je n’osai aller vers la maison de Dagmar, et ce ne fut point avant le couchant que je trouvai le courage de frapper à sa porte.
Elle était debout sur le perron, les yeux hypnotisés par le couchant somptueux.
« Voyez ces nuages, » s’écria-t-elle. « Ils sont pareils à des rois très puissants et très pieux, qui apportent des vases d’or et des ciboires éclairés de pierreries afin de parer les autels.
— Vous êtes une princesse-fée, » lui dis-je, « une princesse qui chante en jouant avec les opales de son collier. Elle aime ses opales, qui sont des reflets d’arc-en-ciel entre ses doigts. En attendant le Prince inconnu, elle s’endort toutes les nuits aux sons d’une invisible harmonie que font murmurer autour d’elle ses rieuses petites sœurs, les Fées ! »
Dagmar, en égrenant ses opales, attisait capricieusement leurs flammes incertaines.
« Les opales… » murmura-t-elle. « Oh ! oui, je les aime. J’aime aussi les turquoises rondes et les saphirs.
— Les Hébreux nommaient le saphir : la plus belle chose, répliquai-je. Ce sont de merveilleux artistes… Le poème épique de l’Ancien Testament n’est surpassé par aucun autre poème. Le livre de Job frémit d’un souffle tragique dont la beauté stupéfie, comme un drame de Sophocle. J’ai la plus profonde admiration pour l’art douloureux de cette race d’exilés qui a su faire de l’univers sa patrie. Mais, surtout, me hantent les silhouettes orientales de Sarah, de Rébecca, de Rachel, de Bethsabée, de Tamar. L’orgueilleux éblouissement de Sarah fut tel qu’Abraham la fit passer pour sa sœur. Car il ne voulut point risquer sa vie en s’exposant à la jalousie qu’inspirerait la possession d’une telle magnificence. Rébecca nous apparaît, mirée éternellement dans un puits légendaire. Rachel fut si harmonieusement splendide que, pour l’avoir vue fouler aux pieds les lys rouges des champs, Jacob l’attendit sept années. En se baignant nue sur sa terrasse, Bethsabée fit naître le désir du meurtre dans l’âme de David, qui, pour l’élever jusqu’à son trône, fit tuer l’époux importun. Je vous rappelle ces idylles orientales, petite Dagmar, sachant que vous aimez les contes. »
Elle sourit de son joli sourire d’enfant perverse.
« Petite âme d’opale, vous avez dû écouter ingénument d’innombrables aveux, — des aveux murmurés par des soirs glorieux comme celui-ci, chuchotés, vers le crépuscule, ou sanglotés dans les ténèbres.
— J’ai eu beaucoup d’amoureux, oui.
— Et des amoureuses aussi, petite princesse. Car je vous ai entendue chanter :
For I would dance to make you’smile, and sing
Of those who with some sweet mad sin have played…
And how Love walks with delicate feet afraid
’Twixt maid and maid...
Vous avez dû cueillir cette chanson sur les lèvres passionnées d’une amie…
— J’aime l’amour des femmes et celui des hommes, » avoua-t-elle. « Je ne partage point le farouche exclusivisme de San Giovanni et de toutes les femmes qui, pour l’amour des femmes, haïssent et méprisent l’amour des hommes. Mais je préfère le plus souvent à la rude véhémence des hommes l’incomparable tendresse féminine. »
Je la considérai.
« Joli poème de porcelaine, de quels mots assez fluides vous dire ma reconnaissance ? Je revis, pour avoir rencontré sur ma route le rêve de Saxe que vous êtes. »
Elle souriait toujours, sans répondre. Je contemplai longtemps ses lèvres entr’ouvertes de rose sauvage.
« Voulez-vous, » dit-elle, « m’emmener voir les feux d’artifice qu’on tire cette nuit ? J’adore les fusées ambitieuses, la pluie d’étoiles tombantes et les arcs-en-ciel brisés.
— Petite princesse, le plus humble d’entre vos courtisans attend avec docilité vos ordres les plus futiles. »
Elle prit mon bras. Le frôlement de ce corps gracile m’enivrait. La conscience de ma force me grandissait à mes propres yeux. Je me sentais l’orgueil attendri de l’être qui domine et qui protège. J’aimais Dagmar d’être insoucieuse et frêle. J’aimais en elle l’enfant câline. Sa puérile perversité était un charme de plus, un charme de trouble et d’inquiétude.
… Une comète s’élança vertigineusement vers l’abîme nocturne. Elle montait, éperdue, jusqu’aux plus lointaines Pléiades. Les yeux de Dagmar la suivirent, étonnés et ravis, de larges yeux d’enfant… Puis, ce fut un bruit d’explosion, et une retombée de rayons d’azur.
« Oh » soupira Dagmar, « la neige d’astres bleus ! Les vois-tu ? les vois-tu ? »
Elle me tutoyait comme une enfant tutoie son petit camarade. Elle ne se rendait même pas compte de ce qu’elle disait, toute à l’extase de ces étoiles filantes, vertes, blanches et rouges.
« Que c’est beau, » murmurait-elle, « que c’est beau, cet éclair avant ces étoiles ! Voici que tout le ciel est blanc d’une voie lactée !… Maintenant, il ruisselle du sang héroïque des géants… Oh ! il est pavoisé de pourpre… Il est comme un vaste tapis de violettes… Non, non, il est plus vert que l’Océan par un soir printanier… Que c’est beau, et que je suis heureuse ! »
Ses paupières battaient fébrilement. Ses yeux éblouis cherchaient les miens pour y surprendre le reflet de sa joie. Je riais comme elle, je riais de son rire. En vérité, nous avions l’âme légère de deux enfants.
… Mais, lorsque la dernière fusée s’éteignit, ma gaieté s’éteignit avec elle. Nous rentrâmes par une avenue de grands chênes séculaires.
« J’ai presque peur de ces arbres, » frissonna Dagmar. « Ils sont plus hauts que la voûte d’une cathédrale gothique. J’aurais peur, grand’peur, j’aurais tout à fait peur si tu n’étais pas là… »
Elle se blottissait contre moi, en un geste frileux et charmant. J’aurais voulu l’emporter très loin, l’étendre sur un lit doux comme une couche de malade, étroit comme un berceau, et brûler de baisers intolérables ses fragiles pieds nus.
« N’êtes-vous point lasse, Dagmar ? »
Elle me regarda, de ses yeux de page effronté :
« Un peu. »
Le rire lumineux de ses prunelles démentait ses paroles. Nous nous assîmes sur un banc de marbre que l’ombre recouvrait, épaisse et tiède autant que la mousse.
Irrésistible à l’égal d’un instinct, le désir de frôler cette chair virginale m’étreignit puissamment. Je me rapprochai d’elle.
« Jolie, ah ! trop jolie, pourquoi ai-je tant d’angoisse en vous aimant ? »
Elle ne s’étonna point, ne s’offensa point. Elle ne dégagea point sa main, d’une blancheur candide.
« Je ne vous comprends pas… D’ailleurs, je n’ai jamais pu vous comprendre. Vous êtes un être bizarre et complexe… »
À ce moment, je sentis en moi l’élan primitif des petits garçons simiesques et cruels, qui s’amusent à meurtrir et à terrifier une colombelle sauvage. J’aurais voulu faire pâlir ce visage de rose apriline, pour la joie farouche de voir en ces yeux l’intensité vivante d’une émotion irrésistible. Faire vibrer cet être indifférent, de terreur ou d’amour, qu’importe ? Le faire frémir, fût-ce de colère, fût-ce de dégoût !
« Dites-moi encore, et mieux, que vous m’aimez, » commanda l’enfant impérieuse.
« Si je vous avouais de quelle convoitise barbare je vous aime, vous vous effraieriez peut-être… La haine est peut-être plus intense et plus durable que l’amour. Elle est aussi belle, aussi sacrée que l’amour lui-même. Celui qui ne sait point haïr, ne sait point aimer. Parmi tous les poètes, Dante m’émeut le plus, à cause de cette puissance de haine qui était en lui, et qui n’eut d’égale que sa puissance d’amour. Les ennemis implacables sont aussi les amants les plus passionnément tendres. L’Alighieri eût moins adoré Béatrice, s’il eût moins haï ses adversaires. Je t’aime de toute l’ardeur de mes antiques haines, Dagmar.
— Vous avez une effroyable façon d’aimer.
— Ô ma fleur d’aube ! Si tu savais pourtant de quelle tendresse très douce je t’environne ! Elle est simple, comme tout ce qui est profond. La prose exprime peut-être mieux que les vers l’ardeur véritable. Ma tendresse est très simple, mais je la tresserai en mille phrases complexes, afin qu’elle te paraisse éternellement nouvelle. Je veux la rendre versatile et changeante, comme les opales et comme les arcs-en-ciel que tu préfères… »
Elle inclina son front sur mon épaule.
« Je t’aime, Dagmar, d’une si indulgente caresse d’âme, que tes trahisons les plus cruellement féminines n’éveilleront jamais en moi la plus faible colère. Et cependant, si je t’aimais plus tard d’une passion comme celle qui me ravagea… qui sait ? »
La vision écarlate du Passé m’éblouit de son reflet sanglant. Je m’abîmai dans cette contemplation terrible et chère…
