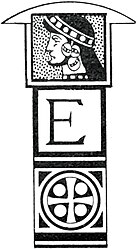Utilisateur:Denis Gagne52/Test

VI
n 781, Rotrude, fille du Franc, avait
été fiancée au prince. Elle était la sœur
de Louis et de Pépin, sacrés récemment
rois d’Aquitaine et d’Italie. L’ambassade
solennelle envoyée près de
Karl revint avec l’acquiescement. Ce
que n’avaient obtenu ni l’Isaurien, ni le Copronyme malgré tant de démarches et d’humiliations, Irène,
par l’initiative de ses ministres, et la grâce que projetait
au loin sa gloire, se l’était fait en quelque sorte solliciter
comme un honneur.
Les Grecs chérissaient déjà leur future impératrice. Ils la baptisèrent Érythro, dans la vivacité de leur allégresse, lui donnant le nom de la mer qui se mariait au sol de l’Empire.
La Régente et Jean élurent un eunuque. Il partit vers la princesse afin de l’instruire dans la coutume et dans la langue de ses futurs sujets ; de l’initier au cérémonial, aux subtilités du dogme byzantin.
Cette fois, les évêques des Gaules ne s’opposaient plus. Certainement Bythométrès avait offert les gages d’une prochaine conversion durant les ententes nuptiales. La précieuse amitié de Rome secondait alors les eunuques iconolâtres.
— Rotrude est-elle aussi belle que le paon ?… demandait Constantin non sans inquiétude… Et comment devrai-je l’embrasser ?
Dans les soucis d’une politique complexe, le jeune prince avait été quelque peu négligé par l’affection maternelle. Si, jusqu’à la mort de Léon, Irène l’avait choyé comme le motif de ses plus ardentes brigues, l’empereur mort, elle commit aux moines et aux eunuques éducateurs le soin de cultiver la croissance de Constantin. Quand se posa la question du mariage franc la régente s’étonna de voir s’enfiévrer l’adolescent. Loin de sa puérilité première, il envisageait l’avenir déjà comme une proche expérience à mener soi-même. Il se révéla soudain très amoureux de Rotrude. Excitée par l’enthousiasme des gens, sa naïve prolixité se promit de conduire le monde avec cette fille de la grande race combattante. Le Maître des Offices, Pierre, lui donna une paonne qu’ils nommèrent Rotrude aussi.
Irène devina qu’il lui siérait bientôt de s’effacer devant le pouvoir de l’empereur devenu l’homme d’État. Son autorité de régente était chose intérimaire, et pis aller de tutelle durant la viduité de la patrie.
Il arriva que cette femme altière se rendît à ce raisonnement vers l’heure même où la combinaison de ses plans aboutissait. Il lui fallut admettre qu’un rôle de vieillesse allait lui convenir dans la retraite du monastère, ou dans les salles du Gynécée. Plus elle ne commanderait ni ne goûterait l’ivresse de sentir lui battre au cœur la faveur publique, de suivre, haletante, le jeu des empereurs où les vies humaines sont les points de dés, et la terre, avec les mers, le plateau d’enjeux.
Constantin avait douze ans. L’extrême jeunesse de l’héritière franque laissait encore du répit.
Irène se vit, à trente ans, près de ne retenir que son titre. Peu lui importait la dignité sans le pouvoir. Cela parut aux eunuques une souveraine injustice du sort. Comment un garçon sot et inexpérimenté saurait-il assumer l’œuvre gigantesque ? Ne croulerait-il pas dans l’ordure de ses vices juvéniles comme ses aïeux mémorables ? Irène le regardait courir avec des chiens molosses dont il possédait au juste l’esprit.
La régente se révolta. Jean lui permit de ne pas céder à la coutume des cours. Et, pour reculer au moins l’échéance d’un si funeste avenir, Staurakios guida sa diplomatie de manière à refroidir les relations actives entre les deux pays. D’abord Irène allégua l’âge des fiancés pour prétexte à son refus de fixer la date des noces, puis tergiversa sur le détail des actes officiels. Ainsi, peu à peu, les négociateurs se lasseraient. Eutychès laissa tomber les questions de date, de contrat, sans rupture apparente, néanmoins.
Mais, de cette secousse morale, il demeurait au cœur d’Irène un étrange sentiment de méfiance à l’égard de ce fils qui la pouvait anéantir, du soir au matin, par un coup de force aussitôt légitimé. Elle le voyait en proie aux conseils de vieux libertins, d’audacieux jouvenceaux aptes à tout tenter pour obtenir la direction des affaires. Déjà Pharès trouvait que le Maître des Offices flattait exagérément son élève, en lui prédisant les victoires de l’Isaurien, du Copronyme, de Léon même, en oubliant de lui dire leurs défaites, en présentant chez le prince telles femmes de la cour réputées pour leurs vices.
Hors le désir de régner, aucun signe d’intelligence ne semblait éclore dans ce cerveau embryonnaire attaché à connaître les plaisirs extérieurs, les futilités de la vie, à livrer et à retirer sa confiance aux plus méprisables favoris. Toute la hideur d’âme propre aux jeunes garçons se manifestait en ce petit-fils du Copronyme. Rien qui fit pressentir en lui un génie du gouvernement ou de la guerre. Il n’aimait que les paons, les biches, les chevaux, les chiens, les athlètes, les filles parées étrangement, la musique violente et langoureuse.
Les eunuques s’assurèrent qu’il importait de ravir Byzance à ses mains.
Ils n’avaient d’autre moyen d’y réussir que de se faire plus indispensables encore aux destinées du pays, que de pousser leur tâche plus outre, et de séduire le monde par le bonheur de leurs entreprises.
Contre leurs adversaires, contre ceux qui, patiemment, résolument, attendaient l’émancipation de Constantin, contre les iconoclastes du parti militaire, il fallait férir et gagner. La seule chance de salut c’était la déchéance de ce parti. Ensuite les orthodoxes devraient aux eunuques leur liberté religieuse, les moines leur richesse territoriale et leur sécurité, les femmes l’accomplissement d’un vœu très cher. Cela raffermirait l’alliance avec le Pape et l’Occident. Cela vaudrait au trône les subventions du clergé, la reconnaissance des classes agricoles ennemies des soldats, et qui payaient l’impôt. Irène entama rapidement la lutte. Pour grandir encore le prestige de la cause qu’elle secondait, Pharès lui ménagea un miracle.
Très à propos, un paysan de Thrace dégagea le sépulcre d’un géant enfoui dans la terre avec cette inscription : « Le Christ naîtra de la Vierge Marie et je crois en lui. Soleil tu me verras encore un jour sous l’empire de Constantin et d’Irène. »
La stèle fut amenée dans Byzance. Elle y produisit grand effet. Elle confirma les réfutations de l’hérésie nestorienne sur quoi se fondait la doctrine des iconoclastes. Ceux-ci refusaient toute adoration aux images de la Panagia, en prétendant qu’elle conçut la forme charnelle du Iésous, et non l’Esprit du Iésous, lequel préexiste au ciel, à la terre, à l’humanité, donc à l’épouse du charpentier Joseph. Le dogme du Copronyme soutenait que l’énergie divine créatrice des mondes n’avait pu être l’œuvre d’une femme née de ce monde. Le Iésous n’avait fait que reconnaître, en Soi, l’âme du Père éternelle en son Fils même.
Préparés depuis longtemps à la résistance par les encouragements du Palais, les moines divulguèrent bruyamment la légende. Ils se déclarèrent en public adorateurs des images. Hardiment tout ce qui n’était pas militaire arbora l’opinion de la régente élue du Théos. Seuls les évêques jadis présents au conciliabule du Copronyme n’osèrent se rétracter par amour-propre.
Le peuple manifestant ainsi, la tâche se facilitait. Un édit décréta la liberté de conscience et la faculté, pour chacun, de suivre le culte qui lui plairait. Aussitôt l’orthodoxie fut prêchée dans les églises. On officia publiquement selon le vieux rite.
Beaucoup n’étaient devenus ardents iconoclastes que par crainte des vexations et des supplices. Le culte de la Vierge se rétablit partout. Les femmes triomphaient par le moyen d’une femme, pour l’adoration d’une divinité féminine. Le parti d’Irène vécut au grand jour. Les soldats le purent dénombrer. Parce que ses forces leur semblèrent considérables, ils n’agirent plus à l’encontre.
Ce premier résultat encourageait les eunuques. Jean s’attendait à une émeute, à la révolte ouverte. Voici que leur fermeté seule en imposait à la multitude brutale. Pour eux-mêmes, pour leurs ambitions secrètes, c’était la victoire en somme de l’élément contraire à Léon l’Isaurien et à Constantin V ; un présage de leur suprématie future sur le prince.
Jean Bythométrès ne laissa point de repos à l’ennemi et porta de nouveaux coups.
Paul, le patriarche de Léon IV, malgré les apparences nécessaires à sa charge, n’avait pas démenti ses préférences pour l’orthodoxie. Il restait fidèle à Irène, l’ayant prouvé en ordonnant les oncles du prince, lors de circonstances périlleuses.
Lorsque le goût populaire fut bien évident, la régente lui persuada de se retirer au monastère de Florus, pour y accomplir une pénitence publique de ses errements. Paul obéit à ce désir vers le milieu d’août. À peine fut-il en cellule, la maladie l’assaillit, une de ces maladies qui secouraient les eunuques à propos. Sans qu’on sût bien si leurs vagues souhaits avaient autorisé Pharès à composer un venin opportun, on déclara bientôt le patriarche perdu.
En compagnie de l’empereur, la régente alla rendre visite au malheureux. Devant leur suite, Paul remercia très haut le ciel d’avoir quitté une charge hérétique avant la mort. Cela seul lui permettait l’espoir du repos éternel. Dès ces paroles, Irène fit mander les principaux patrices et sénateurs iconoclastes. Elle leur suggéra de saluer le patriarche, de l’exhorter à reprendre la direction de l’église. Quand il les reçut, Paul les supplia de garantir leur salut par une prompte abjuration. En outre, il proposa de réunir un concile œcuménique qui résoudrait la question des Images. Ces personnes ne manquèrent pas de lui reprocher son consentement de naguère à l’hérésie. À cela il répondit par des pleurs et des plaintes de contrition. Il répéta que c’était précisément la cause de sa douleur, et pour quoi il s’efforçait de faire rude pénitence. Pendant cette crise de désespoir tragique, il trépassa. Ce ne fut plus qu’une chair inerte, mal barbue, et la bouche béante ; une chair raidie dans un froc sur les cendres que l’agonisant avait fait répandre dans son lit plaqué d’ivoire, veillé par des lions de bronze qui relevaient les courtines. Et il parut aux assistants que c’était la mort aussi du parti militaire. Constantin sanglota si fort qu’on dut l’emporter hors de la chambre.
Bythométrès tenait un édit tout prêt autorisant à prêcher la réfutation des théories iconoclastes. Cet acte fut aussitôt promulgué. Paul ne croyait sans doute pas jouer au réel la comédie du repentir in extremis. Pharès ne dédaignait pas l’office de machiniste suprême dans les drames de palais. Le doucereux Eutychès, avait pensé qu’une mort parfaite allouerait une autre importance à la conversion du patriarche.
D’ailleurs on ne perdit plus un instant. Les délégués des ordres de l’État réunis, par commandement impérial, dans la Magnaure du palais des Blaquernes, virent la régente, l’empereur arborant le sceptre et le globe, tous les dignitaires en costumes présider cette séance extraordinaire. Lorsque le silence se fut établi, Irène, en de belles périodes, invita les personnes présentes à élire un nouveau patriarche qui égalât Paul par ses qualités :
— L’empereur…, ajouta-t-elle…, considère cette dignité comme la plus haute de l’empire puisqu’il s’agit du service du Théos et du salut des citoyens. Aussi veut-il que vous l’aidiez à choisir celui que vous estimerez le plus digne et le plus capable de remplir ces devoirs ; en telle sorte qu’ayant contribué, pour votre part, à l’élection du Patriarche, vous vous soumettiez d’autant mieux à son pouvoir que vous l’aurez vous-mêmes jugé le plus capable de vous gouverner. Or, à la cour, vit un sujet dont chacun prise le mérite. On n’a pu d’abord s’empêcher de jeter les yeux sur lui. C’est Tarasios ; mais…
Ainsi que dans toute assemblée soumise au sentiment de son humble confiance, les gens se hâtèrent d’interrompre Irène, et de crier le plus haut possible le nom de Tarasios, à l’exemple des meneurs postés par Pharès de-ci, de-là.
Satisfaite de cette docilité, Irène continua :
— C’est celui-là même que nous distinguons et que nous voulons pour patriarche. Mais, comme j’allais vous l’apprendre, il refuse cette charge. Or il sied, devant cette manifestation, qu’il expose ici les motifs qu’il a de s’opposer à une élection inspirée, pour ainsi parler, par le Théos même puisqu’elle vient de la voix du peuple, après celle de l’Empereur.
On connaissait Tarasios issu de patrices, réputé homme de talent et de caractère. Ainsi que saint Ambroise avant son élévation au patriarcat, il était laïque. Mais Eutychès le savait orthodoxe intransigeant. Il le tenait pour l’énergique exécuteur de la restauration prochaine, l’homme d’âme robuste qui ne reculerait, ni ne trahirait. Tarasios attendait que l’assemblée le désignât, ne voulant qu’on ne pût lui reprocher plus tard d’avoir obtenu sa charge par faveur.
Devant l’acclamation publique, avec lenteur, il se leva. On vit un homme pâle et corpulent, en manteau brodé de léopards. Ses yeux luisaient. Après les révérences d’étiquette vers l’Empereur, vers l’Impératrice, il discourut.
Son exorde déclina une si grande responsabilité dans une église que l’anathème séparait des autres confessions d’Orient et d’Occident. Il avoua n’admettre qu’une foi unique dans le Iésous et dans son Esprit. Par suite, il n’agréerait la charge que si la réunion d’un concile général statuait bientôt sur le différend des Images, et rétablissait, par ce jugement, l’unité du christianisme.
La houle des têtes chevelues, coiffées de bonnets rouges, verts, jaunes, s’émut et vociféra. L’assemblée sanctionna, de ses cris, l’attitude approbative d’Irène. Puis elle s’écoula dans un grand tumulte, traînant ses sandales et ses bottines, bavarde, sans respect pour la magnificence du lieu qui répétait en échos la rumeur humaine.
Alors les eunuques et Tarasios convinrent d’envoyer un message au pape Adrien. Les maîtres de Byzance le priaient de venir lui-même tenir la présidence du concile œcuménique projeté. Ils lui promirent des honneurs inouïs, outre la satisfaction de ses plus chères visées.
Trop fin pour ne pas soupçonner quel parti la politique d’Irène tirerait de ce voyage pontifical, Adrien préféra envoyer deux légats porteurs d’une lettre fulminatoire contre l’hérésie iconoclaste. Il félicita Tarasios de sa profession de foi et de son élection, encore que celle-ci fût proclamée contre les canons. Les églises d’Alexandrie et d’Antioche déléguèrent aussi des évêques.
L’année suivante, 786, au mois d’août, commença, dans l’église des Saints-Apôtres, le concile annoncé bruyamment à toutes les sociétés ecclésiastiques du monde.
Dans les galeries du pourtour haut tendues, pour la circonstance, d’étoffes impériales quadrillées, de broderies précieusement métalliques enchâssant les pierreries, Irène et Constantin trônèrent. Près d’eux, l’eunuque à tête de vieille appuyait son menton grommeleur contre ses mains tachées et unies au milieu de la canne d’azur. Bythométrès siégeait, fier de tenir enfin l’Orient courbé sous son esprit. Avec sa mine jaune et finement ridée, Staurakios se faisait noble, sévère. Pharès murmurait des oraisons, des actions de grâce en baissant les yeux. Irène dirigeait l’expression bienveillante de sa face vers les évêques resplendissant comme des joyaux par les cornes de leurs mitres, et les dalmatiques orfévrées. Ils étaient déjà résolus, à voter la restauration du culte ancien. Par apparat officiel ils échangeaient quelques propos de la discussion convenue qui précéderait l’accord unanime, lorsque d’effroyables bruits et des clameurs de meurtre grandirent au dehors.
Inquiètes, les têtes se tournèrent vers les portes ouvrant sur la colonnade du narthex. Un groupe se précipitait dans la foule des citoyens et des clercs. Hagard et chauve, les mains en l’air, un moine ventru cria que des séditieux en armes manifestaient pour le maintien du dogme établi par le conciliabule du Copronyme trente-trois années auparavant.
Bientôt on signale les gardes du Palais qui accourent, l’épée nue. Des cris lugubres, des hurlements de guerre épouvantent les Pères de l’Église. Irène pâlit et impose en vain l’autorité de son geste consacré. Un instant refermées, les portes cèdent. Couverts de casques écailleux, les scholaires pénètrent menaçants parmi les cliquetis de fer. Leurs bouches rasées, livides, profèrent qu’ils ne laisseront pas outrager, par un désaveu public, la mémoire des monarques militaires dont ils reçurent leurs enseignes honorifiques. Les échos des clameurs rebondissent dans la coupole. Les officiers de l’escorte qu’envoie l’Impératrice pour rétablir le calme sont brusquement bousculés, chavirés dans leurs manteaux, repoussés, contraints de se réfugier dans la croix de la nef, autour de l’intrépide Tarasios. Lui, vêtu de l’habit patriarcal, monte à l’autel et commence, parmi ce tumulte de bataille, le symbolique sacrifice non sanglant.
Néanmoins le concile se dispersa. Ce fut une débandade. Les doigts liturgiques levés avec leurs anneaux, les mains brandissant leurs crosses pastorales, ordonnaient qu’on livrât passage. Et la foule se ruait à l’encontre. Irène, merveilleusement dédaigneuse sortit au côté de son fils. Devant elle les menaces s’évanouirent. Son courage altier troubla les protestataires. Après son départ, ils rivalisèrent d’insultes envers le patriarche. Les évêques iconoclastes les vinrent joindre. Ensemble, avec la jactance du succès, ils vantèrent les axiomes théologiques du conciliabule. Ils couvrirent de leur dérision les orthodoxes réactionnaires, dont la fermeté ne se démentit pas. Sous l’ambon, l’eunuque à tête de vieille grognait, furieux et rouge, debout dans sa simarre ; et ses gestes secouaient les métaux de ses insignes. Pharès suppliait. Bythométrès raisonnait par grandes phrases, le visage tendu vers les fers des piques. Staurakios gardait le silence, en se peignant les boucles avec des ongles rageurs.
Revenus au Palais, ils ne perdirent pas le temps. Ils n’essayèrent point non plus d’une répression dangereuse, à cette heure de défaite. La violence de la soldatesque triomphait trop pour qu’il fût prudent de refréner alors son délire. Irène se priva de sortir, ne parut plus au dehors.
Bientôt, Staurakios, ayant reçu les dépêches de Cappadoce, les communiqua. Elles annonçaient que le calife Haroun-Al-Raschid successeur d’El-Mahdi et de Hadi se proposait d’envahir la province. Pharès renchérit sur les pires nouvelles des stratèges d’Orient. Un bruit courut la ville : les Sarrasins se jetaient sur les thèmes d’Asie. Des messages rendus publics immédiatement signalèrent les progrès de l’incursion de lieu en lieu, de bourg en bourg.
Les crieurs publics et les tibicinaires sonnaient sur les places la calamité nouvelle. Sur l’ordre d’Eutychès, les troupes commencèrent à passer le Bosphore avec les enseignes, les bagages. La guerre étant prévue terrible et longue, maintes phalanges de l’élite briguèrent la faveur de partir. D’énormes préparatifs agitaient les gens. Pour la première fois, le jeune empereur allait prendre le commandement et déployer en étendard le voile de la Très Illuminante Pureté contre le Croissant des infidèles. Irène le déclara, montrant son fils aux scholaires et aux candidats un matin de revue.
Enchanté de la subite importance dévolue à sa personne, le prince hâta les choses. Il voulut que ses équipages gagnassent tout de suite la Bithynie afin de donner au monde chrétien cette preuve d’une bravoure qui ne pourrait tiédir. Or, c’était coutume et privilège des gardes impériaux de suivre en tous lieux les équipages du souverain. Comme on ne les y conviait pas assez vite, ils réclamèrent cet honneur imprescriptible.
La régente autorisa leur départ. Ils sortirent de Byzance.
Les eunuques n’espéraient rien tant que cette marche. Staurakios se rendit auprès des légions de Thrace sous prétexte de les dénombrer. Il offrit à leurs officiers la défense du trône, et les ramena convertis à Irène, glorieux de leur nouveau titre, de leur riche solde. Ils occupèrent les casernes des gardes impériaux dispersés déjà dans les camps et dans les postes d’Asie.
En même temps, Pharès annonçait la retraite subite des Sarrasins. Les motifs de guerre n’existaient plus. Les équipages de Constantin repassèrent le Bosphore, laissant les troupes iconoclastes sans vivres, sans places fortes dans la Cappadoce. Byzance était au pouvoir des orthodoxes, tout entière. Pris au piège de la Régente les gardes s’inquiétèrent.
En effet, Eutychès les licencia par décret. Dépourvus d’argent, de ressources, ils se dissipèrent, en quête chacun d’un abri, du gain indispensable. Deux semaines après, un ordre suprême expulsait de Byzance tous leurs partisans, leurs familles, leurs serviteurs. Le titre de « gardes » fut aussitôt dévolu à l’élite des légions de Thrace. La panique sarrasine avait délivré les eunuques de leurs ennemis.
Irène n’attendit guère pour consacrer sa victoire.
Dans la ville même où Constantin le Grand avait réuni le grand concile qui formula les principales vérités de la Foi, à Nicée, en Bithynie, l’impératrice convoqua les évêques l’an 787. Du lieu, de son nom historique, l’assemblée sainte devait acquérir un prestige. Une confusion s’établirait dans les esprits chrétiens ; et l’on ne saurait quelle fut la plus importante de ces diètes orthodoxes.
La cérémonie fut extraordinaire. Nombre de religieux mutilés lors des persécutions iconoclastes, s’y montrèrent, palmes humaines du martyre de l’Église. Et dans la poussière des routes ils exhibaient leurs moignons gélatineux, leurs visages sans nez, sans oreilles ; ils ouvraient leurs bouches sans langues ; ils décoiffaient leurs crânes scalpés, zébrés de cicatrices brunes. Trois cent cinquante Pères de l’Église s’assemblèrent le 24 septembre. Le pape Adrien y fit prédire à Irène un règne de victoires si elle restituait le temporel napolitain et sicilien du Saint-Siège. L’Orient et l’Occident allaient enfin s’épouser.
Un prodige ne pouvait faillir à sanctifier une époque si pieuse. Des Juifs de Béryte ayant crucifié une image du Sauveur, le sang et l’eau jaillirent sous le coup de lance qu’ils lui portèrent, et tant qu’on put distribuer ces liquides saints à toutes les basiliques du monde.
Le Théos donnait raison aux eunuques contre le parti militaire. Les miracles affermissaient leur pouvoir. Irène fut béatifiée par l’âme admirante du peuple grec.
Le vingt-troisième jour d’octobre, ce 787, le patriarche Tarasios mena les Pères du concile à Byzance dans la grand’salle du Palais. Irène, l’empereur, les magistrats de la cour, les corporations et la multitude s’étageaient hiérarchiquement de l’intérieur à l’extérieur, vers l’extrémité du faubourg noble. Sur un trône, merveille des orfèvres studieux, la Régente en sa châsse d’habits d’or et de pourpre, présida la lecture du Décret de Foi.
Tous les dignitaires durent y apposer leur seing. Au coup de trompette, des clercs apostés relevèrent les images d’or, les rétablirent dans les niches ; et le peuple, se ruant par la ville avec des acclamations, alla chercher, au fond des cachettes, les statues de piété. On les érigea en grand honneur partout, dans les palais, les églises, aux angles des rues, sur les portes où elles avaient jadis donné.
Bénie par la reconnaissance des femmes, l’impératrice rouvrit le trésor des Isauriens ; elle répandit les largesses. De somptueux présents récompensèrent les hommes de bonne volonté qui l’avaient servie, et consolèrent les ralliés tardifs que les fervents de la première heure avaient querellés aux séances du concile.
En effet, un moment les évêques orthodoxes refusèrent d’y recevoir les pénitents iconoclastes souillés du sang chrétien. Grâce à l’intervention du Palais, le conflit s’apaisa. Toutefois ceux qui avaient tenu le conciliabule du Copronyme durent en relire publiquement tous les articles, puis la réfutation dernière.
Irène se connut à la tête des pouvoirs religieux. Elle inspira désormais la faction majeure du peuple. Si les eunuques demeuraient la pensée directrice, la foule contente de réaliser son vœu, imputait à l’Impératrice seule la restauration du culte libre. Le prince ne comptait guère, sinon comme symbole humain, sorte de maître des cérémonies paraissant à tous les galas publics avec la tenue des Basileis.
Alors Irène l’aima davantage. Elle avait à se faire pardonner, en le chérissant, en le choyant, en favorisant son goût de beaux costumes, des animaux nobles, des coursiers, des paons, et des cortèges superbes. Ce fut une mère dont l’exemple édifia les familles. Le titre de Très-Pieuse lui resta pour le triomphe de l’Église orthodoxe obtenu, par son courage et son intelligence, sur les plus redoutables hérétiques de l’histoire.
À voir perpétuellement le territoire supporter les incursions des Sarrasins ou des Bulgares, les eunuques s’avisèrent qu’un accord entre les peuples du vieux monde s’opposerait seul utilement à l’immigration orientale, à ses conséquences. Il fallait donc oublier la politique exclusive préconisée par les vieux théoriciens de Palais. Au contraire, des rapprochements, des alliances s’imposaient avec les races nordiques d’Occident plus âpres à la lutte, mieux fournies en valeur, innombrables, amantes de la guerre. Dès ce huitième siècle, Staurakios prévit la définitive invasion de 1453, la chute de l’Empire immergé, sans soutien, par l’afflux de la cavalerie turque, toute la civilisation des Césars, tout le souvenir de la gloire romaine émiettés sous la furie du Barbare mongol qui s’installera, hors de ses déserts inféconds, dans la fertile, l’opulente Europe.
Constantin semblait l’obstacle. Les eunuques comprirent qu’il n’échapperait pas à l’individualisme brutal d’ascendants occupés, dans leur orgueil puéril, à se brouiller, par des extravagances religieuses ou politiques, avec le pouvoir occidental. Les dix-neuf années de l’éducation impériale n’avaient pas formé un être supérieur. Le souci d’une débauche quotidienne, une arrogance facile, le mépris des sciences, le goût du beau plastique trahissaient l’âme du futur souverain. Sans doute, Irène dut se reprocher le manque de vigilance. Aux heures de sincérité intime, elle s’avouait certes qu’elle avait jadis constaté sans déplaisir les absurdes penchants de l’héritier. S’avilissant ainsi lui-même, il laissait moins à craindre pour l’avenir. Témoignerait-il jamais de ses aptitudes à régir seul l’empire des Romains ? Esclave d’opiniâtres appétits sensuels, il ne tarderait pas, s’il essayait le despotisme, à lasser le peuple par la fréquence des impôts et l’odieux de ses allures. Déjà ses entremetteurs enlevaient les adolescentes et les jeunes garçons pour les mêler aux orgies du Palais. Des parents ameutaient la canaille parfois jusque dans l’Hippodrome où le cul-de-jatte Serantapichos chantait. Autour d’Irène ses amis attestèrent l’incapacité de l’hoir. Ils disaient comme l’Empire en de telles mains serait confusion et misère !
Une seule de ses qualités s’affermit quand Constantin atteignit l’adolescence : le courage militaire. C’était précisément la plus dangereuse pour les eunuques. Ami du soldat, manieur d’armes, visiteur de camps, le prince pouvait toujours réveiller les partis séditieux. Aussi lorsque les Sarrasins assaillirent, sérieusement cette fois, les frontières, Staurakios mit en œuvre ses intrigues et son influence afin de lui ôter le commandement de l’expédition. Irène simula l’amour maternel, déclara le prince bien trop frêle malgré ses dix-neuf ans pour affronter les fatigues d’une campagne en Asie. Les soldats protestaient. Jean constitua leur état-major avec ceux-là même qui, dans l’entourage impérial, cherchaient à stimuler l’insubordination de Constantin contre l’inflexible autorité de sa mère. Plusieurs batailles malheureuses déconsidérèrent ces intrigants.
Dépité l’empereur pressait sa mère de conclure enfin le mariage avec la fille du Franc. Les portraits qu’il reçut de Rotrude, encourageaient son désir. La Régente ne pouvait offrir de motif valable qui prolongeât le retard de cette union tant souhaitée par le sentiment de son fils et par la diplomatie de la cour. Le récent concile de Nicée avait même réduit l’hostilité du pape.
Une ambassade grecque partit. Elle trouva Karl à Capoue dans sa gloire de conquérant organisateur. Selon les conseils et les ordres du vieil Eutychès, les ministres de Byzance réclamèrent avec hauteur l’accomplissement des promesses nuptiales faites sept années auparavant. En outre, ils élevèrent, sur la Pouille et le duché de Bénévent, des prétentions intransigeantes que l’on savait inadmissibles pour la politique de Rome. Blessé par les tergiversations antérieures des eunuques, les évêques francs évincèrent les cupides. Ainsi que l’avait espéré l’Impératrice, le mariage fut rompu définitivement.
Dès que la nouvelle en parut sûre, elle invoqua l’exemple du Copronyme. Dès le refus de Pépin d’unir sa fille à Léon le Khazar, l’aïeul avait immédiatement fiancé ce prince à une Grecque distinguée d’esprit : Irène. Il seyait d’agir pareillement pour sauvegarder l’honneur de la cour byzantine.
En ce temps vivait, dans la Paphlagonie, un saint homme, nommé Philarète, célèbre par sa charité et ses autres vertus. Il élevait ses filles et ses petites-filles, que l’on disait belles, selon les sévères principes de la piété. Irène affirma que cette éducation les désignait pour le trône, encore que leur naissance fût médiocre. Elle envoya, sous la conduite de Jean, une légation quérir ces vierges, et d’autres, en ordonnant que l’on vérifiât si leurs corps étaient à la mesure esthétique des statues.
« Les fourriers arrivèrent, dit le chroniqueur, dans un pays appelé Amnia, dépendant de la capitale Gangra, et où l’homme miséricordieux habitait. Ils virent de loin la maison de Philarète, peinte en bleu, couverte d’un large toit fleuri. Pensant que c’était la demeure d’un parmi les premiers de l’État, ils ordonnèrent la halte à leurs serviteurs.
« Et les gens du pays leur dirent :
— Seigneurs, n’allez pas vers la maison que voici. Car si du dehors elle paraît grande et belle, il ne s’y trouve rien au dedans. C’est un vieillard misérable qui loge là.
« Bythométrès étant survenu dans sa litière avec le gros de l’escorte, imagina que ces gens parlaient ainsi pour obéir au maître de cette maison, riche, sans doute, puissant, et qui voulait se soustraire aux obligations de l’accueil.
« Vraiment hospitalier et pieux, Philarète prit son bâton et marcha à la rencontre de l’eunuque. Il le serra dans ses bras, disant :
— Dieu a très bien fait de conduire mes seigneurs vers le gîte de leur esclave. C’est un grand honneur pour moi que vous ayez jugé à propos de vous arrêter en la cabane d’un pauvre.
« Or il prescrivit à son épouse droite, fière dans ses voiles bruns et orangés :
— Prépare un bon repas, chère femme, pour que nous traitions les seigneurs.
— Tu administres ta maison de telle manière que nous n’avons pas même une poule. Apprête des légumes sauvages et reçois tes amis…, répondit la matrone.
— Prépare seulement le feu. Mets en état la grande
salle à trois lits. Nettoie la table d’ivoire. Alors le Iésous
nous enverra de quoi manger, assura-t-il.

… les légats admirèrent la beauté parfaite
de la pièce.
Voir le texte.
« Ainsi l’épouse agit-elle. Et, comme la Providence ne néglige jamais ceux qui ont confiance en elle, voici que, par une porte de côté, survinrent les premiers du village apportant au serviteur du Iésous, leurs béliers, des agneaux, des poules, des pigeons, du pain, du vin vieux, et tout le nécessaire. Le couvert ayant été dressé dans la grande salle, les légats admirèrent la beauté parfaite de la pièce, la table d’ivoire incrustée d’or, table ronde très large et très ancienne, capable de contenir trente-six noms de convives. Les mets furent dignes d’un repas royal. L’homme vénérable, ressemblait vraiment au patriarche Abraham non seulement par les sentiments hospitaliers, mais encore par le visage. Les voyageurs étaient complètement charmés. Pendant le repas, le fils du vieillard, nommé Johannès vint saluer Bythométrès. Il avait la démarche et la taille de Saül, la chevelure de Samson, la beauté de Joseph. Les autres descendants de l’hôte se présentèrent aussi, servant et desservant la table, tous radieux.
« Jean et les convives contemplaient la belle apparence des jeunes hommes.
— Oui, mes seigneurs…, affirmait le vieillard…, tous ces jeunes enfants sont mes petits-fils.
— Fais venir ton épouse afin qu’elle nous accueille…, pria l’eunuque.
Elle accourut, éblouissante de beauté, bien qu’âgée déjà. Jean demanda :
— Vous avez des filles ?
— J’ai deux filles, mères des jeunes hommes que vous voyez.
— Ces enfants ont sans doute des sœurs ?
L’aïeul répondit :
— L’aînée de mes filles a trois filles.
— Que les jeunes filles se montrent…, commanda Bythométrès…, afin que nous les jugions, selon la volonté de nos Princes couronnés par la grâce du Christ. Car ils nous ont ordonné, à nous leurs esclaves indignes, de faire en sorte qu’aucune adolescente ne reste dans l’empire romain que nous ne l’ayons appréciée.
— Mangeons et buvons ce que le Théos nous a donné, et que demain sa volonté soit faite…, répondit l’hôte.
« Levés de bon matin, Jean et ses officiers appelèrent les jeunes filles. Le vieillard leur représenta :
— Seigneurs, bien que nous soyons misérables, cependant nos vierges ne sont jamais sorties de notre humble chaumière. Si vous le désirez, maîtres, venez vers l’appartement intérieur ; et vous les verrez.
« Ils s’y rendirent avec empressement. Les deux filles du vieillard accompagnées de leurs enfants marchèrent très fièrement à la rencontre des légats saisis d’un religieux respect. À connaître la vigueur de ces femmes, l’extraordinaire fraîcheur de leur visage, la grâce de leur maintien, tous s’arrêtèrent muets. Ne sachant distinguer les mères des filles égales par les lignes des visages et la grandeur de leur taille, Jean demanda :
— Père, quelles sont les filles, quelles sont les mères et les petites-filles ?
« Et, l’hôte, les désigna. Alors, les officiers mesurèrent la taille de la première selon les indications impériales ; et ils la trouvèrent comme il convenait. Ayant examiné ensuite la tête ils la trouvèrent conforme aux canons esthétiques ; ayant considéré la chaussure du pied, ils la trouvèrent encore de parfaite dimension.
« Satisfaits, ils emmenèrent les vierges avec leur mère, les autres enfants et toute la famille, au nombre de trente, à Constantinople. Voici les noms des enfants de Philarète : Johannès son fils aîné ; sa fille aînée Hypatia, veuve avec deux filles, Marie et Myranthéia ; sa seconde fille Énanthéia avait deux filles Kosmô et Hypatia de qui le père s’appelait Michel.
« Les envoyés impériaux réunirent ensuite dix autres adolescentes en différentes provinces. Parmi elles se trouvait la fille d’un riche stratège, Gérontianos. Superbe, elle avait l’esprit naturellement porté vers l’amour de la richesse.
« Marie, la petite-fille du miséricordieux Philarète regardait ses émules d’un œil timide, et leur proposa :
— Mes sœurs, faisons un traité d’union : que celle d’entre nous que le Théos désignera pour être reine, se charge des autres.
« La fille du stratège Gérontianos répondit :
— Je suis assurée que le prince me prendra pour épouse, car j’ai la démarche noble, le visage délicat, et je suis plus riche, de meilleure naissance que vous. Quant à vous, les pauvres, qui n’avez d’autre défense que votre mine, il vous sied de perdre vos espérances.
« Entendant ces paroles, Marie rougit et garda le silence. Intérieurement elle fit des vœux pour être secourue par l’affection de son aïeul.
« Dès qu’ils furent arrivés à Constantinople, Jean conduisit d’abord la fille de Gérontianos près de Staurakios, logothète du prince, qui administrait toutes les affaires du Palais. Quand celui-ci l’eut examinée, il décida :
— Certes, tu es belle et gracieuse, mais tu ne peux faire l’épouse d’un empereur.
« Après lui avoir donné de nombreux présents, il la congédia. La dernière de toutes, Marie, descendante du juste, sa mère, ses sœurs et Philarète furent introduits. Leur magnificence physique séduisit le Prince Constantin et l’Augusta Irène. Pour cet air modeste et intelligent, pour cette noblesse de la démarche, le Prince choisit Marie. La deuxième fut épousée par l’un des plus notables archontes, Constantiniakos, honoré de la dignité de patrice. Quant à la troisième, elle fut destinée, parmi de nombreux présents, au vieil Argousès, roi des Lombards. Car cet Argousès désirait en mariage une vierge de Constantinople, à condition qu’elle fût superbe, même si elle était pauvre.
« Le prince choya avec beaucoup d’amitiés la famille du pieux Philarète. Il leur offrit à chacun, depuis le vieillard jusqu’à l’enfant à la mamelle, des richesses, des biens, des vêtements, de l’or, des ouvrages de grand prix ornés de pierres précieuses et de perles, quelques spacieuses maisons sises près du Palais. »
Si le refus du Franc servait l’ambition de la Régente, il blessait fort son orgueil. La Despoïna permit au Lombard Adalgis de passer en Italie par les provinces grecques afin de reprendre la couronne de son père, captif des Francs. Elle nantit son allié d’argent et d’hommes. Les spathaires impériaux préparèrent en Calabre une expédition contre Ravenne avec le concours des gens de Naples, Amalfi, Sorrente. Trésorier général des guerres et curopalate, Jean Bythométrès concentra les troupes, leur adjoignit les garnisons de Sicile, et marcha sur le duché de Bénévent soumis à la suzeraineté du Franc. Par malheur, Adalgis obtint de commander, pendant qu’une grosse fièvre paludéenne enlevait au Mesureur de l’Abyme toutes les vigueurs de son esprit. Le duc de Bénévent, Grimoald, accourut, si prompt, à leur rencontre qu’il les surprit pendant une manœuvre nocturne. Son infanterie demi-nue dégringola des cimes, jaillit des buissons, surgit des ravins, poussant des cris de hiboux, dardant les pointes de ses lances au visage des Byzantins effarés. Le sang ruissela sur les écailles des armures. Les crânes fendus par les haches bayèrent. Les corps grecs s’emmêlaient en tombant sur les cailloux. Ainsi Grimoald détruisit les colonnes. Endormi dans sa litière, le Mesureur de l’Abyme fut capturé par le baron d’un fief voisin.
La promesse d’une copieuse rançon tenta ce pillard. Il ne livra point Jean à son suzerain. Mais, ayant habillé le cadavre d’un eunuque avec les vêtements du prisonnier, il déclara que c’était là le corps de Bythométrès ; puis emmena le curopalate dans un repli de l’Apennin où s’érigeait le donjon. Irène avertie, racheta secrètement l’ami qu’elle avait cru tué, plus de six mois, sans autre douleur que celle de perdre un auxiliaire précieux, déjà remplacé par Staurakios, disciple et continuateur.
Adalgis ramena péniblement à Byzance les débris de l’expédition. Il dépérit là, sans honneur, au long d’une existence obscure.
Soucieux de mettre l’Italie grecque aux mains de ses alliés, Karl choisit pour prétexte de guerre les propositions hérésiarques du récent concile de Nicée. Il tenait à paraître le fléau du Pape. Cette attitude lui prêtait une sorte de caractère sacré justifiant la chance de ses armes. Pourtant Adrien craignait une nouvelle scission des Églises. Il écrivit au Franc une longue lettre. Les vainqueurs d’Adalgis ne terminèrent pas moins la conquête des possessions grecques en Italie, et ils préparèrent ainsi le sacre de leur roi comme empereur, titre que Byzance ne lui pouvait plus guère disputer.

… les légats admirèrent la beauté parfaite
de la pièce.
Voir le texte.