Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carlovingienne à la Renaissance/tome 1/Texte entier

PREMIÈRE PARTIE
MEUBLES
A
ARMOIRE, s. f. (amaire, almaire). Ce mot était employé, comme il l’est encore aujourd’hui, pour désigner un meuble fermé, peu profond, haut et large, à un ou plusieurs vantaux, destiné à renfermer des objets précieux.
De tous les meubles, l’armoire est peut-être celui qui a conservé exactement ses formes primitives. On a retrouvé à Pompéi des armoires ou empreintes d’armoires qui donnent la structure et l’apparence des meubles de cette nature dont on se sert encore aujourd’hui.
Autrefois, dans les églises, il était d’usage de placer des armoires de bois, plus ou moins richement décorées, près des autels, pour conserver sous clef les vases sacrés, quelquefois même la sainte Eucharistie. Des deux côtés de l’autel des reliques de l’église abbatiale de Saint-Denis, Suger avait fait disposer deux armoires contenant le trésor de l’abbaye[1]. Derrière les stalles, sous les jubés, des armoires contenaient les divers objets nécessaires au service du chœur, parfois même des vêtements sacerdotaux ; beaucoup de petites églises n’avaient pas de sacristies, et des armoires en tenaient lieu. Il va sans dire que les sacristies contenaient elles-mêmes des armoires dans lesquelles on déposait les trésors, les chartes et les livres de chœur. Près des cloîtres, dans les monastères, une petite salle, désignée sous le nom d’armaria, contenait des meubles renfermant des livres dont les religieux se servaient le plus habituellement pendant les heures de repos. Le gardien de la bibliothèque du couvent était appelé armariatus ou armarius[2].

Les armoires placées près des autels étaient assez ornées pour ne pas faire une disparate choquante au milieu du chœur des églises, alors si remplies d’objets précieux. Autant qu’on peut en juger par le petit nombre de meubles de ce genre qui nous sont conservés, les armoires, jusqu’au XIVe siècle, étaient principalement ornées de peintures exécutées sur les panneaux pleins des vantaux, et de ferrures travaillées avec soin, rarement de sculptures La forme générale de ces meubles était toujours simple, et accusait franchement leur destination. Un des exemples les plus anciens d’armoires réservées au service du culte existe dans l’église d’Obazine (Corrèze). Cette armoire (fig. 1) se compose de pièces de bois de chêne d’un fort échantillon. Les deux vantaux, terminés en cintre à leur extrémité supérieure, sont retenus chacun par deux pentures de fer forgé, deux verrous ou vertevelles les maintiennent fermés. On ne remarque sur la face de cette armoire, comme décoration, qu’un rang de dents de scie sur la corniche et de très-petits cercles avec un point au centre, gravés régulièrement sous cette corniche et autour des cintres des vantaux. Les angles sont adoucis au moyen de petites colonnettes engagées. Ce meuble, qui paraît dater des premières années du XIIIe siècle, était probablement peint, car on remarque encore quelques parcelles de tons rouges entre les dents de  scie de la corniche. Les deux côtés de l’armoire d’Obazine sont beaucoup plus riches que la face ; ils sont décorés d’un double rang d’arcatures portées par de fines colonnettes annelées (fig. 2). Ces deux figures font comprendre la construction de
scie de la corniche. Les deux côtés de l’armoire d’Obazine sont beaucoup plus riches que la face ; ils sont décorés d’un double rang d’arcatures portées par de fines colonnettes annelées (fig. 2). Ces deux figures font comprendre la construction de  ce meuble, qui se compose de madriers de 10 centimètres d’épaisseur environ, fortement assemblés, et reliés en outre à la base de la face par une platebande de fer. Pour compléter ces figures, nous donnons (3) le détail d’un des chapiteaux de l’arcature, (4) la vertevelle, et (5) l’extrémité de l’un des deux verrous, se terminant, pour faciliter le tirage ou la poussée, par une tête formant crochet. Cette recherche dans la ferrure d’un meuble aussi grossier en apparence fait ressortir le soin que l’on apportait alors à l’exécution des objets mobiliers les moins riches. Ces verrous sont forgés, et les deux petites têtes qui terminent leurs extrémités sont remarquablement travaillées.
ce meuble, qui se compose de madriers de 10 centimètres d’épaisseur environ, fortement assemblés, et reliés en outre à la base de la face par une platebande de fer. Pour compléter ces figures, nous donnons (3) le détail d’un des chapiteaux de l’arcature, (4) la vertevelle, et (5) l’extrémité de l’un des deux verrous, se terminant, pour faciliter le tirage ou la poussée, par une tête formant crochet. Cette recherche dans la ferrure d’un meuble aussi grossier en apparence fait ressortir le soin que l’on apportait alors à l’exécution des objets mobiliers les moins riches. Ces verrous sont forgés, et les deux petites têtes qui terminent leurs extrémités sont remarquablement travaillées.
La cathédrale de Bayeux conserve encore, dans la salle du trésor,  une armoire du commencement du XIIIe siècle, d’un grand intérêt. Cette armoire, mutilée aujourd’hui, occupait autrefois tout un côté
une armoire du commencement du XIIIe siècle, d’un grand intérêt. Cette armoire, mutilée aujourd’hui, occupait autrefois tout un côté  de la pièce dans laquelle elle est placée. Elle était destinée à renfermer des châsses[3], et l’on y voit encore l’armure de l’homme d’armes du chapitre (armiger capituli)[4] gentilhomme qui, par son fief relevant de la couronne, était tenu d’assister, armé de toutes
de la pièce dans laquelle elle est placée. Elle était destinée à renfermer des châsses[3], et l’on y voit encore l’armure de l’homme d’armes du chapitre (armiger capituli)[4] gentilhomme qui, par son fief relevant de la couronne, était tenu d’assister, armé de toutes  pièces, à l’office de la cathédrale aux grandes fêtes, et de se tenir près de l’évêque toutes les fois qu’il officiait solennellement[5]. Cette
armoire était entièrement couverte de peintures représentant des
translations de reliques. Les sujets qui garnissent les panneaux sont
blancs sur un fond vermillon ; les montants et traverses sont remplis
par un ornement blanc courant sur un fond noir avec filets rouges ;
les fleurons sont blancs, noirs et rouges. Nous donnons (fig. 6) la
moitié de cette armoire, qui se composait autrefois de huit travées.
Une seule tablette épaisse la sépare horizontalement au droit de la
pièces, à l’office de la cathédrale aux grandes fêtes, et de se tenir près de l’évêque toutes les fois qu’il officiait solennellement[5]. Cette
armoire était entièrement couverte de peintures représentant des
translations de reliques. Les sujets qui garnissent les panneaux sont
blancs sur un fond vermillon ; les montants et traverses sont remplis
par un ornement blanc courant sur un fond noir avec filets rouges ;
les fleurons sont blancs, noirs et rouges. Nous donnons (fig. 6) la
moitié de cette armoire, qui se composait autrefois de huit travées.
Une seule tablette épaisse la sépare horizontalement au droit de la 
 traverse intermédiaire, de sorte que les panneaux, s’ouvrant deux
par deux, laissaient voir séparément les cellules du meuble ; il fallait
forcer l’une après l’autre toutes les vertevelles pour s’emparer
des objets renfermés dans chacune de ces cellules. On remarquera
la disposition des verrous fermant à la fois deux panneaux en s’engageant
dans un piton posé sur les montants, et le dépassant assez
pour mordre sur le panneau qui n’est pas muni de vertevelle. La
figure 7 présente quelques détails des ferrures ; la figure 8, un détail
de l’un des fleurons terminant le montant du milieu, et les peintures
de ces montants et traverses.
traverse intermédiaire, de sorte que les panneaux, s’ouvrant deux
par deux, laissaient voir séparément les cellules du meuble ; il fallait
forcer l’une après l’autre toutes les vertevelles pour s’emparer
des objets renfermés dans chacune de ces cellules. On remarquera
la disposition des verrous fermant à la fois deux panneaux en s’engageant
dans un piton posé sur les montants, et le dépassant assez
pour mordre sur le panneau qui n’est pas muni de vertevelle. La
figure 7 présente quelques détails des ferrures ; la figure 8, un détail
de l’un des fleurons terminant le montant du milieu, et les peintures
de ces montants et traverses.
Ces exemples font voir que la principale décoration de ces meubles était obtenue au moyen des ferrures nécessaires et de peintures
recouvrant les panneaux. La menuiserie était d’une grande simplicité ;
les planches formant les panneaux, assemblées à grain d’orge
(fig. 9) ou simplement collés à joints vifs. Il semble qu’alors on  tenait à conserver à ces armoires l’aspect d’un
meuble robuste, bien fermé. Ce ne fut que a
beaucoup plus tard que la sculpture vint décorer
ces menuiseries. Nous ne pourrions
affirmer cependant qu’il n’y eût pas, avant le
XVe siècle, d’armoires sculptées : mais en observant
les rares exemples d’objets de menuiserie romane, on pourrait
admettre que les panneaux (lorsque la peinture seule n’était
pas appelée à les décorer) recevaient une sculpture plate, champlevée,
telle que celle que nous voyons encore conservée sur l’une
des portes de la cathédrale du Puy en Velay. Les panneaux de cette
porte, de sapin, représentent des sujets peints sur une gravure
dont les fonds sont renfoncés de 2 ou 3 millimètres. Nous avons
vu en Allemagne, dans la cathédrale de Munich, des armoires du
XVe siècle dont les planches sont ainsi travaillées ; les fonds sont
peints en bleu sombre, et les ornements conservent la couleur naturelle
du bois. Souvent aussi les vantaux des armoires-trésors
étaient-ils bordés de bandes de fer battu, étamé ou peint, avec rehauts
dorés. Ces bandes de fer, croisées en façon de treillis avec
rivets aux rencontres, étaient posées sur cuir, sur drap ou vélin.
Mais une des plus belles armoires anciennes connues se trouve dans
le trésor de la cathédrale de Noyon. Les panneaux sont entièrement
peints à l’extérieur et à l’intérieur, et déjà le couronnement de ce
meuble, qui date des dernières années du XIIIe siècle, est orné de
sculptures. Cette armoire était certainement destinée, comme celle
de Bayeux, à renfermer des châsses et ustensiles réservés au culte.
A l’extérieur, les panneaux sont couverts de peintures fines sur fond
pourpre damasquiné, et bleu semé de fleurs de lis blanches, représentant
des saints ; à l’intérieur, ce sont des anges jouant de divers
instruments de musique, tenant des encensoirs et des chandeliers.
De petits créneaux se découpent sur le couronnement. Ce genre
d’ornement fut employé fréquemment dans le mobilier pendant le
XIVe siècle. Voici un ensemble de cette armoire (10) ; nous supposons
les volets ouverts, et, comme on peut le remarquer, ces volets
sont brisés, c’est-à-dire qu’ils se développent en dix feuilles, afin de
ne pas présenter une saillie gênante lorsque l’armoire est ouverte.
Les volets sont suspendus à des pentures de fer étamé, et la peinture est exécutée sur une toile marouflée sur le bois. M. Vitet, dans
sa Description de la cathédrale de Noyon, et M. Didron, dans les
Annales archéologiques[6] ont donné une description étendue de ce
meuble ; nous y renvoyons nos lecteurs, car nous ne pourrions rien
ajouter à ce que ces deux savants archéologues en ont dit. Nous joignons
à la figure 10 une partie coloriée de l’armoire de Noyon (pl. I)[7],
qui nous dispensera de plus longs détails. Les deux côtés du meuble
de Noyon sont décorés de chevrons peints en blanc, alternés avec
d’autres chevrons jaunes.
tenait à conserver à ces armoires l’aspect d’un
meuble robuste, bien fermé. Ce ne fut que a
beaucoup plus tard que la sculpture vint décorer
ces menuiseries. Nous ne pourrions
affirmer cependant qu’il n’y eût pas, avant le
XVe siècle, d’armoires sculptées : mais en observant
les rares exemples d’objets de menuiserie romane, on pourrait
admettre que les panneaux (lorsque la peinture seule n’était
pas appelée à les décorer) recevaient une sculpture plate, champlevée,
telle que celle que nous voyons encore conservée sur l’une
des portes de la cathédrale du Puy en Velay. Les panneaux de cette
porte, de sapin, représentent des sujets peints sur une gravure
dont les fonds sont renfoncés de 2 ou 3 millimètres. Nous avons
vu en Allemagne, dans la cathédrale de Munich, des armoires du
XVe siècle dont les planches sont ainsi travaillées ; les fonds sont
peints en bleu sombre, et les ornements conservent la couleur naturelle
du bois. Souvent aussi les vantaux des armoires-trésors
étaient-ils bordés de bandes de fer battu, étamé ou peint, avec rehauts
dorés. Ces bandes de fer, croisées en façon de treillis avec
rivets aux rencontres, étaient posées sur cuir, sur drap ou vélin.
Mais une des plus belles armoires anciennes connues se trouve dans
le trésor de la cathédrale de Noyon. Les panneaux sont entièrement
peints à l’extérieur et à l’intérieur, et déjà le couronnement de ce
meuble, qui date des dernières années du XIIIe siècle, est orné de
sculptures. Cette armoire était certainement destinée, comme celle
de Bayeux, à renfermer des châsses et ustensiles réservés au culte.
A l’extérieur, les panneaux sont couverts de peintures fines sur fond
pourpre damasquiné, et bleu semé de fleurs de lis blanches, représentant
des saints ; à l’intérieur, ce sont des anges jouant de divers
instruments de musique, tenant des encensoirs et des chandeliers.
De petits créneaux se découpent sur le couronnement. Ce genre
d’ornement fut employé fréquemment dans le mobilier pendant le
XIVe siècle. Voici un ensemble de cette armoire (10) ; nous supposons
les volets ouverts, et, comme on peut le remarquer, ces volets
sont brisés, c’est-à-dire qu’ils se développent en dix feuilles, afin de
ne pas présenter une saillie gênante lorsque l’armoire est ouverte.
Les volets sont suspendus à des pentures de fer étamé, et la peinture est exécutée sur une toile marouflée sur le bois. M. Vitet, dans
sa Description de la cathédrale de Noyon, et M. Didron, dans les
Annales archéologiques[6] ont donné une description étendue de ce
meuble ; nous y renvoyons nos lecteurs, car nous ne pourrions rien
ajouter à ce que ces deux savants archéologues en ont dit. Nous joignons
à la figure 10 une partie coloriée de l’armoire de Noyon (pl. I)[7],
qui nous dispensera de plus longs détails. Les deux côtés du meuble
de Noyon sont décorés de chevrons peints en blanc, alternés avec
d’autres chevrons jaunes.

Le moine Théophile, dans son Essai sur divers arts, ouvrage qui date du XIIe siècle, donne la manière de préparer les panneaux, les portes de bois destinés à recevoir de la peinture. Cette méthode paraît
avoir été suivie dans la fabrication des deux armoires de Bayeux
soin, pièce à pièce, et à l’aide de l’instrument à joindre dont se servent les tonneliers et les menuisiers (le sergent). On les assujettit au moyen de la colle de fromage… » L’auteur donne ici la manière de faire cette colle : « … Les tables assemblées au moyen de cette colle, quand elles sont sèches, adhèrent si solidement, qu’elles ne peuvent être disjointes ni par l’humidité ni par la chaleur. Il faut ensuite les aplanir avec un fer destiné à cet usage. Ce fer, courbe et tranchant à la partie intérieure, est muni de deux manches, afin qu’il puisse être tiré à deux mains. Il sert à raboter les tables, les portes et les écus, jusqu’à ce que ces objets deviennent parfaitement unis. Il faut ensuite les couvrir de cuir, non encore tanné, de cheval, d’âne ou de bœuf. Après l’avoir fait macérer dans de l’eau et en avoir raclé les poils, on en exprimera l’excès d’eau : dans cet état d’humidité, on l’appliquera (sur le bois) avec la colle de fromage. » Dans le chapitre xix, Théophile indique le moyen de couvrir ces panneaux revêtus de cuir d’un léger enduit de plâtre cuit ou de craie ; il a le soin de recommander l’emploi de la toile de lin ou de chanvre, si l’on n’a pas de peau à sa disposition ; puis enfin, au chapitre suivant, il donne les procédés pour peindre ces tables ou portes en rouge, ou de toute autre couleur, avec de l’huile de lin, et de les couvrir d’un vernis.
Le goût pour les meubles plutôt décorés par la peinture que par la sculpture paraît s’être affaibli à la fin du XIVe siècle ; à cette époque, les moulures et les ornements taillés dans le bois prennent de l’importance et finissent par se substituer entièrement à la polychromie. Il faut dire qu’il en était alors de la menuiserie et de l’ébénisterie comme de la construction des édifices ; on aimait à donner à la matière employée la forme qui lui convenait. Les larges panneaux, composés d’ais assemblés à grain d’orge ou simplement collés sur leurs rives, mais non barrés, emboîtés ou encadrés, exigeaient des bois parfaitement secs, si l’on voulait éviter qu’ils ne vinssent à se voiler, ils se désassemblaient facilement, se décollaient ou se fendaient, malgré les préparations auxquelles ils étaient soumis et les toiles, cuirs ou parchemins collés à leur surface. On prit donc, pendant les XIVe et XVe siècles, le parti de ne donner aux panneaux des meubles que la largeur d’une planche, c’est-à-dire de 18 à 25 centimètres, et d’encadrer ces panneaux, afin de les maintenir plans, d’empêcher leur coffinage. Ce fut une véritable révolution dans la menuiserie et l’ébénisterie. La construction et la forme des meubles, soumises à ce nouveau principe, changèrent d’aspect. Les boiseries, comme tous les objets destinés à l’ameublement, au lieu de présenter ces surfaces simples, unies, favorables à la peinture, furent divisées par panneaux de largeur à peu près uniforme, compris entre des cadres, des montants et traverses accusés et saillants. Toutefois ces pièces principales étaient toujours assemblées carrément ; on ne connaissait ou l’on n’admettait pas les assemblages d’onglet : et en cela les menuisiers et ébénistes agissaient sagement ; l’assemblage d’onglet étant une des plus fâcheuses innovations dans l’art de la menuiserie, en ce qu’il ne présente jamais la solidité des assemblages à angle droit, et qu’au lieu de maintenir les panneaux, il est soumis à leur déformation.

A la fin du XIIIe siècle et au commencement du XIVe, on mariait
volontiers cependant la peinture à la sculpture dans les meubles, et
le bois sculpté destiné à être peint était parfois couvert de vélin sur lequel on exécutait des gaufrures, des dorures, des sujets et ornements
coloriés. Nul doute que, parmi ces grandes armoires qui étaient
disposées près des autels, il n’y en eut qui fussent ainsi décorées ;
mais c’est surtout dans les palais que ces meubles sculptés et revêtus
de gaufrures et peintures devaient se rencontrer, car jusqu’au
XVe siècle l’armoire, le bahut, la huche, étaient à peu près les seuls  meubles fermants, d’un usage habituel,
chez le riche seigneur comme
chez le petit bourgeois.
meubles fermants, d’un usage habituel,
chez le riche seigneur comme
chez le petit bourgeois.
Les vantaux des armoires présentent
donc rarement, à partir de la
fin du XIVe siècle, des surfaces unies
recouvertes de peinture ; ils se composent
de plusieurs panneaux embrevés
à languettes dans des montants et
traverses. Mais, à dater de cette époque,
l’art du menuisier et du sculpteur
sur bois avait fait de grands progrès :
on ne se contente pas de panneaux
simples ; autant pour les renforcer
par une plus forte épaisseur vers leur
milieu que pour les décorer, ils présentent, le plus souvent, un
ornement en forme de parchemin plié. Tels sont les panneaux du  vantail de la petite armoire que nous donnons ici (11)[9], fermée par
un simple verrou (12). Deux pentures suspendent le vantail ; voici
le détail, moitié d’exécution, de l’une d’elles (fig. 13). A l’appui de la figure 11, nous donnons diverses combinaisons de ces panneaux
figurant des parchemins pliés, si fort en vogue pendant le
XVe siècle (fig. 14).
vantail de la petite armoire que nous donnons ici (11)[9], fermée par
un simple verrou (12). Deux pentures suspendent le vantail ; voici
le détail, moitié d’exécution, de l’une d’elles (fig. 13). A l’appui de la figure 11, nous donnons diverses combinaisons de ces panneaux
figurant des parchemins pliés, si fort en vogue pendant le
XVe siècle (fig. 14).

La salle du trésor de l’église Saint-Germain l’Auxerrois, située au-dessus du porche, contient encore ses armoires, qui datent de la construction de cette partie de l’édifice, c’est-à-dire de la fin du XVe siècle. Ces meubles sont fort bien exécutés, comme toute la menuiserie de cette époque, parfaitement conservés, et garnis de leurs ferrures. Les armoires du trésor de Saint-Germain l’Auxerrois portent sur un banc (fig. 15) dont la tablette se relève. Ici les vantaux sont unis, sans peintures, décorés seulement de jolies pentures de fer plat découpé et d’entrées de serrures posées sur drap rouge ; car alors les ferrures de meubles, n’étant pas entaillées dans le bois comme elles le sont aujourd’hui, s’appliquaient sur des morceaux de cuir ou de drap découpé. La peau ou le drap débordait quelquefois la ferrure par une petite fraise, et se voyait à travers les à-jour de la serrurerie. Les vis n’étaient pas encore usitées à cette époque pour attacher les ferrures aux bois[10] ; les pièces de serrurerie sont toujours clouées ; les pointes des clous étaient même souvent rivées à l’intérieur, afin d’éviter qu’on ne pût les arracher ; dès lors, pour pouvoir frapper sur les têtes de clous sans gâter le bois, et pour que les ferrures portassent également sur toute leur surface, l’application d’un corps doux, flexible, entre elles et le bois, était nécessaire : la présence du drap ou de la peau est donc parfaitement motivée.

Les pentures, moitié d’exécution, de l’armoire que nous donnons
(fig. 15), sont faites de fer battu ajouré : celles des vantaux du haut
(16) sont ornées d’inscriptions : Sancte Vicenti, ora pro nobis[11],
et de feuillages, compris entre deux tringlettes de fer carré décorées
par des coups de lime qui composent, par leur alternance, un petit
rinceau de tigettes, ainsi que l’indique la coupe A ; celles des vantaux du bas sont simplement ajourées, sans tringlettes. Nous donnons
(fig. 17) l’extrémité de l’une d’elles. La construction de ce meuble  est fort simple. Les montants ne sont pas des poteaux carrés,
mais des madriers de 10 centimètres de face sur 5 centimètres
est fort simple. Les montants ne sont pas des poteaux carrés,
mais des madriers de 10 centimètres de face sur 5 centimètres  d’épaisseur, reliés par des traverses sur lesquelles
une moulure (fig. 18) est clouée. Une
frise à jour (19) couronne la traverse supérieure
entre les têtes des montants. Le banc
à et les côtés du meuble sont formés de panneaux
présentant des parchemins pliés. On
remarquera que les montants sont terminés
par des fleurons. A dont la face antérieure
seule est ornée de crochets sculptés aux dépens
de l’équarrissage du bois. Ces armoires
sont disposées pour la pièce qu’elles occupent. Celle-ci est boisée
ainsi que le plafond, dont les nerfs saillants viennent retomber sur
des culs-de-lampe sculptés représentant divers personnages.
d’épaisseur, reliés par des traverses sur lesquelles
une moulure (fig. 18) est clouée. Une
frise à jour (19) couronne la traverse supérieure
entre les têtes des montants. Le banc
à et les côtés du meuble sont formés de panneaux
présentant des parchemins pliés. On
remarquera que les montants sont terminés
par des fleurons. A dont la face antérieure
seule est ornée de crochets sculptés aux dépens
de l’équarrissage du bois. Ces armoires
sont disposées pour la pièce qu’elles occupent. Celle-ci est boisée
ainsi que le plafond, dont les nerfs saillants viennent retomber sur
des culs-de-lampe sculptés représentant divers personnages.
Généralement, les ferrures des meubles, toujours apparentes, sont étamées, peintes ou dorées, forgées avec soin. C’est surtout à partir du XVe siècle que les entrées de serrures des meubles sont richement travaillées, présentent des compositions obtenues au moyen de feuilles de fer battu découpées rapportées les unes sur les autres, et formant ainsi des successions de plans qui paraissent fort compliqués, quoique d’une fabrication très-simple. (Voy. Fabrication des meubles, Serrurier.)

Dans les salles de trésor des églises, les armoires, bardées de bandes de fer battu maintenues avec des clous à tête ronde, sont généralement d’un travail fort grossier. On plaçait également, dans les trésors, de petites armoires portatives destinées à contenir quelques reliques précieuses que l’on déposait, avec le meuble qui les contenait, sur les autels ou les retables, à certaines époques de l’année, ou que l’on portait en procession. La miniature dont nous donnons une copie[12] reproduit une de ces petites armoires (fig. 20). Elle est complètement dorée et semble contenir une couronne et un calice.
Il ne paraît pas que les armoires affectées aux habitations privées aient eu des formes particulières ; elles ne se distinguaient des meubles destinés à un usage religieux que par les sujets profanes peints ou sculptés sur leurs surfaces, par des écussons armoyés, des devises ou sentences.
Les provisions d’armes de main et les armures même, chez les seigneurs  châtelains, étaient soigneusement
rangées dans de grandes armoires disposées
à cet effet dans de vastes salles.
châtelains, étaient soigneusement
rangées dans de grandes armoires disposées
à cet effet dans de vastes salles.
Pour le bourgeois et le paysan, l’armoire était le meuble principal de la famille[13], et il est resté tel dans beaucoup de campagnes, où la fille qui se marie apporte toujours l’armoire dans la maison de son époux. Il n’y a guère de maison de paysan, en France, qui n’ait son armoire de chêne ou de noyer, et ce meuble se distingue des autres par son luxe relatif. L’armoire est le trésor de la famille du paysan ; il y renferme son linge, l’argenterie qu’il possède, ses papiers de famille, ses épargnes. Ce meuble, qui représente son avoir, est entretenu avec soin, luisant, les ferrures en sont brillantes. Pour que cette tradition se soit aussi bien conservée, il faut que l’armoire ait été, pendant toute la durée du moyen âge, la partie la plus importante du mobilier privé ; aussi les armoires des XVIe et XVIIe siècles ne sont-elles pas rares, et nous ne croyons pas nécessaire d’en donner ici un exemple.
AUTEL, s. m. (aultier, auter). Outre les autels fixes, dont nous n’avons pas à nous occuper ici[14], on se servait, pendant le moyen âge, d’autels portatifs. Ces autels étaient transportés pendant les
voyages, et, une fois consacrés, permettaient de célébrer la messe
deux Ewalde offraient, chaque jour, le saint sacrifice de la messe sur une table consacrée qu’ils portaient avec eux. L’ordre romain appelle ces autels des tables de voyage, tabulas itinerarias. Il ne paraît pas toutefois que les autels portatifs aient été fort en usage avant les XIe et XIIe siècles, tandis qu’à cette époque ils étaient très-communs. Saint Anselme croit devoir s’élever contre l’abus des autels portatifs[16] : « Je n’en condamne pas l’usage, dit-il, mais je préfère qu’on ne consacre pas des tables d’autels non fixes. »
Les voyages en terre sainte furent cause cependant que l’on fit beaucoup d’autels portatifs pendant le XIIe et XIIIe siècle. Ces autels se composaient d’une table de pierre, de marbre, ou de pierre dure, telle que le jaspe, l’agate, le porphyre, par exemple, enchâssée dans une bordure de cuivre ciselé, doré, niellé, émaillé, de vermeil ou de bois précieux. On voyait encore, dans certains trésors d’églises cathédrales, avant la révolution, de ces autels portatifs conservés comme objets précieux. Nous avons vu à l’exposition de la Société des arts à Londres, en 1850, un bel autel portatif du XIIIe siècle, faisant partie du cabinet du révérend docteur Rock[17]. Ce meuble se compose d’une table de jaspe oriental de 11 centimètres de largeur sur 22 centimètres de longueur environ, enchâssée dans une riche bordure d’argent niellé, et supportée par un socle d’orfèvrerie délicatement travaillé. Les nielles représentent, parmi de beaux rinceaux, un agneau au milieu de deux anges. Aux angles, on voit des demi-figures de rois (pl. II). Il n’est pas besoin de dire que les autels portatifs contenaient toujours des reliques. Ces autels, de forme carrée ou barlongue, étaient ordinairement renfermés dans des coffres de bois ou des étuis de cuir estampé, armoyés aux armes du personnage auquel ils appartenaient, garnis de courroies et de fermoirs[18].
M. le prince Soltykoff possédait, dans sa belle collection d’objets du moyen âge, un autel portatif provenant du cabinet Debruge-Duménil,
décrit par M. J. Labarte[19]. Cet autel se compose d’une
plaque de marbre lumachelle de 165 millimètres de longueur
sur 135 millimètres de largeur, incrustée dans une pièce de bois  de 3 centimètres d’épaisseur. La table est entourée d’une plaque
de cuivre doré, avec clous à têtes plates niellées, percée en haut
et en bas pour laisser voir deux petits bas-reliefs d’ivoire, l’un représentant un crucifiement avec la Vierge et saint Jean, l’autre la
sainte Vierge assise avec deux évêques à droite et à gauche (fig. 1).
de 3 centimètres d’épaisseur. La table est entourée d’une plaque
de cuivre doré, avec clous à têtes plates niellées, percée en haut
et en bas pour laisser voir deux petits bas-reliefs d’ivoire, l’un représentant un crucifiement avec la Vierge et saint Jean, l’autre la
sainte Vierge assise avec deux évêques à droite et à gauche (fig. 1).  Deux plaques de cristal de roche, maintenues par une bordure
saillante, ornent les deux côtés du cadre de cuivre ; sous ces plaques
ont été posées, à la fin du XIIIe siècle, deux petites miniatures représentant des évêques. Sous la table de marbre sont renfermées
un grand nombre de reliques dans un morceau de toile de coton.
Cet autel portatif date de la première moitié du XIIIe siècle. Les
angles du cadre, entre les bas-reliefs et les plaques de cristal, sont
décorés de gravures représentant les signes des évangélistes, saint
André, saint Pierre, saint Étienne, premier martyr, et saint
Laurent. Nous donnons (fig. 2) l’un de ces angles grandeur d’exécution.
Les bords du meuble sont également décorés de gravures
dont la figure 3 donne un fragment. Le dessous de l’autel est entièrement
revêtu d’une plaque de cuivre couverte par une longue
Deux plaques de cristal de roche, maintenues par une bordure
saillante, ornent les deux côtés du cadre de cuivre ; sous ces plaques
ont été posées, à la fin du XIIIe siècle, deux petites miniatures représentant des évêques. Sous la table de marbre sont renfermées
un grand nombre de reliques dans un morceau de toile de coton.
Cet autel portatif date de la première moitié du XIIIe siècle. Les
angles du cadre, entre les bas-reliefs et les plaques de cristal, sont
décorés de gravures représentant les signes des évangélistes, saint
André, saint Pierre, saint Étienne, premier martyr, et saint
Laurent. Nous donnons (fig. 2) l’un de ces angles grandeur d’exécution.
Les bords du meuble sont également décorés de gravures
dont la figure 3 donne un fragment. Le dessous de l’autel est entièrement
revêtu d’une plaque de cuivre couverte par une longue  inscription gravée entre des bandes, de ce vernis brun foncé que
l’on trouve fréquemment appliqué sur les bronzes dorés des XIIe et
XIIIe siècles de fabrication rhénane. Cette inscription, transcrite par
M. Labarte[20], donne le catalogue des reliques renfermées sous
la plaque de marbre. Sous le petit bas-relief de la Vierge, on lit :
« THIDERICUS. ABBAS. III. DEDIT. » Cet autel provient de l’ancienne
abbaye de Sayna, près de Coblentz.
inscription gravée entre des bandes, de ce vernis brun foncé que
l’on trouve fréquemment appliqué sur les bronzes dorés des XIIe et
XIIIe siècles de fabrication rhénane. Cette inscription, transcrite par
M. Labarte[20], donne le catalogue des reliques renfermées sous
la plaque de marbre. Sous le petit bas-relief de la Vierge, on lit :
« THIDERICUS. ABBAS. III. DEDIT. » Cet autel provient de l’ancienne
abbaye de Sayna, près de Coblentz.
Quelquefois, mais plus rarement, les autels portatifs étaient en forme de disque. On voit encore, au fond du chœur de la cathédrale de Besançon, enchâssé dans la muraille, un disque de marbre blanc sur lequel divers symboles sont sculptés, et que l’on prétend avoir servi d’autel.
B
BAHUT, s m. (bahu, bahur). On donna en nom primitivement à des enveloppes d’osier recouvertes de peau de vache, renfermant un coffre de bois, qui servait, comme nos malles, à transporter des effets d’habillement et tous les objets nécessaires en voyage. Plus tard, le coffre lui-même, avec ses divisions et tiroirs, prit le nom de bahut. De coffre transportable, le bahut devint un meuble fixe. Il n’était pas de chambre, au moyen âge, qui n’eût son bahut. On y renfermait des habits, de l’argent, du linge, des objets précieux ; il servait, au besoin, de table ou de banc, et formait, avec l’armoire et le lit, les pièces principales du mobilier privé des gens riches comme des plus humbles particuliers. Dans les dépendances des églises, telles que sacristies, salles capitulaires, vestiaires, on plaçait aussi des bahuts. On y serrait des tentures, les tapisseries, les voiles destinés à la décoration des chœurs les jours solennels, des parchemins, des chartes, des actes, etc. Cependant le nom de bahut fut également conservé aux coffres de voyage jusqu’à la fin du XVe siècle[21].
Le bahut fixe est ordinairement un coffre long posé sur quatre pieds courts, ou sur le sol, fermé par un couvercle qui se relève au moyen de pentures ou charnières. Le bahut est muni d’une ou plusieurs serrures, selon qu’il contient des objets plus ou moins précieux.
Les plus anciens bahuts sont fortement ferrés de bandes de fer forgé quelquefois avec luxe, le bois était recouvert de peau ou de toile peinte marouflée. Il en est du bahut comme des armoires : sa forme première est très-simple ; les ferrures, la peinture, ou les cuirs gaufrés et dorés le décorent ; plus tard, la sculpture orne ses parois et même quelquefois son dessus. Le marchand qui paye ou reçoit est assis devant son bahut ouvert ; l’avare couche sur son bahut ; on devise en s’asseyant sur le bahut orné de coussins mobiles. Le bahut est coffre, huche, banc, lit même parfois, armoire, trésor ; c’est le meuble domestique le plus usuel du moyen âge. Du temps de Brantôme encore, à la cour, chez les riches seigneurs, on s’asseyait sur des coffres ou bahuts, pendant les nombreuses réunions, comme de nos jours on s’assied sur des banquettes[22]. L’aspect tant soit peu sévère du bahut primitif (fig. 1)[23] correspondait à celui des armoires, c’est-à-dire que ces meubles étaient composés d’ais de bois, décorés seulement d’une simple gravure, de filets par exemple, comme celui-ci, et de ferrures plus ou moins riches, destinées à maintenir solidement les planches entre elles. Le bahut s’élève bientôt sur quatre pieds, formant des montants dans lesquels les planches viennent s’embrever (fig. 2)[24] Des ferrures posées aux angles relient ces montants avec les parois. La miniature dont nous donnons ci-contre un fac-similé montre le bahut ouvert, rempli d’argent. Le personnage déguenillé assis devant le meuble en tire un sac d’écus offert en échange d’un vase d’or qu’il semble peser de la main gauche, et qu’un second personnage paraît donner en gage.

Du temps d’Étienne Boileau, c’est-à-dire au XIIIe siècle, les huchers
ou huchiers faisaient partie de la corporation des charpentiers ; c’est assez dire ce qu’étaient ces meubles d’un usage si général à
cette époque[25]. L’industrie de l’ébéniste (alors désigné sous le nom
de tabletier) s’appliquait à des ouvrages moins ordinaires ; ces  derniers employaient des bois précieux,
l’ivoire, la corne, et ne s’occupaient pas
de fabriquer des meubles vulgaires. Cependant,
bien que les bahuts, coffres, huches,
fussent des meubles destinés à toutes
les classes, et fort communs, on avait cru
devoir faire un supplément de règlement
pour les huchers, afin d’éviter que la marchandise
livrée par eux ne fût défectueuse :
« Les ouvriers huchers ne pouvaient aller
travailler chez les clients du maître
hucher que par son ordre ; défense était
faite aux maîtres de procurer des outils
aux ouvriers qui ne travaillaient qu’à la tâche ou à la journée ;
défense était faite de louer des coffres à gens morts[26]. » Cette
dernière clause fait supposer que les huchers louaient quelquefois,
aux familles pauvres, qui voulaient s’épargner les frais d’un cercueil
pour leurs parents morts, des coffres ou bahuts peur porter le corps
jusqu’au cimetière.
derniers employaient des bois précieux,
l’ivoire, la corne, et ne s’occupaient pas
de fabriquer des meubles vulgaires. Cependant,
bien que les bahuts, coffres, huches,
fussent des meubles destinés à toutes
les classes, et fort communs, on avait cru
devoir faire un supplément de règlement
pour les huchers, afin d’éviter que la marchandise
livrée par eux ne fût défectueuse :
« Les ouvriers huchers ne pouvaient aller
travailler chez les clients du maître
hucher que par son ordre ; défense était
faite aux maîtres de procurer des outils
aux ouvriers qui ne travaillaient qu’à la tâche ou à la journée ;
défense était faite de louer des coffres à gens morts[26]. » Cette
dernière clause fait supposer que les huchers louaient quelquefois,
aux familles pauvres, qui voulaient s’épargner les frais d’un cercueil
pour leurs parents morts, des coffres ou bahuts peur porter le corps
jusqu’au cimetière.
Mais les bahuts ne conservèrent pas longtemps ce caractère de coffre ferré, verrouillé ; lorsque les intérieurs des appartements reçurent de riches boiseries, des tentures précieuses de tapisserie, de toiles peintes ou de cuir gaufré et doré, ces sortes de meubles de bois uni, recouverts seulement de peau ou de toile, ne pouvaient convenir ; la sculpture s’empara des bahuts, et les huchers devinrent des artisans habiles. On renonça aux ais épais et seulement aplanis, pour former les bahuts de panneaux assemblés dans des montants et traverses, et couverts d’ornements, d’emblèmes, de devises, d’armoiries, d’inscriptions ; les pentures et ferrures furent remplacées par des ouvrages de serrurerie moins apparents, mais délicatement travaillés.
Nous donnons ici (fig. 3) un beau bahut du commencement du
XIVe siècle, qui sert de transition entre le bahut à bois plans recouverts
de ferrures et le bahut à panneaux, la huche. Ce bahut, qui appartenait à la collection de M. A. Gérente[27], est encore composé
d’ais sculptés en plein bois, et non de panneaux embrevés dans
des montants. Nous regardons ce meuble comme le plus beau qui
nous soit resté de ce siècle ; sa longueur est de 1m,38, sur 65 centimètres
de haut et 34 centimètres de largeur. C’est probablement
un de ces coffres de mariage que l’époux envoyait, rempli de bijoux  et d’objets de parure, à l’épousée, la veille des noces. Sa face antérieure
représente les douze pairs couverts de leurs armes ; les costumes
de ces personnages ne peuvent laisser de doute sur l’époque
précise à laquelle appartient ce meuble (de 1280 à 1300). Tous ces
guerriers sont encore vêtus de mailles avec le haubert par dessus ;
leurs épaules sont garnies d’ailettes carrées ; les heaumes sont de
fer battu et affectent la forme conique ou sphérique (fig. 4). Leurs
écus armoyés sont pendus à leur côté ou tenus du bras gauche. Ces
douze personnages sont placés dans une jolie arcature d’un faible
relief à simples biseaux. Dans les écoinçons, des têtes bizarres, des
animaux fantastiques sont sculptés en bas-relief. Le côté droit
du bahut représente les douze pairs à cheval ; le côté gauche, un chêne au pied duquel on voit un phallus sur pattes, becqueté par un
oiseau. Le dessus du couvercle montre, dans douze quatre-feuilles en
bas-relief, des scènes de la vie conjugale et une sorte de harpie touchant
de l’orgue à main, à côté d’un homme jouant de la cornemuse
et d’objets de parure, à l’épousée, la veille des noces. Sa face antérieure
représente les douze pairs couverts de leurs armes ; les costumes
de ces personnages ne peuvent laisser de doute sur l’époque
précise à laquelle appartient ce meuble (de 1280 à 1300). Tous ces
guerriers sont encore vêtus de mailles avec le haubert par dessus ;
leurs épaules sont garnies d’ailettes carrées ; les heaumes sont de
fer battu et affectent la forme conique ou sphérique (fig. 4). Leurs
écus armoyés sont pendus à leur côté ou tenus du bras gauche. Ces
douze personnages sont placés dans une jolie arcature d’un faible
relief à simples biseaux. Dans les écoinçons, des têtes bizarres, des
animaux fantastiques sont sculptés en bas-relief. Le côté droit
du bahut représente les douze pairs à cheval ; le côté gauche, un chêne au pied duquel on voit un phallus sur pattes, becqueté par un
oiseau. Le dessus du couvercle montre, dans douze quatre-feuilles en
bas-relief, des scènes de la vie conjugale et une sorte de harpie touchant
de l’orgue à main, à côté d’un homme jouant de la cornemuse  (fig. 5). La ferrure de ce meuble, autrefois peint, est fort belle :
la fig. 4 donne l’entrée de la serrure, et la fig. 6 une des pentures.
Mais la façon dont le couvercle du bahut roule sur ses charnières
mérite d’être mentionnée. Les deux montants de derrière forment charnière à, leur extrémité (fig. 6 bis), et reçoivent une fiche ou
plutôt un boulon sur lequel roule le couvercle. Afin d’éviter que le
contre-coup de ce couvercle ne vienne à fatiguer les charnières de
bois lorsqu’on le laisse retomber, deux bouts de chaîne A, attachés
(fig. 5). La ferrure de ce meuble, autrefois peint, est fort belle :
la fig. 4 donne l’entrée de la serrure, et la fig. 6 une des pentures.
Mais la façon dont le couvercle du bahut roule sur ses charnières
mérite d’être mentionnée. Les deux montants de derrière forment charnière à, leur extrémité (fig. 6 bis), et reçoivent une fiche ou
plutôt un boulon sur lequel roule le couvercle. Afin d’éviter que le
contre-coup de ce couvercle ne vienne à fatiguer les charnières de
bois lorsqu’on le laisse retomber, deux bouts de chaîne A, attachés  à un piton et à l’extrémité de la penture, arrêtent les deux angles
postérieurs de l’abattant. Ces chaînes ont encore pour effet d’empêcher
de forcer le meuble en brisant les charnières ou en enlevant les
à un piton et à l’extrémité de la penture, arrêtent les deux angles
postérieurs de l’abattant. Ces chaînes ont encore pour effet d’empêcher
de forcer le meuble en brisant les charnières ou en enlevant les  fiches. Ce couvercle, à gorge sur les côtés, tombe dans une feuillure
garnie de goujons B, qui arrêtent tout mouvement de va-et-vient, et
maintiennent la gorge parfaitement fixe dans sa feuillure. Les ais du
coffre sont fortement maintenus par des membrures intérieures, et
l’on observera que le couvercle n’est pas plan, mais forme deux
pentes s’inclinant légèrement à droite et à gauche (voy. fig. 3), ce
qui donne au meuble un caractère de solidité particulier ; le couvercle
est maintenu ouvert au moyen d’une chaîne intérieure. Quoique large, et même parfois grossière, la sculpture de ce bahut est d’un
beau style.
fiches. Ce couvercle, à gorge sur les côtés, tombe dans une feuillure
garnie de goujons B, qui arrêtent tout mouvement de va-et-vient, et
maintiennent la gorge parfaitement fixe dans sa feuillure. Les ais du
coffre sont fortement maintenus par des membrures intérieures, et
l’on observera que le couvercle n’est pas plan, mais forme deux
pentes s’inclinant légèrement à droite et à gauche (voy. fig. 3), ce
qui donne au meuble un caractère de solidité particulier ; le couvercle
est maintenu ouvert au moyen d’une chaîne intérieure. Quoique large, et même parfois grossière, la sculpture de ce bahut est d’un
beau style.

À ce sujet, nous ferons remarquer que, dans les meubles antérieurs au XVe siècle encore existants, le style paraît préoccuper les fabricants plutôt que l’exécution. Il semblerait que, jusqu’à cette époque, des artistes, des maîtres prenaient la peine de donner les éléments de ces objets destinés à l’usage journalier, tandis que plus tard, et jusqu’à la renaissance, l’exécution l’emporta sur la composition et le style ; les meubles, parfaits comme travail, perdirent cet aspect monumental, simple, qui, dans les belles époques de l’art, se retrouve jusque dans les objets les plus vulgaires de la vie domestique.
Au XIVe siècle, on plaçait des bahuts servant de bancs dans presque toutes les pièces des appartements. Mais il en était un plus riche que les autres, mieux fermé, auquel on donnait de préférence le nom de huche, et qui était destiné à contenir les bijoux, l’argent et les objets les plus précieux du maître ou de la maîtresse de la maison. Du Guesclin ne se fait pas scrupule d’enfoncer la huche de sa mère pour s’emparer de l’argent dont il a besoin pour payer ses compagnons d’armes :
« Quant argent i faloit, et petit argent a,
« En la chambre sa mère, privéement entra,
« Une huche rompi, ou escrin trouva
« Ou les joiaux sa mère, sachiez (cachés) estoient là,
« Et argent et or fin que la dame garda.
« Bertrand mist tout à fin, à ses gens en donna :
« Et quant la dame sceut comment Bertrand ouvra
« A démenter se prist, son argent regreta[28]. »
Au XVe siècle, la menuiserie fut traitée d’une manière remarquable comme construction et exécution ; les bahuts, ou plutôt les huches, se couvrirent de riches panneaux présentant de ces arcatures et combinaisons de courbes si fréquentes à cette époque[29], ou des simulacres de parchemins pliés. Voici un exemple (fig 7) d’un de ces bahuts servant de table, copié sur l’un des petits bas-reliefs qui décorent les soubassements de la clôture du chœur de la cathédrale d’Amiens[30]. Le personnage est assis sur un de ces pliants faudesteuils, fort en usage pendant le XVe siècle et le commencement du XVIe.
Lorsque des habitudes de comfort se furent introduites dans l’ameublement, les bahuts servant de bancs furent souvent garnis d’appuis, de dossiers et même de dais (voy. Banc) ; leur abattant fut couvert de coussins ou de tapis mobiles, au lieu de ces toiles peintes ou cuirs gaufrés collés sur leur surface.
Pendant les XVIe et XVIIe siècles, le bahut fit encore partie du mobilier domestique, et il en existe un grand nombre qui datent de cette époque. L’usage d’envoyer les présents de noce à la mariée dans de riches bahuts se conserva jusque vers le milieu du dernier siècle. Au Louvre, sous Louis XIII, les salles des gardes étaient encore garnies de coffres ou bahuts qui servaient de bancs. Lorsque Vitry attend le maréchal d’Ancre, « il demeure longtemps dans la salle des Suisses, assis sur un coffre, ne faisant semblant de rien »[31].

On disait : « piquer le bahut, » pour attendre dans une antichambre l’audience d’un personnage ; parce qu’alors, pour passer le temps, celui qui attendait s’amusait à piquer avec sa dague le couvercle du bahut sur lequel il était assis.
Aujourd’hui, la huche du paysan, qui sert à faire le pain, et les banquettes-coffres de nos antichambres, sont un dernier souvenir de ce meuble du moyen âge.
BANC, s. m. Meuble composé d’une planche assemblée dans deux montants servant de pied. Dans les premiers siècles de la monarchie française, le banc était autant une table qu’un siége. « J’arrive », dit Grégoire de Tours[32], « mandé par Chilpéric ; le roi était debout, près d’un pavillon formé de branches d’arbres. A sa droite était l’évêque Bertrand ; à sa gauche, Raguemod. Devant eux un banc[33] chargé de pains et de mets divers »
Il était d’usage de couvrir de tapis les bancs posés autour des salles, du temps de Grégoire de Tours. « Waddon arrive, entre aussitôt dans la maison, et dit : — Pourquoi ces bancs ne sont-ils pas couverts de tapis ? Pourquoi cette maison n’est-elle pas balayée ?…[34] » Lorsque Robert, duc de Normandie, entreprend d’aller en pèlerinage à Jérusalem, passant à Constantinople, il est admis avec les Normands de sa suite, à une audience de l’empereur d’Orient. La salle dans laquelle les seigneurs normands sont reçus était dépourvue de siéges : ceux-ci se dépouillent de leurs manteaux, les jettent à terre, s’asseyent dessus et dédaignent de les reprendre en partant. Le duc répond au Grec qui veut lui rattacher son manteau.
« Jo ne port pas mun banc od mei »
…
« Pur la noblesce des Normanz,
« Ki de lur manteals firent bancz,
« Fist l’Emperor el paleiz faire
« Bancz à siege envirun l’aire ;
« Ainz à cel tems à terre séeint,
« Ki el paleiz séer voleient[35]. »
A Constantinople, l’usage des siéges était donc inconnu au XIe siècle, et les Grecs s’asseyaient à terre sur des tapis, comme les Orientaux de nos jours. Par courtoisie, l’empereur fait faire des bancs autour de la salle du palais, afin que les Normands puissent s’asseoir conformément à leurs habitudes, pendant leur séjour à Byzance.
Guillaume, duc de Normandie, apprend la mort d’Édouard et le couronnement de Harold, étant à la chasse ; il devient pensif, rentre dans son palais, et :
<poem class="lang-fro" lang="fro" style="font-size:83%; " >:::« Al chief d’un banc s’est acotez,
- « D’ores en altre s’est tornez,
- « De sun mantel covri sun vis,
- « Sor un pecol (appui) sun chief a mis ;
- « Issi pensa li Dus grant pose,
- « Ke l’en parler à li n’en ose[36]. »
Les bancs étaient donc munis d’appuis au XIe siècle ; ces appuis
n’étaient que la prolongation des deux montants servant de pieds,  avec une barre pour dossier (fig. 1)[37]. Dans les églises, dès l’époque
romane, on faisait habituellement régner une assise de pierre saillante
avec une barre pour dossier (fig. 1)[37]. Dans les églises, dès l’époque
romane, on faisait habituellement régner une assise de pierre saillante  à l’intérieur des bas côtés ou chapelles, formant un banc continu. Cet usage se perpétua pendant la période ogivale, car alors on
n’établissait pas, comme aujourd’hui, des bancs en menuiserie ou
des chaises pour les fidèles. Mais dans les dépendances des églises,
dans les salles capitulaires, les bibliothèques et les sacristies, on plaçait
des bancs de bois ; les bahuts (voy. ce mot) en tenaient souvent
lieu. Ces bancs furent alors garnis d’appuis, de dossiers et même de
dais. Ils étaient d’une forme très-simple jusqu’au XIVe siècle, composés
de forts madriers, ornés seulement de quelques gravures. Nous
avons encore vu des débris de bancs de ce genre, qui paraissent dater
du commencement du XIIIe siècle, dans des salles voisines des églises
pauvres dont le mobilier n’avait pas été renouvelé (fig. 2).
à l’intérieur des bas côtés ou chapelles, formant un banc continu. Cet usage se perpétua pendant la période ogivale, car alors on
n’établissait pas, comme aujourd’hui, des bancs en menuiserie ou
des chaises pour les fidèles. Mais dans les dépendances des églises,
dans les salles capitulaires, les bibliothèques et les sacristies, on plaçait
des bancs de bois ; les bahuts (voy. ce mot) en tenaient souvent
lieu. Ces bancs furent alors garnis d’appuis, de dossiers et même de
dais. Ils étaient d’une forme très-simple jusqu’au XIVe siècle, composés
de forts madriers, ornés seulement de quelques gravures. Nous
avons encore vu des débris de bancs de ce genre, qui paraissent dater
du commencement du XIIIe siècle, dans des salles voisines des églises
pauvres dont le mobilier n’avait pas été renouvelé (fig. 2).

Dans les habitations, les bancs étaient recouverts de coussins ou d’une étoffe rembourrée non fixée après la tablette. Les montants latéraux étaient souvent ornés de sculptures, et se recourbaient pour offrir un appui plus commode (fig. 3)[38]. Si l’on s’en rapporte aux vignettes des manuscrits, aux peintures et descriptions, les bois de ces meubles étaient rehaussés de couleurs, de dorures, d’incrustations d’or, d’argent et d’ivoire[39]. Au XIIIe siècle, on ne se contenta pas de tablettes assemblées dans des montants ; les bancs affectèrent souvent la forme d’un coffre long, c’est-à-dire que le devant fut garni de planches ornées d’à-jour, d’arcatures et de peintures ; ils pouvaient alors être considérés comme de véritables bahuts, bien qu’ils fussent plus longs que n’étaient ces derniers meubles. Ce qui distingue particulièrement le banc, avec ou sans dossier, de la forme ou chaire, par exemple (voy. ces mots), c’est que le banc est transportable, qu’il peut être déplacé. Ainsi, pendant le moyen âge, on garnissait habituellement les tables à manger de bancs mobiles sur lesquels on jetait des coussins.

Voici deux exemples de ces sortes de bancs, tirés d’un manuscrit (fig. 4)[40] ; le dessus de ces siéges se relevait, et, étant fermé par une serrure, permettait de serrer des objets. Pendant les XIVe et XVe siècles, les bancs, comme tous les autres meubles domestiques, furent décorés de riches étoffes, de cuirs dorés et gaufrés, ou de tapisseries. « Le duc de Bourgogne fut en celle journée assis sur un banc paré de tapis, de carreaux et de palles ; et fut environné de sa noblesse et accompaigné et adextré de son conseil qui estoyent derrière la perche (le dossier) du banc, tous en pié, et prests pour conseiller le duc si besoing en avoit, et dont les plus prochains de sa personne furent le chancelier et le premier chambellan ; et ceux-là estoyent au plus près du prince, l’un à dextre et l’autre à sénestre[41]. »
Pendant les XVe et XVIe siècles, beaucoup de familles nobles firent
construire des chapelles particulières attenantes aux églises. L’intérieur
de ces chapelles était meublé comme un oratoire privé ; les
murs étaient garnis de bancs de bois à dossier ; on y plaçait des prie-Dieu,
des pupitres, des tapis, des carreaux, etc. Voici un banc (fig. 5) provenant d’une de ces chapelles. Ce meuble appartient aux premières
années du XVIe siècle, et est encore déposé dans l’église de  Flavigny ; il est garni de son dossier, et surmonté d’un dais de bois
sculpté. La tablette du banc devait recevoir des carreaux de tapisserie
et d’étoffe ; ce dont on ne peut douter, les traces des attaches de cette garniture étant encore visibles, et les petites bases des pilastres
s’arrêtant au point où elle était fixée. Dans les châteaux, les vestibules,
les salles des gardes, les pièces destinées aux réceptions
étaient entourées de bancs plus ou moins somptueux, soit comme
sculpture, soit comme garniture, en raison de la richesse des propriétaires.
Chez les bourgeois, la salle, c’est-à-dire la pièce où l’on
admettait les étrangers, était également entourée de bancs qui servaient
en même temps de coffres ; les uns n’étaient que des coffres,
les autres étaient munis de marches en avant et de coussins. On trouve
dans l’inventaire d’un certain Jean Rebours, garde du scel de l’archevêché
de Sens et curé d’Ervy, dressé en 1399, parmi les meubles,
« une aumoire de bois à trois étages doubles, un banc, un banc à
marche, deux banchiers » (couvertures de bancs)[42].
Flavigny ; il est garni de son dossier, et surmonté d’un dais de bois
sculpté. La tablette du banc devait recevoir des carreaux de tapisserie
et d’étoffe ; ce dont on ne peut douter, les traces des attaches de cette garniture étant encore visibles, et les petites bases des pilastres
s’arrêtant au point où elle était fixée. Dans les châteaux, les vestibules,
les salles des gardes, les pièces destinées aux réceptions
étaient entourées de bancs plus ou moins somptueux, soit comme
sculpture, soit comme garniture, en raison de la richesse des propriétaires.
Chez les bourgeois, la salle, c’est-à-dire la pièce où l’on
admettait les étrangers, était également entourée de bancs qui servaient
en même temps de coffres ; les uns n’étaient que des coffres,
les autres étaient munis de marches en avant et de coussins. On trouve
dans l’inventaire d’un certain Jean Rebours, garde du scel de l’archevêché
de Sens et curé d’Ervy, dressé en 1399, parmi les meubles,
« une aumoire de bois à trois étages doubles, un banc, un banc à
marche, deux banchiers » (couvertures de bancs)[42].
BERCEAU, s. m. (bers). Les berceaux d’enfant, les plus anciens
et les plus simples, figurés dans des manuscrits des IXe et Xe siècles,
paraissent être formés d’un morceau de tronc d’arbre creusé, avec
de petits trous sur les bords, pour passer des bandelettes destinées
à empêcher le marmot de se mouvoir. La convexité naturelle du bois  à l’extérieur permettait à la nourrice
de bercer l’enfant[43]. Quelquefois les berceaux
ne sont que des paniers d’osier,
dans lesquels on déposait les enfants,
soigneusement entourés de bandelettes
(fig. 1[44]). Plus tard, on trouve un grand
nombre d’exemples de berceaux qui
sont façonnés comme de petits lits posés
sur deux morceaux de bois courbes
(fig. 2). On ne rencontre guère d’exemples
de berceaux suspendus au-dessus
du sol sur deux montants, que dans les
manuscrits ou bas-reliefs du XVe siècle ;
alors ces montants sont fixes, et le berceau se meut au moyen de
deux tourillons (fig. 3). Les enfants représentés dans les berceaux
ou entre les bras de leurs nourrices, jusqu’au XVIe siècle, ont toujours
le corps et les bras soigneusement emmaillottés et entourés de bandelettes ; la tête seule reste libre. Cet usage s’est conservé en
Orient et dans le sud de l’Italie, et il ne paraît pas que le développement
physique des enfants ait à en souffrir.
à l’extérieur permettait à la nourrice
de bercer l’enfant[43]. Quelquefois les berceaux
ne sont que des paniers d’osier,
dans lesquels on déposait les enfants,
soigneusement entourés de bandelettes
(fig. 1[44]). Plus tard, on trouve un grand
nombre d’exemples de berceaux qui
sont façonnés comme de petits lits posés
sur deux morceaux de bois courbes
(fig. 2). On ne rencontre guère d’exemples
de berceaux suspendus au-dessus
du sol sur deux montants, que dans les
manuscrits ou bas-reliefs du XVe siècle ;
alors ces montants sont fixes, et le berceau se meut au moyen de
deux tourillons (fig. 3). Les enfants représentés dans les berceaux
ou entre les bras de leurs nourrices, jusqu’au XVIe siècle, ont toujours
le corps et les bras soigneusement emmaillottés et entourés de bandelettes ; la tête seule reste libre. Cet usage s’est conservé en
Orient et dans le sud de l’Italie, et il ne paraît pas que le développement
physique des enfants ait à en souffrir.

Nous n’avons pas vu, dans les manuscrits, peintures ou bas-reliefs,
que les berceaux des enfants fussent munis de rideaux jusqu’au  XVIe siècle. Il est vrai que les lits des grandes personnes étaient fort
vastes, entourés presque toujours d’amples courtines, et que la nuit
le berceau de l’enfant était mis à l’abri derrière ces courtines qui enveloppaient ainsi toute la famille comme sous une tente commune.
XVIe siècle. Il est vrai que les lits des grandes personnes étaient fort
vastes, entourés presque toujours d’amples courtines, et que la nuit
le berceau de l’enfant était mis à l’abri derrière ces courtines qui enveloppaient ainsi toute la famille comme sous une tente commune.
BUFFET, s. m. On entendait par ce mot, pendant le moyen âge, la chambre où l’on renfermait la vaisselle, des objets précieux, tels que vases, bijoux, curiosités ; on donna aussi, pendant les XIVe et XVe siècles, le nom de buffet au meuble que l’on plaçait, pendant les repas de cérémonie, au milieu de l’espace réservé entre les tables en fer à cheval, et sur lequel on rangeait des pièces d’orfèvrerie, des épices et confitures, comme sur des gradins. Le dressoir est un meuble servant au même usage, mais ordinairement appliqué contre le mur ; tandis que le buffet est isolé, on tourne autour, il pare le centre de la salle du festin. C’est surtout pendant le XVe siècle, alors que le luxe intérieur atteignit des proportions extravagantes, que les buffets furent en grand usage. À cette époque, le mot buffet indique non-seulement le meuble, mais tous les objets dont on le couvre ; on dit buffet pour exprimer l’ensemble de ces décorations de fêtes. Aux entrées de souverains, d’ambassadeurs, on offre un buffet, c’est-à-dire qu’on donne au personnage auquel on veut faire honneur un amas de vaisselle d’argent ou de vermeil contenant des rafraîchissements ; et, dans ce cas, le meuble et ce qu’il porte appartient audit personnage.
C’est au buffet, dans les repas d’apparat, que viennent les chevaliers, écuyers ayant la charge de servir les souverains, pour prendre les plats qui doivent être distribués sur les tables, « En celle salle avoit trois tables drécées, dont l’une fut au bout de dessus… Celle table étoit plus haute que les autres, et y montoit on à marches de degrés… Aux deux costés de ladite salle, tirant du long, furent les autres deux tables drécées, moult belles et moult longues ; et au milieu de ladite salle avoit un haut et riche buffet, faict à manière d’une lozange. Le dessouz dudict buffet estoit clos à manière d’une lice, et tout tapicé et tendu des armes de Monsieur le Duc ; et delà en avant commençoyent marches et degrez chargés de vaisselle, dont par le plus bas estoit la plus grosse, et par le plus haut estoit la plus riche et la plus mignole ; c’est à sçavoir par le bas la grosse vaisselle d’argent dorée, et par l’amont estoit la vaisselle d’or, garnie de pierrerie, dont il y avoit à très grand nombre. Audessus dudict buffet avoit une riche coupe garnie de pierrerie, et par les quarrés dudict buffet avoit grandes cornes de licornes toutes entières, moult grandes et moult belles ; et de toute la vaisselle de la pareure dudict buffet ne fut servi pour ce jour, mais avoyent autre vaisselle d’argent, de pots et de tasses, dont la salle et les chambres furent servies ce jour[45]. » C’est là un buffet d’apparat, destiné à récréer la vue pendant le repas.
Voici le buffet d’usage. « Au regard du service, Madame la nouvelle duchesse fut servie d’eschançon et d’escuyer tranchant, et de pannetier, tous Anglois, tous chevaliers, et gens de grande maison ; et l’huissier de salle cria : « Chevaliers, à la viande ! » Et ainsi ala-on au buffet la viande quérir ; et autour du buffet marchoyent tous les parens de Monsieur, et tous les chevaliers tant de l’ordre que de grand-maison, tous deux à deux, après les trompettes, devant la viande…[46] »
Le buffet, au moyen âge, n’était donc pas, à proprement parler, un meuble, mais une sorte d’échafaudage dressé pour une cérémonie ; il n’était décoré que par les étoffes dont il était tapissé et surtout par les objets de prix qu’il supportait. (Voy. Dressoir.)
Buffet s’entend aussi comme soufflet (voy. au Dictionnaire des ustensiles le mot Buffet).
BUSTAIL, s. m. Vieux mot qui signifie bois de lit (voy. Lit).
C
CABINET, s. m. Au XVIe siècle, on donna ce nom à une armoire montée sur quatre pieds, fermée par deux vantaux, et remplie de petits tiroirs. Ce meuble est particulièrement en usage pendant le XVIIe siècle. On y serrait des bijoux, des objets précieux ; c’est le bahut du moyen âge, dressé sur quatre pieds, ainsi que le fait remarquer judicieusement M. le comte de Laborde[47] (Voy. Bahut.)
CASIER, s. m. Sorte de garde-manger en forme de huche (voy. Huche).
CHAALIT, s. m. Vieux mot employé pour bois de lit (voy. Lit).
CHAISE, s. f. (chaire, chaière, forme, fourme). Siége garni de bras et dossier, quelquefois de dais pendant les XIVe et XVe siècles. Nous comprenons dans cet article tous les siéges, meubles, et même les trônes de bois ou de métal, sauf les siéges pliants, faudesteuils (voy. ce mot). Quant aux chaires de marbre et de pierre, nous les considérons comme immeubles, et nous renvoyons nos lecteurs au Dictionnaire d’architecture, dans lequel ces objets sont décrits.
Il semble que, dès les premiers temps du moyen âge, on ait voulu donner aux siéges une élégance et une richesse particulières ; il est à remarquer que, plus les meubles se rattachent à l’usage personnel, plus ils sont traités avec luxe. Les vêtements étant fort riches, on comprendra ce besoin de mettre en harmonie avec ceux-ci les meubles destinés, pour ainsi dire, à les compléter. Si un personnage, vêtu de couleurs éclatantes et d’étoffes précieuses, s’assied dans une chaire grossière comme matière et comme travail, la disparate sera trop choquante. On ne sera donc pas étonné si les exemples de siéges que nous donnons ici sont, relativement aux autres meubles, d’une richesse remarquable.
Les chaires étaient déjà fort anciennement incrustées d’or, d’ivoire, d’argent, de cuivre, composées de marqueterie, recouvertes d’ètoffes brillantes, non point, comme cela se pratique de nos jours, par des tissus cloués, rembourrés et fixes, mais par des coussins et des tapis mobiles, attachés par des courroies, ou jetés sur le bois. Ces sortes de meubles étaient rares d’ailleurs ; dans la pièce principale de l’appartement, il n’y avait, la plupart du temps, qu’une seule chaire, place d’honneur réservée au seigneur, au chef de la famille ou à l’étranger de distinction que l’on recevait. Autour de la pièce, on ne trouvait pour s’asseoir que des bancs, des bahuts, des escabeaux, de petits pliants, ou même parfois des coussins posés sur le carreau. Dans les chambres à coucher, il y avait aussi une seule chaire et des bancs ; de même dans la salle où l’on mangeait. La chaire ou chaise est toujours le trône du maître ou de la maîtresse ; cet usage était d’accord avec les mœurs féodales. Si le chef de la famille recevait des inférieurs, il s’asseyait dans sa chaire, et les laissait debout ou les faisait asseoir sur des siéges plus bas et souvent sans dossiers ; s’il recevait un supérieur dans l’ordre féodal, ou un égal auquel il voulait faire honneur, il lui cédait la chaire. Toutefois, si ces meubles sont riches par la matière et le travail, ils sont simples de forme pendant les premiers siècles du moyen âge, se composent de montants, de traverses et de tablettes pour s’asseoir, ou parfois de sangles sur lesquelles on jetait un gros coussin enveloppé de cuir gaufré ou d’étoffe précieuse.
Dans les premiers siècles, des chaires avec dossiers hauts sont peu
communes ; cependant des vignettes de manuscrits des IXe, Xe et  XIe siècles en laissent voir quelques-unes
(fig. 1)[48] ; mais ils paraissent être des siéges
d’honneur, des trônes réservés pour de
grands personnages. Il arrivait d’ailleurs
que des siéges sans dossiers étaient appuyés
contre la muraille, laquelle alors était tapissée
au-dessus d’eux. Souvent les chaires
étaient garnies de bras ou d’appuis, et le
dossier ne dépassait pas la hauteur des bras
latéraux, ainsi que le fait voir la fig. 2[49].
Ces dossiers à même hauteur que les bras
étaient généralement circulaires et enveloppaient
les reins, comme la chaise antique. Mais cependant, jusqu’au XIIIe siècle,
les chaires de forme carrée étaient parfois
dépourvues de dossiers élevés, ainsi que le fait voir l’exemple (fig. 3)
tiré de l’ancienne collection de M. le prince Soltykoff. Cette pièce
XIe siècles en laissent voir quelques-unes
(fig. 1)[48] ; mais ils paraissent être des siéges
d’honneur, des trônes réservés pour de
grands personnages. Il arrivait d’ailleurs
que des siéges sans dossiers étaient appuyés
contre la muraille, laquelle alors était tapissée
au-dessus d’eux. Souvent les chaires
étaient garnies de bras ou d’appuis, et le
dossier ne dépassait pas la hauteur des bras
latéraux, ainsi que le fait voir la fig. 2[49].
Ces dossiers à même hauteur que les bras
étaient généralement circulaires et enveloppaient
les reins, comme la chaise antique. Mais cependant, jusqu’au XIIIe siècle,
les chaires de forme carrée étaient parfois
dépourvues de dossiers élevés, ainsi que le fait voir l’exemple (fig. 3)
tiré de l’ancienne collection de M. le prince Soltykoff. Cette pièce  d’orfèvrerie est de cuivre émaillé, fabrication de Limoges, et date des premières années du XIIIe siècle. Les quatre montants, dépassant
les bras et le dossier, sont garnis de pommes sur lesquelles
on s’appuyait pour se soulever. Ces pommes étaient généralement
riches, soit comme travail, soit comme matière, d’ivoire, de cristal
de roche, de cuivre émaillé ou doré.
d’orfèvrerie est de cuivre émaillé, fabrication de Limoges, et date des premières années du XIIIe siècle. Les quatre montants, dépassant
les bras et le dossier, sont garnis de pommes sur lesquelles
on s’appuyait pour se soulever. Ces pommes étaient généralement
riches, soit comme travail, soit comme matière, d’ivoire, de cristal
de roche, de cuivre émaillé ou doré.

Dès le XIIe siècle, on employait très-fréquemment les bois tournés dans la fabrication des chaires ; non-seulement les bois tournés entraient dans la composition des montants, mais ils servaient encore à garnir les dossiers, l’intervalle laissé entre la tablette et les bras (fig. 4)[50]. Parfois les montants supérieurs, en s’élevant au-dessus des montants antérieurs et dépassant les bras, ne servaient qu’à maintenir
des courroies ou sangles sur lesquelles on jetait un morceau d’étoffe, ainsi que le fait voir la fig. 4.
Les quelques exemples que nous venons de donner indiquent déjà une assez grande variété dans la composition des chaires, et nous ne nous occupons que de celles qui sont mobiles, ne tenant pas à un ensemble de siéges comme les stalles, formes et autres meubles dépendant du mobilier fixe des églises[52]. Parmi ces exemples, les uns paraissent conserver les traditions du mobilier antique, comme la fig. 2, par exemple, les autres affectent des formes plus ou moins originales ; mais il ne faut pas oublier que, jusqu’à la fin du XIIe siècle, l’influence de l’antiquité, ou plutôt du Bas-Empire, influence rajeunie, pour ainsi dire, par les relations plus fréquentes avec Constantinople, laisse de profondes traces dans la disposition et la forme des vêtements ; les meubles usuels subissent naturellement cette même influence.
Au XIIIe siècle, la modification dans le costume est sensible ; elle
existe également dans le mobilier ; nous voyons alors paraître des
formes sinon neuves, au moins empruntées à d’autres sources que
celle de la tradition antique romaine ou byzantine. Diverses causes  amènent ces changements : les
rapports avec les populations
mahométanes de la Syrie ; le développement
de la richesse et de
l’industrie chez les populations
urbaines, qui commençaient à
manifester des goûts de luxe ;
rétablissement régulier des corporations
de gens de métiers,
qui allaient chercher des modes
nouvelles en toutes choses, afin
d’alimenter la production.
amènent ces changements : les
rapports avec les populations
mahométanes de la Syrie ; le développement
de la richesse et de
l’industrie chez les populations
urbaines, qui commençaient à
manifester des goûts de luxe ;
rétablissement régulier des corporations
de gens de métiers,
qui allaient chercher des modes
nouvelles en toutes choses, afin
d’alimenter la production.
On remarquera que les chaires antérieures au XIIIe siècle sont assez étroites entre bras ; c’est qu’en effet, jusqu’alors, bien que les vêtements fussent amples, ils étaient faits d’étoffes souples, fines, et leurs nombreux plis se collaient au corps. Mais, au XIIIe siècle, on se vêtit d’étoffes plus roides, doublées de fourrures ou de tissus assez épais ; on fit usage des velours, des brocarts, qui forment des plis larges : les vêtements se collaient moins au corps, ils tenaient plus de place, produisaient des plis amples et très-marqués ; il fallut élargir les siéges et leur donner des formes plus en rapport avec ces nouveaux habits, afin qu’ils ne fussent pas froissés et que les plis pussent conserver leur jet naturel. Ainsi, nous voyons ici (fig. 5) un roi assis dans une chaire longue et étroite[53], et le vêtement du personnage, quoique très-ample, dessine la forme du corps ; il est fait d’une étoffe souple qui n’avait rien à craindre du froissement, et pouvait, sans gêner le personnage, tenir avec lui dans un espace assez resserré.

Nous venons de dire que la Syrie eut une influence sur les meubles usuels vers le commencement du XIIIe siècle. En effet, à cette époque, on voit dans les peintures, bas-reliefs et manuscrits, des chaires figurées qui rappellent certaines formes encore usitées dans l’Inde, en Perse et en Égypte. Telles sont les deux chaires représentées dans les deux figures 6 et 7[54]. Ces deux chaires, dont l’une dépourvue et l’autre munie de bras, ont leurs montants et dossiers de bois tournés ; toutes deux sont des siéges d’honneur, des trônes, et les six montants de la première sont posés sur des lions, genre de support très-fréquent pour ces sortes de siéges. Ces meubles n’étaient guère transportables ; ils occupaient une place fixe dans la pièce où ils se trouvaient. Ils sont largement ouverts, et permettaient au personnage assis de se mouvoir à droite et à gauche sans être gêné par le froissement des vêtements. Des coussins garnissaient la tablette. Les dossiers ne sont ici que des galeries à jour, assez peu élevées pour ne pas masquer les personnages assis. Ces meubles n’étaient point adossés, mais occupaient un espace libre au milieu d’une pièce ; on circulait autour, et le personnage séant pouvait voir une nombreuse assemblée dont quelques membres se tenaient à ses côtés et derrière lui. Ce sont là des chaires de seigneurs féodaux placées dans la salle publique destinée aux assemblées ; ce sont de véritables trônes[55].

En Italie et dans le midi de la France, les siéges d’honneur de forme polygonale, avec bras et dossiers, étaient aussi fort en usage, et prennent des développements considérables : nous citerons entre autres le trône sur lequel est assis Jésus-Christ dans une des peintures des voûtes de la petite chapelle de Saint-Antonin, aux Jacobins de Toulouse (fig. 7 bis). Ce siége est très-vaste, ses formes sont compliquées, et il permettait de se placer dans toutes sortes de postures.

Quant aux chaires des appartements privés, elles étaient plus
généralement garnies de dossiers, élevés. C’est ainsi qu’est figuré le
siége sur lequel David est assis à côté de Bethsabée, à la porte de
droite du portail de la cathédrale d’Auxerre (fig. 8) [XIIIe siècle]. Ce
beau meuble se rapproche des formes actuelles, et déjà il est enrichi  de sculptures plates qui se mêlent aux
bois tournés encore employés en Orient.
Nous donnons (fig. 9) le dossier de la
chaire de David, sur lequel la sculpture
est prodiguée, mais de façon à ne pas
offrir de ces aspérités gênantes sur un
meuble destiné à l’usage ordinaire.
de sculptures plates qui se mêlent aux
bois tournés encore employés en Orient.
Nous donnons (fig. 9) le dossier de la
chaire de David, sur lequel la sculpture
est prodiguée, mais de façon à ne pas
offrir de ces aspérités gênantes sur un
meuble destiné à l’usage ordinaire.
Il ne faudrait pas croire cependant
que les bois tournés fussent uniformément
adoptés dans la construction des
chaires du XIIIe siècle, car aucune époque
ne présente une aussi grande variété
de siéges, soit comme forme, soit
comme matière ou comme système de
construction. Nous venons de voir des
chaires qui affectent des dispositions
particulières, telles que celles représentées figures 6 et 7, qui sont,
pour ainsi dire, de petites estrades entourées de galeries pour servir
d’appui ou de dossier ; d’autres (fig. 8) qui rentrent dans les formes
en usage encore aujourd’hui. Mais ces meubles sont de bois ; or, pendant le moyen âge, on fabriquait volontiers des siéges de métal,
fer ou bronze, que l’on recouvrait de tapisseries. Sans parler des
pliants {faudesteuils), tels que le trône dit de Dagobert, qui est de
bronze, et tant d’autres que l’on rencontre encore dans nos églises,  et qui sont de fer, il existait aussi des chaires de métal. Nous en
avons rencontré souvent des débris jetés parmi les vieux meubles
hors de service des cathédrales, et les miniatures des manuscrits ou
les bas-reliefs nous en présentent souvent des exemples. Nous
essayerons de réunir ces divers renseignements de façon à donner un
modèle assez complet de ces chaires de fer, qui, du reste, étaient
fort simples, que l’on établissait évidemment dans le but d’obtenir
des meubles légers, facilement transportables, n’étant décorés que
par la dorure appliquée sur le métal et les tapisseries dont on les
couvrait (fig. 10). Afin de mieux faire comprendre la construction de
ce meuble, nous supposons les tapisseries enlevées, et nous n’avons figuré que les sangles destinées à supporter le coussin ; la figure A
et qui sont de fer, il existait aussi des chaires de métal. Nous en
avons rencontré souvent des débris jetés parmi les vieux meubles
hors de service des cathédrales, et les miniatures des manuscrits ou
les bas-reliefs nous en présentent souvent des exemples. Nous
essayerons de réunir ces divers renseignements de façon à donner un
modèle assez complet de ces chaires de fer, qui, du reste, étaient
fort simples, que l’on établissait évidemment dans le but d’obtenir
des meubles légers, facilement transportables, n’étant décorés que
par la dorure appliquée sur le métal et les tapisseries dont on les
couvrait (fig. 10). Afin de mieux faire comprendre la construction de
ce meuble, nous supposons les tapisseries enlevées, et nous n’avons figuré que les sangles destinées à supporter le coussin ; la figure A  donne l’assemblage, moitié d’exécution, des petites écharpes avec
les montants et traverses.
donne l’assemblage, moitié d’exécution, des petites écharpes avec
les montants et traverses.

On remarquera que tous ces meubles ne rappellent pas, dans leur composition, les formes adoptées dans l’architecture. Ce n’est guère
qu’à la fin du XIIIe siècle que l’on introduisit des détails d’ornementation
empruntés à cet art dans la composition des meubles, en
oubliant trop souvent cette règle si sage, conforme au bon goût, qui
veut que la matière et l’usage commandent la forme ; que chaque  objet soit décoré en raison de sa destination. Cet empiétement des
détails de l’architecture dans le mobilier produisit cependant des
œuvres dont il faut reconnaître le mérite d’exécution et de composition ;
d’autant plus qu’on trouve encore, malgré l’oubli du principe,
une simplicité pleine de grâce dans ces premiers écarts, et un
emploi aussi judicieux que possible de ces formes déplacées. La jolie chaire de pierre de Tonnerre qui existe au musée de Cluny est
objet soit décoré en raison de sa destination. Cet empiétement des
détails de l’architecture dans le mobilier produisit cependant des
œuvres dont il faut reconnaître le mérite d’exécution et de composition ;
d’autant plus qu’on trouve encore, malgré l’oubli du principe,
une simplicité pleine de grâce dans ces premiers écarts, et un
emploi aussi judicieux que possible de ces formes déplacées. La jolie chaire de pierre de Tonnerre qui existe au musée de Cluny est  un chef-d’œuvre en ce genre, elle sert de siége à une Vierge, et
figure évidemment un meuble de bois de la fin du XIIIe siècle (fig. 11).
Outre le coussin, une draperie est jetée sur le dossier et les bras de
ce siége ; cette draperie descend jusqu’à terre et se termine par une
frange ; le coussin servant de marchepied est posé sur le bas de la
draperie. Nous donnons (fig. 12) le côté de cette chaire, moitié d’exécution.
Ce meuble figure une construction de bois ; il était certainement
peint et doré, comme toutes les boiseries de ce temps.
un chef-d’œuvre en ce genre, elle sert de siége à une Vierge, et
figure évidemment un meuble de bois de la fin du XIIIe siècle (fig. 11).
Outre le coussin, une draperie est jetée sur le dossier et les bras de
ce siége ; cette draperie descend jusqu’à terre et se termine par une
frange ; le coussin servant de marchepied est posé sur le bas de la
draperie. Nous donnons (fig. 12) le côté de cette chaire, moitié d’exécution.
Ce meuble figure une construction de bois ; il était certainement
peint et doré, comme toutes les boiseries de ce temps.

Bientôt on ne se contenta pas de dossiers bas, on les éleva beaucoup
au-dessus de la tête du personnage assis. Les siéges d’honneur du XVe et même du XVIe siècle, conservés encore en grand nombre dans les musées, présentent une foule d’exemples de chaires à hauts dossiers richement sculptés, décorés souvent d’écussons armoyés, et couronnés par des dentelures. La figure 13 représente une belle chaire de ce genre, qui faisait partie de la collection du prince Soltykoff, et qui date de la fin du XVe siècle. Le siége sert de coffre, et est muni d’une serrure. Ces sortes de meubles étaient presque toujours adossés à la muraille, car le derrière du dossier est laissé brut. Mais c’était là un meuble destiné à un riche personnage ; tous n’étaient pas décorés avec ce luxe de sculpture. Chez les bourgeois, si la forme de la chaire était la même, les détails de son ornementation étaient beaucoup plus simples, composés de montants et de panneaux ; les chaires les plus ordinaires étaient cependant couronnées encore par une crête sculptée. L’exemple que nous donnons (fig. 14), tiré des bas-reliefs des stalles de la cathédrale d’Amiens, reproduit une de ces chaires vulgaires, comme celles que l’on voyait dans les appartements des marchands, des particuliers, dont l’intérieur était modeste. Ainsi qu’on peut en juger, ces derniers meubles n’étaient guère transportables, et occupaient une place privilégiée.Les chaires, pendant le XVe siècle, (étaient souvent drapées, comme la chaire du XVIe siècle représentée fig. 11, au moyen d’une grande pièce d’étoffe jetée sur le dossier, le siége et le bras. Ces draperies mêmes prirent souvent la forme d’une housse, c’est-à-dire qu’elles furent adaptées au meuble de façon à le couvrir exactement. Voici (fig. 15) une chaire ainsi tapissée : la housse forme de larges plis ; elle est faite d’un brocart d’or avec pois rouges, et tombe assez bas pour que la personne assise puisse mettre ses pieds sur son extrémité antérieure[56].
L’usage des chaires fixes à grands dossiers se perdit pendant le XVIe siècle ; elles furent remplacées par des meubles plus mobiles, et l’on commença dès lors à fixer au bois l’étoffe destinée à les garnir. Jusqu’alors, comme nous l’avons dit, les coussins ou tapis étaient indépendants des siéges et simplement jetés sur la tablette et les bras ; du moment que les chaires devenaient mobiles, il fallait nécessairement que les garnitures d’étoffe fussent clouées sur leur surface.
CHAPIER. s. m. Meuble composé de tiroirs semi-circulaires tournant sur un pivot placé au centre du demi-cercle, et servant, depuis le XVIIe siècle, à renfermer les chapes. Cette combinaison de meuble fut commandée par l’usage que l’on fit, à partir de cette époque, de chapes d’étoffes roides et ne pouvant, à causes de lourdes broderies dont elles étaient surchargées, supporter de plis. Jusqu’au XVIe siècle, le clergé se servait de chapes d’étoffes souples que l’on se contentait d’accrocher à des portemanteaux fixés dans les armoires-vestiaires. Les chapiers à tiroirs semi-circulaires ont l’inconvénient, outre leur prix, qui est élevé, de tenir une place considérable dans les sacristies. Ces meubles ne peuvent avoir moins de 4 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur : c’est la surface qu’occupe une petite chambre.
CHAR, s. m. (char branlant, charrette, chariot, curre). Les
chars, carrosses, voitures, étaient en usage pendant le moyen âge.
Il y a lieu de croire même que, dès l’époque mérovingienne, il
existait une sorte de service public de voitures. Childebert, voulant
s’emparer des trésors de Rauching, expédie des ordres et envoie des
gens munis de lettres qui mettaient à leur disposition les voitures publiques du royaume[57]. Les voitures ne furent longtemps que de
véritables charrettes non suspendues à quatre roues, auxquelles on
attelait des chevaux montés par des postillons. Ces moyens de locomotion
furent tellement communs, qu’au XIIIe siècle des lois somptuaires
les interdirent aux classes moyennes[58]. Les femmes nobles,
les abbés, voyageaient dans des chariots ; et les miniatures des manuscrits
du XIIIe siècle nous en ont transmis un grand nombre qui
tous affectent la forme d’une charrette à quatre roues égales de diamètre
(fig. 1)[59] avec brancards ou timons, traînée par des attelages  accouplés ou en flèche et des postillons. Si ces voitures étaient fort
simples comme forme et combinaison, elles étaient enrichies de
peintures, de dorures, recouvertes d’étoffes posées sur des cercles,
comme nos voitures de blanchisseurs ; à l’intérieur, des coussins
étaient jetés sur les banquettes disposées en travers. On entrait dans
ces chars par derrière comme on peut encore entrer dans nos charrettes,
et souvent cette issue était fermée par des chaînes ou des
barres d’appui. Du reste, le coffre, jusqu’à la fin du XVe siècle, reposait
sur deux essieux, sans courroies ni ressorts ; et les essieux étant
fixes, parallèles, il fallait s’y prendre de loin pour tourner. Grâce à
une grande quantité de coussins, à des étoffes épaisses, on pouvait
encore voyager longtemps dans ces charrettes, menées d’ailleurs assez doucement. Quelle que fut la naïveté de leur structure, il est
certain que les voitures des XIIIe et XIVe siècles étaient fort richement
décorées.
accouplés ou en flèche et des postillons. Si ces voitures étaient fort
simples comme forme et combinaison, elles étaient enrichies de
peintures, de dorures, recouvertes d’étoffes posées sur des cercles,
comme nos voitures de blanchisseurs ; à l’intérieur, des coussins
étaient jetés sur les banquettes disposées en travers. On entrait dans
ces chars par derrière comme on peut encore entrer dans nos charrettes,
et souvent cette issue était fermée par des chaînes ou des
barres d’appui. Du reste, le coffre, jusqu’à la fin du XVe siècle, reposait
sur deux essieux, sans courroies ni ressorts ; et les essieux étant
fixes, parallèles, il fallait s’y prendre de loin pour tourner. Grâce à
une grande quantité de coussins, à des étoffes épaisses, on pouvait
encore voyager longtemps dans ces charrettes, menées d’ailleurs assez doucement. Quelle que fut la naïveté de leur structure, il est
certain que les voitures des XIIIe et XIVe siècles étaient fort richement
décorées.
« Biaus fu li chars à quatre roës,
« D’or et de pelles estelés.
« En leu de chevaux atelés
« Ot es limons huit colombiaus
« Pris en son colombier moult biaus ;
« … » [60]
Au XIVe siècle, Eustache Deschamps, dans son Mirouer de mariage, énumérant toutes les charges qui incombent au mari pour le mesnage soustenir avec les pompes et grans bobans des femmes, fait dire à l’une d’elles :
« Et si me fault bien, s’il vous plest,
« Quant je chevaucheray par rue,
« Que j’aie ou cloque[61] ou sambue[62]
« Haquenée belle et amblant,
« Et selle de riche semblant,
« A las et à pendans de soye ;
« Et se chevauchier ne povoye,
« Quant li temps est frès comme burre,
« Il me fauldroit avoir un curre (char)
« A cheannes, bien ordonné,
« Dedenz et dehors painturé,
« Couvert de drap de camocas (camelot).
« Je voy bien femmes d’avocas,
« De poures bourgois de villaige
« Qui l’ont bien ; pour quoy ne l’arai-ge,
« A quatre roncins atelé ? »[63]
Il fallait donc à une femme de qualité, au XIVe siècle, pour voyager, une haquenée, et un char attelé lorsque le temps était mauvais : les petites bourgeoises en usaient bien de la sorte !
Ces chars étaient généralement d’une assez grande dimension pour
contenir une dizaine de personnes. La couverture était fixée sur une
armature de bois et percée de trous latéraux fermés par des rideaux (fig. 2)[64], ou elle était posée sur des cercles et quatre montants, se  rabattait sur les côtés ou se relevait à volonté (fig. 3)[65]. Ce dernier
exemple est copié sur le beau manuscrit le Romuleon, histoire des
rabattait sur les côtés ou se relevait à volonté (fig. 3)[65]. Ce dernier
exemple est copié sur le beau manuscrit le Romuleon, histoire des  Romains, de la Bibliothèque nationale. Cette compagnie de dames nous représente Tullie avec ses femmes, faisant passer son char sur
le corps de son père.
Romains, de la Bibliothèque nationale. Cette compagnie de dames nous représente Tullie avec ses femmes, faisant passer son char sur
le corps de son père.

Les chars de voyage ou les chars d’honneur avaient souvent la même forme, c’est-à-dire qu’ils n’étaient que des tombereaux recouverts de riches étoffes. Nous trouvons encore dans le Romuleon une miniature représentant le triomphe de Camille (fig. 4). Le dictateur est traîné par deux chevaux attelés en flèche, dans un char dont la couverture, soutenue par des cercles et des traverses, est relevée sur les côtés. Deux croix de Saint-André empêchent les cercles de se déformer. Camille est assis dans un fauteuil pliant (faudesteuil) simplement posé au milieu du chariot. Le limonier est attelé comme le sont nos chevaux de charrettes encore aujourd’hui. Toutefois, ces chars d’apparat avaient généralement, au moyen âge, plus d’importance. L’exemple que nous donnons plus loin (fig. 5), tiré d’un manuscrit du commencement du XVIe siècle, de la Bibliothèque nationale, le prouve. C’est encore une entrée triomphale ; le char est attelé de plusieurs chevaux en flèche, menés par un postillon. Le triomphateur est assis en avant sous un dais ; il tient ses prisonniers attachés au bout d’une corde ; un homme placé dans l’intérieur du char les fait marcher avec un bâton. Le corps du char, qui paraît assez vaste, est couvert d’une tente ornée d’une crête, d’épis avec bannières et pennons armoyés, de franges d’or et d’inscriptions. Il faut dire que ces chars de cérémonie n’étaient en usage, lors des entrées de rois et reines, que pour les dames de suite ; les rois entraient à cheval et les reines le plus souvent en litière (voy. ce mot).

« La lictière de la Reyne de France estoit adextrée du duc de Touraine et du duc de Bourbon, au premier chef ; secondement et au milieu, tenoient et adextroient la lictière le duc de Berry et le duc de Bourgongne ; et à la dernière suite Messire Pierre de Navarre et le comte d’Ostrevant ; et vous dy que la lictière de la Reyne estoit très-riche et bien ornée, et toute découverte… Des autres dames et damoiselles qui venoient derrière sur chariots couverts et sur pallefrois n’est nulle mention, et des chevaliers qui les suivoient…[66] »

Lors des enterrements des princes, il était d’usage de transporter le corps du défunt dans des chars richement décorés. « … Et fut la préparation du duc moult bien ordonnée et faicte : les chevaux du chariot couverts de velours ; et pennons, bannières et cottes-d’armes estoyent bien ordonnés. Le corps gisoit en son chariot, et pardessus avait un poisle élevé ; et après venoit le corps de Madame de Bourgongne en son chariot et chevaux couverts de velours… Les églises (le clergé) aloyent devant, par ordre. Les chevaliers de l’ordre estoyent tous à pié, adextrans le chariot, et tenant le poisle couchant (le drap recouvrant le corps). Le poisle élevé fut soustenu par quatre des plus grands du pays de Bourgongne…[67]. »

Vers le commencement du XVIe siècle, de certaines modifications furent apportées dans la construction des chariots de voyage ; on fit alors des entrées littérales entre les deux roues. Voici (fig. 6) un chariot de cette époque, exécuté en sapin, qui existe encore dans le bâtiment de la douane de Constance. La figure 7 donne les extrémités de ce véhicule, qui ne paraît pas avoir été posé autrement que sur deux essieux. Les deux banquettes se regardant, le plancher et les accoudoirs étaient garnis de tapis mobiles. Quelquefois (si l’on s’en rapporte aux gravures du XVIe siècle) les deux entrées étaient munies de marchepieds fixes sur lesquels tombaient les tapis, et une sorte de capote à soufflet pouvant s’abattre et se relever était posée sur les dossiers et les accoudoirs, au-dessus de l’une des deux banquettes ou sur les deux. Ces voitures prenaient le nom de coches[68]. Il ne paraît pas qu’elles fussent suspendues avant le milieu du XVIe siècle. Ce premier système de suspension consiste en deux courroies passant longitudinalement sous le coffre (fig. 6 A). Cette suspension fit donner à ses chars le nom de chars branlants.
Quant aux charrettes à deux roues, que nous trouvons dans les manuscrits des XVe et XVIe siècles, elles diffèrent si peu de celles qui sont encore en usage aujourd’hui, qu’il nous semble inutile d’en donner un exemple.
Nous voyons aussi qu’au moyen âge on se servait de charrettes à bras. Les tapisseries de Saint-Médard, dont il existe des copies fort belles à la bibliothèque Bodléienne d’Oxford, nous en donnent un exemple. Ces tapisseries dataient de la fin du XIIIe siècle. (Voy. Tapisserie.)
CHASSE, s. f. La châsse n’est, à proprement parler, que le cercueil de pierre, de bois ou de métal dans lequel sont enfermés les restes d’un mort. Le mot de châsse, au moyen âge, s’applique indistinctement aux coffres qui renferment des corps de saints ou de grands personnages.
Les mots arca, capsa, furent employés, dans les premiers siècles et jusqu’à l’époque carlovingienne, indifféremment pour désigner des coffres destinés à un usage profane ou sacré. Grégoire de Tours rapporte[69] que l’empereur Justinien étant mort à Constantinople, Justin, qui lui succéda, était d’une avarice outrée. « Telle était sa cupidité, dit cet auteur, qu’il fit construire des coffres de fer[70] pour y entasser des milliers de pièces d’or. »
Frédégonde, voulant se venger de sa fille Rigonthe, qui l’insultait, l’engage, comme pour adoucir son mauvais naturel, à prendre ce que bon lui semblerait parmi ses bijoux. « … Entrant dans le réduit qui renfermait le trésor, elle ouvrit un coffre[71] rempli de colliers et d’autres ornements précieux ; et, après en avoir pendant longtemps retiré, en présence de sa fille, divers objets qu’elle lui remettait : « Je suis fatiguée, lui dit-elle ; enfonce toi-même la main dans le coffre, et tires-en ce que tu trouveras. » Pendant que, le bras enfoncé dans le coffre, celle-ci en tirait les effets, sa mère prit le couvercle et le lui rabattit sur la tête, puis pesa dessus avec tant de force, que le devant (du coffre) lui pressa le cou au point que les yeux étaient près de lui sortir de la tête[72]. » Il faut supposer que ces coffres à bijoux étaient de la grandeur d’une huche ou d’un bahut.
Le même auteur rapporte encore qu’étant évêque de Tours et ayant rebâti l’église de Saint-Martin, il trouva dans une auge de pierre, fermée par un couvercle, une cassette d’argent[73] contenant des reliques des martyrs de la légion sacrée.
Depuis le XVIe siècle, le mot châsse ne s’emploie que pour désigner le coffre transportable dans lequel est déposé le corps d’un saint. Il serait difficile de préciser l’époque où les corps des saints commencèrent à être déposés dans des châsses (capsœ), que l’on pouvait transporter d’un lieu à un autre ; originairement, ces restes vénérés étaient placés dans des sarcophages, au-dessus et au devant desquels on élevait un autel. Mais, sauf quelques rares exceptions, et dès l’époque carlovingienne déjà, on retira les restes des corps-saints des tombeaux fixes, pour les renfermer dans des coffres meubles. Les incursions des Normands contribuèrent à répandre cet usage. Ces barbares, faisant subitement irruption dans les Gaules, tantôt sur un point, tantôt sur un autre, se jetaient de préférence sur les riches abbayes, sur les églises qui possédaient des trésors ; les religieux voulurent empêcher que les sépultures des saints martyrs ne fussent violées, leurs restes dispersés. Car, à cette époque, outre le respect dont on entourait ces reliques, celles-ci étaient pour les monastères une source intarissable de richesses. L’église pillée, dévastée, brûlée se relevait promptement de ses ruines, si les reliques du saint vénéré dans son enceinte étaient conservées. Il y a donc lieu de croire que c’est surtout pendant les IXe et Xe siècles que l’usage des châsses mobiles devint général, spécialement sur le littoral nord et ouest de la France.
Les premières châsses furent naturellement exécutées en bois ; ce n’étaient que des coffres assez légers pour être facilement transportés d’un lieu à un autre, assez simples pour ne pas exciter la cupidité. Pendant les invasions normandes, il est sans cesse question de corps-saints enlevés par les religieux, cachés, en attendant des temps meilleurs. La réintégration des reliques, lorsque le calme était rétabli, donnait lieu à des processions, à des cérémonies pendant lesquelles le saint, rétabli dans son sanctuaire, faisait quelques guérisons miraculeuses : c’était l’occasion pour les églises de recevoir des dons considérables. Nous ne pouvons que difficilement nous faire une idée aujourd’hui de la désolation qui s’emparait des populations lorsqu’il fallait se séparer des restes du saint vénéré dans la localité, de la joie qu’elles éprouvaient lorsque revenait en grande pompe la châsse contenant ces restes. C’est qu’en effet un corps-saint, pour une population, avait une importance dont nous ne trouvons pas aujourd’hui l’équivalent. Le corps-saint faisait de l’église un lieu inviolable ; il était le témoin muet de tous les actes publics, le protecteur du faible contre l’oppresseur ; c’était sur lui que l’on prêtait serment ; c’était à lui qu’on demandait la cessation des fléaux, de la peste, de la famine ; lui seul avait le pouvoir d’arrêter souvent la main de l’homme violent ; quand l’ennemi était aux portes, la châsse, paraissant sur les murailles, donnait du courage aux défenseurs de la cité. Ce n’est pas tout : si le corps-saint avait le pouvoir de protéger la vie des citoyens, d’exciter leur patriotisme, de les guérir de leurs maux et de détourner les calamités qui les affligeaient, il était encore une source de richesse matérielle, non-seulement pour l’église, mais pour la population au milieu de laquelle il résidait, en attirant de nombreux pèlerins, des étrangers, en devenant l’occasion de fêtes qui étaient presque toujours aussi bien commerciales que religieuses. Il nous suffit, nous le croyons, de signaler cette influence pour faire comprendre que rien aujourd’hui, si ce n’est peut-être le drapeau pour l’armée, ne remplace le corps-saint au milieu de nos cités. Qui donc oserait traiter de superstition le sentiment qui fait que le soldat se jette au milieu de la mitraille pour reprendre un morceau d’étoffe cloué à une hampe ? Et comment nous tous, qui regardons cet acte comme un simple devoir que l’on ne saurait discuter, dont l’accomplissement fait la force d’une armée, comme le symbole de la discipline et du patriotisme le plus pur, comment n’aurions-nous plus, à défaut de foi vive, un profond respect pour ces châsses qui, elles aussi, ont été si longtemps en France l’arche de la civilisation ? Et cependant nous avons vu et nous voyons encore des églises se défaire de ces meubles vénérables, les vendre à des brocanteurs, s’ils ont quelque valeur, ou les laisser pourrir dans quelque coin obscur parmi les immondices, si la matière en est grossière. Des églises, les châsses précieuses épargnées par la révolution ont presque toutes passé, en France, des mains du clergé dans les collections publiques ou particulières.
L’histoire des reliques de saint Germain d’Auxerre est celle de presque tous les corps-saints depuis les premiers siècles du christianisme jusqu’au XIe ou XIIe siècle. L’abbé Lebeuf l’a recueillie avec soin d’après les renseignements les plus authentiques[74] ; nous la donnons ici sommairement, afin de bien établir dans l’esprit de nos lecteurs cette distinction qu’il faut faire entre le sépulcre et la châsse.
Vers le milieu du Ve siècle, saint Germain meurt à Ravenne ; il demande en mourant que son corps soit transporté à Auxerre. En effet, ses restes sont déposés dans cette ville deux mois après sa mort. Le cercueil était de bois de cyprès, selon Héric ; il fut descendu dans un sarcophage de pierre placé sous la petite église de Saint-Maurice. Sainte Clotilde fait rebâtir sur ce tombeau une église plus grande avec une vaste crypte, et la dédie à saint Germain. Un des successeurs de Clovis fait surmonter le tombeau du saint d’un dais recouvert d’or et d’argent. En 841, le tombeau est ouvert en présence de Charles le Chauve, et le corps est placé dans un nouveau tombeau. Lothaire, fils de ce prince et abbé de Saint-Germain, fait faire peu après une châsse magnifique, couverte d’or et de pierreries, pour y renfermer le corps du saint. Vers la fin du IXe siècle, la crainte qu’inspiraient les Normands fit songer à cacher cette chasse somptueuse, et probablement les reliques de Saint-Germain, qui jusqu’alors étaient restées dans le sépulcre donné par Charles le Chauve, y furent renfermées. On augmenta, pour ce faire, la profondeur du caveau ; on y descendit la châsse, et on la mit dans le premier sépulcre de pierre où le saint avait reposé ; lorsqu’on eut bien maçonné le couvercle de ce tombeau, de manière à faire disparaître toute trace de sépulcre, on plaça par-dessus un autre sépulcre de pierre dans lequel on déposa les morceaux du cercueil de cyprès qui avait servi à la translation du corps de Ravenne à Auxerre. A la fin du XIe siècle, la chasse due à Lothaire est exposée aux yeux du peuple.
Quel que soit le plus ou moins d’exactitude de ces récits, toujours est-il que le corps de saint Germain, déposé d’abord dans un cercueil de pierre, en est extrait pour être mis dans un coffre, une châsse transportable. Cet usage fut cause que la plupart des corps-saints trouvés entiers dans leurs cercueils, entourés, comme celui de saint Germain, des suaires et vêtements primitifs, une fois déposés dans des châsses que l’on pouvait facilement transporter et ouvrir, furent en grande partie dispersés, divisés en une quantité innombrable de reliques. Ce fut la première et la plus grave atteinte portée au respect que l’on avait pour les restes de ces défenseurs de la foi chrétienne.
Jusqu’au XIIIe siècle cependant, on conserva aux châsses l’aspect de coffres, de cercueils qu’elles avaient eu dans l’origine. À cette époque, beaucoup de ces anciennes châsses de bois, revêtues de cuivre ou d’argent doré, faites pour soustraire les corps-saints au pillage des Normands, existaient encore ; on semblait hésiter à détruire ces enveloppes que les fidèles étaient habitués à vénérer, surtout lorsqu’elles protégeaient les restes de personnages aussi populaires que saint Germain, saint Martin, saint Denis, saint Firmin, saint Marcel, sainte Geneviève, etc.
Autant qu’on peut en juger par les représentations peintes ou sculptées, ces châsses primitives étaient d’assez grande dimension pour contenir un corps ayant conservé sa forme ; lorsque ces coffres de bois tombèrent de vétusté, ou semblèrent trop pauvres au milieu du luxe déployé dans la décoration intérieure des églises, on les remplaça par des châsses de cuivre repoussé ou émaillé, d’argent blanc ou de vermeil. Alors les restes des saints ne devaient plus présenter qu’un amas d’ossements séparés ; il n’était plus nécessaire de donner aux châsses les dimensions d’un cercueil : l’emploi du métal, par sa valeur aussi bien que par son poids, devait nécessairement contribuer à faire adopter, pour des châsses transportables, des dimensions qui pussent permettre de les porter, et qui ne rendissent pas leur fabrication trop dispendieuse.
C’est à la fin du XIIe et pendant les XIIIe et XIVe siècles que presque toutes ces anciennes châsses de bois peint ou revêtu de lames minces de métal furent refaites. En diminuant leur grandeur, en les fabriquant avec des matières plus précieuses, on changea leur forme et leur position. Elles perdirent l’aspect de coffre, de cercueil, qu’elles avaient généralement conservé, pour prendre la forme de petits monuments assez semblables à des chapelles ou même à des églises ; au lieu d’être placées sous l’autel, comme le sépulcre primitif du saint, on les éleva et on les suspendit sous des dais, sortes d’expositions de bois peint et doré, de pierre ou de métal, disposées derrière les autels. On les descendait de ces expositions, à certains jours de l’année, pour les placer sur l’autel même ou sur le retable, ou pour les porter processionellement dans l’église, dans la ville ou dans tout un diocèse. Quelquefois même on faisait voyager les châsses jusque dans des pays éloignés ; elles étaient accompagnées de religieux qui les offraient à la vénération des fidèles, et recevaient des dons en argent destinés à l’achèvement d’une cathédrale, d’une abbaye, d’une église.
Les translations de reliques, leur passage à travers les villes, étaient l’occasion de cérémonies imposantes. Les châsses étaient ordinairement transportées par des clercs, sur des pavois et des brancards. Sous ces pavois, on attachait des cassolettes dans lesquelles brûlaient des parfums (fig. 1)[75].
Quand les corporations laïques eurent acquis, au XIIIe siècle, une grande importance, elles obtinrent souvent le privilége de porter des chasses les jours de grandes fêtes[76].

Lorsque Philippe le Hardi revint à Paris avec les ossements du roi son père, il voulut transporter lui-même sur ses épaules, de Notre-Dame à l’abbaye de Saint-Denis, la châsse qui les contenait. Sur la route, en mémoire de cet acte, on éleva, à chaque station qu’il fit, des croix de pierre richement sculptées que l’on voyait encore debout au commencement du dernier siècle[77].
Quelques corps-saints restèrent cependant déposés dans leurs cercueils primitifs, ou dans des coffres de pierre ou de bois revêtus de métal, fixés derrière les autels. C’est ainsi que la châsse de saint Firmin était placée derrière l’un des autels de l’église abbatiale de Saint-Denis[78]. A la cathédrale d’Amiens, dans les bas-reliefs qui décorent le tympan de la porte dite de la Vierge dorée, on remarque, derrière un autel, une grande châsse en forme de coffre, sur laquelle est posée la statue d’un évêque ; un aveugle approche de ses yeux la nappe qui couvre ce coffre : c’est la châsse de saint Honoré opérant des guérisons miraculeuses par l’attouchement des linges dont elle est couverte. Ce renseignement a sa valeur ; il explique comment, au XIIIe siècle, étaient placées les grandes châsses à la portée des fidèles, comment elles étaient recouvertes de nappes ainsi qu’un autel, et comment l’image des saints dont elle enveloppaient la dépouille était représentée. La figure 2 nous dispensera de plus longues explications.

Derrière le grand autel de Notre-Dame de Paris, on voyait, dit Dubreuil, « sur une large table de cuivre, soutenue de quatre gros et fort haults piliers de mesme estoffe, la châsse de saint Marcel, neufième évesque de Paris… A droite, sur l’autel de la Trinité, dict des Ardents, est la châsse de Notre-Dame, d’argent doré ; en laquelle il y a du laict de la sainte Vierge, et de ses vêtemens ; plus des pierres desquelles fust lapidé saint Etienne… A côté senestre dudict autel est une châsse de bois, ayant seulement le devant couvert d’argent doré, en laquelle est le corps de sainct Lucain, martyr… Ceste châsse, couverte de quelque drap de soye précieux, se porte en procession par deux hommes d’église… » Voici qui rappelle parfaitement la disposition de la châsse de saint Honoré, représentée figure 2.
Nous remarquons encore, sur l’un des bas reliefs du tympan de la porte méridionale de la cathédrale d’Amiens, la châsse du même saint transportée par deux clercs ; elle est à peu près de la dimension d’un cercueil, et paraît exécutée en bois recouvert de lames de métal (fig. 3). Des infirmes se placent sous la châsse et la touchent en invoquant le saint, afin d’être guéris de leurs maux. C’était en effet ainsi qu’on venait implorer l’intercession d’un saint, en se plaçant directement sous la châsse qui contenait son corps. Cet usage, établi probablement par les fidèles, fit que l’on plaça presque toujours les chasses, à partir du XIIe siècle, soit sur des édicules élevés, comme la châsse de saint Marcel, soit sur des crédences, sous lesquelles on pouvait passer à genoux et même en rampant.

Il n’existe aujourd’hui qu’un bien petit nombre de ces châsses de
bois d’une époque ancienne destinées à contenir des corps-saints.
Nous en connaissons une à Cunault (Maine-et-Loire), sur laquelle
on voit encore des traces de peintures et sculptures représentant
les douze apôtres, le Christ accompagné d’anges thuriféraires ; sa
forme est d’ailleurs d’une extrême simplicité ; une arcature ogivale
sépare les apôtres. Cette châsse date du XIIIe siècle. On en voit une,
également de bois, dans l’église de Saint-Thibaut (Côte-d’Or), qui
date du commencement du XVe siècle, cette châsse n’est ornée que par les fortes ferrures qui servent à maintenir les panneaux
de bois et aux deux bouts par six montants se terminant en
fleurons sculptés. Elle est exactement reproduite, avec tous les détails
de sa construction, dans les Annales archéologiques[79]. Déjà cependant,
dès les premiers siècles, ces grandes châsses de bois étaient
revêtues de lames de métal, d’émaux ou de morceaux de verre[80]. Les
feuilles de métal clouées sur le bois étaient fort minces, rehaussées  de gravures et quelquefois accompagnées de figures faites au repoussé
ou d’ivoire. Ce mode de fabrication persista longtemps, car
nous voyons encore des châsses des XIIe et XIIIe siècles, de dimensions
médiocres, dont le fond est de bois recouvert de plaques de
métal émaillé, gravé, doré, avec statuettes faites à l’étampe, au
repoussé, ou embouties, avec des feuilles de cuivre ou d’argent d’une
faible épaisseur. Outre l’économie, ce procédé de fabrication avait
l’avantage de laisser à ces châsses, que l’on transportait fréquemment,
la légèreté d’un coffre de bois. C’est ainsi qu’est exécutée la
châsse de saint Calmine (fig. 4), duc d’Aquitaine, fondateur des monastères de Saint-Théophrède en Velay et de Masac en Auvergne,
patron de l’église de Saguenne, près Tulle. Cette châsse est de cuivre
émaillé, doré, avec des figures bas-reliefs faites au repoussé. Sur
l’une des faces latérales (qui est la face principale), on voit le Christ
couronné, nimbé, bénissant, et tenant un livre ; à sa gauche est un
personnage drapé tenant un livre, et à sa droite un saint abbé probablement.
Deux anges thuriféraires sont posés sur les rampants du
petit omble. Sur le côté droit de la chasse est gravé un saint
Paul (fig. 5). Sur le côté gauche, qui sert d’entrée, un saint Pierre.
de gravures et quelquefois accompagnées de figures faites au repoussé
ou d’ivoire. Ce mode de fabrication persista longtemps, car
nous voyons encore des châsses des XIIe et XIIIe siècles, de dimensions
médiocres, dont le fond est de bois recouvert de plaques de
métal émaillé, gravé, doré, avec statuettes faites à l’étampe, au
repoussé, ou embouties, avec des feuilles de cuivre ou d’argent d’une
faible épaisseur. Outre l’économie, ce procédé de fabrication avait
l’avantage de laisser à ces châsses, que l’on transportait fréquemment,
la légèreté d’un coffre de bois. C’est ainsi qu’est exécutée la
châsse de saint Calmine (fig. 4), duc d’Aquitaine, fondateur des monastères de Saint-Théophrède en Velay et de Masac en Auvergne,
patron de l’église de Saguenne, près Tulle. Cette châsse est de cuivre
émaillé, doré, avec des figures bas-reliefs faites au repoussé. Sur
l’une des faces latérales (qui est la face principale), on voit le Christ
couronné, nimbé, bénissant, et tenant un livre ; à sa gauche est un
personnage drapé tenant un livre, et à sa droite un saint abbé probablement.
Deux anges thuriféraires sont posés sur les rampants du
petit omble. Sur le côté droit de la chasse est gravé un saint
Paul (fig. 5). Sur le côté gauche, qui sert d’entrée, un saint Pierre.  Outre les émaux, qui sont fort beaux et
des fabriques de Limoges, cette châsse
est décorée de pierres et le faîtage de
boules de cristal de roche. Tout l’ouvrage
appartient à la première moitié
du XIIIe siècle[81]. Vers la fin de ce siècle,
la fonte vint, dans les châsses d’orfèvrerie,
se marier au métal repoussé,
embouti ou estampé, aux émaux ou filigranes.
Nous renvoyons nos lecteurs,
pour l’explication de ces procédés, à la
partie du Dictionnaire qui traite de
l’orfévrerie, ne nous occupant ici que
de la composition générale des châsses.
Mais ces meubles conservent jusqu’au
XVIe siècle un caractère particulier ;
ils n’affectent pas encore la forme de
modèles de chapelles ou d’églises ; il
suffit de voir les châsses des grandes
reliques de Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle,
des Trois-Rois, à Cologne, de
Saint-Taurin, à Évreux[82], et surtout la
belle châsse de Tournay, pour reconnaître
que ces meubles, de la fin du XIIe siècle et du XIIIe, ont des
formes, des proportions et une ornementation qui leur appartiennent.
Plus tard, et particulièrement pendant le XVe siècle, les
orfèvres cherchent, dans la composition des châsses, à reproduire
en petit de grands édifices : c’est ainsi que fut refaite, en 1408, la
grande châsse de saint Germain, qui dépendait du trésor de Saint-Germain des Prés. Nous la donnons ici (fig. 6)[83]. Quel que fût le
mérite d’exécution de ces objets, ils avaient alors perdu leur caractère
propre, si remarquable deux siècles auparavant. La châsse de
saint Germain présentait cependant un grand intérêt au point
Outre les émaux, qui sont fort beaux et
des fabriques de Limoges, cette châsse
est décorée de pierres et le faîtage de
boules de cristal de roche. Tout l’ouvrage
appartient à la première moitié
du XIIIe siècle[81]. Vers la fin de ce siècle,
la fonte vint, dans les châsses d’orfèvrerie,
se marier au métal repoussé,
embouti ou estampé, aux émaux ou filigranes.
Nous renvoyons nos lecteurs,
pour l’explication de ces procédés, à la
partie du Dictionnaire qui traite de
l’orfévrerie, ne nous occupant ici que
de la composition générale des châsses.
Mais ces meubles conservent jusqu’au
XVIe siècle un caractère particulier ;
ils n’affectent pas encore la forme de
modèles de chapelles ou d’églises ; il
suffit de voir les châsses des grandes
reliques de Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle,
des Trois-Rois, à Cologne, de
Saint-Taurin, à Évreux[82], et surtout la
belle châsse de Tournay, pour reconnaître
que ces meubles, de la fin du XIIe siècle et du XIIIe, ont des
formes, des proportions et une ornementation qui leur appartiennent.
Plus tard, et particulièrement pendant le XVe siècle, les
orfèvres cherchent, dans la composition des châsses, à reproduire
en petit de grands édifices : c’est ainsi que fut refaite, en 1408, la
grande châsse de saint Germain, qui dépendait du trésor de Saint-Germain des Prés. Nous la donnons ici (fig. 6)[83]. Quel que fût le
mérite d’exécution de ces objets, ils avaient alors perdu leur caractère
propre, si remarquable deux siècles auparavant. La châsse de
saint Germain présentait cependant un grand intérêt au point  de vue iconographique ; c’est ce qui nous engage à la donner ici.
Les deux basses nefs étaient divisées en six arcades de chaque côté,
dans lesquelles étaient placées les statuettes de cuivre doré des
douze apôtres. A l’une des extrémités, on voyait, sous un arc, la
Trinité, représentée par le Père éternel assis, vêtu en pape, tenant devant lui Jésus-Christ en croix. Le Saint-Esprit, sous forme d’une
colombe, sort de la bouche du Père et descend vers le crucifix.
L’abbé Guillaume, qui fit exécuter cette châsse, était à la droite du
Père, en habit de religieux, la crosse en main et la mitre en tête ;
le roi Eudes était à sa gauche, revêtu des insignes de la dignité
royale. A l’autre extrémité se voyait également, sous une archivolte,
saint Germain en habits pontificaux, ayant à ses côtés saint Vincent
et saint Étienne, patrons de l’abbaye, en habits de diacres. Cette
châsse, surmontée d’une flèche à jour, n’avait qu’un mètre environ
de longueur ; elle était supportée par six figures d’hommes, de
cuivre doré, tenant des phylactères sur lesquels étaient gravés des
vers à la louange de ceux qui avaient contribué à faire exécuter
ou à décorer tant l’ancienne que la nouvelle châsse. Des pierres
précieuses qui avaient été posées sur l’ancienne châsse donnée par
Eudes, comte de Paris, entrèrent dans la décoration de celle-ci ;
ces pierres précieuses étaient au nombre de deux cent soixante,
les perles au nombre de quatre-vingt-dix-sept[84]. Un grand nombre
de châsses furent ainsi refaites pendant les XIIIe et XIVe siècles et
au commencement du XVe. Beaucoup furent vendues ou détruites
pendant les guerres désastreuses de l’invasion anglaise. Louis XI
répara ces pertes, si toutefois elles étaient réparables. On fit
refondre encore beaucoup de châsses neuves au commencement du
XVIe siècle, les formes des anciennes châsses n’étant plus dans le
goût de ce temps ; les guerres religieuses de la fin de ce siècle en
détruisirent une quantité innombrable. Pendant la Révolution, la
plupart des châsses qui avaient une valeur intrinsèque furent
envoyées à la monnaie et depuis, le clergé, les fabriques, les ont
vendues, souvent à vil prix à des amateurs ou brocanteurs, ou les
ont échangées contre des ornements de mauvais goût. Aussi, en
France, les châsses anciennes de quelque importance, et surtout
exécutées en matières précieuses, sont-elles fort rares.
de vue iconographique ; c’est ce qui nous engage à la donner ici.
Les deux basses nefs étaient divisées en six arcades de chaque côté,
dans lesquelles étaient placées les statuettes de cuivre doré des
douze apôtres. A l’une des extrémités, on voyait, sous un arc, la
Trinité, représentée par le Père éternel assis, vêtu en pape, tenant devant lui Jésus-Christ en croix. Le Saint-Esprit, sous forme d’une
colombe, sort de la bouche du Père et descend vers le crucifix.
L’abbé Guillaume, qui fit exécuter cette châsse, était à la droite du
Père, en habit de religieux, la crosse en main et la mitre en tête ;
le roi Eudes était à sa gauche, revêtu des insignes de la dignité
royale. A l’autre extrémité se voyait également, sous une archivolte,
saint Germain en habits pontificaux, ayant à ses côtés saint Vincent
et saint Étienne, patrons de l’abbaye, en habits de diacres. Cette
châsse, surmontée d’une flèche à jour, n’avait qu’un mètre environ
de longueur ; elle était supportée par six figures d’hommes, de
cuivre doré, tenant des phylactères sur lesquels étaient gravés des
vers à la louange de ceux qui avaient contribué à faire exécuter
ou à décorer tant l’ancienne que la nouvelle châsse. Des pierres
précieuses qui avaient été posées sur l’ancienne châsse donnée par
Eudes, comte de Paris, entrèrent dans la décoration de celle-ci ;
ces pierres précieuses étaient au nombre de deux cent soixante,
les perles au nombre de quatre-vingt-dix-sept[84]. Un grand nombre
de châsses furent ainsi refaites pendant les XIIIe et XIVe siècles et
au commencement du XVe. Beaucoup furent vendues ou détruites
pendant les guerres désastreuses de l’invasion anglaise. Louis XI
répara ces pertes, si toutefois elles étaient réparables. On fit
refondre encore beaucoup de châsses neuves au commencement du
XVIe siècle, les formes des anciennes châsses n’étant plus dans le
goût de ce temps ; les guerres religieuses de la fin de ce siècle en
détruisirent une quantité innombrable. Pendant la Révolution, la
plupart des châsses qui avaient une valeur intrinsèque furent
envoyées à la monnaie et depuis, le clergé, les fabriques, les ont
vendues, souvent à vil prix à des amateurs ou brocanteurs, ou les
ont échangées contre des ornements de mauvais goût. Aussi, en
France, les châsses anciennes de quelque importance, et surtout
exécutées en matières précieuses, sont-elles fort rares.
Les châsses ne contenaient pas seulement des corps-saints ; elles étaient destinées aussi à renfermer certaines reliques pieuses. On désignait l’armoire de vermeil contenant les précieuses reliques de la Sainte-Chapelle à Paris sous le nom de la grande-châsse. Dans l’église cathédrale de Chartres, la chemise de la sainte Vierge était conservée dans une magnifique châsse donnée en 896 par le roi Charles le Chauve. Cette chasse, qui avait 0m,677 de longueur, sur 0m,271 de largeur et 0m,569 de hauteur, était posée sur un brancard de vermeil semé de fleurs de lis en relief ; elle était de bois de cèdre, couverte de plaques d’or et enrichie d’une infinité de perles, diamants, rubis, émeraudes, saphirs, agates, turquoises, camées ou intailles, et accompagnée de nombreux bijoux donnés par divers princes et des évêques[85]. (Voyez, pour la position des châsses suspendues derrière et au-dessus des autels, le Dictionnaire d’architecture, au mot Autel.)
CHASUBLIER, s. m. Armoire renfermant une suite de tiroirs peu profonds, à coulisses, dans lesquels on pose les chasubles. Il est à croire que les chasubliers anciens n’étaient autrefois que des armoires vestiaires, les chasubles étant faites d’étoffes souples et non surchargées, comme elles le sont aujourd’hui, de lourdes broderies, doublées de bougran, ce qui leur donne la roideur d’une planche.
COFFRE, s. m. — Voy. Bahut, Chasse.
COFFRET, s. m. (coffre, escrint). Petit coffre.
« Pour les dames, cofres ou escrint
« Pour leurs besongnes hebergier[86]. »
Dès les premiers siècles du moyen âge, les coffrets étaient fort en usage ; on les fabriquait en matières précieuses, en ivoire, en marqueterie, en cuivre émaillé, en or, en argent ; ils étaient repoussés, ciselés, émaillés. Pendant leurs voyages, les dames les transportaient avec elles et y renfermaient des bijoux de prix. En campagne, dans les expéditions lointaines, les nobles, les chevaliers, outre les bahuts qui contenaient leurs effets, portaient de ces coffrets qui étaient confiés à la garde des écuyers, et qui contenaient l’argent, les bijoux, parfois même des titres. Car il était assez d’usage, jusqu’au XIIIe siècle, d’emporter avec soi les archives de famille, les titres précieux : tel était l’esprit de défiance qui dominait alors toutes les classes, que les plus puissants seigneurs n’osaient se séparer des objets dont ils n’eussent pu réparer la perte. Les coffres et coffrets tiennent donc une place importante dans le mobilier du moyen âge. C’est dans un coffret que sont déposés le cœur et la lettre de Raoul de Coucy destinés à la dame de Fayel, et rapportés par son écuyer Gobert, de Brindes en France.
Le châtelain de Coucy, sentant sa mort prochaine,
« … fist aporter
« Un des coffres de ses sonmiers
« Ouquel estoit li trésors chiers
« Des tresches (tresses) qu’il véoit souvent.
« Un coffre petitet d’argent
« En a trait et puis l’a baizié,
« Ouvert l’a, si a fors sachié
« Les tresches qui sambloient d’or[87].
« … »

Les trésors des cathédrales, des églises, les musées, conservent
encore un grand nombre de ces petits meubles, exécutés en général
avec beaucoup de soin et de recherche. Un des plus beaux et des
plus anciens coffrets que nous connaissions faisait partie de la collection
de M. le prince Soltykoff[88]. Ce coffret est d’ivoire bordé de
lames de cuivre doré finement gravées ; il a 32 centimètres de long sur
19 de large et 10 de hauteur. En voici (fig. 1) l’ensemble : il nous
paraît appartenir au Xe siècle, il est intact, sauf la serrure, la
clef et l’anse, qui ont été refaites au XVe siècle. Les dessins dont il
est orné sur ses quatre faces et le couvercle représentent des animaux
dans des entrelacs, biches becquetées par des aigles, daims,  aiglettes. La figure 2 donne le détail de la plaque formant couvercle, et la figure 3 une des bordures de cuivre gravé, grandeur d’exécution.
Il est facile, avec ces renseignements, de se faire une idée
complète de cet objet, remarquable par sa date, sa belle composition
et sa parfaite conservation.
aiglettes. La figure 2 donne le détail de la plaque formant couvercle, et la figure 3 une des bordures de cuivre gravé, grandeur d’exécution.
Il est facile, avec ces renseignements, de se faire une idée
complète de cet objet, remarquable par sa date, sa belle composition
et sa parfaite conservation.

Beaucoup de ces coffrets étaient renfermés, comme nos nécessaires de voyage, dans des enveloppes de cuir ornées elles-mêmes de gaufrures et dorures, de légendes armoyées ou d’emblèmes. Ces coffrets se rangeaient parfois à côté les uns des autres dans les bahuts de voyage, et contenaient chacun des armes, des objets nécessaires à la toilette, des parfums, des bijoux, des coiffures, aumônières, manches brodées, ceintures, etc. D’autres séries contenaient couteaux, petite vaisselle de table, coupes, hanaps, tasses de vermeil, épices, cordiaux dans de petits flacons.
« Or est monte a cheual le gentil Palanus lequel sen va accoustre tout ainsi que le vous conteray sans grant nombre de gens ne bagaige, car il nauoit que deux baheux, dont lung portait ung lit de camp bien petit entre deux coffres ou estoit une partie de son accoustrement, et l’autre bahu portoit ses coffres d’armes avec ses hardes sans aultre chose[89]. »
Les mœurs du moyen âge étaient nomades : nobles et marchands étaient souvent sur les grands chemins, et force était alors, lorsqu’on voulait vivre passablement, d’emporter tout avec soi ; puis, comme nous l’avons dit plus haut, on ne s’en rapportait qu’à soi-même pour garder son bien. Arrivait-on dans une ville, dans une hôtellerie, s’établissait-on temporairement quelque part, on se faisait un mobilier de tous ces coffres de voyage : les plus grands devenaient lits, tables ou armoires ; les moyens servaient de bancs, et les petits de nécessaires propres à renfermer tous les menus objets. Ces habitudes prirent un tel empire, que, dans des temps plus rapprochés de nous, où l’état du pays n’exigeait plus le charroi de tous les objets utiles à la vie journalière, on voyait encore des princes, et même de riches particuliers, se faire suivre en voyage de leur vaisselle et d’une quantité de meubles, tapisseries, linge et vêtements assez considérable pour meubler un palais[90].
Mais revenons aux coffrets. Ceux-ci n’affectent pas toujours la forme d’un parallélipipède ; quelquefois ils sont à pans. Il existe encore aujourd’hui, dans le trésor de la cathédrale de Sens, un coffret d’ivoire sculpté et peint, qui fut, dit-on, rapporté de Constantinople au XIIe siècle, et qui contenait des reliques précieuses. Il est en forme de prisme à douze pans, terminé par un couvercle en pyramide tronquée également à douze faces ; la hauteur du prisme est de 0m,22, le diamètre du coffret de 0m,31. Il est divisé en trois zones : celle inférieure représente l’histoire de David, celle au-dessus l’histoire de Joseph ; la troisième, des lions, des griffons affrontés, un griffon terrassant un bœuf, un griffon dépeçant une bête à cornes, un lion se jetant sur un bœuf, un griffon tuant un serpent, et un lion poursuivant un bouc. Sur le couvercle, on retrouve la suite de l’histoire de Joseph, ou plutôt son triomphe, l’arrivée de sa famille en Égypte, et son apothéose. La gorge qui sépare le couvercle du corps du coffret est revêtue de plaques d’émail de fabrique byzantine. Ce petit meuble fut certainement exécute à Byzance et paraît appartenir au XIIe siècle ; les bas-reliefs sont accompagnés d’inscriptions grecques, et le style des figures rappelle l’antiquité gréco-romaine.
Voici (fig. 4) un ensemble de ce précieux coffret, et (fig. 5) un
fragment d’un des petits bas-reliefs représentant Joseph allant au-devant
de Jacob et le recevant à son arrivée dans la terre de Gessen.
Le style des bas-reliefs qui décorent l’extérieur du coffret de Sens
est plein de grandeur, et certainement l’introduction d’objets de
fabrique byzantine, si fréquente en France pendant le XIIe siècle,
dut exercer une notable influence sur la sculpture due à nos artistes
occidentaux. Le trésor de la cathédrale de Sens n’a pas cessé de posséder
ce coffret depuis cette époque. Son origine n’est pas douteuse. Quand on examine les bas-reliefs des édifices du XIIe siècle,  dans l’Ile-de-France, la Champagne et la Bourgogne, on demeure
dans l’Ile-de-France, la Champagne et la Bourgogne, on demeure  frappé de l’analogie qu’il y a entre les sculptures de ce coffret, par exemple, et celles des chapiteaux du porche de l’église de Vézelay,
qui datent de 1130 environ. Nous avons dit que les ivoires du coffret
de Sens étaient peints : le vert, le pourpre, y dominent ; malheureusement,
une maladroite réparation a fait disparaître en grande
partie cette intéressante coloration et les inscriptions que Millin
a encore pu copier lorsqu’il visita Sens[91] en 1805. Sur le sommet
tronqué de la pyramide s’élevait probablement un bouton de cuivre
émaillé, pour permettre de soulever le couvercle ; il a été remplacé
par une de ces pommes de cuivre que l’on pose sur les premiers
balustres des escaliers.
frappé de l’analogie qu’il y a entre les sculptures de ce coffret, par exemple, et celles des chapiteaux du porche de l’église de Vézelay,
qui datent de 1130 environ. Nous avons dit que les ivoires du coffret
de Sens étaient peints : le vert, le pourpre, y dominent ; malheureusement,
une maladroite réparation a fait disparaître en grande
partie cette intéressante coloration et les inscriptions que Millin
a encore pu copier lorsqu’il visita Sens[91] en 1805. Sur le sommet
tronqué de la pyramide s’élevait probablement un bouton de cuivre
émaillé, pour permettre de soulever le couvercle ; il a été remplacé
par une de ces pommes de cuivre que l’on pose sur les premiers
balustres des escaliers.
L’abbaye du Lys possédait un coffret de bois recouvert de plaques d’argent vernies en noir verdâtre, de cuir doré et émaillé ; ce petit meuble est aussi précieux par sa composition que par son exécution. Il est aujourd’hui conservé dans l’église de Dammarie (Seine-et-Marne), et connu sous le nom de cassette de saint Louis[92]. Il est certain que ce coffret date du XIIIe siècle. Sur le couvercle, outre les huit médaillons représentant en relief des animaux, quatre améthystes sont enchâssées sur les encoignures ; sur la face et les côtés sont également disposés des médaillons. Un grand nombre d’écussons, semés entre ces médaillons, sont émaillés aux armes de France ancien, de Castille, de Bourgogne ancien, de Guillaume de Courtenay, de Montfort, de Dreux, de Bretagne, de Flandre, de Navarre et Champagne, de Graville, de Dammartin, de Toulouse, de France à trois fleurs de lis, de Coucy, de Beaumont, de Roye, de Champagne, de Jérusalem, de Bar, de Montmorency, de Normandie, d’Harcourt. L’anse, les équerres, les charnières, la serrure et son moraillon sont dorés et émaillés. De petits clous d’or à tête ronde fixent, entre les médaillons et les écus, la plaque d’argent très-mince qui recouvre exactement le bois. Rien n’indique que cette cassette ait eu une destination religieuse, et nous la regardons plutôt comme un de ces précieux écrins qui devaient renfermer des bijoux de prix.
Souvent les coffrets étaient faits de bois, et n’avaient de valeur que par la délicatesse et le goût des sculptures dont leurs ais étaient couverts.
Voici un de ces coffrets, très-simples comme matière, très-riches
par le travail (fig. 6) ; il est de bois de châtaignier, avec anse, charnières et serrure de fer[93]. Le dessus, que nous reproduisons
(Pl. III), est remarquable par sa composition. L’anse est munie
d’un anneau maintenu par une goupille lâche, de manière qu’en le
passant au doigt, le coffret puisse être cependant tourné en tous
sens ; procédé qui permettait, en tenant cette anse d’une main, de  présenter l’entrée de la serrure en face de l’autre main tenant la
clef. Ce coffret est décoré de figures et d’animaux dans des cercles
ornés de feuillages ; sur le côté, dans un des cercles, est une rose
au milieu de laquelle est sculptée en relief la lettre H ; sur des banderoles
portées par les figures, sont gravées des devises.
présenter l’entrée de la serrure en face de l’autre main tenant la
clef. Ce coffret est décoré de figures et d’animaux dans des cercles
ornés de feuillages ; sur le côté, dans un des cercles, est une rose
au milieu de laquelle est sculptée en relief la lettre H ; sur des banderoles
portées par les figures, sont gravées des devises.
Souvent, sur les coffrets, étaient sculptées des chasses, des scènes tirées de romans en vogue, des inscriptions, etc. Il existe encore, dans le trésor de l’église de Saint-Bertrand de Comminges, un coffret de bois recouvert de plaques de cuivre jaune estampé, sur lesquelles sont figurés en relief des chevaliers, des dames, des animaux. Les reliefs faits à l’étampe se répètent comme ceux d’une étoffe. Il était d’usage aussi de porter en voyage des coffrets de fer solidement fermés, dans lesquels on gardait les bijoux. Voici (fig. 7) un de ces coffrets, qui date du XVe siècle. Il se compose d’une boîte de chêne recouverte de cuir rouge ; sur le cuir est appliqué un premier réseau de fer étamé, à jour ; puis une seconde enveloppe de fer non étamé, également à jour, laissant voir à travers ses mailles le cuir et le réseau étamé. Des nerfs de fer
renforcent le couvercle, et une petite serrure très-solide et

anneaux permettent d’attacher ce coffret, au moyen de courroies  ou de chaînes, à l’intérieur d’un bahut trop lourd pour être facilement soustrait, ou de le porter en croupe, de le réunir au bagage
chargé sur des bêtes de somme[94].
ou de chaînes, à l’intérieur d’un bahut trop lourd pour être facilement soustrait, ou de le porter en croupe, de le réunir au bagage
chargé sur des bêtes de somme[94].
La figure 8 explique la disposition des deux plaques de fer appliquées l’une sur l’autre ; la charnière occupe toute la largeur du coffret et est formée par les plaques de fer battu qui lui servent d’enveloppe (fig. 9).
L’Italie fournit beaucoup de ces petits meubles : on en trouve encore dans les trésors de nos églises ; ils sont généralement d’os ou d’ivoire sculpté et de marqueterie. Le trésor de l’église de Saint-Trophime d’Arles en possède un fort remarquable, qui parait remonter au XIIIe siècle (Pl. IV)[95]. Celui de la cathédrale de Sens en conserve un autre du XIVe siècle. On en voit un grand nombre dans nos musées et dans les collections particulières.
COURTE-POINTE, s. f. (coustepointe, keutespointe). Grande couverture doublée et piquée, que l’on posait sur les bancs et tous les meubles pouvant servir de siéges ou de lits de repos.
« … L’empereriz fist traire les dames et les damoiselles en une autre chambre, et entre li et le vallet s’asistrent sor une cheuche (un coussin) d’une coustepointe coverte et d’un drap de soie[96]. »
On admet volontiers que les meubles du moyen âge étaient de formes incommodes et dépourvus de garnitures d’étoffes, parce que, dans quelques musées, on voit des chaires de bois, de la fin du XVe siècle ou du commencement du XVIe, à dossiers droits, couverts de sculptures souvent, qui ôtent toute idée de s’appuyer. Mais ces meubles d’apparat ne servaient guère et n’étaient placés dans les appartements que pour la montre. Ce n’étaient qu’à l’occasion de certaines solennités que le chef de famille se plaçait entre les bras de ces chaires richement sculptées et recouvertes d’ailleurs d’un épais coussin.
Quant aux meubles d’usage, ils étaient bien garnis, non à demeure, comme le sont les nôtres, mais au moyen de ces coussins si nombreux mentionnés dans les inventaires du moyen âge, et de ces courtes-pointes jetées sur le tout comme une housse, courtes-pointes faites d’étoffes moelleuses, épaisses, doublées et piquées.
Cet usage permettait d’entretenir les étoffes des meubles, de les
sans altération. Comme de nos jours, on plaçait aussi ces courtes-pointes sur les lits.
COUSSIN, s. m. (ceuche, coute, coite). Sac d’étoffe rembourré de laine ou de plume ; s’entend comme oreiller, coussin, matelas.
« Conchier comme sor une coite,
« Car la terre estoit douce et moite[97].
« … »
Les assassins de la reine Blanche, femme de don Pèdre, étouffent cette princesse entre deux matelas :
« Dont prinrent li Juif sans point de l’atargier
« La dame, et puis la vont dessus. I. lit couchier ;
« Et puis gietent sur lui une coute à ormier[98],
« Et puis vont les. II. coûtes d’une corde lier,
« Et à chascun coron pendirent. I. mortier[99] ;
« … »
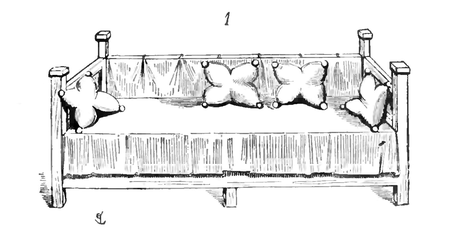
On plaçait des coussins sur les siéges de bois ou de métal, et sous les pieds des personnes assises (voy. Chaire), sur les bancs, les bahuts ou coffres placés autour des salles de réception, Ces coussins étaient, chez les personnages riches, recouverts d’étoffes précieuses, brodées, ou tissées d’or et de vives couleurs ; ils étaient généralement carrés, avec quatre boutons ou glands aux quatre angles. Dans les peintures et vignettes de manuscrits antérieurs au XIIe siècle, on voit figurer aussi des coussins cylindriques comme nos traversins. Le XVe siècle, qui apporta un grand luxe dans l’ameublement, donna aux coussins des formes appropriées à leur usage particulier : ainsi les coussins de siéges sont épais, larges, carrés ou ronds ; ceux destinés à être placés sous les pieds sont quelquefois en forme de boule ; ceux jetés sur les bancs sont taillés de façon à permettre aux personnes assises d’appuyer leurs coudes entre leurs oreilles. C’est ainsi que sont figurés les coussins que nous présente la vignette (fig. 1), tirée du manuscrit de Girard de Nevers, de la Bibliothèque nationale[100]. Les dames de qualité qui se rendaient à l’église faisaient porter avec elles des coussins que l’on posait sur les dalles ; elles pouvaient s’agenouiller ainsi sans trop de fatigue et sans salir leurs vêtements. Dans les cérémonies, c’était, comme aujourd’hui encore, sur des coussins richement drapés que l’on posait les insignes, couronnes, épées, sceptres.
COUVERTURE, s. f. — Voy. Lit.
CRÉDENCE, s. f. Petit buffet sur lequel on déposait les vases destinés à faire l’essai. La crédence, dans l’église, est une tablette sur laquelle on plaçait les burettes, les linges et tous les menus objets nécessaires aux cérémonies du culte. Jusqu’au XVIe siècle, une crédence est disposée près de chaque autel et souvent dans la niche destinée aux piscines.
« Les principaux autels d’aujourd’hui », dit Thiers dans sa Dissertation sur les principaux autels des églises, « ne sont pas toujours accompagnés de ce que nous appellons crédences. La plus-part de ceux des cathédrales n’en ont point du tout. Ceux des autres églises en ont, les uns deux, l’une à droit, l’autre à gauche ; les autres n’en ont qu’une à droit ou du côté de l’épître. Mais il n’y a que celle qui est du côté de l’épître qui serve à mettre le calice, les burettes, le livre des épîtres et des évangiles, etc. Celle qui est à gauche ne sert de rien pour l’ordinaire, si ce n’est pour faire la simétrie, ou tout au plus pour placer quelques chandeliers et quelques violiers… » Cette idée de symétrie n’existait pas avant le XVIe siècle, et il n’y avait du côté de l’épître qu’une crédence. « Les rubriques du Missel romain n’en veulent qu’une tout au plus du côté de l’épître, encore insinuent-elles que l’on s’en pourroit passer s’il y avoit une petite fenêtre proche l’autel, où l’on pût mettre la clochette, les burettes, le bassin et l’essuie-main qui servent à la messe… Le cérémonial des évêques n’en veut qu’une aussi, dont on ne doit se servir qu’aux messes solemnelles. » Mais jusqu’au qu’au XVIe siècle, il n’y avait guère de crédence, c’est-à-dire de tables découvertes près des autels, mais bien des armoires, soit prises dans la muraille, soit meubles, dans lesquelles on déposait le calice, la patène, le voile, le corporal, le pain et le vin. Dans les églises de l’ordre de Cluny et de l’ordre de Cîteaux, c’était dans des armoires (meubles) placées vis-à-vis ou au côté droit de l’autel qu’on déposait tout ce qui était nécessaire pour la consécration, pour la communion des religieux.
Ces crédences sont immeubles ; nous n’avons pas à nous en occuper ici[101]. Quelquefois, sur le côté de l’autel, est réservée une tablette saillante ou un petit réduit servant de crédence[102].

Près des tables à manger, lorsque le couvert était mis[103], on plaçait
un meuble qui servait à faire l’essai ; ce meuble se composait d’une petite armoire fermée à clef, dont le dessus, recouvert d’une
nappe, était destiné, au moment du festin, à recevoir les vases que
renfermait l’armoire. Avant le XIIIe siècle, ces petits meubles (autant
qu’on en peut juger par l’examen des vignettes des manuscrits ou
les sculptures) sont circulaires et rappellent assez la forme d’un
guéridon, d’une table ronde entre les pieds de laquelle seraient
disposées des tablettes. Un des chapiteaux du porche de Vézelay[104]
nous présente une crédence assez riche et garnie de ses vases. Cette
sculpture (fig. 1) appartient au XIIe siècle ; elle représente probablement  un des traits de la vie de saint Antoine[105]. Sous la tablette circulaire
supérieure s’ouvre une petite armoire plein cintre, dans
laquelle on voit deux coupes ; en avant, sur un escabeau, reposent
deux vases à col allongé. Dans les vignettes des manuscrits des XIIIe et
XIVe siècles, les vases contenant les liquides soumis à l’essai étaient
parfois posés simplement à terre, et recouverts d’une petite nappe
(fig. 2)[106].
un des traits de la vie de saint Antoine[105]. Sous la tablette circulaire
supérieure s’ouvre une petite armoire plein cintre, dans
laquelle on voit deux coupes ; en avant, sur un escabeau, reposent
deux vases à col allongé. Dans les vignettes des manuscrits des XIIIe et
XIVe siècles, les vases contenant les liquides soumis à l’essai étaient
parfois posés simplement à terre, et recouverts d’une petite nappe
(fig. 2)[106].
Les reproductions de crédences deviennent fréquentes dans les manuscrits du XVe siècle, et prennent alors, dans le mobilier, une assez grande importance. D’abord fort simples de forme (voy. fig. 3)[107] comme tous les meubles privés, décorées seulement par les étoffes dont elles étaient couvertes et par leur construction propre, les crédences s’enrichissent bientôt de sculptures, de délicates ferrures ; puis elles sont munies de dossiers, ainsi que l’indique la figure 4, copiée sur im des bas-reliefs de bois des stalles de la cathédrale d’Amiens[108]. Ces dossiers sont même parfois surmontés de dais sculptés avec luxe (voy. fig. 5)[109]. Les deux dernières crédences que nous donnons ici indiquent parfaitement l’usage auquel on les destinait pendant les repas.

Chez les souverains, les grands seigneurs, les crédences étaient souvent garnies d’orfèvrerie, de plats d’argent ou de vermeil ; on les plaçait d’ordinaire derrière le maître, auquel on présentait la première coupe de liqueur après avoir fait l’essai. Les dossiers des crédences ou les panneaux des vantaux de la petite armoire portent quelquefois l’écusson aux armes du maître du logis.
Le meuble qu’on désignait, dans le siècle dernier et au commencement
de celui-ci, sous le nom de servante, rappelait encore la crédence ;
il a presque totalement disparu de nos maisons, et n’était
plus destiné au même usage que la crédence, puisqu’il était fait pour
permettre à un petit nombre de convives de se servir eux-mêmes
sans le concours des domestiques et sans être obligés de se lever de  table. La servante, toutefois, était un meuble commode : c’était la crédence mise sur quatre roulettes, devenue légère, et privée de l’écuyer
ou du familier chargé de faire l’essai. C’est à la fin du règne
table. La servante, toutefois, était un meuble commode : c’était la crédence mise sur quatre roulettes, devenue légère, et privée de l’écuyer
ou du familier chargé de faire l’essai. C’est à la fin du règne  de Louis XIV, lorsqu’il s’éleva contre l’étiquette majestueuse du
grand règne une réaction générale, que la crédence devint servante. Le gentilhomme qui avait dans son hôtel une nuée de familiers
trouva insupportable de manger devant deux ou trois gaillards chargés
de lui donner une assiette ou de lui verser du vin ; il fit approcher
la crédence de la table à manger, ferma la porte sur le dos des
laquais, et put causer à son aise avec les deux, trois ou quatre convives
invités à sa table ; on mit dès lors des roulettes aux pieds de
la crédence, et elle prit un nom indiquant son usage. Aujourd’hui, le
plus petit bourgeois qui tient un valet à gages se croirait déshonoré
s’il se servait lui-même ; s’il invite un ami, quitte à rendre le repas
ennuyeux comme un dîner de table d’hôte, il prétend que le laquais
soit là. Le bourgeois a repoussé la servante de son père avec dédain ;
nous en avons vu bon nombre dans les greniers.
de Louis XIV, lorsqu’il s’éleva contre l’étiquette majestueuse du
grand règne une réaction générale, que la crédence devint servante. Le gentilhomme qui avait dans son hôtel une nuée de familiers
trouva insupportable de manger devant deux ou trois gaillards chargés
de lui donner une assiette ou de lui verser du vin ; il fit approcher
la crédence de la table à manger, ferma la porte sur le dos des
laquais, et put causer à son aise avec les deux, trois ou quatre convives
invités à sa table ; on mit dès lors des roulettes aux pieds de
la crédence, et elle prit un nom indiquant son usage. Aujourd’hui, le
plus petit bourgeois qui tient un valet à gages se croirait déshonoré
s’il se servait lui-même ; s’il invite un ami, quitte à rendre le repas
ennuyeux comme un dîner de table d’hôte, il prétend que le laquais
soit là. Le bourgeois a repoussé la servante de son père avec dédain ;
nous en avons vu bon nombre dans les greniers.
Nos buffets de salle à manger et nos caves à liqueur fermées à clef sont encore une dernière tradition de la crédence du moyen âge.
CUIR peint, gaufré, doré (voy. Tenture). L’usage de peindre, dorer, argenter et gaufrer le cuir est fort ancien, puisque le moine Théophile donne la manière de le préparer pour recevoir la décoration[110]. Mais il semblerait que, de son temps, au XIIe siècle, on n’employait guère le cuir dans l’ameublement que comme un moyen de recouvrir des tables, armoires, panneaux : il ne paraît pas qu’on en ait fait des tentures fabriquées comme celles que nous possédons encore et qui datent des XVIe et XVIe siècles. Cependant on savait, dès les premiers siècles du moyen âge, peindre, dorer et gaufrer le cuir libre, non collé sur panneau, et on l’employait dans les équipements et harnachements militaires ; il est donc probable qu’on s’en servait aussi parfois pour recouvrir des meubles, des dossiers de bancs, des stalles, etc.[111]. Au XVIe siècle, les cuirs-tentures se fabriquaient principalement à Paris, à Rouen, en Allemagne et en Brabant.
D
DAIS, s. m. (ciel). Châssis recouvert d’étoffes et quelquefois accompagné
de courtines, que l’on plaçait au-dessus d’un trône, d’un siége
d’honneur, ou que l’on transportait sur des bâtons au-dessus d’un
personnage à pied ou à cheval. Les trônes, dans les vignettes des
manuscrits qui datent des XIVe et XVe siècles, sont presque toujours  surmontés de dais très-simples de forme, riches comme étoffe.
Voici (fig. 1) le trône d’un roi, avec dais, dossier et couverture
d’étoffe rouge semés de fleurs de lis d’or[112]. Les dais qui accompagnaient
les siéges des personnes souveraines sont ordinairement carrés, sans pavillon : cette forme était d’étiquette ; les dais avec
pavillon au-dessus étaient plus particulièrement réservés aux trônes
d’évêques. Les autels, les suspensions, les fonts baptismaux, étaient
aussi parfois couverts de dais sans pavillon. Voici (fig. 2) un dais
royal accompagné de deux courtines relevées[113] ; l’étoffe est pourpre
avec dessin or ; le bois du trône est complètement doré. Lors des entrées
surmontés de dais très-simples de forme, riches comme étoffe.
Voici (fig. 1) le trône d’un roi, avec dais, dossier et couverture
d’étoffe rouge semés de fleurs de lis d’or[112]. Les dais qui accompagnaient
les siéges des personnes souveraines sont ordinairement carrés, sans pavillon : cette forme était d’étiquette ; les dais avec
pavillon au-dessus étaient plus particulièrement réservés aux trônes
d’évêques. Les autels, les suspensions, les fonts baptismaux, étaient
aussi parfois couverts de dais sans pavillon. Voici (fig. 2) un dais
royal accompagné de deux courtines relevées[113] ; l’étoffe est pourpre
avec dessin or ; le bois du trône est complètement doré. Lors des entrées  des princes et princesses, des personnes royales, il était d’usage
de faire porter un dais au-dessus de leur tête. « Quand nos Rois et
Reines font leur première entrée à Paris, c’est à eux (les échevins)
d’apporter le ciel d’azur semé de fleurs de lis d’or, et le mettre
et porter parmi la ville par-dessus leurs majestés[114]. » En effet, la
figure 3 nous représente l’entrée d’Isabeau de Bavière dans la bonne ville de Paris La jeune reine est montée sur une haquenée ; quatre
échevins portent le dais au-dessus de sa tête[115]. On donnait aussi,
dans le cérémonial, par extension, le nom de dais à l’estrade sur
laquelle montaient et se tenaient les personnes royales pendant certaines
des princes et princesses, des personnes royales, il était d’usage
de faire porter un dais au-dessus de leur tête. « Quand nos Rois et
Reines font leur première entrée à Paris, c’est à eux (les échevins)
d’apporter le ciel d’azur semé de fleurs de lis d’or, et le mettre
et porter parmi la ville par-dessus leurs majestés[114]. » En effet, la
figure 3 nous représente l’entrée d’Isabeau de Bavière dans la bonne ville de Paris La jeune reine est montée sur une haquenée ; quatre
échevins portent le dais au-dessus de sa tête[115]. On donnait aussi,
dans le cérémonial, par extension, le nom de dais à l’estrade sur
laquelle montaient et se tenaient les personnes royales pendant certaines  solennités ; ce n’était toutefois que lorsque ces estrades étaient
couvertes d’un ciel. On disait dais à queue, pour désigner les dais
accompagnés de courtines, comme celui représenté figure 2 ; dais
sans queue, pour désigner les ciels simples, composés d’un dessus
avec pentes ou gouttières, sans courtines. Dans les banquets la
chaire du seigneur était couverte d’un dais ; et pendant les plaids
royaux le dais était placé sur le trône, à l’un des angles de la salle.
solennités ; ce n’était toutefois que lorsque ces estrades étaient
couvertes d’un ciel. On disait dais à queue, pour désigner les dais
accompagnés de courtines, comme celui représenté figure 2 ; dais
sans queue, pour désigner les ciels simples, composés d’un dessus
avec pentes ou gouttières, sans courtines. Dans les banquets la
chaire du seigneur était couverte d’un dais ; et pendant les plaids
royaux le dais était placé sur le trône, à l’un des angles de la salle.
DORSAL, s. m. Grande pièce de tapisserie ou d’étoffe que l’on
accrochait aux murs d’appui, aux panneaux des chaires, des formes,
derrière le dos du clergé, sur le fond des dressoirs chargés de vaisselle.
Les stalles des chœurs, des salles capitulaires étaient souvent
garnies d’étoffes ou de cuirs gaufrés et dorés. La cathédrale d’Augsbourg
a conservé jusqu’à nos jours ses dossiers de cuir doré, qui
datent du commencement du XVIe siècle. Nos églises françaises étaient fort riches en décorations de ce genre dès les premiers temps
du moyen âge. Lorsque Héribert, quarante-neuvième évêque
d’Auxerre, après avoir été sacré en 1040, fut porté, suivant la coutume,  jusqu’à la cathédrale, sur les épaules de la noblesse, et qu’il
eut fait ainsi son entrée dans l’église, « il y fit présent d’une belle
et grande pièce de tapisserie ou d’étoffe qu’on appelait du nom
de dorsal, parce qu’elle servoit à orner les murs d’appui derrière le dos du clergé[116] » Les anciennes stalles de l’église abbatiale de
Saint-Denis étaient encore, du temps de dom Doublet, garnies de
tapisseries semées de fleurs de lis d’or. A la cathédrale de Paris, des
tapisseries étaient également suspendues aux dossiers des chaires
du chœur avant 1714[117]. Ce n’était pas seulement le long des meubles
fixes, comme les stalles, que l’on plaçait des tentures d’étoffes, c’était
aussi contre les dossiers des bancs ou formes disposés autour des
appartements dans les palais et maisons. La fig. 1[118] représente un de
ces meubles civils garni de son dorsal, de sa couverture ou keutespointe
et de coussins. Ce dorsal est vert avec dessins or. Il est accroché
par des anneaux à des boutons fixés au sommet des panneaux
du meuble sous le dais saillant, et tombe jusqu’au siège. Ces tentures
pouvaient donc être facilement enlevées pour être nettoyées
ou remplacées. Il est probable qu’on ne les posait, lorsqu’elles étaient
précieuses, que pour les grands jours ; à l’ordinaire, on accrochait
des pièces de serge ou d’étoffe commune.
jusqu’à la cathédrale, sur les épaules de la noblesse, et qu’il
eut fait ainsi son entrée dans l’église, « il y fit présent d’une belle
et grande pièce de tapisserie ou d’étoffe qu’on appelait du nom
de dorsal, parce qu’elle servoit à orner les murs d’appui derrière le dos du clergé[116] » Les anciennes stalles de l’église abbatiale de
Saint-Denis étaient encore, du temps de dom Doublet, garnies de
tapisseries semées de fleurs de lis d’or. A la cathédrale de Paris, des
tapisseries étaient également suspendues aux dossiers des chaires
du chœur avant 1714[117]. Ce n’était pas seulement le long des meubles
fixes, comme les stalles, que l’on plaçait des tentures d’étoffes, c’était
aussi contre les dossiers des bancs ou formes disposés autour des
appartements dans les palais et maisons. La fig. 1[118] représente un de
ces meubles civils garni de son dorsal, de sa couverture ou keutespointe
et de coussins. Ce dorsal est vert avec dessins or. Il est accroché
par des anneaux à des boutons fixés au sommet des panneaux
du meuble sous le dais saillant, et tombe jusqu’au siège. Ces tentures
pouvaient donc être facilement enlevées pour être nettoyées
ou remplacées. Il est probable qu’on ne les posait, lorsqu’elles étaient
précieuses, que pour les grands jours ; à l’ordinaire, on accrochait
des pièces de serge ou d’étoffe commune.
DRAP, s. m. Pièce d’étoffe plus ou moins riche, que l’on posait sur le cercueil d’un mort, ou que l’on jetait sur le corps d’un chevalier, d’un noble tué dans une bataille, avant de l’ensevelir. Quand Charles de Blois est tué devant le château d’Alroy, le comte de Montfort dit à ses chevaliers :
« … Seignor, aller cerchant
« Le ber Charles de Bloiz, qui est mort en ce champ ;
« Et puis le renderay aux gentilz (bourgeois) de Guingamp.
« …
« Adont le fist partir tost et incontinant
« Et couvrir d’un drap d’or, à loi d’omme poissant.
« …[119] »
Dans la tapisserie de Bayeux, on voit la bière du roi Edward portée par huit hommes ; elle est couverte d’un drap très-riche et qui tombe de chaque côté du cercueil. Ces draps semblent n’avoir été, jusqu’au XVIe siècle, qu’une pièce d’étoffe recouvrant les parties latérales de la châsse ou bière ; plus tard ils furent composés de pièces cousues et enveloppant la bière tout entière comme une housse, ainsi que le fait voir la figure 1, copiée sur une vignette d’un manuscrit du XVe siècle[120]. Ce drap est noir, rehaussé d’or ; il est coupé suivant la forme et la dimension du cercueil et tombe largement tout autour.

Aux XVe et XVIe siècles, il était d’usage de garnir les draps mortuaires d’écussons armoyés aux armes du défunt. Lorsque le personnage était un roi ou un puissant seigneur possesseur de nombreux domaines, on plaçait autour de la bière, sur le drap, les armes de chaque fief ; une croix, ordinairement blanche, était cousue sur l’étoffe, et les insignes de la qualité du mort étaient déposés au centre de la croix. La figure 2 donne un exemple de cette disposition. Pour les obsèques des souverains, les draps, très-amples, recouvraient le sol autour de la bière, et sur ces pentes étaient placés les flambeaux.

Il ne paraît pas que le noir fût adopté pour les draps mortuaires ou poêles avant le XVIe siècle[121] ; dans les peintures, les vitraux et les miniatures, les cercueils sont recouverts de draps d’or, chamarrés ou unis, de couleur avec dessins, avec ou sans croix ; au XIVe siècle particulièrement, les draps adoptent les émaux des armes du défunt, car le poêle était surtout destiné à faire connaître sa qualité. Ce ne fût guère qu’au XVIe siècle que les poêles furent invariablement noirs et blancs, exceptés pour les personnages souverains, qui conservèrent l’or, le pourpre, le violet ou le rouge. Nous avons encore vu, dans quelques églises, des draps de cette époque pendus aux murailles ou conservés dans les sacristies ; ils sont noirs, avec une croix blanche dont les bras sont divisés par deux autres bandes longitudinales également blanches (fig. 3) qui se trouvaient sur les deux angles formés par les deux parties inclinées du couvercle de la bière. Quelquefois de petites croix, noires sur les extrémités de la croix ou blanches sur les fonds noirs, viennent rehausser l’étoffe. Il existe un drap de ce genre dans l’église de Folleville (Somme)[122].

DRESSOIR, s. m. (dressouer, dreçouer). Meuble fait en forme d’étagère,
garni de nappes, et sur lequel on rangeait de la vaisselle de
prix, des pièces d’orfévrerie pour la montre. On disposait dans les
salles de festins, chez les personnages riches, des dressoirs couverts
de vaisselle d’argent ou de vermeil, d’objets précieux, de drageoirs,
de pots contenant des confitures et des épices. Dans la cuisine ou
l’office, le dressoir était destiné à recevoir, dans l’ordre convenable,
tous les mets qui devaient être placés sur la table. Dans la chambre,
de petits dressoirs supportaient sur leurs gradins, comme les étagères
de notre temps, des vases précieux et les mille superfluités dont les personnes habituées au luxe aiment à s’entourer. Le nombre
des degrés du dressoir était fixé par l’étiquette : telle personne noble
pouvait avoir un dressoir à trois degrés, telle autre à deux seulement.
Quelquefois la crédence et le dressoir ne font qu’un, ou plutôt
le dressoir sert de crédence. La figure 1 nous donne un dressoir
remplissant cette double fonction[123] ; un seul gradin porte des plats
d’argent appuyés de champ sur un fond couvert d’étoffe. La petite
armoire inférieure, servant de crédence, est couverte d’une nappe  sur laquelle sont posées trois aiguières également
d’argent. Mais le véritable dresseoir
n’était composé que de gradins avec
un dorsal et quelquefois un dais d’étoffe
ou de bois sculpté, ainsi que l’indique la
figure 2.
sur laquelle sont posées trois aiguières également
d’argent. Mais le véritable dresseoir
n’était composé que de gradins avec
un dorsal et quelquefois un dais d’étoffe
ou de bois sculpté, ainsi que l’indique la
figure 2.
« En ladite chambre (de la comtesse
de Charolais, femme de Charles le Téméraire),
il y avoit ung grand dresseoir, sur
lequel y avoit quatre beaux degrez, aussi
longs que le dresseoir étoit large, et tout
couvert de nappes, ledit dresseoir et les
degrez estoient tous chargez de vaisselles
de cristalle garnies d’or et de pierreries
et sy en y avoit de fin or ; car toute la plus
riche vaisselle du Ducq Philippe y estoit,
tant de pots, de tasses, comme de coupes
de fin or. Autres vaisselles et bassins,
lesquels on y met jamais qu’en tel
cas. Entre autre vaisselle, il y avoit sur ledit dressoir trois drageoirs
d’or et de pierreries, dont l’un estoit estimé à quarente mil
escus et l’autre à trente mil. Sur ledit dressoir estoit tendu un dorset
(dorsal) de drap d’or cramoisy bordé de velours noir, et sur
le velour noir estoit brodée de fin or la devise de Monseigneur
le Ducq Philippe, qui estoit le fusil. Pour déclarer de quelle façon
est un dorseret, pour ce que beaucoup de gens ne sçavent que
c’est ; un dorseret est de largeur de trois draps d’or ou d’un autre
drap de soye, et tout ainsi fait que le ciel que l’on tend sur un
lict, mais ce qu’est dessus le dressoir ne le passe point plus d’un
quartier ou d’une demi aulne, et est à gouttières et à franges  comme le ciel d’un lict, et ce qu’est derrière le dressoir, depuis
en hault jusques en bas est à deux costez, bordé de quelque chose
autre que le dorseret n’est ; et doit être la bordure d’un quartier
de large ou environ, aussi bien au ciel que derrière.
comme le ciel d’un lict, et ce qu’est derrière le dressoir, depuis
en hault jusques en bas est à deux costez, bordé de quelque chose
autre que le dorseret n’est ; et doit être la bordure d’un quartier
de large ou environ, aussi bien au ciel que derrière.
« Item, sur le dressoir qu’estoit en la chambre de ladite dame, avoit toujours deux chandeliers d’argent, que l’on appelle à la cour mestiers[124], là où il y avoit toujours deux grands flambeaux ardens, tant qu’elle fut bien quinze jours avant que l’on commençât à ouvrir les verrières de sa chambre. Auprès du dressoir à un coing, il y avoit une petite tablette basse, là où l’on mettoit les pots et tasses pour donner à boire à ceux qui venoient voir Madame, après qu’on leur avoit donné de la dragée ; mais le drageoir estoit sur le dressoir[125]. »
Le dressoir décrit ici, placé dans la chambre d’Isabelle de Bourbon, femme du comte de Charollais, depuis Charles le Téméraire, fut garni ainsi richement, à l’occasion de la naissance de Marie de Bourgogne, qui épousa le duc d’Autriche. C’était un usage, lors des couches des princesses, de tenir leur chambre fermée pendant quinze jours, et de la décorer de tout ce que le trésor du palais contenait de plus précieux. Les étoffes prenaient une place importante dans ces meubles ainsi garnis, et servaient de fond à la vaisselle posée sur les gradins. On voit que l’étiquette, non-seulement imposait le nombre de ces gradins, mais aussi la forme et la dimension du dorsal, du dais et des bordures. Dans la chambre de parade, qui précédait la chambre de l’accouchée, il y avait un autre dressoir très-grand, tout chargé de grands flacons, pots et autre vaisselle d’argent doré, de tasses et drageoirs ; celui-ci était également couvert de nappes sur les degrés et autour, suivant l’usage. Marie de Bourgogne, comme fille du comte de Charolais, et héritière par conséquent, avait cinq degrés à son dressoir ; cependant les reines de France seules jouissaient de ce privilège. Une femme de chevalier banneret n’avait pendant ses couches que deux degrés à son dressoir ; une comtesse pouvait en avoir trois[126].
Les dressoirs n’étaient pas toujours disposés pour être adossés à la muraille ; ils étaient isolés quelquefois en forme de buffet (voyez ce mot), ronds, à pans ou carrés. Ce meuble ne paraît guère avoir été en usage avant le XIVe siècle, car, jusqu’alors, les plus riches seigneurs et les souverains ne semblent pas avoir possédé une vaisselle somptueuse. Pendant l’époque féodale, les habitudes de la vie intérieure étaient simples, et les grands possesseurs de fiefs préféraient employer leurs trésors à bâtir des châteaux forts, à tenir près d’eux un grand nombre d’hommes d’armes, à les équiper et les nourrir, qu’à acheter de la vaisselle d’or ou d’argent. C’est depuis Charles V surtout que l’on voit apparaître ce désir d’étaler un luxe excessif. Ni les malheurs qui accablèrent la France pendant le XVe siècle, ni la misère des classes inférieures, ne purent arrêter les progrès du mal. Le peu de matières d’or ou d’argent que laissèrent les guerres dans ce malheureux pays étaient soustraites à la circulation pour décorer les dressoirs de la haute noblesse.
Dès la fin du XIVe siècle, la maison de Bourgogne, puissante, possédant les domaines les plus productifs de l’Europe d’alors, faisait parade de sa richesse, donnaient des fêtes qui surpassaient comme luxe tout ce que l’on peut imaginer. La cour de France était plus jalouse encore peut-être de cette splendeur que de la prédominence politique qu’avaient acquise les ducs de Bourgogne. C’était donc à qui, à Paris ou à Dijon, éclipserait son rival par un déploiement de luxe inouï, par la montre d’une grande quantité de vaisselle d’or et d’argent, d’orfévrerie de table, par des largesses et des fêtes renouvelées à de courts intervalles.
C’est aussi pendant le XVe siècle que des meubles, et particulièrement ceux d’apparat, prennent une importance inconnue jusqu’alors. Les dressoirs, qui étaient plutôt des meubles de luxe que d’utilité, se rencontrent dans toutes les descriptions de fête, de banquets, dans les entrées mêmes des personnes souveraines, car les bonnes villes en établissaient alors, chargés de vaisselle, en plein air ou sur des litières transportées pendant le passage des princes ; ils les suivaient jusqu’à leur logis, où, bien entendu, on les laissait[127]. (Voy. Litière.)
E
ÉCRAN, s. m. (garde-feu). Sorte de claie d’osier que l’on plaçait devant le feu afin de ne point être incommodé par la trop grande chaleur[128].
Les appartements, pendant le moyen âge et jusqu’au XVIIe siècle, étaient chauffés au moyen de très-grandes cheminées dans lesquelles on brûlait des troncs d’arbres énormes (voy. dans le Dictionnaire raisonné de l’architecture le mot Cheminée) ; ces feux devaient être tellement ardents, qu’on ne pouvait s’en approcher sans risquer tout au moins de roussir ses vêtements. Ces écrans d’osier, plus ou moins grands, tempéraient la chaleur qui arrivait tamisée à travers les mailles de la claie ; ils étaient montés sur pieds, de manière à pouvoir être posés comme bon semblait. On fabriquait encore des écrans de ce genre, dans l’ouest de la France, à la fin du siècle dernier ; souvent aussi on se contentait de les suspendre par deux boucles au manteau de la cheminée, pour pouvoir se chauffer les pieds sans avoir le visage brûlé. Nos aïeux prenaient, pour rendre le voisinage du feu agréable, une foule de précautions de détail qui indiquent combien on appréciait ce compagnon indispensable des longues soirées d’hiver. Si le feu était ardent et remplissait l’âtre, on approchait les écrans, petits et grands, que l’on disposait comme des mantelets pour tempérer le rayonnement de la flamme et de la braise ; si le feu commençait à s’éteindre et n’occupait plus qu’un petit espace du foyer, on s’asseyait sous le manteau de la cheminée, sur des escabeaux. Parfois des lambrequins, accrochés au manteau, préservaient le visage des personnes qui voulaient se chauffer debout, en se tenant d’une main à des poignées scellées sous le grand linteau de la cheminée.
Voici (fig. 1) la copie d’un meuble qui sert à la fois de siège et d’écran ; c’est un banc double[130], avec dossier pivotant sur un axe de manière à s’incliner, soit d’un côté, soit de l’autre, suivant que les personnes assises veulent faire face au feu ou lui tourner le dos. Ce meuble, placé dans l’âtre, permettait de profiter de toute la chaleur du foyer en s’asseyant du côté qui lui faisait face, ou de s’en garantir en jetant une pièce d’étoffe sur la barre du dossier. Cela est assez ingénieux.
On avait aussi, pendant le moyen âge, des paniers ou coffrets d’osier dans lesquels on mettait les jambes lorsqu’on voulait s’asseoir près du feu sans brûler ses chausses[131].
ESCABEAU, s. m. (escame). Petit banc sans dossier, court, bas et étroit.
« Uns compains estoit assomez (assoupi)
« Qui ronfloit dessus une escame[132]. »
L’escabeau est plus bas que le banc et la chaise ; l’inférieur auquel on permettait de s’asseoir prenait un escabeau (fig. 1)[133]. C’était un meuble commode pour causer avec les femmes, celles-ci étant assises sur des bancs ou des chaires ; il permettait de se tourner dans tous les sens, de se déplacer facilement. Aussi les escabeaux étaient-ils souvent triangulaires (fig. 2)[134]. On ne s’en servait pas seulement comme de sièges, mais aussi comme de petites tables basses, ainsi que l’indique la dernière figure ; on posait dessus une tasse, un pot, une assiette pour goûter. Les femmes s’en servaient aussi comme de tabourets, lorsqu’elles travaillaient à l’aiguille et au métier, occupations pendant lesquelles il est nécessaire d’avoir les pieds élevés. Les meubles servant de sièges pendant le moyen âge sont très-variés de forme, de hauteur et de dimensions ; autant les uns étaient fixes et lourds, autant les autres étaient légers et mobiles. Ces différences ne contribuent pas peu à donner à la conversation un tour facile, imprévu, piquant ; car, si l’on veut bien le remarquer, rien n’est moins pittoresque qu’une réunion de personnes, hommes et femmes, assis tous sur des sièges de formes et de hauteurs pareilles : il semble qu’alors la conversation prenne quelque chose de l’uniformité de postures qui résulte de la similitude des sièges. Nous ne savons si la décence y gagne, mais certainement l’esprit y perd quelque chose de sa liberté. Nous voyons que, pour rompre cette monotonie de poses, les hommes ont pris l’habitude de parler debout aux femmes assises ; mais celles-ci, le cou tendu, la tête levée, éprouvent de la fatigue, et bientôt de l’ennui par conséquent. Nous avons, au contraire, observé que, les hommes étant assis plus bas que les femmes, chacun se trouve dans la posture qui prête le mieux à une conversation suivie.
Les escabeaux étaient donc nombreux dans les appartements du moyen âge ; ils accompagnaient les grands siéges, et les hommes, dans la familiarité, les prenaient volontiers. Chez les gens riches, ces escabeaux étaient couverts de petits coussins ou de banquiers[135].
« Item, en la chambre des dames doit avoir une chaire à doz emprez le chevet du lict, couverte de velours ou d’aultre drap de soye, ne chault de quelle couleur il soit ; mais le velours est le plus honorable qui le peut recouvrer. Et au plus près de la chaire y aura place où l’on peut mettre un petit banc sans appois (sans appui ni bras), couvert d’un banquier, et des quarreaux de soye ou aultres pour s’asseoir quand on vient veoir l’accouchée[136]. »
Nous donnons, pour clore cet article, un joli escabeau copié sur les bas-reliefs des stalles de la cathédrale d’Amiens (voy. fig. 3).
F
FAUTEUIL, s. m. (fadesteuil, faudesteuil, faudestuef, faudestuel[137]), C’est un pliant de bois ou de métal que l’on pouvait transporter facilement, et qui, recouvert d’un coussin et d’une tapisserie, servait de siège aux souverains, aux évêques, aux seigneurs : c’est à proprement parler un trône. Le plus ancien de ces meubles connu est certainement le fauteuil dit de Dagobert, conservé dans le Musée des Souverains, provenant du trésor de Saint-Denis, et dont la fabrication est attribuée à saint Éloi. Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit à propos de ce précieux meuble par M. Ch. Lenormant[138] ; la notice de ce savant archéologue est aussi complète que possible, et nous paraît prouver, de la manière la plus évidente que le trône de Dagobert appartient aux premiers temps mérovingiens, et n’est pas, comme on l’a prétendu, une chaise consulaire antique. Cette forme de siège se trouve d’ailleurs reproduite dans les manuscrits d’une époque fort reculée (VIIIe, IXe et Xe siècles), et persiste jusqu’au XVe siècle. Que le faldistorium soit une tradition antique, cela ne peut être nié ; mais le moyen âge en fit de nombreuses applications, et le fauteuil fut toujours considéré comme un siège d’honneur. « Le fauteuil de l’évêque, dit Guillaume Durand[139], désigne la juridiction spirituelle qui est annexée à la dignité pontificale… »
« El faudestuel ont Aymeri assis
« Et la contesse jostc l’Empereriz.
« …[140] »
« El faudestuef d’or l’aserront,
« Illuecques le couronneront.
« …[141] »
Voici (fig. 1) Nabuchodonosor assis sur un faudesteuil copié sur un manuscrit du IXe au Xe siècle[142]. Ce meuble est élevé, les pieds du roi ne touchent point à terre. Nous ne pensons pas que ce soit là une fantaisie du dessinateur, car cet exemple n’est pas le seul. Les personnages considérables étaient mis ainsi en évidence, sans qu’il fût nécessaire de monter le siège sur une estrade. Et en effet, comme le disent les deux derniers vers cités, il fallait asseoir le prince, le porter sur le faudesteuil. Ce n’était pas sans raison que ces meubles se pliaient facilement ; dans les temps mérovingiens et carlovingiens, des souverains étaient souvent en campagne. Grégoire de Tours nous fait voir sans cesse le roi recevant en plein champ sous une tente ou même à l’abri des forêts. On ne pouvait transporter, sur des chariots qui suivaient la cour, un mobilier considérable ; on se contentait de quelques bancs assez bas, sortes d’escabeaux, et d’un trône pour le roi : ce trône était fait de façon à se plier. Cette vie nomade contribua, nous le croyons, autant que les traditions romaines, à conserver le faudesteuil comme un siége d’honneur chez les grands, à cause de la facilité avec laquelle on pouvait le transporter et le monter en tous lieux ; alors on tenait à ce qu’il fût assez élevé pour dominer une assemblée de personnes debout. Plus tard, en conservant la forme traditionnelle de pliant donnée au faudesteuil, ces meubles n’étant plus sans cesse chargés sur des chariots ou sur des bêtes de somme, on les fit plus larges et on les posa sur une estrade, où ils furent accompagnés d’un escabeau, sur lequel les pieds du personnage s’appuyaient. « L’escabeau, dit Guillaume Durand[143], ou marchepied (scanellum) (qui accompagne le faudesteuil), désigne la puissance temporelle, qui doit être soumise à la puissance spirituelle… » C’est possible ; mais il devient un appendice obligé des fauteuils laïques aussi bien que des trônes épiscopaux dès le XIIe siècle.
La figure 2 nous montre un roi assis sur un faudesteuil, avec un large escabeau en avant[144]. Ce siège est fort élevé, et présente cette particularité que les deux montants de derrière sont beaucoup plus hauts que ceux de devant ; ce n’est plus là, par conséquent, un meuble facile à transporter. Au XIIe siècle déjà, le trône dit de Dagobert avait été restauré par Suger, et de pliant était devenu rigide, au moyen de l’adjonction d’un dossier de bronze[145].
Contrairement au dernier exemple (fig. 2), les branches du faudesteuil sont habituellement terminées, à leur partie supérieure, par des têtes d’animaux. M. C. Lenormant regarde l’adjonction des têtes et pattes de lion aux branches de la chaise curule antique comme une modification qui eut lieu sous l’influence des idées chrétiennes. « Le lion, dit-il, est, dans le langage allégorique de notre religion, l’emblème de la justice, à cause des deux lions qui formaient les bras du trône de Salomon, le roi juste par excellence, et les douze lionceaux qui en ornaient les marches. » Cependant les têtes d’animaux qui terminent les quatre montants du trône de Dagobert sont des têtes de panthère, ainsi que celles figurées sur le dessin (fig. 2 bis)[146]. Ce dernier exemple nous fournit encore un renseignement précieux : c’est la draperie ou tapis jeté sur le faudesteuil et qui tombe jusque sur le marchepied. Nous voyons ce morceau d’étoffe figuré sur presque tous les trônes pliants du XIIe siècle, et plus tard il prend une grande ampleur.
Les sceaux royaux français, à partir du XIIe siècle jusqu’au XVe, présentent des exemples assez nombreux de trônes pliants, rarement avec des tètes de lion ; ce sont des panthères, des dragons, des lévriers, des chiens. Le roi Jean est figuré sur un trône terminé par des têtes d’aigle, peut-être, ainsi que l’observe M. Ch. Lenormant, en l’honneur du patron du roi, saint Jean.
Au XIVe siècle, les faudesteuils royaux sont accompagnés de dossiers avec dais et estrade ; des lionceaux servent de marchepied. C’est ainsi qu’est figuré le fauteuil de Charles V sur le sceau de ce prince. La figure 3 nous montre ce meuble, que la belle exécution du creux permet de rétablir d’une façon complète.
Mais, vers le XVe siècle, les formes du faudesteuil s’altèrent ; ne conservant du pliant que l’apparence, il est accompagné de dossiers, de barres, qui le rendent fixe et lourd. Nous donnons comme un des derniers vestiges de ce meuble, un fauteuil copié sur les bas-reliefs de bois des stalles de la cathédrale d’Amiens (fig. 4). Il est décoré de franges attachées aux barres horizontales, suivant un usage assez répandu à la fin du XVe siècle, au moyen de bandes de fer battu étamé clouées sur le bois ; plus tard encore, les bandes de fer sont remplacées par des galons de passementerie. Ces petites franges se retrouvent sur les bois des fauteuils jusque vers le milieu du XVIIe siècle.
FORME, s. f. (fourme). Mot qui s’emploie quelquefois comme chaire (siége), mais plus généralement comme banc divisé en stalles, avec appui, dossier et dais. On donnait aussi le nom de fourmes aux stalles des églises. Nous n’avons pas à nous occuper ici des stalles fixes, qui sont immeubles ; nous ne parlerons que des bancs divisés par des appuis, qui conservent le caractère d’un meuble pouvant être déplacé. Nous avons dit ailleurs déjà que les siéges étaient, pendant le moyen âge, de formes et de dimensions très-variées. Les grand salles des châteaux étaient destinées à divers usages ; c’était là qu’on recevait, qu’on assemblait les vassaux, que la famille se réunissait, qu’on donnait les grands repas, que le seigneur rendait la justice. La grand salle était ordinairement terminée à l’une de ses extrémités par une estrade sur laquelle étaient disposées des formes de bois plus ou moins richement décorées et tapissées, servant de siége au chef de la juridiction seigneuriale et à ses assesseurs. Ces siéges avaient la forme d’un banc continu, mais où chaque place était marquée par une séparation ; habituellement la forme centrale était plus élevée que les autres.
La forme est un siége d’honneur ; elle n’est pas toujours accompagnée du dais, mais elle possède un dossier.
Les peintures murales, les vignettes des manuscrits et les bas-reliefs des XIe et XIIe siècles, nous présentent des formes généralement dépourvues de dais, mais divisées par stalles avec dossier. Pendant l’époque romane, et jusqu’à l’entier développement du style adopté au XIIIe siècle, ces siéges à plusieurs places sont massifs et ne pouvaient se transporter facilement. S’ils sont de bois, ils paraissent taillés et sculptés à même d’énormes pièces de charpente. Ce n’est pas par l’élégante combinaison des différents membres de la menuiserie que ces meubles se font remarquer, mais bien plutôt par l’éclat des peintures ou des étoffes dont ils sont couverts. S’ils se composent de riches matières, telles que l’ivoire, des bois précieux, de l’or, de l’argent, ou même de l’étain, leur caractère général conserve une certaine lourdeur en harmonie avec le style adopté dans l’architecture ; mais ils se couvrent de dessins très-fins obtenus par des incrustations ou de la marqueterie.
Il n’existe plus nulle part, que nous sachions, de ces meubles entiers d’une époque aussi reculée ; on n’en trouve que des fragments épars dans des musées, fragments qui ont changé bien des fois de destination, et qui n’ont été conservés qu’à cause de la richesse des incrustations. Mais nous en trouvons un grand nombre dans les manuscrits carlovingiens et même dans ceux du XIIe siècle. Le beau manuscrit d’Herrade de Landsberg, de la bibliothèque de Strasbourg, et brûlé par les Allemands, contenait plusieurs formes qui paraissent être entièrement décorées de fines incrustations. Nous en choisissons une entre autres à trois places, servant de siége à trois apôtres. Plutôt que de copier en fac-similé cette vignette, qui explique grossièrement la combinaison et les détails de cette forme, nous croyons plus utile pour nos lecteurs d’en donner ici (fig. 1) comme une sorte de traduction, afin de faire mieux comprendre la disposition et le mode de décoration de ce meuble roman. L’ivoire et l’os étaient, pendant toute la période romane, souvent employés dans la composition des siéges, des tables, et des meubles à la portée de la main ; ces matières étaient tournées, gravées de dessins délicats que l’on remplissait d’une matière noire, rouge ou verte, ou bien posées en placages également gravés, et collés ou cloués sur une carcasse de bois. C’est d’après ces données que nous supposons que la forme (fig. 1) est fabriquée. Les montants de face, les appuis et les pieds sont en partie composés de morceaux d’ivoire et de plaques gravés et niellés. L’appui est une marqueterie d’ivoire, de bois et de morceaux de métal ; un tapis sans coussins couvre la tablette servant de siège. Une marche de bois, plaquée d’ouvrages de marqueterie, est, suivant l’usage, placée en avant du siège. Toutes les salles intérieures des palais, des monastères et des habitations privées, à cette époque, étant toujours carrelées ou dallées, il était nécessaire de disposer sous les pieds des personnes assises un parquet tenant au siège.
Les formes romanes ou de la période ogivale conservent un aspect sévère, une sorte de rigidité que nous ne trouvons pas dans les autres siège : c’est que les formes étaient destinées, dans l’ordre religieux ou civil, à des personnes remplissant de graves devoirs, pendant l’accomplissement desquels il était convenable de garder une posture décente. Nous voyons ces meubles garnis de tapis le plus souvent sans coussins. Les dossiers sont droits, les appuis disposés plutôt pour servir de séparation que d’accoudoirs. Vers la fin du XIIe siècle, les dossiers prirent plus de hauteur, et plus tard encore, ils furent souvent surmontés de dais. Nous trouvons dans quelques manuscrits des formes qui semblent avoir été disposées pour que les assesseurs du personnage principal ne puissent converser entre eux pendant la séance.
Nous donnons (fig. 2) un de ces siège[147]. La forme centrale est élevée de deux marches et placée en avant des formes secondaires ; ces dernières sont comme autant de niches de bois carrées, complètement séparées les unes des autres par des cloisons pleines. On comprend qu’une pareille disposition ne permettait aux assesseurs ou auditeurs aucune distraction ; mais aussi devaient-ils s’endormir volontiers dans leur compartiment, pour peu que la cause ou la discussion se prolongeât.
S’il nous reste en France un assez grand nombre de formes fixes ou stalles, nous n’en possédons pas de mobiles, composées d’un grand nombre de siège. Celles que l’on voit dans quelques musées ou collections particulières ne comprennent guère que trois places, et datent des XVe et XVIe siècles ; ce sont des formes provenant de pièces d’appartements privés, pour la plupart. Ce qui distingue particulièrement les formes en usage dans l’ordre civil des formes usitées dans l’ordre religieux, c’est que les premières ne sont que des bancs divisés, tandis que les autres sont faites comme de véritables stalles ; c’est-à-dire que les sièges sont à bascule, se relèvent au moyen d’un axe, et permettent aux personnes qui veulent s’en servir, ou de s’asseoir sur la tablette abaissée, ou de se tenir à peu près debout, tout en s’appuyant sur une petite console ménagée sous la tablette relevée, console appelée patience ou miséricorde. Dans ce cas, la forme mobile n’est réellement qu’une fraction des stalles continues fixes. Nous pourrions donner des exemples de ces formes d’usage religieux tirés de manuscrits ; mais les vignettes n’indiquent toujours que d’une manière assez vague ou conventionnelle les dispositions de ces meubles, et nous préférons présenter à nos lecteurs une forme dont la composition est fournie par ces renseignements peints, et dont les détails sont tirés de stalles fixes existantes. Nous croyons donner ainsi à notre exemple une application plus utile[148]. La figure 3 explique clairement ce qu’était la forme d’usage religieux au XIIIe siècle.
Lorsque les trônes épiscopaux ne furent plus placés au fond de l’abside, comme dans la primitive Église, on les disposa généralement à côté du maître autel : « Dans l’église cathédrale de Sens », dit le sieur de Mauléon (Voyages liturgiques en France), « vis-à-vis du grand autel, du côté de l’épître, il y a un fort beau banc, grand et long, composé de cinq siéges toujours en baissant, dont le premier, qui est le plus haut, est pour le célébrant, et les autres pour les diacres et sous-diacres. Immédiatement au-dessous est la chaire de l’archevêque, qui est assez belle et de menuiserie bien travaillée. » Le trône épiscopal se trouvait ainsi en haut des stalles du chœur et était souvent accompagné de deux siéges plus bas. Cet ensemble constituait une forme à trois places, et était décoré avec un certain luxe. Malheureusement les XVIIe et XVIIIe siècles firent disparaître ces beaux meubles des chœurs de nos églises pour les remplacer par de lourdes charpentes décorées de sculptures de mauvais goût et de draperies simulèes en bois, avec force glands, nœuds et franges également de menuiserie ; ou bien encore, enlevés pendant la Révolution, on leur substitua des estrades avec fauteuils et tentures provisoires, souvent d’un aspect peu convenable. Les prélats veulent avec raison aujourd’hui rétablir ces meubles nécessaires au service religieux, et beaucoup d’architectes cherchent, soit à se rattacher à des traditions perdues, lorsqu’il s’agit de replacer ces trônes avec leurs accessoires, soit à satisfaire au programme, en donnant un libre cours à leur imagination.
Au mot Trône, nous essayons de fournir les documents qui peuvent être utiles en pareil cas.
H
HERSE, s. f. (râtelier). Sorte de traverse de fer, de cuivre ou de bois posée sur un ou deux pieds, ou suspendue par des potences, sur laquelle on disposait des cierges dans les chœurs, à côté ou devant l’autel, devant les châsses des saints, près des tombeaux particulièrement vénérés, dans certaines chapelles. Ce meuble est encore en usage dans les églises ; il se compose habituellement aujourd’hui d’un triangle de fer hérissé de pointes verticales, en forme d’if, destinées à retenir de petits cierges.
« Entre le chœur et le sanctuaire (de la cathédrale de Lyon), au milieu, est un chandelier à sept branches appelé râtelier, en latin rastrum ou rastellum[149], composé de deux colonnes de cuivre hautes de six pieds, sur lesquelles il y a une espèce de poutre de cuivre de travers, avec quelques petits ornements de corniches et de moulures, sur laquelle il y a sept bassins de cuivre avec sept cierges qui brûlent aux fêtes doubles de première et de seconde classe… À cette porte (du haut du chœur) il (l’archevèque) salue d’une inclinaison de tête l’autel, puis étant, à côté du râtelier ou chandelier à sept branches, il ôte sa mitre[150]. »
La gravure que le sieur de Mauléon donne de ce meuble est fort grossière ; elle ne peut que nous fournir un renseignement plus précis que le texte. Nous chercherons à l’interpréter ici du mieux qu’il nous sera possible (fig. 1). Les colonnes cannelées qui supportent la traverse feraient supposer que la herse de la cathédrale de Lyon pouvait appartenir au style du sanctuaire (fin du XIIe siècle), dans lequel on remarque un grand nombre de pilastres cannelés. L’une des deux colonnes porte un crochet. « L’encensoir est accroché, dès le commencement de vêpres, au pilier droit du râtelier, et la navette est au milieu de l’autel. Le thuriféraire, qui doit être sous-diacre et en aube et rabat, sans amict, prend l’encensoir en passant…[151] »
Les herses ou râteliers fournissaient aux artisans du moyen âge un beau programme ; ils durent en profiter avec le goût qu’ils savaient mettre dans tous les objets d’un usage habituel. Les manuscrits et les vitraux reproduisent un grand nombre de ces meubles, dont il ne reste guère de traces dans nos églises.
La fig. 2 représente une herse figurée dans un des manuscrits de la Bibliothèque nationale[152], dont la disposition est originale ; elle paraît être de métal, sa forme ne se prêtant guère à l’emploi d’une autre matière, et porte sept cierges. Quelquefois les herses se composaient simplement d’une tringle fixée à la muraille sur deux consoles : telle est celle que nous montre la fig. 3[153]. Ce râtelier est posé à côté d’un autel, et devait recevoir les cierges que les fidèles faisaient brûler en grand nombre devant l’autel ou la statue de Notre-Dame. De là vient le dicton, lorsque quelqu’un avait évité un péril : « Il doit un beau cierge à la sainte Vierge. »
Dans le chœur de l’église cathédrale de Bourges il existait encore, au commencement du dernier siècle, ainsi que le constate le sieur de Mauléon dans ses Voyages liturgiques en France, une grande herse, dont il donne, du reste, une description assez vague : « Au pied du cierge, dit-il, qui brûle devant le Saint-Sacrement, est une barre de fer grosse comme le bras, laquelle soutient une petite poutre longue du travers du chœur, sur laquelle sont trente-deux cierges. De là jusques à l’autel il y a six grands chandeliers de cuivre hauts de quatre ou cinq pieds… »
Les râteliers étaient souvent posés sur un seul pied ; c’étaient alors de véritables chandeliers. Beaucoup d’églises en possédaient, ordinairement à sept branches, en mémoire du célèbre chandelier du temple de Jérusalem. Un assez grand nombre de ces objets nous ont été conservés ; nous avons cru devoir les classer parmi les ustensiles (voy. Chandelier).
Autour des tombeaux dans les églises, on plaçait aussi, le jour des Morts, de ces râteliers de fer ou de cuivre, que l’on couvrait de cierges. Les tombeaux élevés par saint Louis, dans l’église de Saint-Denis, aux rois de France ses prédécesseurs, étaient presque tous munis, du côté de la tête, de deux colonnettes sur les chapiteaux desquelles étaient posée une tringle garnie de bassins pour recevoir des lumières. Les magnifiques tombeaux de bronze émaillé et doré qui, dans l’église de Villeneuve, près de Nantes, recouvraient les sépultures des princesses Alix et Yolande de Bretagne, étaient entourés de chandeliers fixes propres à recevoir des cierges. Il en était de même pour les tombeaux de l’abbaye de Braisne. Les vestiges de ces dispositions nous sont conservés dans le curieux recueil de Gaignères, faisant aujourd’hui partie de la bibliothèque Bodléienne à Oxford. (Voy. le Dictionnaire d’architecture, au mot Tombeau.)
HORLOGE, s. f. Nous ne parlons ici que des horloges meubles, non des horloges fixes, comme celles qui tiennent à un monument et sont destinées à donner l’heure aux habitants d’une cité ou d’un quartier. L’usage de placer des horloges dans l’intérieur des appartements n’est pas nouveau ; toutefois, jusqu’au XVe siècle, ce meuble était un objet assez rare pour que l’on ne le trouvât que dans des palais, des monastères ou des châteaux. Dans l’antiquité et dans les premiers temps du moyen âge, on avait déjà des horloges transportables dont le mouvement était produit par l’écoulement de l’eau (clepsydre). En 505 ou 506, Gondebaud, possesseur du royaume de Bourgogne, reçut de Théodoric, roi d’Italie, deux horloges, dont l’une était mue au moyen de l’eau[154]. Les statuts de l’ordre de Cîteaux parlent d’horloges meubles mues par des rouages et des poids. Plus tard, nous les voyons mentionnées dans le Roman de la Rose :
« Et refait sonner ses orloges,
« Par ses sales et par ses loges,
« A roës trop sotivement
« De pardurable movement[155]. »
Nous n’essayerons pas de décrire le mécanisme de ces horloges primitives ; cela devait ressembler beaucoup à ces coucous que l’on rencontre encore dans presque toutes les maisons de paysans de notre temps. Quant à la boîte dans laquelle était renfermé le mécanisme, elle pouvait être plus ou moins richement décorée de sculptures et de peintures, mais ne se composait que d’ais de bois, sorte de petite armoire au milieu de laquelle se détachait le cadran. La sonnerie était placée au-dessus, presque toujours visible : c’était le clocher de l’horloge. Ce petit meuble, dont le mécanisme était mû par des poids ne pouvait être placé sur une table ou sur une console ; on le suspendait à la muraille, assez haut pour que les poids pussent parcourir une distance aussi longue que possible.
Nous voyons figurée, dans le bas-relief de l’Annonciation des stalles de la cathédrale d’Amiens, une horloge d’appartement dont la forme appartient aux dernières années du XVe siècle (fig. 1). Dans cet exemple, on se rend parfaitement compte du mécanisme au moyen duquel le marteau frappait sur le timbre supérieur fait en forme de toit conique.
11 était d’usage, dans les tournois, de limiter parfois la durée des joutes entre deux champions à la durée d’un sablier qu’on appelait horloge. Celui qui, des deux adversaires, pendant cet espace de temps, avait obtenu un plus grand nombre d’avantages, était déclaré vainqueur. On empêchait ainsi que des joutes à armes courtoises ne pussent, par suite de l’acharnement des jouteurs, dégénérer en luttes sanglantes.
« Aussi tost qu’ils eurent d’un costé et d’autre les lances sur la cuisse, le nain (qui estoit sur le perron) drécea son horloge (qui estoit de verre plein de sablon, par tout le cours d’une grande demye heure), et puis sonna sa trompe tellement que les deux chevaliers le purent ouyr. Si mirent les lances es arrest, et commencerent leur jouste, laquelle fut bien courue et joustée… et durant celle demye heure rompit le chevalier à l’Arbre d’or plus de lances que le chevalier venant de dehors, parquoy il gaigna la verge d’or comme il estoit contenu es articles du pas. Ainsi se passa la demye heure que tout le sablon fut coulé…[156] »
Nous voyons ces horloges de sable employées plus tard encore,
mais dans des circonstances bien différentes. A la Sorbonne, à propos
des discussions que suscitèrent les questions sur la grâce efficace
et la grâce suffisante, Pascal, dans sa seconde lettre à un Provincial,
rapporte ce propos d’un sien ami :… « Et je l’ai bien dit ce matin
en Sorbonne. J’y ai parlé toute ma demi-heure ; et, sans le sable,
j’eusse bien fait changer ce malheureux proverbe qui court déjà
dans Paris : « Il opine du bonnet comme un moine en Sorbonne. »
— Et que voulez-vous dire par votre demi-heure et par votre
sable ? lui répondis-je ; taille-t-on vos avis à une certaine mesure ?
— Oui, me dit-il, depuis quelques jours »
On employait, il n’y a pas encore longtemps, les horloges de sable dans les ventes aux enchères et les adjudications.
HUCHE, s. f. Meuble en forme de coffre monté sur quatre pieds, avec dessus formant couvercle.
(Voy. Bahut). Nos paysans ont encore conservé la huche ; ce meuble sert à renfermer la farine pour faire le pain et à façonner la pâte.
I
IMAGE, s. f. (ymage, imaige). On donnait ce nom, pendant le moyen âge, à toute représentation sculptée ou peinte qui décorait l’extérieur ou l’intérieur des monuments et des habitations privées. Une suite de ces images sur un portail, autour d’un chœur, s’appelait ymagerie, et l’on désignait sous la dénomination d’ymagiers les artistes peintres ou sculpteurs chargés d’exécuter ces représentations fréquentes. Mais nous n’avons à nous occuper ici que des images meubles, de celles qui, comme nos tableaux ou nos œuvres de sculptures transportables, sont disposées dans les intérieurs d’églises ou d’appartements, sur des meubles, ou appendues aux murailles. Ces images meublantes étaient, le plus souvent, dans les appartements, enfermées dans des sortes de petites armoires dont les vantaux étaient décorés de peintures ou même de sculptures. Dans les chambres à coucher, par exemple, il y avait toujours une image de la Vierge ou de Notre-Seigneur, ou du patron de l’habitant. Les vantaux qui la cachaient ne s’ouvraient qu’au moment de la prière du matin ou du soir, ou lors de quelque solennité de famille. Les musées et les collections particulières renferment un grand nombre de ces images, mais appartenant presque toutes aux XVe et XVIe siècles, alors que l’intérieur des appartements était, même chez les petits bourgeois, décoré avec un certain luxe. Le musée de Cluny, à Paris, possède, entre autres, deux images à volets, que nous donnons ici (fig. 1 et 2). La première représente une Vierge avec l’enfant Jésus, surmontée d’un dais ; sa disposition générale est assez adroitement combinée. La seconde représente la sainte Trinité dans le panneau du milieu ; deux anges, sculptés dans les panneaux des volets, jouent des instruments de musique. On lit, dans le livre ouvert sur les genoux du Père et du Fils : « Ego sum via, veritas et vita. » Dieu le Père, ainsi qu’il était d’usage parmi les imagiers du XVe siècle, est représenté en pape, la tiare à triple couronne sur la tête. Le Fils n’est vêtu que d’un manteau. Derrière cette image, on lit l’inscription suivante :
A seur Perrette
Dobray et luy feut doñcee
L’an MVXLII au moy de
décembre par ses frères et seur
Et a couste XVIIIl Xs Id.
Je prie à tous ceulx et celles qu’y
prendront devon ce gardent de
La gaster et prie por moy et por
Ceulx qi nie l’ont donnée
Ser Perrette Dobray.
Le désir de Perrette Dobray a été respecté : l’image est demeurée à peu près intacte. Ces images faisaient donc partie du mobilier des chambres à coucher ; on se les donnait en cadeaux, comme aujourd’hui ces petits meubles qui abondent dans les appartements des femmes.
Les tablettes sculptées en bois ou en ivoire à deux ou trois panneaux, et qu’on désigne ordinairement sous les noms de diptyques ou de triptyques, ne sont autres que des images destinées à être transportées dans les voyages, ou à décorer la ruelle d’un lit, le dessus d’un prie-Dieu, ou ces petits oratoires qui avoisinaient souvent les chambres à coucher. Il existe encore un grand nombre de ces précieux objets qui datent des XIIIe et XIVe siècles, ce qui fait supposer qu’alors on en trouvait dans les appartements des bourgeois comme des seigneurs. Toutefois il est rare d’en rencontrer dont l’exécution soit parfaite : on voit que ces images se fabriquaient en grand nombre et pour toutes les bourses. Lorsque les images d’ivoire à deux ou trois volets, des XIIIe et XIVe siècles, sont belles et exécutées avec soin, ce sont des œuvres d’art fort remarquables.
Une des plus belles que nous connaissions appartenait à M. le prince Soltykoff, et date du milieu du XIIIe siècle. Elle se compose d’une tablette centrale accompagnée de deux autres tablettes formant volets, le tout d’ivoire. Les sujets sculptés sont divisés en trois zones décorées de colonnettes très-délicates et d’une riche arcature.
Dans la zone inférieure, la sainte Vierge est assise tenant l’enfant Jésus bénissant ; à la gauche du trône de la Vierge, un évêque est à genoux ; deux anges encensent. Le volet de droite représente les trois mages, celui de gauche la circoncision.
La zone centrale contient le crucifiement de Notre-Seigneur entre les deux larrons, la Vierge et saint Jean, l’Église et la Synagogue.
Dans la zone supérieure, le Christ est ressuscité ; il est assis demi-nu, et montre ses plaies. A droite et à gauche, la Vierge et saint Jean, à genoux, intercèdent pour les humains ; deux anges tiennent les instruments de la passion, deux autres réveillent les morts au son de l’olifant. A droite, un évêque est conduit par un ange en paradis ; à gauche, les damnés sont précipités dans la gueule béante de l’enfer par deux démons. Le sommet de cette imagerie est décoré de fins pinacles et de gables ornés de crochets, de rosaces et de fleurons. Cet ensemble n’a pas plus de 0m,25 de large sur 0m,22 de haut environ, et les figurines sont traitées de main de maître.
Les images portatives de bois ou d’ivoire n’avaient pas toujours un caractère religieux ; il en existe qui étaient évidemment destinées seulement à récréer les yeux, et qui représentent des jeux, des chasses, des passe-temps de nobles et de damoiselles : mais ces sculptures sont comparativement en petit nombre. (Voyez à la fin du Dictionnaire du mobilier, le Résumé historique.)
Au XVIe siècle, les images d’ivoire à volets, si fort prisées jusqu’alors, furent remplacées par des images peintes sur émail par les artistes de Limoges. Il existe, au musée de Cluny, une image fort précieuse exécutée d’après ce procédé, ayant appartenu à Catherine de Médicis, et sur laquelle est représentée cette princesse à genoux devant un prie-Dieu : c’est un des meubles les plus remarquables que possède cette riche collection.
Nous ne devons pas omettre ici les images ouvrantes si fort en vogue pendant les XIIe et XIIIe siècles. On donnait ce nom à des statues ou statuettes qui s’ouvraient par le milieu, et laissaient ainsi voir dans leur intérieur, soit des reliques, soit des scènes sculptées. Le musée du Louvre possède une image de ce genre extrêmement précieuse à cause de la beauté du travail. C’est une statuette de la sainte Vierge, d’ivoire, dont nous donnons une copie (fig. 3), au tiers de l’exécution. La statue est représentée de face en perspective, de profil en géométral. Ces deux aspects A et B font voir comment s’ouvre l’image en trois parties : les deux composant la face se développent des deux côtés de celle qui forme le fond ; quznd l’image est ouverte, le socle, qui est fixe, laisse une saillie représentant assez bien la figure d’un petit autel devant un grand retable à volets.
La figure 4, montrant l’image ouverte, explique cette disposition gracieuse. Les trois compartiments d’ivoire, étant développés, laissent voir une suite de petits bas-reliefs dont la série commence à la gauche du spectateur. Dans le compartiment de gauche sont figurées les scènes qui précèdent immédiatement le crucifiement de Notre-Seigneur : Jésus est amené devant Pilate ; il est flagellé, il porte sa croix. Au centre est représenté le crucifiement ; deux anges tenant le soleil et la lune accostent les bras de la croix ; au sommet est sculptée la figure symbolique de l’Agneau dans un nimbe. De chaque côté du Christ on voit, à sa droite, la sainte Vierge ; puis l’Église, représentée par une femme couronnée, tenant un calice qu’elle élève pour recevoir le sang du Christ ; à sa gauche, saint Jean, et la Synagogue sous la forme d’une femme tenant un étendard brisé et les tables de l’ancienne loi renversées ; ses yeux sont couverts d’un bandeau. Au-dessous du sujet principal, le Christ mort est enseveli ; on aperçoit sous le sarcophage un animal ressemblant assez à un loup. Dans le compartiment de droite, au sommet, Jésus-Christ ressuscite assisté de deux anges ; les saintes femmes viennent au tombeau ; l’ange leur montre le sarcophage vide ; des soldats sont endormis sous une arcade. Jésus apparaît à Marie-Madeleine, et lui dit : « Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père[158]. » Il tient un phylactère dans sa main droite. Deux demi-cercles font voir les quatre évangélistes à la base des compartiments, placés dans l’ordre suivant : saint Marc, saint Mathieu, saint Jean, saint Luc. Dans les lobes pris aux dépens de la tête de la statue se trouvent : au centre, le Christ ressuscité, bénissant et tenant le livre des Évangiles ouvert ; à sa droite et à sa gauche, deux anges adorateurs. On retrouve ici le socle représentant la Nativité que nous avons vu sous les pieds de l’image fermée.
L’image ouvrante du musée du Louvre a 0m,45 de hauteur : elle devait être accrochée et non posée, comme le prouve le crochet fixé derrière le dossier du siège de la Vierge. Il était d’usage aussi de placer dans les églises des statues ouvrantes d’une assez grande dimension, dans lesquelles on déposait des reliques. Lorsqu’en 1166 le sanctuaire de l’église abbatiale de Vézelay fut détruit par un incendie, Hugues de Poitiers raconte qu’une statue de bois de la sainte Vierge, seule, ne fut pas atteinte par le feu. Cette circonstance étant considérée comme miraculeuse, les moines examinèrent la statue avec soin, et ils virent qu’elle avait une petite porte très-bien fermée, entre les deux épaules. L’ayant ouverte, le prieur et les assistants constatèrent l’existence de reliques précieuses déposées dans le corps de la statue, qui dès lors fut placée sur le nouveau maître autel, où elle demeura exposée à la vénération des nombreux pèlerins qui affluaient à l’abbaye de toutes parts. Le même historien ajoute que, les moines ayant été accusés de satisfaire leur avarice par les offrandes de ce grand concours de peuple, ils se virent obligés, pour se mettre à couvert de ce reproche, d’empêcher qu’on ne baisât ni ne touchât l’image miraculeuse.
Les images de cire étaient aussi fort en usage pendant le moyen âge ; on en plaçait dans les églises et même dans les palais. Ces images représentaient des donateurs ou des personnages vénérés dont on voulait perpétuer la mémoire ; on les revêtait d’habits comme des personnes vivantes, et elles demeuraient en place jusqu’au moment où elles tombaient de vétusté. Les sorciers, pendant le moyen âge, considéraient les images de cire qu’ils se plaisaient à façonner, comme un des moyens les plus puissants d’influence sur la destinée de ceux qu’ils prétendaient soumettre à leur volonté. Dans la célèbre procédure contre les templiers, sous le règne de Philippe le Bel, il est question d’images du roi percées de styles, employées comme maléfices contre ce prince. Les sorciers baptisaient aussi certaines images de cire. « Il y a néanmoins des gens assez abandonnés de Dieu, dit le savant docteur Thiers en son Traité des superstitions[159], pour baptiser des figures de cire, afin de faire mourir les personnes qu’ils haïssent. Et voici les cérémonies qu’ils pratiquent dans ce cas : Ils font une image de cire entière, et avec tous ses membres ; la mettent tout de son long dans une boîte qui se ferme avec un couvercle ; prennent de l’eau dans le creux de leur main, la jettent sur cette image, en disant : « N. Ego te bapttizo, etc. » Ils récitent ensuite le petit office de la Vierge, et quand ils en sont au psaume… entre generatione et generationem, ils prennent une épine d’O… de laquelle ils piquent légèrement l’endroit du cœur de l’image, et achèvent le petit office. Le lendemain, ils font la même cérémonie et enfoncent l’épine plus avant. Le troisième jour, ils en font autant et enfoncent l’épine tout entière, achèvent l’office, et le neuvième jour ils ont ce qu’ils souhaitent… » Dans un autre passage[160], il ajoute « qu’il étoit des prêtres assez malheureux pour dire des messes sur des images de cire, en faisant des imprécations contre leurs ennemis, jusques-là qu’ils en disoient dix et plus, afin que leurs ennemis mourussent dans le dixième jour… » Ces superstitions prouvent l’importance que le vulgaire attachait aux images.
L
LAMPESIER, LAMPIER (lampe)[161]. S’entendait, au moyen âge, comme lustre portant de petits godets dans lesquels on versait de l’huile et qui étaient munis de mèches. Ce meuble se fabriquait en argent, en cuivre, en fer ou en bois. Il consistait généralement en un cercle d’un diamètre plus ou moins grand, en raison du nombre de godets que l’on voulait placer, suspendu par une ou plusieurs chaînes, ordinairement trois. On avait, dans les églises, des lampiers qui, lorsqu’ils contenaient un grand nombre de godets, étaient désignés sous le nom de : couronne de lumières, ou de : roue. Le clocher central de la grande église abbatiale de Cluny était appelé le clocher des lampes, parce que sous sa voûte était suspendue une couronne de lumières. C’est, de toute antiquité chrétienne, une manière d’honorer Dieu que de placer des lumières dans son église. « La lumière qui est allumée dans l’église, dit Guillaume Durand dans son Rational, est la figure du Christ, selon cette parole : « Je suis la lumière du monde », et Jean dit : « Il étoit la lumière véritable qui illumina tout homme venant en ce monde. » Et les lampes de l’Église signifient les apôtres et les autres docteurs, par la doctrine desquels l’Église resplendit comme le soleil et la lune, et dont le Seigneur a dit : « Vous êtes la lumière du monde », c’est-à-dire : Vous donnez les exemples des bonnes œuvres. C’est pourquoi, en les avertissant, il leur dit : « Que votre lumière luise devant les hommes. » Et c’est d’après les ordres du Seigneur que l’église est éclairée ; et voilà pourquoi on lit dans l’Exode : « Ordonne aux fils d’Aaron de m’offrir l’huile la plus pure que l’on tire des olives, afin que la lampe brûle toujours dans le tabernacle du témoignage… »
Il était d’usage, autrefois comme aujourd’hui, de maintenir au moins une lampe allumée devant l’autel, et, pendant les fêtes solennelles, de garnir un grand nombre de lampes de godets et de bougies de cire, non-seulement dans l’enceinte des églises, mais même dans les rues. Cet usage avait été pratiqué dans les églises de Byzance dès les premiers siècles du christianisme, et Sainte-Sophie se distinguait entre toutes les églises de la capitale de l’empire d’Orient par son riche luminaire[162]. En Occident, nous voyons que des rentes fixes et des revenus fonciers étaient affectés à l’entretien du luminaire dans les églises abbatiales, collégiales, paroissiales et dans les cathédrales. A en juger par l’importance de ces dotations, le luminaire des églises devait être autrefois très-considérable. Les lampiers étaient vulgairement fabriqués en cuivre doré, enrichis d’émaux, de boules de cristal, de dentelles découpées dans le métal, de pendeloques, que rehaussait encore l’éclat des lumières. En Orient, il existait des lampiers en forme de navire contenant un grand nombre de lumières ; le mat était terminé par une croix[163].
Il n’existe plus en France une seule de ces lampes, qui se trouvaient encore, avant la révolution du dernier siècle, en grand nombre dans nos églises ; tout a été jeté au creuset ou détruit. Nous n’en pouvons connaître la forme que par quelques descriptions assez vagues ou des représentations peintes ou sculptées. Nous sommes donc forcés d’avoir recours à ces renseignements. Toutefois on voit encore, dans l’église d’Aix-la-Chapelle, une couronne de lumières donnée par l’empereur Frédéric Barberousse, qui peut passer pour une œuvre des plus remarquables et des plus complètes du moyen âge, sous le double rapport du goût et de l’exécution ; le travail en est occidental, et nous semble plutôt avoir été exécuté de ce côté-ci du Rhin qu’au delà. Cette couronne se compose, en plan horizontal, de huit segments de cercle retenus par huit chaînes se réunissant en quatre ; aux points de rencontre des arcs de cercle et au sommet de chacun des arcs, sont des lampes ajourées, autrefois garnies de statuettes d’argent[164] ; deux bandes de cuivre gravées, formant les lobes de la couronne, rappellent en vers latins le don de l’empereur. Outre les lampes, quarante-huit bobèches permettaient de placer des cierges sur la crête à jour de la couronne. Toute la richesse de ce lampier est obtenue au moyen de gravures sur le cuivre, lesquelles sont remplies d’un mastic brun formant comme un ouvrage niellé. Les chaînes sont alternativement composées de boules, de chaînons et de petits cubes, aux points de rencontre. Les gravures détaillées que les RR. PP. Martin et Cahier ont données de cette couronne de lumières dans les Mélanges archéologiques[165] nous dispenseront de nous étendre davantage sur ce précieux objet.
La cathédrale de Toul possédait encore, dans le siècle dernier, une énorme couronne de lumières en avant de l’ancien maître autel, qui passait pour être d’argent et d’or (probablement de cuivre doré). « La bande circulaire de la couronne, haute de 0m, 22 environ, était garnie des statuettes des douze apôtres, ayant entre chacune d’elles huit girandoles. L’évêque Pibon, qui avait donné cette couronne à la cathédrale, au commencement du XIIe siècle, y avait fait graver des vers de sa composition. Douze chaînes de cuivre réunissaient le cercle à une chaîne plus forte, également de cuivre[166]. »
L’église abbatiale de Saint-Remi de Reims avait aussi, avant la révolution, sa couronne de lumières, dont il ne reste qu’un assez médiocre dessin dans un manuscrit de la fin du XVIe siècle[167]. Ce dessin est cependant assez précis pour permettre de donner une idée de ce que devait être ce grand lampier portant à la fois, comme la couronne d’Aix-la-Chapelle, des lampes et des cierges. Nous le reproduisons ici (fig. 1). « C’est, dit l’auteur du manuscrit, le portraict de la couronne qui est au millieux du chœur de la dicte esglise de Sainct-Remy, laquelle a esté mise en cest endroict en l’honneur et souvenance de l’aage dudict patron qui vescut IIIIXX xvj ans, partant y a le tour IIIIXX et xvj chierges. » Cette couronne se divisait en douze lobes ou segments de cercle séparés par autant de lanternes ; elle paraît avoir été fabriquée pendant le XIIe siècle. Chaque lobe portait huit cierges sur de petites bobèches terminées par une pointe ; c’était donc en tout quatre-vingt-seize cierges.
Le plan (fig. 2) indique comme étaient disposées les chaînes, composées de douze tringles aboutissant à quatre, puis à une seule chaîne. Ainsi que la couronne d’Aix-la-Chapelle, le lampier de Saint-Remi présentait des figures découpées à l’entour des tourelles contenant les lampes (fig. 3). Les RR. PP. Martin et Cahier, et M. de Caumont, considèrent les couronnes de lumières suspendues aux voûtes des églises comme des représentations de la Jérusalem céleste. En effet, cette opinion est confirmée par les inscriptions gravées ou émaillées autour de ces phares.
À Hildesheim, il existe encore deux couronnes de lumières fort belles. « L’une d’elles, la plus grande, dit M. de Caumont[168], remonte à l’évêque Hézilon. Elle se compose de cercles d’un très-grand diamètre, portant des tours et des flambeaux de cuivre doré sur lesquels se lisent des inscriptions émaillées : la dentelle du pourtour était d’argent. Les douze tours attachées sur les cercles de métal, comme dans la couronne d’Aix-la-Chapelle, logeaient chacune quatre statuettes d’argent, représentant des personnages de l’Ancien Testament et les personnifications des Vertus, ce que prouvent les noms qu’on lit encore sur ces tours. Au milieu des espaces compris entre les tours se trouvent des niches qui portent les noms des douze apôtres, preuve qu’elles en renfermaient les statuettes. Il y aurait donc eu soixante statuettes dans les niches et les tours qui garnissent les cercles de cette grande couronne. On croit que les lampes étaient superposées aux tours. D’une tour à l’autre, six flambeaux portaient des cierges ; il y en avait en tout soixante-douze… La seconde couronne de Hildesheim se trouve dans le chœur de la cathédrale. On la fait remonter au milieu du XIe siècle… ; mais elle est moins grande que celle de la nef, et les espaces compris entre les tours ne portaient que trois flambeaux, de sorte qu’il n’y en avait que trente-six au lieu de soixante-douze dans le pourtour. Les tours ou niches renfermaient quarante-huit statuettes de bronze, qui n’existent plus[169]. »
Les lampiers, couronnes ou phares, n’avaient pas toujours ces dimensions considérables, et il en était beaucoup qui ne portaient qu’une seule lampe : celles-ci sont encore plus rares que les grandes couronnes, s’il est possible ; leur peu d’importance les a fait supprimer depuis longtemps dans les églises. Il nous faut avoir recours aux vignettes des manuscrits, aux vitraux ou aux bas-reliefs, pour pouvoir nous rendre compte de leur disposition et de leur forme.
Les petits lampiers à une seule lampe étaient habituellement suspendus au-dessus des autels, et leur forme la plus vulgaire est celle reproduite dans la figure 4[170]. Quelquefois la lampe est placée au milieu d’un cercle de métal ciselé, ainsi que l’indique la figure 5, copiée sur l’un des bas-reliefs du porche nord de la cathédrale de Chartres (XIIIe siècle). Souvent aussi les lampes sont disposées autour d’une roue, et le lampier était alors appelé roue. Dans un des vitraux de l’église Saint-Martin de Troyes, représentant sainte Anne et saint Joachim apportant un agneau dans le temple, on voit une roue entourée d’un certain nombre de godets, et sous laquelle est suspendue une dernière lampe (fig. 6). Ce vitrail date du XVIe siècle.
Il paraîtrait, en consultant les bas-reliefs et les vignettes des manuscrits, que la forme circulaire donnée aux couronnes de lumières, ou lampiers, serait la plus ancienne. La division en lobes semble avoir été préférée pendant les XIIe et XIIIe siècles. Dans les peintures des XIVe et XVe siècles, on en voit qui adoptent, en plan, la figure d’une étoile à six ou huit branches. Il en existe aussi en forme de croix, dans les églises qui subissent l’influence byzantine. A Saint-Marc de Venise, on voit encore, suspendue à la coupole de la nef, une croix de cuivre qui paraît remonter au XIIIe siècle, et qui servait de luminaire les jours fériés. Les bras de cette croix lumineuse sont doubles et se coupent à angles droits, ainsi que l’indique la figure 7. Les godets contenant l’huile se trouvaient suspendus entre les branches de ce lampier, au moyen de chaînettes.
La croix illuminée est une fort ancienne tradition dont on retrouve la trace dans des manuscrits carlovingiens[171], et beaucoup plus anciennement dans les peintures des catacombes de Rome[172]. Nous devons mentionner aussi les lampes que l’on plaçait sur les tombeaux élevés à l’extérieur des églises. Cet usage était usité chez les chrétiens de Syrie dès le IVe siècle ; nous le retrouvons adopté chez les Occidentaux jusqu’à la fin du XVIe siècle. Le nombre de renseignements précis qu’il est possible de recueillir encore sur les lampiers, si communs dans nos églises pendant le moyen âge, indique assez l’importance de ce meuble, le luxe avec lequel il était traité, la richesse des matières employées. Il est certain que les orfèvres de cette époque avaient déployé, dans la fabrication de ces objets, toute leur habileté, ce goût parfait qui distingue leurs œuvres ; employant à la fois le cuivre doré, le vermeil, les fines dentelures, le cristal, les émaux, ils avaient su donner aux grandes couronnes de lumières un aspect éblouissant qui représentait aux yeux des fidèles, les jours de fête, l’image de la Jérusalem céleste. Ces grands cercles lumineux complétaient l’éclairage des chœurs garnis de râteliers, de nombreux candélabres, de flambeaux autour de l’autel, de cierges sur les tombeaux.
LANDIER, s. m. (chenet). Les cheminées, dans les habitations du moyen âge, étaient larges et hautes. Généralement un homme pouvait y entrer debout sans se baisser, et dix ou douze personnes se plaçaient facilement autour de l’âtre[173]. Il fallait, à l’intérieur de ces cheminées, de forts chenets de fer, désignés alors sous le nom de landiers, pour supporter les bûches énormes que l’on jetait sur le foyer et les empêcher de rouler dans l’appartement. Il y avait les landiers de cuisine et les landiers d’appartement. Les premiers étaient assez compliqués comme forme, car ils étaient destinés à plusieurs usages. Leur tige était munie de supports ou crochets pour recevoir les broches, et leur tête s’épanouissait en forme de petit réchaud pour préparer quelques mets, comme nos cases de fourneaux, ou pour maintenir les plats chauds. Dans les cuisines, l’usage des fourneaux divisés en plusieurs cases n’était pas fréquent comme de nos jours ; les mets cuisaient sur le feu de la cheminée, et l’on comprend facilement que ces foyers ardents ne permettaient pas d’apprêter certains mets qu’il fallait remuer pendant leur cuisson ou qui se préparaient dans de petits poêlons. Les réchauds remplis de biaise à la tête des landiers, se trouvant à la hauteur de la main et hors du foyer de la cheminée, facilitaient la préparation de ces mets.
Nous donnons (fig. 1) un de ces landiers de cuisine déposé au musée de Cluny. Sa hauteur est de 1m,12 ; le diamètre du réchaud supérieur est de 0m,25. A la base de la tige, on voit trois crochets destinés à supporter la broche. Vers la partie supérieure de la tige est un crochet recouvert A, muni d’une boucle B, à laquelle étaient suspendues les petites pincettes destinées à attiser le feu du fourneau supérieur C, une cuiller de fer ou une fourchette, pour retourner les viandes ou remuer les sauces. Cette boucle, dont nous donnons le détail en E, était faite de façon que les pincettes, en raison de la forme de leur tête G, pouvaient facilement être suspendues au crochet F. Les objets accrochés aux boucles E servaient également pour le rôti. On voit en C le réchaud de fer battu qui se posait sur la tête D du landier, pour recevoir la braise. Les gens de la cuisine mangeaient même sur ces petits fourneaux, tout en se chauffant[174]. Quelquefois, mais plus rarement, la tête du landier se divisait en deux réchauds[175]. C’était donc alors quatre plats que l’on pouvait apprêter et faire cuire en dehors du foyer, sur lequel étaient suspendues une ou plusieurs marmites au moyen de la crémaillère et de trépieds, et devant lequel tournaient une ou deux broches garnies de plusieurs pièces. La cheminée suffisait seule ainsi pour apprêter un repas abondant (fig. 2).
Dans le Charrois de Nymes, IIe livre de Guillaume d’Orange (chansons de geste des XIe et XIIe siècles, il est question du bagage du prince porté par trois cents bêtes de somme ; les meubles et ustensiles destinés à la cuisine ne sont pas oubliés :
« Bien vos sai dire que reporte li tierz :
« Preoz et pailles, chauderons et trepiez,
« Et cros agus, tenailles et landiers ;
« Quant il venront el règne essilié
« Que bien en puissent atorner à mengier ;
« S’en serviront Guillaume le guerrirer,
« Et en après trestoz les chevaliers. »
La fig. 2 fera comprendre les divers procédés de cuisson employés simultanément autour de l’âtre. Ordinairement un gros anneau était fixé à la tige des landiers pour pouvoir les remuer avec plus de facilité, lorsqu’on voulait les éloigner ou les rapprocher l’un de l’autre, suivant le besoin. La même figure montre la disposition de ces anneaux. Les landiers de cuisine sont simples, quoique forgés avec grand soin ; mais ceux qui devaient être placés dans les appartements étaient souvent fort riches, ornés de brindilles de fer étampé soudées sur la tige, de pièces de forge finement exécutées. On rencontre peu de landiers antérieurs au XVe siècle qui aient quelque valeur comme travail, ces objets ayant, depuis longtemps, été vendus comme vieille ferraille. Nous en avons dessiné un cependant qui existait encore, il y a quinze ans, dans une maison de Vézelay, et qui provenait probablement de l’abbaye[176]. Cette paire de landiers datait certainement du XIIIe siècle ; elle était d’une exécution assez grossière, mais d’une belle forme et bien composée. Nous reproduisons ici (fig. 3) notre croquis. Ce landier est formé d’une tige de fer plat de 0m,05 sur 0m,02 à 0m,03 de gros, gravée, et sur laquelle sont soudées des embrasses d’où s’échappent des feuilles étampées et soudées après ces embrasses. L’extrémité supérieure du landier se compose d’une tête d’animal fort bien forgée et soudée sur la tige ; une des embrasses maintient un anneau ; le pied se termine en jambes d’homme. La queue du landier, destinée à supporter les bûches, est rivée au moyen de trois gros rivets à tête ronde sur la tige. Ce landier n’avait pas moins de 0m,90 de hauteur.
Voici (fig. 4) un landier d’une cheminée d’appartement aujourd’hui conservé dans le musée de Cluny ; il est de fer fondu, probablement, sur un modèle de bois, avec ornements appliqués en cire. La queue du landier est assemblée à tenon dans le pied de fonte et rivée, ainsi que l’indique la gravure ; sa hauteur est de 0m,64. Nous le croyons du commencement du XVe siècle : on remarque sur sa face un écusson sur le champ duquel sont posées trois merlettes. A partir de cette époque, il n’est pas rare de rencontrer des landiers de fonte de fer. Il en existait deux il y a quelques années, posés en guise de bornes, sur la place de Saint-Thaurin, à Évreux ; nous ne savons s’ils s’y trouvent encore. Ces deux landiers de fonte de fer paraissent appartenir aux dernières années du XIVe siècle et sont fort grands ; avec la partie des pieds enterrée, ils devaient avoir plus d’un mètre de haut. La portion supérieure, seule apparente, représente une figure d’homme debout tenant un écu et une massue ; l’écu et le vêtement de la figure sont échiquetés. M. de Caumont en donne un croquis dans le XIe volume du Bulletin monumental, page 644.
Nous donnons (fig. 5), pour finir cet article, un landier d’appartement de la fin du XVIe siècle, dont la forme diffère de celle usitée jusqu’alors : la lige verticale, destinée à empêcher les bûches de rouler sur le pavé, a disparu et est remplacée par une pomme. Ces landiers paraissent combinés de façon à permettre de poser les pieds sur les deux volutes, afin de se chauffer plus facilement. Ils sont ornés de rosaces de tôle rivées sur le fer. La queue est de fer carré présentant sa diagonale parallèlement au sol de l’âtre ; un ornement de tôle découpée, placé en B, cache le tenon de la grosse pomme ; ce tenon passe à travers la queue du chenet aplatie, ainsi qu’on le voit en C, et est retenu par une clavette. Le landier représenté figure 5, et dont le profil est tracé en A, provient d’une auberge de Froissy (Côte-d’Or), et est fort petit.
L’époque de la renaissance apporta un grand luxe dans la composition des landiers ; mais alors ils sont presque toujours de fonte de fer coulée sur des modèles de cire exécutés souvent par de très-habiles artistes. Ils sont ornés de figures humaines, d’animaux fantastiques, et le plus souvent ils étaient dorés ou argentés. Ce n’est guère qu’au milieu du XVIIe siècle que l’on commença en France à fondre des landiers en cuivre. Ceux-ci ont complétement abandonné la forme haute et primitive, et s’étendent au contraire en largeur devant le foyer, en se reliant même parfois au moyen de galeries destinées à empêcher le bois enflammé de rouler sur les parquets qui, dans les appartements riches, remplaçaient les anciens carrelages de terre cuite émaillée. L’Italie, Venise et Florence fabriquaient dès le XVIe siècle de magnifiques landiers de bronze. Beaucoup de palais et châteaux en possédaient dans le nord de la France.
LAVOIR, s. m. (lavabo). Il était d’usage déplacer, à proximité des réfectoires des établissements monastiques ou des palais, souvent dans la salle elle-même, de grands bassins de pierre, de marbre, de cuivre ou de plomb, destinés au lavement des mains avant et après le repas. On voit encore, dans un grand nombre de monastères, la place destinée à recevoir ces meubles d’un usage journalier[177]. C’est ordinairement une niche peu profonde, mais fort large, couronnée par une arcature soutenue par des consoles (voy. le Dictionnaire d’architecture, au mots Lavabo et Réfectoire). Ces lavoirs étaient munis d’une grande quantité de petites gargouilles qui répandaient l’eau sur les mains des personnes qui venaient laver. Quelquefois, dans les couvents, le lavoir était une grande vasque circulaire placée à l’un des angles du cloître (voy. le Dictionnaire d’architecture, au mot Cloître). Mais ces derniers objets ne pouvant être considérés comme des meubles, nous n’avons pas à nous en occuper ici. Les lavoirs de bronze ou de plomb étaient fréquents ; il n’est pas besoin de dire qu’ils ont tous disparu des établissements monastiques pendant la révolution de 1793, et même avant cette époque ; leur usage n’étant plus, pendant le dernier siècle, conforme aux habitudes des moines. Ces meubles étaient ordinairement en forme d’un grand coffre long, assez profond, posé sur un appui au-dessous duquel était une auge de pierre ou de métal, recevant l’eau tombant par les gargouilles et l’épanchant au dehors par une rigole. On en voit des représentations assez grossières et fort simples dans des vignettes de manuscrits, et la reproduction de ces vignettes ne peut avoir plus d’intérêt qu’une description. Mais on trouve, dans la collection Gaignières de la bibliothèque Bodléienne, un grand dessin assez bien exécuté d’un de ces lavoirs. A défaut de monument existant, nous devons nous trouver fort heureux de rencontrer une copie fidèle d’un meuble de cette importance[178].
Voici (fig. 1) une réduction de cette copie, au-dessous de laquelle est écrite cette légende : « Piscine ou lavoir dans l’abbaye de Saint-Amand de Rouen, auquel sont les armes de plusieurs abbesses, et qui a été fondu en 1702 pour employer aux dépenses du bâtiment neuf »
Le lavoir est de bronze, divisé en trois compartiments, que l’on remplissait probablement en raison de la quantité de personnes qui venaient laver ; ou chaque compartiment, ainsi que les gargouilles y correspondant, était peut-être affecté aux différents degrés du couvent : aux abbesses, prieures, sous-prieures, etc. ; aux nonnes et aux novices. Il est percé de onze gargouilles posées à des hauteurs différentes. Le dessin fait supposer que le bronze était émaillé sur les écussons armoyés et dans les bordures. La cuvette qui reçoit les eaux était également de bronze. Ce magnifique lavoir datait certainement de la fin du XIIe siècle ou du commencement du XIVe. La figure 2 en donne le détail.
Dans les palais, depuis le XIIIe siècle, on ne se servait plus des lavoirs : lorsqu’on se mettait à table, des écuyers apportaient à laver au seigneur, dans un bassin ; des serviteurs, aux personnages moins élevés en dignité (voy. le Dictionnaire des ustensiles, au mot Bassin). Cet usage se conserva jusqu’au commencement du dernier siècle. C’était sur la crédence que l’on plaçait le bassin et l’aiguière destinés au lavement des mains avant et après les repas.
« Quand tous ceux-cy furent entrez, on prit aussitôt à l’autel de la crédence un grand bassin d’argent doré avec une aiguière de mesme estoffe, et d’un des côtés de la nef qui estoit sur la table on prit une serviette plyée à fort petits plis. Avec tout cecy, les trois que je viens de dire[179] se lavèrent tous les mains, puis ceux qui estoient de cette suite auxquels on bailla d’autres serviettes, et aussitôt chacun se vint seoir[180]… » Puis après le repas : « … Après que chacun se fut rassasié de ces délicatesses, on commença à desservir ceux du bas bout, car en ceste action là ils escorchent l’anguille par la queuë. Et après qu’on eust tout osté, on apporta à ceux qui estoient demeurez à table (d’autant que la pluspart s’estoient levez) un grand bassin d’argent doré avec un vase de mesme estoffe, et dedans de l’eau où avait trempé de l’iris, avec laquelle ils lavèrent leurs mains, ceux du haut bout séparément, et ceux qui estaient au-dessous ensemblement, et toutefois (ajoute l’auteur de cette curieuse satire[181]), elles ne dévoient pas trop sentir la viande ni la gresse, car ils ne l’avoient pas touchée, ains seulement de la fourchette… »
Les lavoirs n’avaient pas toujours l’importance de celui que nous avons donné fig. 1 ; dans les maisons, dans les châteaux, on se servait, pendant le moyen âge, de lavoirs de marbre, de terre cuite, de pierre, de cuivre ou de plomb, munis d’un ou deux robinets avec une cuvette au-dessous. M. Parker, dans son ouvrage sur l’architecture domestique du moyen âge, donne un de ces lavoirs du XIVe siècle. Nous en connaissons un autre existant encore dans un des bâtiments du palais archiépiscopal de Narbonne, mais il est de pierre et fait partie de la construction. Ces lavoirs privés sont toujours disposés dans de petites niches pratiquées dans la muraille et souvent décorées avec élégance. On trouve beaucoup de ces niches dans les salles de nos anciens châteaux ; quant aux lavoirs, ordinairement de métal, ils ont disparu. Les petites fontaines de faïence ou de cuivre qu’on rencontre encore dans quelques vieilles maisons et dans la plupart des auberges de province, suspendues à l’entrée des salles à manger, sont un dernier vestige de ces meubles du moyen âge.
LIBRAIRIE, s. f. On donnait ce nom, pendant le moyen âge, aux pièces qui renfermaient des meubles en forme de casiers, sur les rayons desquels on plaçait des manuscrits, et, par extension, aux meubles eux-mêmes.
Les livres, avant l’invention de l’imprimerie, étaient fort rares et par conséquent chers : une bibliothèque qui se composait de cent volumes était un luxe peu commun ; les abbayes, les évêchés, les palais des souverains, pouvaient seuls posséder un assez grand nombre de manuscrits pour qu’il fût nécessaire de disposer des salles garnies de meubles propres à les renfermer. Le lectrin avec une petite armoire, une simple tablette disposée dans un angle de la chambre ou d’un cabinet, pouvaient contenir toute la bibliothèque d’un particulier se livrant à l’étude.
Presque toutes les abbayes possédaient déjà, au XIIe siècle, une bibliothèque à proximité de laquelle se trouvaient des cellules destinées aux copistes. Dans les cloîtres mêmes, il y avait un petit réduit dans lequel on renfermait les livres laissés aux religieux pour les lectures ordinaires pendant les heures de repos. Ce réduit, appelé armariolum, était garni au pourtour de quelques tablettes et fermé par une porte donnant sur l’une des galeries du cloître. À proximité des chœurs des églises abbatiales et cathédrales, ou dans leur enceinte même, une grande armoire, bien fermée, contenait les Évangiles et les livres de chant nécessaires au service religieux, (voy. Armoire).
Charles V réunit, dans l’une des tours du château du Louvre, une belle bibliothèque pour son temps, qui forma le premier noyau de cette riche collection de livres conservés aujourd’hui rue de Richelieu. Comment étaient faits les meubles de cette librairie, c’est ce que nous ne pouvons savoir aujourd’hui. C’était, autant qu’on peut en juger par les peintures des manuscrits, des tablettes sur lesquelles étaient rangés les livres, soit sur leur plat, soit le dos contre la muraille et la tranche vers le dehors ; car les manuscrits, fermés par deux bandes de cuir et des agrafes (pipes), avaient le plus souvent leur titre gravé sur la tranche et non sur le dos. Ou bien c’étaient des armoires basses, sortes de buffets fermés avec tablette sur laquelle on ouvrait les livres lorsqu’on voulait les consulter. Sauval[182], qui pouvait puiser des renseignements à des sources perdues aujourd’hui, dit que Charles V « n’oublia rien pour rendre la bibliothèque du Louvre la plus nombreuse et la mieux conditionnée de son temps.... Si bien que, outre les bancs, les roues, les lettrins et les tablettes de la bibliothèque du Palais qu’on y avoit transportés, il fallut que le roi en fit faire encore quantité d’autres. Il ne se contenta pas de cela ; car, pour garantir ses livres de l’injure du temps, il ferma de barreaux en fer, de fil d’archal et de vitres peintes, toutes les croisées ; et afin qu’à toute heure on y pût travailler, trente petits chandeliers et une lampe d’argent furent pendus à la voûte, qu’on allumoit le soir et la nuit. On ne sait point de quel bois étoient les bancs, les roues, les tablettes, ni les lectrins; il falloit néanmoins qu’ils fussent d’un bois extraordinaire, et peut-être même rehaussé de quantité de moulures ; car enfin les lambris étoient de bois d’Irlande la voûte enduite de cyprès, et le tout chargé de basses tailles (bas-reliefs)..... »
LIT, s. m. Meuble de bois ou de métal garni de matelas, couvertures, oreillers, courtes-pointes et draps, destiné au repos. De toute antiquité, les lits ont été en usage; les peintures et bas-reliefs assyriens, égyptiens, grecs et romains, nous en donnent de nombreux exemples. Les anciens, jusqu’aux ive et ve siècles, prenaient mémo leurs repas couchés sur des lits disposés en fer à cheval autour d’une table sur laquelle étaient placés les mets. Cet usage paraît avoir été abandonné vers le vie siècle. A dater de cette époque ou environ, en Occident, les lits furent uniquement destinés au repos. Le moyen âge mit un grand luxe dans la façon et la décoration des lits, qui prirent en même temps des formes très-variées. Le métal, le bronze, l’argent, les bois précieux, l’ivoire, la corne, étaient employés dans la construction de ces meubles, qui formaient l'ornement principal des chambres à coucher.
Dans l’antiquité, les lits de repos étaient souvent fabriqués en métal, et il semble que cet usage ait persisté assez longtemps. Les manuscrits de l’époque carlovingienne fournissent un grand nombre d’exemples de ces meubles, qui par leur forme et leur disposition, indiquent l’emploi du bronze. Ces lits étaient beaucoup plus élevés du côté du chevet que vers les pieds, de manière que la personne couchée se trouvait presque sur son séant. Nous voyons cette forme de lits persister jusqu’au xiiie siècle. C’est par des amas de coussins plus nombreux et plus épais vers la tète que l’on donnait une grande Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/176 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/177 [ LIT ] — 160 —
couvert d’ornements est placé sous le matelas, qui lui-même est couvert d’une étoffe très-riche. Sous la tête de Salomon est placé un petit oreiller, et le roi est enveloppé dans une couverture doublée de fourrure (voir). Des courtines sont suspendues au-dessus du lit, ainsi qu’une petite lampe. L'usage des veilleuses suspendues au-dessus des lits paraît avoir été habituel pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles. On semblait craindre l’obscurité complète pendant le repos de la nuit. A une époque où l’on croyait aux apparitions, à l’influence des mauvais esprits, il n’est pas surprenant qu’on voulut avoir une lampe allumée près de soi pendant le sommeil ; la clarté d’une lampe rassure les personnes qui éprouvent cette vague inquiétude que cause l’obscurité complète. On supposait d’ailleurs que les lumières éloignaient les esprits malfaisants ou des apparitions funestes.
11 s’agit d’une veuve qui se retire dans un monastère, voulant abandonner les pompes du siècle :
« Or avoit donc en usage « Que près du lit ou elle jesoit « Touz tems por nuit mettre fesoit « Deux chandelles qui y ardoient, « Quar ténèbres mal li faisoient. « « Une nuit gesoit moult grevée « « Si vit entre les .ii. lumières « Devant son lit saint Pierre ester « Quel connut bien sans arreter. »
Les courtines sont, au XIIe siècle, comme nous l’avons dit plus haut, attachées à des traverses, avec ou sans ciel. Voici encore un exemple (fig. 3) tiré du même manuscrit-, représentant le songe de la femme de Pilate. Le lit paraît être de bois tourné décoré d’incrustations. Un seul matelas, très-relevé vers le chevet, pose sur un drap jeté sur la sangle. Un linceul enveloppe le personnage, qui, du reste, paraît vêtu d’une tunique et dont la tête est couverte d’un voile. Un petit oreiller couvert d’une riche étoffe
’ Poésies diverses d’un prieur du Mont-Saint-Michel. Extraits publ. en 1837, p. II, Caen, chez Mancel.
’ D’Herrade de Landsberg, biblioth. de Strasbourg, XIIe siècle. Nous avons ici, comme dans la fig. 1 , rectifié la perspective et le dessin. Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/179 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/180 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/181 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/182 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/183 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/184 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/185 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/186 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/187 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/188 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/189 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/191 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/192 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/193 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/194 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/195 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/197 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/198 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/199 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/200 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/201 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/202 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/203 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/204 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/205 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/206 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/207 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/209 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/210 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/211 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/212 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/213 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/214 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/215 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/216 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/217 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/218 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/219 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/220 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/221 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/222 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/223 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/224 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/225 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/226 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/227 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/228 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/229 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/230 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/231 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/232 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/233 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/234 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/235 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/236 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/237 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/238 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/239 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/240 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/241 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/242 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/243 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/245 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/246 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/247 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/248 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/249 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/250 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/251 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/252 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/253 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/254 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/255 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/256 — -231 — [ RELIQUAIRE J
derrière la Vierge. D’ailleurs ce reliquaire portatif est trop grossièrement exécuté et fabriqué en matière trop commune pour donner
13
•^
G. .c :.
-a
lieu de croire qu’il ait fait partie du trésor du saint roi. Peut-être
/4
/^axc’^ ".
a-t-il appartenu à l’un des membres de sa famille. Les plaques intéPage:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/258 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/259 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/260 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/261 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/263 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/264 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/265 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/266 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/267 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/268 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/269 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/270 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/271 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/272 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/273 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/274 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/275 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/276 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/277 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/278 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/279 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/280 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/281 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/282 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/283 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/284 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/285 [ TABLE ]
— 256 —
Nous donnons (fig. 3) une copie réduite de la vignette¹. Il est certain qu’au XIIIe siècle, les tables à manger étaient habituellement couvertes de nappes :
« Einsi s’esbatent sans dangier « Tant qu’il fu ore de mangier « Et pue les napes furent mises, « Et dessus les tables assises « Et les salieres et li pains². »
Après le repas, les convives se levaient ; des serviteurs enlevaient
les nappes, et, sur les mêmes tables qui avaient servi à manger, on jouait aux échecs, aux tables (trictrac), aux dés :
« Rois Arragons les fist moult bien servir, « A mangier orent assez et pain et vin, « Grues et gentes et bons poons rostiz ; « Des autres mes ne sais que vos devis ; « Tant en i ot com lor vint à plésir. « Quant ont mengié et béu à loisir, « Cil eschançons vont les napes tolir, « As eschés jeuent paien et Sarrazin³. »
Ce texte, antérieur au précédent, parle déjà de nappes enlevées de dessus les tables à manger pour permettre aux convives de jouer.
¹ Page 119.
² Le Roman du Renart, vers 22769 et suiv.
³ La Prise d’Orenge, vers 551 • Guill d’Orange, chansons de geste des XIe et XIIe siècles, publ. par J.-A. Jonckbloet. La Haye, 1854. Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/287 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/288 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/289 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/290 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/291 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/292 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/293 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/294 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/295 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/296 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/297 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/298 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/299 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/300 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/301 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/302 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/303 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/304 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/305 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/306 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/307 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/308 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/309 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/310 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/311 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/312 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/313 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/314 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/315 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/316 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/317 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/318 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/319 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/320 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/321 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/323 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/324 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/325 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/326 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/327 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/328 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/329 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/330 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/331
VIE PUBLIQUE DE LA NOBLESSE FÉODALE, RELIGIEUSE ET LAÏQUE
CÉRÉMONIES, SACRES, COURONNEMENTS.
Eginhard rapporte que le jour de Noël de l’année 801, Charlemagne entra dans la basilique de Saint-Pierre à Rome, pour assister à la célébration de la messe, et qu’au moment où il s’inclinait, pour prier, devant l’autel, le pape Léon lui mit une couronne sur la tête. Alors tout le peuple romain s’écria : « A Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire ! » Après cette proclamation, le pontife se prosterna devant lui, et l’adora suivant la coutume établie du temps des anciens empereurs, et dès lors Charles, quittant le nom de Patrice, porta celui d’empereur et d’Auguste[183].
Guillaume le Conquérant se fit couronner roi d’Angleterre dans l’église abbatiale de Westminster, le jour de la Nativité de Notre-Seigneur.
« …
« E tant que li Noël avint
« Que li Engleis e li Normant
« Communaument petit e grant
« Voudront qu’il fust reis coronez.
« Eissi le jor que Deus fu nez,
« Sens terme plus e senz devise,
« Ont la corone el chef assise
« A Saint-Pere de Weslmostier[184]. »
Wace décrit les pompes du couronnement d’Arthur[185]. La cour s’assemble,
« Quant la cort al roi fut jostée (réunie)
« Mult véissiés forte asamblée,
« Et tote la cité frémir ;
« Sergans aler, sergans venir,
« Et ostex saisir et porprandre[186] ;
« Maisons veair, cortines tandre.
« Les marescax ostex livrer[187],
« Soliers (salles) et cambres délivrer.
« Et cil qui nul ostel u’avoicnt
« Lor loges et lor très tendoient[188].
« Mult véissiés as escuiers
« Palefrois mener et deffers
« Seles mètre, seles oster,
« Lorains (harnais) terdre (essuyer), lorains laver,
« Faire estables, paissons fichier[189],
« Cevax mener et estrillier,
« Ceval tondre, ceval férer,
« Et seles des cevaus oster,
« Cevaux torchier et abrever,
« Avaine et fuerre (paille), erbe porter.
« Mult véissiés en pluisors sens
« Vallès aler el camberlens (chambellans),
« Garnimens et mantiax ploier,
« Et enverser et atacier,
« Péliçons porter vairs et gris ;
« Foire samblast, ce vous fust vis.
« Al matin, al jor de la feste,
« Ce dist l’estoire de la geste,
« Li vinrent tôt li arcevesque
« Et li abé cl li evesque.
« El palais le roi coronerent[190],
« Et à l’église le menèrent :
« Dui archevesque le menoient ;
« Chascuns un bras li sostenoit
« De si qu’à son siege venoit.
« Qatre espées i ot à or
« Que pont, que helt, que entretor.
« Qatre rois ces quate portoient
« Qui par devant Artur aloient ;
« …
« La roine par grant esgart
« Fu servie de l’autre part.
« Devant la feste avoit mandées
« Et à cele cort assamblées
« Les grant dâmes del païs,
« Et les fames à ses amis ;
« Ses amies et ses parantes
« Et meschines beles et gantes
« Fist à la feste à soi venir.
« Por cele feste maintenir
« En sa chambre fu coronée[191].
« Et al temple as nonains menée,
« l’or la grant presse départir,
« Que nus masters ne peust sofrir,
« Quatre dames qui devant vinrent
« Quatre cornelles blauces tinrent ;
« As quatre estoient mariées
« Qui portoient les quatre espées.
« … »
Le poëte décrit les riches costumes des personnages composant le cortège, la presse du peuple, la splendeur de la cérémonie dans l’église :
« Mult oïssiez orgres soner,
« Et clers chanter et orguener. »
Et les chevaliers qui vont et viennent, regardent les dames, courent aux églises. La messe finie, le roi et la reine ôtent leurs couronnes, changent leurs vêtements de cérémonie pour d’autres plus légers, et vont s’asseoir au festin, le roi chez lui, la reine chez elle. Après, commencent les jeux : les uns montent à cheval, d’autres combattent, sautent, jettent la pierre ou le dard ; les vainqueurs sont conduits devant le roi, qui leur donne des présents.
« Les dames sor le mur montoient,
« Qui les jus agarder voloient,
« Qui ami avoit en la place,
« Tost li monstre l’oil et la face. »
Puis viennent les jongleurs, les chanteurs et joueurs d’instruments, les poëtes et les conteurs. Ou joue aux dés, aux dames, aux jeux de hasard. La fête se prolonge ainsi trois jours, et finit par de grandes largesses à toute rassemblée.
Le cérémonial des couronnements des rois ne fut formulé à peu près régulièrement qu’au XIIe siècle, à l’occasion du sacre du roi Louis le Jeune, en 1179, et enregistré, la même année, en la chambre des comptes[192]. Voici en quoi consistait cette cérémonie : Devant le chœur de l’église cathédrale de Reims était dressé un trône sur un échafaud élevé, auquel on montait par des gradins en assez grand nombre pour que les pairs du royaume et d’autres seigneurs s’y pussent tenir. Le sacre devait avoir lieu le dimanche, et, dès la veille, l’église était gardée par les gens du roi et ceux de l’église. La nuit, le roi venait prier dans l’église, avant les matines, chantées à l’ordinaire.
Primes sonnées, le roi est accompagné à la cathédrale par les archevêques, évêques et barons, avant que l’eau bénite soit faite. Des siéges sont disposés autour de l’autel à droite et à gauche, celui du roi au milieu. Dès l’aube, le roi a dû envoyer ses plus notables et puissants barons à l’abbaye de Saint-Remi chercher la sainte ampoule ; ceux-ci jurent de la reconduire après la cérémonie et de la rendre à l’église abbatiale. La sainte ampoule est accompagnée, entre prime et tierce, par les religieux de Saint-Remi, et portée par l’abbé sous un dais de soie, dont les bâtons sont soutenus par quatre moines en aube. L’archevêque de Reims reçoit la sainte ampoule à la grande porte de la cathédrale, étant accompagné des autres archevêques, évêques et barons ; il promet de la rendre à l’église de Saint-Remi, et la porte sur l’autel. Les religieux attendent la fin de la cérémonie que la sainte ampoule soit rapportée.
L’archevêque se prépare à dire la messe, et le roi se lève. Après quoi, le prélat fait au roi cette demande : « Nous te requérons nous octroyer, que à nous et aux églises à nous commises, conserves le privilège canonique, loi et justice dues ; nous gardes et défendes comme roi est tenu en son royaume, à chaque évêque et église à lui commise. » Le roi octroie et promet.
Le Te Deum est entonné, et deux archevêques ou évêques conduisent le roi par les mains à l’autel, devant lequel il se prosterne, ne se relevant qu’après le chant. Sur l’autel ont été placés la couronne royale, l’épée dans son fourreau, les éperons d’or, le sceptre, la verge surmontée d’une main d’ivoire, les chausses ou bottines de soie bleue semées de fleurs de lis d’or, la tunique ou dalmatique de même étoffe et couleur, le manteau royal également bleu, semé de fleurs de lis, fait en manière de chape sans chaperon ; toutes choses apportées par l’abbé de Saint-Denis en France et gardées par lui. Alors le roi, étant devant l’autel, ôte ses vêtements, sauf la camisole ou veste de soie et sa chemise, lesquels derniers vêtements sont ouverts fort bas devant et derrière et maintenus par des agrafes d’argent.
Le grand chambellan de France chausse au roi les bottines ; le duc de Bourgogne lui attache les éperons et incontinent les lui ôte. L’archevêque lui ceint son épée, puis, replaçant le fourreau sur l’autel, remet le fer nu entre les mains du roi en lui disant : « Prends ce glaive donné avec la bénédiction de Dieu, etc.[193]. » Le chœur chante une antienne pendant laquelle le roi offre l’épée à l’autel, la reprend des mains de l’archevêque, et sans délai la remet au connétable ou à celui des barons qui en tient lieu, lequel la porte devant le roi tant en l’église qu’après la cérémonie et jusqu’au palais. Cela fait, l’archevêque ouvre la sainte ampoule, en tire un peu d’huile qu’il mêle au saint chrême dans une patène sur l’autel. Les agrafes des vêtements du roi sont ouvertes, et celui-ci s’étant mis à genoux devant l’archevêque, assis comme quand il consacre, les évêques disent sur lui trois oraisons. L’archevêque dit celle de la consécration et oint la personne du roi en cinq endroits, savoir : le dessus de la tête, la poitrine, entre les épaules, sur les deux épaules et aux saignées des deux bras. A chaque onction, le prélat dit : « Je t’oins de l’huile sanctifiée, au nom du Père, etc., etc. », et l’on chante une antienne.
Le vêtement du roi est refermé, et le grand chambellan de France revêt le roi de la dalmatique, du manteau royal, de façon que son bras droit soit libre ; l’archevêque lui met l’anneau au doigt du milieu de la main droite, en disant : « Prends l’anneau, signal de la sainte Foi, etc. » Puis il récite une oraison. Il remet le sceptre en la main droite du roi, en disant : « Prends ce sceptre, insigne de la puissance royale, etc. » Il récite une seconde oraison. Il remet la verge de justice en la main gauche du roi, en disant ; « Prends la verge de vertu et d’équité, etc. » Le chancelier de France, ou, à son défaut, l’archevêque, appelle par leurs noms et selon leur ordre les pairs de France, les laïcs les premiers, lesquels étant réunis autour du roi, le prélat prend la couronne sur l’autel et la pose sur le chef du roi, et aussitôt tous les personnages assemblés y mettent les mains et la soutiennent pendant que l’archevêque dit : « Dieu te couronne de la couronne de gloire et de justice…, etc. » Puis il récite une oraison. S’adressant ensuite à la personne du roi, il lui dit : « Sois stable, et retiens dorénavant l’État, lequel tu as tenu jusqu’aujourd’hui par la succession de ton père de droit héréditaire…, etc. » Il termine en appelant les bénédictions de Dieu sur le roi. Cette cérémonie achevée, l’archevêque, accompagné des pairs, mène le roi sur le trône posé sur l’estrade, afin qu’il soit vu de tous, et la messe commence. Au moment de la lecture de l’Évangile, le roi se lève, et la couronne est enlevée de dessus sa tête. Le livre est porté ensuite au roi à baiser parle plus grand parmi les archevêques, puis à l’archevêque officiant. A l’offrande, on porte un pain, un baril d’argent rempli de vin et treize pièces d’or ; le roi y est conduit et ramené par les pairs soutenant la couronne, son épée nue portée devant lui. La secrète étant dite et les bénédictions appelées sur le roi et le peuple, après le Pax Domini, celui qui aura porté le livre des Évangiles à baiser au roi prend la paix de l’archevêque, le baisant sur la joue, et la présente à baiser au roi. Après lui, tous les autres archevêques et évêques en leur ordre vont baiser le roi séant sur son trône. La messe achevée, les pairs conduisent le roi derechef à l’autel, où il reçoit la communion. Cela fait, l’archevêque lui ôte la grande couronne et met sur sa tête une autre couronne plus petite et légère ; ainsi le roi s’en va au palais, l’épée nue portée devant lui. Sa chemise est brûlée, à cause de l’onction qu’elle a touchée. La sainte ampoule est accompagnée à Saint-Remi comme elle a été amenée.
Quand la reine est sacrée et couronnée avec le roi à Reims, un trône est préparé pour elle, de moindre apparence que celui du roi, lequel séant déjà couronné, la reine est amenée dans l’église, et se prosterne devant l’autel pour prier. Après son oraison dite, les évêques la relèvent sur les genoux. La reine est ointe sur le chef et la poitrine ; le sceptre, la main de justice et l’anneau lui sont remis comme au roi. Puis l’archevêque seul place la couronne sur sa tête, laquelle couronne est soutenue de tous côtés par les barons. La reine est conduite ainsi jusqu’à son trône, et le même ordre est suivi comme pour le roi pendant le reste de la cérémonie.
Un grand festin était donné après le sacre et le couronnement. Philippe-Auguste fut servi par le roi d’Angleterre pendant ce banquet du sacre, le vassal à genoux[194]. Pendant ces fêtes, on tendait des étoffes dans les rues de la ville. Au sacre et couronnement de la reine Marie de Brabant, en 1275, à Paris, « les bourgeois firent aussi fête grande et solennelle ; ils encourtinèrent la ville de riches draps de diverses couleurs. Les dames et pucelles s’éjouissoient en chantant diverses chansons[195]. » On se ferait difficilement une idée aujourd’hui du luxe déployé dans les cérémonies des couronnements et de l’hospitalité donnée à tous venants pendant plusieurs jours ; par les princes à cette occasion, s’il ne nous était pas resté des descriptions assez détaillées de ces solennités. Un écrivain de Londres, clerc probablement[196], vers la fin du XIIIe siècle, raconte ce qui fut fait au palais de Westminster pour le couronnement d’Edward Ier, en 1273 : « Tout l’espace de terrain vacant dans l’enclos du palais de Westminster fut entièrement couvert de maisons et dépendances. Plusieurs salles furent construites au sud du vieux palais, autant qu’il en put tenir, dans lesquelles des tables, solidement fixées sur le sol, furent dressées pour régaler les grands et tous les nobles le jour du couronnement et pendant deux semaines après. Tous ceux qui vinrent à la solennité, riches ou pauvres, furent reçus et nourris gratuitement. Des cuisines en grand nombre furent bâties dans le même enclos, et, dans la crainte qu’elles ne pussent suffire, des chaudières de plomb en nombre incalculable furent disposées au dehors, en plein air, pour la cuisson des viandes. » L’auteur fait remarquer que « la cuisine principale dans laquelle les volailles et autres mets devaient être cuits était entièrement découverte, afin de permettre à la fumée de s’échapper librement ». Les comptes des dépenses faites à cette occasion mentionnent « l’acquisition de 300 tonneaux de vin qui coûtèrent, compris le transport, 643 livres 15 s. 4 d. Il en fut bu 116 le seul jour du couronnement. Ces vins provenaient en grande partie de Bordeaux ». Ces mêmes comptes relatent l’achat des chaudières de plomb, l’établissement de fours, etc. Une écurie provisoire, d’une étendue considérable, fut élevée dans le cimetière de Saint-Margaret. Pour que le roi et la reine pussent passer à couvert de leurs appartements à l’église, on dressa une galerie de bois. Le chœur de l’abbaye était garni d’un plancher provisoire[197]. Les travaux et le vin seulement s’élèvent à 2865 liv. 1 s. 1 d. Cette somme doit être multipliée par 15, si l’on veut connaître la valeur qu’elle représente aujourd’hui, c’est-à-dire 1 074 875 francs environ. A cette occasion, la grande et la petite salle de Westminster furent « blanchies et repeintes à neuf, et le « palais fut réparé ».
Le trouvère Cuvilier, au XIVe siècle, donne quelques détails sur le couronnement de Henri de Transtamare à Burgos :
« Le jour de saintes Pasques que Dieu fu surrexis,
« Fu couronnez à joie li nobles roys Henris
« Ou moustier Nostre-Dame, la mère Jhesu-Cris
« Là fu li nobles rois sacrez et bénéis
« Et receut la couronne par devant les martirs ;
« De l’evesque de Burs (Burgos) fu li services dis ;
« Li rois fu couronnez, et la dame gentilz
« Ramenée au palais, qui estoit moult jolis.
« A joie et à honnour fu li rois recueillis.
« Nobles fu li disners de tous bien raemplis,
« De gelines, de grues et de chappons rostis
« Et de tous riches vins des meilleurs du païs.
« Maint son de menestrez y fu ce jour oys,
« Menestrez et heraut y furent bien partis :
« Chascun receut beaux dons et fu bel revestis. »
Les comptes de Geoffroi de Fleury, argentier du roi Philippe le Long (fin de l’année 1316), donnent le détail des dépenses faites à l’occasion du sacre du roi, le 9 janvier 1317, en vêtements, étoffes, tentures et tapis. Ces dépenses s’élèvent, pour le roi, à : 2378 liv. 8 s. 6 d., pour la reine et ses enfants à 5007 liv. 13 s. 10 d. Ils mentionnent, pour le roi, trois chambres, et pour la reine deux chambres, tendues de neuf avec un grand luxe d’étoffes, de broderies, de tapis, coussins, courtines[198].
Froissart s’étend assez longuement sur le sacre et couronnement du jeune roi Charles VI, le dimanche 4 novembre 1380 : « Et entra Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/341 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/342 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/343 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/344 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/345 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/346 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/347 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/348 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/349 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/350 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/351 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/352 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/353 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/354 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/355 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/356 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/357 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/358 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/359 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/360 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/361 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/362 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/363 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/364 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/365 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/366 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/367 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/368 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/369 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/370 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/371 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/372 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/373 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/374 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/375 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/376 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/377 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/379 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/380 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/381 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/382 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/383 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/384 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/385 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/386 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/387 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/388 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/389 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/390 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/391 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/392 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/393 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/394 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/395 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/396 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/397 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/399 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/401 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/403 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/405 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/406 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/407 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/409 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/410 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/411 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/413 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/414 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/415 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/416 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/417 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/418 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/419 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/421 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/422 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/423 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/424 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/425 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/427 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/428 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/429 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/431 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/432 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/433 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/435 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/436 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/437 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/438 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/439 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/440 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/441 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/442 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/443 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/444 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/445 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/447 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/449 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/450 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/451 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/453 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/455 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/456 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/457 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/458 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/459 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/460 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/461 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/463 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/464 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/465 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/467
VIE PRIVÉE DE LA HAUTE BOURGEOISIE
Si, de nos jours, quelques industries nouvelles se sont élevées, s’il en est d’anciennes qui se soient perfectionnées, il en est plusieurs qui n’ont fait que décroître depuis le xvie siècle. Les corps de métiers avaient l’inconvénient de maintenir la main-d’œuvre à un prix élevé, de composer une sorte de coalition permanente, exclusive, jalouse, et toujours en situation de faire la loi à l’acheteur ; mais ces corps conservaient les traditions, repoussaient les incapacités ou les mains inhabiles. La main-d’œuvre, n’ayant pas de concurrence ruineuse à craindre, tenait à la bonne renommée qui faisait sa richesse et lui assurait le travail de chaque jour. Il faut bien reconnaître qu’en France nous ne savons pas user de la liberté avec la discrétion et la tenue qui peuvent seules en garantir la durée, et qu’une barrière n’est pas plutôt renversée, que tout le monde veut la franchir en même temps sous peine de passer les uns sur les autres. Les industries affranchies de toute entrave par les principes de 1789 se sont bientôt livrées à une concurrence effrénée, à ce point que plusieurs ont cessé d’inspirer la confiance, et ont vu les demandes cesser peu à peu, surtout à l’étranger, à cause de l’infériorité de la fabrication. Aucun peuple ne sait faire d’aussi bonnes lois que nous, mais aucun peut-être ne sait moins s’y soumettre. Nos chefs d’industrie sont très-capables, nos ouvriers sont pleins d’intelligence ; mais, dans le cours ordinaire des choses, maîtres et ouvriers se contentent d’à peu près. S’il s’agit d’une exposition industrielle, de paraître devant les autres nations, la plupart de nos fabricants pourront se trouver au premier rang, envoyer des produits incomparables sous le rapport du goût et de l’exécution ; mais s’il s’agit de multiplier ces produits à l’infini, d’en exporter des milliers, beaucoup seront défectueux, négligés, incomplets. Ce malheureux défaut, qui tient à notre caractère, nous a fermé bon nombre de débouchés sur la surface du globe ; tandis que nos voisins les Anglais, inférieurs à nous sur bien des points, s’emparent des marchés par l’égalité de leurs produits. L’organisation des jurandes et maîtrises apportait un frein à cette déplorable habitude de fabriquer d’autant moins bien qu’on fabrique davantage. Nous avons tous éprouvé que l’on ne peut aujourd’hui prendre dans le commerce les objets qui demandent une exécution régulière et soignée, et que si nous voulons, par exemple, de bonnes serrures, il faut les faire faire exprès ; que si nous avons un appartement à meubler, nous devons commander chaque meuble et veiller à ce que son exécution soit irréprochable.
L’amour irréfléchi pour le luxe qui s’est répandu dans toutes les classes est venu encore augmenter chez nous cette disposition de l’industrie mobilière à donner son attention à l’apparence, au détriment du fond. Si bien que, pour aucun prix, on ne trouve, dans les ateliers, un meuble simple, mais irréprochable comme exécution ; s’il vous prend fantaisie d’en posséder un, il faut le faire faire. Il est vrai qu’aujourd’hui un chef de famille change cinq ou six fois son mobilier pendant le cours de sa vie, et qu’autrefois les mêmes meubles servaient à deux ou trois générations. Les meubles étaient de la famille, on les avait toujours vus, on s’y attachait, comme il est naturel de s’attacher à tout objet témoin des événements de la vie et des occupations de chaque jour. Sans être trop profond observateur, chacun peut reconnaître qu’il s’établit entre les hommes et les objets qui les entourent, quand ces objets demeurent constamment sous leurs mains, certains rapports harmonieux qui, à notre avis, donnent aux habitations un caractère particulier, comme une âme.
Tout s’enchaîne et se tient dans la vie des hommes ; il serait illogique de demander aux familles du xixe siècle une perpétuité dans leurs meubles qui n’existe plus dans les mœurs. Les familles se dispersent aujourd’hui à chaque génération, après chaque décès, et nous ne pouvons raisonnablement demander à un chef de famille de meubler sa maison pour un temps illimité, puisque, lui mort, sa maison sera démembrée. Mais telle est la force des traditions, malgré les lois, malgré les mœurs, que nous voyons cependant chaque jour des hommes graves oublier qu’ils sont, au xixe siècle, à l’auberge leur vie durant, et qu’après eux un voyageur inconnu habitera leur chambre.
Du xiiie au xvie siècle, le luxe était singulièrement développé, non-seulement chez les nobles, mais aussi parmi la classe bourgeoise. Pendant les malheurs politiques des xive et xve siècles même, il semble que dans les habitations des villes le mobilier devint plus riche et plus nombreux. À cette époque, la bourgeoisie profitait de l’affaiblissement de la noblesse et rivalisait de luxe avec elle dans ses maisons et sur ses habits. Elle ne se ruinait pas comme les gentilshommes à la guerre ; elle vendait, achetait, prenait en gage, se plaignait fort, obtenait des privilèges, imposait des conditions usuraires aux seigneurs qui avaient besoin d’argent, et se moquait d’eux quand elle les voyait dénués de tout.
« Hommes d’onneur, chevalereux,
Gentilz, sages, loyaulx et preus
N’en savoient leur cuer abaisser
De toujours ses dons demander (au roi) ;
Mais hommes bas, de néant venus,
Qui veulent de bas monter sus,
N’ont honte de riens demander ;
Puys parle qui en vouldra parler,
Car ils l’auront pour flatoyer,
Ou pour la robe desplumer.
Sy se riront des chevaliers
Qui n’auront robes ne deniers,
Qui ont porté pour le Roy douleur,
Et sont prests de porter greigneur,
Et de mourir com bon vassal
Pour garder le Roy de tout mal.
Les autres, par sainte Marie,
Le serviront de flaterie
Et de porter nouvelle guise ;
N’oncques leur pères n’eust la mise
Que il peust payer la façon.
Après vouldront faire maison
De deux sales de lis tendus,
D’argent vaisselle comme dus
Vouldront-il avoir tost après,
El s’ils treuvent rentes assés
Que veulent vendre gentilz hommes,
Les achèteront ces prudommes
Le mondes est huy très-puissans
Quant des sy bas fait sitost grans ;
Car de vray vilain, chevalier
Ne de droit buzart, esprevier ;
Ne de toille, franc camelin :
Ne de Goudale, sade vin,
Souloient dire les anciens,
Non se pourroit fiire pour riens
Se au prince faiiloit conseil querre,
Ou s’il survenoit une guerre,
De quoy luy sauroyent ayder ?
« Ne le me vueilliez demander[199].
............
Ailleurs le Sarrasin reproche aux Français les abus du temps :
Vous avez une autre police
Qui certes me samble trop nice,
Qu’entre vous je voy ces truans
Voulans contrefaire les grans ;
Se un grans portoit mantel en ver,
Incontinent un vilain sers
Aussi se prent en ver porter
Pour les bien nobles ressambler.
............
Puis, c’est le Juif qui demande à rentrer en France ; car les marchands, dit-il, se livrent, à l’abri de leur négoce, à une usure cent fois pire que la sienne. Jehan lui reproche de ne cultiver aucun art, de n’être ni laboureur ni marin :
Pourquoi estes-vous venus cy ?
Le Juif répond :
Loy de Dieu, Sire, je vous pry
Que vous me veuilliez escouter :
Je suy çà venus espyer,
« Par mandement de nos Juifz,
Se nous pourrions estre remis
Et retourner en ceste terre.
Nous avons oy que tel guerre
font les usuriers marchans
Qu’ilz gaignent le tiers tous les ans :
Sy font secrètement usure
Tel qui passe toute mesure,
Car il fauldra grand gage perdre
« Se cilz ne vient au jour por rembre ;
Et qui gage bailler ne puet
Il aura perles se il vuelt,
Mais il fault qu’il les pleige bien,
Autrement n’emportera rien.
Les perles on ly monstrera,
Mille francs les achètera :
Il confessera cet achat,
Mais il vendra de l’autre part
Un marchant qui marchié fera,
Et pour huit cens francs les aura
Et sy sera mise journée
Pour payer la somme nommée,
Et s’il ne paye celluy jour
Oncques ne fut tant mal séjour,
Car il fault prendre autre terme
Mais il fault bien l’intérest rendre
Tel que, si je disoye tôt
Vous orriez envis celluy mot
Pires usures oncques ne vy
Qu’ils font aujourd’uy, je vous dy :
Les courratiers font ce Lendit.
............
Ces braves marchands des villes qui rançonnaient si bien les seigneurs, et qui n’avaient nulle occasion de déployer un luxe ruineux à l’extérieur, se meublaient richement, mettaient leur plaisir à avoir de bonnes maisons bien closes et bien garnies, de belle vaisselle, de bons vêtements ; et certainement il était, au xive siècle, plus d’un baron en France qui se fût trouvé heureux de posséder le mobilier, l’argenterie, les provisions de toiles, de drap et d’étoffes de tel gros bourgeois de la ville voisine. Les documents écrits qui nous restent de cette époque, et qui donnent quelques détails sur la vie privée de la bourgeoisie, sont tous empreints de cet amour du chez soi, qui indique toujours le bien-être intérieur, la vie régulière, l’aisance et ce luxe privé, égoïste, que nous appelons le confort. Il est un livre fort curieux à lire lorsqu’on veut prendre une idée complète des habitudes de la riche bourgeoisie au xive siècle en France, c’est le Ménagier de Paris[200]. L’auteur de cet ouvrage entre dans tous les détails de la vie privée ; il nous fait connaître que le luxe s’était répandu partout sous les règnes de Charles V et de Charles VI, et qu’alors, plus qu’aujourd’hui peut-être, la vie était embarrassée de ces soins infinis, de ces habitudes de bien-être, de ces menus détails, qui appartiennent à une société très-raffinée. Nous allons essayer de résumer les passages de ce traité qui se rapportent à notre sujet. Notre auteur recommande à sa femme de prendre soin de son mari, dans la crainte qu’il ne s’éloigne d’elle. Les hommes, dit-il, doivent s’occuper des affaires du dehors ; c’est aux femmes à avoir cure de la maison. Le mari ne craindra ni le froid, ni la pluie, ni la grêle, ni les mauvais gîtes, s’il sait au retour trouver ses aises, « estre deschaux à bon feu, estre lavé des pies, avoir chausses et soulers frais, bien peu (repu), bien abreuvé, bien servi, bien seignouri (traité en maître), bien couchié en blans draps, et cueuvrechiefs blans, bien couvert de bonnes fourrures… » Trois choses, dit-il, « chassent le preudhomme de son logis : c’est assavoir maison découverte, cheminée fumeuse et femme rioteuse… Gardez en yver qu’il ait bon feu sans fumée, et entre vos mamelles bien couchié, bien couvert, et illec l’ensorcellez. Et en esté gardez que en vostre chambre ne en vostre lit n’ait nulles puces, ce que vous povez faire en six manières, si comme j’ay oy dire… » Plus loin, il recommande à sa femme de se garantir des cousins (cincenelles) au moyen de moustiquaires (cincenelliers), des mouches, en prenant certaines précautions encore en usage de nos jours[201]. L’auteur parle de chambres dont les fenêtres doivent être bien closes de toile cirée ou autre, ou de parchemin ou autre chose. » On pourrait croire, d’après ce passage, que les châssis de fenêtres des habitations bourgeoises, au xve siècle, n’étaient fermés que par de la toile cirée, du parchemin ou du papier huilé[202] mais cependant on employait depuis longtemps le verre à vitres, et l’on en trouve des traces nombreuses dans les constructions mêmes des xive et xve siècles, et des représentations dans les peintures et les vignettes des manuscrits. Nous pensons que ces toiles cirées, parchemins, etc., s’appliquaient bien plutôt sur les volets dont on laissait une partie découpée à jour. Cette précaution était d’autant plus utile pour se garantir du froid, du soleil et des mouches, que les verres à vitres, n’étaient alors, dans les habitations, que des boudines, c’est-à-dire de petits culots de verre circulaires réunis par un réseau de plomb. L’air devait passer entre ces pièces de verre, et le soleil, traversant ces lentilles, eût été insupportable si l’on n’eût tempéré son éclat par des châssis tendus de toile ou de parchemin.
Plus loin[203] il est fait mention des soins donnés aux chevaux revenant de longue course et aux chiens revenant de chasse. Les chevaux sont déferrés et couchés (mis au bas) ; « ils sont emmiellés, ils ont foing trié et avoine criblée… Aux chiens qui viennent des bois et de la chasse fait-l’en lictiere devant leur maistre, et luy même leur faict lictiere blanche devant son feu ; l’en leur oint de sain doulx leurs piés au feu, l’en leur fait souppes, et sont aisiés par pitié de leur travail… »
Les bourgeois des villes, n’avaient pas autour d’eux les ressources que possédait le châtelain pour se faire servir ; ils n’avaient pas de paysans corvéables et étaient obligés de prendre des valets à gage. Dans le Roman du roi Guillaume d’Angleterre[204] le héros, fugitif, se voit forcé de se mettre en service chez un bourgeois, auquel il se présente sous le nom de Gui :
« Or me dit (le bourgeois), Gui, que sès-tu faire ?
Saras-tu l’eue del puc traire[205],
Et mes anguilles escorcier ?
Saras-tu mes cevax torcier[206] ?
Saras-tu mes oisiax larder ?
Saras-tu ma maison garder ?
Se tu le sès bien faire nete
Et tu sès mener me carete,
Dont deserviras-tu molt bien
Çou que jou donrai del mien.
— Sire, fait Gui, je ne refus
Tou çou à faire et encor plus :
Jà de faire vostre servisse
Ne troverés en moi faintise. —
En liu de garçon sert li rois
Molt volentiers chiés le borgois,
Ne ja par lui n’iert refusée
Cose qui lui soit commandée. »
Un valet chez un bourgeois, au xiiie siècle, remplissait ainsi l’office de cuisinier, de palefrenier, de cocher, de majordome, de portier, d’homme de peine. Il faut dire qu’alors les maisons de ces bourgeois étaient petites et qu’elles ne contenaient que deux ou Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/476 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/477 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/478 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/479 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/480 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/481 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/482 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/483
CONCLUSION
Lorsque l’empire romain tomba en Occident sous l’épée des barbares, ceux-ci trouvèrent chez les populations conquises, et particulièrement dans les Gaules, les habitudes de luxe qui s’étaient développées sous les derniers empereurs. En s’emparant du territoire, des propriétés publiques et privées, ces barbares cherchèrent bientôt à ressembler aux vaincus ; ils voulurent avoir des demeures abondamment pourvues de ce qui constitue le bien-être et le luxe. Mais en tarissant les sources de la richesse publique, des arts et du commerce, ils furent réduits à se servir longtemps des débris ramassés dans les villes et les campagnes ; le mobilier de leurs palais dut être ce qu’étaient ces palais eux-mêmes : un amas désordonné, produit du pillage et de la ruine. L’industrie, en Occident, fut anéantie à ce point que les Mérovingiens, et après eux les princes de la race carlovingienne, durent longtemps recevoir de l’Orient les meubles précieux, les étoffes et tous les objets de luxe dont ils voulaient s’entourer. Sous Justinien déjà, des fabriques de soieries s’établirent à Byzance, à Athènes, à Thèbes et à Corinthe. L’Occident acheta ces étoffes précieuses dans ces centres de fabrication, et aussi en Égypte, grand entrepôt des soieries de l’Asie, qui furent longtemps apportées par les marchands arabes trafiquant avec la Perse, l’Inde et même la Chine[207]. Plus tard les relations avec l’Orient s’établirent, d’une part, entre les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem et les Arabes qui visitaient la Mecque. Ainsi ces pèlerinages religieux furent, pour les chrétiens occidentaux comme pour les mahométans, une des voies les plus actives de commerce qu’il y ait eu dans l’histoire du monde. Le but religieux n’était pas le seul qui faisait affluer les Occidentaux vers les lieux saints. Beaucoup certainement, dans ce mouvement qui dura plusieurs siècles, pensaient à s’enrichir. Voyant sans cesse venir d’Orient tous les objets précieux, les barbares dominateurs de l’Occident se sentaient attirés vers ces régions privilégiées qui leur envoyaient l’or, la soie, les épices, les parfums et tout ce qui constituait la richesse et le luxe, comme autrefois les Gaulois s’étaient rués sur l’Italie et la Grèce, mus par l’amour du pillage. Ces relations durent avoir et eurent en effet, dans les premiers siècles du moyen âge, une grande influence sur l’industrie qui se reformait péniblement en Occident.
Si donc nous voulons avoir une idée de ce que pouvait être le mobilier des seigneurs dans les Gaules, la Bretagne et la Germanie, jusqu’à la fin du Xe siècle, il faut aller chercher les types, les moyens de fabrication et les matières premières en Orient. Certes les traditions romaines occidentales avaient, dans ces contrées, laissé des traces profondes ; mais elles durent être peu à peu altérées par l’importation d’une quantité prodigieuse d’objets fabriqués en Asie ou à Constantinople et dans les villes grecques. L’architecture elle-même subit cette influence ; mais on ne transporte pas un édifice, et l’on transporte facilement un meuble. Ce mouvement des arts d’Orient en Occident se prononce d’une manière bien évidente déjà sous le règne de Charlemagne. Ce prince fait venir d’Orient des manuscrits, des objets de toute nature, des armes, des étoffes, et ce n’est véritablement qu’à partir de son règne que l’on voit percer les premiers germes de l’art appliqué à l’industrie en Occident. L’influence des manuscrits grecs et des étoffes orientales fut considérable à partir du IXe siècle. Nous avons l’occasion ailleurs de suivre pas à pas les traces de cette influence sur l’architecture[208] ; nous devons nous borner ici à constater qu’elle fait naître une véritable renaissance dans les produits industriels, tombés, avant cette époque, dans la plus grossière barbarie.
L’architecture répond à des besoins tellement impérieux, qu’elle avait pu se soutenir tant bien que mal à l’aide des traditions romaines occidentales. Depuis l’époque de l’invasion des barbares jusqu’à Charlemagne, l’architecture n’est plus un art, par le fait : c’est une imitation grossière ou plutôt un pillage des arts du Bas-Empire en Occident ; mais les types subsistaient et pouvaient encore servir de modèles. Il n’en est pas de même du mobilier antique, qui dut être promptement détruit ; sa fabrication exigeant des ouvriers habiles, instruits par des traditions non interrompues, était tombée dans l’oubli. L’introduction d’un grand nombre de manuscrits byzantins, d’étoffes et d’objets fabriqués en Orient, fut le point de départ des nouveaux artisans occidentaux, qui s’efforcèrent, non sans succès, de reproduire ces types d’un art très-avancé, assez mal connu chez nous encore aujourd’hui, malgré les nombreux documents que nous avons entre les mains. C’est surtout dans les contrées formant le centre du gouvernement impérial de Charlemagne que l’on voit combien la renaissance byzantine des VIIIe et IXe siècles fut complète, et combien elle laissa des traces profondes et durables. Le manuscrit d’Herrade de Landsberg souvent cité par nous[209] et qui datait du XIIe siècle, nous laissait voir encore, dans ce qui touche au mobilier et aux étoffes, l’influence très-prononcée des manuscrits antérieurs de l’école byzantine. Les quelques débris de meubles carlovingiens qui existent sur les bords du Rhin sont également empreints des arts industriels de l’empire d’Orient. Mais les manuscrits grecs des VIe, VIIe, VIIIe et IXe siècles, bien qu’ils soient nombreux, particulièrement dans la bibliothèque nationale, sont peu connus des gens qui s’occupent d’art, ainsi que nous le disions tout à l’heure ; cependant c’est en examinant leurs précieux feuillets que l’on peut se former une idée de ce qu’était l’art byzantin : c’était un art très-puissant, beaucoup plus fort et vivace que ne l’était l’art romain sous les derniers empereurs de Rome. L’art romain s’était évidemment retrempé en s’établissant à Byzance, et quand on compare les manuscrits grecs des VIIe et VIIIe siècles avec les derniers débris des arts romains sous Constantin en Italie, on constate mieux qu’un progrès : on reconnaît une véritable renaissance, pleine de jeunesse et d’avenir, une verdeur sauvage, plutôt que la décrépitude des derniers artistes de Rome. Ces éléments, importés chez des nations barbares, devaient être beaucoup plus fertiles que ne l’eussent été les traditions affaiblies de l’art romain occidental. Aussi la renaissance carlovingienne a cela de particulier qu’étant le résultat d’une importation étrangère, elle conserve cependant une séve pleine d’énergie, d’originalité, et se trouve en parfaite harmonie avec les mœurs de cette époque.
Dès le XIe siècle, Venise était non-seulement un entrepôt du commerce du Levant et de l’Occident ; c’était déjà une ville industrieuse, manufacturière. Venise tirait des laines de Flandre et d’Angleterre, et fabriquait des draps qu’elle vendait sur les côtes d’Asie et à Constantinople ; ne pouvant lutter avec les drapiers flamands et français qui fabriquaient à meilleur marché, puisqu’ils possédaient chez eux la matière première, elle laissa entrer les draps étrangers, et en échange elle livrait aux marchands occidentaux des épices, du sucre, de l’ivoire, des soieries, des tapis, des meubles ou ustensiles précieux, du verre coloré, du coton tissé, de la toile de lin d’Égypte, des lames d’or et d’argent, de la cire, des fourrures qu’elle tirait de Russie. A l’Orient, outre ses draps, elle fournissait du cuivre, de l’étain affinés, du fer, du bois, des armes (ce qui était, de la part des gouvernements chrétiens, l’objet de reproches incessants), des canevas, de la toile, des cuirs façonnés, du savon. La multitude d’artisans qui affluaient à Venise fit instituer des juges, des inspecteurs et toute une hiérarchie de fonctionnaires veillant à la fabrication, à la navigation, au trafic. A la fin du XIIe siècle déjà, la douane vénitienne fonctionne régulièrement pour les marchandises importées de l’étranger, soit par la voie de mer, soit par la voie de terre. Au commencement du XIIIe siècle, il existe des consuls étrangers. C’est donc à Venise qu’il faut chercher le nœud des arts industriels en Europe. C’est elle, qui la première, fabrique et exporte. Placée entre l’Orient et l’Occident, c’est chez elle que la plupart des objets nécessaires à la vie journalière de la classe riche prennent une forme, un style partie oriental, partie occidental. Venise est, pendant la première période du moyen âge, un vaste creuset dans lequel se fondent les traditions de l’antiquité romaine, les arts de l’Orient, quelques industries des barbares, pour former les modèles de tout ce qui tient au mobilier, aux ustensiles, aux vêtements, aux armes adoptés par les Occidentaux. Il ne faut donc pas s’étonner si, dans le mobilier primitif du moyen âge, on trouve des éléments étrangers que l’architecture laisse à peine entrevoir, des formes qui sont empreintes d’une influence orientale très-franche ; c’est dans les tissus principalement que l’on reconnaît cette influence, dans de petits meubles ou ustensiles de marqueterie ou de métal fondu, facilement transportables. On constate cependant qu’en France, dès le XIIIe siècle, les arts industriels s’affranchissent de cette influence ; ils ont leurs écoles, leur style particulier beaucoup mieux caractérisé qu’en Italie, qu’en Allemagne et en Angleterre. Les corps de métiers réglementés à cette époque indiquent, d’ailleurs, une industrie locale avancée, indépendante, possédant ses procédés et son goût propre. Aussi voit-on alors les autres contrées envoyer des artistes et des artisans étudier à Paris, centre de l’unité des arts pendant les XIIIe et XIVe siècles. Jusqu’à la fin du XIIe siècle, on ne peut dire qu’il y ait un mobilier français ; il n’en est plus ainsi au XIIIe siècle. Alors les artisans procèdent méthodiquement dans leur fabrication, tout comme les maîtres des œuvres d’architecture dans la construction ; le mobilier suit une mode locale, il se transforme chez lui sans subir d’influences étrangères. Certaines villes sont renommées pour leurs tissus, pour les ouvrages de métal fondu ou repoussé. Les fabricants emploient de préférence les matières premières provenant du sol. Le bois, et le bois de chêne particulièrement, sculpté, peint ou doré, remplace ces ouvrages de marqueterie en faveur en Orient et même en Italie. Le fer forgé remplace le bronze coulé. Les étoffes de laine couvrent les murs et les pavés. L’ivoire, l’ébène, l’or et l’argent, les verroteries ne sont employés que pour de petits meubles très portatifs, mais ne trouvent plus guère leur emploi pour les meubles d’un usage ordinaire. La main-d’œuvre, enfin, l’emporte sur la valeur de la matière employée, ce qui est le signe d’un art qui n’a plus rien de barbare, chez qui le goût s’est développé. La ligne de démarcation entre les arts industriels empruntés à l’Orient et ceux qui s’élèvent chez nous au XIIIe siècle est facile à tracer. Jusque vers le milieu du XIIe siècle, l’ornementation sculptée ou peinte est toute conventionnelle ; on reconnaît parfaitement qu’elle subit une influence dont elle ne se rend pas compte ; elle ne consiste même souvent qu’en un travail mécanique dans lequel la main, guidée par des traditions, suit certaines lois importées ; tandis qu’à dater de la fin du XIIe siècle, dans l’architecture comme dans les meubles, la décoration peinte ou sculptée commence à rechercher l’imitation des végétaux de la contrée ; plus tard elle arrive même à pousser cette imitation jusqu’au réalisme. Alors les dernières traces des arts byzantins sont complétement effacées et l’art industriel nous appartient : car si, dans l’ornementation, l’imitation des végétaux et animaux se fait sentir, dans la composition des meubles les traditions font place à l’observation des besoins auxquels il faut satisfaire et des propriétés particulières à la matière employée. C’est le rationalisme substitué à la tradition.
Des maisons particulières, décorées à l’extérieur comme celles dont nous voyons quelques débris dans nos vieilles villes françaises, devaient être garnies intérieurement de meubles en rapport avec cette richesse ; si quelque chose doit surprendre, c’est qu’on ait pu si longtemps croire au dénûment et à la simplicité barbare des habitants de ces demeures. Le luxe décroît chez les bourgeois vers la fin du XVIe siècle ; cela tient principalement aux longues guerres religieuses qui ruinèrent alors la portion élevée de la classe moyenne. La renaissance, qui produisit de si gracieuses compositions et modifia les meubles comme l’architecture, fit abandonner bon nombre d’habitudes attachées à notre vieux mobilier français. A peine la bourgeoisie avait-elle commencé à remplacer les décorations intérieures de ses appartements (ce qu’elle ne pouvait faire qu’avec plus de lenteur que la noblesse), que la guerre civile éclata. Sous Henri IV, la bourgeoisie respira ; mais la révolution dans les arts était terminée, les traditions s’étaient perdues ; les mobiliers des châteaux comme des maisons ne se rattachait plus guère au passé. La réformation avait apporté avec elle certaines habitudes de simplicité qui n’étaient pas faites pour développer le goût. Les seigneurs les plus riches s’étaient pris d’engouement pour tout ce qui venait d’Italie, Les corps de métiers, si florissants au commencement du XVIe siècle, avaient vu s’éteindre les traditions du passé et ne possédaient pas encore un nouvel art applicable aux objets usuels de la vie. Si bien qu’au commencement du XVIIe siècle, alors que l’architecture civile prenait un nouvel essor, tout ce qui tenait au mobilier était comparativement grossier, d’une exécution lâche, d’un goût bâtard, visant au magnifique et n’arrivant qu’à faire lourd et gros. Si l’Italie brillait par ses monuments des XVe et XVIe siècles, elle n’avait à nous fournir, pour le mobilier, que des objets d’un usage incommode et assez rares. On était venu en France, à cette époque, à faire de l’architecture en petit lorsqu’on voulait une armoire, un cabinet, un dressoir, et nous avions pris ce faux goût à nos voisins d’outre-monts. Ce ne fut guère que pendant le siècle de Louis XIV que la France reconquit, dans la fabrication des meubles, la juste influence qu’elle avait conservée pendant plusieurs siècles. Ce prince fit de grands efforts pour organiser des fabriques d’objets mobiliers, comme chacun sait, et de son temps la noblesse ne pensa plus guère à imiter dans les châteaux les meubles inutiles et fastueux qui sont clair-semés dans les palais de Rome. En plein XVIe siècle tous les gens de bon sens ne croyaient pas qu’il fallût tout prendre à l’Italie, et comme preuve nous terminons par cette boutade d’Henri Étienne : « … Et toutesfois c’est aujourd’huy plus grant honneur d’avoir esté en telle escole (à Rome) que ce n’estoit anciennement d’avoir esté en celle d’Athènes, remplie de tant et de si grands philosophes ; voire tant plus un François sera romanizé, ou italianizé, tant plus tost il sera avancé par les grands seigneurs, comme ayant très bien estudié, et pour ceste raison estant homme de service, par le moyen de ceste messinge de deux naturels ; comme si un François de soy-mesme ne pouvoit estre assez meschant pour estre employé en leurs bonnes affaires. »
Si la noblesse et la bourgeoisie vivaient dans des demeures bien pourvues de tout le nécessaire et même du superflu, les petits marchands, les artisans, et surtout les paysans, n’avaient qu’une existence fort précaire. Dans les villes, le menu peuple habitait des chambres louées dans lesquelles s’entassait une famille entière. Le même lit recevait le père, la mère et les enfants ; ou bien, dans un angle de l’unique pièce qui servait de chambre à coucher, de cuisine et de salle, des cases superposées, comme des tiroirs, recevaient les membres de toute une famille, depuis l’aïeul jusqu’au petit-fils ; de grands volets glissant sur galets fermaient ces lits posés les uns sur les autres. On peut se figurer ce que devaient être ces intérieurs, souvent exigus, donnant sur des rues étroites, dans lesquelles le soleil ne pénétrait jamais, et traversées par un ruisseau puant et recouvert de planches ou de dalles disjointes. La peste, inconnue de nos jours dans les villes de l’Europe, faisait invasion parfois au milieu de ces demeures et enlevait en quelques jours un cinquième de la population. Les écoliers et les ouvriers qui ne demeuraient pas chez les patrons, couchaient dans des maisons garnies, sur la paille ou sur des grabats fourmillant d’insectes. On peut encore prendre une idée de ce qu’étaient ces habitations, si l’on parcourt certains quartiers de Paris, comme le faubourg Saint-Marceau, les alentours de Sainte-Geneviève, la Cité, et quelques-unes de ces rues, heureusement devenues rares, qui se croisaient en tous sens dans le centre de Paris il y a quelques années. Nous avons vu encore, dans la rue des Gravilliers, des Ménétriers, Simon-le-Franc, de la Grande-Truanderie, du Grand-Hurleur, du Mouton, etc., des maisons n’ayant que deux fenêtres de façade sur la voie, habitées par des familles nombreuses du rez-de-chaussée au cinquième étage, et dont tout le mobilier consistait en un lit, deux chaises, une table et un coffre, ne possédant qu’un escalier étroit, sombre, couvert de boue et d’ordures. Beaucoup de ménages n’avaient même pas une cheminée pour faire cuire leurs aliments et devaient aller prendre leur repas chez le gargotier voisin. Les meuble garnissant ces habitations n’ont pas besoin d’être décrits… Le paysan au moyen âge était relativement mieux logé et mieux meublé ; l’air et l’espace ne lui manquaient pas ; il possédait toujours son lit large et garni de gros draps, surtout dans les campagnes du Nord, sa huche, ses bancs, sa table et son foyer, et souvent son armoire bien remplie de linge, sa vaisselle de terre. Dans ces demeures, cependant, les animaux domestiques vivaient pêle-mêle avec les humains : le poulailler, le toit à porcs, étaient quelquefois près du lit des habitants ; mais le soleil pouvait réchauffer et assainir ces demeures, le foyer s’allumait chaque jour, et le paysan passait sa journée aux champs. Si la demeure de l’artisan citadin, du pauvre écolier, de l’ouvrier, ne fournit nulle matière à la description, si elle n’est qu’un amas sordide de meubles sans non, sans forme, qu’une sorte de détritus de la civilisation des villes, il n’en est pas de même de la chaumière : celle-ci conserve les traces de l’industrie de ses habitants, car le paysan peut créer ; la matière première ne lui fait pas défaut ; on n’éprouve pas, au milieu de la campagne, ce découragement profond qui saisit le pauvre dans les grandes villes. Si le chef de famille est robuste et intelligent, si la femme est active et laborieuse, on voit bientôt le mobilier satisfaire aux besoins de la vie ; car aux champs les bras suffisent pour tout créer, tandis qu’à la ville on ne peut rien obtenir qu’avec de l’argent. D’ailleurs le paysan avait, au moyen âge, une grande ressource : c’était celle du voisinage du château ou de l’abbaye. Tous les seigneurs féodaux n’étaient pas des tyrans aveugles, dépouillant les paysans pour le plaisir de les ruiner ; le paysan était une richesse, un revenu, et c’était d’une sage administration de lui laisser un bien-être qui profitait au seigneur. Beaucoup de vieux meubles du château ou de l’abbaye allaient garnir les chaumières. Quantité de bahuts ramassés par nos brocanteurs étaient installés depuis plusieurs siècles dans les maisons des paysans, et il ne faut pas croire qu’ils aient tous été pillés à la fin du dernier siècle. Les demeures seigneuriales s’étaient débarrassées depuis longtemps de ces meubles hors d’usage au profit des chaumières, comme beaucoup de villages s’étaient élevés avec les débris des donjons féodaux avant la révolution de 1792.
Lorsque la mode n’avait pas remis en honneur encordes meubles du moyen âge, il n’était guère de hameau, surtout dans le voisinage des châteaux ou des abbayes, qui ne possédât quantité d’objets précieux par leur âge et même leur travail. Les familles qui étaient devenues propriétaires de ces meubles les gardaient avec une sorte de respect, et conservant les meubles, elles conservaient les usages auxquels ils étaient destinés. Aujourd’hui les commissionnaires en vieilleries ramassent tous ces débris, les payent cher, et les paysans vont acheter à la ville voisine des meubles d’acajou ou de noyer plaqué. Or rien n’est plus ridicule que de voir ce faux luxe moderne installé dans la demeure du campagnard. Nous avons trouvé parfois ainsi des tables à ouvrage de la plus mauvaise fabrication du faubourg Saint-Antoine renfermant des oignons, leurs angles d’acajou plaqué laissant voir le bois blanc ; des commodes à dessus de marbre dont les tiroirs capricieux ne veulent pas rentrer dans leurs rainures ; des pendules de zinc représentant Geneviève de Brabant, ornant la chambre d’une paysanne. Tout cela avait été échangé contre une vieille huche sculptée en bois de chêne et un coucou dont la boîte vénérable avait vu passer plusieurs générations. Bien mieux, il est tel village non loin de Paris où nous trouvâmes un piano droit dans une chaumière ; sur ce que nous demandions à la maîtresse du logis si elle touchait de cet instrument, celle-ci, ouvrant de grands yeux, nous répondit : « Mais c’est une ormoëre. » Et en effet, à la place du clavier, il y avait des fourchettes et des couteaux, et le coffre inférieur s’ouvrant à deux battants renfermait du pain, du sel et des objets de ménage : un commis voyageur avait fourni ce meuble étrange en remplacement d’un vieux coffre incrusté de cuivre. Il n’y a pas grand mal à cela. Cependant il est toujours bon que les choses soient à leur place, les meubles comme le reste ; et si le luxe de mauvais aloi que nous voyons aujourd’hui pénétrer partout n’a pas sur les mœurs une fâcheuse influence, il faut avouer qu’il tend à avilir l’art industriel, si brillant et si fécond pendant plusieurs siècles en France.
Aujourd’hui, tout le monde veut être meublé avec le luxe qui convient à un financier ; mais comme peu de gens possèdent une fortune qui permet de payer ce qu’ils valent des meubles somptueux et bien faits, il en résulte que les fabricants s’évertuent à donner l’apparence du luxe et de la richesse aux objets les plus vulgaires comme façon et matière. On ne trouve partout que tables garnies de cuivre, mais qui ne tiennent pas sur leurs pieds, que fauteuils sculptés et dorés dont les débris jonchent les parquets, que tentures de laine et de coton qui simulent la soie.
Nous ne prétendons pas qu’il faille, au milieu du XIXe siècle, s’entourer de meubles copiés sur ceux qui nous sont laissés par le moyen âge. Et s’il paraît ridicule aujourd’hui de voir une femme en robe bouffante assise sur un fauteuil imité d’un siége grec, il ne l’est guère moins de placer dans un salon une chaire de quelque seigneur du XVe siècle. Ce que nous voudrions trouver dans nos habitations, c’est une harmonie parfaite entre l’architecture, le mobilier, les vêtements et les usages. Lorsque nous voyons des hommes habillés comme nous le sommes, assis dans des fauteuils du temps de Louis XV, il nous semble assister à une réunion de notaires et de commissaires-priseurs procédant à un inventaire après décès. Évidemment ces formes molles, ces couleurs tendres, ne sont point en harmonie avec nos habitudes et notre costume. Le signe le plus certain d’une civilisation avancée c’est l’harmonie entre les mœurs, les diverses expressions de l’art et les produits de l’industrie. « Montre-moi ton mobilier, et je te dirai qui tu es. » Or, si l’on s’en tenait à l’apparence, on pourrait prendre aujourd’hui de petits bourgeois pour des seigneurs. Il est certain que, de nos jours, le sens moral s’est modifié. La résignation fière et digne est considérée comme un défaut de savoir-vivre et la vanité un moyen de succès. Nous n’avons pas à faire ici un sermon ou un cours de morale, mais il est difficile de ne pas parler des mœurs lorsqu’on s’occupe des objets qui en sont la vivante expression. Ces mœurs du moyen âge, tant vantées par les uns, si fort décriées par les autres, sont, à tout prendre, assez mal appréciées : comme citoyens d’un pays, nous valons mieux, il nous semble, qu’au moyen âge ; comme hommes privés, nous sommes loin d’égaler les caractères tranchés, énergiques, individuels, que l’on rencontre à chaque pas jusqu’au siècle de Louis XIV. La révolution de 1792 a laissé dans nos lois, dans nos habitudes et nos mœurs, une empreinte qu’aucun pouvoir ne saurait effacer ; ce que nous ne pouvons comprendre et ce qui nous paraît dangereux, c’est de ne pas admettre les conséquences de ce changement dans ce qui touche à la vie journalière. Vouloir imiter les habitudes de luxe, les idées et jusqu’aux préjugés d’une époque séparée de nous par l’abîme de 1792, est au moins un travers. Nous possédons des qualités précieuses ; nous possédons, à un haut degré, le sentiment des devoirs publics, comparativement aux siècles précédents ; nous avons la conscience de notre droit et de la justice ; nous sommes enfin en état de distinguer le vrai du faux : pourquoi donc étouffer ces sentiments dans la vie privée, prétendre être autres que nous ne sommes, et nous cramponner à ces vieilleries auxquelles personne, au fond, ne croit plus ? Veut-on mesurer l’abîme qui nous sépare de ces temps auxquels nous essayons de revenir par un seul exemple ? ce sera facile. N’allons pas au delà du XVIIe siècle. Nous trouvons, en ces temps, des gentilshommes, gens de bien et d’honneur, bons pères de famille, religieux, qui ne se font aucun scrupule de provoquer une guerre civile, de piller leur propre pays, de s’allier avec des souverains étrangers, parce qu’ils sont au prince de Condé ou au duc de Beaufort[210]. Nous avouons que lorsque nous voyons un notaire ou un négociant retirés vouloir aujourd’hui se meubler comme ces gens-là, c’est-à-dire vivre comme eux dans leur intérieur, le fou rire nous prend… Il semble que, dans notre pays, le désordre et les contradictions doivent toujours exister quelque part. Jusqu’au commencement du dernier siècle, bien peu de citoyens possèdent le sentiment des devoirs publics ; mais, dans la vie privée, on trouve de grands caractères, un respect général pour les traditions, des mœurs qui s’accordent avec le milieu dans lequel on est né. Depuis 1792, l’esprit public présente une certaine unité, il s’est développé ; mais la confusion est entrée dans la vie privée, et l’on peut citer comme des exceptions les hommes qui savent être ce que la fortune les a faits ou s’accommoder à leur temps. Le besoin de paraître s’est introduit dans le mobilier comme dans les vêtements, et l’industrie s’efforce naturellement de satisfaire à ces travers. On concevrait que les petites fortunes prétendissent au luxe apparent que peuvent se permettre les grandes, et que le bien-être fût ainsi, parfois, sacrifié au désir de briller — il y a longtemps que pour la première fois on a reproché à la bourgeoisie de vouloir singer les gentilshommes, — mais notre temps dévoile une infirmité sociale qui ne s’était pas encore produite au même degré. C’est au contraire dans les classes élevées (ou du moins favorisées de la fortune) que se manifestent particulièrement ce besoin de paraître, ce goût pour le faux luxe qui semblaient autrefois réservés à ceux qu’on appelait les parvenus. Bien rares sont aujourd’hui, parmi les classes les plus riches de notre société, ceux qui aiment à s’entourer d’objets plus remarquables par leur qualité que par leur apparence, ceux qui s’enquièrent si un meuble est bien fait, s’il est conçu et exécuté de façon à être utile. On achète, il est vrai, à des prix fabuleux, des objets anciens, souvent faux, parce que cela est de mise, et qu’il convient de montrer dans sa galerie des faïences, des émaux, des bronzes et des raretés d’un autre âge ; mais s’il s’agit d’un objet moderne, sorti de nos ateliers, on s’adresse le plus souvent à la fabrication de pacotille, qui donne à bas prix des meubles bons pour la montre ; si bien que, chaque jour, les industriels consciencieux, et qui penseraient avant tout à ne produire que des œuvres de bon aloi, se découragent et suivent le courant qui pousse dans le luxe à bon marché.
On aurait pu croire que la vogue du bibelot, des vieux débris, épaves du passé, aurait fait pénétrer dans l’esprit des heureux du siècle le goût des bonnes et belles choses, ou du moins le dégoût pour ce luxe malsain qui envahit le salon et la mansarde. Il n’en est rien ; et l’on ne peut se résoudre à blâmer les petits de s’adonner à l’amour du luxe qui cache la misère, quand on voit les appartements les plus somptueux remplis d’objets dont l’apparence menteuse ne saurait tromper sur leur valeur réelle les gens de goût. Ce sont là des vanités qui accusent la faiblesse des convictions et des caractères d’une société qui ne sait trop ce qu’elle est et où elle va, et qui croit maintenir un passé qui croule, en simulant des goûts qu’elle n’a plus, une grandeur qui lui échappe. Mais que dire de ceux qui affectent des principes en fait d’art et de goût, et qui s’entourent d’objets aussi plats par le style que grossiers par l’exécution ; qui, nous entretenant de la supériorité de l’art grec à tout propos, remplissent leurs appartements de meubles mal copiés sur les débris des salons de Mme de Pompadour ou de Marie-Antoinette ; de ceux qui s’émerveillent sur les créations du moyen âge, et, ne voyant dans ces œuvres que l’apparence, non le sens vrai et pratique, garnissent leurs châteaux de meubles aussi incommodes que mal faits, ornés de pâtes, et rappelant ces formes que l’on qualifiait de style troubadour, il y a trente ans ? Quelques-uns (et ceux-ci au moins sont l’expression vivante de la confusion de nos principes en fait d’art) s’entourent des débris de tous les âges, de tous les styles, et ressemblent ainsi chez eux à des marchands de bric-à-brac. Beaucoup se soucient médiocrement qu’un meuble remplisse son objet, pourvu qu’il sorte des ateliers de tel fabricant en vogue. Tout cela n’est pas très-sérieux, et nous avouons qu’il faut avoir l’esprit mal fait pour s’en fâcher ; mais ce qui n’est qu’un travers d’esprit chez un particulier devient une inconvenance au premier chef lorsqu’il s’agit des objets destinés à l’usage du culte religieux, par exemple. Or, depuis qu’il s’est fait une réaction chez nous en faveur des arts du moyen âge, nous voyons nos églises se remplir de meubles soi-disant gothiques, ridicules par la forme, insuffisants par la matière et l’exécution, et qui n’ont d’autre avantage que de périr promptement. Le zèle, respectable, mais peu éclairé souvent, des ecclésiastiques, la modicité des ressources dont ils disposent, les ont mis à la discrétion de cette classe de fabricants qui avilissent leur profession en produisant à bas prix des objets qui, par leur nature et leur destination, exigent sinon du luxe, au moins du soin, un travail consciencieux, du savoir et le respect pour tout ce qui tient au culte. C’est là une chose funeste, et à laquelle les esprits éclairés dans le clergé apporteront certainement un remède ; car, pour quelques dignes dévotes émerveillées devant ces productions barbares, il est beaucoup de gens qui s’attristent en voyant nos églises se garnir de meubles d’un goût déplorable, prêtant à rire, mal faits, inconvenants même, et qui, sous la dorure et les oripeaux, cachent les matières les plus fragiles eu les plus grossières, un art sans forme, une exécution misérable. La pauvreté décente et modeste commande partout le respect et la sympathie, mais la pauvreté qui se cache sous l’apparence du luxe et de la richesse, et laisse voir, malgré qu’elle en ait, les haillons sous la pourpre, n’est plus la pauvreté : c’est la misère vaniteuse qui n’excite que la pitié et la raillerie.
Parmi ces splendeurs à bon marché, ce faux goût et ce faux luxe, nous sommes ravi quand nous trouvons un banc bien fait, une bonne table de chêne portant d’aplomb sur ses pieds, des rideaux de laine qui paraissent être de laine, une chaise commode et solide, une armoire qui s’ouvre et se ferme bien, nous montrant en dedans et en dehors le bois dont elle est faite et laissant deviner son usage. Espérons un retour vers ces idées saines, et qu’en fait de mobilier, comme en toute chose, on en viendra à comprendre que le goût consiste à paraître ce que l’on est et non ce que l’on voudrait être.
TABLE DES MATIÈRES
PAR ORDRE ALPHABETIQUE
A
ARMOIRE. Amaire, almaire, page 3.
— (Assemblage d’), p. 12.
— Baveux de), xiiie siècle, p. 6, fig. 6.
— Banc, xve siècle, p. 14, fig. 15.
— Cath. de Munich (de la), xve siècle, p. 9.
— Ca h. de Noyon (de la), xill s., p. 9, fig. 10, pL I.
— (^Clous d’-, xv s., p. 14, 16.
— Colle de fromage (son emploi peur panneau d’), p. 1 1.
— (Cuir sur), xu^ s , p. 1 1 ; xV s., p. 14.
— Dorée, p. 18, M^% llg. 20, p. 373.
— (^Enduit sur), xii*" s , p. 11.
— (Entrée de serrure d’ ;, xV s., p. 14, 16.
— (Ferruie d"), xiii^ s., p. 8, fig. 7 ; p. 14, 16.
— Grain d’orge (panneaux à), xiii*^ s., p. 9, fig. 9 ; p. 372.
— Mortain (de l’église de), xv s., p. 13, fig. 11.
— Obazine (de l’église d’), xiii s., p. 4, fig. 1 , 2, 3.
— (Panneaux d’),xil s., p. 8, 10, 11,13, fig. 11, xV s., p. 14, fig. 14, ]). 10.
— (Peau sur), xir’ s., p. 11 ; xV s., p. 14.
— Peinte, xii<’ s., p. 11 ; xin<^s., p. 5, 8, fig. 6,8 ; XV- s., p 9, fig. 10, |.l. 1, p. 373.
— (Pentures d’), xlii*" s., p. 5, 9 ; xv" s.. p. 13, fig. 13, p. 14.15, fig. 16, 17.
— Saint Denis (de}, xiii*^ s., p. 3.
— Saint-Germain ! Auxerrois (de), xv^ s., p. 14, fig. 15, 19.
— (Vantaux d’), xui s., p. 5 ; xiv’= s., p. 13, 14, 15, fig. 15.
— (Vernis pour) xii* s , p. 11.
ARMOIRE (Verrous d’ ;, x ;ii^ s., p. 5, fig. 5, p. 8," 13, fig 12.
— (Verteveile d’), xiu" s., p. 5, fig. 4, p. 8.
AUTEL PORTATIF. Aultiev, auter, p. 18, fig. 1, 2, 3, pi. II.
B
BAHUT. Bahu, hahur, p. 23.
— Banc, XIV- s., p. 30,
— Bram(iton (de), xii- s., p. 24, fig 1.
— (Charnières de), xiv^ 3., p. 29, fig. 6 hh.
— (Entrée de serrure de), xiv- s., p. 27, • fig- ^•
— (Ferrure de^l, p. 23, 24 ; xiv-s., p. 27, fig. 4.
— Fixe, p. 23.
— Garni, xv- s., p. 30.
— (Pentuics de), p. 23 ; MV- «., p. 27. fig. 6.
— Pieds (.’i), XMi- s., p. 24, llg. 2, >P’.
— Sculpté, xiV s , p. 26, fig. 3, 4, 5.
— Table, xv« s., p. 31, ù^ 7.
— Voyage (de), p. 23, 375.
BANC, p. 31, 32 ; x ;- s., p. 33 ; xiii- s., p. 34, 35, M" ; mv- s. ; xv-s., p. 35 ; xvr s. p. 36, fig. 5.
— (Appui de), XI- s., p. 33, fig. I ; xiii-s., p. 33, fig. 2, 3.
— Bane (à), xiii- s., p. 371, fig. 1.
— Flavigny (de), xv s., p. 36, fig. 5.
— Garni, xiV^ s., p. 32 ; xv« s., p. 35, 96, fig. 1.
— (Marchepied de), p. 262, fig. 7.
— Table, vi- s., p. 32.
BANCHIER (Couverture de banc), xiv« s., l<. 37.
BERCEAU. Bers, p. 37
— Creusé dans un tronc d’arbre, ix* s. ; X’ s.. M", p. 37.
— l’anicr d’osier, M’Six’s.jp. 37,fig. 1.
— l’etil lit, p. 38, fig. 2.
— Suspendu, p. 38, M", xv^ s., fig. 3.
BUFFET, p. 39.
— Apparat fd’), p 39, x’ s.
— l’^'ige (d’j, p 39.
BUSTAIL. Bois de lit, p. 40.
C
CABINET. Armoire sur pied, xvi«s.,p. 40.
CASIER en forme de huche, p. 40.
CHAALIT. Bois de lit, p. 40.
CHAISE. Chaire, chaière, forme, fourme, p. 41 ; ix" s., x*s.,xi^ s., M5% p. 42, fig. 1.
— Bois tourné (de), bas relief de l’église Saint-Lazare d’Avallon, xu* s., p 44, fig. 4.
— Bias à), xii<= s., p. 42, fig. 2.
— Calh. d’Auxerre (de la), xiu*s., p. 48, fig. 8, 9.
— Calh. de Bourges ’,de la) , vitrail , xin s., p. 45, fig. 5.
— Coffre, xv« s., p. 54, fig. 13.
— (Coussins (le), xlV^s., p. 54, fig. 11, 12.
— Dorée, xiii’ s., p. 49, fig. 10
— Dossier (à), xill" s., p. 43, fig. 3.
— Dossier haut (à), bas-relief des stalles d’Amiens, p. 54, fig. 14 ; Xv’^ s., p. 54, fig. 13.
— (Housse de), p. 54, fig. 15, M".
— (.Marchepied de), p. i4, fig. 4.
— .Musée de Cluny (du), xiV s., p. 52, fig. 11, 12.
— Polygonale (peintures des Jacobins de Toulouse), p. 47, fig. 7 bis ; xiii« s., p. 46, fig. 6, 7, M".
— Pommes de ;, xiu* s., p. 43. CHAMBRE dlsabelle de Bourbon, W s , p. 167.
— Parade du Boi (de), au Louvre, p. 169
— Seigneur (de_,, xii* s., p. 364, pi. XII ; xiii" s., p. 365, pi. XIII ; i" s., pi. XIV, xv« s., p. 365, pi. XV.
CHAMBRES (Tapisseries dans les), p. 269.
CHANDELIER à couronnes de fer, p. 393, pi. XXVI
— Portatif, p, 412.
CHAPIER, p. 55.
CHAR. Char- branlant, charetle, chariot, cttrre, p. 55 ; Xlil’ s., p. 55, fig 1, M" ; xiv« s., p. 57, fig. 2, M’» ; w’ s., p. 58, fig. 3, M^% fig. 4, W ; xvr s., p. 59, fig. 5, ^p^
— Branlant, xvi’" s , p. 62, fig. 6.
— Bras (à), xill*^ s , p. 62.
— Coche, M", XVI s., p. 62.
— Constance (de la douane de), xvi’ s., p. 62, fig. 6, 7.
— Mortuaire de Philii’pe de Bourgogne, xV s., p. 61.
— Voyage (de), M", xv^ s., p. 58, fi. 4.
CHÂSSE, p. 63.
— Bois (de) de Cunault,xiir s., p. 70.
— (Cassolettes sous les), Xi*^ s., p. 67, fig 1.
— Cuivre émaillé (de), de Saiiit-Culmii e, xiii"’ s., p. 71, fig. 4, 5.
— Chapelle (de la sainte), xiii’ s., p. 74.
— Chartres (de la sainte Vierge de), ix" s., p. 74.
— Ferrures de), xiv^ s., p. 70.
— Métal (de), xui’ s., p. 67, 71.
— Peintes, xiii s., p. 70.
— Primitives (de bois), p. 64.
— Saint-Firmin (de), p. 69.
— Saint-Germain (de), p. 65, xV s., p. 73, fig. 6. ^
— Saint-Honoré (de), cath. d’Amiens. xiu" s., p. 69, fig. 2, 3.
— Saint Marcel de Paris (de), p. 69.
— Saint-Thibaud (de), de bois, xiv^ s., p. 70.
CHASUBLIER, p. 75.
CHATEAU ;Mobilier de), xni’s., p. 358.
— Iléception de la noblesse, Xlv’ s., p. 352.
— (Tables de), p. 257.
— (Tableaux dans les), p. 268.
— Allégoriques, p. 268.
— Généalogiques, p 268.
— (Tapis, tapisseries dans les), p. 270.
CHEMINÉE, xii" s., p. 364, pi. XII, xni s , p. 364, pi. XIII ; i- s., p 365, pi. XIV ; xv^ s , p. 365, pi XV.
COFFRE, p 75.
— (Poignées de), xiii’" s., p 377, fig 3.
— Voyage (de), p. 78, xiir’ s., p. 376,
l’ï XVIII.
COFFRET Coffre, escriut, petit coffre.
p. 75, X" s , p 76, fig.1,2, 3.
— (Anse de), xiV s., p. 82, fig. 6, pi. III,
MV s., p 76, fig. 1.
— Bois (de x ;V s., p. 82, [.1. 111, fig. 6.
— Cassette de saint Louis, xui s., p. 81
— Catii de Sens (de la), d’ivoire sculplô,
xii"s , p 79, fig. ’i, ô ; ’ s., p. 83.
— (^Charnières de), xiV s., XV s., p. 83,
fig. 9.
— Fer (de), xv« s., p. 82, fig. 7, 8.
— Sainl-Trophime d’Ar’es (de), xin*’ ?.,
p 8i, pi. IV.
— (Serrure de), xiv^ s., xv* s., p. 76,
fin- 1
COLLE de blanc d’œuf pDur meaLles, p. 374
— Fromage (de), xiii« s., p. 237, p 37/i ;
xii« s., p. 267.
— Peau (de), p 267, 279.
COUR plénière à Saumur, xiir’ s., p. 367.
COURONNEMENT d’Arthur de Breligne,
xii" s., p. 302.
— Charleniagne (de), ix"" s., p. 301.
— Edward I" (d’), xu^s., p. 307.
— François I" (de), xvi« s., p. 310.
— Guillaume le Conquérant (de), xi s,,
p. 301.
— Henri d’Angleterre (d’), xv^ s., p. 309.
— Henri de Transtamare (de’, xiV s.,
p. 308.
COURTE-POINTE. Coustc-poiate, keustespoinfe,
p. 84.
COUSSINS. Cheucke, coûte, coite, p. 85,
xv^ s., p. 85, fig. 1, M’K
COUVERTURE, p. 86,
CRÉDENCE, xv^ s., p. 89, fig. 3, M".
— A dossier, xV s., p. 89, fig. 4.
— A dossier, avec dais, p. 89, fig, 5.
— Vases couverts >vec), Xlir s., M-’ ;
xiv^ s., p. 88, fig. 2,
— Vézelay ’d'un chapiteau de), xu" s.,
p. 87, fig. 1.
CUIR peint, gaufré, doré, p. 92.
D
DAIS. Ciel, p. 93.
— Porté, XIV" s., p. 94, fig. 3,
— Queue (à), p. 95, fig. 2, .’^I", xV s.
— Trône (de), xv’s., JP^ p. 93, fig. 1, 2.
DÉPENSIER, p. 412.
DOMESTIQUES loués, p. 410.
DORSAL, xV s., p 95, fig 1.
— Cath. d’Augsbourg (de la), xvi" s.,
p. 95.
— Calh. d’Auxerre (de la), xi* s , p 96.
— Saint-Denis (de), p. 97.
DOTS chez les Francs, p. 323.
DRAPS. Housse de bière, xv’ s., M’,
p. 97, fig 1.
— Mortuaire, xvi« s., p. 98, fig. 2.
— Mortuaire, à Folleville, .xvi" s., p. 1 00.
fig. 3.
DRESSOIR. Drrssowr, dreçouer, p. 100.
— Apparat (d’), p. 103,
— Crédcnce, p. 101, fig. 1, M^^
— Dais (à), p. 101, fig. 2.
— Isabelle de Bourbon (d’), c"’ de Chnrolais,
p. 103.
— Marie de Bourgogne (à Foccasion de
la naissance de), p 102.
E
ÉCRAN. B.mc double, p 105, fig. 1 M-’,
XV* s.,
— Garde feu, p. 105
ÉCRIN (Charnière ds cuir d"), p. -84.
— Cuir bouilli (de), p. 382, pi. XXF,
— Garni d’argent, p. 379, pi. MX.
— Ivnire scu’plé d’), p. 379. p ; XIX.
— Jiroirs d’), tirettes, liettes, p. 380,
pi. XX.
— Toilette de), p. 379.
ÉCRINIER(r),xiv«s., p. 378.
ENTRÉES solennelles.
— ArthusIII(d’),àSl-Ma’o,xVs.. p. 317,
— Berthe de), au Mans, p. 311.
— Blanche d’Orléans ’de xiV s, p. 3 18.
— Charles VI (de), xV" s., p. 314.
— Charles Vil ide), à ’ aris et à Rouen,
xv« s , p. 315 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/502 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/503 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/504 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/505 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/506 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/507 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/508 Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la Renaissance (1873-1874), tome 1.djvu/509
- ↑ Dom Doublet. — Du Cange, Gloss., Armaria, Armariolus.
- ↑ Udalricus, lib. III Constiet, Cluniac, cap. x « Præcentor (cantor) et armarius : armarii nomen obtinuit eò quòd in ejus manu solet esse bibliotheca, quæ et in alio nomine arinarium appellatur. »
- ↑ Hist. somm. de la ville de Bayeux, par l’abbé Béziers, 1779.
- ↑ Voyez la description et la gravure de cette armoire dans la Revue de l’architecture de M. Daly, tome X, page 130. La gravure, entière et fort exacte, est faite sur les dessins de M. Ruprich Robert.
- ↑ Hist. somm. de la ville de Bayeux, par l’abbé Béziers.
- ↑ Tome IV, page 369.
- ↑ Ce dessin colorié nous a été communiqué par M. Bœswilwald, architecte.
- ↑ Cap xvii.
- ↑ Nous devons ce dessin à l’obligeance de M Ruprich Robert. Cette armoire est posée à l’angle d’une salle de l’église de Mortain (abbaye Blanche), garnie de stalles ; elle était élevée au niveau de l’appui des siéges et se raccordait avec la boiserie formant leur dossier.
- ↑ La fabrication à la main, des vis, était trop longue et difficile, pour que l’on employât ce moyen d’attache dans la menuiserie. La vis ne se trouve que dans les armes.
- ↑ L’église Saint-Germain l’Auxerrois fut primitivement dédiée à saint Vincent.
- ↑ Manusc. anc. fonds Saint-Germain. — Psalm., Bibl. nat., no 37.
- ↑
« A Roem fist mainte malice (l’archevêque Maugier),
« N’i lessa teile ne galice,
« Ne croix, ne boen drap en almaire,
« Ke Maugier ne fist forz traire ;
« … »(Le Roman de Rou, XIIe siècle, vers 9685 et suiv., 2e partie) - ↑ Voyez le Dict. raisonn. de l’archit. franc., au mot Autel.
- ↑ Historia Anglor, t. V.
- ↑ Lib III, epist. 159.
- ↑ Cet autel est gravé dans le Glossaire d’architecture de M. Parker (Oxford, vol. I, p. 19) et décrit dans le Journal archéologique, vol, IV, p. 245. M. le docteur Rock a eu l’obligeance de nous laisser dessiner cet autel, que présente notre planche II.
- ↑ « Un autel beneoit, garny d’argent, dont les hors sont dorez à plusieurs souages, et la pièce dessouz est toute blanche, et la pierre est de diverses couleurs, et aux IIII. parties a IIII escuçons des armes Pierres d’Avoir, et poise l’argent environ IIII. mares, et poise en tout IX. marcs I. once. » (Invent. du duc d’Anjou.) Voyez dans le Gloss. et Répertoire par. M le comte de Laborde (Paris, 1853), au mot Autel portatif, un curieux catalogue d’autels portatifs extrait de divers inventaires.
- ↑ Descript. des objets d’art qui composent la collect. Debruge-Duménil, précédée d’une Introd. hist. par Jules Labarte (Paris, 1847, p. 737). M, le prince Soltykoff a bien voulu nous permettre de copier ce précieux meuble.
- ↑ Descript. des objets d’art qui composent la collect. Debruge-Duménil, précédée d’une Introd. hist, par Jules Labarte. Paris, 1837, p 737.
- ↑ Pendant son voyage en Portugal, J. de Lalain porte avec lui des coffres bahuts, brodés à ses armes. (Choix de chron., édit. Buchon, p. 664.)
- ↑ Voyez Brantôme, Vies des hommes et femmes illustres.
- ↑ Ce bahut provient de l’église de Brampton (Northamptonshire), et parait dater des dernières années du XIIe siècle. Nous le choisissons entre beaucoup d’autres, parce qu’il conserve encore la forme primitive du coffre de voyage. À cette époque, d’ailleurs, la différence entre les meubles anglo-normands et les meubles français n’est pas sensible.
- ↑ Manuscr. de la Bibl. nat., anc. fonds Saint-Germain, no 37. Psalm., XIIIe siècle.
- ↑ Registre des métiers et marchandises ; le Livre des métiers d’Étienne Boileau publié par G. B. Depping, 1837.
- ↑ Ibid., Ordonn. relat. aux métiers de Paris, titre XIII, 1250.
- ↑ Ce meuble fait partie aujourd’hui du musée de Cluny.
- ↑ Chron. de du Guesclin, vers 657 et suiv.
- ↑ Les exemples de ces sortes de meubles se rencontrent si fréquemment dans les collections publiques ou particulières, que nous ne croyons pas nécessaire d’en donner ici ; nous renverrons nos lecteurs aux ouvrages qui ont reproduit ces meubles.
- ↑ Hist. de saint Jean-Baptiste
- ↑ Relat. de ce qui s’est passé a la mort du maréchal d’Ancre (Journ. de Pierre Dupuy, 1659, Leyde, Elzevier)
- ↑ Lib. V.
- ↑ « … Et erat ante scamnum pane desuper plenum, cum diversis ferculir… »
- ↑ Ibid., lib. IX.
- ↑ Le Roman de Rou, 1re partie, vers 8273 et suiv.
- ↑ Le Roman de Rou, 2e partie, vers 1109 et suiv.
- ↑ Manuscr. de saint Cuthbert, University collège Library, Oxford. — Voyez d’autres exemples donnés dans Some Account of domestic Architecture in England, T. Hudson Turner. H. Parker, Oxford, 1851. — Voyez aussi la tapisserie de Bayeux, dite de la reine Mathilde.
- ↑ Tapisserie de Bayeux.
- ↑
« Déjoste lui les assist sor un banc
« Qu’iert entaillez à or et à argent… »Rom de Guill. d’Orange, prise d’Orange.) - ↑ Ces deux exemples sont tirés d’un manuscrit de l’Apocalypse appartenant à M. B Delessert (XIIIe siècle).
- ↑ Mém. d’Olivier de la Marche, conférences au sujet du Luxembourg, p. 398, édit. Buchon.
- ↑ Voyage paléogr. dans le départ. de l’Aube, par H. d’Arbois de Jubainvillo, 1855.
- ↑ Les paysans grecs se servent encore aujourd’hui de berceaux ainsi façonnés.
- ↑ Manuscr. latin, IXe siècle, Astronom., fonds Saint-Germain, no 434, Bibl. nat. Il faut remarquer toutefois que, dans cette vignette, qui représente la naissance du Saveur, le berceau est une crèche plutôt qu’un meuble d’un usage habituel.
- ↑ Mém. d’Oliv. de la Marche, mariage du duc Charles de Bourgogne avec Marguerite d’York. Édit. Buchon. p. 542, date 1474.
- ↑ Ibid.
- ↑ Gloss. et Répert., 2e partie. Paris, 1853.
- ↑ Manusc. IXe siècle, no 6-2, Bib. nat.
- ↑ Ivoire, couverture de manusc. moul., coll. de M. A. Gérente, XIIe siècle. Nous avons enlevé la figure de la sainte Vierge assise sur cette chaire, afin d’en mieux faire comprendre l’ensemble.
- ↑ Du linteau de la porte de droite de l’église Saint-Lazare d’Avallon, XIIe siècle.
- ↑ Guill. d’Orange, Li coronemens Looys, vers 2620 et suiv., édit de la Haye. Jonckbloet, 1854.
- ↑ Nous renvoyons nos lecteurs au Dictionnaire d’architecture, pour ces objets que nous considérons comme immeubles, aux mots Chaire, Stalle.
- ↑ Vitrail de la cathédrale de Bourges, commencement du XIIIe siècle.
- ↑ Du manuscrit de la Bibl. nat. ancien fonds Saint-Germain, no 37, XIIIe siècle. Nous avons donné à ces copies de meubles une apparence réelle que les vignettes ne présentent que grossièrement ; mais leur forme est parfaitement indiquée d’ailleurs.
- ↑ Toutes les personnes qui ont voyagé en Orient ont pu voir des meubles de ce genre, encore en usage aujourd’hui. On sait combien peu les Orientaux modifient les formes des objets usuels.
- ↑ Le Romuléon, hist. des Romains, man. XVe siècle. Bibl. nat., no 6984. « Comment une femme appelée Zénobie obtint l’empire, en partie, de Perse et de Syrie. » Ce meuble est donc celui d’un grand personnage.
- ↑ « Qui cum adfuisset (Rauching), priusquam eum rex suo jussisset adstare conspectui, datis litteris, et pueris destinatis cum erectione publica qui res ejus per loca singula deberent capere… » (Grég. de Tours. Hist. Franc., lib. IX.)
- ↑ Gloss. et Répert., par M. le comte de Laborde, 1853.
- ↑ Manuscr. Bibl. nat., anc. fonds Saint-Germain, no 37 XIIIe siècle.
- ↑ Le Roman de la Rose, descrip. du char de Vénus. Édit. de M. Méon (Paris, 1814),
t. 111, p. 83. - ↑ Manteau.
- ↑ Capote pour monter à cheval.
- ↑ Poésies morales et hist. d’Eust. Deschamps, édit. Crapelet, un vol. Paris, 1832
p. 207. - ↑ Manuscr. du XIVe siècle, Domest. Archit. of the middle ages. Oxford, J. H. Parker.
- ↑ Manuscr, du XVe siècle, no 6984, Bibl. nat.
- ↑ D. Godefroy, le Cérémonial français ; 1649, t. I, p. 639 : Entrée de la reine Isabeau de Bavière à Paris (Froissart, liv. IV).
- ↑ Enterrement du duc Philippe de Bourgogne, 1467 (Mem d’Oliv. de la Marche).
- ↑ La Coche, poëme de Marguerite, reine de Navarre, man. du XVIe siècle, orné de onze miniatures. Biblioth. de M. J. Pichon, prés, de la Soc. des bibl. franç.
- ↑ Lib. IV.
- ↑ « Cui tanta fuit cupiditas, ut arcas juberet fieri ferreas, in quas numismatis aurei talenta congereret. »
- ↑ « Reseravit arcam… »
- ↑ Grég. de Tours, Hist. Franç., lib. IX.
- ↑ « … Et inveni in hoc capsulam argenteam, in qua… » (Ibid., lib. X.)
- ↑ Mém. concernant l’hist. civ. et ecclés. d’Auxerre et de son ancien diocèse, par l’abbé Lebeuf, édit. 1848, t. I, p. 72 et suiv.
- ↑ Sculpture de l’un des chapiteaux de la crypte de l’église de Saint-Denis en France. Ces chapiteaux appartiennent à la construction conservée par Suger, et paraissent être du commencement du Xe siècle.
- ↑ Dubreuil, liv. III, châsses de Saint-Merry.
- ↑ Félibien, Hist. de l’abbaye roy. de Saint-Denis, 1706.
- ↑ Voyez le Dict. d’architect. du XIe au XVIe siècle, art. Autel, fig. 15 et 16.
- ↑ Annales archéol. par Didron, t. V, p. 189.
- ↑ « La première châsse de sainte Aure, abbesse, n’était que de bois et de verre… » (Dubreuil, Ant. de Paris, liv. I)
- ↑ Cette châsse faisait partie de la collection de M. le prince Soltykoff.
- ↑ Mélang. archéol. des RU. PP. Martin et Cahier.
- ↑ Ce dessin est exécuté à l’aide de la gravure de cette châsse, donnée par D. Bouillard dans son Hist. de l’abbaye roy. de Saint-Germain des Prés.
- ↑ Le marché passé par l’abbé Guillaume avec Jean de Clichy, Gauthier Dufour et Guillaume Boey, orfèvres à Paris, est donné tout au long dans les pièces justificatives de l’Hist. de l’abbaye roy. de Saint-Germain des Prés de dom Bouillard. Cette pièce est fort curieuse.
- ↑ Voyez l’inventaire de cette châsse et de ces bijoux dans le Bullet. des Comités histor. ; janvier 1851. Les camées et intailles qui garnissaient cette châsse ont été, en 1793, envoyés à la Bibliothèque nationale ; ils y sont encore déposés.
- ↑ Eust. Deschamps.
- ↑ L’Hist. du châtelain de Coucy et de la dame de Fayel, vers 7607 et suiv., édit. de
Crapelet, 1829. - ↑ Nous devons encore à l’obligeance de M le prince Soltykoff d’avoir pu dessiner ce précieux meuble.
- ↑ L’Hist. de Palanus, comte de Lyon, manuscr. de la Bibl. de l’Arsenal.
- ↑ Nous avons vu encore un auguste personnage qui ne voyageait qu’avec son lit, et qui eût mieux aimé passer la nuit dans un fauteuil que de se coucher dans un lit qui n’eût pas été le sien.
- ↑ Voyages dans le midi de la France, par Millin, 1807. Atlas.
- ↑ Ce charmant coffret est reproduit avec beaucoup d’exactitude dans les Monuments de Seine-et-Marne, par MM. A. Aufauvre et G. Fichot, in-fo. Melun, 1854.
- ↑ Ce coffret, qui date du XIVe siècle, faisait partie de la collection de M. A. Gérente ; il est de fabrication rhénane. Il faut dire qu’à cette époque les provinces de l’est de la France et l’Allemagne fournissaient beaucoup de ces menus objets sculptés en bois.
- ↑ Nous devons ce petit meuble à M. Alaux, architecte de Bordeaux. Les dimensions de ce coffret sont : longueur, 0m,17 ; largeur, 0m,13 ; hauteur, 0m,10.
- ↑ Le dessin de ce coffret nous a été donné par M. Révoil, architecte à Nîmes.
- ↑ Le Roman des sept Sages, manuscr. Biblioth. nat., fonds Saint-Germain, no 1672.
- ↑ Le Roman de la Rose, vers 1403, édit. de Méon.
- ↑ Un coussin d’étoffe d’or.
- ↑ Chron. de Bertrand du Guesdin, vers 6931 et suiv.
- ↑ Manusc. fonds la Vallière, no 92.
- ↑ Voyez le Dictionn. de l’architecture franç., au mot Piscine.
- ↑ Ibidem, au mol Autel.
- ↑ Il était d’usage, chez les grands, de servir les mets couverts jusqu’à l’arrivée des convives ; d’où est resté l’habitude de dire mettre le couvert. (Voy. Gloss. et Répert. de M. le comte L. de Laborde.)
- ↑ C’est celui qui est placé sur la colonne engagée à la droite de la porte centrale.
- ↑ Saint Pierre, dit une légende, apparut à saint Antoine dans le désert, et partagea un pain avec lui. Ce même sujet se retrouve sur un des chapiteaux du XIe siècle de la nef de la même église.
- ↑ D’un manuscrit de la fin du XIIIe siècle, de l’Apocalypse, appartenant à M. B. Delessert.
- ↑ Manuscr. de la Biblioth. nat., no 6984.
- ↑ Exécutées au commencement du XVIe siècle, ces stalles reproduisent, dans leurs sculptures, des meubles qui appartiennent plutôt au XVe siècle.
- ↑ Ce dessin provient des mêmes sculptures.
- ↑ Cap. XIX.
- ↑ Voyez la Descript. hist. des maisons de Rouen, par E. Delaquérière, l. I, p. 430. et t. II, p. 1G8.
- ↑ Manuscr. de la biblioth. du Corps législatif, Bible française, no 35 ; date, 1290.
- ↑ Manuscr. le Miroir historial de Vincent de Beauvais, Biblioth. nat., no 6731 ; date, 1423.
- ↑ Sauval, Pièces justific., p. 246.
- ↑ Manusc. de Froissart, Biblioth. nat., fonds Colbert, no 8323, XVe siècle.
- ↑ Mém. concernant l’hist. civ. et ecclés. d’Auxerre, par l’abbé Lebeuf, t. I, p. 261.
- ↑ L’Entrée triomphante de LL. MM. Louis XIV et M. Thérese d’Austriche, etc. Paris, 1662, pet. in-fo. Voyez la gravure, IIe part., p. 29.
- ↑ Du manuscr. le Romuléon, Biblioth. nat., no 6984.
- ↑ Variante : « En bière et bien couvert droitement à Guingant. » (Chron. de Bertr.
du Guesclin, XIVe siècle, t. I. vers 6318 et suiv. Coll. des docum. inéd. sur l’hist. de
France) - ↑ Le Romuléon, manusc. de la Biblioth. nat., no 6984 : Convoi de César.
- ↑ Pour la sépulture de l’abbé de Saint-Ouen de Rouen, Jehan Marc-d’Argent, « furent achetés deux biaux draps d’or qui furent bordés de noirs cendaux ». Chron. de Saint-Ouen, recueillie par Franç. Michel, p. 24.)
- ↑ Ce drap est décrit et reproduit par la gravure dans le 2e volume des Annales archéol. de M. Didron, page 230. Les bandes blanches sont couvertes de têtes de mort, d’ossements et d’inscriptions, memento mori, brodés. Sur le fond noir sont brodés deux miroirs reflétant des crânes humains. (Voyez l’article de M. Bazin.)
- ↑ Du manuscr. de l’Hist. de Girard, comte de Nevers, Biblioth. nat., fonds la Vallière, no 92.
- ↑ Mortiers, chandelles de nuit, qu’on appelait aussi mortiers de cire.
- ↑ Alienor de Poictiers, les Honneurs de la cour.
- ↑ Alienor de Poictiers.
- ↑ Suivant Nicod, ce qui distingue le dressoir du buffet, c’est que le premier n’a jamais de tiroirs ni d’armoires à portes. Le dressoir ne sert qu’à étaler la vaisselle qu’on lire du buffet. « Jacquemart Canisset, charpentier, fait un crechoir à coulombe (à tablettes ou compartiments) pour l’hôtel de ville de Béthune, au commencement du XVIe siècle. » (Voy. les Artistes du nord de la France, par M. le baron de Mélicocq. Béthune, 1848.)
- ↑ « A Noël l’escrainier, pour II grans écrans d’osier ; à lui pour II petits écrans d’osier achetés pour la chambre du Roy et de Monseigneur de Valois. » (Compte des dépenses du roi Charles VI, année 1382.)
- ↑ Eustache Deschamps, le Miroir de mariage, XIVe siècle.
- ↑ Le Romuleon, manuscr. do la Biblioth. impér., no 6984.
- ↑ Pendant le dernier siècle encore, lorsque les hommes portaient tous des culottes et des bas de soie, on laissait, près de la cheminée des jambards ou sortes de bottes de carton ou d’osier, dont on avait le soin de s’armer pour se chauffer sans se rôtir les jambes.
- ↑ Eust. Deschamps, le Dit du jeu des dés, XIVe siècle.
- ↑ Manuscr. de l’Hist. de Girard de Nevers. Bibl. imp., fonds la Vallière, no 92, XVe siècle.
- ↑ Ibid.
- ↑ Pièce d’étoffe jetée sur un banc.
- ↑ Alienor de Poictiers, les Honneurs de la cour, XVe siècle.
- ↑ « Faldisrorium, sella plicatilis… » (Du Gange, Gloss.) — « Unam cathedram, quam faudestolam vocant… » (Matth. Paris, in Vitis abbat. S. Albini.)
- ↑ Mélang. d’archéol. par les RR. PP. Martin et Cahier, t. 1, p. 157. Et à la suite de la notice de M. C. Lenonnant, la gravure fidèle du fauteuil de Dagobert.
- ↑ Rational, lib. II, cap. xi.
- ↑ Guill. d’Orange, vers 2858 et suiv., édit. de la Haye, 1854.
- ↑ Le Lusidaire, manuscr.
- ↑ Bible manuscr., no 6-3, Biblioth. nat.
- ↑ Rational, lib. II, cap. xi.
- ↑ Bible franç., manuscr. de 1294, no 35, biblioth. du Corps législatif.
- ↑ Voyez les Mélanges archéol. des RR, PP. Martin et Cahier.
- ↑ Manuscr. d’Herrade de Landsberg, XIIe siècle, biblioth. de Strasbourg.
- ↑ Le Romuleon, manuscr. no 6984, Biblioth. nat., XVe siècle.
- ↑ Il existe, dans le musée de Cluny, une forme à trois places qui provient de quelque salle capitulaire probablement ; les siéges sont à bascule, avec miséricordes. Ce meuble date de la Renaissance ; mais il a certainement été recomposé en grande partie au moyen de divers fragments. Toutefois il est bon à consulter comme disposition générale. La forme présentée ici est prise de morceaux de boiseries placés aujourd’hui dans le chœur de l’église Saint-Audoche de Saulieu.
- ↑ « Ordo cereorum instar rastri circa altare Usus culturæ cenoman. Mss. accendatur omnes lampades ecclesiæ et rastrum ante et retro. » Consuet. Mss. S. Crucis Burdegal. ante anno 1305 : « Debent portari cadavera familiarium per quatuor familiares dicti monasterii coram altari B. M. V. extra januaria ejusdem altaris, et rastellum ejusdem altaris debet compleri de candelis. » (Du Gange, Gloss.)
- ↑ Voyages liturg. en France, par le sieur de Mauléon, p. 44.
- ↑ Voyages liturg. en France, par le sieur de Mauléon, p. 46.
- ↑ Ancien fonds Saint-Germain, no 37, XIIIe siècle, Biblioth. nat.
- ↑ Mss. des Miracles de la sainte Vierge, biblioth. du sémin. de Soissons (XIVe siècle) : « Du cierge qui descendi sus la viele au vielceus devant lymage Notre-Dame. »
- ↑ Hist. de Bourgogne, par dom Plancher, t. 1, p. 48.
- ↑ Vers 21288 et suiv.
- ↑ Mém. d’Olivier de la Marche, liv. II.
- ↑ Eust. Deschamps, le Mirouer de Mariage, XIVe siècle.
- ↑ Évangile selon saint Jean.
- ↑ Vol. II, p. 81, édit. de 1741.
- ↑ Vol. III, p. 207, Rapport de Pierre le Chantre, Abréviat., chap. xxxix.
- ↑ « Item trois lampiers d’argent pendans devant la grant porte. » (Invent. de la sainte Chapelle de Paris, 1376, Bibl. nation. — « Lampadarium, candelabrum sustinendis lampadibus in Ecclesiis. » (Bulle d’Innocent VIII : voy. du Cange, Gloss.) Dans l’antiquité romaine, toutefois, les mots « lampadarius, lampas », s’appliquaient dans certains cas, non point à des luminaires contenant de l’huile, mais à des candélabres portant des bougies de cire.
- ↑ Paul le Silentiaire, Descript. de Sainte-Sophie.
- ↑ Ibid. — Voyez la savante dissertation du R. P. Cahier, dans les Mélanges d’archéologie, vol. III, p. 1, sur la couronne de lumières d’Aix-la-Chapelle.
- ↑ L’invasion française fut cause que ces statuettes, ainsi que la dentelle d’argent qui garnissait le milieu des bandes de cuivre, ont été enlevées.
- ↑ Vol. III.
- ↑ Morel, Notice sur la cathédrale de Toul.
- ↑ Voici le titre de ce curieux manuscrit : Recherches de plusieurs singularitez par Françoys Merlin, contrôl. gén. de la maison de feu Mad. Marie, Eliz., fille unique du feu roy Charles dernier que Dieu absolve. Portraictes et escrites par Jac. Cellier, demourant à Reims. Commencé le 3e jour de mars 1583 et achevé le 10e sept. 1587. Biblioth. nat., S. F., no 153.
- ↑ Voyez le Rapport de M. de Caumont sur les couronnes de lumières de Hildesheim (Bull. monum., vol. XX, p. 289).
- ↑ Voyez, dans le même rapport, un croquis de cette seconde couronne, fait sur une gravure de M. le docteur Kratz.
- ↑ Du bas-relief de la porte Sainte-Anne, à Notre-Dame de Paris, XIIe siècle.
- ↑ Voyez la Bible d’Alcuin, Brit. Mus.
- ↑ Voyez Roma subterranea, tab. secund. cœmeterii Potiani via Portuensi, une croix peinte sur les bras de laquelle sont posés deux flambeaux.
- ↑ Voyez l’article Cheminée dans le Dictionnaire raisonné d’architecture.
- ↑ Nous avons encore vu cet usage conservé dans quelques campagnes de l’ouest et du centre de la France.
- ↑ Il existait encore, il y a quelques années, des landiers à deux réchauds dans une cuisine dépendant de l’hôtel de la Poste à Saulieu ; on en trouve un assez grand nombre dont les deux branches supérieures sont conservées, mais dont les réchauds ont été enlevés, dans les provinces du centre de la France.
- ↑ Depuis lors nous avons recherché cette paire de landiers qui était d’une assez belle exécution, afin de l’acheter pour le musée de Cluny ; mais nous n’avons pu savoir ce qu’elle était devenue : il est probable qu’elle aura été, comme tant d’autres anciennes pièces de forges éparses dans nos petites villes de province, vendue avec de vieux fers.
- ↑ Les ruines de l’abbaye de Beauport (Bretagne) possèdent encore une de ces grandes niches, surmontée d’une triple arcature supportée par des culs-de-lampe. M. Alf. Ramé nous a fourni un dessin de cette niche.
- ↑ Ce dessin, qui a 25 centimètres de long, et bien exécuté, se trouve dans le tome Ier des Épitaphes des églises de Normandie, p. 53, Biblioth. Bodl. Oxford.
- ↑ Henri III et deux de ses mignons.
- ↑ L’Isle des Hermaphrodites, pour servir de supplément au Journal de Henri III. Cologne, 1624.
- ↑ D’Aubigné, croit-on.
- ↑ Livre VII, p. 15.
- ↑ Eginhard, Hist. de Charles
- ↑ Chron. de Benoît de Sainte-More.
- ↑ Li Romans de Brut, XIIe siècle, vers 10609 et suiv. On ne peut mieux faire que de donner ce passage, qui peint vivement l’animation de la foule, le jour de la fête, et qui, d’ailleurs, est plein de curieux détails.
- ↑ S’emparer des hôtels.
- ↑ Les maréchaux font les logis.
- ↑ Ceux qui ne peuvent trouver de logements se mettent sous des tentes.
- ↑ Paissons, littéralement lieux de pâture, mais ici doit s’entendre comme fourrage ;
paissons fichier, fourrage fiché, mis dans les râteliers, ou peut-être posé sur des fourches,
ainsi que cela se pratiquait en campagne. - ↑ La cérémonie du couronnement se fait dans le palais du roi, Artur est ensuite conduit
à l’église. - ↑ Comme le roi, la reine est couronnée dans ses appartements, avant d’aller à l’église.
- ↑ Voyez le Formulaire des sacres et couronnemens des roys (Godefroy, Cérémonial françois, 1649).
- ↑ A l’occasion du sacre de Louis le Gros, Suger, dans la Vie de ce prince, s’exprime ainsi : « … L’archevêque oignit de l’huile sainte le seigneur Louis, célébra la messe d’actions de grâces, ôta au jeune roi le glaive de la milice séculière, lui ceignit celui de l’Église pour la punition des malfaiteurs…, etc. « (Suger, Vie de Louis le Gros, chap. XIII)
- ↑ La Chronique de Rains, chap. I, manuscr. de la Biblioth. nation., publ. par L. Pâris, Techener, 1837.
- ↑ Rubriq. et chapitres du bon roy Philippe, fils de Mgr saint Louis (Coll. des mém. relatifs à l’hist. de France, de MM. Michaud et Poujoulat, t. II, p. 158).
- ↑ Voy. Domestic Architect., by T. Hudson Turner, t. I, p. 64. Oxford, Parker, 1851.
- ↑ Comptes de maître Robert. Voy. Domestic Architect., thirteenth century, General Remarks, p. 65.
- ↑ Voyez les Comptes de l’argenterie des rois de France au XIVe siècle, publ. par L. Douët d’Arcq. Renouard, 1851.
- ↑ L’Apparition de Jehan de Meun, par Honoré Bonet, prieur de Salon, xive siècle. Publ. par la Société des Biblioph. franc., 1858.
- ↑ Le Ménagier de Paris, composé vers 1393 par un Parisien pour l’éducation de sa femme. Publ. pour la première fois par la Société des Biblioph. franc., 2 vol., 1857.
- ↑ Tome I, art. vii, p. 169 et suiv.
- ↑ Voyez la note, tom. I, p. 173, le Ménagier.
- ↑ Tome I, p. 175.
- ↑ Chron. anglo-normandes, Recueil d’extraits et d’écrits relat. à l’hist. de Normandie et d’Angleterre. Publ. par Francisque Michel, t. III, p. 79.
- ↑ Tirer l’eau du puits.
- ↑ Panser mes chevaux.
- ↑ Voyez la Relat. de deux voyag. arabes ou IXe siècle, trad. par Renaudot. — Hist. du commerce entre le Levant et l’Europe. Depping. 1830.
- ↑ Voyez les Entretiens sur l’architecture, t. I.
- ↑ Biblioth. de Strasbourg. Brûlé par les Allemands.
- ↑ Une seule citation entre mille. Henri de Campion, bon gentilhomme, brave, excellent homme au fond, plein de droiture et d’honneur, dit, dans ses Mémoires, lorsque le duc de Longueville, auquel il s’était donné, rompt avec les princes : « Il avoit (le duc de Longueville) alors changé de projet, pour quelques mécontentemens qu’il eut des Princes, qui refusèrent de lui accorder des choses qu’il souhaitoit d’eux pour se déclarer » (c’est-à-dire pour concourir avec eux à faire entrer les troupes espagnoles sur le territoire français). « Il envoya à la cour le sieur de la Croisette, qui négocia si bien, que le duc (de Longueville) s’engagea entièrement dans les intérêts du roi. J’ai toujours eu une telle passion pour le maintien des lois, que je ressentis une extrême joie de cet arrangement, quoique je jugeasse que je ferois plutôt fortune dans l’autre parti. » Il est difficile de se réjouir plus naïvement de ne pas être traître à son pays. Remarquons, en passant, que ce même Henri de Campion, bien qu’il trouvât le procédé vif, était un des gentilshommes du duc de Beaufort qui devait assassiner le cardinal Mazarin dans sa voiture (voy. Mém de Campion, Jannet, 1857). Cela ne se passe pas sous Philippe-Auguste, mais au milieu du XVIIe siècle.

