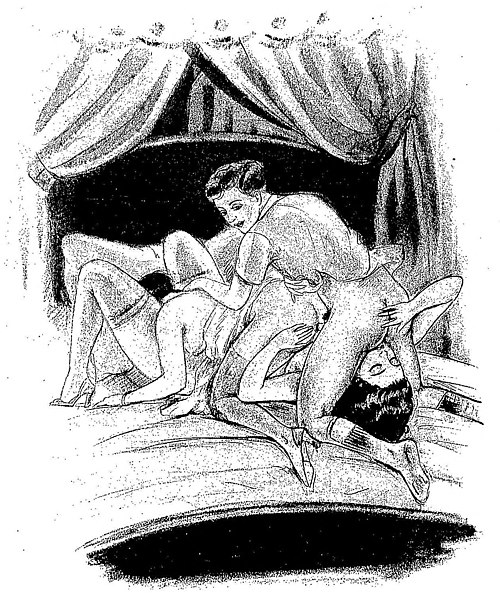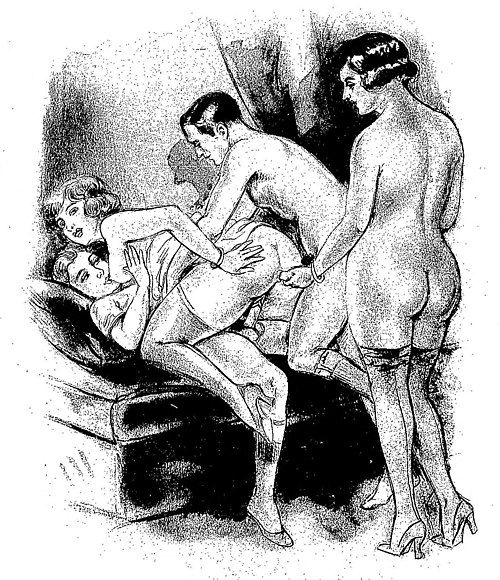Le roman de la luxure/La Veuve amoureuse
(Volume 3, p. 5-128).
LA VEUVE AMOUREUSE
Nous flânâmes trop longtemps en route et n’arrivâmes à l’école qu’à dix heures. Le pasteur nous ordonna sévèrement d’aller l’attendre à midi dans son cabinet particulier. Nous savions ce que cela signifiait : une bonne fessée, pendant que le pasteur se réjouirait au compte rendu de nos succès.
À midi nous entrâmes dans la chambre du pasteur, où il vint nous rejoindre immédiatement. Il nous gronda beaucoup d’être arrivés en retard, et nous dit qu’il avait l’intention de nous fouetter tous deux pour cette faute et probablement aussi pour les débauches qu’il supposait.
Nous vîmes immédiatement qu’il fallait nous résigner ; de temps en temps il aimait réellement à fouetter quelqu’un, et il n’y avait pas à douter qu’il était dans un de ces moments ; nous savions aussi que cela finirait par une orgie, quand nous l’aurions suffisamment excité par le récit détaillé de nos fouteries qui devaient certainement avoir eu lieu. Il nous fit déshabiller, et ayant décidé de commencer par Henry, il le fit monter sur mon dos. Quand tout fut prêt, il commença par appliquer sur le derrière d’Henry des coups véritablement très violents, en disant :
— Alors, jeunes gens, vous avez séduit votre cousine, n’est-ce pas ?
Vrsh !… Vrsh !… Vrsh !…
— Et c’est là toute votre excuse pour manquer l’école ?
— Je croyais vous avoir déjà suffisamment fouetté pour vous enlever cette envie de foutre votre cousine.
Vrsh !… Vrsh !… Vrsh !…
Le pauvre Henry souffrait réellement.
— Oh ! monsieur, je ne le ferai plus jamais sans votre permission.
— Ma permission, vraiment !
Vrsh !… Vrsh !… Vrsh !…
Le pasteur, pendant quelque temps, fouetta vraiment très cruellement jusqu’à ce que la peine se changeât en plaisir ; la pine d’Henry se mit à bander, se frottant contre mes fesses chaque fois que le pasteur lui appliquait un coup de verge. En voyant cet effet attendu, le pasteur se relâcha de sa sévérité, et changeant sa verge de main, il ne s’en servit plus après que pour chatouiller ce joli derrière et le maintenir dans un certain excitement. Prenant dans sa main le vit tout raide, il dit :
— Ainsi voici l’oiseau qui a fait tout le mal.
Il branla un peu, se courba et se mit à sucer.
— Ah ! oui, je sens qu’elle a encore le goût du con, elle sent absolument cette odeur ; ainsi tu l’as encore fait ce matin ? Dis-moi comment cela est arrivé.
Henry se leva alors et se tint debout devant le pasteur qui lui pelotait son vit toujours bandant.
— Allons, raconte-moi.
— Eh bien, monsieur, pendant que Charles était occupé avec maman…
— Oh ! en est-il vraiment ainsi ? s’écria le pasteur, il nous dira tout alors lui-même tout à l’heure, continue.
— Je me glissai dans la chambre d’Ellen, mais elle fit quelques difficultés dans la crainte que maman ne nous surprenne ; mais je la conduisis devant la chambre de Charles et lui fis voir maman qui s’enfilait sa grosse pine. Elle fut stupéfiée de son extraordinaire grosseur, mais voyant avec quelle aisance et quel plaisir maman s’en accommodait, elle pensa que la mienne, qui était plus petite, ne lui ferait pas de mal, et elle me laissa faire. Cependant je la fis crier et saigner quand j’atteignis sa virginité. Elle essaya de me repousser, mais j’étais trop fermement enfoncé, et je la foutis complètement deux fois avant de me retirer ; je lavai son con, y appliquai un peu de glycérine, et je l’ai encore fait ce matin sans lui faire aucun mal. Elle y prit tant de plaisir, qu’elle embrassa et suça mon vit, me fit décharger dans sa bouche et me demanda de tirer avec elle un dernier coup.
— Sur mon honneur ! s’écria le pasteur, voilà une jolie affaire ! Maintenant suce ma pine comme elle a sucé la tienne.
Henry obéit jusqu’à ce qu’elle devint raide. Il cessa alors et ce fut à mon tour de monter sur le dos d’Henry. Je savais que je serais fouetté avec force, car je voyais le pasteur assez excité pour chercher à l’être encore davantage. Il me demanda d’abord comment j’avais pu arriver à mes coupables actions. Je lui répondis que je n’avais fait que suivre son conseil de lui laisser voir ma pine, ce que j’ai fait et qui me réussit à merveille. Vrsh !… Vrsh !… Vrsh !…
— Est-ce que tu penses avoir commis là une faute innocente ?
— Oh ! oui, épargnez-moi, monsieur, ne frappez pas si fort.
Vrsh !… Vrsh !… Vrsh !…
— T’épargner, vraiment ! Dis-moi, baise-t-elle bien ?
— Oh ! monsieur, d’une manière admirable.
Vrsh !… Vrsh !… Vrsh !…
— Combien l’as-tu fait de fois ?
— Je ne puis vraiment pas le savoir, monsieur, nous avons été après toute la nuit et encore ce matin.
— Est-ce qu’elle t’a sucé la pine ?
— Oh ! oui, monsieur.
Vrsh !… Vrsh !… Vrsh !…
— Qu’est-ce qu’elle en pense ?
— Elle a dit que c’était la plus belle qu’elle eût jamais vue et que je devais la réserver pour elle seule.
— C’est bien, en voilà assez, maintenant, suce-moi la pine comme elle a sucé la tienne.
Il arriva bientôt au dernier degré d’excitement. Il fit prendre la verge à Henry en lui ordonnant de le fouetter ; je me courbai sur la table, il me branla et m’encula, répétant tout le temps le récit que nous lui avions fait de nos fouteries. Il nous renvoya aussitôt qu’il eut déchargé, car il avait satisfait ses désirs.
Peu de temps avant les vacances de Noël, Mme Dale me raconta, pendant que j’étais couché avec elle un samedi soir, qu’elle croyait, d’après l’arrêt subit de ses menstrues, qu’elle était enceinte par la faute de ce terrible bébé, en disant cela elle caressait mon énorme vit qu’elle avait pris dans sa main, mais qui était mou et inerte.
— Oh ! ma chère maman, est-il vraiment possible ?
Ma pine se redressa enflammée à cette idée et je fus sur elle en un instant ; nous tirâmes alors le coup le plus délicieux et nous mourûmes dans des délices de volupté. Étant un peu calmés, maman commença à discuter sur les probabilités et sur ce qu’il faudrait faire si ses craintes se réalisaient. Elle m’expliqua alors que pour le moment elle ne pouvait pas être certaine, mais en se rappelant son évanouissement de la première nuit et la cessation de son écoulement mensuel, dont elle m’expliqua la nature (pensant que je n’étais pas au fait de tout cela), elle avait bien peur que ses craintes ne fussent que trop fondées. Cela l’obligerait d’aller au loin, lorsqu’elle serait assez avancée pour ne pouvoir plus cacher son état ; mais elle ajouta que nous ne devions pas nous tourmenter de tout cela jusqu’à ce que nous ayons un résultat plus certain.
Cependant cette idée m’enflamma à nouveau et nous nous jetâmes encore et encore dans les extases de la passion de toutes sortes et de toutes manières, spécialement en nous suçant tous deux mutuellement jusqu’à ce que, complètement vidés tous deux, nous nous abandonnâmes aux bras de Morphée.
Dès le matin, après un sommeil réparateur, nous renouvelâmes nos exploits de la nuit. Plusieurs fois dans la journée du dimanche nous nous retirâmes dans la chambre de maman pour le même motif et nous eûmes encore une nuit très voluptueuse avant de nous séparer le lundi matin.
Le dimanche suivant, après une nuit de bonheur, nous allâmes tous à l’église, où nous n’avions pas pu nous rendre le dimanche précédent à cause d’une pluie diluvienne, et après le service nous nous dirigeâmes vers le presbytère pour luncher. Là, dans le courant de la conversation, Mme Dale nous dit qu’elle se proposait d’aller passer quelques jours à Londres pour affaires et qu’elle avait l’intention de partir jeudi prochain qui était le lendemain du jour où nos vacances finissaient.
Elle ajouta qu’elle voulait emmener son fils avec elle à Londres. Le pasteur fit alors observer que lui aussi était obligé d’aller à Londres, pour voir un gentleman qui avait l’intention de mettre son fils en pension chez lui et si Mme Dale voulait remettre son départ à samedi, il serait heureux de lui servir de compagnon de voyage.
Cette proposition fut acceptée, et ma chère tante qui devinait ce qui devait en résulter et qui avait un violent caprice pour Ellen, désirant jouir de ses jeunes charmes et la gamahucher, fit la proposition que, puisque la chère enfant resterait toute seule à la maison, elle serait très heureuse si elle voulait accepter son invitation et occuper la chambre à coucher contiguë à la sienne, pendant l’absence de Mme Dale. Cette dernière qui ne se doutait nullement de mon intimité avec sa chère nièce, pensant du reste que la présence de ma tante serait une sauvegarde suffisante, sauta sur cette invitation et exprima sa reconnaissance et ses remerciements pour une aussi aimable proposition de la part de ma tante.
Je n’ai pas parlé d’Henry pendant tout ce temps, mais cela coule de source que pendant que j’étais occupé avec sa mère à des passe-temps amoureux, il faisait de même avec Ellen ; et je dois même ajouter qu’une fois ou deux je pus saisir l’occasion favorable pour gratifier la lascive créature de ce qu’elle appelait une réjouissance de ma splendide pine. Elle fut naturellement ravie de la proposition de ma tante, car elle prévoyait qu’elle m’aurait pour elle seule pendant plus d’une semaine ; elle m’expliqua tout cela par un singulier coup d’œil et quand, en partant, elle trouva l’occasion de prendre ma main, elle la pressa d’une manière des plus éloquentes. Ainsi tout le monde était enchanté, car Henry me dit quand nous fûmes seuls tous deux.
— Mon Dieu, Charles, je suis joliment content ; je te parie ce que tu voudras que j’aurai foutu ma mère avant de revenir. Tu sais combien j’aspire à entrer dans ce con ravissant qui m’a mis au monde ; quand j’ai entendu qu’elle m’emmenait avec elle, ma pine s’est mise à bander à en éclater.
Mon oncle était aussi très désireux d’enfiler Mme Dale, et ses désirs dans ce sens se trouvaient singulièrement favorisés par les arrangements convenus. La nuit suivante, comme j’étais couché avec lui et ma tante, pendant l’intervalle d’une gentille petite orgie où il m’avait enculé pendant que j’enculais moi-même ma tante, ne pouvant plus rien faire, il amena la conversation sur son futur voyage. Il exprima le plaisir qu’il ressentait de l’occasion qu’il allait avoir de satisfaire son désir et de posséder l’objet qu’il convoitait. Le vieux satyre fit aussi une allusion que cela lui donnerait l’occasion future de jouir des jeunes charmes de la nièce.
— Naturellement, toi et ma chère femme, vous vous arrangerez de manière à ce qu’elle ne soupçonne rien de notre entente à son sujet ; aussi laissez-moi vous suggérer une idée. Il faudrait que Charles se fasse surprendre par sa tante au moment où il commettra l’acte avec Ellen, qu’il s’empare de toi en te disant qu’afin que tu ne puisses pas raconter sa faute, il allait te faire participer de force à la scène ; tu devras t’échapper de ses bras, courir à ton lit où il devra t’attraper au moment où tu vas t’y glisser ; alors il poussera dans toi son énorme pine, tu crieras à l’aide et appelleras Ellen pour venir à ton secours ; elle viendra, mais je me tromperais bien si elle faisait autre chose que d’aider Charles à te maintenir. Tu devras paraître ensuite très offensée ; mais à la fin, conquise par la beauté et la grosseur de la pine de Charles, tu te réconcilieras avec lui et tu pourras partager leurs plaisirs.
Tels furent les conseils que nous donna cet homme admirable avec sa profonde connaissance du monde et du beau sexe, conseils que nous suivîmes de point en point, comme on le verra par la suite.
Cependant ma tante, excitée par cette perspective, avait pris ma pine dans sa bouche, elle la suça jusqu’à ce qu’elle fût très raide ; puis, montant sur moi, elle commença à se trémousser si bien, tortillant son admirable derrière, que cela enflamma à nouveau mon oncle. Trouvant que sa pine se tenait suffisamment raide, il s’agenouilla entre mes jambes et, à la grande satisfaction de ma chère tante, il lui donna le double plaisir d’être foutue par deux pines à la fois, l’une devant, l’autre derrière.
Mon tuteur avait désiré que je restasse avec mon oncle pendant les vacances et que je ne le quitterais tout à fait qu’à la fin de l’année scolaire. Je ne connaissais pas ses raisons à ce moment, mais je sus que lui-même alla voir ma mère, passa quinze jours à la maison et fit beaucoup attention à miss Frankland. Il annonça son désir de voir mes sœurs entrer en été dans une école de première classe à Londres, et voyant miss Frankland fort désappointée de ce projet, il lui demanda une entrevue, et mit à ses pieds son nom et sa fortune, exprimant le désir que, si elle l’acceptait, le mariage aurait lieu avant qu’elle ne se sépare de ses élèves.
Ceci était une trop belle proposition pour la refuser, et, après les grimaces d’usage, disant qu’elle n’était pas préparée à une pareille demande, elle demanda un ou deux jours pour réfléchir, et finalement elle accepta.
Je prévoyais de suite les jouissances nombreuses que ce mariage me procurerait dans l’avenir ; quand je serais à Londres, j’aurais naturellement toutes les facilités pour jouir de cette admirable créature, et on verra dans le dernier volume de ces mémoires, quelles délicieuses orgies ce mariage amena. On peut être assuré que mon adorable maîtresse Benson, ainsi que la non moins lascive Egerton seraient les bienvenues par miss Frankland, devenue alors Mme Nixon ; on voit d’ici quels yeux glissera le comte sur les formes superbes de ces femmes, quand les deux femmes gamahucheront son énorme clitoris et que le comte et moi ferons tout notre possible pour satisfaire leurs passions lascives et lubriques. Mais on verra tout cela par la suite à sa véritable place.
Cependant le jour du départ de mon oncle et de Mme Dale avec Henry arriva enfin. Comme la voiture passait dans notre village, Mme Dale vint l’attendre à la maison, amenant avec elle Ellen qu’elle devait laisser au presbytère, comme c’était convenu.
Tout alla fort bien ; ils partirent, Henry monta à l’extérieur, et le pasteur et Mme Dale seuls à l’intérieur. Je pressai la main de mon oncle en lui lançant un regard d’intelligence qu’il me retourna, et bientôt ils furent loin.
Nous retournâmes à la maison et ma tante installa Ellen dans une chambre voisine de la sienne, ayant entre elles une porte de communication, dont s’était déjà servi mon oncle dans plus d’une occasion, comme je l’ai déjà fait remarquer.
Lorsqu’elles descendirent, ma tante prenant en pitié l’état dans lequel j’étais et qui se manifestait par une énorme protubérance de mon pantalon, nous dit :
— Ma chérie, il faut m’excuser, car j’ai à remplir quelques devoirs de maîtresse de maison ; mais Charles va vous montrer le jardin et vous distraira pendant une heure ou deux. Quand le lunch sera prêt, je ferai sonner la grosse cloche pour vous.
Ellen n’avait pas encore enlevé son chapeau, aussi, prenant son manteau, nous nous éloignâmes. On peut être assuré que nous ne perdîmes pas de temps pour atteindre le pavillon d’été, que l’on sait déjà être approprié pour les plaisirs de l’amour. Il y avait toujours un feu de préparé ; je l’allumai immédiatement ? mais comme il faisait un beau soleil et que la pièce était exposée au midi, il n’y faisait pas froid.
Pendant que j’étais occupé avec le feu, Ellen se débarrassa de son chapeau et de son manteau, et défit sa ceinture (elle ne portait pas de corset). Je la saisis dans mes bras et la portai sur le sofa, puis je retroussai ses jupes, admirant son ventre d’albâtre et son con qui était beaucoup plus garni de poils. Je me baissai et me mis de suite à la gamahucher. Elle était tellement excitée, qu’en moins de deux minutes, elle soupira profondément, pressa ma tête contre les lèvres de son con, et laissa couler son foutre doux et crémeux. Je bandais moi-même tellement fort que, sans prendre le temps de le lécher, j’approchai mon gros vit du charmant orifice, où je le plongeai d’un seul coup jusqu’aux couilles, faisant presque perdre à Ellen sa respiration. Mais elle se remit à l’instant et, avec toute la fureur de sa jeune lubricité, elle nous amena rapidement tous deux à l’extase finale dans laquelle l’âme et le corps semblent s’évanouir d’un plaisir trop grand pour que notre pauvre humanité puisse le supporter.
Nous demeurâmes enlacés l’un dans l’autre pendant un certain temps, et perdus pour tout ce qui nous environnait. Nous reprîmes enfin nos sens ; je me levai et dis que la prochaine fois nous ne devions pas manœuvrer aussi rapidement.
Le feu avait brûlé, et comme la chambre était petite, il y faisait une température très supportable et très douce ; aussi je priai Ellen de se dévêtir, je quittai moi-même tous mes habits, et nous pûmes bientôt nous admirer mutuellement dans toutes nos beautés naturelles. Quelques délicieux préliminaires précédèrent notre prochaine course, que nous ne commençâmes que lorsqu’il ne nous fut plus possible de nous retenir, et nous mourûmes encore dans tous les ravissements d’une luxure satisfaite, et nous tombâmes encore une fois dans cette délicieuse langueur qui suit les plaisirs amoureux. Nous procédâmes ensuite à un gamahuchage mutuel, et enfin une dernière fouterie termina la présente séance, car il était temps de s’habiller et de se tenir prêts pour le lunch.
Lorsque notre toilette fut finie, je la pris sur mes genoux et l’informai que la nuit je me glisserais sans bruit dans sa chambre, et qu’elle ne devait donc pas fermer sa porte à clef. Je la prévins aussi que nous devions faire le moins de bruit possible, parce que ma tante couchait dans la chambre voisine. Elle fut enchantée à cette idée de m’avoir entièrement à elle toute la nuit, me disant naïvement que je la faisais bien mieux jouir qu’Henry, que je semblais remplir tout son corps d’une volupté bien plus intense, et que maintenant qu’elle allait pouvoir jouir de moi toute la nuit, elle voudrait voir sa tante rester partie pendant un mois. La chère créature m’entoura alors le cou de ses bras et m’embrassa en fourrant sa douce petite langue dans ma bouche. On peut être assuré que je lui en fis autant, et ayant passé ma main sous ses jupons pour branler son charmant petit con, j’allais la porter sur le sofa, quand ma tante ouvrit la porte et arrêta nos manœuvres.
Elle ne parut pas s’apercevoir de la confusion d’Ellen, me demanda si je l’avais distraite, et nous dit de retourner à la maison où le lunch nous attendait. Nous obéîmes naturellement. D’un appétit féroce, produit par nos derniers exercices, nous fîmes honneur à un plantureux repas, et ma tante prenait bien soin de me faire boire beaucoup de champagne, car, comme on peut se l’imaginer, elle avait ses raisons pour cela. Elle m’ordonna ensuite d’aller dans ma chambre pour faire le devoir quotidien que mon oncle m’avait laissé et qu’elle était chargée de me faire faire.
Ellen, ma chère, dit-elle, vous devez pratiquer et étudier votre piano pendant une heure ou deux tous les jours.
Elle nous sépara ainsi. Je montai dans ma chambre, m’étendis sur mon lit et tombai dans un profond sommeil, mais, au bout d’une demi-heure, je fus réveillé par l’amoureuse étreinte de ma tante en chaleur. Elle se baissa et prenant dans sa bouche ma pine molle, et débandée, la fit rapidement raidir en la suçant suivant son habitude.
Aussitôt elle me pria de me lever et de me déshabiller ; elle était elle-même venue dans une lâche robe de chambre, elle la jeta loin d’elle et monta sur le lit, où elle se coucha entièrement nue, montrant complètement toutes ses ravissantes formes. J’étais aussi entièrement nu ; mais sachant qu’elle désirait une très longue fouterie, je me jetai sur son con et la gamahuchai, la faisant décharger deux fois avant de monter sur elle et d’introduire mon gros vit dans son con avide. Là encore, je jouai avec elle et ne déchargeai moi-même que lorsqu’elle eut payé deux fois sa contribution à l’amour. Je tirai ce coup sur son ventre, elle avait croisé ses magnifiques jambes sur mon dos, prenant ainsi son point d’appui pour se trémousser exquisement, car peu de femmes peuvent lui être comparées pour sa manière délicieuse de tortiller le derrière.
Après être restés un certain moment dans les extases de la langueur qui suit la jouissance, je me retirai pour lui permettre de se mettre sur les mains et sur les genoux pour la fouterie suivante, mais je profitai de la position pour la gamahucher et la faire encore décharger deux fois avant de retirer ma langue libertine. Puis, me retournant et contemplant avec ravissement ce beau et massif derrière comme je n’en ai jamais vu de pareil à aucune femme, je m’approchai tout près pour embrasser et lécher son divin orifice, la chatouillant à la rendre folle en introduisant ma langue à l’intérieur, et l’excitant tellement ainsi qu’elle me supplia de la foutre de suite. J’approchai mon ventre de son fessier, elle passa sa main entre ses cuisses, empoigna ma grosse saucisse et se l’enfila elle-même dans son con avide et brûlant. Je poussai avec fureur et d’un seul coup la lui enfonçai jusqu’aux couilles.
Cela excita tellement la chère créature, qu’après deux ou trois tortillements de son cul sur ma pine immobile et une pression intérieure qu’on aurait dit qu’elle voulait la déraciner, elle déchargea copieusement, poussant tout le temps des cris comme un lapin.
J’étais très content de la faire décharger plus souvent sans être moi-même obligé de lâcher mon foutre, car je voulais rester vigoureux pour la nuit promise à Ellen. Ma tante resta plusieurs minutes, palpitante et frissonnante, pressant toujours délicieusement ma pine, au point que je ne pus rester plus longtemps inactif quoique la vue de ces globes énormes palpitants et tremblants sous mes yeux, fût pour moi une satisfaction des plus grandes. Aussi me courbant sur elle, je passai une main par-dessous pour exciter son clitoris et de l’autre je m’emparai d’un de ses magnifiques, larges et fermes tétons et commençai à lui peloter les mamelles, action qui avait le pouvoir de l’exciter au plus haut point.
Cela réveilla toute sa luxure et la lascive créature déchargea encore une fois avant que je ne fusse prêt à la suivre. Le repos qui suivit permit à mon excitement de subsister et me permit de me retirer encore jusqu’à ce que son énergie fût revenue. Par ses pressions intérieures et ses tortillements, elle m’obligea à activer mes mouvements, mais cette fois j’étais bien déterminé à jouir des voluptés de son trou du cul.
Aussi quand elle fut en pleine chaleur, je déconnai subitement, et m’approchant de suite du divin orifice, je l’enfonçai d’un seul coup jusqu’aux couilles, coupant la respiration à ma tante ; mais elle la recouvra presque aussitôt et, comme elle aimait par-dessus tout à être enculée, je n’aurais rien pu faire qui satisfasse mieux ses passions lubriques.
C’était beau de voir l’énergie avec laquelle elle répondait à mes coups, ses fesses superbes, s’agitant avec une fureur surprenante, me donnant à chaque coup que j’enfonçai jusqu’à la garde les plus exquises étreintes.
Étant tous les deux terriblement excités, les choses ne furent pas pour nous amener à l’extase finale. On aurait dit que mon âme sortait par ma pine, quand je déchargeai avec fureur, au beau milieu de ses entrailles en poussant des cris de ravissement.
Quant, à elle, elle était tout à fait anéantie de bonheur ; elle tomba sans connaissance sur son ventre, m’entraînant dans sa chute, car l’étreinte qu’elle opérait avec son sphincter était trop forte pour pouvoir laisser sortir la plus petite chose qui aurait été dedans.
Nous étions insensibles à tout, excepté aux délicieuses langueurs qui suivent la jouissance. Nous jouissions de ces transes de bonheur, et quand ma chère tante recouvrit ses sens, elle me pria de me lever, car il était nécessaire qu’elle descende.
Je lui obéis, et quand elle fut debout, elle me prit dans ses bras, m’embrassa passionnément et me remercia de la divine jouissance que je lui avais procurée, avouant que je n’avais pas mon semblable dans le monde et que je devais bien la remercier pour me permettre de faire sentir à d’autres les jouissances exquises de ma pine. Elle ramassa sa robe et me laissa m’habiller.
Je descendis bientôt à mon tour et rejoignis Ellen qui me regarda comme si elle n’attendait qu’une occasion pour se faire foutre de suite. Mais après les combats que je venais de livrer tant avec elle qu’avec ma tante, et malgré la manière dont je m’étais retenu avec cette dernière, je ne me décidai pas à rien faire pour arriver à cette conclusion, surtout parce que je me proposais de passer la nuit avec elle.
Aussi lui assurant que nous nous ferions sûrement surprendre et que nous perdrions par notre imprudence les chances de la nuit, elle se trouva satisfaite et resta tranquille et raisonnable.
Ma tante entra et nous passâmes l’après-midi à causer de choses et d’autres et à nous promener dans le jardin.
Après dîner je m’endormis profondément sur le sofa. Les deux femmes, chacune pour la même raison, me laissèrent à mon profond sommeil et ne me réveillèrent que lorsqu’il fut temps de se retirer. Ainsi reposé, je me trouvais tout dispos pour le travail qui m’attendait.
Je laissai passer une demi-heure, attendant que tout le monde dans la maison fût retiré dans leur chambre à coucher, puis, enfilant une large robe de chambre, je me glissai doucement vers la chambre de ma chère Ellen, j’ouvris la porte et j’entrai.
Elle était déjà couchée, impatiente de me voir arriver ; elle avait laissé les deux bougies allumées et un bon feu donnait aussi une éclatante lumière. Je retirai ma robe de chambre et me précipitai aussitôt complètement nu dans ses bras impatients de me tenir. Nous étions tellement en chaleur tous deux que le premier coup fut tiré à la volée ; il fut suivi d’une langueur de satisfaction et d’une étreinte encore plus prolongée et enivrante.
Après nous être pénétrés de bonheur pendant un certain temps, nous nous levâmes ; je fis mettre Ellen devant le feu pour repaître ma vue de ses jeunes charmes. Les poils de son con étaient devenus plus longs et mieux fournis, ses tétons aussi s’étaient développés, même ses hanches et ses fesses paraissaient avoir grossi, grâce probablement à tous les arrosages qu’elle avait reçus depuis la première fois où je l’enfilai, ce qui naturellement devait la former comme une femme.
Cette inspection de ses charmes se développant, m’excita énormément et je voulus la foutre sur le tapis devant le feu. Afin de jouir davantage, j’approchai une psychée, dont je penchai la glace en avant, la dirigeant jusqu’à ce qu’elle puisse refléter le jeu du derrière d’Ellen pendant que j’allais la foutre.
Je m’étendis sur le dos, et la faisant mettre à genoux avec ma tête entre ses cuisses à portée de son con, je la gamahuchai jusqu’à ce qu’elle fit couler deux fois sa précieuse liqueur. Elle se pencha alors davantage jusqu’au dessus de ma pine qui était raide et frémissante de désirs. J’en guidai le bout vers ses petites lèvres roses, puis la faisant s’appuyer de tout son poids dessus, elle se trouva empalée jusqu’aux couilles, je la fis se lever et se baisser plusieurs fois, afin de pouvoir jouir de la vue de l’entrée et de la sortie de ma pine. Puis la tirant doucement sur moi, je passai un bras autour de sa taille mignonne, et tournant la tête, je vis que la psychée reflétait parfaitement son dos et son gentil petit derrière, ainsi que son con qui serrait étroitement ma grosse saucisse et par-dessous le tout son joli petit trou du cul rose.
De mon autre main libre j’entourai sa hanche et je mouillai son fondement avec le foutre qui sortait de son con et j’introduisis un doigt dans l’étroit chemin du bonheur. Son excitement devint furieux et ne connut plus de bornes. Les mouvements de son derrière étaient superbes à voir dans la psychée, je la laissai opérer toute seule, ce qui me permettait de me retenir un peu jusqu’à l’approche de la deuxième décharge, quand la chaleur de son con sembla m’enflammer de nouvelles forces ; alors les mouvements de nos deux derrières devinrent rapides et furieux et amenèrent de suite une exquise décharge qui nous laissa pantelants des passions sauvages que nous venions de satisfaire.
Nous restâmes longtemps entrelacés dans les bras l’un de l’autre, savourant les joies de notre jouissance. Nous levant alors, nous nous embrassâmes tendrement et regagnâmes le lit.
Je voulais l’exciter encore ainsi que moi-même pour un nouvel effort, mais elle me demanda grâce, disant qu’elle était tout à fait anéantie par nos jouissances du jour et de la nuit. Je n’en fus vraiment pas étonné, car je l’avais fait décharger cinq ou sis fois de plus que moi. Je ne regrettais pas non plus sa résolution, sachant que ma tante entrerait en lice le matin et qu’alors les deux ensemble m’épuiseraient complètement.
Nous nous réveillâmes assez tard après avoir dormi très profondément. Une chaise déplacée me prouva que ma tante était déjà entrée dans la chambre et que par conséquent elle devait déjà nous épier. Je découvris Ellen entièrement, de manière à pouvoir admirer ses jeunes charmes ; le besoin de se couvrir la réveilla ; elle me regarda amoureusement, et passant ses bras autour de mon cou pendant que je me tournais vers elle, elle approcha ma tête de la sienne et imprima sur mes lèvres un baiser passionné. Nos langues se cherchèrent, elle glissa sa main vers ma pine bandante et frémissante et l’empoigna aussitôt. Je montai sur elle et, plaçant mes genoux entre ses jambes, je m’apprêtai à l’enfiler, lorsque s’ouvrit la porte qui communiquait avec la chambre à coucher de ma tante. Cette dernière entra, poussa un cri de surprise des plus naturels, et s’écria à haute voix :
— Mon Dieu ! Qu’est-ce que je vois ! Qui aurait jamais pu se douter de cela !
Et soi-disant pour sauver Ellen, elle se rua en avant, me saisit par le bras et, facilitée par ma bonne volonté, me jeta hors du lit en disant :
— Je suis scandalisée au dernier point. Quelle horreur ! Comment as-tu pu commettre une telle faute et un tel crime de séduire une jeune fille qui est sous ma garde ? Couvrez-vous de suite, monsieur, et rentrez dans votre chambre.
Je répondis hardiment que je n’en ferais rien, mais qu’au contraire, comme elle avait troublé mon plaisir avec Ellen, j’étais décidé à le prendre avec elle.
— Comment osez-vous me parler ainsi, vilain garnement !
— Pas si vilain que cela, chère tante, regardez cette pauvre affaire muette, comme elle a envie d’entrer dans vous.
En disant cela, je la saisis par le bras comme pour la jeter sur le lit ; elle fit semblant de se débattre, tout en serrant tendrement dans sa main ma pine enflammée ; s’échappant alors, elle courut à sa chambre, essayant de me fermer la porte au nez, mais faisant en sorte de ne pas réussir, et se hâta de courir vers son lit. Je l’attrapai juste au moment où elle se baissait pour entrer dedans, et relevant sa chemise, le seul vêtement qu’elle eût, j’enfonçai d’un seul coup ma pine jusqu’aux couilles dans son con avide et tout en feu. Elle jeta un cri et appela Ellen pour m’empêcher de la violer. Ellen arriva, mais sagement ne put faire autre chose que de regarder la manière dont je faisais voir que j’étais un homme.
— Ellen, pourquoi ne le retirez-vous pas ? Il me viole ! Oh ! l’horreur, il commet un inceste !
Elle paraissait se débattre énormément, mais les tortillements de son cul ne faisaient que m’enfoncer plus avant dans son con, ce qui tournait à son profit.
— Oh ! Ellen, Ellen, venez à mon secours !
— Ah, non ! dit Ellen, je le laisse faire, car vous ne pourrez rien dire de nous.
Ma tante parut atterrée de cette réponse, elle se mit subitement à pleurer, plongeant sa tête dans le lit de désespoir et pour cacher ses larmes, mais me secondant tout le temps le mieux du monde. Comme la crise approchait, elle releva la tête en disant :
— Pardonnez-moi, Seigneur ! mais ce simple petit garçon me fait éprouver un plaisir plus grand que tous ceux que j’ai ressentis jusqu’à ce jour.
Elle se laissa alors aller à toute sa lubricité et nous arrivâmes à la crise avec la plus grande extase de volupté. Ma tante laissa tomber sa tête sur le lit, pendant que les étreintes intérieures de son con rendaient à mon vit sa raideur primitive. Elle sentit ses soubresauts et y répondit ; mais pensant alors qu’une répétition immédiate ferait connaître notre intimité précédente, elle tourna subitement sa figure et son corps, délogeant par ce mouvement ma pine, qui fit un grand bruit en sortant. Elle recommença à pleurer (les femmes pleurent quand elles veulent) et à me gronder pour l’horrible crime que je venais de commettre : c’était un véritable inceste de faire cela avec elle (et ses pleurs continuaient de couler).
Je jetai mes bras autour de son cou, voulant essuyer ses larmes par mes baisers, faisant retomber tout le blâme sur ma pine en fureur ; tout en parlant, j’avais pris sa main et la lui avais fait empoigner. Elle retira sa main rapidement, mais non sans l’avoir auparavant gentiment pressée. Elle me répéta que j’étais un horrible garçon, que je devais me retirer et la laisser seule avec Ellen pour pouvoir réfléchir à ce qu’il restait à faire dans une circonstance aussi épouvantable.
Ellen s’approcha alors, et l’embrassant tendrement, la supplia de ne pas me faire sortir.
— Je l’aime tant, chère madame, et j’ai si envie de le posséder maintenant, car cela m’a si excitée de le voir jouir de vous, que je mourrais si vous ne me laissiez pas le posséder de suite.
— Horrible ! Horrible ! dit ma tante, je croyais que j’étais arrivée assez à temps pour vous sauver.
— Oh ! non, il a couché avec moi toute la nuit et m’a possédée souvent déjà, mais il n’a pas été le premier, en sorte qu’il n’y a eu ni viol, ni séduction.
— Alors c’est vous qui l’avez séduit, petite vicieuse, car on n’a jamais vu d’enfant plus innocent que lui.
La pauvre Ellen, confondue de cette accusation, répondit que c’était une calomnie et qu’elle connaissait bien la personne qui m’avait séduit.
Ma tante crut un moment que c’était à elle qu’Ellen faisait allusion, car on doit se rappeler qu’elle s’imaginait avoir eu ma virginité.
— Qu’est-ce que vous entendez par là ? J’insiste pour que vous donniez des explications plus précises.
Ellen consentit disant que c’était Mme Dale qui m’avait eu la première, ajoutant :
— Elle avait vu par hasard comment Charles était supérieurement membré et n’avait pu résister au plaisir de lui apprendre à se servir de ce formidable pieu. Je les ai vus faire et c’est alors que je suis devenue moi-même avide de le posséder.
— Regardez, chère madame, comme il est beau ! Je suis sûre que si vous l’aviez connu aussi auparavant, vous n’auriez pu résister au désir de le posséder, essayez-en encore une fois et je suis sûre que vous nous pardonnerez et partagerez nos jouissances.
J’appuyai aussi ce bon avis ; ma tante parut effrayée de moi et sauta sur le lit. J’y sautai aussi, et l’attrapant autour de la taille, pendant qu’elle était sur ses mains et ses genoux, je la maintins dans cette position jusqu’au moment où m’agenouillant à mon tour derrière elle j’approchai ma pine pour la faire entrer en jeu. Tout en ayant l’air de résister, elle sut cependant se mouvoir assez habilement pour faciliter plutôt que pour empêcher l’introduction ; naturellement elle fut enfilée de suite, mais je restai immobile quelques minutes pour la laisser jouir de cette rapide introduction dont je la savais si friande. Elle avait plongé sa tête sur l’oreiller, disant :
— C’est horrible ! c’est horrible !
Ellen vint se pencher sur le lit pour l’embrasser, lui conseillant de ne pas résister, mais de m’accepter de bonne volonté, l’assurant qu’elle jouirait extraordinairement.
— C’est justement là ce qui m’horrifie, ma chère, car je n’ai jamais de ma vie ressenti quelque chose d’aussi exquis, mais quel péché ! avec mon propre neveu, c’est un pur inceste. Oh ! c’est épouvantable !
— Qu’est-ce que cela fait ? chère tante, car je veux aussi vous appeler ma tante, parce que vous êtes si superbe et si aimable. Oh ! si vous saviez quel plaisir j’ai éprouvé de vous voir possédée par lui, vous êtes une si belle femme que je voudrais être un homme pour vous posséder aussi.
Elle caressait les splendides tétons de ma tante, à qui rien ne pouvait faire plus plaisir, et elle lui demandait de lui permettre d’en sucer un ; ma tante l’autorisa et fut ravie ; elle glissa alors sa main vers le con d’Ellen, qui ouvrit les cuisses, et se mit à la branler avec ses doigts.
— Ah ! ma chère, si vous saviez comme j’aimais, à votre âge, à m’amuser avec mon propre sexe, remplaçant les hommes par nos langues, et encore maintenant j’aurais du plaisir à lécher un joli petit con rose comme celui-ci, cela me ferait presque oublier ce que ce vilain garçon est en train de me faire.— Oh ! ce serait charmant ! faisons-le de suite ! Charles va se retenir un moment pendant, que je vais me glisser sous vous, et pendant que vous me lécherez je pourrai vous exciter et voir le glorieux travail d’une grosse pine au-dessus de moi.
— Vous me tentez beaucoup, ma chère enfant, mais que dirait votre tante si elle apprenait cela ?
— Mais ma tante n’en saura jamais rien, répondit Ellen, tout en s’allongeant déjà sur le lit.
Ma tante se mit sur le côté pour permettre à Ellen de se mettre sous elle ; Ellen pria ma tante de quitter sa chemise afin qu’elle puissent bien sentir leurs deux corps nus ; ma tante n’attendait que cela, cependant elle fit quelques manières pour y consentir. À la fin elle obéit et s’allongeant sur Ellen, elle se jeta avec avidité sur le joli con placé sous ses yeux, et commença à le gamahucher « à mort ». Je repris de suite ma position.
Ellen guida ma pine dans le con brûlant de ma tante, lui branla le clitoris, lui travailla le cul avec son doigt, pendant que ma tante la gamahuchait. Nous arrivâmes bientôt tous à la grande crise avec un excès de luxure difficile à égaler. Nous étions tous un peu anéantis par cette jouissance et comme il était tard nous nous levâmes.
Ma tante me pardonna mon prétendu viol en raison des jouissances que je lui avais fait éprouver. Elle embrassa tendrement Ellen, lui disant qu’elle avait tellement eu de plaisir avec elle, qu’elle espérait bien renouveler bientôt cette petite séance. Prenant alors ma pine dans sa main, elle l’embrassa, la suça, ce qui la fit de suite bander et dit :
— Je ne m’étonne plus, ma chère, que vous l’aviez désirée après l’avoir vue, et j’envie Mme Dale d’avoir eu le plaisir de jouir la première d’une aussi monstrueuse chose. Si j’avais su qu’il était aussi prodigieusement pourvu, je doute fort d’avoir pu résister à la tentation de lui montrer à s’en servir. Mais ce qui m’étonne surtout c’est que votre jolie fente puisse avaler un pareil monstre.
Ellen se mit à rire, disant que son cousin Henry avait ouvert le chemin, qu’elle ne pensait pas elle-même qu’elle aurait pu me recevoir, mais que je le lui avais introduit si gentiment, et qu’une fois rentrée ma pine remplissait tellement bien de partout sa crevasse, qu’elle aurait beaucoup de chagrin si elle refusait de se l’introduire plus tard.
— Aussi, chère tante, j’espère que vous le laisserez nous la mettre à toutes deux. Je puis vous faire ce que vous venez de me faire, parce que avant que nous possédions Henry et Charles, ma tante et moi nous avions l’habitude de nous amuser de cette manière. Ma tante a un immense clitoris, elle peut le faire pénétrer un peu dans mon con, ce qui me procure toujours beaucoup de plaisir, et elle m’a avoué que je la suçais bien mieux que feu son mari ou qu’une demi-douzaine d’enfants, avec qui elle le faisait quand elle allait encore à l’école : aussi, ma chère tante, permettez-moi de vous le faire pendant que Charles m’enfilera et vous me le ferez ensuite pendant qu’il vous foutra à votre tour. Pensez seulement comme ce sera charmant !
— Oh ! chère petite putain, tu serais capable de séduire un ange.
Il fut convenu qu’Ellen viendrait pendant la nuit de sa chambre, moi de la mienne, et que nous nous rencontrerions dans le lit de ma tante. Pendant huit jours nous passâmes ensemble des nuits voluptueuses. Je fis voir à ma tante que je pouvais enculer Ellen, ce qui lui faisait éprouver un très grand plaisir et qu’avec raison elle éprouvait aussi les mêmes jouissances. Elle donna son consentement, faisant pour la forme quelques difficultés, et alors elle lâcha la bride à toute sa lubricité. Elle avait une grande passion pour Ellen, elles se gamahuchaient toutes deux « à mort ». Je n’en étais pas fâché, car cela me reposait d’un travail trop excessif.
Au bout de huit jours les absents rentrèrent. Mon oncle et Henry avaient pu tous deux satisfaire leurs désirs. Chacun me fit un récit détaillé des événements, mais comme leurs récits pourraient se répéter, je préfère les raconter sous forme de narration.
« Mon oncle et Mme Dale se trouvaient donc à l’intérieur de la voiture pendant qu’Henry était à l’extérieur. Mon oncle commença par faire l’éloge d’Henry, rappelant l’époque où il fut envoyé pour la première fois au presbytère, ainsi que la lettre que Mme Dale lui avait envoyée : il lui demanda avec un certain sourire si l’intimité, dont elle avait eu si peur, s’était renouvelée, parce qu’il avait remarqué qu’Henry était pâle et abattu chaque fois qu’il revenait le lundi de la maison et que toute la journée il était triste et stupide. Mme Dale parut alarmée en apprenant cela, et elle commença à penser qu’il devait probablement se passer quelque chose entre les cousins pendant qu’elle était occupée avec moi : mon oncle observait son malaise et se doutant de la raison, il dit :
« — Ma chère madame Dale, si quelque chose s’est passé entre eux et s’il en arrive quelque chose, je suis homme du monde et vous pouvez compter sur mon assistance et ma discrétion pour faire tout en mon pouvoir pour que cela n’arrive à la connaissance de personne.
« Elle le remercia, lui disant qu’elle serait heureuse d’accepter son aide s’il arrivait un aussi malheureux événement, mais elle espérait que cela ne serait pas.
« Mon oncle vit qu’il avait éveillé ses craintes, aussi il continua sur ce sujet : à la fin elle avoua qu’elle craignait qu’il ne se soit passé quelque chose entre les deux enfants, parce qu’elle s’était follement imaginé que ses idées premières à ce sujet étaient mal fondées et qu’elle n’avait pas pris autant de précautions qu’elle aurait dû.
« — Aussi, ma chère madame, je mets mes services à votre disposition s’ils sont nécessaires. À la vérité, je ne suis pas très collet monté, quoique je sois obligé de le paraître à cause de la position que j’occupe. Je suis certain que mon expérience me suggérera un moyen infaillible d’éviter le scandale s’il devait avoir lieu.
« Mme Dale le remercia chaleureusement ; le pasteur devint alors plus entreprenant par ses discours, disant que pour une aussi belle femme qu’elle, qu’il admirait et convoitait depuis longtemps, il ferait n’importe quoi.
« — Car, ma chère madame, quoique appartenant à l’église, il me reste encore quelque chose du vieil Adam, et la vue et la présence d’une personne qui m’a aussi charmé que vous l’avez fait, me rajeunit énormément.
« Passant alors son bras autour de sa taille petite et ronde, il l’attira à lui ; elle fit un peu de résistance, mais se laissa facilement embrasser : relevant avec son autre main ses jupons, il se mit à lui caresser son magnifique con, malgré la résistance qu’elle essaya d’opposer. Sentant son large clitoris en pleine érection, il vit que ses passions étaient excitées. Écartant ses jambes, il s’agenouilla entre elles et, comme il avait déboutonné son pantalon et que ce con nouveau avait fait son effet sur lui, il sortit sa pine enflammée et la lui enfonça de suite jusqu’aux couilles. À la fin elle déclara qu’elle ne pouvait lui permettre une chose pareille, mais elle tortillait en même temps son derrière à la perfection aussitôt qu’elle se sentit pénétrée par la pine du pasteur. Elle le seconda de son mieux, l’embrassant et lui fourrant sa langue dans la bouche. Les choses en arrivèrent à une conclusion rapide, à la grande satisfaction des deux parties. »
Après cela, il n’y eut plus de difficultés pour organiser des rencontres faciles à Londres. Il fut même entendu qu’ils logeraient dans la même maison et dans des appartements contigus. En arrivant à Londres, ils allèrent de suite visiter une de ces grandes maisons meublées de Norfolk Street, Strand, et furent assez heureux pour trouver des chambres à coucher libres au premier étage. C’était une maison double ou plutôt deux maisons ayant une entrée l’une dans l’autre. La chambre du pasteur se trouvait sur le devant et communiquait avec la chambre de derrière par une porte fermée à clef d’un côté et de l’autre par un verrou.
Mme Dale prit la chambre de derrière parce qu’il y avait un petit cabinet voisin avec un lit où Henry coucha. Le pasteur pouvait entrer facilement dans la chambre de la dame qui n’avait pour cela qu’à sortir son verrou.
Après réflexions, il fut cependant convenu qu’elle viendrait elle-même dans la chambre du pasteur, de manière à ce qu’Henry ne puisse entendre aucune des exclamations qui pourraient leur échapper au milieu de leurs jouissances amoureuses. Naturellement, le pasteur qui connaissait le grand désir d’Henry d’enfiler sa mère et d’y arriver d’une manière ou d’une autre avant de quitter Londres, communiqua à Mme Dale le désir qu’il avait de coucher avec elle cette nuit, en conséquence de quoi il pria Henry de différer son essai pendant la première nuit et qu’alors il l’aiderait de tous ses efforts.
Le malin pasteur se proposait bien, quand Henry aurait réussi, de devenir le futur compagnon de leurs débauches incestueuses. La chambre à coucher d’Henry était fermée par un de ces vieux loquets de fer qu’on clouait à la porte. Mme Dale l’enfermait quand il s’était mis au lit. Henry remarqua tout cela et sourit en pensant qu’il pourrait facilement sortir, mais comme il avait promis au pasteur de ne rien tenter sur sa mère cette nuit-là, il se coucha et s’endormit profondément.
La nuit suivante il fut convenu entre lui et le pasteur que, par des gamahuchages et des branlages, le pasteur amènerait sa mère à un grand degré d’excitement sans la satisfaire entièrement, de manière à ce que ses passions l’obligent à se faire foutre par n’importe quelle pine. À cet effet, le pasteur devait la garder avec lui jusqu’à la nuit. Henry épiait par le trou de la serrure, et dès qu’il vit sa mère entrer dans la chambre du pasteur, il fit jouer le loquet, ouvrit la porte et la referma. Il était prêt à tout événement, et si sa mère était étonnée de son entrée, il pourrait dire qu’il avait trouvé la porte ouverte, qu’elle avait sans doute oublié de la fermer. Il regarda alors tout ce qui se passa entre le pasteur et sa mère, puis, quand sa mère regagna son propre lit, il rentra dans sa chambre dont la porte resta légèrement entr’ouverte, il entendait sa mère se mettre sur le vase, et par la force du jet d’eau, il put juger qu’elle devait être très en chaleur. Il la vit se glisser sur son lit. Jetant alors sa robe de chambre et ses chaussettes, il ouvrit la porte et s’approcha du lit de sa mère. N’étant pas endormie, elle l’aperçut tout de suite.
— Henry ! qu’est-ce qui t’amène ici et comment as-tu ouvert la porte ?
— Je t’ai entendue remuer, chère maman, car je ne puis pas dormir à cause du froid. Je me suis levé, et comme la porte n’était pas fermée, tu as sans doute oublié de le faire, je suis venu te demander de me laisser me réchauffer dans ton lit bien chaud et tu feras bien plaisir à ton pauvre Henry. N’est-ce pas que tu veux bien, chère maman ?
— Si tu veux être tranquille et parler plus bas, car le pasteur pourrait t’entendre, tu peux venir ; tu me tourneras le dos et je te réchaufferai.
Henry ne perdit pas de temps pour se glisser à côté d’elle, et ayant réellement froid, grelottant même, il fit comme elle avait dit, il tourna son derrière qu’il approcha du ventre de sa mère.
— Pauvre enfant ! dit-elle, il est tout froid ; dors maintenant dans les bras de maman.
Naturellement, ce n’était pas là son intention. Aussitôt qu’il fut réchauffé, il tourna sa figure vers sa maman et lui murmura à voix basse :
— Oh ! comme j’aime ma jolie maman !
Pressant son ventre contre le sien, il lui fit sentir sa pine raide poussant contre son mont de Vénus.
— Henry ! à quoi penses-tu de m’étreindre de cette manière ! Ne savez-vous pas, monsieur, que je suis votre mère ?
Il avait saisi d’une main un de ses magnifiques seins, et il était vraiment dans un excitement extrême, ainsi qu’elle pouvait s’en apercevoir par la raideur de sa pine qui frémissait entre ses poils,
— Ma maman bien-aimée, si tu savais combien je t’aime et combien j’ai désiré d’embrasser ton joli corps.
— Finissez, impudent enfant, savez-vous que c’est un péché horrible de vouloir posséder sa mère. Quittez-moi tout de suite.
— Oh ! non, maman, je ne puis vraiment pas, il faut absolument que je possède ma propre mère ; quel mal cela peut-il faire que je rentre d’où je suis sorti !
H transporta alors sa main de son téton à son magnifique mont de Vénus, et montra par là ce que ses paroles voulaient dire. Elle fit semblant d’être très fâchée et essaya de l’éloigner, mais il la tenait trop bien serrée, ayant son bras passé autour de sa taille.
— Lâche-moi de suite ou je crie !
Elle paraissait vraiment furieuse, cependant elle ne poussa pas un seul soupir pendant et après le colloque. Henry fit alors valoir son meilleur argument.
— Pourquoi essaies-tu de me repousser ainsi, chère maman ? Pourquoi ne me laisses-tu pas jouir de toi comme tu le permets à Charles ?
Elle se redressa devant ce coup droit.
— Qu’est-ce que tu dis, mauvais garnement ? Où as-tu entendu une pareille calomnie ? Est-ce là une des inventions de ton ami Charles pour toutes les bontés que j’ai eues pour lui ?
— Ma chère maman, Charles ne m’a jamais ouvert la bouche à ce sujet, je ne parle que de ce que j’ai vu de mes propres yeux.
— Que veux-tu dire ? Allons, parle-moi de suite.
— Eh bien, ma chère maman, te rappelles-tu la première nuit du samedi où Charles et moi nous avons couché à la maison ? Après être entré dans ma chambre, je fut obligé de descendre pour aller aux water-closets ; je n’avais mis que mes chaussettes pour ne pas faire de bruit et je n’avais pas de lumière. Je remontais, quand j’aperçus un filet de lumière qui filtrait en haut. Je montai, et quand ma tête fut au niveau du premier étage, je t’aperçus te dirigeant vers la chambre de Charles. J’entrai dans la mienne, mais je laissai la porte ouverte afin de voir quand tu retournerais ; voyant que tu ne revenais pas, je me glissai dans le corridor jusqu’au tournant conduisant à la chambre de Charles. La lumière filtrait à travers le trou de la serrure, je m’approchai très doucement. Tu sais que le lit est juste en face la porte, alors, ma chère maman, je vis que tu initiais Charles à des plaisirs inconnus de lui jusqu’à ce jour. Oh ! mère chérie, la vue de tes charmes nus, la manière délicieuse dont tu lui donnais la première leçon, me rendit fou de désirs. Je fus alors tenté d’entrer et de te violer si tu n’avais pas voulu consentir. Je me rappelai alors qu’Ellen était en train de dormir dans ton lit ; j’étais dans un tel état de chaleur que je courus vers elle, et, jetant au loin le peu de vêtements qui me couvraient, je me glissai à ses côtés et me mis à lui caresser ses parties secrètes. Elle se réveilla en disant :
— Chère tante, veux-tu que je t’en fasse autant ?
Sa main toucha alors mon membre bandé, elle jeta un cri de stupéfaction. Je lui dis alors que ce n’était que moi.
— Oh ! va-t’en tout de suite, ma tante est allée sûrement aux cabinets et va rentrer bientôt.
— Elle ne fut vraiment rassurée que lorsque je l’eus, bien convaincue que tu ne reviendrais pas de sitôt, ce à quoi je ne pus arriver qu’en la conduisant devant la porte de Charles : nous te vîmes entièrement nue, te levant et t’abaissant sur l’énorme pine de Charles. Je ne l’avais jamais vu bander et je pouvais à peine en croire mes yeux. C’était vraiment merveilleux la manière charmante dont tu te glissais à l’intérieur cette belle saucisse. Cela excita Ellen extraordinairement ainsi que moi-même. Nous retournâmes à notre chambre où le feu brûlait encore. Je la fis coucher sur le tapis devant la cheminée et lui pris là son pucelage. Elle avait vu comme l’immense pieu de Charles entrait facilement dans ta fente et elle sentait que le mien était bien plus petit ; elle ne pensait pas que cela pût lui faire du mal, aussi elle me laissa très facilement lui glisser ma pine entre les grosses lèvres, et je profitai du moment où je venais de la faire décharger pour enlever tous les obstacles d’une seule poussée vigoureuse et l’affaire fut faite. Elle jeta un cri, car cela lui fit grand mal, mais comme la porte était fermée tu n’as rien entendu. Je la laissai ensuite reposer et ne recommençai que le lendemain matin. La nuit suivante nous assistâmes encore à tes combats amoureux. Ellen n’avait plus mal et nous répétâmes ton exemple sept fois dans la nuit. Encore aujourd’hui elle ne peut croire aux proportions gigantesques de Charles et se demande comment tu peux t’introduire un pareil morceau. Mais, oh ! ma chère maman, si tu savais comme mes passions sont excitées par tes charmes ravissants ! Qu’est Ellen en comparaison de toi ? Elle fut assez bonne pour soulager mon envie de te posséder, quand je vis que tu étais trop occupée ailleurs, mais c’est tout. C’est toi, et toi seule, ma maman chérie, que j’adore, et j’ai un désir sauvage de posséder ce cher et magnifique con que je caresse en ce moment.
Mme Dale fut absolument abasourdie à ce récit.
— Abominable garçon, comment as-tu osé me suivre, espionner ta mère et surtout mettre Ellen dans le secret ? Sans doute, vous avez dû vous vanter de cela et le dire à d’autres.
— Non vraiment, maman, Ellen et moi nous avons fait le serment de ne jamais révéler à âme qui vive ce que nous venions de voir ; aussi, maman chérie, tu vois que tu peux avoir pleine confiance en ton propre fils. Oh ! laisse-moi te le faire ! Sens comme mon pauvre vit sursaute.
Ici je suis obligé de donner le propre récit d’Henry sur ce qui s’est passé.
« Je pris sa main que je portai sans grande résistance sur ma pine, mais elle la retira de suite, non sans l’avoir un peu pressée entre ses doigts, en disant :
« — Mais non, ce n’est pas possible, ce serait un inceste.
« Elle me tourna le dos, de sorte que son derrière vint se frotter contre mon ventre. Pendant qu’elle se tournait, j’avais glissé ma main en bas, relevant sa chemise, de sorte que je la sentais à cul nu. Je ne perdis pas un instant, et avant qu’elle ne fût tout à fait installée, j’approchai par derrière une pine raide de son con délicieux, et comme il était encore mouillé des décharges que le pasteur lui avait fait faire en la gamahuchant, d’un seul coup je l’enfonçai aussi loin que le permirent ses fesses et mon ventre ; en même temps, lâchant sa taille, j’approchai ma main de son con, de sorte que lorsqu’elle fit un mouvement en avant pour me déloger, je rencontrai son clitoris, excessivement raide, ce qui prouvait qu’elle était réellement très en chaleur. Cette attaque sur son clitoris lui fit faire une poussée en arrière qui m’enfonça par ce double mouvement au plus profond de son con. Je ne perdis pas de temps pour procéder à des mouvements de va et vient.
« C’en était trop pour elle, elle ne put s’empêcher d’entrer elle-même en mouvement avec toutes les forces de ses passions et nous tirâmes un coup très rapide qui se termina par les plus ineffables délices et nous restâmes anéantis tous deux dans la joie de notre jouissance satisfaite.
« Je sentais par les pressions intérieures qu’elle faisait sur ma pine, que sa lubricité n’était pas éteinte, ce qui me donna une nouvelle vigueur. Après avoir feint de la résistance, ma chère maman passa sa main par derrière et, la plaçant sur mes fesses, m’aida en poussant pour que je pénètre plus avant. Nous restâmes plus longtemps à tirer ce nouveau coup et nous en eûmes plus de plaisir. Après le repos forcé qui suit toute jouissance, elle se tourna vers moi, m’embrassa tendrement et dit :
« — Oh ! mon cher enfant, c’est bien mal, mais c’est bien bon. Tu dois être discret, mon cher Henry, car si on le savait, nous serions déshonorés pour toujours.
« — Ma chère maman, n’aie pas peur ; t’es-tu aperçue de la moindre indiscrétion au sujet de ce que je t’ai raconté depuis six semaines, quoique je te désirasse par-dessus tout ? Oh ! embrasse-moi, ma maman bien-aimée.
« Nous nous donnâmes les plus doux baisers, nos langues se rencontrèrent, ses mains me caressaient de partout : elle rencontra ma pine déjà toute raide.
« — Mon chéri, il faut que je l’embrasse, elle est bien plus grosse que je l’aurais cru, et aussi dure que du fer.
« — Mais pas aussi grosse que celle de Charles, maman.
« — C’est vrai, mon chéri, mais c’est la raideur et non la grosseur qui donne le véritable plaisir, naturellement quand les deux sont combinées, comme chez Charles, c’est alors irrésistible.
« Pendant tout ce temps je lui pelotais le con : son clitoris que l’on sait être développé, se tenait raide et enflammé.
« — Maman chérie, comme il est gros :
« Ellen m’a dit que tu pouvais l’enfiler avec.
« — Oh ! la vilaine fille, qui raconte des mensonges !
« — Ça ne fait rien, maman, il faut que je le suce pendant que tu t’amuses avec la mienne.
« Je me tournai sur le dos avec mes talons relevés pendant que maman s’allongea sur mon ventre en sens contraire. Je suçai son clitoris tout en branlant son con, et elle suça ma pine jusqu’à ce que nous déchargeâmes tous deux et chacun lécha et suça l’amoureuse liqueur qui s’échappait de l’autre. Nous continuâmes nos caresses jusqu’à ce que ma pine montrât par sa raideur qu’elle était prête pour un nouveau combat. Maman cette fois-ci me fit mettre sur son ventre et, aussitôt qu’elle se sentit enfilée, elle croisa ses jambes sur mes reins et contribua par ses mouvements lascifs à notre jouissance mutuelle.
« Son magnifique derrière se trémoussait à l’unisson du mien, nos langues s’entrelaçaient, à la fin nous tombâmes tous deux dans l’extase finale en poussant des soupirs de ravissement. Nous restâmes longtemps insensibles à ce qui nous entourait, palpitants encore de nos lascives jouissances, et nous aurions été bientôt prêts pour une nouvelle course, mais maman me murmura qu’il serait imprudent de continuer, car il était l’heure de déjeuner.
« Je me retirai avec regret de ce con délicieux et, glissant hors du lit, j’y appuyai ma bouche, je lui donnai un baiser passionné et le suçai, jouant avec les magnifiques poils frisés qui le recouvraient, puis enfin me décidai avec grandes difficultés à rentrer dans ma chambre.
« Ainsi se termina la première séance de jouissances avec ma mère ; elle fut suivie par des nuits et des nuits de voluptés les plus lubriques. Je m’habillai à la hâte et descendis déjeuner avant elle. Le pasteur m’informa qu’elle l’avait averti de ne pas compter sur elle la nuit prochaine sous prétexte qu’elle ne se trouvait pas bien, mais en réalité c’était pour me réserver la nuit entière, nuit qui fut, sans contredit, des plus voluptueuses. Elle exerça et laissa le plus libre cours à ses passions lubriques, jamais auparavant je n’avais si bien joui. C’était peut-être l’alliance si proche entre nous qui ajoutait à notre excitement, mais elle me fit l’effet de surpasser même la splendide femme du pasteur. Oh ! elle était si aimante ! la façon dont elle me prenait dans ses bras et me caressait était irrésistible.
« Je ne puis dire combien nous le fîmes de fois, nous fûmes après, toute la nuit.
« La nuit suivante, sous prétexte de craindre de m’épuiser, elle me força à me retirer dans ma chambre après le deuxième coup et m’y enferma. Le pasteur m’avait déjà informé qu’elle l’avait prévenu de compter sur elle pour cette nuit, il me priait de bien la foutre d’abord, de manière à lécher mon foutre quand il la gamahucherait ; aussi je fis à peine de la résistance quand elle me dit qu’il était sage de me retirer dans ma chambre. Elle me promit de me laisser tirer un coup avant de me lever, mais ce coup fut converti en de copieuses décharges.
La nuit suivante, le pasteur prétexta d’avoir besoin de repos, car il se proposait de nous surprendre le matin. Pour lui faciliter sa tâche, je me levai pour pisser quand maman fut endormie ; je sortis le verrou de la porte, je secouai le pasteur pour le réveiller et je retournai me coucher. Je l’avais prévenu qu’au moment de la décharge je ferais plus de bruit que d’habitude ; il devait attendre assez longtemps après avoir entendu ce signal, comme pour avoir le temps de s’habiller un peu, et alors il devait entrer dans la chambre avec une lumière.
Maman dormait encore, il était environ quatre heures du matin. Je commençai à lui caresser ses belles fesses et, me glissant sous les couvertures, lui ouvris les cuisses (insensiblement elle se mit sur le dos), je pris son gros clitoris entre mes lèvres et me mis à le sucer, ce qui le fit de suite raidir. L’excitement la réveilla (elle rêvait que j’étais en train de la foutre), aussi elle était toute prête et bien en chaleur.
« Elle m’attira sur son sein, rejeta les couvertures, et croisa ses magnifiques cuisses sur mes reins ; ses deux mains pressaient mes fesses pour me faire entrer plus avant, et nous tirâmes un coup délicieux. Je feignis d’être encore plus excité que je ne l’étais vraiment, et je me mis presque à braire comme un âne au moment de l’éjaculation ; maman elle-même était trop anéantie pour faire attention à mes cris. Elle était insensible, pressant intérieurement ma pine palpitante ; ses yeux étaient fermés, aussi elle ne remarqua pas la lumière que le pasteur tenait à la main en entrant. Ce ne fut que lorsqu’il fut arrivé tout près du lit et poussa une exclamation de surprise, qu’elle s’aperçut de sa présence.
« Elle poussa un cri étouffé et se couvrit les yeux avec la main. Je me levai de dessus elle ; le pasteur, avec une grande politesse, lui demanda pardon de son intrusion, mais ayant entendu un bruit inaccoutumé, il avait craint qu’elle ne fût malade.
« Alors maman se mit à pleurer, la ressource habituelle des femmes. Le pasteur la pria le plus affectueusement du monde de se calmer.
« — Ma chère madame, dit-il, je ne vous blâme nullement de cela. Je suis un homme du monde et je sais que l’inceste est pratiqué beaucoup plus que l’on ne se l’imagine, et pour vous prouver que cela ne m’offense nullement, je puis vous avouer de suite que ce fut ma propre mère qui m’initia à ces voluptueux mystères. Je vois que le pauvre garçon paraît terriblement effrayé de me voir le témoin des jouissances qu’il a dû éprouver, mais, pour le mettre à son aise, nous pouvons aussi lui avouer que nous avons déjà tous deux joué ensemble à ce gentil petit jeu. Je dois ajouter que ce n’est pas la première fois que je participe à une orgie avec plus d’un homme ou d’une femme, et rien ne me fait plus plaisir que d’étreindre dans mes bras une personne sortant des bras d’une autre, spécialement quand j’ai été témoin de leur plaisir. Regardez, chère madame, comme ce cher instrument se tient raide comme preuve de ce que j’avance, et pour s’assurer de mon silence, ce cher Henry ne s’opposera pas à ce que je jouisse de vous après lui et devant lui.
« En parlant ainsi, il quitta son pantalon et sauta dans le lit. Ma mère ne fit pas grande difficulté pour se le laisser mettre en présence de son fils, car je l’assurais que je préférais vraiment la voir opérer comme elle aimait plutôt qu’autrement, surtout parce qu’elle en éprouvait plus de jouissance.
« Le pasteur monta donc de suite sur elle, il n’y a pas de doute qu’elle jouit également beaucoup avec lui. Cette vue me fit raidir la pine que je mis dans sa main et qu’elle serra avec amour ; puis, me courbant, je lui suçai un téton, on sait combien cela l’excitait, je glissai ma main derrière le pasteur, lui chatouillant gentiment les couilles et lui donnant le postillon dans le trou du cul. Ils tirèrent un coup splendide et tombèrent anéantis dans de mutuelles délices. Le pasteur ne se fut pas plutôt retiré que je sautai à sa place et engloutis ma pine jusqu’aux couilles dans ce con inondé de foutre. Maman se récria faiblement, mais le pasteur la supplia de lui laisser le plaisir d’être témoin de la vigueur du jeune homme. Je savais qu’au fond du cœur maman était enchantée, parce que toutes les femmes aiment spécialement se sentir enfilées par une nouvelle pine juste au moment où une autre se retire après les avoir foutues. »
Ceci est la vérité ; voyez par exemple ma chère madame Benson dans mes commencements ; son plus grand plaisir était de me posséder au moment où monsieur Benson venait de la foutre, et elle avouait que rien ne pouvait lui faire plus plaisir. Je connus par la suite une dame que nous possédions, moi et trois autres hommes, et aussitôt que l’un était dehors, l’autre était dedans et quelquefois deux en même temps. Elle nous racontait de la manière dont elle trompait son mari. Une fois, à Florence, elle prit huit fouteurs et elle les posséda tous la même nuit sans qu’ils s’aperçussent l’un ou l’autre de leur présence. Voici comment elle s’y prit :
Elle les fit venir deux à dix heures, deux à dix heures et demie, deux à onze heures et deux à onze heures et demie. Elle les fit entrer tous dans une chambre séparée contenant un sofa confortable. Elle alla au numéro 1, portant seulement une large robe de chambre qu’elle quitta instantanément. C’était une créature admirablement bien faite, dont les charmes auraient enflammé n’importe qui. Elle tira rapidement deux coups avec le numéro 1 sans déconner ; puis, disant alors que son mari se mettait à sa recherche si elle ne se sauvait pas, elle sonna un domestique allemand, qui avait aussi l’habitude de la foutre lui-même et qui me confirma par la suite la véracité de cette histoire, pour faire sortir le monsieur de la chambre.
De là elle courait au numéro 2, lui disant qu’elle n’avait pu s’échapper qu’après avoir laissé tirer un coup à son mari, qui la croyait seulement sortie pour aller aux cabinets, qu’en conséquence il avait juste le temps de la foutre une fois et de s’en aller. Naturellement, ce con plein de foutre ne l’excitait que davantage, aussi il ne fut pas long à décharger et laissa la chambre libre pour les deux qui devaient venir à onze heures. Comme elle n’avait pas cinq minutes à perdre, elle courut au numéro 3 où l’attendait un autre fouteur. Elle lui raconta la même histoire qu’au numéro 2, mais comme il avait une pine énorme, elle tira deux coups avec lui et le congédia de la même manière que les autres. Elle courut vers tous les autres de la même manière, leur racontant la même histoire, tirant deux coups avec les trois derniers qui étaient les meilleurs fouteurs, et resta avec le dernier jusqu’à ce qu’il fut tout à fait vidé.
La même dame, me raconta qu’une fois, pendant qu’ils étaient à Dieppe, son mari retourna en Angleterre pour quelques jours. Pendant son absence, elle soupait toutes les nuits avec quatre jeunes gens et se faisait foutre par eux sur des coussins par terre, se faisant en même temps enculer par un. Pendant le jour, son propriétaire, un homme marié, avait l’habitude de venir la foutre aussi. Une fois elle resta seule à Manstheim, où elle fit la connaissance d’un officier qui lui en présenta un second, puis un troisième ; enfin, elle en connut huit. Elle les invita tous un jour à souper et ils la foutirent chacun trois fois. C’était une splendide femme et qui aurait pu foutre sans jamais s’arrêter. Son père l’avait initiée à l’âge de douze ans. Elle était d’origine grecque, et dans son pays, les filles de cet âge sont formées et réglées. Les femmes sont généralement putains au fond du cœur, et nombreuses sont celles qui ne sont pas embarrassées pour se satisfaire.
Pendant l’opération d’Henry avec sa mère, le pasteur se tint à côté d’eux, pelotant les couilles d’Henry et lui donnant le postillon ; maman jouit énormément. Cette vue avait enflammé le pasteur à nouveau, l’idée de l’inceste l’excitait au plus haut point. Aussitôt qu’Henry déconna, il pria Mme Dale de se mettre sur les mains et les genoux afin de le lui mettre par derrière. Il aurait bien voulu le lui mettre dans le derrière, mais elle pensa qu’elle n’était pas encore suffisamment préparée pour lui permettre cette fantaisie ; il lui dit seulement que le tortillement d’un aussi joli fessier que le sien devant ses yeux l’excitait furieusement. Il lui proposa ensuite de s’étendre allongée sur Henry à contre-sens, de manière à pouvoir le gamahucher pendant qu’il lui branlerait son gros clitoris.
— Vous voulez donc me faire mourir entre vous deux ? dit-elle, mais elle se prêta avec plaisir à cette pose. Elle suça la pine d’Henry qui déchargea dans sa bouche ; elle avala tout avec la plus grande avidité, déchargeant elle-même au même moment un peu avant le pasteur. Henry continua de la branler d’une main, pendant qu’avec l’autre il branlait le trou du cul du pasteur. Le combat dura très longtemps, elle fit décharger Henry deux fois dans sa bouche, pendant qu’elle-même le faisait trois fois et le pasteur seulement une ; enfin ils tombèrent tous anéantis par la décharge finale, complètement insensibles à tout, et quand ils revinrent à eux, ils se séparèrent et se retirèrent chacun dans leur chambre.
La glace étant ainsi rompue, les jours suivants se passèrent dans la plus grande débauche. Le pasteur arriva à l’enculer et lui demanda la permission d’enculer aussi Henry après qu’Henry l’aurait enculée elle-même pendant que le pasteur la foutrait par devant. Il voulut aussi se faire enculer par Henry, et quand il le fit, il se mit à crier très fort : « Hi !… hi !… hi !… » comme si on lui faisait beaucoup de mal et comme s’il perdait réellement sa virginité de ce côté. Il parut éprouver une très grande jouissance quand il encula Henry et déclara qu’il ne savait pas ce qui était le meilleur de la foutre par devant et par derrière, ou d’enfiler un homme par derrière ou de se faire enculer soi-même. Maman déclara que le plus délicieux était de jouir par les deux côtés en même temps. Ce fut alors que le pasteur voulut essayer. Aussi, faisant agenouiller maman, il la foutit et présenta son gros fessier à Henry qui l’encula parfaitement bien. Ce fut après cette complète initiation qu’ils revinrent à la maison, et après de tels procédés, on comprend facilement que l’on s’arrangea pour jouir tous ensemble.
Comme ils devaient arriver assez tard, il fut convenu que Mme Dale passerait la nuit à la maison et que nous verrions alors ce qui arriverait. Ils arrivèrent enfin ; Mme Dale fit monter Ellen avec elle dans sa chambre pour l’aider à sa toilette ; là, il y eut une explication entre elles. Mme Dale Voulut des aveux complets des deux côtés. Elle avoua qu’Henry avait couché avec elle et qu’il était arrivé à satisfaire ses horribles désirs en lui racontant que lui et Ellen avaient assisté à ses fouteries avec Charles et avaient suivi son exemple.
— Maintenant, ma chère Ellen, qu’il ne doit plus y avoir de secrets entre nous, dis-moi si Charles te l’a mis.
— Oui, certainement ; vous savez que j’avais vu quelle immense pine il a et aussi avec quel plaisir vous vous enfiliez ; aussi la curiosité me poussa à le posséder un jour dans le pavillon d’été, et depuis il a souvent couché avec moi.
— Est-ce que la femme du pasteur se doute de quelque chose ?
— Oh ! oui, elle sait tout. J’avais oublié de fermer la porte à clef une nuit ; au matin, Charles fit trop de bruit, elle entra presque en chemise, courut vers nous et le délogea, ne s’imaginant courir aucun risque. Charles la saisit dans ses bras, jurant qu’il allait lui en faire autant pour l’empêcher de bavarder. Elle fut épouvantée, courut vers sa propre chambre, mais elle n’eut pas le temps de l’empêcher d’y pénétrer avec elle ; elle courut à son lit, voulant sonner pour un domestique, il la saisit au moment où elle avait déjà un genou sur le lit et l’enfila par derrière avant qu’elle ait pu atteindre la sonnette. Elle m’appela pour venir le faire sortir. J’arrivai, mais je lui dis que Charles avait raison, car cela l’empêcherait de bavarder sur nous. Je crois vraiment que l’énorme pine de Charles lui faisait bien plaisir, car elle cessa bientôt de se débattre, elle l’aidait même beaucoup en tortillant ses fesses, et de ses bras nerveux passés autour de sa taille, Charles l’empêchait de faire usage de ses mains. Elle pleura beaucoup ensuite, pensant à l’horreur d’un pareil crime ; elle était alors dans son lit où Charles l’avait suivie pour la consoler et la caresser, et naturellement l’enfiler à nouveau. À la manière dont elle tortilla son derrière, je jugeai que ce second coup la fit énormément jouir. Elle l’accusa ensuite d’avoir commis le crime de séduire la jeune fille, son hôte ; mais là, je l’arrêtai en lui disant que mon cousin l’avait déjà possédée. Elle m’accusa alors à mon tour d’avoir séduit Charles, alors, je dois implorer votre pardon pour cela, je laissa échapper inconsciemment que c’était vous qui l’aviez initié et que je vous avais vue.
— Oh ! la petite sotte ! Comment as-tu pu être aussi imprudente !
— Mais, ma chère tante, il n’y a pas grand mal à cela.
La tante de Charles s’apaisa bientôt et partagea par la suite toutes nos jouissances. Elle est très passionnée, peut-être plus passionnée que vous pour me gamahucher ; elle est folle de l’énorme pine de Charles, vous envie d’avoir été la première à la posséder, et dit que si elle avait su qu’il eût une aussi énorme saucisse, elle n’aurait pu résister au plaisir de l’initier elle-même. Elle espère, grâce à moi, de devenir plus intime avec vous. Je lui ai parlé de votre magnifique clitoris, elle est avide de le gamahucher et avoue qu’elle ne sera pas heureuse tant qu’elle ne l’aura pas fait.
Cette explication fut un grand soulagement pour la veuve, qui, étant déjà très bien avec le pasteur, vit que cela irait tout seul avec sa femme et que tous ensemble ils pourraient se livrer en toute liberté à leurs orgies lubriques. Elles descendirent pour dîner après avoir achevé leurs toilettes. Le pasteur avait raconté à sa femme tout ce qu’il avait fait à Londres, de sorte qu’après dîner les trois dames échangèrent de mutuelles confidences. Ma tante était tellement avide de voir et de sucer le gros clitoris de Mme Dale, qu’elles montèrent dans la chambre de ma tante où le pasteur les surprit au milieu de leurs opérations. Mme Dale était étendue sur le dos avec les cuisses bien écartées, pressant avec ses mains la tête de ma tante contre son con ; ma tante suçait son magnifique clitoris tout en faisant aller et venir ses doigts dans son con.
Elles étaient trop bien affairées pour remarquer l’entrée du pasteur ; ma tante était agenouillée et avait ses jupons bien relevés sur son dos. La pine du bonhomme se dressa, il s’avança, s’agenouilla aussi, se mit entre ses jambes et la foutit ainsi, lui demandant de continuer son opération sur Mme Dale. Quand il eut déchargé, il complimenta les deux dames sur la grande intimité qui venait de s’établir entre elles, disant que c’était le vœu le plus cher de son cœur. Il assura à Mme Dale que sa femme était la meilleure femme du monde et n’était jamais fâchée des infidélités qu’il lui faisait.
— Aussi je lui ai raconté mes jouissances avec vous, et il paraît que mon neveu a pris ma place pendant mon absence. Elle m’a dit que c’est vous qui avez initié Charles, et qu’il est tout à fait monstrueux quand il bande, encore plus gros que moi ou qu’un certain capitaine de grenadiers qui fut un des favoris de ma femme. Je suis curieux de le voir. Elle m’a aussi dit qu’il a couché avec votre charmante nièce qui, je ne vous le cache pas, m’a donné un violent désir de la posséder. Maintenant, ma chère madame, si vous voulez consentir à inviter Charles à coucher avec vous et Ellen, je viendrai vous rejoindre quand vous aurez été foutues toutes deux une ou deux fois par Charles, je prendrai Ellen, et vous, vous aurez Charles entièrement pour vous seule. Ma femme n’y fera aucune objection et j’espère que vous allez donner votre consentement.
— Certainement, mon cher pasteur, après ce qui s’est passé entre nous, je ne puis rien vous refuser, mais je voudrais bien que mon cher Henry eût, lui aussi, un peu de plaisir. Je suppose, chère madame, que le pasteur a dû vous raconter comment il nous a surpris pendant qu’il me violait et m’enfilait. Votre mari m’a réconciliée avec lui et je puis vous assurer que, quoique n’étant pas aussi bien monté que Charles, il a certaines manières qui charment vraiment les femmes lascives. D’après ce que le pasteur me dit, vous n’avez pas de scrupules, pourquoi resteriez-vous inactive, pendant que nous allons tous nous livrer à la volupté ? Pourquoi n’iriez-vous pas le rejoindre dans sa chambre et voir comment il est fait. Moi, sa mère, je puis vous le recommander tout spécialement à vos faveurs.
Les choses furent ainsi arrangées.
Pendant la soirée, Mme Dale me souffla tout bas de venir les rejoindre quand les domestiques se seraient retirés. J’y allai et je les foutis toutes deux trois fois, deux fois par devant et une fois par derrière, celle que je foutais gamahuchait toujours l’autre pendant l’opération.
Comme ma pine commençait à avoir besoin d’un peu de repos, Mme Dale se leva, alla ouvrir la porte qui communiquait avec la chambre de mon oncle, et l’invita à se jeter dans les bras d’Ellen, qui était très heureuse d’avoir une nouvelle expérience d’une autre pine d’homme.
Mon oncle la gamahucha galamment avant de la foutre, puis demanda à voir mon énorme pine, prétendant être absolument renversé de ses monstrueuses proportions, il se demandait comment le petit con d’Ellen avait pu l’avaler. C’était, à la vérité, un peu étroit et serré, mais la chère créature n’en avait que plus de plaisir pour cela. Avant de foutre Ellen, il demanda à Mme Dale la permission de le laisser lui-même guider dans elle cette énorme saucisse. Après avoir joui de nos premiers mouvements et se sentant suffisamment excité, il se mit en devoir d’enfiler Ellen ; cependant il eut quelques difficultés pour entrer, malgré les nombreuses libations dont je l’avais arrosée ; mais une fois qu’il fut enfoncé jusqu’aux poils, il déclara que c’était un des plus jolis petits cons qu’il ait jamais eu la bonne fortune d’enfiler. Nous procédâmes alors chacun de notre côté et, après un intervalle assez long, nous arrivâmes à la conclusion finale, tombant tous anéantis pendant quelques instants.
Le pasteur se retira alors et nous nous disposâmes à reposer. Nous fûmes réveillés le matin par l’entrée de ma tante et d’Henry. Il courut se jeter dans les bras de sa mère qui était allongée sur Ellen pour la gamahucher pendant qu’Henry la foutait. Ma tante et moi nous étions accouplés suivant la vieille manière ; mon oncle entra pendant que nous étions en pleine opération, et voyant le derrière tentateur d’Henry, sauta derrière lui et l’encula. Quand il eut fini, ma tante se trouva scandalisée d’une attaque dans le derrière d’un garçon, prétendant que ce n’était pas la même chose dans un derrière de femme.
— Eh bien, alors, ma chère, la prochaine fois, monte sur Charles et je t’enculerai pendant qu’il te foutra.
Il appela alors l’attention de madame Dale sur les magnifiques proportions de ma tante, non seulement de son énorme derrière, mais de tout son corps et de tous ses membres.
— Oh ! c’est vraiment superbe, dit-elle, il faut, ma chère madame, que je vous gamahuche. Je n’ai pas oublié les délicieux plaisirs que vous m’avez fait éprouver hier de cette manière.
— Avec plaisir, répondit ma tante, pourvu que pour m’occuper vous me donniez votre énorme clitoris.
— Certainement, cela me convient admirablement ; mais vous devez vous mettre sur moi, de manière à ce que je puisse avoir le plaisir de regarder ce magnifique derrière et caresser les immenses rondeurs de vos fesses.
— Oh ! c’était un coup d’œil délicieux de voir ces deux femmes voluptueuses se livrer toutes deux aux délices du gamahuchage. Cette vue nous enflamma tous et aussitôt qu’elles eurent fini, j’éteignis le feu qui me brûlait en me précipitant dans le vaste mais étroit con de ma tante, pendant que mon oncle l’enculait. Madame Dale était étendue sous Ellen, qui était foutue par derrière par Henry et gamahuchait sa tante qui guidait elle-même la pine de son propre fils dans le con d’Ellen, branlant son clitoris et en même temps donnant à son fils le postillon dans le trou du cul.
Oh ! ce fut un coup splendide ! Nous étions tous très excités et c’était aussi la première fois où nous nous trouvions tous réunis dans la même orgie. Nous tombâmes tous anéantis dans une extase de volupté. Nos travaux de la nuit ne nous permettaient pas de recommencer, et nous nous séparâmes pour prendre un peu de repos avant le déjeuner.
Madame Dale resta au presbytère pendant trois jours, durant lesquels on se réunissait tous ensemble dans la chambre du pasteur pour renouveler nos orgies. Madame Dale emmena son fils et sa nièce et je promis d’aller la voir le samedi suivant ; ce jour-là, Henry et moi nous prîmes à tour de rôle chacune de ces chères créatures, quelque-fois nous en mettions une entre nous deux pour la foutre des deux côtés en même temps. Quand les classes recommencèrent, madame Dale et Ellen vinrent tous les dimanches dîner et coucher au presbytère, et alors nous faisions une orgie générale dans de grandes largeurs.
Cela continua jusqu’aux vacances de l’été, quand je dus quitter le presbytère pour le collège royal. Les grossesses de madame Dale et d’Ellen devenaient de plus en plus visibles à mesure que le terme de la délivrance approchait. Nous eûmes avec mon oncle de longues discussions pour savoir ce qu’il y avait de mieux à faire. À la fin, il fut décidé qu’elles quitteraient la villa pour faire un tour sur le continent, mais qu’en réalité elles s’arrêteraient à Paris, prendraient des appartements dans la maison d’une bonne accoucheuse des environs où elles resteraient jusqu’à l’époque de leurs délivrances. Il n’était pas nécessaire pour elles de partir avant la fin des études, de sorte que le pasteur, Henry et moi, nous puissions les accompagner ; je ne mettais pas en doute d’obtenir de mon tuteur, après lui avoir fait une visite à Londres, l’autorisation et les subsides nécessaires pour visiter le continent jusqu’au milieu d’octobre, époque à laquelle les classes devaient recommencer. Tout arriva comme nous avions décidé ; les grossesses purent être dissimulées grâce aux robes larges et lâches.
Notre voyage se passa très bien ; nous découvrîmes dans les environs une très bonne accoucheuse qui possédait un très grand jardin. Henry, mon oncle et ma tante restèrent avec elles pendant que je retournais à Londres. Je vis mon tuteur qui, après m’avoir fait passer un sévère examen, fut très satisfait des progrès que j’avais faits ; il dit qu’en effet, un tour sur le continent développerait mes idées et qu’il me donnerait l’argent nécessaire pour cela. Il me recommanda d’aller d’abord passer une quinzaine avec ma mère et m’annonça qu’à peu près vers cette époque mes sœurs allaient entrer dans une pension de première classe à Londres pour finir leur éducation.
Il ajouta ensuite qu’il avait demandé et obtenu la main de miss Frankland, et qu’ils devaient se marier vers cette même époque ; mes sœurs devaient être demoiselles d’honneur et moi-même je pourrais assister au mariage avant mon départ. Tout étant bien arrangé, je me hâtai d’arriver à la maison. Ma mère fut enchantée de me revoir et me trouva beaucoup grandi et développé. Je n’ai pas besoin de dire combien mes sœurs et miss Frankland furent heureuses de me revoir. Elles étaient privées de pine et ne se servaient que de leurs langues et de godmichés, aussi on peut s’imaginer quelle furie amoureuse elles déployèrent pendant les deux ou trois premières nuits. Nous accomplîmes toutes les opérations des anciens jours. Mes sœurs étaient devenues des femmes superbes, mais la plus jeune était toujours la plus cochonne. Ma chère Frankland me dit, comme je la félicitais de son prochain mariage, qu’elle n’avait accepté que parce qu’elle serait toujours, ainsi près de moi. Nous passâmes une quinzaine, délicieuse qui ne nous parut pas plus longue qu’un jour.
Je trouvai une occasion de foutre mon ancienne gouvernante, qui était miss Vincent. Mon fils était un joli petit gars qui commençait déjà à marcher et à parler. Sa mère m’aimait toujours autant et, était devenue une fort belle femme, plus amoureuse et plus lascive qu’auparavant.
Elle me dit qu’il n’y avait d’aussi bon et d’aussi aimant que son mari, à qui elle n’avait jamais fait une infidélité, si ce n’est avec moi qu’elle aimerait toujours, qu’elle ne me refuserait jamais rien de ce qui pourrait être fait en toute sûreté. Pendant cette seule occasion que j’eus de la foutre, je lui déchargeai trois fois dans le con sans déconner et je l’enculai ensuite pour finir. Je puis ici ajouter qu’une petite fille vint au monde neuf mois après ce jour, et la mère fut persuadée qu’elle était de moi.
Ma mère, mes sœurs et miss Frankland vinrent toutes m’accompagner jusqu’à Londres. Le mariage se fit avec beaucoup d’éclat. Mon tuteur fit de très riches cadeaux à mes sœurs et me donna une chaîne et une montre en or, accompagnées d’un fort chèque pour les dépenses de mon voyage. Lui et sa fiancée, que je foutis juste un peu avant son départ pour l’église, allèrent passer leur lune de miel en Écosse et revinrent par les lacs anglais.
Quelques jours après, ayant passé deux ou trois délicieuses nuits à foutre mes sœurs, maman et moi les conduisîmes à la pension et les y laissèrent après des adieux où les larmes coulèrent en abondance.
Ma mère devait rester à Londres une semaine encore, jusqu’au retour de mon oncle et de ma tante de leur tour sur le continent. J’arrivai rapidement à Paris. Nous prîmes des chambres voisines de nos deux chéries, et mon oncle et ma tante les occupèrent pendant la semaine qu’ils devaient encore rester avec nous.
Nous foutîmes maman et Ellen plusieurs fois dans une orgie générale, et elles venaient toutes les nuits coucher avec nous.
Mon oncle et ma tante nous quittèrent à la fin de la semaine, mais nous conservâmes leurs chambres, afin que nos chéries puissent venir vers nous se faire foutre autant que nous le pourrions.
On aurait dit que la grossesse les excitait encore davantage, car nous arrivions à peine à les satisfaire. À la fin, elles ne pouvaient plus se faire enfiler qu’en se mettant sur les mains et les genoux, quoiqu’aucune d’elles n’eût un trop gros ventre, mais, par contre, leurs hanches s’étaient extraordinairement développées. Celles de maman mesuraient un mètre de diamètre et ses fesses étaient presqu’aussi énormes que celles de ma tante. Elle adorait se faire enculer.
Nous les enfilâmes toutes les deux la nuit même où elles accouchèrent ; rien ne pouvait être plus heureux, car, leur vagin étant bien graissé de foutre, cela aida au passage de l’enfant. Comme je l’ai déjà fait remarquer, elles eurent chacune une fille.
Elles purent toutes deux se lever le neuvième jour, mais, comme on aurait pu leur occasionner des désordres graves en recommençant nos fouteries avant trois semaines, nous décidâmes, Henry et moi, d’aller faire une excursion en Suisse, que nous visitâmes dans toutes les directions avec un plaisir continuel, à la vue de ces magnifiques scènes de la nature.
Nous ne touchâmes pas une seule femme. Quand nous bandions trop fort, nous nous enculions mutuellement, mais très rarement ; nous reprenions ainsi nos forces et nous rentrâmes en pleine santé, prêts à rendre hommage aux charmes de nos deux chéries, qui avaient impatiemment attendu notre retour.
Il est inutile de répéter les délicieuses fouteries qui s’en suivirent.
Elles paraissaient plus charmantes que jamais, surtout Ellen, qui était complètement femme maintenant.
Nous nous arrangeâmes pour laisser les deux charmantes enfants entre les mains de deux nourrices saines et robustes, et nous nous mîmes en route pour faire une excursion sur la Loire, visitant Tours, Bordeaux, les Pyrénées, et revenant, à la fin de septembre, par Montpellier, Nîmes, Avignon et Lyon.
Les deux bébés se portaient à ravir.
Nous prîmes des arrangements pour les laisser à leurs nourrices pendant un an, et nous retournâmes à Londres tous ensemble.
Nous eûmes pendant trois nuits avant leur départ pour la province des fouteries délicieuses, et elles nous promirent de venir de temps en temps à Londres pour renouveler nos orgies.
Ma mère et ma tante vinrent visiter mon installation de garçon, qui était située à Norfolk Street, et j’entrai au Collège royal.
Je passai une délicieuse nuit avec ma tante avant son départ et j’accompagnai ma mère à la maison. À mon retour, je sus que mon tuteur était revenu. J’allai présenter mes respects à sa femme. Je la trouvai seule, et nous nous livrâmes à la première séance d’adultère qui, comme on peut bien le penser, ne fut pas la dernière.
J’ai dit plus haut que je m’étais installé à Norfolk Street, à cause de sa proximité du Collège royal. C’était dans la maison de madame Nichols, une veuve, grande, bien bâtie, un peu hommasse, mais bonne et tendre ; elle paraissait avoir cinquante-deux ans, mais c’était une propriétaire très vive et attentionnée, s’occupant elle-même d’une bonne cuisine, bien qu’ayant une cuisinière qui lui servait de bonne à tout faire pour les travaux du bas ; elle avait deux nièces qui s’occupaient des logements du haut.
La plus jeune était seule quand j’arrivai à mon appartement. La sœur aînée avait eu un « accident » et était en ce moment à la campagne jusqu’à ce qu’elle en fût remise. On attendait son retour dans environ six semaines.
Cependant, comme l’hiver n’est pas la saison pour louer les appartements, j’étais le seul locataire et la plus jeune fille n’avait que moi à s’occuper.
Elle s’appelait Jane.
Elle était petite et mignonne, mais très bien faite, avec, comme je ne tardai pas à m’en assurer, de gros tétons durs et fermes et un gros derrière bien rond.
Elle était très jolie, mais avec un air de grande liberté innocente, ce qui me fit supposer qu’elle n’avait pas encore couru le risque d’un « accident ». Après une semaine écoulée, nous étions très intimes et, après l’avoir souvent complimentée sur sa jolie figure et ses belles formes, je lui prenais par-ci par-là quelques baisers dont elle se vengeait ensuite par une espèce d’impertinence innocente mais attrayante. Ce fut dans une de ces occasions où elle se défendait que je pus m’assurer de la fermeté de ses tétons et de ses fesses.
Jusqu’à ce moment, mes flirtations n’avaient pas de but déterminé, mais l’envie de toucher ces charmes cachés excita bientôt mes passions amoureuses. J’augmentais petit à petit mes compliments et mes caresses, tâtant ses tétons, pendant que je la prenais quelquefois sur mes genoux pour l’embrasser et m’apercevant alors que son derrière était bien plus développé que je ne l’aurais supposé. Graduellement, elle cessa toute résistance pour ces petites libertés et s’asseyait d’elle-même sur mes genoux pour se faire embrasser. Une fois, sa robe était légèrement ouverte devant, j’en profitai pour toucher à l’intérieur ce que je n’avais encore fait que tâter à l’extérieur et, petit à petit, j’arrivai à caresser entièrement ses jolis petits tétons. Je pensai alors que je pouvais me permettre de plus grandes familiarités ; aussi, un jour qu’elle était assise sur mes genoux, ayant passé un bras autour de sa taille, je la pressai contre moi et, avant qu’elle eût pu se rendre compte de mon mouvement, ma main caressait déjà son mont de Vénus, qui était déjà recouvert d’une épaisse toison. Elle se leva instantanément, mais comme je la tenais fortement maintenue par la taille, elle ne put se sauver, et cette nouvelle position me permettait de glisser plus facilement ma main entre ses cuisses et de toucher son joli petit con saillant. J’essayai de branler son clitoris, mais en se baissant elle retira son con et, me regardant avec une innocente expression de frayeur et avec une parfaite inconscience de ses paroles, elle me cria :
— Oh ! faites attention à ce que vous faites. Vous ne savez pas ce qu’il en a coûté au locataire, l’été dernier, pour m’avoir saisie ainsi et m’avoir fait du mal. J’ai crié, ma tante est montée et il a dû payer, pour son impudence, 1.250 francs.
Je ne pus m’empêcher de sourire à l’extrême innocence de cette petite fille.
— Mais, chère Jane, je ne te fais pas mal et n’ai pas non plus l’intention de t’en faire.
— C’est aussi ce qu’il disait, mais il agit si horriblement que, non seulement, il me fit beaucoup souffrir, mais il me fit aussi saigner.
— Ce n’était assurément pas avec sa main, car, tu vois, je ne fais que caresser gentiment cette jolie petite affaire poilue, et je suis sûr que je ne te fais pas mal.
— Oh ! non, si ce n’était que cela, ça ne me ferait rien, mais il me poussa sur le sofa et se jeta sur moi ; c’est alors qu’il me fit terriblement souffrir, et vous devez faire attention à ce que vous allez faire, sans cela vous aurez aussi à payer 1.250 francs.
Elle disait tout cela avec un air de véritable innocence ; il était évident que le bonhomme l’avait enfilée et brisé sa virginité brutalement, c’est alors que les cris de Jane l’avaient empêché d’achever sa besogne. Ses manières me convainquirent qu’elle en ignorait absolument les conséquences ou, plutôt, que ses passions n’avaient pas encore été excitées.
— Eh bien ! ma chère Jane, je n’ai l’intention ni de te faire du mal, ni de me mettre dans le cas de payer 1.250 francs. Mais tu ne me refuseras pas le plaisir de caresser ce joli petit nid soyeux ; regarde comme je le fais doucement.
Si vous ne me faites pas plus de mal, je ne veux pas vous refuser, parce que vous êtes un joli et bon garçon, et bien différent de l’autre, quiétait brutal, ne me parlait jamais et ne me faisait jamais rire comme vous. Mais il ne faut pas pousser votre doigt là-dedans, car c’est quelque chose qu’il m’a poussé là qui m’a fait si mal.
Je retirai mon doigt et comme, sur ma demande, elle avait un peu écarté les cuisses, je pelotai et caressai son joli petit con et chatouillai, avec le doigt, son charmant petit clitoris, ce qui la fit rougir et frissonner ; je continuai à peloter doucement son mont de Vénus et son con entr’ouvert. Elle me pria de la laisser partir, sans quoi sa tante allait monter.
Le premier pas était fait. Je fis des progrès sérieux petit à petit : je caressai à nu son charmant petit cul rond, pendant qu’elle se tenait debout près de moi, j’obtins qu’elle me laissât voir les jolis poils qui recouvraient son con, puis je l’embrassai, jusqu’à ce qu’enfin elle écartât les cuisses et se laissât lécher, en éprouvant à cela la plus grande volupté.
Je la fis décharger pour la première fois de sa vie et ensuite elle venait elle-même me trouver pour le lui faire encore.
Tout en lui suçant le clitoris, j’avais glissé un doigt dans son con, mais elle était tellement excitée qu’elle ne s’apercevait pas de ce que je faisais ; puis, j’introduisis deux doigts à la fois et, après l’avoir fait délicieusement décharger, je leur fis faire les mouvements d’une pine, ce qui la fit sauter debout, me demandant ce que je lui faisais. Je lui demandai si elle ne sentait pas que mes doigts étaient dans sa petite fente.
— Ce n’est pas vrai. C’est là que j’ai le plus souffert.
— Mais, moi, je ne te fais pas mal, ma chère Jane ?
— Oh ! mon Dieu non, cela me fait un drôle d’effet, mais très bon.
— Eh bien ! tu sais maintenant que j’ai introduit deux doigts, je vais avec ma langue sucer ton joli petit clitoris pendant que je ferai aller et venir mes doigts.
C’est ce que je fis, et elle ne fut pas longue à décharger avec ivresse, pressant ma tête contre son con en me disant :
— Oh ! oh ! comme c’est bon ! et retomba alors presque insensible.
Je recommençai une autre fois le même exercice, mais, auparavant, elle m’avait bien prévenu elle-même de ne pas oublier de mettre mes doigts.
Après l’avoir fait décharger deux fois, je la pris sur mes genoux et lui dis que je possédais un instrument qui la ferait jouir bien plus que mes doigts et que ma langue.
— Vraiment, dit-elle, où est-il ? J’aimerais bien à le voir.
— Mais il ne faudra pas le dire ?
— Oh ! non.
Je sortis alors ma pine toute raide qu’elle fixa avec stupeur. Elle n’avait réellement jamais vu de pine quoiqu’elle eût été évidemment déflorée par une pine, car j’avais exploré son con avec mes doigts et n’avais pas trouvé de virginité. Je la lui mis dans la main et elle la pressa tendrement.
— Cette énorme affaire ne pourrait jamais entrer dans mon ventre ; regardez, elle est plus grosse que tous vos doigts rassemblés, et vos deux doigts sont déjà très serrés.
— Oui, chérie, mais la petite fente est élastique et est faite pour recevoir cette grosse affaire.
Tout en causant, je branlais son clitoris avec mes doigts, elle devint tout à fait en chaleur ; aussi, je lui dis :
— Laisse-moi essayer et, si ça te fait mal, je m’arrêterai. Tu sais, je suis toujours gentil avec toi.
— C’est vrai, mon bon ami, mais prenez bien garde de ne pas me faire souffrir.
Elle se coucha sur le lit, comme je voulus, avec les jambes bien écartées et les talons ramenés près des fesses. Je crachai sur ma pine, dont je mouillai la tête et la partie supérieure, je l’approchai de son con, bien lubrifié par ma salive pendant que je l’avais gamahuchée, j’entr’ouvris avec ma main gauche les grosses lèvres et j’enfonçai la moitié de la tête avant d’arriver à sa véritable entrée.
— N’aie pas peur, chérie, je ne te ferai pas de mal, et j’entrai tout à fait la tête et même un pouce en plus.
— Arrêtez, cria-t-elle, on dirait que vous allez me déchirer ; vous m’écartelez.
— Mais cela ne te fait pas encore mal, chérie ?
Je m’étais immédiatement arrêté avant de faire cette question.
— Non, pas exactement, cela me fait l’effet comme si j’avais quelque chose dans la gorge qui m’étouffe.
— Repose-toi un peu et cela va passer.
Je glissai un doigt sur son clitoris et elle devint de plus en plus excitée à mesure que je le branlais, serrant délicieusement ma pine dans son con. Elle avançait graduellement, car je continuai à pousser sans faire de mouvements. La moitié était déjà dedans, quand elle déchargea, ce qui non seulement lubrifia l’intérieur, mais fit relâcher les muscles intérieurs, et un doux mouvement en avant me logea jusqu’au fond ; je restai alors immobile jusqu’au moment ou elle revint de l’extase de volupté que lui avait procurée la décharge ; les pressions intérieures de son con augmentèrent et me prouvèrent que ses passions étaient de nouveau allumées. Elle ouvrit ses yeux et, me regardant amoureusement, dit que je lui avais procuré un très grand plaisir, mais elle sentait comme si quelque chose d’énorme la déchirait intérieurement.
— Est-ce que tout est dedans ?
— Oui, chérie, et, maintenant, cela va te donner un plaisir encore plus grand qu’auparavant.
Je commençai un lent mouvement de va-et-vient, branlant son clitoris en même temps, car j’étais debout entre ses jambes. Elle devint bientôt folle d’excitement, son derrière se levant et s’abaissant comme si elle n’avait fait que ça toute sa vie ; la nature prenait ses droits et la guidait mieux que tout. La combinaison nouvelle de la pine et du doigt amena rapidement la crise finale.
Moi aussi, j’étais fou de luxure, aussi nous déchargeâmes en même temps, en éprouvant des ravissements qui nous anéantirent tous deux entièrement. Nous restâmes quelque temps à savourer la langueur qui suit de pareilles voluptés. Ma chère Jane me demanda de lui donner un peu d’eau, car elle sentait qu’elle allait s’évanouir. Je me retirai, bandant encore énormément, je pris un peu d’eau, l’aidai à s’asseoir sur le sofa et l’embrassai amoureusement, la remerciant pour les exquises jouissances qu’elle m’avait procurées. Elle jeta ses bras autour de mon cou et, les larmes aux yeux, me dit qu’elle m’aimerait toujours, que je devais toujours l’aimer, car maintenant elle ne pourrait plus vivre sans moi. Je séchai ses larmes sous mes baisers et lui dis qu’à l’avenir elle jouira encore davantage quand elle y sera mieux habituée.
— Laissez-moi voir la chère affaire qui m’a donné tant de plaisir.
Je la sortis de mon pantalon, mais comme elle ne bandait pas, Jane fut très surprise. Je lui expliquai la nécessité pour laquelle ça devait être ainsi, mais qu’elle la verrait rapidement se redresser et revenir au même état de raideur qu’auparavant si elle continuait à la manier aussi gentiment. Elle bandait déjà avant que je n’eus fini ma phrase. Elle la caressa et même se baissa pour embrasser sa jolie tête rubiconde. Nous en serions vite arrivés à tirer un nouveau coup si nous n’avions été rappelés à nous par la sonnette que la tante tirait d’en bas pour appeler Jane : aussi, après avoir à la hâte arrangé ses cheveux et sa robe, elle descendit en emportant des menus objets du déjeuner.
Naturellement, un commencement aussi bon fut suivi de répétitions constantes, et Jane devint bientôt extrêmement passionnée, et, grâce à mes bonnes leçons, une fouteuse de premier ordre.
Comme tous mes chers amis n’étaient pas encore à Londres, j’étais heureux d’avoir cette « bonne bouche » pour m’entretenir. Mes sœurs passaient tous leurs dimanches avec moi et je les foutais à pleines cuisses sans jamais provoquer aucun doute dans la maison.
J’étais depuis un mois locataire de monsieur Nichols, lorsque la sœur de Jane arriva. C’était une femme bien plus belle que Jane, de larges épaules, une poitrine rebondie et ferme, n’ayant pas souffert de son accident, comme je pus m’en convaincre quelques jours après, car elle n’avait pas allaité son enfant. Ses hanches étaient très prononcées et elle avait un cul superbe. D’un tempérament très passionné, elle devint de plus en plus lascive quand elle eut tâté de l’énorme pine que je possède, et elle fut une des meilleures fouteuses que j’aie jamais rencontrées. Son casse-noisette était aussi puissant presque que celui de ma tante.
Jane était blonde, Anne était brune, avec des cheveux et des poils du cul très noirs, une fente très longue, mais avec un tout petit trou et, au-dessus, un superbe mont de Vénus très prononcé et tout couvert d’une épaisse forêt de poils. Son clitoris était large et raide, mais très court. Elle devint aussi très friande de se faire foutre dans le cul et aimait spécialement à ce que j’y décharge dedans. C’était un peu pour éviter qu’il ne lui arrive un deuxième « accident ».
À son arrivée, Jane eut une très grande peur de voir notre intimité découverte par elle, et nous prenions toutes les précautions, quoiqu’au fond du cœur je désirasse que cela arrive, car, comme elle me servait à l’occasion, j’étais devenu très avide de posséder ses charmes qui, quoique cachés, ne m’en excitaient que davantage. Chaque fois qu’elle entrait seule chez moi, je lui faisais des compliments de son corps superbe ; mais, comme Jane était toujours autour de nous, je m’en tenais aux compliments.
Un matin, j’entendis monsieur Nichols dire à Jane de mettre son chapeau pour aller faire une commission dans Oxford Street. Je me doutais qu’Anne allait alors me servir et, ne courant pas le risque d’être dérangé par Jane, je me déterminai de suite à brusquer le dénouement.
Nous étions devenus de bons amis et quand elle eut apporté à déjeuner je la priai de m’aider à mettre mon habit, ce qu’elle fit avec plaisir ; je la remerciai et, lui passant un bras autour de la taille, je l’attirai à moi et l’embrassai.
— Halla ! dit-elle, qu’est-ce que ça veut dire ?
Mais elle n’essaya pas de se retirer, aussi, lui donnant un nouveau baiser, je lui dis qu’elle était une magnifique femme et qu’elle m’excitait énormément.
Je tenais une de ses mains et, avant qu’elle pût se douter de ce que j’allais faire, je la plaçai sur ma pine qui pointait au travers de mon pantalon, comme si elle allait le déchirer. Elle ne put s’empêcher de la serrer en s’écriant :
— Seigneur Jésus ! Quelle énorme affaire vous avez !
Sa figure s’enflamma, ses yeux brillèrent du feu de la luxure, elle essaya de la prendre tout à fait.
— Arrête, lui dis-je, je vais te la mettre dans la main dans son état de pure nature.
Je déboutonnai ma braguette et ma pine frémissante sauta hors de mon pantalon ; elle s’en saisit de suite, la regarda amoureusement et la serra gentiment. Elle devenait évidemment de plus en plus excitée, aussi je lui proposai de suite de la foutre ; mais pensant qu’il valait mieux être très franc et la mettre à son aise, je lui dis que je connaissais l’ « accident » qui lui était arrivé, mais que, si elle voulait se laisser enfiler, je lui promettais, sur mon honneur, de ne pas décharger dedans et d’enlever ainsi toute chance de lui faire enfler le ventre.
— Puis-je me fier à vous, dit-elle ?
— En toute sûreté, ma chère.
— Alors, vous pouvez me la mettre, mais, auparavant, laissez-moi embrasser cet objet chéri.
Se courbant alors, elle l’embrassa avec passion et, en même temps, elle frissonna avec plaisir à la suite d’une copieuse décharge, que lui avait occasionné la vue et le toucher de cette énorme saucisse. Elle poussa deux ou trois « oh ! » et me menant vers [le] lit en me tenant toujours par la pine, elle s’y coucha à la renverse en relevant tous ses jupons.
Je pus alors jouir de la vue de son con dans toute la magnificence de sa longueur et de sa fourrure. Je tombai à genoux et collai mes lèvres à cette entrée humide, car elle était une de celles qui déchargent toujours très copieusement ; son con avait une odeur délicieuse de foutre ; le sien était très épais et très gluant pour une femme. Je léchai son clitoris, la rendant absolument folle de désirs ; aussi s’écria-t-elle :
— Oh ! mets-moi ton immense pine, mais rappelle-toi ta promesse.
J’approchai ma pine de ce con bien fendu, avec des lèvres larges et saillantes ; je pensai, quoique très grosse, que je pouvais très facilement y glisser ma pine d’un seul coup jusqu’au-dessous de la tête ; aussi on peut imaginer ma surprise de trouver la plus petite et la plus étroite entrée du vagin que j’aie jamais rencontrée ; ce fut vraiment avec la plus grande difficulté que je pus opérer l’introduction ; j’en avais eu beaucoup moins avec sa jeune sœur dont le con ne paraissait pas aussi largement fendu. Je me sentis aussi étroitement serré que la première fois que j’enfilai Ellen. Tout étroit que c’était, elle n’en ressentait pas moins un plaisir délicieux ; elle se mit de suite à manœuvrer ses fesses, et elle était réellement une des fouteuses les plus voluptueuses et les plus lascives que j’aie pu rencontrer pendant toutes mes expériences, qui ont été très nombreuses.
En la branlant et la foutant, je la fis décharger six fois avant de retirer subitement ma pine dont je pressai la tête entre ses lèvres et mon propre ventre pour décharger en dehors. Peu de temps après, je bandai à nouveau et, cette fois-ci, après avoir déchargé aussi souvent que la première fois, car elle était affreusement voluptueuse, elle se glissa de dessous moi subitement quand je déconnai et, saisissant ma pine d’une main, se baissa, prit la tête entre ses lèvres et me fit rapidement couler un torrent de foutre dans sa bouche ; elle avala tout, tout en continuant à sucer, à ma plus grande joie.
Nous aurions certainement tiré un troisième coup si elle n’avait pas été obligée de descendre rejoindre sa tante.
Je déjeunai et sonnai à nouveau. Nous eûmes encore une délicieuse fouterie et une quatrième quand elle vint faire le lit et apporter de l’eau. Cette fois-ci je la priai de se mettre à genoux sur le sofa, afin que je puisse voir son magnifique cul et, quand je déconnerais, je lui montrerais un moyen de continuer le plaisir pour nous deux.
Aussi, après l’avoir foutue par derrière et l’avoir fait décharger plusieurs fois, je déconnai et, passant ma pine entre les lèvres de son con contre son clitoris où je lui fis continuer ses mouvements de va-et-vient, ce qui la fit encore décharger en même temps que moi, qui inondai son ventre de foutre. Elle déclara que c’était presque aussi bon que dedans.
Je lui proposai ensuite d’enfoncer un peu la tête dans son trou du cul, juste assez pour pouvoir décharger dedans.
Elle consentit avec une certaine répugnance d’abord, mais par la suite, non seulement elle laissait entrer la tête, mais elle exigeait que je lui enfile toute la pine, ce qui la faisait énormément jouir. Généralement c’était toujours là que je faisais la décharge du premier coup, mais le second se tirait toujours entièrement dans son cul ; aussi elle devint bientôt une « enculeuse » de première force.
Les deux sœurs s’aperçurent bientôt que je les foutais toutes les deux, aussi il arriva qu’elles descendaient doucement de leur chambre où elles couchaient toutes deux dans le même lit, pour venir me trouver et jouir de délicieuses fouteries et d’un double gamahuchage.
Anne baisait plus voluptueusement et plus lascivement, mais la petite Jane avait un certain charme de jeunesse et de fraîcheur qui me la faisait souvent préférer à Anne.
Nous continuâmes ainsi pendant plusieurs semaines, jusqu’au moment où l’habitude leur fit négliger certaines précautions relatives au bruit.
La tante, quand elle n’avait pas de locataire pour occuper la chambre, couchait au-dessus de nous, et un matin, étant réveillée, quoiqu’il fît à peine jour, elle entendit nos voix, descendit et me surprit en train de foutre Anne et de gamahucher Jane qui se tenait devant elle en présentant son con à ma langue amoureuse. Un cri d’exclamation de la tante nous fit tous lever instantanément.
— Allez vous coucher, misérables coquines !
Elles s’enfuirent sans un moment d’hésitation.
Madame Nichols commença alors à me réprimander sur l’infamie de ma conduite. Je m’approchai de la porte comme pour prendre ma chemise, car j’étais entièrement nu, je fermai la porte à clef, je revins alors vers madame Nichols qui avait apparemment oublié qu’elle n’avait sur elle qu’une courte chemise, qui, non seulement laissait voir des tétons larges, blancs et fermes, mais n’arrivant qu’au milieu des jambes, découvrait des jambes remarquablement bien faites, des petits genoux, laissant deviner, en les indiquant légèrement, que dessous se trouvaient de fort belles cuisses.
Comme j’avais été interrompu au milieu d’un coup, j’avais encore ma pine dressée etaffreusement raide, car j’étais excité aussi par les beautés que madame Nichols me montrait si inconsciemment ; m’approchant d’elle, je la saisis à la ceinture par derrière, la poussai en avant, et avant qu’elle pût comprendre ce qui lui arrivait, je l’avais courbée sur le bord du lit où je découvris son cul magnifique, et m’enfonçai ensuite dans son con jusqu’aux couilles.
Elle cria à l’assassin, mais comme personne ne pouvait entendre, excepté les nièces, je savais que je ne serais pas interrompu. Je continuai à la foutre malgré ses cris, et passant ma main autour de sa taille, je lui chatouillai avec le doigt son clitoris qui se dressa dans des proportions superbes. Ma grosse pine, aidée du branlage du clitoris, produisit son effet naturel ; malgré elle, elle se mit à jouir. Je sentis les serrements de son con et m’aperçus que ses passions étaient enflammées.
Au lieu de continuer à résister, elle se mit à crier par saccades : « Oh ! oh ! » Elle respirait bruyamment et tortillait son splendide cul avec une grande volupté, et au moment où je déchargeais, elle aussi fut prise de l’extase finale de la volupté. Elle demeura palpitante, enfilée par ma grosse pine qui n’avait pas débandé. Je recommençai un mouvement lent, elle ne fit aucune résistance, se contentant de crier : « Oh ! cher ! oh ! cher ! » comme si elle ne pouvait s’empêcher de jouir, malgré tous ses regrets. Cependant, à la fin, elle dit :
— Oh ! quel homme vous êtes, monsieur Roberts ; c’est bien mal à vous d’agir ainsi, mais je ne puis m’empêcher de jouir. Voilà des années que je n’ai pas éprouvé pareille chose, mais vous me l’avez si bien mis que je ne désire qu’une chose, c’est que vous recommenciez. Changeons de position.
— Je veux bien, mais il faut que vous quittiez cette chemise gênante ou je ne déconne pas.
Comme sa lubricité était alors excitée, elle ne fit aucune objection, aussi je déconnai et nous nous tînmes debout ; elle passa sa chemise par-dessus sa tête et elle étala des formes bien plus belles que je n’aurais cru.
— Ma chère madame Nichols, quelles admirables formes vous possédez ! Laissez-moi vous serrer dans mes bras.
Elle le fit sans répugnance, se trouvant flattée par mes compliments. D’une main elle s’empara de ma pine, me serrant tendrement contre elle de son autre bras, pendant que je caressais d’une main son cul magnifique et de l’autre je pelotais une paire de tétons aussi durs et aussi fermes que ceux d’une jeunesse de dix-huit ans. Nos bouches se rencontrèrent dans un baiser passionné et nos langues se cherchèrent.
Alors elle dit :
— Vous m’avez rendue bien vilaine, aussi laissez-moi m’enfiler encore cette chère et monstrueuse pine.
Je répondis que je devais d’abord admirer ses beautés, spécialement son énorme et ravissant derrière. Elle se tourna elle-même de tous côtés, heureuse de voir que je l’admirais avec conviction.
Elle s’étendit alors sur le dos, écartant bien les cuisses, et m’appela pour monter sur elle et l’enfiler.
— Il faut d’abord que j’embrasse ce magnifique con et suce ce superbe clitoris.
Son mont de Vénus était couvert de poils épais, soyeux et de couleur marron ; son con était large avec de grandes lèvres épaisses entièrement couvertes de poils de chaque côté. Son clitoris sortait raide et rouge d’au moins trois pouces de long ; je le pris dans ma bouche, le suçai et branlai son con avec mes doigts qui entrèrent avec la plus grande aisance, mais qui furent étroitement serrés aussitôt qu’ils eurent pénétré ; je suçai et branlai jusqu’à ce qu’elle déchargeât en poussant des cris de voluptés. Je continuai de sucer et de l’exciter, ce qui la fit bientôt crier :
— Oh ! cher monsieur, venez et enfoncez votre énorme pine dans mon con avide et qui n’en peut plus.
Je lui sautai dessus et la lui introduisis jusqu’à ce que nos poils se frottassent les uns contre les autres. Elle me tint serré contre elle pendant une minute, puis elle commença à manœuvrer du cul comme une bacchante sauvage en poussant des exclamations voluptueuses et ordurières.
— Enfonce-moi bien ta grosse pine ! plus vite ! plus fort ! oh ! tu me fais mourir de bonheur !
Elle connaissait à fond l’art de foutre, me procura un plaisir exquis et, je puis ajouter, me prouva par la suite être une femme connaissant les grandes variétés de jouir, et elle devint une de mes plus ferventes admiratrices.
Notre intimité dura pendant des années, car l’âge, comme le bon vin, ne faisait que la rendre encore meilleure. Son mari n’était pas un mauvais fouteur, mais comme il n’avait qu’un petit vit, il n’avait jamais excité ses passions comme je le faisais avec ma grosse andouille.
Pour cette première, nous tirâmes encore trois coups dont elle parut jouir de plus en plus.
Comme j’avais auparavant pas mal foutu les nièces, ma pine à la fin refusa de bander et d’opérer. Je fus obligé de m’arrêter de la foutre, mais je la gamahuchai encore une fois après l’avoir fait poser pour admirer son corps si merveilleusement beau et bien conservé. Elle suça longtemps ma pine sans arriver à la faire dresser.
Nous nous séparâmes enfin, mais non sans qu’elle m’eût promis de venir coucher avec moi la nuit prochaine, et je puis assurer que ce fut une magnifique nuit.
J’eus la plus grande difficulté pour l’amener à me laisser continuer à jouir de ses nièces, mais elle y consentit et je passais une nuit avec la tante et une nuit avec les nièces.
Comme je l’ai déjà dit, Anne était la plus chaude et la plus voluptueuse femme que j’aie connue. Je leur avais parlé de la beauté des formes de leur tante, de son prodigieux clitoris et de sapassion pour se faire gamahucher. Ce qui réveilla la passion lesbienne de Anne pour gamahucher sa tante.
À la fin je persuadai cette dernière de permettre à Anne de se joindre à nous et toutes deux furent ensuite ravies de cela, car elles étaient par nature tribades, et elles se faisaient jouir mutuellement pendant que je les foutais chacune à leur tour.
Madame Nichols aussi une fois qu’elle eut goûté de l’enculage voulut y revenir souvent et nous faisions ensemble les plus folles orgies.
Cependant, mon très cher ami Mac Callum était revenu à Londres. Il habitait les environs, mais il avait loué un petit appartement à la Taverne du Lion, composé d’un salon et d’une chambre à coucher, où il avait une collection complète de gravures et livres érotiques qui excitaient à l’excès les passions amoureuses.
C’était là que je menais mes sœurs, et tous les dimanches, nus tous quatre comme Adam et Eve, nous jouissions autant qu’il est possible de jouir,
À la Noël, mon oncle, ma tante, madame Dale, Henry et Ellen vinrent tous à Londres et allèrent se loger au même endroit où madame Dale et son fils s’étaient logés lors de leur précédent voyage à Norfolk Street, où nous fîmes les plus grandes orgies.
J’avouai que j’avais débauché mes sœurs pendant le mois que j’étais resté seul avec elles et demandai la permission de les introduire dans la société. Mon oncle, ma tante et Henry furent enchantés de cette idée, mais madame Dale et Ellen n’étaient pas contentes. Cependant comme la majorité était pour elles, ma tante alla les chercher à la pension pour leur faire passer les vacances avec nous.
Je les avais prévenues de se taire sur nos jouissances antérieures et de dire comme moi qu’il n’y avait que fort peu de temps que je les avais initiées, mais qu’elles aimaient ça à la folie.
Elles amenèrent un surcroît de jouissances à la société. Mon oncle les affectionnait et ne se lassait jamais de foutre, sucer ou gamahucher leurs splendides charmes. Ma tante, qui avait la passion des jeunes et fraîches femmes, professait pour elles une admiration sans bornes et les gougnottait constamment.
Je mis Henry dans le secret de nos réunions avec Mac Callum et, avec l’assentiment de ce dernier, je l’introduisis dans nos jouissances à la taverne.
Mac Callum était très friand du joli cul étroit du jeune Dale ; il aurait aussi voulu que j’introduise Ellen ; je lui en causai et à la fin elle se joignit aussi à ces petites orgies particulières.
En mars, madame Benson, madame Egerton et leurs maris vinrent à Londres.
J’avais écrit aux Benson et j’avais reçu un mot d’« Elle » me prévenant du jour de son arrivée, J’allai de suite leur rendre visite, et la trouvant seule, car son mari était allé à la cité pour affaires, je fus reçu avec joie.
Après nous être jetés dans les bras l’un de l’autre, nous étions trop excités pour nous attarder à des préliminaires, un sofa reçut nos corps en feu, et avant qu’on eût le temps d’y penser, les cuisses furent ouvertes, le con envahi et le plus rapide coup, trop rapide même, fut tiré.
Pendant que nous revenions de ce premier délire de jouissance, nous eûmes le temps d’échanger quelques paroles d’admiration sur les changements qui s’étaient opérés pour nous deux ; mais ce ne fut qu’après l’avoir foutue quatre fois, fait décharger le double, que je trouvai le temps de parler des événements passés.
J’avais connu par lettre son intrigue avec madame Egerton et le comte, et j’appris alors de sa bouche de plus grands détails. Elle me dit combien madame Egerton était avide de posséder ma pine si immensément grosse, ajoutant :
— Au fait, elle doit être seule à cette heure, viens la voir, nous pouvons nous amuser aujourd’hui même, ne perdons pas notre temps.
Je n’avais pas vu madame Egerton depuis plusieurs années, en réalité bien avant que je ne foute madame Benson. Nous allâmes la voir et sa réception fut telle que je pouvais la désirer.
Madame Benson nous dit de ne pas perdre de temps et, puisque l’occasion était bonne, de procéder de suite à un enfilage sérieux ; madame Egerton ne fit aucune objection. Madame Benson, s’instituant maîtresse de cérémonies, sortit ma pine, releva les jupons de madame Egerton, nous tourna en face l’un de l’autre et lui fit manier et admirer les dimensions de ma pine ; puis, la faisant mettre à genoux pour que je puisse admirer son magnifique cul, elle guida ma pine frémissante dans son con vraiment délicieux.
Nous tirâmes un coup superbe qui, comme le dit madame Benson, nous mettait à notre aise pour une entrevue qu’elle avait organisée pour le lendemain, pendant laquelle le comte se joindrait à nous, ajoutant que j’aurais alors à rivaliser comme ardeur et vigueur avec le comte.
Nous nous rencontrâmes le lendemain dans une maison tranquille de Percy street, Tottenham court road. Les dames étaient allées au bazar de Soho, laissant leur voiture dans Soho square, sortirent par derrière dans une petite rue, sautèrent dans une voiture et arrivèrent à Percy street.
Il est inutile de dire qu’aussitôt arrivées, elles furent couvertes de baisers et de caresses, puis elles se retirèrent dans une chambre donnant dans celle où nous nous trouvions, afin de se débarrasser de tout ce qui pouvait gêner nos transports amoureux pendant que nous en faisions autant de notre côté. Nous eûmes plus tôt fait qu’elles, et le comte était en train de manier et d’admirer l’immensité de ma pine, lorsque les deux admirables créatures entrèrent dans l’état de pure nature, ce qui nous fit pousser cette exclamation :
— Les femmes sont le mieux parées quand elles ne sont pas du tout parées.
On ne pouvait pas voir deux femmes plus jolies ni plus admirablement bien faites, et aussi voluptueuses et lascives dans leurs passions qu’une femme puisse être ; aussi ce fut pour nous un bonheur de satisfaire leur ardente luxure en les foutant de toutes les manières et en leur faisant sentir pour la première fois les délices de deux véritables pines en même temps. La charmante Benson, comme ma première initiatrice aux mystères de Vénus, réclama ma première décharge, le comte foutant madame Egerton. Nous nous étions placés de manière à nous voir opérer mutuellement, et cela ajoutait beaucoup à notre jouissance. Les chères créatures déchargèrent trois fois pendant que nous déchargions une fois.
La Egerton me réclama alors pendant que le comte remplissait le con que je venais de quitter à la minute.
Nous les fîmes encore décharger trois fois et nous une. Elles préférèrent ces fouteries préliminaires à tous les excès auxquels nous allions nous livrer, car elles excitaient et préparaient leurs passions à de plus voluptueuses étreintes.
Les deux chéries aimaient de temps en temps à sentir une pine dans le cul, mais jusqu’à ce jour elles n’avaient jamais eu l’occasion de sentir une pine dans chaque ouverture en même temps.
La Egerton, pour qui ma pine était une nouveauté, dit qu’elle devait l’avoir dans le con pendant que le comte lui mettrait dans le cul sa jolie pine, mais pas aussi grosse que la mienne.
La pine du comte était presque aussi longue que la mienne, même plus large vers les poils, mais allait en se rétrécissant jusqu’au bout, de sorte que pour l’enculage il avait de bien plus grandes facilités que moi avec mon énorme tête de pine en forme de massue. Cette différence de conformation engagea nos deux créatures à préférer ma grosse pine par devant pendant que le comte occuperait avec la sienne plus effilée les derrières.
Elles se placèrent pour cela entre nous deux, moi dessous et le comte dessus elles. Quoique au commencement ce fût un peu douloureux quand mon gros vit prit place dans leur derrière, elles s’y habituèrent vite, mais pour commencer elles préféraient toujours avoir la pine du comte dans le cul.
La Egerton, comme je l’ai dit plus haut, fit son premier essai de deux pines à la fois, pendant que j’étais sous elle. Je m’étais couché sur le dos et elle s’était allongée sur moi ; la Benson réclama la faveur de diriger les deux instruments de plaisir et, suçant d’abord ma pine, elle la guida vers le con délicieux de son amie, qui se laissa tomber sur mon membre droit et raide, s’empalant délicieusement elle-même et déchargeant le plus copieusement dès qu’elle sentit l’énorme tête arriver jusqu’au fond ; elle se leva et s’abaissa sur elle de la manière la plus passionnée jusqu’à ce qu’elle émît une deuxième décharge, ce qui l’amena à une telle rage de luxure que, se laissant tomber dans mes bras, elle appela le comte pour lui introduire de suite sa pine dans le cul.
Pendant ce temps, la Benson avait lubrifié, en la suçant, la pine du comte, le rendant aussi avide que la Egerton de s’introduire dans son trou de cul. La Benson la dirigea vers l’entrée de ce divin réceptacle, où il s’introduisit de suite sans la moindre difficulté ; mais comme la grosseur de sa pine commençait à faire se dilater la légère membrane qui séparait nos deux pines, la Egerton nous pria de rester un moment immobiles, car cela lui produisait une étrange sensation, pareille à celle que produit une seule pine dans une étreinte sodomique dans un âge plus tendre.
La Benson vint à son aide en priant le comte de tirer environ la moitié de ce qui était entré, et ayant fait mousser un peu de savon dans de l’eau chaude, elle en enduisit la partie inférieure de la pine du comte qui regagna plus facilement le terrain perdu et trouva un logement complet, malgré l’énormité de son affaire dont, comme je l’ai déjà dit, la partie inférieure était d’une grosseur telle que je ne pouvais en faire le tour en l’empoignant d’une main.
La Egerton eut la sensation qu’on lui faisait un seul trou de deux et supplia de cesser pendant quelques minutes.
Nous restâmes tous deux immobiles, excepté les frémissements involontaires de nos pines pressées l’une contre l’autre, car la légère membrane qui nous séparait était tellement étirée, qu’elle était aussi fine qu’une toile d’araignée et que nous ne la sentions pas du tout.
Ces doubles palpitations allumèrent bientôt les passions de la folle lubricité de la Egerton, y répondant d’abord elle-même par des serrements intérieurs de ses deux ouvertures ; puis devenant tout à fait lascive, elle nous cria à tous deux de commencer par des mouvements très lents. Nous allions et venions en cadence, d’abord très doucement, mais la Egerton trouvant que cette manière de faire procurait à ses deux réceptacles une double jouissance, s’écria :
— Oh ! oh ! c’est divin ! foutez plus vite, mes anges fouteurs ! Oh ! plus vite ! oh !… plus vite… oh !… oh !… c’est… c’est trop !
Et elle déchargea dans une agonie de délices, s’évanouissant presque entièrement.
Nous n’avions pas déchargé nous-mêmes, nous nous étions simplement arrêtés pour la laisser jouir entièrement de cette divine décharge. Alors, d’abord avec des palpitations, ensuite avec des mouvements de va-et-vient, nous la rappelâmes rapidement à la réalité et au plaisir.
Ses passions furent plus que jamais excitées, elle remuait son derrière convulsivement de tous côtés, elle disait les mots, les paroles les plus obscènes et les plus ordurières et nous excita tellement que nous arrivâmes tous trois à la crise finale en poussant des cris de la plus grande jouissance et tombâmes dans une agonie de volupté qui nous anéantit tellement que nous restâmes tout à fait insensibles, inondés de foutre dans les deux chères ouvertures où se trouvaient encore compromis nos deux pines satisfaites.
Cependant la Benson, follement excitée par la scène qui se passait sous ses yeux, s’était agenouillée derrière ma tête car nous foutions par terre sur des matelas mis les uns à côté des autres sur le plancher : ensuite amenant un peu en arrière son magnifique cul au-dessus de ma tête, elle avait approché son con de ma bouche et je l’avais gamahuchée continuellement jusqu’au moment où ma propre décharge m’enleva tous mes moyens pour un certain temps.
La Egerton, dans son agonie de jouissance au moment du dernier spasme, avait planté ses dents dans le magnifique cul de la Benson qui se trouvait devant elle, et l’avait mordu si fort que le sang coula et que la Benson se retira précipitamment en avant en poussant un cri de souffrance ; mais nous étions tous trop perdus de plaisir pour entendre le cri qu’elle poussa.
À la fin la Egerton parut revenir à elle. La Benson s’était levée et attendait son tour avec impatience, mais la Egerton supplia de pouvoir encore goûter une fois les joies plus que divines des deux pines englouties en même temps dans son corps, sans éprouver la souffrance de l’introduction dans le cul.
Cela était si raisonnable que la Benson y consentit, de fort bonne grâce.
Le comte, comme compensation, lui proposa de s’allonger sur nos deux corps, de manière à mettre son con suave à portée de sa bouche, qui se trouverait juste à son niveau, puisqu’il était à genoux.
Ainsi il la gamahucha, en pelotant son magnifique cul, auquel il donna le postillon en même temps, et nous formions ainsi un magnifique groupe dédié à la déesse de la volupté.
Nous fîmes durer cette fouterie très longtemps :
Les Egerton avaient certainement déchargé une demi-douzaine de fois et, lorsqu’à la fin, tous deux nous enfonçâmes nos pines avec la sauvagerie de la luxure et que nous déchargeâmes tous trois dans une extase presque mortelle, elle s’évanouit tout à fait et nous effraya tellement que nous usâmes, pour la rappeler à elle, de tous les remèdes qui pouvaient se trouver à notre portée : elle était tout à fait hystérique.
On la mit au lit, et elle ne fut soulagée que par un flot de larmes qu’elle nous assura être des larmes de joie pour les délices inexprimables que nous lui avions fait éprouver. Elle nous pria alors de faire éprouver à la Benson les mêmes jouissances dont nous l’avions gratifiée, et qu’elle serait une paisible et enchantée spectatrice de nos actions.
C’était maintenant au tour de ma bien-aimée Benson d’expérimenter les délices d’une double fouterie. En raison de son amour pour ma splendide saucisse, dont elle avait la première éprouvée les délices, en l’initiant dans son con adultère aux divins mystères de l’amour et, mieux encore, aux joies sacrées et secrètes du second autel réservé à Priape ; en raison donc de ces circonstances et dû constant usage qu’avait fait de son cul son mari, qui possédait une très belle pine, l’initiation à la double jouissance la rendrait moins nerveuse que son amie Egerton, dont le trou du cul était moins habitué que le sien.
La douce Benson se prêta de suite à l’opération et nous seconda par son art à tortiller du cul et aussi par les délicieuses pressions de son con et de son cul ; jouissant de suite et plus rapidement que la Egerton, elle déchargea quatre fois avant que nos sens un peu plus paresseux nous permissent d’arriver à la grande crise finale, qui semblait stimuler la divine Benson à un point de luxure furieuse, qu’elle faisait voir par des paroles de la plus grossière obscénité ; nous criant de lui foutre nos pines plus vite et plus loin, nous appelant de tous les plus sales noms qu’elle put imaginer, et vociférant furieusement quand la finale décharge la saisit au moment où nous inondions l’intérieur de ses deux ouvertures d’un torrent de foutre. Elle tomba alors anéantie par les excès de jouissance que nous lui avions procurés, mais encore frémissante et palpitante du bonheur ressenti.
Nous demeurâmes longtemps dans le délicieux anéantissement d’excès aussi voluptueux.
La chère Benson exerçait ses délicieuses pressions par ses deux ouvertures, qui produisirent bientôt leurs effets habituels, et bientôt la chair donna des symptômes de résurrection aux joies mondaines après avoir passé par les délices divines du paradis, se relevant des plus délicieuses tombes où elles avaient été enterrées. Comme son charmant prédécesseur, elle était trop en chaleur et notre seconde jouissance fut encore, si c’est possible, supérieure à la première ; et dans tous les cas elle dura plus longtemps, car les précédents tirages sur nos pines paresseuses obligeaient un supplément de pompage pour obtenir encore du liquide, ce qui nous procurait un surcroît de plaisir en retardant le moment où nous devions arriver à la grande crise finale.
La Benson, bien plus ingouvernable que nous dans ses passions, avait déchargé six ou sept fois pendant ce second coup et elle tomba dans un anéantissement encore plus profond, si c’est possible, que la première fois et resta entièrement épuisée par l’entière satisfaction de sa rage de luxure pour un certain temps. Nous avions aussi tous deux besoin de repos, aussi nous nous levâmes.
Les deux chères créatures une fois debout éprouvèrent de suite la nécessité de se délivrer des deux cargaisons que nous avions logées dans leurs respectables derrières et disparurent quelques minutes.
Nous nous purifiâmes tous et nous lavâmes avec de l’eau glacée toutes nos parties pour les ranimer plus vite.
Nous nous assîmes alors pour prendre un rafraîchissement stimulant, buvant chacun au moins une bouteille de champagne, tout en parlant de choses cochonnes avec des mots obscènes et orduriers ; et là-dessus je dois avouer que nos chères fouteuses nous étaient supérieures.
Une demi-heure après nous étions à nouveau prêts à entrer en lice. C’était à mon tour de les enculer, mais elles demandèrent grâce pour ce jour-là. La pause du rafraîchissement leur avait donné le temps de ressentir la peine causée par le grand élargissement qu’elles avaient dû subir pour la première fois, aussi mon tour fut remis à trois jours plus tard, ce qui était le délai habituel pour leurs orgies, pour éviter des soupçons par des absences trop fréquentes ; mais cependant elles ne s’opposaient pas à ce que nous les foutions un peu séparément ; aussi nous les foutîmes chacun une fois et nous clôturâmes la séance pour ce jour-là ; elles partirent en nous embrassant passionnément et en nous assurant que leur sens étaient entièrement satisfaits.
Le comte et moi nous nous dirigeâmes à pied vers son domicile, où nous nous restaurâmes avec des grogs au whiskey ; le whiskey étant une de ses boissons favorites, et suivant son opinion, le plus capable de renouveler nos forces épuisées par ces deux charmantes créatures.
Il se félicitait de mon introduction dans ses orgies, car c’était pour lui une aide à la charge qu’il avait seul jusqu’alors de satisfaire ces fouteuses extraordinaires et par devant et par derrière.
Cependant le comte était un fouteur infatigable, mais ces deux cons insatiables l’avaient souvent épuisé, lui faisant faire dans une entrevue plus de besogne qu’il ne pouvait, aussi il avait trouvé dans le whiskey un remède agréable et très efficace. Je fus moi-même très heureux, vu mes excès particuliers à la maison, de connaître un pareil régénérateur. Le comte et moi devînmes deux amis des plus intimes ; grâce à lui je perfectionnai mon italien, et quelques années après, je passais d’heureux mois avec lui en Italie où il put rentrer après une amnistie et recouvrer une partie de ses immenses propriétés ; mais nous raconterons cela quand le moment sera venu.
Le lendemain, j’allai faire visite à mon adorée Benson qui était devenue une magnifique femme, plus amoureuse et plus lascive que jamais.
Nous ne fûmes seuls qu’un instant et ne pûmes nous livrer à l’amour, mais comme nous avions tous deux beaucoup de choses à nous dire, nous nous donnâmes rendez-vous pour le lendemain à la maison de Percy street.
Cette maison était meublée simplement en vue des plaisirs amoureux ; elle était seulement gardée par une vieille femme chargée de mettre tout en ordre après notre départ. Elle était louée au nom du comte, mais payée par les deux femmes qui en faisaient usage. Elles avaient chacune une clef d’entrée et on pouvait y venir quand on voulait.
La chère et libertine Benson m’avoua qu’elle s’en servait avec des fouteurs inconnus du comte ou de Mme Egerton ; comme elle payait largement lavieille femme, elle pouvait faire tout ce qu’elle voulait.
Nous nous rencontrâmes là le lendemain, nous jetant dans les bras l’un de l’autre, et nous nous aidâmes mutuellement à nous déshabiller. Je tirai avec elle trois coups délicieux pendant lesquels la Benson déchargea sept fois, et nous pûmes alors faire une longue et agréable causette sur le vieux temps. Je lui racontai tout, comment la Vincent, mes sœurs, miss Frankland, ma tante, Mme Dale, comment toutes m’avaient cru innocent, recevant la première leçon de leurs cons délicieux, et comment elles m’avaient donné de bons, de véritables et de sages conseils. Elle m’écoutait surprise et émerveillée, et excitée par mes descriptions lascives, elle interrompit trois fois mon récit pour se faire foutre et calmer le feu que j’avais allumé en lui parlant de toutes ces belles femmes. Je lui racontai aussi mes intrigues à mon domicile avec les deux nièces et la tante.
Ma description de cette dernière la rendit folle de luxure et produisit une autre excellente fouterie. Mais ensuite elle me dit que je devais trouver une autre place où Mme Egerton et elle, ou l’une ou l’autre, puissent venir me voir et être reçues sans être le sujet d’observations plus ou moins suspectes.
Je lui dis que je m’étais fait inscrire pour avoir une chambre dans l’intérieur du Palais de Justice et que j’espérais l’avoir dans une ou deux semaines. Cela lui fit grand plaisir, et on verra bientôt que j’obtins un petit logement qui répondait exactement aux projets que nous avions en vue, car il était absolument indépendant et personne ne pouvait remarquer ceux qui entraient ou sortaient ; commode et agréable, c’est tout ce que la chère Benson désirait pour nos réunions particulières, et on y fit les plus grandes orgies d’une luxure insatiable.
Mes descriptions de ma tante, de madame Dale et de miss Frankland, maintenant madame Nixon, avaient excité les passions lesbiennes dont la chère Benson était si friande.
Son clitoris qui était déjà pas mal gros, l’était bien davantage maintenant, et elle adorait gougnotter. Pour cela elle prit une grande passion pour Elise, qui avait ces mêmes goûts très prononcés. Nous avions donc en perspective des orgies effrénées qui se réalisèrent toutes en partie à notre grande satisfaction à tous.
En hommes, nous étions un peu pauvres ; le comte voulut bien consentir à faire partager nos orgies à mon oncle et à Henry Dale. Il n’aimait pas à faire connaître ses goûts d’enculeur à trop de monde, et il n’y consentit qu’en raison des liens étroits qui liaient à moi mon oncle et Henry Dale ; de plus, ce dernier habitant avec moi, il fut presque obligé par force de supporter sa présence. Il fut bientôt ravi de sentir dans son cul la pine d’Henry, pendant qu’il en foutait d’autres.
On remarquera que la timidité du comte écartait de nos orgies mon cher et véritable ami monsieur Mac Callum More. Cependant c’était un avantage dans un certains sens, car avec mes deux sœurs et Ellen, nous avions tout le lot des jeunes filles, car Ellen ne se fit pas tirer l’oreille pour se joindre à nous dans nos orgies à la taverne du Lion.
De plus, notre excellent ami avait aussi de son côté un choix d’hommes et de femmes qui se joignaient à nous par deux ou trois à la fois, car nous ne pouvions pas réunir toutes ces chères créatures en même temps. En revanche, Mac Callum connaissait plusieurs jeunes ganymèdes dont les jeunes trous du cul nous soulageaient beaucoup quand les cons nous faisaient tout à fait défaut.
Nous avions donc ainsi deux catégories bien distinctes d’orgies, qui eurent l’avantage, par le changement qu’elles nous procuraient, de nous exciter davantage et de renouveler notre vigueur qui aurait pu se lasser d’avoir toujours les mêmes personnes.
Comme mes sœurs ne pouvaient venir que le dimanche, c’était un jour exclusif que nous leur consacrions entièrement ; mais, à la longue, je persuadai à Anne de se joindre à nos orgies avec Mac Callum, et dès le premier jour elle prouva qu’elle était un appoint de premier ordre à nos plaisirs.
J’ai déjà relaté qu’elle était d’un tempérament très passionné et une femme aussi lascive et voluptueuse qu’il soit possible de rencontrer, qu’elle était remarquablement belle de formes et qu’elle pouvait rendre fou de luxure les hommes et même les femmes, car, comme ma tante et miss Frankland, elle était très friande des jouissances des tribades. Sa situation de domestique m’empêchait de la présenter à Ellen et à mes sœurs. De plus, par simple prudence, il valait mieux ne pas lui faire connaître notre parenté en raison des libertés qu’elle nous permettait sur leurs charmantes personnes.
Le comte, nos deux charmantes amoureuses et moi, nous réunîmes le jour convenu pour renouveler notre délicieuse orgie. Après avoir foutu les deux chères créatures, nous nous mîmes en position pour la double jouissance.
Nous commençâmes par la Benson, afin que la vue de nos exploits érotiques excite au plus haut degré la chère Egerton. C’était mon tour d’occuper l’autel secret de Priapus pendant que le comte remplirait le con avec délices.
Comme je l’ai déjà dit, le trou du cul de la Benson était bien plus habitué à cela que celui de la Egerton, dont le mari n’avait jamais pensé à une telle « horreur », comme elle appelait ça. Monsieur Benson, au contraire, l’aimait beaucoup, et passait rarement une nuit sans offrir son offrande à cette délicieuse ouverture. Aussi, quoique ce fût seulement la deuxième fois qu’elle se procurait la double jouissance, sa grande lubricité lui fit accepter, avec une bien plus grande facilité, ma grosse pine dans son trou du cul et celle du comte dans son con.
Elle montra une rage de folle luxure, créée par l’exquise extase d’avoir une pine dans chaque ouverture ; elle poussa des cris sauvages de joie divine, déchargea copieusement et à la fin se pâma dans une félicité indescriptible. Elle revint rapidement à elle et réclama une nouvelle opération avant de nous retirer. Naturellement, elle fut immédiatement servie et nous tombâmes anéantis de célestes voluptés.
J’avais tout le temps gamahuché la Egerton qui s’était mise sur les deux corps au-dessous d’elle et dont le con se trouvait par cette position à portée de ma bouche, pendant que mes bras entouraient ses fesses blanches et roses, lui donnant en même temps le postillon aux deux doigts pour augmenter sa jouissance.
Nous nous levâmes après ce second coup et bûmes un peu de champagne ; puis, bandant affreusement raide à la pensée de posséder le corps charmant de la Egerton, nous prîmes la même position qu’auparavant, le comte dessous dans le con, la Egerton sur lui, présentant son magnifique cul à mes baisers d’abord et à ma grosse pine ensuite.
L’adorée Benson l’avait un peu sucée d’abord, et ayant bien mouillé la tête, elle la guida vers l’entrée secrète de l’amour aveugle. La tête fut rapidement logée, quoique procurant encore d’étranges sensations, mais l’attaque de l’autre jour avait rendu l’entrée beaucoup plus facile.
Après un moment d’hésitation, nous commençâmes à opérer et fîmes une première et délicieuse décharge.
Le second coup fut absolument divin et exquis, et par la suite la lascive Egerton préféra cette manière de jouir à toutes les autres.
Ces délicieuses orgies avec ces deux ravissantes femmes se renouvelaient tous les trois jours.
Je devins un ami favori de leurs deux maris, grâce à l’air que je pouvais prendre d’un agneau innocent.
Pendant ce temps, comme j’avais reçu une bonne instruction, que j’étais très studieux, attentif aux classes du collège et désireux de connaître les langues étrangères, je devins assez savant en espagnol et en allemand et pouvais lire le français et l’italien.
Je perfectionnais cette dernière langue avec le comte, car nous n’en parlions pas d’autre ensemble. Peut-être c’était la raison qui faisait que monsieur Egerton me témoignait une plus grande amitié, car il était un très bon élève en italien. L’intrigue de sa femme avec le comte avait été une excellente occasion pour elle de se perfectionner, aussi quand nous dînions tous les quatre ensemble nous parlions toujours italien.
La chère Benson aussi était une parfaite maîtresse de la « langue » du comte, car elle l’avait assez souvent dans la bouche ; et comme c’est un langage très doux qui invite par lui-même à l’amour et à la jouissance, il devint notre langage favori pendant toutes nos orgies.
Au printemps, la charmante Frankland, maintenant madame Nixon, revint à Londres. À cette époque j’étais installé dans mon nouveau logement au Palais ; je l’avais meublé simplement, mais avec tout le confortable nécessaire pour les plaisirs amoureux à deux et pour les plus folles orgies.
Ce fut l’adorable Benson qui l’inaugura et le dédia au service de la Sainte-Mère Vénus et de son fils Cupidon, aussi bien qu’à celui du plus libertin Eros.
Ce fut dans cette circonstance que ces deux créatures folles de luxure insistèrent pour voir le comte et moi nous enculer mutuellement. La Benson me guida dans le cul du comte, qui enculait en même temps la Egerton et la Benson conduisait le comte dans mon cul pendant que je jouissais dans le cul délicieux de mon adorée Benson. Cela satisfit le désir qu’elles avaient depuis longtemps de voir des hommes s’enculer, et cela ne déplut ni au comte ni à moi, qui tous deux, dans le secret de notre cœur, désiraient nous posséder l’un l’autre.
Le comte était un homme puissant et poilu et avait le trou du cul spécialement plein de poils, ce qui m’excitait follement.
Pour cela mon goût différait de celui de mon ami Mac Callum, qui aimait les culs nus de jeunes gens sans un seul poil, me disant que les hommes qui avaient le cul plein de poils le dégoûtaient presque et quoique pendant sa vie de pédéraste il en eût rencontré de pareils, mais c’était toujours avec une certaine répugnance qu’il les opérait.
Je différais pour cela de lui entièrement, car plus le trou du cul d’un homme est grossier et poilu, plus il m’excite, sous ce rapport le comte était entièrement à mon goût. Il avait des poils jusque dessus les fesses, avait la peau très rude et un trou du cul tout noir, tellement il était brun foncé, dont la seule vue me rendait fou de luxure.
Il m’aimait aussi beaucoup, mais pour une autre raison. Sa grande volupté était de branler une belle grosse pine pendant qu’il enculait le propriétaire, aussi, comme il n’en avait jamais trouvé d’aussi grosse que la mienne, il était insatiable pour m’enculer et me branler en même temps.
Nous avions donc tous deux ces deux raisons différentes pour devenir des amis des plus intimes, mais nous laissâmes toujours ignorer à nos amies que nous prenions ensemble des plaisirs auxquels elles ne participaient pas.
La superbe Frankland, maintenant la femme de mon tuteur, vint aussi seule me rendre visite et nous renouvelâmes nos plus folles expériences. Elle m’avoua que cela la soulageait extraordinairement, car quoique son mari monsieur Nixon fût très amoureux et fît tout ce qu’il pouvait, cependant cela n’avait d’autre résultat que de l’exciter pour en avoir davantage, spécialement de ma grosse pine dont elle n’oubliait pas qu’elle avait été la première initiatrice dans les plaisirs les plus secrets de l’amour.
Se trouvant, dans une telle chaleur amoureuse, on peut s’imaginer à quels excès elle se porta pour sucer, gamahucher, foutre et se faire enculer. Je n’ose pas dire combien de fois ce jour-là ni de quelles manières son joli corps m’a fait décharger ; c’est plus que je ne me serais cru capable de le faire.
Quand nous fûmes tout à fait épuisés, nous pûmes, sans nous interrompre, parler de tout ce qui s’était passé depuis le jour où je quittai la maison maternelle ; elle apprit pour la première fois mes aventures dans leurs plus petits détails.
Je lui avais donné, au moment de son mariage, un aperçu de ce qui s’était passé, mais sans détails, qu’elle était maintenant avide d’apprendre ; je lui parlai de la soi-disant séduction de mon oncle et de ma tante, ne cachant pas mes actions avec le jeune Dale, ni la possession d’Ellen et de sa mère, qui fut la dernière à se croire mon initiatrice, car, comme je le dis à ma délicieuse Frankland (je n’ai jamais pu m’habituer à l’appeler madame Nixon), j’avais suivi ses sages avis et, jusqu’au moment de posséder madame Dale, j’avais joué mon rôle de garçon innocent dans la perfection ; mais maintenant que j’étais un homme je n’avais plus recours à ce moyen.
— Vraiment, me dit-elle, et avec qui donc as-tu eu recours à d’autres moyens ?
Je souris à sa demande et lui fis la confession entière de toutes mes autres intrigues.
Elle ne fut pas contente de mes intimités avec les deux servantes, les nièces de mon ancienne propriétaire, pensant que c’était déroger de gratifier deux domestiques d’une pine que n’importe quelle lady serait heureuse de posséder, mais elle fut saisie par ma description des superbes formes et de l’incroyable lubricité de madame Nichols.
Cela l’excita énormément, surtout quand je lui dis qu’elle me rappelait ma chère Frankland par la beauté de son corps et son amour des jouissances.
On verra par la suite quelle intimité ce récit amena entre elle et madame Nichols. Sur ses instances inquisitoriales, j’avouai mon intrigue avec le comte, les Benson et Egerton. Cela excita sa luxure, comme je pus m’en apercevoir à la manière dont ses yeux brillèrent immédiatement, je la foutis délicieusement, et, quand elle se remit de l’extase finale, elle voulut savoir comment j’étais arrivé à une pareille intimité, mais je m’attendais à sa curiosité jalouse et j’étais prêt à la satisfaire. Je lui laissai croire qu’elles avaient passé tout l’hiver à Londres ; je lui dis que ma mère avait désiré que j’aille faire une visite aux Benson, de vieilles connaissances à elle, ce que j’avais fait. Madame Benson, ayant rapidement remarqué combien j’étais supérieurement monté, m’encouragea à lui faire la cour et il ne me restait pas grand’chose à apprendre après ce qui s’était passé avec elle, ma tante et madame Dale. Dans ces conditions, les choses en arrivèrent rapidement à la conclusion naturelle.
Elle fut absolument stupéfiée de l’énormité de mon boudin et, comme elle, ainsi que sa plus tendre amie, recherchaient souvent des fouteurs, je fus de suite présenté à madame Egerton ; elles me possédaient toutes les deux ensemble et me firent confidence de leur intrigue avec le comte, confidence qui fut suivie de mon initiation à leurs orgies.
Mes louanges sur ces deux femmes, ma certitude combien ce serait délicieux pour elle de faire la cinquième et ma description des beautés merveilleuses de la tribade madame Benson, enflammèrent son imagination follement et réveillèrent toutes ses passions de gougnotte ; aussi elle finit par me demander d’inviter à un lunch les Benson et Egerton, de manière à pouvoir leur être présentée, spécialement parce qu’elle paraissait appartenir à une société plus élevée que les connaissances de monsieur Nixon, quoique, au point de vue de la richesse, les Nixon leur étaient bien supérieurs.
Le petit lunch se passa très agréablement : les dames se plurent de suite beaucoup ; voyant cela, je rompis la glace hardiment en disant aux Benson et Egerton que la chère madame Nixon avait été ma première initiatrice, et comme je les avais foutues toutes les deux, la chose la plus sage à faire était de rejeter tout ce qui pouvait nous gêner et de faire une bonne partie de culs tous ensemble. Après un moment d’hésitation, mon discours les mit à leur aise et, sortant ma pine bandant à tout casser, je leur dis :
— Voilà ma pine digne de vos cons exquis, qui les a tous fait jouir et qui a eu aussi beaucoup de plaisir avec eux. Donc, pas d’hésitation, laissez-la vous faire jouir encore. Qui est-ce qui veut être la première ?
Elles se mirent à rire, s’approchèrent toutes pour la tripoter, échangèrent leurs opinions à son sujet et furent d’accord pour reconnaître que c’était la plus belle qu’elles aient jamais vue.
— Ah ! maintenant que je vous ai mises à votre aise, dis-je, faisons-le donc sans cérémonie ; entièrement nus, voilà le mot d’ordre, et jouissons à en mourir.
Elles rirent, s’embrassèrent les unes les autres, reconnurent que j’avais raison et se mirent de suite à se déshabiller.
Le merveilleux et magnifique corps tout couvert de poils de ma chère Frankland les stupéfia et alluma leurs passions de tribades jusqu’à la rage, la Benson spécialement, qui se jeta sur ces superbes formes dans une extase de délices, et, comme les passions de Frankland étaient aussi très excitées, son clitoris sortait long et rouge de cette masse de poils noirs qui couvraient non seulement son ventre et son mont de Vénus, mais tous les environs de son con.
Rien ne pouvait satisfaire la Benson, si ce n’est un mutuel et immédiat gamahuchage qu’avec leurs instincts de gougnottes, ces deux magnifiques et lascives créatures devinèrent être leur passion favorite, et, de suite, se mirent l’une sur l’autre, à se gougnotter mutuellement. La Egerton et moi, nous profitâmes de l’occasion pour tirer un coup délicieux, qui fut achevé avant que les deux autres aient pu satisfaire leurs passions soudaines.
La Frankland, qui était d’abord dessous, était dessus maintenant et, comme elle était agenouillée, poussant son magnifique cul pour l’approcher de la bouche de la Benson, la vue de ce trou du cul poilu m’enflamma du désir de la foutre, ma pine répondit immédiatement à ce désir, aussi, m’agenouillant par derrière, je l’introduisis dans l’ouverture bien connue et l’enculai dans la perfection, ce qui augmenta son ravissement. C’était un autre moyen de les mettre toutes à leur aise ; je les foutis et les enculai toutes jusqu’au moment où ni branlage ni suçage ne purent plus faire relever la tête à ma pine épuisée et vidée.
On peut aisément s’imaginer après cela combien elles furent heureuses de faire participer la belle Frankland à leurs orgies avec le comte. Je n’oublierai jamais la surprise et la luxure du comte lorsqu’il vit pour la première fois les formes superbes et poilues de la divine Frankland, quand elle entra dans la chambre dans toute la splendeur de sa ravissante nudité. Ces deux natures étaient faites l’une pour l’autre, sensuelles au même degré, tous deux vigoureux et infatigables pour les plus grandes orgies de la plus furieuse luxure ; tous deux poilus jusqu’à l’invraisemblance, montraient cette extraordinaire profusion de poils dont leurs deux corps étaient couverts. Ils furent instantanément attirés l’un vers l’autre, se jetèrent dans une mutuelle étreinte et, tombant sur le plancher là où ils se rencontrèrent, tirèrent deux coups de suite avant de revenir à un état plus modéré et plus conforme aux opérations générales. Cependant, toute cette scène nous avait tous considérablement excités.
La Benson était furieusement stimulée par la vue du superbe corps de la Frankland ; son long et rouge clitoris, non satisfait par la double décharge du comte, n’en paraissait, au contraire, que plus excité, et faisait soupirer d’envie l’adorable Benson, Elle se jeta elle-même à contre-sens sur la Frankland avant qu’elle eût le temps de se relever, saisit dans sa bouche le prodigieux clitoris, m’appela pour la foutre par derrière et, introduisant ses doigts dans le cul et le con de la Frankland, se mit alors à opérer partout avec fureur. La chère Frankland répondit en gougnottant le joli clitoris de la Benson et en me donnant le postillon dans le trou du cul. Nous tirâmes deux coups dans cette délicieuse position et, nos passions étant un peu assouvies, nous nous levâmes pour organiser des combinaisons mieux groupées.
Le comte avait enfilé la Egerton pendant que nous étions occupés avec Frankland. Notrepremière pose fut organisée par la Egerton, qui avait moins joui que nous. Elle aussi avait été étrangement excitée par les beautés du corps de Frankland et, spécialement frappée de son clitoris extraordinaire, elle avait le désir de le sentir dans son cul pendant qu’elle se ferait foutre à la gamin par mon énorme pine. Nous partîmes d’un éclat de rire à cette bizarre idée, mais nous consentîmes de suite, et spécialement la Frankland, dont la grande volupté était de foutre toutes les jeunes et jolies femmes avec son long et gros clitoris. On ne pouvait pas trouver une plus jolie créature que la charmante Egerton.
La Frankland avoua qu’au fond du cœur elle avait désiré posséder la Egerton du premier moment où elle l’avait vue, et son plaisir et sa surprise de voir que la chère Egerton désirait aussi la posséder, avait encore davantage enflammé et augmenté ses désirs. Je me couchai sur le dos, la Egerton m’enjamba et, sentant les délices que lui faisait éprouver l’enfoncement seul de ma grosse pine, elle déchargea en donnant seulement deux secousses avec le cul. S’allongeant alors sur le ventre, elle présenta son admirable cul à toute la lubricité de la lascive Frankland, dont la première action fut de se baisser pour caresser, baiser et lécher le joli petit orifice rose, le mouillant avec sa salive ; puis elle approcha son clitoris si extraordinairement long, aussi raide qu’une pine, et encula. Le plaisir qu’elles éprouvèrent toutes deux les enchanta tellement, et leur furieuse imagination était tellement surexcitée, qu’elles ressentirent vraiment des jouissances qu’on n’aurait jamais pu supposer, car, quoique très gros, le clitoris de Frankland ne pouvait être comparé à nos énormes pines.
Nous nous pâmâmes deux fois dans ces délices, et les femmes déchargèrent une demi-douzaine de fois pendant que moi une seulement.
J’avais aidé la Frankland en me servant d’un double godmiché qui remplissait les deux ouvertures en même temps. Cet excellent instrument était une invention de Frankland, qui l’avait suggérée à un fabricant parisien de godmichés et qui en avait fait de plusieurs calibres. Ils devinrent très utiles dans nos orgies.
Pendant notre accouplement avec la Egerton, enculée par le clitoris de Frankland, le comte avait d’abord enconné, puis ensuite enculé la Benson à leur satisfaction mutuelle. Nous nous levâmes tous, nous lavâmes et nous rafraîchîmes avec du vin et des biscuits, tout en discutant ce que nous allions imaginer comme pose nouvelle. Le comte n’avait pas encore enculé la Frankland et suggéré, comme c’était sa première introduction à nos orgies, qu’à cette occasion c’était à elle qu’on réserverait tous les honneurs, que je devais la foutre par devant pendant qu’il la sodomiserait par derrière.
La Benson et la Egerton se serviraient mutuellement du double godmiché ou s’amuseraient comme elles le voudraient.
Ceci fut une rencontre des plus exquises et d’une telle volupté que nous prîmes à peine le temps de respirer entre le premier et le second combat, et nous ne nous retirâmes qu’après avoir inondé trois fois les deux intérieurs.
La Frankland, ravie, n’avait pas cessé de décharger, mais une nature aussi passionnée aurait pu en faire deux fois autant ; mais il fallait aussi penser un peu aux deux autres créatures.
Le comte enfila alors la Benson par devant, pendant que je m’emparai du derrière ; la Frankland encula encore la Egerton qui s’introduisait en même temps un godmiché dans le con ; nous courûmes tous deux courses.
Nous nous levâmes alors pour nous purifier et nous rafraîchir. Quand nos pines furent de nouveau raides, la Egerton voulut m’avoir dans son con et le comte dans le cul, et la Benson, qui était devenue avide de sentir le clitoris de la Frankland, se fit enculer par elle pendant qu’elle introduisait un godmiché dans son con. La Egerton souffrit encore un peu de la double introduction, de sorte que nous ne tirâmes qu’un coup, ce qui nous permit de ménager nos forces, un peu épuisées, pour la fin de la séance, qui se fit par une double introduction dans le superbe corps de la ravissante Frankland.
Nous continuâmes ces orgies jusqu’aux vacances de la mi-automne ; ce fut alors que je présentai Benson, Egerton, Frankland et le comte à mon oncle, ma tante, madame Dale, Henry et Ellen, qui se joignirent à nous dans les délicieuses orgies que nous fîmes dans mon logement du Palais.
Le splendide cul de ma tante captiva la Frankland et le comte. Ce dernier commença par enculer le jeune Dale, ce qu’il fit un jour en arrivant une demi-heure en avance du moment convenu pour le rendez-vous. J’étais présent et je fus tellement excité à cette vue que je m’emparai du cul du comte et l’étonnai en lui faisant éprouver les délices de la double jouissance.
Ce fut après cet événement, comme Henry demeurait avec moi, qu’il fut admis à nos orgies en commun, où nous occupions tout le monde et où nous éprouvions tous les plus voluptueuses et les plus exquises jouissances : de temps en temps, le comte venait nous faire des visites particulières.
Pendant ce temps, Ellen avait été mise dans la même pension où mes sœurs étaient déjà, avec la permission de sortir avec elles le dimanche, jour où nous faisions une délicieuse orgie avec mon cher ami Mac Callum. Lui aussi, comme le comte, avait un goût tout particulier pour l’étroit trou du cul rose d’Henry Dale, sans négliger cependant les femmes, spécialement ma sœur Elisa, qui avait un goût très prononcé pour les plaisirs du cul et ne voulait jamais se laisser enfiler par devant si elle n’avait pas, en même temps, une pine dans le cul, préférant la mienne dans le con, parce qu’elle était plus grosse, et celle d’Henry ou Mac Callum dans le derrière.
Sachant les heures où je ne courais pas le risque d’être interrompu par aucun de mes amis, je ne négligeai pas la superbe Nichols ; je la fis venir, elle et sa nièce Anne, pendant une heure et demie, et je les foutis toutes deux avec ravissement. Je les avais aussi initiées aux plaisirs du cul, pour lequel elles prirent toutes deux un goût très prononcé. Voyant cela, je leur décrivis les jouissances exquises de la double introduction de deux pines d’hommes, remplissant en même temps les deux ouvertures.
Quand une fois j’eus excité leurs désirs sur ce point, je leur parlai de mon cher ami Mac Callum More comme d’un homme à qui on pouvait se fier et, après quelques petites hésitations, j’obtins la permission de le leur présenter. Je lui avais auparavant expliqué l’affaire ; je lui avais dit qu’il trouverait peut-être la Nichols un peu vieille, mais qu’elle avait un corps magnifique et extraordinairement bien conservé ; son corps avait vingt ans de moins que sa figure et que sa lubricité et son amour pour la fouterie la rendaient supérieure à n’importe quelle femme de vingt-cinq ans. Je lui insinuai, en outre, qu’il devait essayer de persuader à Anne ainsi qu’à sa sœur Jane de se joindre à nos orgies à la taverne du Lion.
Nous nous rencontrâmes un certain matin convenu d’avance. J’avais averti Mac Callum de venir en avance et, quand les femmes seraient arrivées, sous prétexte que mon ami ne pouvait pas venir, je les ferais mettre complètement nues et, quand tout serait prêt, il devait apparaître lui aussi entièrement nu, de manière à leur éviter d’un seul coup la fausse pudeur qu’elles auraient pu avoir pour se déshabiller devant lui.
Il fut absolument renversé par la beauté du corps de la Nichols et, comme étranger, nous le laissâmes choisir. Il l’entoura de ses bras nerveux, la dévora de baisers et, se couchant de suite sur un matelas par terre, il la foutit à la vieille mode anglaise, croisant ses jambes et ses bras autour de son corps. Anne et moi, nous regardâmes les splendides tortillements du cul de ma tante et la manière évidente dont elle tétait cette belle pine, chaque fois qu’il soulevait le cul pour la faire entrer avec plus de vigueur jusqu’au fond du con. Nous ne résistâmes pas davantage, et, nous précipitant dans les bras l’un de l’autre, nous tirâmes un coup délicieux, qui nous laissa pâmés et anéantis de délices.
Nos charmantes partenaires avaient déchargé plusieurs fois pendant notre rencontre ; ils désiraient recommencer de suite, mais Mac Callum suggéra de changer de partenaire et de position, par exemple de les faire mettre à genoux, de manière à bien exposer leurs culs ravissants pendant que nous les enfilerions par derrière, mais dans le con.
Le changement s’opéra rapidement ; nous nous plaçâmes de manière à pouvoir voir chacun ce que l’autre faisait. Ce fut une splendide fouterie et, comme notre première fureur était passée, nous fîmes durer le combat excessivement longtemps, obligeant les chers réceptacles à décharger quatre ou cinq fois et nous une seule.
Après avoir savouré un certain moment les joies de cette délicieuse fouterie, nous bûmes du champagne et racontâmes des histoires cochonnes ; nous les complimentâmes surtout sur leur manière délicieuse de foutre ; sentant, nous leurs cons, elles nos pines, de nouveau prêts à recommencer, nous nous mîmes en position pour le prochain combat. Comme c’était leur première initiation aux jouissances de la double introduction, la splendide Nichols eut la première à faire son choix. Elle me choisit pour le con et, à la grande joie de Mac Callum, elle le voulut dans le cul. Anne devait se mettre par dessus nous et se faire gamahucher le con par notre ami. Nous n’éprouvâmes aucune difficulté pour nous enfoncer jusqu’aux poils dans les deux ouvertures, mais cela excita tellement la Nichols qu’un simple palpitement de nos pines, une fois bien englouties, suffit pour la faire décharger en poussant des cris comme un lapin.
Nous lui laissâmes le temps de bien savourer son bonheur, puis nous commençâmes des mouvements lents et réguliers qui rendirent bientôt la Nichols folle de luxure et la firent se pâmer dans une agonie de délices, déchargeant et poussant des cris d’extase. Nous nous arrêtâmes encore pour bien la laisser jouir pour recommencer, lorsque les étreintes de son con et de son cul nous apprirent que son appétit était revenu. Ces pauses nous permirent de la faire décharger sept fois, jusqu’au moment où elle n’en voulut plus, spécialement lorsque tous deux, arrivant ensemble à la crise finale, nous l’inondâmes d’un torrent de foutre. Quand nous reprîmes nos sens, nous soulageâmes la Nichols des cargaisons que nous avions logées dans ses ouvertures.
Elle m’étrangla presque dans ses étreintes pour les immenses jouissances que je lui avais procurées ; se tournant un peu de côté, elle attira à elle Mac Callum et l’embrassa avec passion pour le remercier des voluptés intenses qu’il lui avait fait éprouver.
Après nous être lavés avec l’eau froide pour nous rendre un peu de vigueur, nous nous rafraîchîmes de nouveau, car nous avions besoin de nous restaurer. Alors, Anne prit position à son tour, car, elle aussi, désirait expérimenter la double jouissance avec la plus petite pine dans le cul,
La Nichols, se sentant anéantie pour un moment, se coucha sur le sofa pour jouir de la vue de trois personnes dans le délire et la rage de la lubricité et de la sodomie. L’épreuve enchanta la jolie Anne aussi puissamment qu’elle avait enchanté la tante. Elle aussi déchargea sept ou huit fois avant de nous rejoindre dans notre seule mais épuisante décharge.
La Nichols était restée tranquille pendant environ les deux tiers de l’opération ; elle s’était alors levée pour se mettre sur Anne et moi, afin de se faire gamahucher par le comte son large et magnifique con, mais il la pria de lui présenter son derrière et de bien le soulever en appuyant ses mains sur les épaules d’Anne. Il put alors contempler et manier ses superbes et grosses fesses, puis, transportant ses mains à son con et à son clitoris, il lécha et entra sa langue dans le grand trou de son cul, rude, brun et ridé, absolument comme je les aime.
Nous tirâmes un coup des plus délicieux, finissant dans les joies les plus exquises de la décharge. Anne fut grandement satisfaite de la double jouissance, comme sa tante l’avait été auparavant. Nous nous lavâmes encore et nous rafraîchîmes et terminâmes cette délicieuse orgie ainsi : Mac Callum enfila d’abord le con de Nichols, qui avait ma large pine dans le cul, ce qui, maintenant qu’elle y était habituée, lui était plus que jamais agréable.
Nous fîmes éprouver la même jouissance dans le même ordre, quoiqu’elle eût encore préféré avoir Mac Callum dans le cul et mon gros boudin dans le con. Nous les gamahuchâmes encore une fois toutes deux, car le temps nous manquait pour rebander à nouveau, et elles nous quittèrent enchantées, ravies et satisfaites.
Mon tuteur, pour son mariage, avait acheté une maison à Portland Place, mais le bail des occupants actuels n’expirait que le 30 mars prochain et, avant d’être réoccupée, elle avait besoin d’être entièrement repeinte et décorée, de sorte qu’ils ne purent réellement s’y installer confortablement qu’à la fin juillet. Pendant ce temps, ils occupaient un appartement au coin de Hyde Park.
Quand ils furent alors complètement installés, ce qui n’arriva pas avant le milieu d’août, mon tuteur désira que sa femme envoyât tous les dimanches matin la voiture chercher mes sœurs à la pension. Apprenant qu’Ellen était leur amie intime, il la comprit dans l’invitation. Ceci mit fin à nos orgies du dimanche au logement de notre ami Mac Callum, à notre grand regret à tous.
Quant à ce qui nous concernait Henry et moi, la délicieuse Frankland, qui ne nous oubliait pas, venait à notre secours. Prétendant que les jeunes filles devaient prendre de l’exercice en marchant, elle proposait toujours, après le lunch, de faire une promenade jusqu’au logement de leur frère, de prendre Charles et Henry comme compagnons au jardin zoologique ou au Kensington, et de rentrer tous pour dîner chez monsieur Nixon.
Mon tuteur avait l’habitude de toujours faire la sieste le dimanche, après le lunch, car étant trop vieux pour foutre sa femme toutes les nuits, le samedi soir ou plutôt le dimanche matin, quand il n’avait rien qui l’ennuie, il consacrait une heure ou deux à satisfaire sa femme adorée. Elle me dit qu’il était très amoureux d’elle, qu’il ne pouvait pas la foutre beaucoup, et que les efforts qu’il faisait pour cela étaient au-dessus de ses forces pour son âge, mais qu’il ne se lassait pas de la gamahucher et de la faire poser toute nue dans toutes les attitudes possibles ; naturellement, elle se prêtait à toutes les fantaisies de ce vieillard et lui avait même permis, après s’être fait longtemps prier et pour lui prouver son attachement et son amour, de l’enculer. Comme cette opération nécessitait une pine très raide, elle lui fit le plaisir de le peloter et le sucer jusqu’à ce que sa pine eût atteint la raideur voulue.
Aussi il l’adorait à la folie et elle pouvait en faire tout ce qu’elle voulait. Ses désirs étaient des ordres pour lui, aussi elle faisait tout ce qu’elle voulait.
Plusieurs fois, elle me dit qu’il s’épuisait outre mesure avec elle, qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour modérer ses passions, mais sans succès ; il était fou des charmes de son corps, il avait reçu le « coup de foudre » ou plutôt le « coup de con », qui est la plus forte passion qui puisse saisir un homme, mais qui est dangereuse pour un vieillard.
Aussi, sa sieste du dimanche après-midi était longue et donnait toute facilité à la Frankland pour venir avec mes sœurs à mon logement, où, nus comme Adam et Eve, nous foutions de toutes les manières connues et inconnues.
Je m’aperçus bientôt que nous avions besoin d’un aide ; aussi, avec le consentement de ma chère Frankland, je mis le comte dans notre confidence, lui demandant s’il voulait se joindre à nous dans nos orgies du dimanche.
On peut s’imaginer avec quelle joie il accepta, car, à part son plaisir à voir mes accouplements incestueux avec mes sœurs, leurs jeunes charmes, spécialement ceux d’Elisa, étaient pour lui d’une grande attraction, et aussi la Frankland, si excitante et si lubrique.
Nous fîmes ainsi tous les dimanches après-midi de délicieuses orgies jusqu’à la fin d’octobre de l’année suivante, époque à laquelle mes sœurs finirent leurs études.
Moi aussi je quittai le collège pour entrer au Palais. Je fis un stage de trois mois chez un notaire avant de faire mes études d’avocat.
Ce fut alors que la santé de monsieur Nixon donna de sérieuses inquiétudes, et son docteur lui ordonna de passer l’hiver dans un climat chaud. Sa femme lui fit comprendre qu’un voyage ferait du bien à mes sœurs et à moi ; elle n’eut qu’à exprimer le désir de nous voir tous ensemble, et monsieur Nixon nous invita de suite chaleureusement à les accompagner.
Nous visitâmes la Suisse, Milan, Florence, Rome, où nous nous fixâmes pour quatre mois.
Heureusement, les Egerton et les Benson passèrent cet hiver à Rome.
J’habitais un appartement voisin de celui où logeaient monsieur et madame Nixon, ainsi que mes sœurs et où il n’y avait pas de place pour moi. J’avais un charmant entresol composé de cinq pièces pour moi tout seul ; une d’elles donnait sur le Tibre et n’était dominée de nulle part. C’est dans cette chambre que nous faisions constamment des orgies.
La Egerton avait passé plusieurs hivers à Rome et elle connaissait deux ou trois fouteurs ecclésiastiques qui en avaient présenté deux autres à la Benson lors d’un séjour précédent, et ils étaient tous habitués à faire des orgies en commun.
On peut s’imaginer les délices de ces orgies ecclésiastiques quand ils se trouvèrent introduits dans un cercle de trois jeunes cons frais, nouveaux et si splendides, sans fausse honte ni pudeur, mais prêts à jouir de tous les excès de la luxure.
Nous étions donc six hommes pour cinq femmes ; il y avait surtout un très beau prêtre, jeune mais débauché par les autres, qui faisait partie de nos réunions, et nous fîmes les plus folles et les plus extravagantes orgies de tous genres. Nous nous mîmes à la suite les uns des autres avec la pine au cul ; une femme entre deux hommes, ayant chacune, attaché à la ceinture, un gros godmiché avec lequel elles enculaient les hommes devant elles, pendant que les hommes avaient la pine dans le cul des femmes.
Ces révérends et saints hommes connaissaient une infinité de manières de varier les plaisirs, nous excitant à de tels excès de débauches que la verge fut bientôt obligée d’entrer en action.
Tous, de temps en temps, nous nous procurions le plaisir de la double jouissance, mais les femmes l’éprouvaient à chaque réunion.
Tous ces saints prêtres avaient des pines superbes, mais pas une aussi grosse que la mienne, et tous aimaient à sentir la mienne dans leurs culs quand l’occasion s’en présentait.
L’hiver se passa rapidement au milieu de toutes ces délices.
Au printemps, la santé de monsieur Nixon empira et nous partîmes pour Naples où, par nécessité, nos jouissances amoureuses furent plus rares.
En mai, nous retournâmes en Angleterre, mais le pauvre monsieur Nixon était évidemment foutu. La Frankland me raconta que plus sa santé était mauvaise, plus il était passionné. Sa passion pour lui gamahucher le con s’était encore augmentée et sa pine semblait même reprendre plus de vigueur à mesure que la santé se retirait de son corps, car, chaque nuit, il la foutait dans le con et, le matin, la faisant mettre à genoux, il l’enculait en caressant et admirant ses superbes fesses. Lui et elle sentaient qu’il se tuait, mais c’était plus fort que lui, et il déclara que si ça devait le tuer, il ne pourrait pas mourir d’une plus heureuse mort.
En effet, un mois après notre retour, il fut atteint d’une attaque d’apoplexie au moment où sa pine était engloutie jusqu’aux couilles dans le trou du cul de sa femme. Il vécut encore un mois après.
Il laissa sa fortune entière à sa femme, sauf un legs de 50.000 francs à chacune de mes sœurs, et un autre de 25.000 francs pour moi.