CATHÉDRALE, s. f. De cathedra, qui signifie siége, ou trône épiscopal. Cathédrale s’entend comme église dans laquelle est placé le trône de l’évêque du diocèse[1]. Dans les églises primitives, le trône de l’évêque (cathedra) était placé au fond de l’abside, dans l’axe, comme le siège du juge de la basilique antique, et l’autel s’élevait en avant de la tribune, ordinairement sur le tombeau d’un martyr[2]. L’évêque, entouré de son clergé, se trouvait ainsi derrière l’autel isolé et dépourvu de retable ; il voyait donc l’officiant en face (voy. Autel). Cette disposition primitive explique pourquoi, jusque vers le milieu du dernier siècle, dans certaines cathédrales, le maître autel n’était qu’une simple table sans gradins, tabernacles ni retables[3]. La cathédrale du monde chrétien, Saint-Pierre de Rome, conserve encore le siège du prince des apôtres enfermé dans une chaire de bronze, au fond de l’abside. C’était dans les églises cathédrales, dans ce lieu réservé à la cathedra, que les évêques faisaient les ordinations. Lorsque ceux-ci étaient invités par l’abbé d’un monastère, on plaçait une cathedra au fond du sanctuaire. Ce jour-là, l’église abbatiale était cathédrale. Le siège épiscopal était et est encore le signe, le symbole de la juridiction des évêques. La juridiction épiscopale est donc le véritable lien qui unit la basilique antique à l’église chrétienne. La cathédrale n’est pas seulement une église appropriée au service divin, elle conserve, et conservait bien plus encore pendant les premiers siècles du christianisme, le caractère d’un tribunal sacré ; et comme alors la constitution civile n’était pas parfaitement distincte de la constitution religieuse, il en résulte que les cathédrales sont restées longtemps, et jusqu’au XIVe siècle, des édifices à la fois religieux et civils. On ne s’y réunissait pas seulement pour assister aux offices divins, on y tenait des assemblées qui avaient un caractère purement politique ; il va sans dire que la religion intervenait presque toujours dans ces grandes réunions civiles ou militaires.
Jusqu’à la fin du XIIe siècle, les cathédrales n’avaient pas des dimensions extraordinaires ; beaucoup d’églises abbatiales étaient d’une plus grande étendue ; c’est que, jusqu’à cette époque, le morcellement féodal était un obstacle à la constitution civile des populations ; l’influence des évêques était gênée par ces grands établissements religieux du XIe siècle. Propriétaires puissants, jouissant de privilèges étendus, seigneurs féodaux, protégés par les papes, tenant en main l’éducation de la jeunesse, participant à toutes les grandes affaires politiques, les abbés attiraient tout à eux, richesse et pouvoir, intelligence et activité. Lorsque les populations urbaines, instruites, enrichies, laissèrent paraître les premiers symptômes d’émancipation, s’érigèrent en communes, il se fit une réaction contre la féodalité monastique et séculière dont les évêques, appuyés par la monarchie, profitèrent avec autant de promptitude que d’intelligence. Ils comprirent que le moment était venu de reconquérir le pouvoir et l’influence que leur donnait l’Église, et qui étaient tombés en partie entre les mains des établissements religieux. Ce que les abbayes firent pendant le XIe siècle, les évêques n’eussent pu le faire ; mais, au XIIe siècle, la tâche des établissements religieux était remplie ; le pouvoir monarchique avait grandi, l’ordre civil essayait ses forces et voulait se constituer. C’est alors que l’épiscopat entreprit de reconstruire et reconstruisit ses cathédrales ; et il trouva dans les populations un concours tellement énergique, qu’il dut s’apercevoir que ses prévisions étaient justes, que son temps était venu, et que l’activité développée par les établissements religieux, et dont ils avaient profité, allait lui venir en aide. Rien, en effet, aujourd’hui, si ce n’est peut-être le mouvement intellectuel et commercial qui couvre l’Europe de lignes de chemins de fer, ne peut donner l’idée de l’empressement avec lequel les populations urbaines se mirent à élever des cathédrales. Nous ne prétendons pas démontrer que la foi n’entrât pas pour une grande part dans ce mouvement, mais il s’y joignait un instinct très-juste d’utilité, de constitution civile.
À la fin du XIIe siècle, l’érection d’une cathédrale était un besoin, parce que c’était une protestation éclatante contre la féodalité. Quand un sentiment instinctif pousse ainsi les peuples vers un but, ils font des travaux qui, plus tard, lorsque cette sorte de fièvre est passée, semblent être le résultat d’efforts qui tiennent du prodige. Sous un régime théocratique absolu, les hommes élèvent les pyramides, creusent les hypogées de Thèbes et de Nubie ; sous un gouvernement militaire et administratif, comme celui des Romains pendant l’empire, ils couvrent les pays conquis de routes, de villes, de monuments d’utilité publique. Le besoin de sortir de la barbarie et de l’anarchie ; de défricher le sol, fait élever, au XIe siècle, les abbayes de l’Occident. L’unité monarchique et religieuse, l’alliance de ces deux pouvoirs pour constituer une nationalité, font surgir les grandes cathédrales du nord de la France. Certes, les cathédrales sont des monuments religieux, mais ils sont surtout des édifices nationaux. Le jour où la société française a prêté ses bras et donné ses trésors pour les élever, elle a voulu se constituer et elle s’est constituée. Les cathédrales des XIIe et XIIIe siècles sont donc, à notre point de vue, le symbole de la nationalité française, la première et la plus puissante tentative vers l’unité. Si, en 1793, elles sont restées debout, sauf de très-rares exceptions, c’est que ce sentiment était resté dans le cœur des populations, malgré tout ce qu’on avait fait pour l’en arracher.
Où voyons-nous les grandes cathédrales s’élever à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe ? c’est dans des villes telles que Noyon, Soissons, Laon, Reims, Amiens, qui toutes avaient, les premières, donné le signal de l’affranchissement des communes ; c’est dans la ville capitale de l’Île de France, centre du pouvoir monarchique, Paris ; c’est à Rouen, centre de la plus belle province reconquise par Philippe-Auguste. Mais il est nécessaire que nous entrions à ce sujet dans quelques développements.
Au commencement du XIIe siècle, le régime féodal était constitué ; il enserrait la France dans un réseau dont toutes les mailles, fortement nouées, semblaient ne devoir jamais permettre à la nation de se développer. Le clergé régulier et séculier n’avait pas protesté contre ce régime ; il s’y était associé ; toutefois, quoique seigneurs féodaux, les abbés des grands monastères conservaient, par suite des privilèges exorbitants dont ils jouissaient, une sorte d’indépendance au milieu de l’organisation féodale. Il n’en était pas de même des évêques ; ceux-ci n’avaient pas profité de la position exceptionnelle que leur donnait le pouvoir spirituel ; ils venaient se ranger, comme les seigneurs laïques, sous la bannière de leurs suzerains. « Qui ne s’étonnerait pas, disait saint Bernard[4], de voir que la même personne qui, l’épée à la main, commande une troupe de soldats, puisse, revêtu de l’étole, lire l’Évangile au milieu d’une église ? » Mais les évêques ne tardèrent pas à reconnaître que cette position douteuse ne convenait pas au caractère dont ils étaient revêtus. Lorsque la monarchie eut laissé voir que son intention était de dompter la féodalité, « le clergé sentit aisément[5] que, dans la lutte qui allait s’engager, les seigneurs seraient vaincus ; dès lors il rompit avec eux, sépara sa cause de la leur, renonça à tout engagement, déposa ses mœurs guerrières, et même, abjurant tout souvenir, il ne craignit pas de rivaliser d’ardeur avec le trône, pour dépouiller les seigneurs de leurs prérogatives. Il commença par étendre au delà de toutes limites sa juridiction, qui, dans l’origine, était toute spirituelle ; il lui suffit pour cela d’un mauvais raisonnement, dont le succès fut prodigieux ; il consistait à dire : que l’Église, en vertu du pouvoir que Dieu lui a donné, doit prendre connaissance de tout ce qui est péché, afin de savoir si elle doit remettre ou retenir, lier ou délier. Dès lors, comme toute contestation judiciaire peut prendre sa source dans la fraude, le clergé soutenait avoir le droit de juger tous les procès ; affaires réelles, personnelles ou mixtes, causes féodales ou criminelles… Le peuple ne voyait pas ces envahissements d’un mauvais œil ; il trouvait dans les cours ecclésiastiques une manière de procéder moins barbare que celle dont on faisait usage dans les justices seigneuriales : le combat n’y avait jamais été admis ; l’appel y était reçu ; on y suivait le droit canonique, qui se rapproche, à beaucoup d’égards, du droit romain ; en un mot, toutes les garanties légales que refusaient les tribunaux des seigneurs, on était certain de les obtenir dans les cours ecclésiastiques. » C’est alors que, soutenus par le pouvoir monarchique déjà puissant, forts des sympathies des populations qui se tournaient rapidement vers les issues qui leur faisaient entrevoir une espérance d’affranchissement, les évêques voulurent donner une forme visible à un pouvoir qui leur semblait désormais appuyé sur des bases inébranlables ; ils réunirent des sommes énormes, et jetant bas les vieilles cathédrales devenues trop petites, ils les employèrent sans délai à la construction de monuments immenses faits pour réunir à tout jamais autour de leur siège épiscopal ces populations désireuses de s’affranchir du joug féodal. Cela se passait sous Philippe-Auguste, et c’est en effet sous le règne de ce prince que nous voyons commencer et élever rapidement les grandes cathédrales de Soissons, de Paris, de Bourges, de Laon, d’Amiens, de Chartres, de Reims. C’est alors aussi que l’architecture religieuse sort de ses langes monacals ; ce n’est pas aux couvents que les évêques vont demander leurs architectes, c’est à ces populations laïques dont les trésors apportés avec empressement vont servir à élever le premier édifice vraiment populaire en face du château féodal, et qui finira par le vaincre.
Nous ne voudrions pas que cette origine à la fois politique et religieuse donnée par nous à la grande cathédrale pût faire supposer que nous prétendons diminuer la valeur de cet élan qui se manifeste en France à la fin du XIIe siècle. Il y a dans le haut clergé séculier de cette époque une pensée trop grande, dont les résultats ont été trop vastes, pour qu’elle ne prenne pas sa source dans la religion ; mais il ne faut pas oublier que, chez les peuples naissants, la religion et la politique vont de pair ; il n’est pas possible de les séparer ; d’ailleurs les faits parlent d’eux-mêmes. On était aussi religieux en France au commencement du XIIe siècle qu’à la fin ; cependant, c’est précisément au moment où les évêques font cause commune avec la monarchie, veulent se séparer de la féodalité, qu’ils trouvent les ressources énormes dont l’emploi va leur permettre d’élargir l’enceinte de leurs cathédrales pour contenir tout entières les populations des villes. Non-seulement alors la cathédrale dépasse les dimensions des plus vastes églises d’abbayes, mais elle se saisit d’une architecture nouvelle ; son iconographie n’est plus celle des églises monastiques ; elle parle un nouveau langage ; elle devient un livre pour la foule, elle instruit le peuple en même temps qu’elle sert d’asile à la prière.
Nous allons étudier tout à l’heure, sur les monuments mêmes, les phases de ce mouvement qui se manifeste vers la fin du XIIe siècle.
Poursuivons. L’alliance du clergé avec la monarchie ne tarda pas à inquiéter les barons ; saint Louis reconnut bientôt que le pouvoir royal ne faisait que changer de maître. En 1235, la noblesse de France et le roi s’assemblèrent à Saint-Denis pour mettre des bornes à la puissance que les tribunaux ecclésiastiques s’étaient arrogée. En 1246, les barons rédigèrent un acte d’union « et nommèrent une commission de quatre des plus puissants d’entre eux[6], pour décider dans quels cas le baronnage devait prendre fait et cause pour tout seigneur vexé par le clergé ; de plus, chaque seigneur s’était engagé à mettre en commun la centième partie de son revenu, afin de poursuivre activement le but de l’union. Ainsi l’on voit l’attitude du clergé français quand saint Louis monta sur le trône ; elle était hostile et menaçante. »
Au milieu de ces dangers, par sa conduite à la fois ferme et prudente, le saint roi sut contenir les prétentions exorbitantes du clergé dans de justes bornes, et faire prévaloir l’autorité monarchique sur la féodalité. Dès 1250, le peuple, rassuré par la prédominance du pouvoir royal, s’habituant à le considérer comme la représentation de l’unité nationale, trouvant sous son ombre l’autorité avec la justice, ne montra plus le même empressement pour jeter dans l’un des plateaux de la balance ces trésors qui, cinquante ans auparavant, avaient permis de commencer, sur des proportions gigantesques, les cathédrales. Aussi est-ce à partir de cette époque que nous voyons ces constructions se ralentir, ou s’achever à la hâte sur de moins vastes patrons, s’atrophier pour ainsi dire. Faut-il attribuer cela à un refroidissement religieux ? nous ne le pensons pas ; la nation, sentant désormais un pouvoir supérieur à la féodalité, portait ses regards vers lui, et n’éprouvait plus le besoin si vif, si pressant, d’élever la cathédrale en face de la forteresse féodale.
À la fin du XIIIe siècle, celles de ces vastes constructions qui étaient tardivement sorties de terre n’arrivèrent pas à leur développement ; elles s’arrêtèrent tout à coup ; si elles furent achevées, ce ne fut plus que par les efforts personnels d’évêques ou de chapitres qui employèrent leurs propres biens pour terminer ce que l’entraînement de toute une population avait permis de commencer. Il n’est pas une seule cathédrale qui ait été finie telle qu’elle avait été projetée ; et cela se comprend ; la période pendant laquelle les grandes cathédrales eussent dû être conçues et élevées, celle pendant laquelle leur existence est pour ainsi dire un besoin impérieux, l’expression d’un désir national irrésistible, est comprise entre les années 1180 et 1240. Soixante ans ! Si l’on peut s’étonner d’une chose, c’est que dans ce court espace de temps, on ait pu obtenir, sur tout un grand territoire, des résultats aussi surprenants ; car ce n’était pas seulement des manœuvres qu’il fallait trouver, mais des milliers d’artistes qui, la plupart, étaient des hommes dont le talent d’exécution est pour nous aujourd’hui un sujet d’admiration.
Tel était alors, en France, le besoin d’agrandir les cathédrales, que, pendant leur construction même, les premiers travaux, déjà exécutés en partie, furent parfois détruits pour faire place à des projets plus grandioses. En dehors du domaine royal, le mouvement n’existe pas, et ce n’est que plus tard, vers la fin du XIIIe siècle, lorsque la monarchie eut à peu près réuni toutes les provinces des Gaules à la France, que l’on entreprend la reconstruction des cathédrales. C’est alors que quelques diocèses remplacent leurs vieux monuments par des constructions neuves élevées sur des plans sortis du domaine royal. Mais ce mouvement est restreint, timide, et il s’arrête bientôt par suite des malheurs politiques du XIVe siècle.
À la mort de Philippe-Auguste, en 1223, les principales cathédrales comprises dans le domaine royal étaient celles de Paris, de Chartres, de Bourges, de Noyon, de Laon, de Soissons, de Meaux, d’Amiens, d’Arras, de Cambrai, de Rouen, d’Évreux, de Séez, de Bayeux, de Coutances, du Mans, d’Angers, de Poitiers, de Tours ; or tous ces diocèses avaient rebâti leurs cathédrales, dont les constructions étaient alors fort avancées. Si certains diocèses sont politiquement unis au domaine royal et se reconnaissent vassaux, leurs cathédrales s’élèvent rapidement sur des plans nouveaux comme celles de la France ; les diocèses de Reims, de Sens, de Chalons, de Troyes en Champagne, sont les premiers à suivre le mouvement. En Bourgogne, ceux d’Auxerre et de Nevers, les plus rapprochés du domaine royal, reconstruisent leurs cathédrales ; ceux d’Autun et de Langres, plus éloignés, conservent leurs anciennes églises élevées vers le milieu du XIIe siècle.
Dans la Guyenne, restée anglaise, excepté Bordeaux qui tente un effort vers 1225, Périgueux, Angoulême, Limoges, Tulle, Cahors, Agen, gardent leurs vieux monuments.
À la mort de Philippe le Bel, en 1314, le domaine royal s’est étendu : il a englobé la Champagne ; il possède le Languedoc, le marquisat de Provence ; il tient l’Auvergne et la Bourgogne au milieu de ses provinces. Montpellier, Carcassonne, Narbonne, Lyon, exécutent dans leurs cathédrales des travaux considérables et tentent de les renouveler. Clermont en Auvergne cherche à suivre l’exemple. Les provinces anglaises et la Provence résistent seules.
À la mort de Charles V, en 1380, les Anglais ne possèdent plus que Bordeaux, le Cotentin et Calais ; mais la séve est épuisée : les cathédrales dont la reconstruction n’a pas été commencée pendant le XIIIe siècle demeurent ce qu’elles étaient ; celles restées inachevées se terminent avec peine.
Nous avons essayé de tracer sommairement un historique général de la construction de nos cathédrales françaises ; si incomplet qu’il soit, nous espérons qu’il fera comprendre l’importance de ces monuments pour notre pays, de ces monuments qui ont été la véritable base de notre unité nationale, le premier germe du génie français. À nos cathédrales, se rattache toute notre histoire intellectuelle ; elles ont abrité, sous leurs cloîtres, les plus célèbres écoles de l’Europe pendant les XIIe et XIIIe siècles ; elles ont fait l’éducation religieuse et littéraire du peuple ; elles ont été l’occasion d’un développement dans les arts qui n’est égalé que par l’antiquité grecque. Si les derniers siècles ont laissé périr dans leurs mains ces grands témoins de l’effort le plus considérable qui ait été fait depuis le christianisme en faveur de l’unité, espérons que, plus juste et moins ingrat, le nôtre saura les conserver.
Puisque nous prétendons démontrer que la cathédrale française, dans le sens moral du mot, est née avec le pouvoir monarchique, il est juste que nous commencions par nous occuper de celle de Paris ; d’ailleurs, c’est la première qui ait été commencée sur un plan vaste destiné à donner satisfaction aux tendances à la fois religieuses et politiques de la fin du XIIe siècle.
La cathédrale de Paris se composait, en 860, de deux édifices, l’un du titre de Saint-Étienne, martyr, l’autre du titre de Sainte-Marie ; nous ne savons pas quelles étaient les dimensions exactes de ces monuments, dont l’un, Saint-Étienne, fut épargné par les Normands moyennant une somme d’argent. Les fouilles qui furent faites au midi, en 1845, laissèrent à découvert un mur épais qui venait se prolonger, en se courbant, sous les chapelles actuelles du chœur. La portion visible du cercle donne lieu de croire que l’abside de cette première église n’avait guère plus de huit à neuf mètres de diamètre. En 1140 environ, Étienne de Garlande, archidiacre, fit faire d’importants travaux à l’église de la Vierge. De ces ouvrages, il ne reste plus que les bas-reliefs du tympan et une portion des voussures de la porte Sainte-Anne, replacés au commencement du XIIIe siècle, lorsqu’on construisit la façade actuelle, probablement parce que ces sculptures semblèrent trop remarquables pour être détruites. C’était d’ailleurs un usage assez ordinaire, au moment de cet entraînement qui faisait reconstruire les cathédrales, de conserver un souvenir des édifices primitifs, et l’exemple cité ici n’est pas le seul, ainsi que nous le verrons. En 1160, Maurice de Sully, évêque de Paris, résolut de réunir les deux églises en une seule, et il fit commencer la cathédrale que nous voyons aujourd’hui[7], sous l’unique vocable de Sainte-Marie. En 1196, Maurice de Sully mourut en laissant cinq mille livres pour couvrir le chœur en plomb ; donc, alors, le chœur était achevé jusqu’au transsept, ce que vient confirmer le caractère archéologique de cette partie de Notre-Dame de Paris. Il y a tout lieu de croire même que la nef était élevée alors jusqu’à la troisième travée après les tours, à quelques mètres au-dessus du sol. Eude de Sully, successeur de Maurice, continua l’œuvre jusqu’en 1208, époque de sa mort. La grande façade et les trois premières travées de la nef furent seulement commencées à la fin de l’épiscopat de Pierre de Nemours, vers 1218 ; car ce fut seulement à cette époque, d’après le Martyrologe de l’église de Paris cité par l’abbé Lebeuf, qu’on détruisit les restes de la vieille église de Saint-Étienne qui gênaient les travaux. À la mort de Philippe-Auguste, en 1223, le portail était achevé jusqu’à la base de la grande galerie à jour qui réunit les deux tours. Il y eut évidemment, à cette époque, une interruption dans les travaux ; le style du sommet de la façade et la nature des matériaux employés ne peuvent faire douter que les tours, avec la grande galerie qui enceint leur base, aient été élevés, vers 1235, fort rapidement. Alors la cathédrale était complètement terminée, sauf les flèches qui devaient surmonter les deux tours.



La tradition de la construction romane est donc déjà complètement abandonnée dans la cathédrale de Paris de la fin du XIIe siècle ; il n’y a plus que des piles et des arcs. Le système de la construction ogivale est franchement écrit dans ce remarquable monument.
Malheureusement, cette église reçut très-promptement d’importantes modifications qui sont venues en altérer le caractère si simple et grandiose. De 1235 à 1240[12] un incendie, dont l’histoire ne fait nulle mention, mais dont les traces sont visibles sur le monument, détruisit les charpentes supérieures et les combles E du triforium de la cathédrale (voyez la coupe transversale fig. 2 et la coupe longitudinale fig. 4) ; les meneaux des roses J furent calcinés ainsi que leurs claveaux et les bahuts O du grand comble. Il est probable que la seconde volée I des arcs-boutants et les voûtes du triforium furent endommagées.
Déjà, à cette époque, d’autres cathédrales avaient été élevées, et on les avait percées de fenêtres plus grandes, garnies de brillants vitraux ; cette décoration prenait chaque jour plus d’importance. Au lieu de réparer le dommage survenu aux constructions de Notre-Dame de Paris, on en profita pour supprimer les roses J percées au-dessus du triforium, faire descendre les fenêtres hautes, en sapant leurs appuis jusqu’au point P (voyez la coupe fig. 2, la face extérieure fig. 3 et la coupe fig. 4) ; on enleva le chéneau D, on démolit les arcs-boutants H I à double volée ; on descendit le chéneau D au niveau R, on abaissa les triangles S des voûtes ; on fit sur ces voûtes un dallage à double pente ; les grandes fenêtres A de la galerie furent coupées, ainsi qu’il est indiqué en Q, fig. 3 ; et, n’osant plus laisser isolées les piles K, fig. 2, qui ne se trouvaient plus suffisamment étrésillonnées par les couronnements D abaissés, on établit de grands arcs-boutants à une seule volée de T en V. Les arcs-boutants sous-comble L, détruits par le feu, furent supprimés, et les arcs-boutants M restèrent seuls en place dans une situation anormale, car ils étaient trop hauts pour contrebutter les voûtes du triforium seulement. Les corniches et les couronnements supérieurs X furent refaits, les pinacles Z changés. Les fenêtres hautes, agrandies, furent garnies de meneaux (fig. 3 et 4) très-simples, dont la forme et la sculpture nous donnent précisément l’époque de ce travail. À peine cette opération était-elle terminée à la hâte (car l’examen des constructions dénote une grande précipitation), que l’on entreprit, vers 1245, de faire des chapelles U, entre les saillies formées à l’extérieur par les gros contreforts de la nef[13]. Ces chapelles furent élevées également avec une grande rapidité ; leur construction eut pour résultat de faire disparaître la claire-voie A′ (voyez les fig. 2 et 3)[14] qui donnait du jour au-dessus des voûtes du deuxième bas-côté, et de rendre l’écoulement des eaux plus difficile. En examinant le plan (fig. 1), on peut se rendre compte du fâcheux effet produit par cette adjonction. Les deux pignons du transsept se trouvaient alors débordés par la saillie de ces chapelles. Comparativement à la nouvelle décoration extérieure de la nef, ces deux pignons devaient présenter une masse lourde ; on les démolit, et, en 1257, on les reconstruisit à neuf, ainsi que le constate l’inscription sculptée à la base du portail sud. Entre les contreforts du chœur, trois chapelles au nord et trois chapelles au sud, compris la petite porte rouge qui donnait dans le cloître, furent bâties en même temps, pour continuer la série des chapelles de la nef. Ces travaux, vu leur importance et le soin apporté dans leur exécution, durent exiger plusieurs années. En 1296, Matiffas de Bucy, évêque de Paris, commença la construction des chapelles du chœur, entre les contreforts du XIIe siècle, en les débordant de 1m,50 environ. Ce fut alors aussi que l’on refit les grands pinacles des arcs-boutants de cette partie de l’édifice, et que l’on ouvrit, dans la partie circulaire du triforium, de grandes fenêtres surmontées de gâbles à jour, à la place des fenêtres coupées précédemment. Ces ouvrages durent être terminés vers 1310. En même temps que l’on reconstruisait les pignons du transsept (c’est-à-dire vers 1260), on refit, au nord, un arc-boutant à double volée, le premier après le croisillon. C’était un essai de reconstruction des anciens arcs-boutants du XIIe siècle, probablement conservés jusqu’alors autour du chœur, bien que l’on eût fait subir aux fenêtres hautes, vers 1230, le même changement qu’on avait imposé à celles de la nef. Il n’était plus possible de rien ajouter à ce vaste édifice, achevé vers 1230 et remanié pendant près d’un siècle. Son plan ne fut plus modifié depuis lors ; nous le donnons ici (fig. 5) tel qu’il nous est resté[15].
Dans l’origine, peu ou point de chapelles, un seul autel principal, le trône de l’évêque placé derrière à l’abside. Tout autour, dans des collatéraux larges, la foule ; à l’entrée du chœur, donnant sur le transsept, une tribune pour lire l’épître et l’évangile ; les stalles du chapitre dans le chœur des deux côtés de l’autel. La cathédrale, dans cet état, c’est-à-dire au moment où elle prend une grande importance morale et matérielle, se rapproche plus de la basilique antique que des églises monastiques, déjà toutes munies, à l’abside au moins, de nombreuses chapelles. C’est une immense salle, dont l’objet principal est l’autel, et la cathedra, le siège du prélat, signe de la justice épiscopale. Le monument vient donc ici pleinement justifier ce que nous avons dit au commencement de cet article. Mais un seul exemple n’est pas une preuve ; ce peut être une exception. Examinons d’autres cathédrales de la France d’alors.
À Bourges, il existait encore, au milieu du XIIe siècle, une cathédrale bâtie pendant le XIe, d’une dimension assez restreinte, si l’on en juge par la crypte qui existe encore au centre du chœur et qui donne le périmètre de l’ancienne abside. En 1172, l’évêque Étienne projette de bâtir un nouvel édifice[16]. Toutefois, il ne paraît pas que l’exécution de ce grand monument ait été commencée avant les premières années du XIIIe siècle. En voici le plan (fig. 6)[17].
Les parties supérieures de la cathédrale de Bourges se ressentent du défaut d’unité ; défigurées aujourd’hui par des restaurations barbares qui n’appartiennent à aucune époque, à aucun style, on n’en peut plus juger ; mais nous les avons vues encore, il y a quinze ans, telles que les siècles nous les avaient laissées ; il semblait que l’emploi des sommes successives eût été fait sans tenir compte du projet primitif ; c’était comme une montagne sur laquelle chacun élève à son gré la construction qui lui convient. Les architectes appelés successivement à la terminer ou à consolider des constructions élevées avec des moyens insuffisants, y ajoutèrent, l’un un arc-boutant, l’autre un couronnement de contrefort incomplètement chargé. Certainement celui qui avait conçu le plan et élevé le chœur jusqu’à la hauteur des voûtes avait projeté un édifice qui ne présentait pas ces superfétations et cette confusion ; et il faut se garder de juger l’art des hommes du commencement du XIIIe siècle avec ce que nous donne aujourd’hui la cathédrale de Bourges[19].
La cathédrale de Bourges nous représente mieux encore une salle destinée à une grande assemblée que la cathédrale de Paris, non-seulement dans son plan, par l’absence du transsept, mais dans sa coupe, par la disposition des deux galeries étagées, l’une au-dessus du second bas-côté donnant dans le premier bas-côté, l’autre au-dessus des voûtes de ce premier bas-côté donnant dans la nef centrale. C’était là un moyen de ménager des vues sur le milieu du vaisseau, et de permettre à de nombreux spectateurs de voir ce qui se passait dans la grande nef. Ne perdons pas de vue que les cathédrales n’étaient pas, au XIIIe siècle, seulement destinées au culte ; on y tenait des assemblées, on y discutait, on y représentait des mystères, on y plaidait, on y vendait, et les divertissements profanes n’en étaient pas exclus[20], par exemple, la fête des Innocents à Laon, qui se célébrait le 28 décembre ; la fête des Fous, etc. ; ces farces furent difficilement supprimées, et nous les voyons encore persister pendant le XVe siècle.
Mais les dispositions particulières à la cathédrale de Bourges nous ont fait sortir de la voie chronologique, dans laquelle il est nécessaire de revenir pour mettre de l’ordre dans notre sujet.
En 1131, un incendie terrible détruit la ville de Noyon et sa cathédrale. L’évêque Simon, qui occupait alors le siège épiscopal de Noyon, n’était pas en état de réparer le désastre ; ses finances étaient épuisées par la construction de l’abbaye d’Ourscamp ; alors, le mouvement qui, quelques années plus tard, allait porter le haut clergé séculier et les fidèles à élever des cathédrales sur de vastes plans, n’était pas prononcé. Le successeur de Simon, Beaudoin II, prélat rempli de prévoyance, prudent, régulier, sut administrer son diocèse avec autant de sagesse que d’énergie ; il était lié d’amitié avec saint Bernard, honoré de la confiance et de la faveur de Suger. Dans son excellente notice archéologique sur Notre-Dame de Noyon, M. Vitet croit devoir faire remonter la construction de cette église, telle que nous la voyons aujourd’hui, à l’épiscopat de Beaudoin ; non-seulement nous partageons l’opinion émise par M. Vitet, mais nous serons plus affirmatif que lui, car nous appuierons ses preuves historiques de preuves plus sûres encore, tirées de l’examen du monument même. Nous venons de dire que Suger honorait l’évêque Beaudoin d’une confiance particulière, et Suger était, comme chacun sait, fort préoccupé de la construction des églises ; il fit rebâtir entièrement celle de son abbaye, et les portions qui nous restent de ces constructions ont un caractère remarquable pour l’époque où elles furent élevées. Elles font un grand pas vers le système ogival ; elles abandonnent presque entièrement la tradition romane. Qui Suger employa-t-il pour élever l’église abbatiale de Saint-Denis ? cela nous serait difficile à savoir. L’illustre abbé et ses successeurs ne nous en disent rien ; ils conservent pour eux (et cela se conçoit) tout l’honneur de cette entreprise ; à les en croire, les moines suffirent à tout. Mais il y a, dans l’histoire de cette édification, tant de fables, de faits évidemment présentés avec l’intention de frapper la foule de respect et d’admiration, que nous ne pouvons y attacher une véritable importance historique[21]. Suger était aussi bon politique que religieux sincère ; il était plus qu’aucun autre à même de se servir des hommes que pourrait lui fournir l’époque où il vivait ; c’était un esprit éclairé, et, comme on dirait aujourd’hui, amateur du progrès. Son église le prouve ; elle est en avance de vingt ou trente ans sur les constructions que l’on élevait alors, même dans le domaine royal. Qu’il ait été le premier à former cette école nouvelle de constructeurs, ou qu’il ait su voir le premier qu’à côté de l’école monacale il se formait une école laïque d’architectes, à nos yeux le mérite serait le même ; mais ce qui est incontestable, c’est la physionomie, nouvelle pour le temps, des constructions élevées par lui à Saint-Denis. Or nous retrouvons, à la cathédrale de Noyon, la même construction, les mêmes procédés d’appareil, les mêmes profils, les mêmes ornements qu’à Saint-Denis. Nous y voyons ce singulier mélange du plein cintre et de l’ogive. L’église de Saint-Denis de Suger et la cathédrale de Noyon semblent avoir été bâties par le même atelier d’ouvriers. L’abbé et l’évêque sont liés d’amitié ; Suger est à la tête du pays : quoi de plus naturel que de supposer que l’évêque Beaudoin, le voyant rebâtir l’église de son abbaye sur des dispositions et avec des moyens de construction neufs pour l’époque, se soit adressé à lui pour avoir les maîtres des œuvres et ouvriers nécessaires à la reconstruction de sa cathédrale ruinée par un incendie ? Si ce ne sont pas là des preuves, il nous semble que ce sont au moins des présomptions frappantes. M. Vitet a compris toute l’importance qu’il y a à préciser d’une manière rigoureuse la date de la construction de la cathédrale de Noyon. Cette importance est grande en effet, car la cathédrale de Noyon est un monument de transition, et un monument de transition en avance sur son temps. Il précède de quelques années la construction des cathédrales de Paris et de Soissons. Faudrait-il donc voir, dans l’église de Saint-Denis et dans les cathédrales de Noyon et de Senlis, le berceau de l’architecture ogivale ? Et Suger, à la fois abbé et ministre, serait-il le premier qui eût été chercher les constructeurs en dehors des monastères, qui eût compris que les arts et les sciences étouffaient dans les cloîtres et ne pouvaient plus se développer sous leur ombre ? Voilà des questions que nous laissons à résoudre à plus habiles que nous.
Mais avant d’entamer la description des monuments, que l’on nous permette encore un argument. Saint-Bernard s’était, à plusieurs reprises, élevé contre le goût des sculptures répandues dans les églises clunisiennes ; son esprit droit, positif, éclairé, était choqué par ces représentations des scènes singulièrement travesties de l’Ancien et du Nouveau Testament, ces légendes, cette façon barbare de figurer les vices et les vertus qui tapissaient les chapiteaux des églises romanes. À Vézelay même, au milieu de ces images les plus étrangement sculptées, il n’avait pas craint de qualifier ces arts de barbares et d’impies, de les stigmatiser comme contraires à l’esprit chrétien ; aussi, lorsqu’il établit la règle de Cîteaux, voulut-il protester contre ce qu’il regardait comme une monstruosité, en s’abstenant de toute représentation sculptée.
Les âmes de la trempe de celle de saint-Bernard sont rarement comprises par la foule ; quand elles sont soutenues par des vertus éclatantes, une conviction inébranlable et une éloquence entraînante, tant qu’elles demeurent au milieu de la société, elles exercent une pression sur ses goûts et ses habitudes ; mais sitôt qu’elles ont disparu, ces goûts et ces habitudes reprennent leur empire ; toutefois, de la protestation d’un esprit convaincu, il reste une trace ineffaçable. Faites honte à un homme de ses goûts dépravés, montrez-les-lui sous le côté odieux et ridicule, il ne se corrigera peut-être pas, mais il modifiera la forme, l’expression de ces goûts. La protestation de saint-Bernard ne changea pas les goûts de la nation pour les arts plastiques, heureusement ; mais il est certain qu’elle les modifia, et les modifia en les forçant de se diriger vers le vrai, vers le beau. Cette révolution se fait précisément au moment où les arts se répandent en dehors du cloître, et deviennent le partage des laïques.
À Saint-Denis, les étrangetés contre lesquelles saint-Bernard s’était élevé ont déjà disparu. Dans nos cathédrales des XIIe et XIIIe siècles, il n’en reste plus trace. Sur les chapiteaux et dans les intérieurs, des ornements empruntés à la Flore locale ; jamais ou très-rarement des figures, des scènes sculptées ; il semble que la voix de saint-Bernard tonnait encore aux oreilles des imagiers.
Dans nos cathédrales, l’iconographie se règle sous la haute direction des évêques ; les ouvriers laïques ne tombent plus dans ces bizarreries affectionnées par les moines des XIe et XIIe siècles. La sculpture cherche moins à surprendre ou terrifier, qu’à instruire et expliquer ; ce n’est plus de la superstition, c’est de la foi, de la poésie, de la science.
Ainsi, constatons bien ce fait : avec le besoin d’élever nos grandes cathédrales, naît un système de construction nouveau, apparaît un art nouveau, en dehors de l’influence des ordres monastiques, et presqu’en opposition avec l’esprit de ces ordres.
Revenons à la cathédrale de Noyon. C’est donc vers 1150 qu’elle fut commencée ; l’église de Saint-Denis, bâtie par Suger, avait été dédiée en 1140 et 1144.

Nous donnons (fig. 7) le plan de la cathédrale de Noyon[22]. Le chœur, le transsept appartiennent à la construction de Beaudoin ; la nef paraît n’avoir été terminée que vers la fin du XIIe siècle. Nous ne pouvons mieux faire ici que de citer M. Vitet[23], pour expliquer la forme de ce plan et le mélange prononcé du plein cintre et de l’ogive dans cette église déjà toute ogivale comme construction :
« Lorsque Beaudoin II entreprit la reconstruction de sa cathédrale, il existait à Noyon une commune depuis longtemps établie, et consacrée par une paisible jouissance, mais placée en quelque sorte sous la tutelle de l’évêque. C’est le reflet de cette situation que nous présente l’architecture de l’église. Le nouveau style avait déjà fait trop de chemin à cette époque pour qu’il ne fût pas franchement adopté, surtout dans un édifice séculier et dans une ville en possession de ses franchises ; mais en même temps le pouvoir temporel de l’évêque avait encore trop de réalité pour qu’il ne fût pas fait une large part aux traditions canoniques. Nous ne prétendons pas que cette part ait été réglée par une transaction explicite, ni même qu’il soit intervenu aucune convention à ce sujet : les faits de ce genre se passent souvent presque à l’insu des contemporains. Que de fois nous agissons sans nous douter que nous obéissons à une loi générale ; et cependant cette loi existe, c’est elle qui nous fait agir, et d’autres que nous viendront plus tard en signaler l’existence et en apprécier la portée. C’est ainsi que l’évêque et les chanoines, tout en confiant la conduite des travaux à quelque maître de l’œuvre laïque, parce que le temps le voulait ainsi, tout en le laissant bâtir à sa mode, lui auront recommandé de conserver quelque chose de l’ancienne église, d’en rappeler l’aspect en certaines parties, et de là tous ces pleins cintres dont l’extérieur de l’édifice est percé, de là ces grandes arcades circulaires qui lui servent de couronnement tant au dedans qu’au dehors. Il est vrai que les profils déliés de ces arcades les rendent aussi légères que des ogives ; l’obéissance de l’artiste laïque ne pouvait pas être plus complète ; elle consistait dans la forme et non pas dans l’esprit.
« C’est encore pour complaire aux souvenirs et aux prédilections des chanoines que le plan semi-circulaire des transsepts aura été maintenu : la vieille église avait probablement ses bras ainsi arrondis, suivant l’ancien type byzantin. Mais tout en conservant cette forme, on semble avoir voulu racheter l’antiquité du plan par un redoublement de nouveauté dans l’élévation. Remarquez en effet que ces transsepts en hémicycles sont percés de deux rangs de fenêtres à ogive, tandis que, dans la nef, bien qu’elle soit évidemment postérieure, toutes les fenêtres sont à plein cintre.
« Il est très-probable aussi que la forme arrondie de ces deux transsepts a été conservée en souvenir de la cathédrale de Tournay, cette sœur de notre cathédrale. À Tournay, en effet, les deux transsepts byzantins subsistent encore aujourd’hui dans leur majesté primitive, avec leur ceinture de hautes et massives colonnes. En 1153, la séparation des deux sièges n’était prononcée que depuis sept années. La mémoire de ces admirables transsepts était encore toute fraîche, et c’est peut-être en témoignage de ses regrets, et comme une sorte de protestation contre la bulle du Saint-Père[24], que le chapitre de Noyon voulut que les transsepts de sa nouvelle église lui rappelassent, au moins par leur plan, ceux de la cathédrale qu’il avait perdue… »
L’incendie de 1131 ne fut pas le seul qui attaqua la cathédrale de Noyon ; en 1152, la ville fut brûlée, et la cathédrale fut probablement atteinte ; mais alors ou l’église de Beaudoin n’était pas commencée, ou elle était à peine sortie de terre, et l’incendie ne put détruire que des constructions provisoires faites pour que le culte ne fût pas interrompu pendant la construction du nouveau chœur. En 1238, le feu dévasta, pour la troisième fois, une grande partie de la ville. En 1293, quatrième incendie, qui brûla les charpentes de la nouvelle cathédrale et lui causa des dommages considérables. Ces dévastations successives expliquent certaines singularités que l’on remarque dans les constructions de la cathédrale de Noyon. Nous allons y revenir.
Observons d’abord que le plan du chœur de la cathédrale de Noyon est accompagné de cinq chapelles circulaires et de quatre chapelles carrées ; or ces chapelles sont la partie la plus ancienne de toute l’église. Nous avons vu et nous verrons que les plans des cathédrales bâties vers la fin du XIIe siècle et le commencement du XIIIe, comme Notre-Dame de Paris, Bourges, Laon, Chartres, sont totalement ou presque totalement dépourvues de chapelles. Mais Noyon précède le grand mouvement qui porte les évêques et les populations à élever de nouvelles cathédrales, mais le plan de Noyon est encore soumis à l’influence canonique ou conventuelle, mais enfin Noyon suit la construction de l’église de Saint-Denis, qui possède de même des chapelles circulaires et des chapelles carrées à l’abside. Si nous examinons le plan de Notre-Dame de Noyon, nous voyons encore qu’à l’entrée du chœur, après les deux piles des transsepts, sont élevées deux piles aussi épaisses. En regard, les maçonneries des bas-côtés ont également une grande force, et contiennent des escaliers. Des tours sont commencées sur ce point, elles ne furent jamais terminées. Dans la nef, dont la construction parait être comprise entre les années 1180 et 1190, nous voyons cinq travées presque carrées portées par des piles formées de faisceaux de colonnes, et divisées par des colonnes monocylindriques. Cette disposition indique nettement des voûtes composées d’arcs ogives portant sur les grosses piles, avec arcs doubleaux simples sur les piles intermédiaires (fig. 8). C’est, en effet, le mode adopté pour la construction des voûtes de Notre-Dame de Paris, de Bourges et de Laon ; cependant, contrairement à cette disposition si bien écrite dans le plan de la nef, les voûtes sont construites conformément à l’usage adopté au XIIIe siècle, c’est-à-dire que chaque pile, grosse ou fine, porte arcs doubleaux et arcs ogives (voy. fig. 7) ;  seulement les arcs doubleaux des grosses piles sont plus épais que ceux posés sur les piles intermédiaires. Il y a lieu de croire que ces voûtes de la nef furent en partie refaites après l’incendie de 1238, les gros arcs doubleaux seuls auraient été conservés ; et, au lieu de refaire ces voûtes ainsi qu’elles avaient existé, c’est-à-dire avec arcs ogives portant seulement sur les grosses piles, on aurait suivi alors la méthode adoptée partout. Si nous examinons les profils de ces arcs ogives et des arcs doubleaux portant sur les piles intermédiaires, nous voyons qu’en effet ces profils ne paraissent pas appartenir à la fin du XIIe siècle. Les voûtes du chœur et des chapelles absidales seules sont certainement de la construction primitive ; leurs nervures sont ornées de perles, de rosettes très-délicates, comme les arcs des voûtes de la partie antérieure de l’église de Saint-Denis. Quoi qu’il en soit, la cathédrale de Noyon était complètement terminée à la fin du XIIe siècle, et, sauf quelques adjonctions et restaurations faites après l’incendie de 1293 et après les guerres du XVIe siècle, elle est parvenue jusqu’à nous à peu près dans sa forme première.
seulement les arcs doubleaux des grosses piles sont plus épais que ceux posés sur les piles intermédiaires. Il y a lieu de croire que ces voûtes de la nef furent en partie refaites après l’incendie de 1238, les gros arcs doubleaux seuls auraient été conservés ; et, au lieu de refaire ces voûtes ainsi qu’elles avaient existé, c’est-à-dire avec arcs ogives portant seulement sur les grosses piles, on aurait suivi alors la méthode adoptée partout. Si nous examinons les profils de ces arcs ogives et des arcs doubleaux portant sur les piles intermédiaires, nous voyons qu’en effet ces profils ne paraissent pas appartenir à la fin du XIIe siècle. Les voûtes du chœur et des chapelles absidales seules sont certainement de la construction primitive ; leurs nervures sont ornées de perles, de rosettes très-délicates, comme les arcs des voûtes de la partie antérieure de l’église de Saint-Denis. Quoi qu’il en soit, la cathédrale de Noyon était complètement terminée à la fin du XIIe siècle, et, sauf quelques adjonctions et restaurations faites après l’incendie de 1293 et après les guerres du XVIe siècle, elle est parvenue jusqu’à nous à peu près dans sa forme première.
À Noyon, comme à la cathédrale de Paris, et comme dans l’église de Saint-Denis construite par Suger, les collatéraux sont surmontés d’une galerie voûtée au premier étage[25]. En examinant la coupe du chœur, on voit que l’arcature qui surmonte la galerie du premier étage n’est qu’un faux triforium, simple décoration plaquée sur le mur qui est élevé dans la hauteur du comble en appentis recouvrant les voûtes du premier étage. Dans la nef, cette arcature est isolée ; c’est un véritable triforium comme à la cathédrale de Soissons dans le croisillon sud (voy. Architecture Religieuse, fig. 31). Une belle salle capitulaire et un cloître du XIIIe siècle accompagnent, du côté nord, la nef de la cathédrale de Noyon (voy. Cloître, Salle capitulaire). Deux grosses tours, fort défigurées par des restaurations successives, et dont les flèches primitives ont été remplacées, si jamais elles ont été faites, par des combles en charpente, sont élevées sur la façade. Quant au porche, il date du commencement du XIVe siècle ; mais cette partie de l’édifice n’offre aucun intérêt.
Il est une cathédrale qui remplit exactement les conditions imposées aux reconstructions de ces grands édifices à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe, c’est celle de Laon. On a voulu voir, dans la cathédrale actuelle de Laon, celle qui fut reconstruite ou réparée après les désastres qui signalèrent, en 1112, l’établissement de la commune. Cela n’est pas admissible ; le monument est là, qui, mieux que tous les textes, donne la date précise de sa reconstruction, et nous n’avons pas besoin de revenir là-dessus après les observations que M. Vitet a insérées sur la cathédrale de Laon dans sa Monographie de Notre-Dame de Noyon.

La cathédrale de Laon (fig. 9) présente en plan une grande nef avec collatéraux, coupée à peu près vers son milieu par des transsepts ; l’abside se termine carrément. Deux chapelles sont seulement pratiquées vers l’est aux deux extrémités des bras de croix. La ville de Laon était, pendant les XIIe et XIIIe siècles, une ville riche, populeuse, turbulente ; elle s’établit à main armée une des premières en commune, et obtint de Philippe-Auguste, après bien des tumultes et des violences, en 1191, une paix, ou confirmation de la commune, moyennant une rente annuelle de deux cents livres parisis[26]. C’est probablement peu de temps après l’octroi de cette paix que les citoyens de Laon, possesseurs tranquilles de leurs franchises, aidèrent les évêques de ce diocèse à élever l’admirable édifice que nous voyons encore aujourd’hui.
De toutes les populations urbaines qui, dans le nord de la France, s’établirent en commune, celle de Laon fut une des plus énergiques, et dont les tendances furent plus particulièrement démocratiques. Le plan donné à leur cathédrale fut-il une sorte de concession à cet esprit ? Nous n’oserions l’affirmer ; il n’en est pas moins certain que ce plan est celui de toutes nos grandes cathédrales qui se prête le mieux, par sa disposition, aux réunions populaires. C’est dans ce vaisseau, qui conserve tous les caractères d’une salle immense, que pendant plus de trois siècles, se passèrent, à certaines époques de l’année, les scènes les plus étranges. Nous avons dit déjà « qu’on y célébrait, le 28 décembre, la fête des Innocents[27], où les enfants de chœur, portant chapes, occupaient les hautes stalles et chantaient l’office avec toute espèce de bouffonneries ; le soir, ils étaient régalés aux frais du chapitre[28]. Huit jours après, venait la fête des Fous. La veille de l’Épiphanie, les chapelains et choristes se réunissaient pour élire un pape, qu’on appelait le patriarche des Fous. Ceux qui s’abstenaient de l’élection payaient une amende. On offrait au patriarche le pain et le vin de la part du chapitre, qui donnait, en outre, à chacun, huit livres parisis pour le repas. Toute la troupe se revêtait d’ornements bizarres, et avait, les deux jours suivants, l’église entière à sa disposition. Après plusieurs cavalcades par la ville, la fête se terminait par la grande procession des rabardiaux. Ces farces furent abolies en 1560 ; mais le souvenir s’en conserva dans l’usage, qui subsista jusqu’au dernier siècle, de distribuer, à la messe de l’Épiphanie, des couronnes de feuilles vertes aux assistants[29]… Au XVe siècle, de nombreux mystères furent représentés dans la cathédrale de Laon, et les chanoines eux-mêmes ne dédaignèrent pas d’y figurer comme acteurs[30]. En 1462, aux fêtes de la Pentecôte, on joua la passion de N.-S. Jésus-Christ, distribuée en cinq journées… Le 26 août 1476, on représenta un mystère intitulé : Les Jeux de la vie de Monseigneur saint Denys. Afin de faciliter la représentation, la messe fut dite à huit heures et les vêpres chantées à midi[31]… »
Si le chapitre et les évêques de Laon croyaient nécessaire de faire de semblables concessions morales aux citoyens, ne peut-on admettre que cette tolérance influa sur les dispositions primitives du plan de la cathédrale ?
Après les luttes et les scènes tragiques qui ensanglantèrent l’établissement de la commune de Laon, lorsque, par l’entremise du pouvoir royal, cette commune fut définitivement constituée, il est probable que, d’un commun accord, le chapitre, l’évêque et les bourgeois élevèrent cet édifice à la fois religieux et civil. C’est par des concessions de ce genre que le clergé put amener les citoyens d’une ville riche à faire les sacrifices d’argent nécessaires à la construction d’un monument qui devait servir non-seulement au culte, mais même à des assemblées profanes. Nous ne nous dissimulons pas combien ces conjectures paraîtront étranges aux personnes qui n’ont pas, pour ainsi dire, vécu dans la société du moyen âge, qui croient que cette société était soumise à un régime purement féodal et théocratique ; mais quand on pénètre dans cette civilisation qui se forme au XIIe siècle et se développe au XIIIe, on voit à chaque pas naître un besoin de liberté si prononcé à côté de privilèges monstrueux, une tendance si active vers l’unité nationale, qu’on n’est plus étonné de trouver le haut clergé disposé à aider à ce mouvement et cherchant à le diriger pour ne pas être entraîné et débordé. Les évêques aimaient mieux ouvrir de vastes édifices à la foule, sauf à lui permettre parfois des saturnales pareilles à celles dont nous venons de donner un aperçu, plutôt que de se renfermer dans le sanctuaire, et de laisser bouillonner en dehors les idées populaires. Sous les voûtes de la grande cathédrale, quoique profanes, les assemblées des citoyens étaient fortement empreintes d’un caractère religieux. Les populations urbaines s’habituaient ainsi à considérer la cathédrale comme le centre de toute manifestation publique. Les évêques et les chapitres avaient raison ; ils comprenaient leur époque ; ils savaient que, pour civiliser des esprits encore grossiers, faciles à entraîner, unis par un profond sentiment d’union et d’indépendance, il fallait que le monument religieux par excellence fût le pivot de tout acte public.
Laon est une ville turbulente qui, pendant un siècle, est en lutte ouverte avec son seigneur, l’évêque. Après ces troubles, ces discussions, le pouvoir royal qui, par sa conduite, commence à inspirer confiance en sa force, parvient à établir la paix ; mais on se souvient, de part et d’autre, de ces luttes dans lesquelles seigneurs et peuple ont également souffert ; il faut se faire des concessions réciproques pour que cette paix soit durable ; la cathédrale se ressent de cette sorte de compromis ; sa destination est religieuse, son plan conserve un caractère civil.
À Noyon, d’autres précédents amènent des résultats différents.
« En l’année 1098, dit M. A. Thierry[32], Baudri de Sarchainville, archidiacre de l’église cathédrale de Noyon, fut promu, par le choix du clergé de cette église, à la dignité épiscopale. C’était un homme d’un caractère élevé, d’un esprit sage et réfléchi. Il ne partageait point l’aversion violente que les personnes de son ordre avaient en général contre l’institution des communes. Il voyait dans cette institution une sorte de nécessité sous laquelle, de gré ou de force, il faudrait plier tôt ou tard, et croyait qu’il valait mieux se rendre aux vœux des citoyens que de verser le sang pour reculer de quelques jours une révolution inévitable… De son propre mouvement, l’évêque de Noyon convoqua en assemblée tous les habitants de la ville, clercs, chevaliers, commerçants et gens de métier. Il leur présenta une charte qui constituait le corps des bourgeois en association perpétuelle, sous des magistrats appelés jurés, comme ceux de Cambrai… »
M. Vitet a donc raison de dire[33] que « lorsque Beaudoin II entreprit la reconstruction de sa cathédrale, il existait à Noyon une commune depuis longtemps établie, et consacrée par une paisible jouissance, mais placée en quelque sorte sous la tutelle de l’évêque. »
Aussi la cathédrale de Noyon présente-t-elle le plan d’un édifice religieux : abside avec chapelles, transsepts avec croisillons arrondis. Là, le clergé est resté le directeur de l’œuvre, il n’a besoin de faire aucune concession ; il n’a pas eu recours, non plus que la commune, lorsqu’il commença l’œuvre, à l’intervention du pouvoir royal. Il entre dans la cathédrale de Noyon moins d’éléments laïques que dans celle de Senlis, par exemple, construite en même temps, et où l’ogive domine sans partage. Mais la cathédrale de Noyon est de près de cinquante années antérieure à celle de Laon ; il n’est pas surprenant, objectera-t-on, que son plan se rapproche davantage des traditions cléricales ; cela est vrai. Cependant, nous avons vu le plan de la cathédrale de Bourges, contemporaine de celle de Laon, où la tradition cléricale est encore conservée ; nous verrons tout à l’heure le plan de la cathédrale de Chartres, où, plus qu’à Bourges encore, les données religieuses de l’architecture romane sont observées. Laon, au contraire, possède un plan dont le caractère est tranché ; il a fallu faire une large part aux idées laïques. Peut-être voudra-t-on prétendre encore que les évêques de Laon, ayant eu de fréquents rapports avec l’Angleterre, leur cathédrale aurait pris la disposition carrée du plan de l’abside aux monuments de ce pays ; l’observation ne saurait être admise, par la raison que les absides carrées anglaises sont postérieures à celle de la cathédrale de Laon ; le chœur de la cathédrale de Cantorbéry, qui date du XIIe siècle, est circulaire ; les absides carrées d’Ély, de Lincoln, ne sont pas antérieures à 1230.
Ce n’est pas seulement cette abside carrée qui nous frappe dans le plan de la cathédrale de Laon (fig. 9), c’est encore la disposition des collatéraux avec galeries supérieures voûtées, comme à Notre-Dame de Paris, comme à Noyon, comme à la cathédrale de Meaux dans l’origine ; c’est la place qu’occupent les chapelles circulaires des transsepts, chapelles à deux étages ; c’est la présence de quatre tours aux quatre angles des deux croisillons et d’une tour carrée sur les piles de la croisée ; c’est cette grande et belle salle capitulaire qui s’ouvre au sud des premières travées de la nef ; ce sont ces deux salles, trésors et sacristies, qui avoisinent le chœur et sont réservées entre les collatéraux et les chapelles circulaires. On voit en tout ceci un plan conçu et exécuté d’un seul jet, une disposition bien franche commandée par un programme arrêté. Quant au style d’architecture adopté dans la cathédrale de Laon, il se rapproche de celui des parties de Notre-Dame de Paris qui datent du commencement du XIIIe siècle ; il est cependant plus lourd, plus trapu ; il faut dire aussi que les matériaux employés sont plus grossiers.
À la fin du XIIIe siècle, ce beau plan fut défiguré par l’adjonction de chapelles élevées entre les saillies des contreforts de la nef. Une salle fut érigée au milieu du préau du cloître. C’est aussi pendant le cours du XIIIe siècle que les dispositions premières du porche furent modifiées. Les sept tours étaient surmontées de flèches, détruites aujourd’hui (voy. Clocher).
Malgré son importance, la cathédrale de Laon fut élevée avec une précipitation telle, que, sur quelques points, et particulièrement sur la façade, les constructeurs dédaignèrent de prendre les précautions que l’on prend d’ordinaire, lorsque l’on bâtit des édifices de cette dimension : les fondations furent négligées, ou bloquées au milieu des restes de substructions antérieures ; on ne laissa pas le temps aux constructions inférieures des tours de s’asseoir avant de terminer leurs sommets. Il en résulta des tassements inégaux, des déchirements qui compromirent la solidité de la façade[34].
La cathédrale de Laon conserve quelque chose de son origine démocratique ; elle n’a pas l’aspect religieux des églises de Chartres, d’Amiens ou de Reims. De loin, elle paraît un château plutôt qu’une église ; sa nef est, comparativement aux nefs ogivales et même à celle de Noyon, basse ; sa physionomie extérieure est quelque peu brutale et sauvage ; et jusqu’à ces sculptures colossales d’animaux, bœufs, chevaux, qui semblent garder les sommets des tours de la façade (voy. Animaux), tout concourt à produire une impression d’effroi plutôt qu’un sentiment religieux, lorsqu’on gravit le plateau sur lequel elle s’élève. On ne sent pas, en voyant Notre-Dame de Laon, l’empreinte d’une civilisation avancée et policée, comme à Paris ou à Amiens ; là, tout est rude, hardi : c’est le monument d’un peuple entreprenant, énergique et plein d’une mâle grandeur. Ce sont les mêmes hommes que l’on retrouve à Coucy-le-Château, c’est une race de géants.
Nous ne quitterons pas cette partie de la France sans parler de la cathédrale de Soissons. Cet édifice fut certainement conçu sur un plan dont les dispositions rappellent le plan de la cathédrale de Noyon (fig. 10). Comme à Noyon, le transsept sud de la cathédrale de Soissons, qui date de la fin du XIIe siècle, est arrondi, et il est flanqué à l’est d’une vaste chapelle circulaire à deux étages, comme celles des transsepts de Laon. À Soissons, ce croisillon circulaire possède un bas-côté avec galerie voûtée au-dessus et triforium dans la hauteur du comble de la galerie (voy. Architecture Religieuse, fig. 30 et 31). L’étage supérieur de la chapelle circulaire servait de trésor avant la révolution ; était-ce là sa destination primitive ? C’est ce que nous ne pourrions dire aujourd’hui, n’ayant aucune donnée sur l’utilité de ces chapelles à deux étages, que nous retrouvons encore à Saint-Remy de Reims et dans la grande église de Saint-Germer.

Que la cathédrale de Soissons ait été élevée complètement pendant les dernières années du XIIe siècle, ou seulement commencée, toujours est-il que le chœur et la nef furent construits pendant les premières années du XIIIe siècle. Le chœur est accompagné de cinq chapelles circulaires et de huit chapelles carrées. C’est déjà une modification au plan des cathédrales de cette époque. Le transsept nord ne fut terminé que plus tard, ainsi que la façade.
Jusqu’à présent, nous voyons régner, dans ces édifices élevés depuis le milieu du XIIe siècle jusqu’au commencement du XIIIe[35], une sorte d’incertitude ; les plans de ces cathédrales françaises sont comme autant d’essais subissant l’influence de programmes variés. On élève des cathédrales nouvelles plus vastes que les églises romanes, pour suivre le mouvement qui s’était si bien prononcé pendant les règnes de Louis le Jeune et de Philippe-Auguste ; mais la cathédrale type n’est pas encore sortie de terre. Nous allons la voir naître définitivement et arriver, en quelques années, à sa perfection.
À la suite d’un incendie qui détruisit de fond en comble la cathédrale de Chartres, en 1020, l’évêque Fulbert voulut reconstruire son église. Les travaux furent continués par ses successeurs à de longs intervalles. En 1145, les deux clochers de la façade occidentale, que nous voyons encore aujourd’hui, étaient en pleine construction. En 1194, un nouvel incendie ruina l’édifice de Fulbert à peine achevé. Les parties inférieures de la façade occidentale, le clocher vieux terminé et la souche du clocher neuf resté en construction échappèrent à la destruction. Sur les débris encore fumants de la cathédrale, Mélior, cardinal-légat du pape Célestin III, fit assembler le clergé et le peuple de Chartres, et, à la suite de ses exhortations, tous se mirent à l’œuvre pour reconstruire, sur un nouveau plan, l’ancienne église de Notre-Dame[36]. L’évêque Reghault de Mouçon et les chanoines abandonnèrent le produit total de leurs revenus et de leurs prébendes pendant trois années.
…. borjois et rente et mueble
Abandonèrent en aie
Chascun selon sa menantie[37].
Philippe-Auguste, Louis VIII et saint Louis contribuèrent par leurs dons à l’érection de la vaste église.
Déjà, en 1220, Guillaume le Breton parle de ses voûtes « que l’on peut comparer, dit-il, à une écaille de tortue, » et qui sont assez solides pour défier les incendies à venir.

Nous voyons se reproduire à Notre-Dame de Chartres un fait analogue à ceux signalés dans la construction des cathédrales de Paris et de Bourges. Non-seulement les architectes du XIIIe siècle conservèrent les deux clochers occidentaux de l’église du XIIe siècle, mais ils ne voulurent pas laisser perdre les trois belles portes qui donnaient entrée dans la nef et étaient autrefois placées au fond d’un porche en A (voyez le plan). On voit encore entre les deux tours la trace des constructions de ce porche et l’amorce du mur de face. Les trois portes, avec leurs belles statues, les tympans, voussures et fenêtres qui les surmontent, replacées sur l’alignement des deux clochers, furent couronnées par une rose s’ouvrant sous la voûte de la nef centrale. La construction de la cathédrale de Chartres fut conduite avec une incroyable rapidité. L’empressement des populations, des seigneurs et souverains, à mener l’œuvre à fin ne fut nulle part plus actif. Aussi, cet édifice présente-t-il une grande homogénéité de style ; il devait être complétement achevé vers 1240[38]. De 1240 à 1250, on ajouta des porches aux deux entrées des transsepts ; la sacristie fut bâtie au nord, proche le chœur, à la fin du XIIIe siècle, et, vers le milieu du XIVe siècle, on éleva, derrière l’abside, la chapelle Saint-Piat à deux étages. C’est aussi pendant la seconde moitié du XIIIe siècle que fut posé l’admirable jubé qui fermait l’entrée du chœur il y a encore un siècle[39].
À Notre-Dame de Chartres, la nef est courte comparativement au chœur ; c’est probablement pour lui donner deux travées de plus que l’ancien porche de la façade fut supprimé et les portes avancées au nu du mur extérieur des tours. Voulant conserver, pour bâtir le chœur, la crypte qui lui sert de fondations et les deux belles tours occidentales, il n’était pas possible de donner à l’église une plus grande longueur.
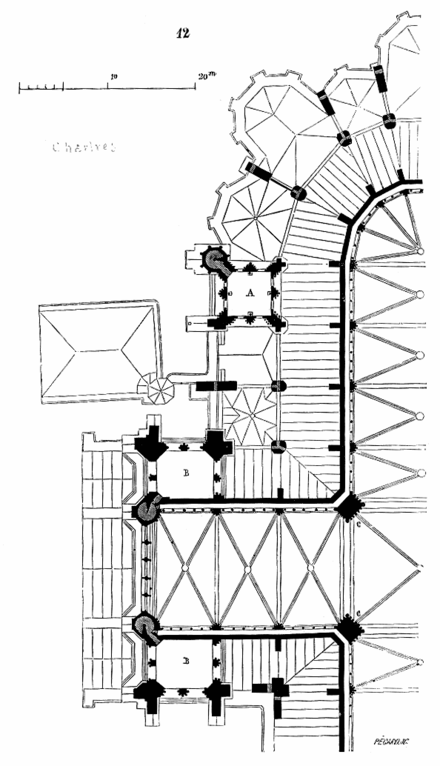
Une seule chapelle fut élevée au sud, entre les contreforts de la nef, en 1413. Au commencement du XVIe siècle, on termina le clocher nord du portail qui était resté inachevé, et on dressa la gracieuse clôture du chœur que nous voyons encore aujourd’hui et qui seule a résisté en partie aux mutilations que les chanoines firent subir au sanctuaire pendant le dernier siècle. Toutes les verrières de cet édifice sont de la plus grande magnificence et datent du XIIIe siècle, sauf celles des trois fenêtres du portail occidental, qui furent replacées avec leurs baies et proviennent de l’église du XIIe siècle.
Guillaume le Breton avait raison lorsque, en 1220, il disait que la cathédrale de Chartres n’avait plus rien à craindre du feu. En 1836, un terrible incendie consuma toute la charpente supérieure et le beau beffroi du clocher vieux (voy. Beffroi). La vieille cathédrale put résister à cette épreuve ; elle est encore debout telle que les constructeurs du XIIIe siècle nous l’ont laissée ; elle demeure comme un témoin de l’énergique puissance des arts de cette époque ; et, du haut de la colline qui lui sert de base, sa mâle silhouette, qui de neuf flèches n’en possède que deux, est une cause d’étonnement et d’admiration pour les étrangers qui traversent la Beauce.
Nous ne trouvons plus à Chartres la galerie supérieure voûtée ; un simple triforium, décoré d’une arcature, laisse une circulation intérieure tout au pourtour de la cathédrale, derrière les combles en appentis des bas-côtés. Cette église, la plus solidement construite de toutes les cathédrales de France[40], ne présente, dans sa coupe transversale, rien qui lui soit particulier, si ce n’est la disposition des arcs-boutants (voy. Arc-boutant, fig, 54).
Afin de conserver un ordre logique dans cet article, nous devons, quant à présent, laisser de côté certains détails sur lesquels nous aurons à revenir, et poursuivre notre examen sommaire des cathédrales élevées au commencement du XIIIe siècle. Jusqu’à présent, nous avons présenté des plans dans lesquels il se rencontre des indécisions, des tâtonnements, l’empreinte de traditions antérieures. À Chartres même, les fondations de l’église de Fulbert et la conservation des vieux clochers ne laissent pas aux architectes toute leur liberté.
En 1211, l’ancienne cathédrale de Reims, bâtie par Ebon, et qui datait du IXe siècle, fut détruite de fond en comble par un incendie. Cette église était lambrissée, et affectait probablement la forme d’une basilique. Dès l’année suivante, en 1212, Albéric de Humbert, qui occupait le siège archiépiscopal de Reims, posa la première pierre de la cathédrale actuelle ; l’œuvre fut confiée à un homme dont le nom nous est resté, Robert de Coucy. Si le monument était champenois, l’architecte était d’une ville voisine du domaine royal ; il ne faut pas oublier ce fait. Le plan, conçu par Robert de Coucy, était vaste, établi sur des bases solides ; cet architecte doutait de pouvoir l’exécuter tel qu’il l’avait projeté ; il doutait de l’étendue des ressources, et peut-être de la constance des Rémois. Ses doutes n’étaient que trop fondés. Cependant le projet de Robert fut rapidement exécuté jusqu’à la hauteur des voûtes des bas-côtés, depuis le chœur jusqu’à la moitié de la nef environ.

Si nous comparons ce plan avec ceux de Notre-Dame de Paris, des cathédrales de Bourges, de Noyon, de Laon et de Chartres, nous serons frappés de l’épaisseur proportionnelle des constructions formant le périmètre de l’édifice. C’est que Robert de Coucy appartenait à une école de constructeurs robustes, que cette école s’était élevée dans un pays où la pierre est abondante ; c’est, bien plus encore, que Robert avait conçu un édifice devant atteindre des dimensions colossales. La bâtisse avait à peine atteint la hauteur des basses nefs, que l’on dut renoncer à exécuter, dans tous leurs développements, les projets de Robert, qu’il fallut faire certains sacrifices, probablement à cause de l’insuffisance reconnue des ressources futures. Le plan du premier étage de la cathédrale de Reims est loin de répondre à la puissance des soubassements. Cependant il est certain que l’on suivit, autant que possible, en diminuant le volume des points d’appuis, les projets primitifs ; et il faut une attention particulière, et surtout la connaissance des constructions de cette époque, pour reconnaître ces changements apportés aux plans de Robert de Coucy. Nous essayerons toutefois de les rendre saisissables pour tout le monde, car ce fait ne laisse pas d’avoir une grande importance pour l’histoire de nos cathédrales, d’autant plus qu’il se reproduit partout à cette époque.




Il y a donc lieu d’admettre que Robert de Coucy éleva la cathédrale de Reims jusqu’à la hauteur des corniches des chapelles du chœur et bas-côtés, sauf les quatre premières travées de la nef, qu’il ne commença même pas ; qu’après lui, la construction fut continuée en faisant subir des changements aux projets primitifs afin de réduire les dépenses ; que cette nécessité de terminer l’édifice à moins de frais était le résultat d’une diminution dans les dons faits par les populations. L’ornementation des parties inférieures du chœur et des transsepts de la cathédrale de Reims, jusques et y compris la corniche des chapelles rayonnantes, porte encore le cachet de la sculpture de la fin du XIIe siècle ; tandis qu’immédiatement au-dessus du niveau des corniches de ces chapelles apparaît une ornementation qui a tous les caractères de celle du milieu du XIIIe siècle. Dans la travée de droite du pignon du transsept nord, est percée une porte donnant aujourd’hui dans la petite sacristie établie entre les contreforts ; cette porte, dont les sculptures sont peintes, date évidemment des premières constructions commencées par Robert de Coucy, et les bas-reliefs pourraient même être attribués à l’école des sculpteurs de la fin du XIIe siècle. Les parties inférieures du pignon du transsept sud, qui ne furent pas modifiées par l’ouverture de portes, affectent une sévérité de style qui ne le cède en rien aux constructions inférieures de la façade de Notre-Dame de Paris. Tout, enfin, dans le rez-de-chaussée de la cathédrale de Reims, du chœur à la moitié de la nef, dénote l’œuvre d’un artiste appartenant à l’école laïque d’architectes née à la fin du XIIe siècle. Au-dessus, le style ogival a pris son entier développement, mais la transition entre les deux caractères architectoniques est habilement ménagée. Nous ne savons en quelle année Robert de Coucy cessa de travailler à la cathédrale ; cependant lui-même, en construisant, modifia probablement quelques détails de son projet primitif. Cet architecte n’en était pas à son coup d’essai lorsqu’il commença l’œuvre en 1212, et peut-être était il déjà d’un âge assez avancé ; toutefois (et les notes de Villart de Honnecourt sont là pour le prouver) il cherchait sans cesse, comme tous ses contemporains, des perfectionnements à l’art laissé par le XIIe siècle ; il ne pouvait ignorer ce que l’on tentait autour de lui ; c’est ainsi qu’il fut amené à terminer les chapelles du chœur, commencées sur un plan circulaire comme celles de la cathédrale de Noyon, par des pans coupés. Les ornements de la corniche de ces chapelles, les carniaux des larmiers dont parle Villart, le style des statues d’anges qui surmontent les petits contreforts, ne peuvent laisser douter qu’elles n’aient été achevées par Robert de Coucy, de 1220 à 1230. Il avait fallu plusieurs années pour jeter les fondements de cet édifice commencé d’après un projet aussi robuste, d’autant plus que le sol sur lequel la cathédrale de Reims est assise n’est pas égal, et ne devient bon qu’à plusieurs mètres au-dessous du pavé (de quatre à sept mètres d’après quelques fouilles faites au pourtour). Il n’est pas surprenant donc que ces énormes constructions, quelle que fût l’activité apportée à leur exécution, ne fussent pas, en 1230, c’est-à-dire dix-huit ans après leur mise en train, élevées au-dessus des voûtes basses. À la première vue, le rez-de-chaussée des pignons des deux transsepts[41] paraît plus ancien que les chapelles du chœur ; les fenêtres basses sont sans meneaux et encadrées de profils et ornements qui rappellent l’architecture de transition ; tandis que les fenêtres des chapelles du chœur sont déjà pourvues de meneaux dont les formes, la disposition particulière et l’appareil sont identiquement semblables aux meneaux des bas-côtés de la nef de la cathédrale d’Amiens, qui datent de l’année 1230 environ. Robert de Coucy avait bien pu amender lui-même certains détails de son projet, en même temps qu’il adoptait les pans coupés pour ces chapelles au-dessus de la forme circulaire de leur soubassement. Quoi qu’il en soit, le maître de l’œuvre, en mourant ou en abandonnant les constructions à des architectes plus jeunes, peut-être après une interruption de quelques années, avait laissé des projets dont ses successeurs, malgré les réductions dont nous avons parlé, se rapprochèrent autant que possible. C’est ce qui donne à cet édifice un caractère d’unité si remarquable, quoiqu’il ait fallu un siècle pour conduire le travail jusqu’aux voûtes hautes. À Reims, plus que partout ailleurs, on respecta la conception du premier maître de l’œuvre. Aussi, lorsque l’on veut se faire une idée de ce que devait être une cathédrale conçue par un architecte du commencement du XIIIe siècle, de la plus belle époque de l’art ogival, c’est à Reims qu’il faut aller. Et cependant, combien ce grand monument ne subit-il pas de modifications importantes ; et, tel que nous le voyons aujourd’hui, combien il est loin des projets de Robert de Coucy et même de ce qu’il fut avant l’incendie de la fin du XVe siècle.
Le plan de la cathédrale de Reims est simple (voy. fig. 13) ; les chapelles rayonnantes du chœur sont larges, profondes ; la nef longue et dépourvue de chapelles. Les coupes et élévations des parties latérales de l’édifice répondent à la simplicité du plan ; les contreforts et arcs-boutants, admirables de conception et de grandeur ; les piles sont épaisses, les fenêtres supérieures profondément encadrées. Cet édifice a toute la force de la cathédrale de Chartres, sans en avoir la lourdeur ; il réunit enfin les véritables conditions de la beauté dans les arts, la puissance et la grâce ; il est d’ailleurs construit en beaux matériaux, savamment appareillés, et on retrouve dans toutes ses parties un soin et une recherche fort rares à une époque où l’on bâtissait avec une grande rapidité et souvent avec des ressources insuffisantes. Ce ne fut guère qu’en 1240 que l’on continua les parties supérieures du chœur, que l’on commença les premières travées de la nef et la façade. Celle-ci ne fut achevée, sauf les deux flèches des deux tours occidentales, que vers le commencement du XIVe siècle ; on y travaillait encore pendant le XVe siècle, mais en suivant les dispositions et détails des XIIIe et XIVe siècles. Un cloître s’élevait au nord de la nef et du transsept ; et c’était probablement pour donner entrée dans ce cloître qu’avait été faite la porte ouverte dans la travée de droite du pignon nord, porte dont nous avons parlé tout à l’heure. Deux autres portes publiques furent ouvertes, dans les deux autres travées de ce pignon, vers le milieu du XIIIe siècle, et richement décorées de voussures, bas-reliefs et statues[42]. Deux tours s’élèvent sur la façade occidentale ; quatre tours surmontent les quatre angles des transsepts, et une tour centrale se dressait, au centre de l’édifice, sur les quatre piles de la croisée. Une flèche en plomb couronnait le poinçon de la croupe du comble au-dessus du sanctuaire. Le pignon du transsept sud donnant du côté de l’archevêché ne fut jamais percé de grandes portes. On arrivait du palais archiépiscopal au chœur par des portes secondaires, percées dans les soubassements de ce pignon (voyez le plan). Pendant les XIVe et XVe siècles, de petites chapelles furent bâties du côté nord, entre les contreforts de la nef et dans l’intervalle laissé par le cloître ; mais ces petites chapelles, qui ne dépassent pas l’appui des fenêtres, ne dérangent en rien l’ordonnance intérieure du vaisseau ; elles ne s’ouvrent, dans le bas-côté, que par de petites portes.
Si les projets de Robert de Coucy furent modifiés, c’est surtout dans la construction de la façade occidentale, qui présente tous les caractères de l’architecture la plus riche de la seconde moitié du XIIIe siècle. Comme décoration, elle se relie encore aux faces latérales par ces admirables couronnements de contreforts dans lesquels sont placées des statues colossales. Mais la multiplicité des détails nuit à l’ensemble ; cette façade, quelque belle qu’elle soit, n’a pas la grandeur des faces latérales. L’archivolte de la porte principale vient entamer la base des contreforts intermédiaires, ce qui tourmente l’œil ; les nus, les parties tranquilles font défaut. Cependant, et telle qu’elle est, la façade occidentale de la cathédrale de Reims est une des plus splendides conceptions du XIIIe siècle ; elle a pour nous, d’ailleurs, l’avantage d’être la seule. Notre-Dame de Paris est encore une façade de l’époque de transition. Il en est de même à Laon. Nous ne pouvons considérer ces portails comme appartenant au style purement ogival. Amiens n’a qu’une façade tronquée, non terminée, sur laquelle des époques différentes sont venues se superposer.
Chartres n’est qu’une réunion de fragments. Bourges et Rouen sont des mélanges de styles de trois et quatre siècles. Les façades de Bayeux, de Coutances, de Soissons, de Noyon, de Sens, de Séez, sont restées inachevées, ont été dénaturées, ou présentent des amas de constructions sans ensemble, élevées successivement sans projet arrêté. La façade principale de Notre-Dame de Reims, malgré cet excès de richesse, a donc pour nous l’avantage de nous donner une conception franche en style ogival, et, sous ce point de vue, elle mérite toute l’attention des architectes. Son iconographie est complète, et ce fait seul est d’une grande importance. Mais nous reviendrons sur cette partie de la décoration des cathédrales.

La cathédrale d’Amiens, dévastée par le feu et les invasions normandes, en 850, 1019 et 1107, fut totalement détruite par un incendie en 1218. En 1220, Evrard de Fouilloy, quarante-cinquième évêque d’Amiens, fit jeter les fondements de la cathédrale actuelle. Le maître de l’œuvre était Robert de Luzarches. L’évêque picard alla chercher son architecte dans l’Île de France. Les nouvelles constructions furent commencées par la nef ; probablement les restes de l’ancien chœur furent conservés provisoirement afin de ne pas interrompre le culte. En 1223, l’évêque Evrard mourut ; les fondations étaient achevées sous la nef, et probablement le pignon du transsept sud était élevé de quelques mètres au-dessus du sol. Sous l’épiscopat du successeur de l’évêque Evrard, Geoffroy d’Eu, nous voyons déjà les travaux confiés à un second architecte, Thomas de Cormont. Robert de Luzarches n’avait pu que laisser les plans de l’édifice qu’il avait fondé. Le second maître de l’œuvre éleva les constructions de la nef jusqu’à la naissance des grandes voûtes ; nous arrivons alors à l’année 1228. Son fils, Renault de Cormont, continua l’œuvre et passe pour l’avoir achevée en 1288, ce qui n’est guère admissible, si nous observons les différences profondes de style qui existent entre le rez-de-chaussée et les parties hautes du chœur. En 1237, l’évêque Geoffroy mourut ; son successeur Arnoult termina les voûtes de la nef et fit élever sur la partie centrale de la croisée une tour de pierre surmontée d’une flèche en bois et plomb. Ce fut probablement aussi cet évêque qui fit élever les chapelles du chœur[45]. En 1240, l’évêque Arnoult avait poussé les travaux avec une telle activité que les fonds étaient épuisés ; il fallut suspendre les constructions et amasser de nouvelles sommes. En 1258, un incendie consuma les charpentes des chapelles de l’abside ; on voit parfaitement, encore aujourd’hui, les traces de ce sinistre au-dessus des voûtes de ces chapelles. Ce désastre dut contribuer encore à ralentir l’achèvement du chœur. Il est certain que le triforium de l’abside, et par conséquent toute l’œuvre haute, ne fut commencé qu’après cet incendie, car, sur les pierres calcinées en 1258, sont posées les premières assises parfaitement pures de ce triforium. Les successeurs d’Arnoult, Gérard ou Evrard de Couchy (pour Coucy) et Aléaume de Neuilly, ne purent que réunir les fonds nécessaires à la continuation des travaux. À Amiens, comme partout ailleurs, les populations montraient moins d’empressement à voir terminer le monument de la cité ; on mit un temps assez long à recueillir les dons nécessaires à l’achèvement du chœur, et ces dons ne furent pas assez abondants pour permettre de déployer dans cette construction la grandeur et le luxe que l’on trouve dans la nef et les chapelles absidales. En 1269, cet évêque faisait placer les verrières des fenêtres hautes du chœur[46], et son successeur, Guillaume de Mâcon, en 1288, mit la dernière main aux voûtes et parties supérieures du chevet. En construisant la nef, de 1220 à 1228, on avait voulu clore, avant tout, le vaisseau, et on ne s’était pas préoccupé de la façade laissée en arrachement. La porte centrale seule avait été percée au bas du pignon et la rose supérieure ouverte. Ce ne fut guère qu’en 1238, lorsqu’une nouvelle impulsion fut donnée aux travaux par l’évêque Arnoult, que l’on songea à terminer la façade occidentale. Mais déjà, probablement, on pressentait l’épuisement des ressources, si abondantes pendant le règne de Philippe-Auguste, et les projets primitifs furent restreints. L’examen de l’édifice ne peut laisser de doutes à cet égard.

Ce fut en 1529 que fut reconstruite la flèche actuelle, en charpente recouverte de plomb, par deux charpentiers picards, Louis Cordon et Simon Taneau (voy. Flèche).
Nous avons dit que Robert de Luzarches avait pu voir non-seulement les fondations de sa cathédrale, mais aussi quelques mètres du pignon du transsept sud, élevés au-dessus du sol. En effet, le portail percé à la base de ce pignon, dit portail de la Vierge dorée, présente des détails d’architecture plus anciens que tous ceux des autres parties de l’édifice ; ce portail fut cependant remanié vers 1250 ; le tympan et les voussures datent de cette époque et furent reposés après coup sur les pieds-droits et le trumeau du commencement du XIIIe siècle. La Vierge qui décore ce trumeau ne peut être antérieure à 1250 ; le trumeau fut lui-même alors doublé à l’intérieur, afin de recevoir une décoration en placage qui n’existait pas dans l’origine.
Le plan de la cathédrale d’Amiens n’indique pas que les premiers maîtres de l’œuvre aient eu la pensée d’élever, comme à Chartres, à Laon et à Reims, quatre tours aux angles des transsepts ; de sorte que nous voyons aujourd’hui la cathédrale d’Amiens à peu près telle qu’elle fut originairement conçue, si ce n’est que les deux tours de la façade eussent dû avoir une base plus large et une beaucoup plus grande hauteur. Cependant on remarque sur ce plan les escaliers posés à l’extrémité des doubles bas-côtés du chœur, et précédant les chapelles. Ces escaliers sont comme un dernier reflet des tours placées sur ces points dans les églises normandes, et qui, comme nous l’avons dit, se voient encore à Chartres. Nous les retrouvons dans les cathédrales de Beauvais, de Cologne, de Narbonne, de Limoges, qui sont toutes des filles de la cathédrale d’Amiens. Du côté du nord s’élevaient les anciens bâtiments de l’évêché, qui étaient mis en communication avec la cathédrale par la grande porte du pignon septentrional et par une petite porte percée sous l’appui de la fenêtre de la première travée du bas-côté. Sur le flanc nord du chœur était placée une sacristie avec trésor au-dessus. Un cloître du XIVe siècle, dans les galeries duquel on entrait par les deux chapelles A et B, pourtournait le rond-point irrégulièrement, en suivant les sinuosités données par d’anciens terrassements. En D sont placées des dépendances et une chapelle, ancienne salle capitulaire qui date également de la première moitié du XIVe siècle. Ce cloître et la chapelle étaient désignés sous la dénomination de cloître et chapelle Macabre, des Macabrés, et, par corruption, des Machabées. Les arcades vitrées de ce cloître, ou peut-être les murs, étaient probablement décorés autrefois de peintures représentant la danse macabre[47].

Bien que la cathédrale de Reims soit un édifice ogival, on y sent encore l’empreinte du monument antique ; que cette influence soit due au génie de Robert de Coucy, ou aux restes d’édifices romains répandus sur le sol de Reims, elle n’en est pas moins sensible. La cathédrale d’Amiens, comme plan et comme structure, est l’église ogivale par excellence. En examinant la coupe (fig. 20), on n’y trouve nulle part d’excès de force[49]. Les piles des bas-côtés, plus hautes que celles de Reims, ont près d’un tiers de moins d’épaisseur. Le triforium B est élancé et permet de donner aux combles des bas-côtés une forte inclinaison. Les arcs-boutants sont parfaitement placés de façon à contrebutter la grande voûte. La charge sur les piles inférieures est diminuée par l’évidement des contreforts adossés aux piles supérieures ; les arcs doubleaux sont moins aigus que ceux de Reims.
On ne voit plus, au sommet de la nef d’Amiens, cette masse énorme de maçonnerie, qui n’a d’autre but que de charger les piles afin d’arrêter la poussée des voûtes. Ici, toute la solidité réside dans la disposition des arcs-boutants et l’épaisseur des culées ou contreforts A. Cependant cette nef, dont la hauteur est de 42m, 50 sous clef, et la largeur d’axe en axe des piles de 14m, 60, ne s’est ni déformée, ni déversée. La construction n’a subi aucune altération sensible ; elle est faite pour durer encore des siècles, pour peu que les moyens d’écoulement des eaux soient maintenus en bon état. À Amiens, les murs ont disparu ; derrière la claire-voie du triforium en C, ce n’est qu’une cloison de pierre, rendue plus légère encore par des arcs de décharge ; sous les fenêtres basses en D, ce n’est qu’un appui évidé par une arcature ; au-dessus des fenêtres supérieures en E, il n’y a qu’une corniche et un chéneau, partout entre la lumière. Les eaux du grand comble s’écoulent simplement, facilement et par le plus court chemin, sur les chaperons des arcs-boutants supérieurs. Celles reçues par les combles des collatéraux sont déversées à droite et à gauche des contreforts par des gargouilles[50]. Il est difficile de voir une construction plus simple et plus économique, eu égard à sa dimension et à l’effet qu’elle produit.
Dans les parties hautes du chœur de la cathédrale d’Amiens, on voulut pousser le principe si simple, adopté pour la nef, aux dernières limites, et on dépassa le but. Lorsque la construction de l’œuvre haute du chœur fut reprise après une interruption de près de vingt ans, on avait déjà, dans l’église de l’abbaye de Saint-Denis, dans les cathédrales de Troyes et même de Beauvais, adopté le système des galeries de premier étage à claire voie prenant des jours extérieurs. Le triforium se trouvait ainsi participer des grandes fenêtres supérieures et prolongeait leurs ajours et leur riche décoration de verrières jusqu’au niveau de l’appui de la galerie. Ce parti était trop séduisant pour ne pas être adopté par l’architecte du haut chœur d’Amiens.
Mais examinons d’abord le plan de cette partie de l’édifice, qui sortait de terre seulement un peu avant 1240, c’est-à-dire au moment où l’on commençait aussi la Sainte-Chapelle du Palais à Paris[51]. On reconnaît, dans le plan du chœur de Notre-Dame d’Amiens, une main savante ; là, plus de tâtonnements, d’incertitudes ; aussi, nos lecteurs ne nous sauront pas mauvais gré de leur faire connaître la façon de procéder employée par le troisième maître de l’œuvre de la cathédrale d’Amiens, Renault de Cormont, pour tracer le rez-de-chaussée du plan de l’abside.
Les rayons G O, H O tirés donnaient, par leur rencontre avec le petit arc C E, les centres des autres piles du sanctuaire. Quant aux chapelles, celles de la cathédrale d’Amiens présentent cinq côtés d’un octogone régulier. Voici comment on s’y prit pour les tracer : la ligne N P, axe de la chapelle, étant tirée, les lignes G G′, F F′ ont été conduites parallèles à cet axe. La base F G du polygone étant reculée pour dégager la pile, la ligne L M a été tirée, divisant en deux angles égaux l’angle droit F′ L S. L’angle M L S a été divisé en deux angles égaux par une ligne L R. L’intersection de cette ligne L R avec l’axe N P est le centre T de l’octogone. Les lignes T R, T M, T Z, T F′ donnent la projection horizontale de quatre des arcs de la voûte. Il en est de même des lignes O C, O K F, O G, etc.
Pour tracer les arcs ogives des voûtes des bas-côtés, soit I le devant de la pile séparative des chapelles, la ligne I I′ a été divisée en deux parties égales, et, prenant O J comme rayon, un cercle a été décrit. La rencontre de ce cercle avec les axes des chapelles a donné le centre des clefs des voûtes (voy. Voûte).
Voulant avoir une chapelle plus profonde que les six autres dans l’axe, on a pris la distance H U sur le prolongement de la ligne tirée du point H parallèlement au grand axe ; puis, à partir du point U, on a procédé comme nous l’avons indiqué à partir du point L.
La fig. 21 bis présente le tracé des arcs des voûtes et piles des chapelles, ainsi que des contreforts extérieurs qui viennent tous s’inscrire dans un grand plateau circulaire en maçonnerie V Q, s’élevant d’un mètre environ au-dessus du sol extérieur.
Tout ce grand ensemble de constructions est admirablement planté, régulier, solide ; les différences dans les ouvertures des chapelles sont de trois ou quatre centimètres en moyenne au plus. On voit que ce sont les projections horizontales des arcs des voûtes qui ont commandé la disposition du plan (voy. Chapelle, Construction, Pilier, Travée, Voûte, pour les détails de cette partie de la cathédrale d’Amiens).
La cathédrale d’Amiens n’était pas la seule qui se construisait sur ce plan, dans cette partie de la France, de 1220 à 1260.

soit (23) la ligne de base A B, le grand axe C D ; O le point de centre, traçant deux arcs de cercle A D B, G F E. Si nous divisons chacun de ces arcs de cercle en sept parties égales, le rayon H O, tiré du point diviseur H de l’arc du grand cercle prolongé, viendra couper la corde A B au point K ; tandis que le rayon, tiré du point diviseur I de l’arc du petit cercle prolongé, viendra couper cette même corde en L. D’où l’on doit conclure, si nous suivons la méthode adoptée par les architectes des cathédrales d’Amiens et de Beauvais, pour tracer une abside avec bas-côtés et chapelles rayonnantes, que le centre de l’abside étant fixé à une distance invariable de la ligne de base sur le grand axe, la largeur du sanctuaire sera en raison inverse de la largeur totale comprise entre les axes des piles extérieures des bas-côtés, du moment que la portion du cercle absidal sera divisée en sept parties.
Nous avons vu, dans le plan de l’abside de la cathédrale de Chartres (fig. 12), que les chapelles sont mal plantées ; les arcs-boutants ne sont pas placés sur le prolongement de la ligne de projection horizontale des arcs rayonnants du sanctuaire ; que l’on trouve encore là les suites d’une hésitation, des tâtonnements. Rien de pareil à Amiens et à Beauvais ; la position des arcs-boutants venant porter sur les massifs entre les chapelles rayonnantes est parfaitement indiquée par le prolongement des rayons tendant au centre de l’abside. À Amiens, à Beauvais, on ne rencontre aucune irrégularité dans la plantation des constructions absidales.
L’architecte de la cathédrale de Beauvais avait voulu surpasser l’œuvre des successeurs de Robert de Luzarches. Non-seulement (fig. 22) il avait tenté de donner plus de largeur au sanctuaire de son église, mais il avait pensé pouvoir donner aussi une plus grande ouverture aux arcades parallèles du chœur, en n’élevant que trois travées au lieu de quatre entre le rond-point et la croisée. Aux angles des transsepts, il projetait certainement quatre tours, sans compter la tour centrale qui fut bâtie. Ses chapelles absidales, moins grandes que celles d’Amiens et moins élevées, laissèrent, entre leurs voûtes et celles des bas-côtés, régner un triforium avec fenêtres au-dessus[55]. En élévation, il donna plus de hauteur à ses constructions centrales, et surtout plus de légèreté. Ses efforts ne furent pas couronnés de succès ; la construction du chœur était à peine achevée avec les quatre piles de la croisée et la tour centrale, que cette construction, trop légère, et dont l’exécution était d’ailleurs négligée, s’écroula en partie. À la fin du XIIIe siècle, des piles durent être intercalées entre les piles des trois travées du chœur (fig. 22) en A, en B et en C (voy. Construction).
Une sacristie fut élevée en D comme à Amiens, et ce ne fut qu’au commencement du XVIe siècle que l’on put songer à terminer ce grand monument. Toutefois, ces dernières constructions ne purent s’étendre au delà des transsepts, ainsi que l’indique notre plan ; les guerres religieuses arrêtèrent à tout jamais leur achèvement[56].
La cathédrale d’Amiens et celle de Beauvais produisirent un troisième édifice, dans l’exécution duquel on profita avec succès des efforts tentés, par les architectes de ces deux monuments ; nous voulons parler de la cathédrale de Cologne. Nous avons vu que le chœur de la cathédrale d’Amiens avait dû être commencé de 1235 à 1240 ; celui de la cathédrale de Beauvais fut fondé en 1225 ; mais nous devons avouer que nous ne voyons, dans les parties moyennes de cet édifice, rien qui puisse être antérieur à 1240 ; cependant, en 1272, ce chœur était achevé, puisqu’on s’occupait déjà, à cette époque, de relever les voûtes écroulées. En 1248, on commençait la construction du chœur de la cathédrale de Cologne[57] ; en 1322, ce chœur était consacré. On a prétendu que les projets primitifs de la cathédrale de Cologne avaient été rigoureusement suivis lors de la continuation de ce vaste édifice ; si cette conjecture n’est pas admissible dans l’exécution des détails architectoniques, nous la croyons fondée en ce qui touche aux dispositions générales.

Cet art français du XIIIe siècle arrive si rapidement à son développement, que déjà, vers le milieu de ce siècle, on sent qu’il étouffera l’imagination de l’artiste ; il se réduit souvent à des formules qui tiennent plus de la science que de l’inspiration ; il tend à devenir banal. Des tâtonnements, il tombe presque sans transition dans la rigueur mathématique. Le moment pendant lequel on peut le saisir est compris entre des essais dans lesquels on sent une surabondance de force et d’imagination, et un formulaire toujours logique, mais souvent sec et froid. Cela tient non pas seulement aux arts de cette époque, mais à l’esprit de notre pays, qui tombe sans cesse des excès de l’imagination dans l’excès de la méthode, de la règle ; qui, après s’être passionné pour les formes extérieures de l’art, se passionne pour un principe abstrait ; qui, pour tout dire en un mot, ne sait se maintenir dans le juste milieu en toutes choses.
On nous a répété bien des fois que nous étions latins : par la langue, nous en tombons d’accord ; par l’esprit, nous penchons plutôt vers les Athéniens. Comme eux, une fois au pied de l’échelle, nous arrivons promptement au sommet, non pour nous y tenir, mais pour en descendre. Si nous passons en revue l’histoire des arts de tous les peuples (qui ont eu des arts), nous ne trouverons nulle part, si ce n’est à Athènes et dans le coin de l’Occident que nous occupons, ce besoin incessant de faire pencher les plateaux de la balance tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, sans jamais les maintenir en équilibre.
Ce qu’on a toujours paru redouter le plus en France, c’est l’immobilité ; au besoin de mouvement, l’on a sacrifié de tout temps, chez nous, le vrai et le bien, lorsque par hasard on y était arrivé. Et pour ne pas sortir des questions d’art, nous avons toujours fait succéder à une période d’invention, de recherche, de développement de l’imagination, de poésie, si l’on veut, une période de raisonnement ; aux égarements de la fantaisie et de la liberté, la règle absolue. De l’architecture si variée et si pleine d’invention du commencement du XIIIe siècle, de cette voie si large qui permettait à l’esprit d’arriver à toutes les applications de l’art, on se jette tout à coup dans la science pure, dans une suite de déductions impérieuses qui font passer cet art des mains des artistes inspirés aux mains des appareilleurs. Des abus de ce principe naissent les architectes de la renaissance, ceux-ci laissent pleine carrière à leur imagination ; la fantaisie règne en maîtresse absolue ; mais bientôt, s’appuyant sur une interprétation judaïque de l’architecture antique, on veut être plus Romain que les Romains, on circonscrit l’art de l’architecture dans la connaissance des ordres, soumis à des règles impérieuses que les anciens se gardèrent bien de reconnaître[59]. Cependant, les excès en France sont presque toujours couverts d’un vernis, d’une sorte d’enveloppe qui les rend supportables ; on appellera cela le goût si l’on veut. On arrive promptement à l’abus, et l’abus persiste parce qu’on le rend presque toujours séduisant.
L’architecture française était en chemin, dès le milieu du XIIIe siècle, de franchir en peu de temps les limites du possible ; cependant on s’arrête aux hardiesses, on n’atteint pas l’extravagance. L’architecte du chœur de la cathédrale de Beauvais, si ce monument eût été exécuté avec soin, fût arrivé, cinquante ans après l’inauguration de l’art ogival, à produire tout ce que cet art peut produire ; il est à croire que les fautes qu’il commit dans l’exécution arrêtèrent l’élan de ses confrères : il y eut réaction ; à partir de ce moment, l’imagination cède le pas aux calculs, et les constructions religieuses qui s’élèvent à la fin du XIIIe siècle sont l’expression d’un art arrivé à sa maturité, basé sur l’expérience et le raisonnement, et qui n’a plus rien à trouver.
Mais avant de donner des exemples de ces derniers monuments, nous ne pouvons omettre de parler de certaines cathédrales qui doivent être classées à part.
Nous avons d’abord fait connaître les édifices de premier ordre élevés pendant une période de soixante ans environ, pour satisfaire aux besoins nouveaux du clergé et des populations, dans des villes riches, et au moyen de ressources considérables. Mais si l’entraînement qui portait les évêques à rebâtir leurs cathédrales était le même sur toute la surface du domaine royal et des provinces les plus voisines, les ressources n’étaient pas, à beaucoup près, égales dans tous les diocèses. Pendant que Reims, Chartres et Amiens élevaient leur église mère sur de vastes plans, après en avoir assuré la durée par des travaux préliminaires exécutés avec un grand luxe de précautions, d’autres diocèses, entourés de populations moins favorisées, moins riches, en se laissant entraîner dans le mouvement irrésistible de cette époque, ne pouvaient réunir des sommes en rapport avec la grandeur des entreprises, quelle que fût d’ailleurs la bonne volonté des fidèles.
De ce besoin de construire des églises vastes avec des moyens insuffisants, il résultait des édifices qui ne pouvaient présenter des garanties de durée. Pour pouvoir élever, au moins partiellement, les constructions sans épuiser toutes les ressources disponibles dès les premiers travaux, on se passait de fondations, ou bien on les établissait avec tant de parcimonie, qu’elles n’offraient aucune stabilité. Lorsqu’on a vu comme sont fondées les cathédrales de Paris, de Reims, de Chartres ou d’Amiens, on ne peut admettre que les maîtres des œuvres des XIIe et XIIIe siècles ne fussent pas experts dans la connaissance de ces éléments de la construction. Mais tel évêque voulait une cathédrale vaste, promptement élevée, qui pût rivaliser avec celles des diocèses voisins, et ses ressources étaient proportionnellement minimes ; il n’entendait pas qu’on enfouît sous le sol une grande partie de ces sommes réunies à grande peine, il fallait paraître ; le maître de l’œuvre se contentait de jeter, dans des tranchées mal faites, du mauvais moellon que l’on pilonnait ; puis il élevait à la hâte, sur cette base peu résistante, un grand édifice. Habile encore dans son imprudence, il achevait son œuvre.
Ces derniers monuments ne sont pas les moins intéressants à étudier, car ils prouvent, beaucoup mieux que ceux élevés avec luxe, deux choses : la première, c’est que le nouveau système d’architecture adopté par l’école laïque se prêtait à ces imperfections d’exécution, et pouvait, à la rigueur, se passer de précautions regardées comme nécessaires ; la seconde, que, dans des cas pareils, les maîtres des œuvres du moyen âge arrivaient, par des artifices de construction qui dénotent une grande subtilité et beaucoup d’adresse, à élever à peu de frais des édifices vastes et d’une grande apparence. Si ces édifices tombent aujourd’hui, s’ils ont subi des altérations effrayantes, ils n’en ont pas moins duré six siècles ; les évêques qui les ont bâtis ont obtenu le résultat auquel ils tendaient : eux et leurs successeurs les ont vus debout.


Tours était cependant une ville très-importante au XIIIe siècle ; mais nous ne trouvons plus dans les populations des bords de la Loire cet esprit hardi, téméraire des populations de l’Île de France, de Champagne et de Picardie. Plus sages, plus mesurés, les riverains de la Loire n’exécutent leurs monuments que dans les limites de leurs ressources. La cathédrale de Tours, dans ses dimensions restreintes, en est un exemple remarquable.
Ce charmant édifice est exécuté avec un soin tout particulier ; on n’y voit, dans aucune de ses parties, de ces négligences si fréquentes dans nos grandes cathédrales du nord. Les cathédrales de Chartres et d’Amiens particulièrement, paraissent avoir été élevées avec une hâte qui tient de la fièvre ; il semble, lorsqu’on parcourt ces édifices, que leurs architectes aient eu le pressentiment du peu de durée de cette impulsion à laquelle ils obéissaient. À Tours, on sent l’étude, le soin, la lenteur dans l’exécution ; le chœur de la cathédrale est l’œuvre d’un esprit rassis, qui possède son art et n’exécute qu’en vue des ressources dont il peut disposer. On peut dire que ce gracieux monument suit pas à pas les progrès de l’art de son temps ; mais aussi n’y sent-on pas l’inspiration du génie qui conçoit et devance l’exécution, qui anime la pierre, et la soumet sans cesse à de nouvelles idées.
Il est nécessaire que nous revenions sur nos pas pour reprendre, à sa souche, une autre branche des grandes constructions religieuses du XIIIe siècle. À Autun, il existe encore une cathédrale bâtie vers le milieu du XIIe siècle ; ce monument rappelle les constructions religieuses de Cluny ; il avait été élevé sous l’influence des églises de cet ordre et des traditions romaines vivantes encore dans cette ville.
Son plan, que nous donnons ici (27), couvre une surface médiocre comme étendue[63] ; il est d’une grande simplicité ; la nef et les collatéraux se terminent par trois absides semi-circulaires ; le vaisseau principal est voûté en berceau ogival, avec arcs doubleaux ; les bas-côtés en voûtes d’arêtes sans arcs ogives[64]. Un vaste porche, bâti peu de temps après la construction de la nef, la précède, comme dans les églises clunisiennes.

Cet édifice en produisit bientôt un autre ; c’est la cathédrale de Langres (28). À Langres, le bas-côté pourtourne le sanctuaire ; une seule chapelle existait à l’abside[65] ; dans les murs est des croisillons, s’ouvrent deux petites absides. Le rond-point était encore voûté en cul-de-four ; mais, dans la travée qui le précède et dans le collatéral circulaire, apparaissent les voûtes d’arêtes avec arcs ogives. Les fenêtres et les galeries sont plein cintre ; tous les archivoltes, formerets et arcs doubleaux, en tiers point (voy. Voûte). Des arcs-boutants, qui datent de la construction primitive, contre-buttent les poussées reportées sur les contreforts.


Cette école de constructeurs, dont nous retrouvons les œuvres à la Charité-sur-Loire, dans le porche de Vézelay, dans celui de Cluny, dans la belle église de Montréale (Yonne), dans une grande partie du Lyonnais, de la Bourgogne et du fond de la Champagne, s’élevait parallèlement à l’école sortie de l’Île de France ; elle fut absorbée par celle-ci.
La cathédrale de Langres est la dernière expression originale de cette branche de l’art ogival issue des provinces du sud-est ; les deux rameaux se rencontrèrent à Sens pour se mêler et produire un édifice d’un caractère particulier, mais où cependant l’influence française prédomine. Nous présentons le plan (30) de la cathédrale de Sens[67], terminée à la fin du XIIe siècle.
Mais, à Sens, plus de pilastres cannelés ; déjà le système de la voûte française est adopté dans les bas-côtés[68]. Autour du sanctuaire, ce n’est plus, comme à Langres, une simple rangée de colonnes qui porte les parties supérieures, mais des colonnes accouplées suivant les rayons de la courbe, et des piles formées de faisceaux de colonnettes. Ce système de colonnes accouplées entre des piles plus fortes, se reproduit dans toute l’œuvre intérieure de la cathédrale de Sens, et s’adapte parfaitement à la combinaison des voûtes dont les diagonales ou arcs ogives comprennent deux travées ; c’est une disposition analogue à celle de la nef de la cathédrale de Noyon, et qui fut généralement adoptée dans les églises de l’Île-de-France de la fin du XIIe siècle. Malheureusement, la cathédrale de Sens subit bientôt de graves modifications ; des reconstructions et adjonctions postérieures à sa construction changèrent profondément ses belles dispositions premières. Pour bien nous rendre compte de l’édifice primitif, il nous faut passer la Manche et aller à Canterbury.
Nous ne possédons aucun renseignement précis sur la fondation de la cathédrale actuelle de Sens, et le nom du maître de l’œuvre qui la conçut nous est inconnu ; on sait seulement que sa construction était en pleine activité sous l’épiscopat de Hugues de Toucy, de 1144 à 1168, dates qui s’accordent parfaitement avec le caractère archéologique du monument. Nos voisins d’outre-mer sont plus soigneux que nous lorsqu’il s’agit de l’histoire de leurs grands monuments du moyen âge. Les documents abondent chez eux, et depuis longtemps ont été recueillis avec soin ; grâce à cet esprit conservateur, nous allons trouver à Canterbury l’histoire de la cathédrale sénonaise.
En 1174, un incendie détruisit le chœur et le sanctuaire de la cathédrale de Canterbury ; l’année suivante, après que les restes de la partie incendiée eurent été dérasés et qu’on eut établi provisoirement les stalles dans l’ancienne nef, on commença le nouveau chœur. L’œuvre fut confiée à un certain Guillaume de Sens[69]. Ce maître de l’œuvre ne quitta l’Angleterre qu’en 1179, à la suite d’une chute qu’il fit sur ses travaux, après avoir élevé la partie antérieure du nouveau chœur et les deux transsepts de l’est[70]. Avant de partir, étant blessé et ne pouvant quitter son lit, Guillaume de Sens, voyant l’hiver (1778-1779) approcher, et ne voulant pas laisser la grande voûte inachevée, donna la conduite du travail à un moine habile et industrieux qui lui servait de conducteur de travaux. Ce fut ainsi que put être terminée la voûte de la croisée et des deux transsepts orientaux.
Mais « le maître, s’apercevant qu’il ne recevait aucun soulagement des médecins, abandonna l’œuvre, et, traversant la mer, retourna chez lui en France. Un autre lui succéda dans la direction des travaux William de nom, Anglais de nation, petit de corps, mais probe et habile dans toutes sortes d’arts. » Ce fut ce second maître, anglais de nation, qui termina le chœur, le chevet, la chapelle de la Trinité et la chapelle dite la couronne de Becket.  Or cette extrémité orientale, dont nous donnons le plan au niveau de la galerie du rez-de-chaussée (31), quoique élevée par un architecte anglais, conserve encore tous les caractères de l’abside de la cathédrale de Sens, non-seulement dans son plan, mais dans sa construction, ses profils et sa sculpture d’ornement, avec plus de finesse et de légèreté ; ce qui s’explique par l’intervalle de quelques années qui sépare ces deux constructions. William l’Anglais n’a fait que suivre, nous le croyons, les projets de son malheureux prédécesseur, qui pourrait bien être le maître de l’œuvre de la cathédrale de Sens. Le chevet de la cathédrale de Canterbury nous donne le moyen de restituer le chevet de la cathédrale de Sens, ainsi que nous l’avons fait (fig. 30)[71].
Or cette extrémité orientale, dont nous donnons le plan au niveau de la galerie du rez-de-chaussée (31), quoique élevée par un architecte anglais, conserve encore tous les caractères de l’abside de la cathédrale de Sens, non-seulement dans son plan, mais dans sa construction, ses profils et sa sculpture d’ornement, avec plus de finesse et de légèreté ; ce qui s’explique par l’intervalle de quelques années qui sépare ces deux constructions. William l’Anglais n’a fait que suivre, nous le croyons, les projets de son malheureux prédécesseur, qui pourrait bien être le maître de l’œuvre de la cathédrale de Sens. Le chevet de la cathédrale de Canterbury nous donne le moyen de restituer le chevet de la cathédrale de Sens, ainsi que nous l’avons fait (fig. 30)[71].
Ce qui caractérise la cathédrale de Sens, c’est l’ampleur et la simplicité des dispositions générales. La nef est large, les points d’appui résistants, élevés seulement sous les retombées réunies des grandes voûtes ; le chœur est vaste et profond. L’architecte avait su allier la mâle grandeur des églises bourguignonnes du XIIe siècle aux nouvelles formes adoptées par l’Île-de-France. Mais il ne faut pas croire que ce monument nous soit conservé tel que l’avait laissé l’évêque Hugues de Toucy. Dévasté par un incendie vers le milieu du XIIIe siècle, les voûtes, les fenêtres hautes et les couronnements furent refaits, puis la chapelle absidale. Des colonnes furent ajoutées entre les colonnes accouplées du rond-point, afin de porter de fond les archivoltes qui devaient, comme à Canterbury, porter sur des culs-de-lampe saillants entre les deux chapiteaux (voy. Pile).
À la fin de ce siècle, on pratiqua des chapelles entre les contreforts de la nef ; cette malheureuse opération, que subirent toutes nos cathédrales françaises, sauf celles de Reims et de Chartres, eut pour résultat d’affaiblir les points d’appui extérieurs et de rendre l’écoulement des eaux difficile. Vers 1260, la tour sud de la façade s’écroula sur la belle salle synodale bâtie vers 1240, en C ; cette tour fut remontée à la fin du XIIIe siècle et achevée seulement au XVIe siècle. La tour du nord, élevée vers la fin du XIIe siècle, n’était terminée que par un beffroi de bois, recouvert de plomb, monté vers le commencement du XIVe siècle[72]. Au commencement du XVIe siècle, le pignon du transsept sud, qui datait du XIIIe siècle, fut repris dans toute sa partie supérieure ; celui du nord, complétement rebâti ; les fenêtres hautes des croisillons, refaites avec leurs vitraux ; enfin, deux chapelles de forme irrégulière vinrent s’accoter, à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, contre les flancs du collatéral de l’abside. Une salle du trésor et des sacristies qui communiquent avec l’archevêché s’élevèrent en B. L’entrée principale du palais archiépiscopal était sous la salle synodale en A.
Dans la cathédrale de Sens, le plein cintre vient se mêler à l’ogive, comme dans le chœur de la cathédrale de Canterbury. C’est encore là une influence de l’école bourguignonne.
Les constructions achevées en 1168 avaient dû s’arrêter à la seconde travée de l’entrée de la nef. Les parties les plus anciennes de la façade ne remontent pas plus loin que les dernières années du XIIe siècle ; il ne reste, de cette époque, que les deux portes centrale et nord et la tour nord tronquée. À l’intérieur et à l’extérieur, sur ce point, c’est un mélange incompréhensible de constructions reprises pendant les XIIIe, XIVe et XVIe siècles.
Ce qui reste des vitraux du commencement du XIIIe siècle et du XVIe, dans la cathédrale de Sens, est fort remarquable (voy. Vitrail).
Saint-Étienne de Sens est une cathédrale à part, comme plan et comme style d’architecture ; contemporaine de la cathédrale de Noyon, elle n’en a pas la finesse et l’élégance. On y trouve, malgré l’adoption du nouveau système d’architecture, l’ampleur des constructions romanes, bourguignonnes et de Langres, comme un dernier reflet de l’antiquité romaine. Ce qui caractérise la cathédrale sénonaise, c’est surtout l’unique chapelle absidale et les deux absidioles des transsepts. Quoique Sens et Langres dépendissent de la Champagne, ces deux églises appartiennent bien moins à cette province qu’à la Bourgogne, comme disposition et style d’architecture.
Nous en trouvons la preuve dans les substructions de la cathédrale d’Auxerre. La cathédrale d’Auxerre, rebâtie après un incendie par l’évêque Hugues, vers 1030, possédait un sanctuaire circulaire avec bas-côtés et chapelle unique dans l’axe ; la crypte de cette église, encore existante aujourd’hui, est, sous ce point de vue, du plus grand intérêt. Nous en donnons ici le plan (32)[73], dépouillé des contreforts extérieurs ajoutés au XIIIe siècle.  En comparant ce plan de crypte avec le plan du chœur et du chevet de la cathédrale de Langres, et surtout avec celui de la cathédrale de Sens, il est facile de reconnaître le degré de parenté intime qui lie ces trois édifices, construits à des époques fort différentes ; et on peut conclure, nous le croyons, de cet examen, que les diocèses d’Autun, de Langres, d’Auxerre et de Sens, possédaient, depuis le XIe siècle, certaines dispositions de plan qui leur étaient particulières, et qui furent adoptées dans la partie orientale de la cathédrale de Canterbury.
En comparant ce plan de crypte avec le plan du chœur et du chevet de la cathédrale de Langres, et surtout avec celui de la cathédrale de Sens, il est facile de reconnaître le degré de parenté intime qui lie ces trois édifices, construits à des époques fort différentes ; et on peut conclure, nous le croyons, de cet examen, que les diocèses d’Autun, de Langres, d’Auxerre et de Sens, possédaient, depuis le XIe siècle, certaines dispositions de plan qui leur étaient particulières, et qui furent adoptées dans la partie orientale de la cathédrale de Canterbury.
Nous retrouvons encore les traces de cette école, au XIIIe siècle, à Auxerre même. En 1215, l’évêque Guillaume de Seignelay commença la reconstruction de toute la partie orientale de la cathédrale d’Auxerre ; l’ancienne crypte fut conservée, et c’est sur son périmètre, augmenté seulement de la saillie de quelques contreforts, que s’éleva la nouvelle abside. Sur la petite chapelle absidale de la crypte, on bâtit une seule chapelle carrée dans l’axe, en renforçant par des piliers, à l’extérieur, le petit hémicycle du XIe siècle (fig. 32).
Certes, à cette époque, si l’on n’avait pas regardé cette forme de plan comme consacrée par l’usage, même en conservant la crypte, on aurait pu, comme à Chartres, s’étendre au dehors de son périmètre, soit pour élever un second bas-côté, soit pour ouvrir un plus grand nombre de chapelles absidales. Le plan du XIe siècle fut conservé, et le chœur de la cathédrale auxerroise du XIIIe siècle respecta sa forme traditionnelle. Cependant la construction du chœur de Saint-Étienne d’Auxerre fut assez longue à terminer.
Guillaume de Seignelay, en prenant possession du siège épiscopal de Paris, en 1220, laissa des sommes assez importantes pour continuer l’œuvre ; son successeur, Henri de Villeneuve, qui mourut en 1234, paraît avoir achevé l’entreprise ; c’est l’opinion de l’abbé Lebeuf[74], opinion qui se trouve d’accord avec le style de cette partie de la cathédrale. Quant aux transsepts et à la nef de l’église Saint-Étienne d’Auxerre, commencés vers la fin du XIIIe siècle, on ne les acheva que pendant les XIVe et XVe siècles. La façade occidentale resta incomplète ; la tour nord seule fut terminée vers le commencement du XVIe siècle.
Si les diocèses méridionaux de la Champagne avaient subi l’influence des arts bourguignons, l’un de ceux du nord avait pris certaines dispositions aux édifices religieux des bords du Rhin.
Ne pouvant nous occuper des admirables cathédrales de Cambrai et d’Arras[76], détruites aujourd’hui, et qui auraient pu nous fournir des renseignements précieux sur la fusion de l’école rhénane avec l’école française, nous ferons un détour vers les provinces du nord-ouest et de l’ouest.
Dans le Nord, les voûtes avaient paru tardivement ; les grandes églises du centre de la France, des provinces de l’est et de l’ouest, étaient déjà voûtées au XIe siècle, quand on couvrait encore les nefs principales des églises par des charpentes apparentes dans une partie de la Picardie et de la Champagne, dans la Normandie, le Maine et la Bretagne.
Pendant le XIIe siècle, la Normandie et le Maine n’étaient pas réunis au domaine royal ; et, quoique les ducs de Normandie tinssent leur province en fief de la couronne, chacun sait combien ils reconnaissaient peu, de fait, la suzeraineté des rois de France. Ce qui reste des cathédrales normandes du XIe au XIIe siècle, en Angleterre et sur le continent, donne lieu de supposer que ces monuments, dont le plan se rapprochait beaucoup de la basilique romaine, étaient, en grande partie, couverts par des lambris ; les voûtes n’apparaissaient que sur les bas-côtés et les sanctuaires. L’ancienne cathédrale du Mans fut construite d’après ce principe au commencement du XIe siècle. Nous en donnons le plan (34)[77].
La cathédrale de Peterborough en Angleterre, d’une date plus récente, mais qui cependant, sur presque toute son étendue, est antérieure au XIIe siècle, présente encore une disposition analogue à celle-ci.
Pendant le XIIe siècle, vers l’époque où l’on construisait les églises de l’abbaye de Saint-Denis et de Notre-Dame de Noyon, la nef romane de la cathédrale du Mans fut remaniée ; on reprit les piles et les parties supérieures de la nef, qui fut alors voûtée ainsi que les transsepts. Ces voûtes se rapprochent, comme construction, non du système adopté dans l’Île-de-France et le Soissonnais, mais de celui qui dérivait des coupoles des églises de l’Ouest (voy. Voûte). Une porte, décorée de sculptures et de statues qui ont avec celles du portail royal de la cathédrale de Chartres la plus grande analogie, fut ouverte au milieu de la nef au sud (35).
Le chœur de la cathédrale du Mans, si ce n’était la profondeur inusitée des chapelles absidales, présenterait une disposition absolument pareille à celle de la cathédrale de Bourges. C’est-à-dire qu’il possède deux rangs de galeries ; le premier bas-côté, étant beaucoup plus élevé que le second, a permis de pratiquer des jours et un triforium dans le mur séparant ces deux bas-côtés au-dessus des archivoltes. Mais la construction, la disposition des chapelles, les détails de l’architecture sont beaucoup plus beaux au Mans qu’à Bourges. Les extérieurs sont traités d’une manière remarquable, avec luxe, et ne laissent pas voir la pauvreté des moyens comme la cathédrale de Bourges. Une belle sacristie s’ouvre au sud ; elle date également du XIIIe siècle. Les deux pignons des transsepts, le seul clocher[78] bâti à l’extrémité du croisillon sud, ne furent terminés qu’au XIVe siècle. Il est à croire que le maître de l’œuvre du chœur de la cathédrale du Mans songeait à reconstruire la nef dans le même style ; les travaux s’arrêtèrent aux transsepts, et si le monument y perd de l’unité, l’histoire de l’art y gagne des restes fort précieux de la cathédrale primitive.
Au Mans, la chapelle de la Vierge, dans l’axe, est beaucoup plus profonde que ses voisines et elle s’élève sur une crypte dans laquelle on descend par un petit escalier particulier. Cette disposition de chapelles absidales profondes, celle centrale étant accusée par une ou deux travées de plus que les autres, se retrouve également dans le chœur de la cathédrale de Séez. Cet édifice, complétement de style normand dans la nef, qui date des premières années du XIIIe siècle, se rapproche du style français dans sa partie orientale ; il peut être classé parmi ceux qui, élevés au moyen de ressources insuffisantes, comme Troyes, Châlons-sur-Marne, Meaux, ne furent point fondés, ou le furent mal.

La nef (36), bâtie au commencement du XIIIe siècle, fut remaniée dans sa partie supérieure cinquante ou soixante ans après sa construction ; le chœur, élevé vers 1230, et presque entièrement détruit par un incendie, dut être repris, vers 1260, de fond en comble, sauf la chapelle de la Vierge, que l’on jugea pouvoir être conservée. Le maître de l’œuvre du chœur, ne se fondant que sur des maçonneries très-insuffisantes, avait cherché, par l’extrême légèreté de sa construction, à diminuer le danger d’une pareille situation ; et en ne considérant même le chœur de la cathédrale de Séez qu’à ce point de vue, il mériterait d’être étudié. Les chapelles profondes absidales, présentant des murs rayonnants étendus, se prêtaient d’ailleurs à une construction légère et bien empattée. En effet, les travées intérieures du sanctuaire sont d’une légèreté qui dépasse tout ce qui a été tenté en ce genre (voy. Travée), et la construction en élévation est des plus savantes ; cependant, rien ne peut remplacer de bonnes fondations ; vers la fin du XIVe siècle, on crut nécessaire de renforcer les contre-forts extérieurs du chœur ; mais ces adjonctions, mal fondées elles-mêmes, contribuèrent encore, par leur poids, à entraîner la légère bâtisse du XIIIe siècle, qui ne fit, depuis lors, que s’ouvrir de plus en plus. Au commencement de notre siècle, les grandes voûtes du sanctuaire s’écroulèrent ; il fallut les refaire en bois.
La façade de la cathédrale de Séez est couronnée par deux tours avec flèches élevées au commencement du XIIIe siècle et réparées ou reprises pendant les XIVe et XVe. Ces tours, ainsi que toute la nef, ont fait de très-sérieux mouvements, par suite de l’insuffisance des fondations. C’est aujourd’hui un monument fort compromis[79].
Nous ne quitterons pas la Normandie, sans parler des cathédrales de Bayeux et de Coutances.

À Bayeux, il n’y a plus trace, dans le style de l’architecture, de l’influence française. Le mode normand domine seul ; c’est celui que nous retrouvons à Westminster, à Lincoln, à Salisbury, à Ely, en Angleterre ; et cependant, comme disposition de plan, la cathédrale de Bayeux se rapproche plus des cathédrales françaises du XIIIe siècle, au moins dans sa partie orientale, que des cathédrales anglaises. C’est qu’au XIIIe siècle, si la Normandie possédait son style d’architecture propre, elle subissait alors l’influence des édifices du domaine royal.
La cathédrale de Dol seule, en Bretagne, paraît s’être affranchie complétement de l’empire qu’exerçaient, sur tout le territoire occidental du continent, les dispositions de plan adoptées, à la fin du règne de Philippe-Auguste, dans la construction des cathédrales, La cathédrale de Dol est terminée, à l’orient, par un mur carré, dans lequel s’ouvre un immense fenestrage, comme les cathédrales d’Ely et de Lincoln.
La cathédrale de Coutances, fondée en 1030 et terminée en 1083, soit qu’elle menaçât ruine comme la plupart des grandes églises du Nord de cette époque, soit qu’elle parût insuffisante, soit enfin que le diocèse de Coutances, nouvellement réuni à la couronne de France, voulût entrer dans le grand mouvement qui alors faisait reconstruire toutes les cathédrales au nord de la Loire ; la cathédrale de Coutances, disons-nous, fut complétement réédifiée dès les premières années du XIIIe siècle. Le chœur, avec ses chapelles rayonnantes, qui rappellent celles du chœur de la cathédrale de Chartres, paraît avoir été fondé vers la fin du règne de Philippe-Auguste. Les constructions de la nef durent suivre presque immédiatement celles du sanctuaire ; mais il est probable que les transsepts furent élevés sur les anciennes fondations romanes du XIe siècle, et que même les énormes piliers de la croisée ne font, comme à Bayeux, qu’envelopper un noyau de construction romane.

Le diocèse dans lequel le mélange du style normand et du style français est le plus complet, ce doit être, et c’est en effet le diocèse de Rouen. La cathédrale de Rouen occupait déjà, au XIIe siècle, la surface de terrain qu’elle occupe encore aujourd’hui. Rebâtie, pour la troisième fois, pendant le cours du XIe siècle, elle fut entièrement réédifiée pendant la seconde moitié du XIIe siècle dans le style normand de transition.

C’est en 1204 que Philippe-Auguste arracha des mains de Jean sans Terre la Normandie, et qu’il réunit à la couronne de France cette belle province, ainsi que l’Anjou, le Maine et la Touraine, avec une partie du Poitou. Peu après, de grands travaux furent entrepris dans la cathédrale de Rouen. La nef, les transsepts et le sanctuaire durent être reconstruits, à la suite d’un incendie, qui, probablement, endommagea gravement l’église du XIIe siècle. Là, comme dans les autres diocèses français, s’élève une cathédrale au commencement du XIIIe siècle, sous l’influence du pouvoir monarchique, et, chose remarquable, à Rouen, les constructions qui paraissent avoir été élevées sous le règne de Philippe-Auguste, c’est-à-dire de 1210 à 1220 environ, appartiennent au style français, tandis que celles qui datent du milieu du XIIIe siècle sont empreintes du style ogival normand. Ce fait curieux, écrit avec plus de netteté encore dans l’église d’Eu, est d’une grande importance pour l’étude de l’histoire de notre architecture nationale.
La Normandie possède, pendant toute la période romane et de transition, c’est-à-dire du XIe au XIIIe siècle, une architecture propre, dont les caractères sont parfaitement tranchés. Dans les édifices élevés pendant ce laps de temps, la disposition des plans, la construction, l’ornementation et les proportions de l’architecture normande, se distinguent entre celles des provinces voisines, l’Île de France, la Picardie, l’Anjou et le Poitou.
Au commencement du XIIIe siècle, lorsque l’architecture ogivale atteint, pour ainsi dire, sa puberté, en sortant de son domaine elle étouffe les écoles provinciales ; si elle respecte parfois certaines traditions, certains usages locaux qui n’ont d’influence que sur la composition générale des plans, elle impose tout ce qui tient à l’art, savoir : les proportions, la construction, les dispositions de détails et la décoration. Cette sorte de tyrannie ne dure pas longtemps, car, de 1220 à 1230, nous voyons l’architecture normande se réveiller et s’emparer du style ogival pour se l’approprier, comme un peuple conquis modifie bientôt une langue imposée, pour en faire un patois. Disons tout de suite, pour ne pas soulever contre nous, non-seulement la Normandie, mais toute l’Angleterre, que le patois ogival de ces contrées a des beautés et des qualités originales qui le mettent au-dessus des autres dérivés, et qui pourraient presque le faire passer pour une langue. Mais nous aurons l’occasion de développer notre pensée à la fin de cet article.
La cathédrale de Rouen, reconstruite au commencement du XIIIe siècle, adopta cependant certaines dispositions qui indiquent une singulière hésitation de la part des architectes, probablement français, qui furent appelés pour exécuter les nouveaux travaux. Dans la nef, le maître de l’œuvre semble avoir voulu figurer une galerie de premier étage, comme dans presque toutes les grandes églises de l’Île de France et du Soissonnais, mais s’être arrêté à moitié chemin, et, au lieu d’une galerie voûtée, avoir fait un simple passage sur des arcs bandés au-dessous des archivoltes des bas-côtés, et pourtournant les piles (voy. Galerie) au moyen de colonnettes portées en encorbellement.
Dans l’église d’Eu, même étrangeté, mais parfaitement expliquée. Le chœur, les transsepts et la dernière travée de la nef de cet édifice furent élevés dès les premières années de la conquête de Philippe-Auguste, c’est-à-dire de 1205 à 1210, en style français parfaitement pur, avec galerie voûtée au premier étage, comme à Notre-Dame de Paris. De 1210 à 1220 environ, interruption ; de 1220 à 1230, reprise des travaux ; la nef est continuée conformément aux dispositions premières, c’est-à-dire que tout est préparé pour recevoir une galerie voûtée de premier étage au-dessus des collatéraux ; mais déjà les tailloirs des chapiteaux et les socles des bases sont circulaires, les ornements et moulures sont devenus normands ; puis, en construisant, on se reprend, on coupe les chapiteaux destinés à recevoir les voûtes formant galerie, on laisse seulement subsister les archivoltes dans le sens de la longueur de la nef entre les piles ; on ne construit pas les voûtes devant servir de sol à la galerie de premier étage, et ce sont les voûtes hautes de cette galerie qui deviennent voûtes des collatéraux ; les fenêtres de cette galerie supprimée et celles du rez-de-chaussée se réunissent, en formant ainsi des baies démesurément longues.
La nef de la cathédrale de Rouen est de quelques années antérieure à celle de l’église d’Eu. A-t-on voulu, dans ce dernier édifice, imiter la disposition adoptée à Rouen, seulement quant à l’effet produit (les sous-archivoltes de la nef de l’église d’Eu étant sans utilité puisqu’on ne peut communiquer de l’un à l’autre, tandis qu’à Rouen ils forment une galerie) ? C’est probable… Quel que fut le motif qui dirigeât l’architecte de la cathédrale de Rouen, toujours est-il que la disposition de sa nef ne fut plus imitée ailleurs en Normandie, et que, dans cette province, dès que l’art ogival se fut affranchi de l’influence française et eut acquis un caractère propre, on ne voit plus de galeries voûtées de premier étage, ni rien qui les rappelle ; un simple triforium couronne les archivoltes des bas-côtés.
La cathédrale de Rouen, rebâtie presque totalement en style ogival français, est terminée, à partir du niveau des voûtes des collatéraux, en style ogival normand. Les quatre tours qui flanquent les transsepts, les fenêtres, les corniches et les balustrades supérieures sont normandes. Mais la nef de la cathédrale de Rouen était, comme toutes les nefs des cathédrales françaises du commencement du XIIIe siècle, dépourvue de chapelles. À la fin de ce siècle, on en construisit entre les contreforts (39), comme à la cathédrale de Paris. En 1302, on commença la reconstruction de la chapelle de la Vierge, située dans l’axe au chevet, en lui donnant de grandes dimensions, à la place de la chapelle du XIIe siècle, qui n’était pas plus grande que les deux autres chapelles absidales encore existantes. Vers cette époque, on refit les deux pignons nord et sud des transsepts (portail de la Calende et portail des Libraires). Ces travaux, du commencement du XIVe siècle, surpassent comme richesse et beauté d’exécution tout ce que nous connaissons en ce genre de cette époque.
Alors, la Normandie possède une école de constructeurs, d’appareilleurs et de sculpteurs, qui égale l’école de l’Île de France.
Les portails de la Calende et des Libraires, la chapelle de la Vierge de la cathédrale de Rouen, sont des chefs-d’œuvre[84].
Mais la cathédrale du XIIIe siècle, dont les dispositions primitives étaient déjà altérées au commencement du XIVe siècle, subit encore des changements importants qui, malheureusement, ne furent pas aussi heureux que ceux dont nous venons de parler. En 1430, les chanoines firent agrandir les fenêtres du chœur, non par nécessité, mais parce que, comme le dit Pommeraye[85], le chœur paraissait « sombre et ténébreux. » Les fenêtres de la nef et une grande partie des couronnements extérieurs, des galeries intérieures, furent également modifiés pendant le XVe siècle. En 1485 fut commencée la construction de la tour qui flanque le portail au sud, connue sous le nom de tour de Beurre[86]. Le cardinal George d’Amboise commença la reconstruction de la façade occidentale, qui ne fut jamais achevée. Déjà, au XIIIe siècle, il existait, sur les quatre piliers de la croisée, une haute tour carrée, dont deux étages subsistent encore ; endommagée par le vent en 1353, puis réparée et brûlée en 1514 par la négligence des plombiers ; l’étage supérieur de cette tour fut reconstruit et surmonté d’une immense flèche en bois recouvert de plomb, qui ne fut achevée qu’en 1544. La foudre y mit le feu en 1821, et on l’a voulu remplacer de nos jours par une flèche en fonte de fer[87].
Les dépendances de la cathédrale de Rouen étaient considérables, et, sous son ombre, l’archevêché, un beau cloître, des écoles, des bibliothèques, des sacristies, salles capitulaires et trésors étaient venus successivement se grouper du côté du nord et de l’est. Il reste encore de beaux fragments de ces divers bâtiments (voy. Cloître).
Jusqu’à présent, nous avons vu l’architecture, née en France à la fin du XIIe siècle, se développer avec le pouvoir royal et pénétrer, à la suite de ses conquêtes ou à l’aide de son influence politique, dans les provinces voisines de l’Île de France. Cette révolution s’accomplit dans l’espace de peu d’années, c’est-à-dire pendant la durée du règne de Philippe-Auguste. Mais, jusqu’à la fin du XIIIe siècle, elle ne dépasse pas les territoires que nous venons de parcourir. Dans d’autres provinces, au sud et à l’ouest, l’architecture romane suit paisiblement son cours naturel ; si elle se modifie, ce n’est pas dans son principe, mais dans les détails de son ornementation.
L’église abbatiale de Saint-Front de Périgueux avait été élevée, vers la fin du Xe siècle, à l’imitation de l’église de Saint-Marc de Venise (voy. Architecture Religieuse). Peu après, ou en même temps peut-être, on élevait l’église cathédrale de Périgueux[88] et l’église cathédrale de Cahors, toutes deux sans transsepts, et présentant seulement une seule nef avec abside.

L’église abbatiale de Saint-Front était plus étendue et plus riche que les deux pauvres cathédrales de Cahors et de la cité de Périgueux.
Dans les provinces de l’ouest, comme en Bourgogne, en Champagne, en Normandie, les églises abbatiales, pendant les Xe et XIe siècles, attiraient tout à elles ; mais si, dans les provinces du centre et de l’ouest, la renaissance épiscopale fut moins active au XIIe siècle que dans le nord et l’est, elle fit cependant de grands efforts, sans trouver une école d’architectes laïques toute prête à la seconder, et, dans les populations, un désir prononcé de se constituer en corps de nation. D’ailleurs, l’architecture romane de ces dernières provinces avait adopté, pour ses monuments religieux, un mode de construction durable, solide, qui excluait les charpentes et, par conséquent annulait les causes d’incendie ; et nous voyons que, dans le nord, à la fin du XIIe siècle, la reconstruction de la plupart des cathédrales romanes est provoquée par des incendies, comme si ce fléau avait voulu venir en aide aux tendances de l’épiscopat et des populations urbaines.
À Angoulême, une cathédrale avait été bâtie au commencement du XIIe siècle, elle se composait d’une nef à quatre coupoles, avec une abside et quatre chapelles rayonnantes (41).

Vers le milieu de ce siècle, alors que sur une grande partie du territoire de la France actuelle on élevait ou on songeait à élever de nouvelles cathédrales plus vastes, on se contenta d’agrandir la cathédrale d’Angoulême, par l’adjonction des deux transsepts surmontés de deux tours[89], et on enrichit l’intérieur de la nef en incrustant des colonnes engagées, et quelques détails d’architecture. La façade occidentale fut reconstruite et couverte de sculpture. De la primitive église, la première travée de la nef demeure seule intacte. À l’extérieur, les couronnements furent refaits.
Nous donnons (42), en A, la coupe sur le transsept nord de cette église, et en B la coupe transversale sur la nef[90]. Les adjonctions et les réparations à l’église primitive de Saint-Pierre d’Angoulême ne modifient pas le système de construction. La tradition romane est conservée pure. En se rapprochant des provinces du Nord, le style byzantin des églises de l’Ouest allait, dès le milieu du XIIe siècle, subir l’influence des écoles de l’Île de France et de Picardie.

De 1145 à 1165, on bâtissait, à Angers, la nef de la cathédrale[91]. Le plan de cette nef (43) se rapproche beaucoup de celui de la nef de la cathédrale d’Angoulême (fig. 41).

Mais, à Saint-Maurice d’Angers, la coupole a fait place à la voûte d’arêtes. Au commencement du XIIIe siècle, on élève les transsepts et le chœur, en suivant encore le système adopté au XIIe. L’architecture du Nord n’impose ici ni ses dispositions de plans, ni même son système de construction ; car ces voûtes d’arêtes sont plutôt des coupoles nervées que des voûtes en arcs d’ogives (voy. Voûte). Les nervures diagonales sont une décoration plutôt qu’un moyen de construction. Point de collatéraux, point de chapelles, une nef, des transsepts et un sanctuaire.
Saint-Front de Périgueux avait été l’origine de tous les monuments à coupole bâtis dans les provinces de l’Ouest pendant un siècle[92]. Mais, dans le Poitou et les provinces du centre, il s’était, dès le XIe siècle, formé une école de constructeurs dont le mode différait essentiellement de ceux adoptés par les architectes romano-byzantins de l’ouest ou par ceux du Nord. Une grande partie des églises romanes du Poitou, du Limousin, de la Saintonge, de la Vendée et même du Berry, possèdent une nef avec bas-côtés, dont les voûtes atteignent à peu près le même niveau ; celles des collatéraux, plus étroites, en berceau ou d’arêtes, servent de buttée aux voûtes centrales en berceau (voy. Architecture Religieuse, fig. 12). C’est conformément à ce principe que sont construites les églises de Saint-Savin près Poitiers, de Notre-Dame la Grande, de Melle, de Surgère, de Saint-Euthrope de Saintes, et même dans des provinces éloignées, de la cité de Carcassonne au XIe siècle, de Brives et de Limoges au XIIIe. Ces trois nefs, égales en hauteur, sinon en largeur, ne permettaient de prendre des jours que dans les murs des collatéraux, la voûte centrale restant dans l’obscurité. Ce mode de construction fut adopté pour l’édification de la cathédrale de Poitiers, au commencement du XIIIe siècle. Seulement, l’architecte donna à ses trois nefs une largeur à peu près égale, et les voûtes furent faites en arcs d’ogives avec nerf portant des clefs centrales aux clefs des arcs doubleaux.

Du dehors, la cathédrale de Poitiers, couverte par un comble à deux pentes, terminée à l’orient par un énorme mur pignon sans saillies et à peine percé, paraît être plutôt une salle immense qu’une église avec nef et collatéraux. Rien, dans le plan, n’indique ni le chœur, ni le sanctuaire. Nous sommes disposés à croire que, comme à Saint-Pierre d’Angoulême, des tours avaient été projetées sur les deux transsepts. Une façade de style français du Nord fut commencée, vers le milieu du XIIIe siècle, à l’ouest, et flanquée de deux petites tours non achevées. Les constructions supérieures de cette façade ne datent que des XIVe et XVe siècles. Malgré sa grandeur, la beauté de sa construction et de ses détails, c’est là, nous l’avouons, un monument étrange, une exception qui ne trouve pas d’imitateurs.

À partir du milieu du XIIIe siècle, l’architecture ogivale française s’impose dans toutes les provinces réunies à la couronne, et même dans quelques-unes de celles qui ne sont encore que vassales. Excepté en Provence et dans quelques diocèses du Midi, les styles provinciaux s’effacent, et les efforts des évêques tendent à élever des cathédrales dans le style de celles qui faisaient l’orgueil des villes du Nord.
C’est de 1260 à 1275 que nous voyons trois villes importantes du Midi jeter bas leurs cathédrales romanes pour élever des édifices dont la direction fut évidemment confiée à un même architecte du Nord, Clermont en Auvergne, Limoges et Narbonne. Ces trois diocèses commencent leurs, cathédrales, la première en 1268 et la dernière en 1272, sur des plans tellement identiques, qu’il est difficile de ne pas voir, dans ces trois monuments, la main d’un même maître. Peut-être, cependant, la cathédrale de Narbonne, tout en appartenant à la même école que les deux autres, fut-elle élevée par un autre architecte ; mais, quant aux cathédrales de Clermont et de Limoges, non-seulement ce sont les mêmes plans, mais les mêmes profils, les mêmes détails d’ornementation, le même système de construction.
Nous représentons ici (46) le plan de la cathédrale de Clermont, la première en date[93].
La construction de la cathédrale de Clermont fut commencée par le chœur. L’ancienne église romane avait été laissée debout, son abside ne venant guère que jusqu’à l’entrée du chœur nouveau[94]. Le sanctuaire achevé vers la fin du XIIIe siècle, l’église romane fut démolie, sauf la façade occidentale, et on continua l’œuvre pendant les premières années du XIVe siècle. Quatre travées de la nef furent complétées. Le travail, alors suspendu, ne fut plus repris, et on voit encore les restes de la façade du XIe siècle[95]. La partie orientale de la cathédrale de Clermont, entièrement bâtie en lave de Volvic, est admirablement construite, bien que l’on s’aperçoive de l’extrême économie imposée au maître de l’œuvre. Absence d’arcature dans les soubassements des chapelles, sculpture rare, pas de formerets aux voûtes. Ce qui est surtout remarquable, à Clermont comme à Limoges et à Narbonne, c’est la concession faite évidemment aux traditions méridionales par l’architecte du Nord. Ainsi, les bas-côtés et les chapelles sont couverts en terrasses dallées, quoique le triforium ne soit point à claire-voie. Les fenêtres hautes ne remplissent pas complétement l’intervalle entre les piliers, mais laissent entre elles des trumeaux d’une certaine largeur, ce qui est tout à fait contraire au système adopté dans toutes les églises du Nord de cette époque. Deux des chapelles carrées du chœur, au nord, sont consacrées au service de la sacristie, avec trésor au-dessus.
À la cathédrale de Limoges, dont nous donnons le plan (47), c’est au sud et de la même manière que sont placés les services pris aux dépens de deux chapelles. Dans les chapelles absidales de ces deux plans, qui présentent non-seulement des dispositions, mais encore des dimensions semblables, on remarquera la petite travée d’entrée qui précède le polygone ; c’est là un parti que nous ne trouvons adopté que dans les chapelles absidales de la cathédrale de Reims. Du reste, comme à Reims, comme à Beauvais, les chapelles rayonnantes sont toutes égales entre elles ; il n’y a pas de chapelle plus profonde dans l’axe, comme à Amiens, à Troyes, etc.
La nef de la cathédrale de Clermont appartient au XIVe siècle ; celle de la cathédrale de Limoges au XVe et même au XVIe[96], ainsi que le pignon du transsept nord. L’histoire de la construction de ces deux monuments est donc semblable. Les ressources que les chapitres et les évêques de Clermont et de Limoges avaient pu réunir, vers la fin du XIIIe siècle, pour rebâtir leurs cathédrales, furent promptement épuisées ; et, à Limoges, ce ne fut qu’à la fin du XVe siècle que les travaux purent être repris, pour être de nouveau abandonnés.

À Narbonne, siège archiépiscopal, la cathédrale de Saint-Just, dont nous admirons aujourd’hui le chœur, ne sortit de terre que vers les dernières années du XIIIe siècle ; entre cet édifice et ceux de Clermont et de Limoges, on remarque une différence notable dans le style des moulures et des détails de la construction. La cathédrale de Narbonne, conçue d’après des données beaucoup plus vastes que ses deux devancières, ne vit élever, de 1272 à 1330 environ, que son chœur (48)[97].

Vers cette époque, Narbonne perdit son antique importance par suite de l’ensablement de son port. Là cathédrale resta inachevée ; les transsepts ne furent même pas élevés[98]. La construction de ce vaste chœur est admirablement traitée, par un homme savant et connaissant parfaitement toutes les ressources de son art. Il semble même qu’on ait voulu, avant tout, à Narbonne, faire preuve de savoir. Les chapiteaux des piles sont complétement dépourvus de sculpture ; le triforium est d’une simplicité rare ; mais, en revanche, l’agencement des arcs, les pénétrations des moulures, les profils, sont exécutés avec une perfection qui ne le cède à aucun de nos édifices du nord. Les voûtes sont admirablement appareillées et construites. Celles des chapelles et des bas-côtés qui reçoivent, comme à Limoges et à Clermont, un dallage presque horizontal, ont 0m,40 d’épaisseur et sont maçonnées en pierres dures. L’ensemble de la construction, bien pondéré, dont les poussées et les buttées sont calculées avec une adresse incomparable, n’a pas fait le moindre mouvement ; les piles sont restées parfaitement verticales. L’architecte, afin de ne pas affaiblir ses points d’appui principaux par les passages des galeries, a fait tourner le mur extérieur du triforium autour des piles (voy. Architecture Religieuse, fig. 38). Cette même disposition se retrouve également à la cathédrale de Limoges. Mais outre la grandeur de son plan, ce qui donne à la cathédrale de Narbonne un aspect particulier, c’est la double ceinture de créneaux qui remplace les balustrades sur les chapelles, et qui réunit les culées des arcs-boutants terminées en forme de tourelles (voy. Arc-boutant, fig. 65). C’est qu’en effet cette abside se reliait aux fortifications de l’archevêché et contribuait, du côté du nord, à la défense de ce palais (voy. Évêché). C’était, dans les villes du Midi, un usage fréquent de fortifier les cathédrales. Celle de Béziers, outre ses fortifications de la fin du XIIIe siècle, laisse voir encore des traces nombreuses de ses fortifications du XIIe. La partie de la cathédrale de Carcassonne qui date du XIe siècle se reliait aux fortifications de la cité.
Au XIVe siècle, nous voyons encore les archevêques d’Alby élever une cathédrale qui présente tous les caractères d’une forteresse. Ce fait n’a rien d’extraordinaire, quand on se rappelle les guerres féodales, religieuses et politiques qui ne cessèrent de bouleverser le Languedoc pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Pour en revenir à la cathédrale de Narbonne, on remarquera la disposition neuve et originale des chapelles nord du chœur, laissant entre elles et le collatéral un étroit bas-côté qui produit un grand effet, en donnant à la construction beaucoup de légèreté, sans rien ôter de la solidité. Il est vraisemblable que cette disposition devait être adoptée dans la nef, qui, comme celles de Clermont et de Limoges, avait été projetée avec des chapelles latérales.
À Narbonne, la sacristie et le trésor sont disposés dans deux des chapelles du chœur, au sud ; c’est encore là un point de ressemblance avec Clermont et Limoges (voy. fig. 46 et 47). Les fenêtres de ces trois monuments furent garnies de vitraux ; mais ceux de la cathédrale de Narbonne, posés seulement pendant le XIVe siècle, ne présentent, dans toutes les chapelles, excepté dans celle de la Vierge, que des grisailles avec entrelacs de couleur et écussons armoyés ; il semble que l’on ait tenu à bannir la sculpture et la peinture de cette église ; aussi est-elle d’un aspect passablement froid. C’est plutôt là l’œuvre d’un savant que d’un artiste. Le sanctuaire de Narbonne, comme celui de Limoges, a conservé sa clôture formée de tombeaux d’évêques (voy. Tombeau). La cathédrale de Narbonne possède encore son cloître du XVe siècle, au flanc sud du chœur, comme celle de Béziers (voy. Cloître), et des dépendances, entre autres une salle capitulaire d’un fort bon style.
Saint-Just de Narbonne est un édifice unique dans cette contrée du sol français et par son style et par ses dimensions ; car les cathédrales du Languedoc sont généralement peu étendues, et la plupart ne sont que des édifices antérieurs aux guerres des Albigeois, réparées ou reconstruites en partie à la fin du XIIIe siècle et pendant le XIVe siècle.
Toulouse, seule peut-être, possédait, au XIIe siècle, une grande cathédrale à nef unique sans collatéraux, autant qu’on peut en juger par le tronçon qui nous reste de ce vaste et bel édifice[99]. Mais Toulouse était, au XIIe siècle, une ville riche, très-populeuse, et fort avancée dans la culture des arts.
Avec celle de Béziers, la cathédrale de Carcassonne[100] est une de celles qui nous présente cette invasion du style ogival, du Nord, dans un monument roman du Midi. Nous donnons (49) le plan de ce curieux monument. La nef et ses deux collatéraux, jusqu’aux transsepts, appartiennent à une église de la fin du XIe siècle. Immédiatement après que Carcassonne eut été réunie à la couronne de France sous saint Louis, l’évêque Radulphe fit construire, à l’extrémité du transsept sud (qui alors était roman et devait avoir l’étendue actuelle), la chapelle teintée en gris sur le plan, en style ogival quelque peu bâtard, et la salle voisine[101]. Au commencement du XIVe siècle, l’évêque Pierre de Roquefort ou Rochefort démolit le chœur, les transsepts romans, et bâtit la partie orientale de la cathédrale que nous voyons aujourd’hui, en style ogival pur français. Cependant, soit qu’on ait voulu se tenir sur les fondations anciennes du chevet et des transsepts romans, soit qu’on ait voulu conserver une disposition traditionnelle et que nous ne voyons guère adoptée, en dehors de Carcassonne, que dans l’église d’Obazine, on donna à la nouvelle construction un plan qui ne trouve d’analogue nulle part dans le Nord ; mieux encore : dans la nef romane, il existe des piles alternativement carrées, cantonnées de demi-colonnes, et cylindriques.

Cette forme de pilier, qui n’est pas ordinaire dans les constructions d’églises du XIIIe et du XIVe siècle, fut adoptée pour les six piliers formant têtes des chapelles et du sanctuaire, c’est-à-dire que les deux piles de la croisée, à l’entrée de l’abside, rebâties en face des deux piliers romans laissés en place, prirent la section horizontale en plan de ces derniers, et que les quatre autres piles séparant les chapelles des transsepts prirent la forme cylindrique, comme pour se relier avec la vieille église ; partout ailleurs les sections des piliers du XIVe siècle adoptent les formes usitées à cette époque. L’évêque Pierre de Roquefort, en faisant rebâtir la partie orientale de sa cathédrale, avait donc l’intention de borner là son entreprise et de respecter la nef romane, puisqu’il cherchait à conserver, entre les deux constructions, une certaine harmonie, malgré la différence de style. Ce n’était plus cette confiance des évêques du Nord, qui, au XIIIe siècle, lorsqu’ils laissaient subsister, pour le service du culte, une portion d’église antérieure, ne le faisaient qu’à titre provisoire, et ne songeaient guère à raccorder leurs nouveaux projets avec ces débris romans destinés à être jetés bas aussitôt que l’avancement de l’œuvre nouvelle l’aurait permis. On voit, d’ailleurs, combien les constructions dernières de la cathédrale de Carcassonne sont exiguës ; on rebâtissait l’église pour se conformer au goût du temps, mais on ne pensait pas à l’agrandir[102] ; tandis qu’à Clermont et à Limoges encore, bien que ces cathédrales ne soient pas d’une grande dimension, on avait cependant beaucoup augmenté, au XIIIe siècle, le périmètre des églises romanes[103]. Si, à la fin du XIIIe siècle, dans le Nord, la puissance qui avait fait élever les cathédrales commençait à s’affaiblir, il est évident que, dans les provinces du Midi, et même dans celles alors réunies à la couronne de France, il n’y avait plus qu’un reste de l’impulsion provoquée par le grand mouvement de la fin du XIIe siècle.
L’évêque Pierre de Roquefort sembla vouloir, du moins, faire de sa petite cathédrale de Saint-Nazaire, si modeste comme étendue, un chef-d’œuvre d’élégance et de richesse. Contrairement à ce que nous voyons à Narbonne, où la sculpture fait complétement défaut, l’ornementation fut prodiguée dans l’église Saint-Nazaire. Les verrières immenses et nombreuses (car ce chevet et ces transsepts sont une véritable lanterne) sont de la plus grande magnificence (voy. Vitrail) comme composition et couleur. Le sanctuaire, décoré des statues des apôtres, était entièrement peint. Les deux chapelles latérales de l’extrémité de la nef, au nord et au sud, ne furent probablement élevées qu’après la mort de Pierre de Rochefort, car elles ne se relient pas aux transsepts comme construction, et dans l’une d’elles, celle du nord, est placé, non pas après coup, le tombeau de cet évêque, l’un des plus gracieux monuments du XIVe siècle que nous connaissions (voy. Tombeau).
Les grands vents du sud-est et de l’ouest qui règnent à Carcassonne avaient fait ouvrir la porte principale au nord de la nef romane ; une autre porte est percée dans le pignon du transsept nord. Le clocher de l’église, qui datait du XIe siècle, s’élevait sur la première travée de la nef et servait de défense, car il dominait la muraille de la cité, qui, alors, passait au raz du mur occidental.
En A est le cloître ; il reliait les bâtiments du chapitre et de l’évêché à l’église. Des deux côtés du sanctuaire, entre les contreforts, sont réservés deux petits sacraires qui ne s’élèvent que jusqu’au-dessous de l’appui des fenêtres. Ces sacraires sont garnis d’armoires doubles fortement ferrées et prises aux dépens du mur. Ils servaient de trésors, car il était d’usage de placer, des deux côtés de l’autel principal des églises abbatiales ou des cathédrales, des armoires destinées à contenir les vases sacrés, les reliquaires et tous les objets précieux. À Saint-Nazaire, on avait habilement profité des dispositions de la construction pour établir d’une manière fixe ces sacraires qui, le plus souvent, n’étaient que des meubles (voy. Autel).
Les diocèses de la France actuelle avaient tous, ou peu s’en faut, reconstruit leurs cathédrales pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles ; ceux dont l’œuvre de reconstruction n’avait été commencée que tardivement ne purent, la plupart, la terminer. Les guerres qui, pendant la dernière moitié du XIVe siècle et le commencement du XVe, ensanglantèrent le sol français, ne permirent pas de continuer ces monuments tardifs. Ce fut seulement à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe que l’on reprit les travaux. Alors, comme nous l’avons dit en décrivant quelques-uns de ces grands édifices, on fit de nouveaux efforts ; à Troyes, à Auxerre, à Tours, à Évreux, à Rouen, à Beauvais, à Limoges, à Bourges, à Nevers, etc., les évêques et les chapitres consacrèrent des sommes considérables à parfaire des monuments que le refroidissement du zèle des populations et les guerres avaient laissés incomplets. Quelques cathédrales, en bien petit nombre, furent commencées à cette époque. Le XVe siècle vit fonder la cathédrale de Nantes, celles d’Auch, de Montpellier, de Rhodez, de Viviers ; les guerres religieuses du XVIe siècle firent de nouveau suspendre les travaux.
Nous ne devons pas quitter ce sujet sans parler de la cathédrale d’Alby ; monument exceptionnel, tant à cause du principe de sa construction et de ses dispositions particulières, que par la nature des matériaux employés, la brique.
Nous donnons (50) le plan de la cathédrale d’Alby[104]. Déjà nous avons parlé de deux cathédrales du midi de la France qui pouvaient, au besoin, servir de forteresses : Narbonne et Béziers ; ce parti est plus franchement accusé encore dans l’église Sainte-Cécile d’Alby. La tour occidentale est un véritable donjon, sans ouvertures extérieures à rez-de-chaussée. Du côté méridional, une porte fortifiée se reliant à une enceinte défendait l’entrée qui longeait le flanc de la cathédrale et s’élevait au niveau du sol intérieur au moyen d’un large emmarchement. Du côté du nord, des sacristies fortifiées reliaient la cathédrale à l’archevêché, fort bien défendu par d’épaisses murailles et un magnifique donjon.
Sainte-Cécile d’Alby, commencée vers le milieu du XIVe siècle, n’est qu’une salle immense terminée par une abside et complétement entourée de chapelles, polygonales au chevet, carrées dans la nef. Ces chapelles sont prises entre les contreforts qui contrebuttent la grande voûte ; à deux étages, ces chapelles communiquent toutes entre elles, au premier étage, par des portes percées dans les contreforts, et forment ainsi une galerie. Ces chapelles du rez-de-chaussée sont, les unes voûtées en berceau ogival, les autres en arcs d’ogives, irrégulièrement, ainsi que l’indique le plan. Les voûtes du premier étage des chapelles sont toutes en arcs d’ogives. Les contreforts, ou séparation des chapelles, au-dessus du soubassement continu, se dégagent en tourelles flanquantes dont la section horizontale donne un arc de cercle dont la flèche est courte. Des fenêtres étroites et longues, percées seulement au premier étage, dans les murs, entre les contreforts, éclairent le vaisseau.

La construction de cette église fut interrompue vers le commencement du XVe siècle ; les couronnements projetés, et qui certainement ne devaient être qu’un crénelage, ne furent pas montés. Au commencement du XVIe siècle, on se contenta de placer des balustrades aux différents étages de la tour, de faire quelques travaux intérieurs, le porche sud, et la clôture du chœur avec un jubé qui occupe la moitié du vaisseau, et forme ainsi comme un bas-côté autour du sanctuaire. Ce grand édifice, entièrement bâti en briques, excepté les meneaux des fenêtres, les balustrades et la clôture du chœur qui sont en pierre, fut enduit à l’intérieur, et complètement couvert de peintures de la fin du XVe siècle et du XVIe[105].
La cathédrale d’Alby est certainement l’édifice ogival le plus imposant des provinces du Midi ; il est d’ailleurs original, et n’a pas subi, comme Narbonne, Rhodez, Mende, Béziers, les influences du Nord. Il dérive des églises de la ville basse de Carcassonne, de l’ancienne cathédrale de Toulouse, monuments religieux sans bas-côtés, qui n’étaient eux-mêmes qu’une application des constructions quasi-romaines de Fréjus, de Notre-Dame des Dons d’Avignon, de la Major de Marseille, églises rappellant le système de construction adopté dans la basilique de Constantin à Rome.
Si la cathédrale d’Alby est un édifice ogival dans les moyens d’exécution, il faut reconnaître qu’il est, comme disposition de plan, comme structure, complétement roman et même antique. Le style ogival n’est là qu’une concession faite au goût du temps, l’application d’une forme étrangère, nullement une nécessité. La voûte de la cathédrale d’Alby pourrait être un grand berceau plein-cintre, pénétré par les petits berceaux transversaux fermant les travées entre les contreforts ; la stabilité de l’édifice n’eût rien perdu à l’adoption de ce dernier système roman ou romain ; et nous dirons même que les voûtes en arcs d’ogives qui couvrent les travées entre les contreforts, à la hauteur de la grande voûte, sont un non-sens ; la véritable construction de ces voûtes eût dû être faite en berceaux, bandés perpendiculairement à la nef et portant sur ces contreforts. Ce parti eût été plus solide et surtout plus logique.
C’est en étudiant les monuments qui ont admis les formes de l’architecture ogivale sans en bien comprendre l’esprit, que l’on reconnaît combien le style adopté, à la fin du XIIe siècle, dans le nord de la France est impérieux ; combien il se sépare nettement de tous les autres modes d’architecture antérieurs.
L’architecture romane est multiple ; dérivée du principe antique romain, elle a pu pousser des rameaux divers, ayant chacun leur caractère particulier ; il n’en est pas et ne peut en être de même de l’architecture ogivale ; il n’y a qu’une architecture ogivale, il y a dix, vingt architectures romanes. Nous voyons en Aquitaine, en Auvergne, en Poitou, en Normandie, en Bourgogne, en Alsace, en Provence, en Picardie, dans l’Île de France, dans le Maine, en Champagne, des écoles romanes qui se développent chacune dans leur propre sphère, bien qu’elles soient filles de la même mère, comme les langues italienne, française, espagnole se sont développées chacune de leur côté, quoique dérivées du latin. Pourquoi ? C’est que dans l’architecture romane, comme dans l’architecture antique, la forme d’art, l’enveloppe ne dépend pas absolument de la construction, du besoin à satisfaire ; l’art est libre, il ne dépend que de la tradition et de l’inspiration ; il n’est pas une déduction d’un principe absolu. Veut-on des exemples ? Nous ne répéterons pas ici ce qu’on a dit du temple grec, qui reproduit en pierre ou en marbre une construction de bois ; nous estimons trop ces maîtres dans tous les arts, pour les accuser d’avoir ainsi manqué aux règles les plus simples du bon sens, et par conséquent du bon goût ; mais il est certain que, dans l’architecture grecque, les ordres prennent une importance, comme art, qui domine l’architecte ; l’art est le maître de son imagination, plus fort que son raisonnement ; aussi, que fait l’artiste ? Il fait tendre toutes les facultés de son esprit à perfectionner cette forme qui l’étreint ; ne pouvant l’assouplir, il la polit. Les Romains, peu artistes de leur nature, prennent la forme de l’art grec pour l’appliquer à des monuments qui n’ont aucun rapport avec les principes de cet art. Ils trouvent des ordres ; entre tous, ils adoptent volontiers le plus riche ; confondant, comme tous les parvenus, la richesse avec la beauté, et ces ordres, dont l’origine est parfaitement rigoureuse et définie, ils les appliquent au rebours de cette origine ; les Romains veulent des arcs et des voûtes ; les Grecs ne connaissaient que la plate-bande. On devrait conclure de ceci que les Romains ont trouvé ou cherché une forme nouvelle propre à leur nouveau système de construction ; point. Les Romains prennent la forme grecque, l’architecture grecque, les ordres grecs, et les plaquent, comme une dépouille, contre leur construction ; peu leur importe que la raison soit choquée de ce contresens ; ils sont les maîtres, mais ce sont des maîtres qui font passer le besoin, la nécessité avant la satisfaction des yeux ; il leur faut de vastes monuments voûtés ; ils les construisent d’abord, puis, leur programme rempli, trouvant un art tout fait, ils s’en emparent, et l’accrochent à leurs murailles comme on accroche un tableau. Que ceux qui voudraient nous taxer d’exagération nous expliquent comment, par exemple, on trouve, autour du Colysée, des ordres complets avec leurs plates-bandes (des plates-bandes sur des arcs !) ; dans l’intérieur des salles des Thermes, des ordres complets, avec leurs corniches saillantes, sous des voûtes (des corniches saillantes à l’intérieur, comme s’il pleuvait dans l’intérieur d’une salle !). Il est évident que les Grecs, amants avant tout de la forme, ayant trouvé cette admirable combinaison des ordres, étant parvenus, guidés par un goût parfait, à donner à ces ordres des proportions inimitables, se sont mis à adorer leur œuvre et à lui sacrifier souvent la nécessité et la raison ; car, pour eux, le premier de tous les besoins était de plaire aux sens ; que les Romains, indifférents au fond en matière d’art, mais désireux de s’approprier tout ce qui dans le monde avait une valeur, ont voulu habiller leur architecture à la grecque, croyant que l’art n’est qu’une parure extérieure qui embellit celui qui la porte, quelle que soit sa qualité ou son origine.
L’habitude prise par les Romains de se vêtir des habits d’autrui a fini par produire, on le conçoit facilement, les costumes les plus étranges. L’architecture romane, dérivée de l’architecture romaine, n’ayant plus même sous les yeux ces principes grecs pillés par les Romains, a interprété les traditions corrompues de cent façons différentes. La forme n’étant pas intimement liée à la matière, n’en étant pas la déduction logique, chacun l’interprétait à sa guise. C’est ainsi que l’art roman a pu, à son tour, s’emparer des lambeaux du vêtement romain, sans en comprendre l’usage, puisqu’il n’était qu’une parure empruntée, et arriver, dans les différentes provinces des Gaules, à former des écoles séparées et qui pouvaient se diviser à l’infini. Il n’en est pas ainsi de l’architecture qui, naît au XIIe siècle ; fille du rationalisme moderne, chez elle le calcul précède l’application de la forme ; bien plus, il la commande, il la soumet ; si, par ce besoin naturel à l’homme, il veut qu’elle soit belle, il faut que ce soit suivant la loi d’unité.
En entrant dans le domaine d’un autre art, nous pourrons peut-être nous faire mieux comprendre… L’architecture antique, c’est la mélodie ; l’architecture du moyen âge, c’est l’harmonie. L’harmonie, dans le sens que nous attachons à ce mot, c’est-à-dire l’arrangement et la disposition des sons simultanés, était inconnue chez les anciens Grecs ; l’antiphonie, au temps d’Aristote, était seule pratiquée, c’est-à-dire les octaves produits par des voix d’hommes et de femmes ou d’enfants chantant la même mélodie. Ce ne fut que pendant les premiers siècles de notre ère que l’usage des quartes et des quintes fut admis dans la musique grecque, et encore l’échelle tonale de ses modes se prêtait si peu aux sons simultanés, que la pratique de l’harmonie était hérissée de difficultés et son emploi fort restreint. M. Vincent[106], malgré des efforts persévérants pour découvrir les traces de l’harmonie chez les Grecs, n’a encore pu arriver à aucun résultat concluant.
Dans l’Église latine, au contraire, l’harmonie n’a cessé de prendre des développements rapides, et c’est principalement au moyen âge qu’il faut rapporter l’invention et l’établissement des règles qui ont élevé cet art à la plus merveilleuse puissance.
Dès l’époque de Charlemagne, on trouve des traces de l’art de combiner les sons simultanés, et cet art s’appelle organum, ars organandi. Il était réservé à Hucbald, moine de Saint-Amand au Xe siècle, de donner une grande impulsion à l’harmonie, en établissant des règles fixes et fécondes. Aux diaphonies à mouvements semblables succéda, au XIe siècle, la diaphonie à mouvements contraires et à intervalles variés, comme le prouvent les ouvrages de Jean Cotton et d’autres auteurs. Enfin, pendant les XIIe et XIIIe siècles, l’harmonie s’enrichit successivement de tous les accords qui forment la base de la composition musicale moderne ; et les traités de Jean de Garlande, de Pierre Picard, de Jérôme de Moravie, etc., prouvent surabondamment l’emploi, dans la symphonie, des tierces, des quartes, des quintes, des sixtes, des septièmes même, la résolution des intervalles dissonants sur des consonnances par mouvement contraire ; et bien plus encore, l’existence des notes de passage, du contrepoint double et des imitations[107].
Or, s’il est deux arts qui peuvent être comparés, ce sont certainement la musique et l’architecture ; ils s’expliquent l’un par l’autre ; ils ne procèdent ni l’un ni l’autre de l’imitation de la nature ; ils créent. Pour créer, il faut calculer, prévoir, construire. Le musicien qui seul, sans instruments, sans articuler un son, entend, la plume à la main et le papier réglé devant lui, la composition harmonique la plus compliquée, qui calcule et combine l’effet des sons simultanés ; l’architecte qui, à l’aide d’un compas et d’un crayon, trace des projections sur sa planchette, et voit, dans ces tracés géométriques et dans des chiffres, tout un monument, les effets des pleins et des vides, de la lumière et des ombres ; qui prévoit, sans avoir besoin de les peindre, les mille moyens d’élever ce qu’il conçoit ; tous deux, musicien et architecte, sont bien forcés de soumettre l’inspiration au calcul. Les peuples primitifs trouvent tous des mélodies ; c’est la création d’instinct, l’épanchement extérieur par les sons d’un sentiment ; mais à notre civilisation moderne seule appartient l’harmonie ; c’est la création voulue, préméditée, calculée, raisonnée de l’homme qui est tourmenté par l’éternel « Pourquoi ? » qui cherche, travaille, et veut, en produisant un effet, en obtenant un résultat, que son labeur paraisse, qu’on apprécie les efforts de sa raison et la science qu’il lui a fallu déployer pour créer… Vanité !… soit ; mais plus l’homme mordra au fruit de l’arbre de la science, plus sa vanité croîtra ; peut-être (Dieu veuille que nous nous trompions !) le jour n’est-il pas éloigné où l’amour de l’art sera remplacé par la vanité de l’art.
L’architecture grecque est une mélodie rhythmée ; mais ce n’est qu’une mélodie, admirable, nous en tombons d’accord. Enlevez d’une mélodie un membre, ce qui restera n’en sera pas moins un fragment de mélodie ; enlevez un ordre d’un temple grec, ce sera toujours un ordre que vous pourrez appliquer à un palais, à une maison, à un tombeau. D’un morceau d’harmonie, d’une symphonie, retirez une partie, il ne reste rien, puisque l’harmonie n’est telle que par la simultanéité des sons.
De même, dans un édifice ogival, toutes les parties se tiennent ; elles n’ont adopté certaines formes que par suite d’un accord d’ensemble. La lecture de ce Dictionnaire le prouverait ; nous ne pouvons nous occuper d’un détail de l’architecture ogivale, et expliquer sa fonction, qu’en indiquant sa place, les circonstances qui ont imposé sa forme, sa raison d’être, indépendamment du goût de l’artiste ou du style dominant. Le même souffle moderne qui faisait substituer l’harmonie à la mélodie dans la musique, faisait, au XIIe siècle, remplacer, dans l’architecture, les traditions plus ou moins corrompues de l’art antique, par une succession de combinaisons soumises à un principe absolu. Les cathédrales sont le premier et le plus grand effort du génie moderne appliqué à l’architecture, elles s’élèvent au centre d’un ordre d’idées opposé à l’ordre antique. Et, pendant qu’on les construisait, les études de la philosophie grecque, du droit romain, de l’administration romaine, étaient en grande faveur.
Au XIIe siècle, l’esprit moderne prit à l’antiquité certains principes de vérité éternelle pour se les approprier et les transformer. Au XVIe siècle, on s’empara de la forme antique, sans trop se soucier du fond. C’est donc une erreur, nous le croyons, de présenter, comme quelques écrivains de notre temps ont voulu le faire, l’architecture née au XIIe siècle comme une sorte de déviation de l’esprit humain ; déviation brusque, sans relations avec ce qui a précédé et ce qui doit suivre. Si l’on prend la peine d’étudier sérieusement cet art, en mettant de côté ces reproches banals engendrés par la prévention, répétés par tous les esprits paresseux, on y trouvera, au contraire, développés avec une grande énergie, les éléments de ce que nous appelons nos conquêtes modernes, l’ordre général avec l’indépendance individuelle, l’unité dans la variété ; l’harmonie, le concours de tous les membres vers un centre commun ; la science qui s’impose à la forme ; la raison qui domine la matière ; la critique enfin, pour nous servir d’un mot de notre temps, qui veut que la tradition et l’inspiration soient soumises à certaines lois logiques. Et ce n’est pas seulement dans la combinaison géométrique des lignes de l’architecture ogivale que nous trouvons l’expression de ces principes, c’est encore dans la sculpture, dans la statuaire.
L’ornementation et l’iconographie de nos grandes cathédrales du Nord se soumettent à ces idées d’ordre, d’harmonie universelle. Ces myriades de figures, de bas-reliefs qui décorent la cathédrale composent un cycle encyclopédique, qui renferme non-seulement toute la nature créée, mais encore les passions, les vertus, les vices et l’histoire de l’humanité, ses connaissances intellectuelles et physiques, ses arts et même ses aspirations vers le bien absolu. Le temple grec est dédié au culte de Minerve, ou de Neptune, ou de Diane ; et, considérant ces divinités au point de vue mythologique le plus élevé, on ne peut disconvenir qu’il y a là comme un morcellement de la Divinité. Le temple de Minerve est à Minerve seule ; son culte ne satisfait qu’à un ordre d’idées. Le Grec qui désire se rendre propices les divinités, c’est-à-dire la puissance surnaturelle maîtresse de l’univers et de sa propre existence, doit aller successivement sacrifier à la porte des douze dieux de l’Olympe ; il ne peut, à son point de vue, croire qu’un sacrifice fait à Cérès pour obtenir de bonnes récoltes, lui rendra Neptune favorable, s’il doit faire un voyage sur mer.
Nous admettons volontiers que les grands esprits du paganisme voyaient, dans les différents mythes qu’ils adoraient, les qualités diverses et personnifiées d’une puissance divine ; mais, enfin, il fallait une mélodie pour chacun de ces mythes. L’harmonie moderne ne pouvait entrer dans le cerveau d’un Grec ; elle n’avait pas de raisons d’exister ; au contraire, tout la repoussait. Avec le christianisme, l’idée du morcellement des qualités de la divinité disparaît ; en priant, le chrétien implore la protection de Dieu pour lui, pour les siens, pour ce qu’il possède, pour l’humanité tout entière ; son Dieu embrasse l’univers sous son regard. Or cette idée chrétienne, chose singulière, nous ne la voyons matériellement développée qu’au XIIe siècle. Il semble que, jusqu’à ce réveil de l’esprit moderne, la tradition païenne laissait encore des traces dans les esprits, comme elle en laissait dans les formes de l’architecture. Jusqu’au XIIe siècle, les églises, même monastiques, conservent quelque chose du morcellement de la Divinité antique. En voyant les nombreuses sculptures romanes qui décorent nos monuments occidentaux, on ne sait trop comment rattacher ces imageries à une idée commune. Les traditions locales, le saint vénéré, les tendances ou l’histoire des populations, dirigent le sculpteur. L’Ancien et le Nouveau Testament se mêlent aux légendes. Si nous nous trouvons dans une église clunisienne, saint Antoine, saint Benoît, l’archange saint Michel jouent un rôle important dans l’iconographie ; on retrouve ces personnages partout, en dedans et en dehors, sans qu’il soit possible d’assigner un ordre hiérarchique à ces représentations. Tout cela est entremêlé de figures d’animaux bizarres, et nous ne croyons pas que la symbolique romane puisse jamais être claire pour nous, puisque saint Bernard lui-même traitait la plupart de ces sculptures de monstruosités païennes. Admettant, si l’on veut, que la fantaisie de l’imagier n’ait pas été pour beaucoup dans le choix des sujets, toujours est-il que chaque église, sauf certaines représentations invariables, possède son iconographie propre.
Avec la cathédrale de la fin du XIIe siècle, surgit l’iconographie méthodique ; et, pour en revenir à notre comparaison musicale, chaque sculpteur, en faisant sa partie, concourt à l’ensemble harmonique ; il est astreint à certaines lois dont il ne s’écarte pas, comme pour laisser à la symphonie sa parfaite unité.
Beaucoup d’églises cathédrales, avant cette grande époque de l’art français, se composaient de plusieurs églises et oratoires. Comme premier pas vers l’unité, les évêques qui reconstruisent ces monuments, aux XIIe et XIIIe siècles, englobent ces églises et ces chapelles dans la grande construction ; puis ils adoptent une iconographie dont nous allons essayer de présenter sommairement le vaste et magnifique tableau. Disons d’abord que les cathédrales qui nous donnent un ensemble de sculptures à peu près complet sont les cathédrales de Paris, de Reims, d’Amiens et de Chartres, toutes les quatre dédiées à la sainte Vierge.
Trois portes s’ouvrent à la base de la façade occidentale. Sur le trumeau de la porte centrale est placé, debout, et bénissant de la droite, tenant l’Évangile de la main gauche, le Christ homme[108] ; ses pieds reposent sur le dragon. Les douze apôtres sont rangés des deux côtés contre les ébrasements[109]. Sur le socle du Christ est la figure de David[110], ou les prophètes qui ont annoncé sa naissance, et les arts libéraux[111] en bas-relief. Sous les apôtres sont sculptés, en bas-relief, les vertus et les vices, chaque vertu placée au-dessus du vice contraire[112]. Les quatre signes des évangélistes occupent les angles des ébrasements[113]. On voit s’élever, sur les deux pieds-droits, à la droite du Christ, les vierges sages ; à la gauche, les vierges folles[114] ; au-dessous d’elles, un arbre feuillu, auquel sont suspendues des lampes, du côté des vierges sages ; du côté des folles, un arbre mort frappé d’une cognée[115]. Le linteau, qui ferme la porte au-dessus du trumeau, représente la résurrection, le pèsement des âmes et la séparation des élus des damnés. Au-dessus, dans le tympan, le Christ au jour du jugement, nu, montrant ses plaies ; des anges tiennent les instruments de la Passion ; la Vierge et saint Jean à genoux implorent le divin Juge[116]. Dans les voussures, des anges[117] ; à la gauche du Christ, les supplices des damnés ; à la droite, les élus ; puis les martyrs, les confesseurs, les vierges martyres, les rois, les patriarches, ou des prophètes, quelquefois un arbre de Jessé[118]. Des deux côtés de la porte, l’Église et la Synagogue[119]. Le trumeau de l’une des deux portes latérales est occupé par la statue de la Vierge tenant l’enfant Jésus[120] ; ses pieds portent sur le serpent à tête de femme. Sur le socle est sculptée la création de l’homme et de la femme, et l’histoire de la tentation[121]. Sur la tête de la Vierge, et lui servant de dais, l’arche d’alliance, soutenue par des anges[122]. Des deux côtés, dans les ébrasements, les rois Mages, l’Annonciation, la Visitation, la Circoncision, David[123]. Sur le linteau de la porte, on voit les rois et les prophètes[124], ou Moïse et Aaron et des prophètes[125]. Au-dessus, la mort de la Vierge[126] ou son ensevelissement par les apôtres et l’enlèvement de son corps par les anges[127]. Dans le tympan, son couronnement[128]. Les voussures contiennent des anges, les rois ancêtres de la Vierge, et les prophètes qui ont annoncé sa venue[129]. La troisième porte est ordinairement réservée au saint patron du diocèse ; à Amiens, c’est saint Firmin qui occupe le trumeau ; des deux côtés, dans les ébrasements, viennent les représentants de l’ordre religieux dans l’ancienne et la nouvelle loi ; Aaron, Melchisedech et l’Ange ; les premiers prêtres martyrs, saint Étienne, saint Denis, etc. ; quelquefois des saints vénérés dans la localité, comme sainte Ulphe, saint Honoré et saint Salve à Amiens. Les linteaux et tympans de ces portes, consacrées au saint patron du diocèse, contiennent sa légende et l’histoire de la translation de ses reliques[130]. Sur les soubassements ou les pieds-droits de l’une de ces portes latérales sont sculptés, en bas-relief, un zodiaque et les travaux de l’année[131]. À Amiens, sur les faces des contreforts, en avant des trois portes, sont posées les statues des prophètes, et, au-dessous, les prophéties dans des médaillons ; c’est comme une sorte de prologue aux scènes sculptées autour des portes et qui tiennent à la nouvelle loi. Sur les façades des grandes cathédrales du titre de sainte Marie, mère de Dieu, au-dessus des portes, on voit une série de statues colossales de rois ancêtres de la Vierge[132]. Ils assistent à sa glorification. Une galerie supérieure reçoit la statue de la sainte Vierge entourée d’anges[133]. C’était de ce balcon élevé qu’au Dimanche des Rameaux le clergé entonnait, en plein air, le Gloria devant le peuple assemblé sur le parvis. Le sommet du pignon de la nef reçoit une statue du Christ bénissant, ou un ange sonnant de la trompette, comme pour rappeler la scène du Jugement dernier tracée sur le tympan de la porte centrale. Les sculptures des portes nord et sud des transsepts sont ordinairement réservées aux saints particulièrement vénérés dans le diocèse, ou, comme à Paris, du côté sud, consacrent le souvenir de l’une des églises annexées à la cathédrale avant sa reconstruction[134]. Autour de la cathédrale, sur les contreforts, contre les parois des chapelles[135], des statues d’anges tiennent les ustensiles nécessaires au service religieux, des instruments de musique[136], comme pour indiquer que l’Église est un concert éternel à la gloire de Dieu.
Nous ne pouvons ici entrer dans tous les détails de la statuaire de nos grandes cathédrales du Nord ; ce serait sortir du cadre déjà très-large que nous nous sommes tracé. Nous avons seulement voulu faire comprendre le principe d’unité qui avait dû diriger les sculpteurs. On a pu le voir, par cet exposé sommaire, non contents de tracer l’histoire de la naissance du Sauveur, les évêques voulaient, aux yeux de tous, établir la généalogie de la Vierge, sa victoire sur le démon, sa glorification, les rapports qui existent entre l’ancienne et la nouvelle loi par les prophéties, et surtout frapper les imaginations par la représentation du jugement dernier ; de la récompense des bons et de la punition des méchants. Comme épisodes de ce grand poëme, la parabole des vierges sages, celle de l’enfant prodigue, quelquefois des scènes tirées de l’Ancien Testament, la tentation et la chute d’Adam, la mort d’Abel, le déluge, l’histoire de Joseph, de Job, celle de David, les principaux exemples de la faiblesse, de la résignation ou du courage humain, de la vengeance divine. Puis ces figures énergiques des vertus et des vices personnifiés ; puis, enfin, l’ordre naturel, les saisons, les éléments, les travaux de l’agriculture, les sciences et les arts. L’iconographie de la cathédrale, à l’extérieur, embrassait donc toute la création.
Dans l’église, la statuaire était remplacée par les peintures des verrières ; sur ces splendides tapisseries, on retrouvait, dans le chœur, la passion de Jésus-Christ, les apôtres, les évangélistes et les prophètes, les rois de Juda ; dans la nef, les saints évêques. Les fenêtres basses retraçaient aux yeux les légendes des saints, des paraboles, l’Apocalypse, des scènes du jugement dernier. Celles de la chapelle du chevet consacrée à la Vierge, son histoire, ses légendes, l’arbre de Jessé, les prophéties, les sibylles. Le pavage venait à son tour ajouter à la décoration en entrant dans le concert universel ; au centre de la nef était incrusté un Labyrinthe (voyez ce mot), figure symbolique, probablement, des obstacles que rencontre le chrétien et de la patience dont il doit être armé ; c’était au centre de ce labyrinthe que les noms et les portraits des maîtres des œuvres étaient tracés, comme pour indiquer qu’ils avaient eu, les premiers, à traverser de longues épreuves avant d’achever leur ouvrage. Sur les dallages des cathédrales, on voyait aussi, gravés, des zodiaques[137], des scènes de l’Ancien Testament[138], des bestiaires[139]. Si nous ajoutons, à ces décorations tenant aux monuments, les tapisseries et les voiles qui entouraient les sanctuaires, les jubés enrichis de fines sculptures, les peintures légendaires des chapelles, les autels de marbre, de bronze ou de vermeil, les stalles, les châsses, les grilles admirablement travaillées, les lampes d’argent et les couronnes de lumière suspendues aux voûtes, les armoires peintes ou revêtues de lames d’or renfermant les trésors, les statues en métal ou en cire, les tombeaux, les clôtures de chœur couvertes de bas-reliefs, les figures votives adossées aux piliers, nous pourrons avoir une idée de ce qu’était la cathédrale, au XIIIe siècle, un jour de grande cérémonie, lorsque les cloches de ses sept tours étaient en branle, lorsqu’un roi y était reçu par l’évêque et le chapitre, suivant l’usage, aussitôt son arrivée dans une ville.
Dépouillées aujourd’hui, mutilées par le temps et la main des hommes, méconnues pendant plusieurs siècles par les successeurs de ceux qui les avaient élevées, nos cathédrales apparaissent, au milieu de nos villes populeuses, comme de grands cercueils ; cependant elles inspirent toujours aux populations un sentiment de respect inaltérable ; à certains jours de solennités publiques, elles reprennent leur voix, une nouvelle jeunesse, et ceux mêmes qui répétaient, la veille, sous leurs voûtes, que ce sont là des monuments d’un autre âge sans signification aujourd’hui, sans raison d’exister, les trouvent belles encore dans leur vieillesse et leur pauvreté[140].
- ↑ Cathedra, proprie est sedes, seu sessio honestior et augustior episcoporum in Ecclesia, cæteris aliorum presbyterorum sedilibus excelsior : Ut in mentem revocarent, inquit S. August. in Psalm. 126, altiore se in loco, tanquam in specula constitutos, quo oculorum acie pervigili, atque indefessa, in tutelam gregis incumbant, tanto cæteris virtute et probitate clariores, quanto magis essent sedis honore ac sublimitate conspicui. (Ducange, Gloss.)
- ↑ Il existe encore quelques-uns de ces sièges épiscopaux. En Provence, à Avignon, on en voit un dans l’église cathédrale ; il est en marbre, et fut enlevé de sa place primitive pour être rangé à la droite de l’autel. Dans la cathédrale d’Augsbourg, le siége épiscopal est resté à sa place, au fond de l’abside, comme ceux que l’on voit encore dans les basiliques de Saint-Clément et de Saint-Laurent (extra muros) à Rome (voy. Chaire).
- ↑ À Lyon, le trône épiscopal occupait encore, il y a un siècle, le fond de l’abside de la cathédrale, et l’autel était dépourvu de tout ornement au-dessus de la table ; une croix et deux flambeaux devaient seuls y être placés.
- ↑ Lettre 78.
- ↑ Instit. de saint Louis, p. 172. Le comte Beugnot.
- ↑ Instit. de saint Louis. Le comte Beugnot.
- ↑ Voir, pour de plus amples détails, l’Itinér. archéol. de Paris, par M. le baron de Guilhermy.--Paris, 1855.
- ↑ L’échelle de ce plan, ainsi que de tous ceux qui vont suivre, est de 0,001m pour mètre.
- ↑ La surface couverte de l’église de Notre-Dame de Paris était de 4 370 mèt. ; déduisant les pleins et le sanctuaire, restait environ 3 800 mèt. à rez-de-chaussée, pouvant contenir, en supposant les espaces laissés libres pour les passages, 7 500 personnes.
- ↑ Ces galeries peuvent contenir 1 500 personnes, en supposant qu’elles soient placées seulement sur quatre rangs.
- ↑ C’est en réparant les fenêtres hautes de la nef de la cathédrale, pendant le cours de la campagne de 1854, que nous avons découvert les roses s’ouvrant dans la nef au-dessus de la galerie du premier étage, et éclairant le comble de cette galerie. Des fragments de ces roses ont pu être replacés dans la dernière travée de la nef et les deux travées ouest du croisillon sud.
- ↑ Nous n’avons, pour donner ces dates, que le caractère architectonique des constructions ; mais, dans l’Île de France, les progrès sont si rapides, que l’on aperçoit, dans un espace de dix ans, des changements assez sensibles pour pouvoir, à coup sûr, fixer la date d’une construction.
- ↑ Époque de la construction de la Sainte-Chapelle. Ces chapelles présentent des détails et des profils identiques avec ceux de ce monument.
- ↑ Cette claire-voie est restée du côté nord, derrière les couvertures de ces chapelles.
- ↑ Ce plan est le plan actuel, avec la sacristie bâtie depuis 1845 à la place de l’ancien archevêché au sud.
- ↑ En 1160, on jette les fondements de la cathédrale actuelle de Paris ; en 1172, on projette la reconstruction de celle de Bourges. L’évêque Étienne donne à Odon, clerc, cette année 1172, une place située devant la porte de l’église, pour y bâtir une maison, à la condition de rendre l’emplacement « aussitôt que la construction de l’église projetée l’exigera. » La Cathédrale de Bourge, par A. de Girardot et Hip. Durand. Moulins, 1849.
- ↑ Nous avons enlevé de ce plan quelques chapelles ajoutées le long du bas-côté de la nef pendant les XIVe et XVe siècles.
- ↑ Nous avons entendu exprimer l’opinion que ces portes étaient les restes, demeurés en place, d’une église du XIIe siècle ; il n’est pas besoin d’être très-familier avec les détails de sculpture et les moulures des XIIe et XIIIe siècles, pour reconnaître qu’à la porte B du sud, par exemple, le trumeau portant la figure du Christ est du XIIIe siècle, que les moulures de soubassements et quelques colonnes servant de supports aux statues sont du XIIIe siècle, tandis que les figures des ébrasements, les linteaux et tympans sont du XIIe. C’est encore là, comme à Paris, une collection de fragments précieux, un souvenir d’un édifice antérieur qu’on a voulu conserver et enchâsser dans la construction même. Du reste, comme à Paris, ces sculptures méritaient bien cet honneur ; elles sont de la plus grande beauté.
- ↑ On a reproché, et on reproche chaque jour aux architectes de cette époque, d’avoir conçu des édifices qui n’étaient pas possibles ; et, confondant les styles, les époques, ne tenant pas compte de l’épuisement des sources financières qui se tarirent au milieu du XIIIe siècle, on les accuse de n’avoir pas su achever ce qu’ils avaient commencé. Mais les architectes qui, en 1490, élevaient une cathédrale, ne pouvaient supposer alors (tel était l’entraînement général) que les moyens dont ils disposaient viendraient à s’amoindrir. Lorsqu’ils ont pu, par hasard, terminer l’œuvre qu’ils avaient conçue, nous verrons avec quelle puissance de moyens et avec quelle science soutenue ils l’ont fait. Déjà l’exemple de la cathédrale de Paris que nous avons donné le prouve ; nous allons voir qu’il n’est pas le seul. Un fait curieux fait comprendre ce que c’était que la construction d’une cathédrale au commencement du XIIIe siècle. Ce fait étant plus rapproché de nous, bien connu, convaincra, nous le croyons, les esprits les plus enclins au doute. La cathédrale d’Orléans fut détruite de fond en comble par les protestants, à la fin du XVIe siècle. Les Orléanais voulurent avoir non-seulement une cathédrale, mais leur cathédrale, celle qui avait été démolie, et pendant deux siècles ils poursuivirent cette idée, malgré que le goût des constructions ogivales ne fût guère de mode alors. La cathédrale d’Orléans fut rebâtie, et ce n’est pas la faute des populations si les architectes ne surent leur élever qu’un monument bâtard. Certes, nous n’avons pas l’intention de donner cet édifice comme un modèle d’architecture ogivale ; mais sa reconstruction est un fait moral d’une grande portée. Orléans, la ville centrale de la France, avait seule peut-être conservé, en plein XVIIe siècle, le vieil esprit national ; seule elle était restée attachée à son monument, qui lui rappelait une grande époque, de grands souvenirs, les premiers efforts de la société française pour se constituer. Nous l’avons dit déjà, si les châteaux, si les abbayes furent brûlés et dévastés en 1793, toutes nos grandes cathédrales restèrent debout, et beaucoup même ne subirent pas de mutilations.
- ↑ Ces usages ne furent guère abolis qu’à la fin du XIIIe siècle. Jean de Courtenai, archevêque de Reims, donna, en 1260, des lettres de réformation pour la cathédrale de Laon, dans lesquelles on lit ce passage : « Ecclesiam quoque, quæ domus orationis esse debet, locum negociationis fieri prohibemus, nec in eadem rerum quarumlibet merces vendi, causas audiri vel decidi volumus, seu mundana celebrari : imo mundanis exclusis negotiis, solum ibidem divinum negotium fiat. » Cartul. Laudun., Essai sur l’égl. de N.-D. de Laon, par J. Marion, 1843.
- ↑ Tels sont, par exemple, les faits relatifs aux fondations, que Suger dit avoir fait exécuter avec le plus grand soin ; or ces fondations sont aussi négligées que possible : aux colonnes du chœur, qui auraient été rapportées d’Italie, elles proviennent des carrières de l’Oise ; aux vitraux, dans la fabrication desquels il entra une quantité considérable de pierres précieuses, saphirs, émeraudes, rubis, topazes : or ces vitraux, dont nous possédons heureusement de nombreux fragments, quoique fort beaux, sont, bien entendu, en verre coloré par des oxydes métalliques. On objectera peut-être que les fabricants chargés de faire ces vitraux firent croire à Suger que, pour obtenir des verrières d’une belle couleur, il fallait y jeter des pierres précieuses ; mais alors ces vitraux auraient donc été faits en dehors de l’abbaye, et Suger se servait donc d’artistes laïques ? Nous sommes plus disposé à croire que ce récit est une exagération. Suger, tel que nous le représente l’histoire, ne paraît pas être homme à se laisser tromper d’une façon aussi grossière. On devait savoir, dans son abbaye, comment se fabriquaient les vitraux.
- ↑ Ces plans sont tous à la même échelle, 0,001m pour mètre. Il est entendu que lorsque nous parlons du côté sud, c’est la droite que nous prétendons indiquer ; du nord, c’est la gauche pour celui qui regarde la planche, toutes les cathédrales étant orientées de la même manière, sauf de très-rares exceptions.
- ↑ Monog. de l’égl. N.-D. de Noyon, par M. L. Vitet, 1845.
- ↑ La réunion des deux évêchés de Tournay et de Noyon fut maintenue jusque vers 1135 ; à cette époque, les chanoines de Tournay obtinrent une bulle qui prononçait la séparation des deux diocèses et donnait à Tournay un évêque propre.
- ↑ Voyez la Monog. de l’égl. N.-D. de Noyon, par M. L. Vitet, et l’atlas de planches, par M. D. Ramée ; 1845.
- ↑ Lettres sur l’hist. de France, Aug. Thierry (Lettre XVIII).
- ↑ Essai hist. et archéol. sur l’égl. cathéd. de N.-D. de Laon, par J. Marion, 1843.
- ↑ Dom Bugnâtre.
- ↑ Dom Bugnâtre.
- ↑ Regist. capit.
- ↑ Idem.
- ↑ Lettres sur l’Hist. de France, par Aug. Thierry (Lettre XV).
- ↑ Monog. de la cathéd. de Noyon.
- ↑ Cette partie de la cathédrale de Laon est aujourd’hui en pleine restauration, sous la direction de M. Bœswiswald, architecte des monuments historiques. La cathédrale de Laon n’est plus siége épiscopal depuis la révolution ; elle dépend du siége de Soissons.
- ↑ Nous comprenons la cathédrale de Bourges dans cette période, parce qu’il y a lieu de présumer, en examinant son plan, que les architectes du XIIIe siècle qui la construisirent exécutèrent un projet antérieur, peut-être celui qui avait été conçu dans la seconde moitié du XIIe siècle.
- ↑ Descript. de la cathéd. de Chartres, par l’abbé Bulteau, 1850.
- ↑ Poëme des Miracles, p. 27. (Jehan le Marchant.)
- ↑ Notre-Dame de Chartres fut dédiée seulement le 17 octobre 1260.
- ↑ Des fragments de ce jubé ont été découverts en grand nombre sous le dallage ; ils sont de la plus grande beauté, et déposés aujourd’hui dans la crypte et sous la chapelle Saint-Piat (voy. Jubé).
- ↑ La cathédrale de Chartres est bâtie en pierre de Berchère ; c’est un calcaire dur, grossier d’aspect, mais d’une solidité à toute épreuve. Les blocs employés sont d’une grandeur extraordinaire. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces détails (voy. Arc-boutant, Base, Construction, Porche, Pilier, Soubassement).
- ↑ Il est entendu que, pour le pignon nord, nous ne parlons pas des deux portes percées vers le milieu du XIIIe siècle.
- ↑ Seule, la porte centrale est ouverte aujourd’hui.
- ↑ Jean et Remi Legoix.
- ↑ Anquetil.
- ↑ «…. Le nécrologe du chapitre en la fondation de l’obit de cet évesque le faict origenaire de la ville d’Amiens, fort débonnaire et de grande estude, et croyrois que c’est luy qui gist en marbre noir, tout au plus haut, s’il faut ainsi dire, de l’église, vis-à-vis de la chapelle paroissiale (la chapelle de la Vierge dans l’axe) justement derrière le chœur, en mémoire qu’il acheva la summité d’icelle… » Antiquitez de la ville d’Amiens. Adrian de la Morlière, chan., 1627.
- ↑ L’inscription qui constate ce fait existe encore sur la verrière haute située dans l’axe du chœur.
- ↑ De ces dépendances, il ne reste aujourd’hui que la chapelle qui sert de grande sacristie ; elle est décorée par une belle tribune en bois sculpté de la fin du XVe siècle. Une portion du cloître a été reconstruite depuis 1848, ainsi que le petit bâtiment placé en D. Les restes anciens étaient en ruine.
- ↑ Le plan de la cathédrale de Cologne terminée couvre une surface de 8 900 m, environ ; celui de la cathédrale de Reims une surface de 6 650 mètres ; celui de la cathédrale de Bourges une surface de 6 200 mètres ; celui de la cathédrale de Paris une surface de 5 500 mètres.
- ↑ Voy. Architecture Religieuse, fig. 35, un ensemble perspectif de cette coupe.
- ↑ Il est entendu que nous parlons ici de la nef de la cathédrale d’Amiens telle qu’elle existait avant la construction des chapelles du XIVe siècle. Cette adjonction laisse d’ailleurs voir toute la disposition ancienne, et à l’intérieur, dans le transsept, les fenêtres des bas-côtés sont restées en place.
- ↑ L’architecture des chapelles absidales de la cathédrale d’Amiens a la plus grande ressemblance avec celle de la Sainte-Chapelle de Paris. Ce sont les mêmes profils, les mêmes meneaux de fenêtres, le même système de construction. L’arcature de la Sainte-Chapelle basse reproduit celle des chapelles du tour du chœur d’Amiens.
- ↑ Il faut se rappeler que la nef était entièrement élevée lorsque le chœur était à peine commencé.
- ↑ À l’échelle de 0,001m pour mètre, comme tous les autres plans contenus dans cet article.
- ↑ La nef centrale, d’axe en axe des piles, porte, à Amiens, 14m,60 ; à Beauvais, 15m,60.
- ↑ Voy. Arc-boutant, fig. 61.
- ↑ Dans notre plan fig. 22, la teinte grise indique les constructions du XVIe siècle, et le trait le projet de la nef qui ne fut jamais mis à exécution.
- ↑ Voyez l’excellente Notice de M. Félix de Verneilh sur la cathédrale de Cologne, dans les Annales archéologiques de M. Didron, tirée à part ; 1848. (Librairie archéol. de M. V. Didron.)
- ↑ Comme tous les autres, ce plan est à l’échelle de 0,001m pour mètre.
- ↑ Dans le temps où l’on croyait très-sérieusement faire en France de l’architecture romaine, on portait des perruques colossales et des souliers à talons, des canons couverts de rubans, des aiguillettes et des baudriers larges de six pouces, nous n’y voyons pas de mal ; mais on nous dit, très-sérieusement aussi, lorsque nous croyons qu’on peut tirer quelque chose de l’architecture française du XIIIe siècle, et lorsque nous engageons les jeunes architectes à l’étudier, pour combattre cette opinion et ce désir, que nous ne nous habillons plus comme du temps de Philippe-Auguste. Est-ce que nos habits se rapprochent davantage du costume romain que de celui de Louis XIV ?
- ↑ En 1845, il fallut rebâtir le pignon du transsept sud qui s’était écroulé en partie ; déjà, au XVe siècle, on avait consolidé celui du nord. En 1849, il fallut étayer les voûtes du chœur, et, depuis cette époque, des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations ont été exécutés avec une grande adresse ; les chapelles furent restaurées, et on reconstruit aujourd’hui toute la partie supérieure du sanctuaire.
- ↑ Le haut chœur de l’église abbatiale de Saint-Denis a la plus grande analogie avec le chœur de la cathédrale de Troyes.
- ↑ Le chœur seul de cet édifice date du XIIIe siècle (première moitié). La nef appartient, ainsi que les chapelles, aux siècles suivants ; la façade ne fut élevée qu’au commencement du XVIe siècle.
- ↑ Ce plan est à 0,001m pour mètre. La cathédrale d’Autun est mal orientée ; l’abside est tournée vers le sud-sud-est.
- ↑ Voy. Architecture Religieuse, fig. 20.
- ↑ Ce collatéral circulaire a été entouré, au XIVe siècle, de chapelles informes ; mais on retrouve facilement, au-dessus des voûtes de ces chapelles, fort légèrement construites, les dispositions primitives du bas-côté.
- ↑ Quoique la cathédrale d’Autun ait été bâtie en excellents matériaux, bien appareillés, d’un fort volume, et posés avec soin, le grand berceau ogival fit déverser les murs latéraux immédiatement après le décintrage ; on dut soutenir ces murs par des arcs-boutants, qui furent refaits ou rhabillés au XVe siècle. Il y a dix ans, il fallut reconstruire les grandes voûtes en poterie et fer ; elles menaçaient ruine.
- ↑ À l’échelle de 0,001m pour mètre.
- ↑ Nous ne parlons pas des voûtes hautes du chœur et de la nef qui, dans la cathédrale de Sens, furent refaites, vers la fin du XIIIe siècle, à la suite d’un incendie.
- ↑ Il ne faut pas oublier que la cathédrale de Canterbury avait conservé avec la France des relations suivies. Lanfranc, Saint-Anselme, tous deux Lombards, tous deux sortis de l’abbaye du Bec en Normandie, devinrent successivement archevêques de Canterbury, primats d’Angleterre. Saint Thomas Becket demeura longtemps à Pontigny et à Sens ; le trésor de cette cathédrale conserve encore ses vêtements épiscopaux.
- ↑ La cathédrale de Canterbury est à doubles croisillons ; les croisillons de l’ouest dépendent de la Basilique primitive ; ceux de l’est appartiennent à la construction commencée par Guillaume de Sens (voy. The architectural history of Canterbury cathedral, par le professeur Willis, auquel nous empruntons ce curieux passage, que l’auteur a lui-même extrait de la chronique de Gervase).
- ↑ La seule partie contestable de cette restitution serait la chapelle circulaire dans l’axe, remplacée par une chapelle plus profonde élevée, après l’incendie, à la fin du XIIIe siècle. Mais il y a tant d’analogie entre le chevet de Canterbury et celui de Sens, que nous sommes fort disposés à croire que la couronne de Becket n’est qu’une imitation d’une chapelle semblable bâtie à Sens par le maître Guillaume, avant son départ pour l’Angleterre. N’oublions pas que c’est en 1168 que la cathédrale de Sens est terminée, et que c’est en 1175 que Guillaume commence les constructions du chœur de Canterbury. Nous renvoyons nos lecteurs, pour de plus amples renseignements sur ce sujet, à l’excellent ouvrage déjà cité du Profr Willis.
- ↑ Ce beffroi n’existe plus ; il fut descendu, pour cause de vétusté, il y a une dizaine d’années.
- ↑ À l’échelle de 0,001m pour mètre.
- ↑ Mém. concern. l’hist. civ. et eccl. d’Auxerre, par l’abbé Lebeuf, 1848, t. I, p. 402 et suiv. Pour les dispositions intérieures de l’édifice du XIIIe siècle, voyez au mot Construction. Ces dispositions appartiennent franchement à l’école bourguignonne.
- ↑ Au XIVe siècle, un collatéral circulaire et des chapelles furent levées autour du sanctuaire de la cathédrale de Châlons, et la nef fut presque entièrement reconstruite. La partie occidentale de cette cathédrale date du dernier siècle. Après un incendie qui causa les plus graves dommages à cet édifice et qui détruisit la voûte du sanctuaire, une restauration, entreprise sous le règne de Louis XIV, acheva de dénaturer ce qui restait du monument du XIIIe siècle. Cependant on peut encore facilement reconnaître le plan primitif enté sur un édifice roman.
- ↑ La belle cathédrale d’Arras ne fut détruite que depuis la révolution de 1792 ; elle existait encore au commencement du siècle. Celle de Cambrai était l’œuvre de Villart de Honnecourt, ce maître dont nous avons parlé plusieurs fois, l’ami de Robert de Coucy. Vienne possède un modèle de cette cathédrale dépendant d’un plan en relief enlevé, en 1815, du musée des Invalides, par les généraux autrichiens.
- ↑ Ce plan est à l’échelle de 0,001m pour mètre. Il est entendu que nous n’avons eu, pour le tracé de l’abside principale, que des données fort vagues. Mais nous présentons ce plan comme un type plutôt que comme un édifice particulier.
- ↑ La position inusitée de ce clocher ne peut être expliquée que par la détermination, prise à la fin du XIIIe siècle, de ne pas étendre plus loin que les transsepts les nouvelles constructions, et de conserver la nef romane restaurée au XIIe siècle. Dans l’église primitive, dont nous avons donné le plan fig. 34, le clocher unique devait être posé sur les quatre piles de la croisée, suivant la méthode normande. Démoli lorsqu’on refit le chœur, en renonçant à la reconstruction totale, on ne trouva pas d’autre place pour recevoir les cloches que l’extrémité du croisillon sud.
- ↑ De funestes restaurations furent entreprises sur la façade et autour de la nef de la cathédrale de Séez, de 1818 à 1849 ; elles n’ont fait qu’empirer un état de choses déjà fort dangereux. Des travaux, exécutés avec intelligence et soin depuis cette époque, permettent d’espérer que ce remarquable édifice pourra être sauvé de la ruine dont il est menacé depuis longtemps.
- ↑ Voir le plan du premier étage de la cathédrale de Chartres, où ce parti est largement développé.
- ↑ Par suite de ces constructions successives, faites d’ailleurs en matériaux peu résistants, des écrasements si graves se sont manifestés dans les quatre points d’appui, sous l’énorme charge qu’ils ont à porter, qu’il a fallu cintrer les quatre arcs doubleaux, étayer les piliers, et procéder à la démolition des parties supérieures.
- ↑ La cathédrale de Bayeux possède encore, des deux côtés du chœur, ses sacristies et salle de trésor, et, au nord de la façade occidentale, une belle salle capitulaire du XIIIe siècle (voy. Salle capitulaire).
- ↑ Les chapelles de la nef présentent une disposition si belle et si rare, que nous avons cru devoir les donner sur ce plan, bien qu’elles dénaturent les dispositions primitives. Ces chapelles sont mises en communication les unes avec les autres à une hauteur de trois mètres environ, par des claires-voies ou meneaux sans vitraux ; c’est comme un collatéral qui serait divisé par des cloisons transversales peu élevées.
- ↑ Le portail des Libraires (nord) vient d’être restauré par MM. Desmarets et Barthélemy, avec un soin et une perfection qui font le plus grand honneur à ces deux architectes.
- ↑ Hist. de l’égl. cathéd. de Rouen, 1696, Rouen.
- ↑ « Chacun sçait (dit Pommeraye dans son Hist. de l’égl. cathéd. de Rouen, p. 35) qu’elle a eü ce nom à cause de la permission que le cardinal Guillaume d’Estouteville obtint pour les fidelles du diocèse de Roüen et d’Évreux d’user de beurre et de laict pendant le carême… Robert de Croismare (archevêque de Rouen) destina au bâtiment de cette tour les deniers qui furent offerts par les fidelles pour reconnoissance de cette faveur… La tour ne fut achevée qu’en 1507… »
- ↑ À la suite de l’incendie de 1821, une partie de la toiture des grands combles et les voûtes de la nef furent refaites à neuf.
- ↑ Nous désignons ici l’ancienne cathédrale de Périgueux et non la cathédrale actuelle, rétablie dans l’église abbatiale de Saint-Front.
- ↑ Seule la tour du nord existe aujourd’hui.
- ↑ Nous devons ces dessins à notre ami, M. Abadie, architecte de la cathédrale d’Angoulême, qui vient de terminer avec autant de bonheur que de talent le démontage et la reconstruction pièce par pièce de la belle tour dont nous donnons la coupe.
- ↑ Voyez L’Archit. byzantine en France, par M. Félix de Verneilh. Paris, 1851, p. 283 et suiv.
- ↑ Voyez le même ouvrage, et l’article Architecture Religieuse.
- ↑ Comme tous les autres plans, celui-ci est à l’échelle de 0,001m pour mètre.
- ↑ En faisant quelques fouilles, M. Mallay, architecte, a retrouvé exactement le plan de la cathédrale du Xe au XIe siècle, dont les dispositions se rapportaient à celles de toutes les églises romanes d’Auvergne.
- ↑ Deux tours qui subsistaient encore sur cette façade, mais qui avaient été dénaturées depuis longtemps, ont dû être démolies parce qu’elles menaçaient de s’écrouler.
- ↑ La nef de la cathédrale de Limoges resta inachevée comme celle de la cathédrale de Clermont. À l’ouest (voy. fig. 47), on a laissé subsister un débris de l’ancienne nef romane et les soubassements de la tour du XIe siècle, renforcés et surélevés au XIIIe et au XIVe siècle (voy. Clocher).
- ↑ Ce chœur est à peu près aussi élevé que celui des cathédrales de Beauvais et de Cologne.
- ↑ L’un des archevêques de Narbonne, pendant le dernier siècle, voulut reprendre cette construction et élever l’église au moins jusqu’à la première travée en avant des transsepts ; l’entreprise fut bientôt suspendue ; les constructions, reprises de nouveau il y a quinze ans, n’ont fait qu’ajouter quelques assises à celles laissées en attente à la fin du XVIIIe siècle. Dans notre plan, la teinte grise indique les constructions dernières, et le trait le projet probable.
- ↑ Cette nef dans œuvre n’a pas moins de 24 mètres ; les voûtes sont en arcs d’ogives, portées sur des piles et contrebuttées par des contreforts formant des travées intérieures profondes ou des chapelles entre eux. Il est probable que cette disposition était une de celles adoptées dans ces provinces avant l’invasion du style français, après les guerres des Albigeois.
- ↑ Aujourd’hui l’église de la Cité, le siége épiscopal ayant, depuis le concordat, été transféré dans la ville basse.
- ↑ Cette salle a été modifiée au XVe siècle. Le tombeau de l’évêque Radulphe est placé dans la chapelle (voy. Tombeau).
- ↑ Ce plan est à la même échelle que les autres, 0,001m pour mètre.
- ↑ La crypte romane de l’église cathédrale de Limoges, qui existe encore et était placée sous le chevet, n’arrive guère qu’au milieu du sanctuaire actuel. Les fondations de la cathédrale romane de Clermont ne dépassent pas la première travée du chœur.
- ↑ À l’échelle de 0,001m pour mètre.
- ↑ Voir la coupe de la cathédrale d’Alby, à l’article Architecture Religieuse, fig. 51.
- ↑ Membre de l’Institut.
- ↑ Si l’on doute de nos assertions, on peut consulter l’excellent ouvrage de M. de Coussemaker sur cette matière, et les travaux de M. Félix Clément, qui a bien voulu nous fournir tous ces renseignements scientifiques (voy. les Annales archéol. de M. Didron).
- ↑ Paris, Amiens, Chartres, portail méridional ; Reims, portail septentrional.
- ↑ Idem.
- ↑ Amiens.
- ↑ Paris.
- ↑ Paris, Amiens. À Chartres, les vertus et les vices sont sculptés sur les piles du porche méridional.
- ↑ Paris.
- ↑ Paris, Amiens, Sens.
- ↑ Amiens
- ↑ Paris, Amiens, Reims, Chartres.
- ↑ Paris, Amiens, Reims, Chartres.
- ↑ Amiens.
- ↑ Paris.
- ↑ À Paris, la Vierge est à la porte de gauche, en regardant le portail ; à Amiens, à la porte de droite.
- ↑ Paris, Amiens.
- ↑ Idem.
- ↑ Amiens, Reims.
- ↑ Paris.
- ↑ Amiens.
- ↑ Paris.
- ↑ Amiens, Senlis.
- ↑ Paris, Amiens, Senlis, Reims.
- ↑ Amiens.
- ↑ Reims, portail septentrional ; Amiens ; Paris, Meaux, portail méridional.
- ↑ Paris, Reims, Amiens.
- ↑ À Paris, à Reims, à Amiens, on a voulu voir, dans ces statues de rois, la série des rois de France ; et cette idée populaire date de fort loin, puisqu’elle est déjà exprimée au XIIIe siècle. L’une de ces statues, invariablement posée sur un lion, est alors prise pour Pépin. Dans les XXIII manières de vilains, manuscrit qui date de la fin du XIIIe siècle, on lit ce passage : « Li vilains Babuins est cil ki va devant Notre-Dame à Paris, et regarde les rois et dist : « Vés-la Pépin, vés-la Charlemainne. » « Et on li coupe sa borse par derière. » Nous ne voyons pas cependant que les évêques qui, à la fin du XIIe siècle fixèrent les règles générales de l’iconographie des cathédrales, aient voulu représenter les rois de France sur les portails des églises du titre de Sainte-Marie, mais bien plutôt les rois de Juda ; car rien ne rappelle l’histoire contemporaine dans ces grands monuments, ou, quand par hasard, elle s’y montre, ce n’est que d’une manière très-accessoire ; le manuscrit cité ici est une satyre et son auteur a bien pu d’ailleurs, en faisant ainsi parler le badaud parisien devant le portail de Notre-Dame de Paris, vouloir rappeler une erreur populaire. Il nous parait bien plus conforme à l’esprit de l’époque d’admettre que les statues des rois sont des rois de Juda, puisqu’ils complètent, par leur présence, les représentations des personnages qui participent à la venue du Christ. Le roi toujours posé sur un lion, et tenant une croix et une épée, ne peut être que David ; l’autre roi, tenant également une croix et un anneau, Salomon. D’ailleurs, avant le règne de Philippe-Auguste, et même jusqu’à celui de saint Louis, les évêques ne pouvaient avoir, de la puissance royale, les idées admises à la fin du XIIIe siècle. Il nous suffira, pour faire comprendre ce qu’était, au XIIe siècle, un roi de France aux yeux de l’évêque et du chapitre de Paris, de citer un fait rapporté par un écrivain contemporain, Étienne de Paris. « J’ai vu, dit-il, que le roi Louis (VII), qui voulait arriver un jour à Paris, étant surpris par la nuit, se retira dans un village des chanoines de la cathédrale appelé Creteil (Cristolium). Il y coucha ; et les habitants fournirent la dépense. Dès le grand matin, on le vint rapporter aux chanoines ; ils en furent fort affligés et se dirent l’un à l’autre : « C’en est fait de l’Église, les priviléges sont perdus : il faut ou que le roi rende la dépense, ou que l’office cesse dans notre église. » Le roi vint à la cathédrale dès le même jour, suivant la coutume où il étoit d’aller à la grande église, quelque temps qu’il fit. Trouvant la porte fermée, il en demanda la raison, disant que si quelqu’un avoit offensé cette église, il vouloit la dédommager. On lui répondit : « Vraiment, sire, c’est vous-même qui, contre les coutumes et libertés sacrées de cette sainte église, avez soupé hier à Creteil ; non à vos frais, mais à ceux des hommes de cette église : c’est pour cela que l’office est cessé ici, et que la porte est fermée, les chanoines étant résolus de plutôt souffrir toutes sortes de tourments que de laisser de leur temps enfreindre leurs libertés. » Ce roi très-chrétien fut frappé de ces paroles. « Ce qui est arrivé, dit-il, n’a point été fait de dessein prémédité. La nuit m’a retenu en ce lieu, et je n’ai pu arriver à Paris comme je me l’étois proposé. C’est sans force ni contrainte que les habitants de Creteil ont fait de la dépense pour moi ; je suis fâché maintenant d’avoir accepté leurs offres. Que l’évêque Thibaud vienne, avec le doyen Clément, que tous les chanoines approchent, et surtout le chanoine qui est prévôt de ce village : si je suis en tort, je veux donner satisfaction ; si je n’y suis pas, je veux m’en tenir à leur avis. » Le roi resta en prière devant la porte en attendant l’évêque et les chanoines. On fit l’ouverture des portes ; il entra en l’église, y donna pour caution du dédommagement la personne de l’évêque même. Le prélat remit en gage aux chanoines ses deux chandeliers d’argent ; et le roi, pour marquer par un acte extérieur qu’il vouloit sincèrement payer la dépense qu’il avait causée, mit de sa propre main une baguette sur l’autel, laquelle toutes les parties convinrent de faire conserver soigneusement, à cause que l’on avoit écrit dessus, qu’elle étoit en mémoire de la conservation des libertés de l’Église. » (Hist. des Dioc. de Paris, l’abbé Lebeuf, t. XII.) Nous le demandons, est-il possible d’admettre que, quarante ou cinquante ans après une scène de ce genre, l’évêque et le chapitre de Paris eussent fait placer, sur le portail de la cathédrale neuve, au-dessus des trois portes, au-dessus du Christ, des statues colossales des rois de France, quand on commençait à peine à se faire une idée du pouvoir monarchique ?
- ↑ À Paris. Autrefois à Amiens.
- ↑ On n’a pas oublié qu’à Paris l’une des deux églises cathédrales était placée sous le titre de saint Étienne. Le tympan de la porte sud retrace la prédication et le martyre de ce saint, dont la statue était posée sur le trumeau ; dans les ébrasements étaient rangées les statues de saint Denis, de ses deux compagnons, et de quelques autres saints évêques du diocèse. La statue de saint Étienne se voyait encore dans l’une des niches latérales de la façade. Ce fut, en effet, pour bâtir cette façade que l’on détruisit les restes de la vieille église de Saint-Étienne ; et lors de la construction de cette façade, le portail sud actuel n’était point élevé.
- ↑ Reims.
- ↑ Paris, sur les pignons des fenêtres des chapelles du chœur ; Reims.
- ↑ Canterbury
- ↑ Saint-Omer.
- ↑ Genève ; Canterbury.
- ↑ Un jour quelqu’un nous dit, en parcourant l’intérieur de Notre-Dame d’Amiens : « Oui, c’est fort beau : mais c’est folie de vouloir conserver, quand même, ces monuments d’un autre âge qui ne disent plus rien aujourd’hui ; vous pourrez galvaniser ces grands corps ; la manie de l’archéologie et du gothique leur donnera quelques années d’existence de plus ; mais, cette mode passée, ils tomberont dans l’oubli, au milieu de populations qui ont besoin de chemins de fer, d’écoles, de marchés, d’abattoirs, de tout, enfin, ce qui est nécessaire à la vie journalière. » À quelques jours de là, une grande solennité publique appelait dans la cathédrale un immense concours de monde ; elle était parée de quelques maigres tentures, son chœur étincelait de lumières. Notre interlocuteur ne se souvenait plus de son discours précédent ; il s’écriait alors : « Vraiment, c’est bien là le monument de la cité ; tout ce qu’on peut faire pour donner de l’éclat à une cérémonie publique n’a jamais cet aspect imposant du vieux monument qui appelle toute la population de la ville sous ses voûtes. Voyez comme cette foule donne la vie à ce grand vaisseau si bien disposé pour la contenir ! Combien d’illustres personnages ont abrités ces arceaux ! Quelle idée merveilleuse d’avoir voulu et su élever la cathédrale comme un témoin éternel de tous les grands événements d’une cité, d’un pays ; d’avoir fait que ce témoin vit, parle, en présentant au peuple ces exemples tirés de l’histoire de l’humanité, ou plutôt du cœur humain ! » Pour un peu, notre interlocuteur, entraîné par la grandeur du sujet, nous eût accusé de froideur. Telle est aujourd’hui la cathédrale française : aimée au fond du cœur par les populations ; tour à tour flattée et honnie par ceux qui sont charmés de s’en servir, mais qui ne songent guère à la conserver ; occupée par un clergé sans ressources, et souvent insouciant ; énigme pour la plupart, dernier vestige des temps d’ignorance, de superstition et de barbarie pour quelques-uns, texte de phrases creuses pour ces rêveurs, amateurs de poésie nébuleuse, qui ne voient qu’ogives élancées vers le ciel, dentelles de pierre, sculpture mystérieuse ou fantastique, dans des monuments où tout est méthodique, raisonné, clair, ordonné et précis ; où tout a sa place marquée d’avance, et retrace l’histoire morale de l’homme, les efforts persévérants de son intelligence contre la force matérielle et la barbarie, ses épreuves et son dernier refuge dans un monde meilleur.
