Mœurs des diurnales/0/1
NOTIONS GÉNÉRALES
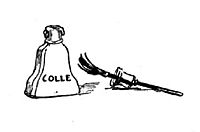
NOTRE MAÎTRE
L’avez-vous vu ? — Qui ? — Dites, l’avez-vous vu ? — Qui ? mon… — Chut, ce n’est pas ça. Notre Maître. Si vous ne l’avez pas vu, vous n’avez rien vu.
Il était Notre Maître, bien que, par pure humilité, noblesse et grandeur d’âme, il ne voulût jamais se dire que Notre Oncle. Il était notre Dieu sur terre. Que dis-je — il était ? Il l’est toujours. Nous l’adorons, nous le respectons, nous tâchons à l’imiter de notre mieux, selon notre pauvre pouvoir. Sa grosse ombre plane encore sur nous : elle nous maintient dans les toutes-puissantes et salutaires ténèbres.
Il aima le public, et le public l’aima. Tous les genres lui étaient familiers et il était familier dans tous les genres. Jamais homme ne sut mieux diriger la bienveillance universelle. Le bon sens seul lui servait de guide, c’est-à-dire l’opinion de la foule. Quand la foule n’avait pas d’opinion, par une grâce surnaturelle, il savait deviner celle qu’elle eût dû avoir.
Ah ! que ne l’avez-vous vu siéger, mes amis, mes bons amis, sur son modeste fauteuil de côté, à la Comédie Française ! Il s’efforçait de ne point se faire remarquer. Parfois il semblait dormir : mais c’était à la façon d’Homère, et, comme les dieux d’Homère, un rire inextinguible le secouait du ventre jusqu’à la barbe, aux bons endroits que le public comprend. Il n’avait qu’un préjugé : c’était sa propre intelligence. Il n’était l’adversaire que des idées qu’il ne saisissait pas. Qui de nous oserait tant de charité intellectuelle ?
Les vaudevilles et les farces l’emplissaient d’allégresse. Les drames lui tiraient les larmes. Il s’intéressait à la tragédie. La comédie le divertissait. Il appelait un chat un chat. Sa tolérance était si grande qu’il tâchait souvent de ramener à son niveau les notions qu’il avait du mal à concevoir. D’autres ne se seraient point donné cette peine. Il croyait, par cet effort, accomplir un devoir naturel. C’est ainsi que la Phèdre de Racine lui apparaissait volontiers sous les traits d’une belle-mère de notre temps. Il considérait Œdipe roi comme une manière de vieillesse de M. Lecoq. Ainsi Notre Maître essayait de se familiariser avec toutes choses. Il avait si peu d’ambition qu’il ne se souciait ni d’étonner les autres, ni de s’étonner lui-même. Aussi écrivait-il le plus bonnement du monde, et n’admira-t-il jamais sincèrement que le coq à l’âne.
Il avait eu des lettres, mais il ne voulait pas s’en souvenir, crainte de gêner l’opinion du public par un semblant de supériorité. Il parlait la langue de tout le monde, et pensait avec les idées de tout le monde… Et ce miracle s’accomplissait sans aucun effort apparent, tant il y mettait de bonhomie et de naïveté. Longtemps il souffrit de sa barbe inculte qui lui donnait un air de vieux solitaire, de ses lunettes qui pouvaient le faire prendre pour un savant professeur. C’était là sa seule faiblesse. Pour tout le reste il ne se distinguait en rien du plus commun des hommes.
Sa bonté fut grande. Jamais il ne fut l’ennemi de personne sans raison. Quand on l’attaquait, il répondait de la meilleure grâce du monde quelque chose qui pût faire toujours rire. Sa table était ouverte aux jeunes débutantes. C’était un oncle nourricier. Oh que n’avez-vous pris part à ces déjeuners mémorables où son indulgence était telle qu’il souffrait au café que l’on vînt s’asseoir jusque sur ses genoux !
Il naquit à Dourdan-en-Hurepoix. Ses premières années sont obscures.
À douze ans, en 1839, il avait déjà son embonpoint précoce, sa mine réjouie, son optimisme imperturbable, « sa prétention au bon sens » et ses lunettes[1]. Il arriva rue des Minimes, à l’institution Massin, dans une diligence jaune.
On voit encore, place du marché Sainte-Catherine, l’étroite pâtisserie qui vendait en 1889 des petits pains succulents dont il se régalait. Il se levait à cinq heures du matin ; à sept heures et demie, il avalait une assiettée de soupe ; à une heure un quart, il déjeunait ; il goûtait à quatre heures, et soupait à huit. « Vendredi, écrivait-il à sa mère, pour second plat on nous a donné à chacun un hareng ; je m’en suis joliment régalé. Le dimanche nous avons toujours une petite saucisse. » Sa mère lui envoyait des confitures, du raisiné, du chocolat. « La galette était excellente, lui écrivait-il ; je viens de la finir il y a quelques jours ; le pot de beurre m’a fait aussi un grand plaisir. J’étais, comme tu le dis, un peu las des confitures. J’ai mangé aussi du chocolat… Il y a un élève (Salard, encore plus patapouf que moi) à la pension qui avait dernièrement dans sa baraque une poularde rôtie de son pays, une poularde du Mans. Il a été moqué… Je serais très fâché s’il m’en arrivait autant. »
Il obtint à grand’peine qu’un tailleur lui fît un pantalon à pont. Mais il avait honte de son chapeau. « À l’endroit où l’on met un cordon tout autour, le poil se détache un peu et sur le dessus du chapeau, juste au milieu, il y a un rond blanc qui est en train de s’agrandir. »
Chaque fois qu’il était premier, son père mettait 3 fr. 50 dans une tirelire pour lui acheter un chapeau neuf.
En ces tendres années déjà il « pouffait » de rire (Dieux ! ai-je ri) en allant voir les Folies amoureuses, et il citait Virgile, mieux connu, à la place d’Aratus.
Enfin aux vacances de 1839, il gagna une glace aux dominos et on lui acheta « un couvre-chef flambant neuf et sortant de la fameuse maison Cornu ».
Le 1er aout 1843, à 11 h. 30, il fit ses véritables débuts dans la littérature qu’il devait illustrer. « Il est 11 h. 30, dit-il ; je songe que l’on pourrait fort bien me dire à la pension, comme j’ai entendu dire : il fallait néanmoins faire quelque chose. Je vais bâcler ce que je vais pouvoir dans l’heure et demie qui me reste… Il est midi 1/2. Je n’ai fait que du galimatias… »
Dès ce temps, il savait « tâter » son public, s’ennuyer quand les gens s’ennuient, et rire quand ils ont envie de rire. « Je me trouvai par enchantement au diapason des malheureux qui bâillaient à se décrocher la mâchoire, et nous fîmes chorus tous ensemble ; je n’en connaissais pas un ; nous nous trouvâmes liés par une communauté de sentiments. » Mais bientôt il « enrégimenta une trentaine de moutards ». « Nous sommes tout entiers au rire franc et bête, qui est le vrai rire… tous ont allumé leur gaieté à la mienne, et c’est un feu roulant de saillies et de bons mots. »
La république de 1848 lui donna du plaisir.
« Encore quelques jours, et nous vivrons dans la République comme le poisson dans l’eau. »
M. Massin ayant calmé l’effervescence de sa pension « en apparaissant au seuil du réfectoire le chef orné de sa fameuse casquette verte », sous l’égide de cette « casquette-drapeau, Massini vexilla », Notre Maître fut reçu à l’École Normale, et y conquit rapidement sa place. « Notre année, dit-il, s’est mise assez promptement à la hauteur des deux autres ; personne ne trouve grâce devant leurs yeux : ils n’ont affaire qu’à des mâchoires. »
Le Prince-président vint visiter l’École, et dit aux élèves et à Notre Maître :
— Messieurs, je suis content de vous voir.
Puis il ajouta :
— Dans une demi-heure, il va venir des dames, ce sera plus amusant.
Notre Maître s’intéressait aux idées nouvelles. « Proudhon, dit-il, ressemble comme deux gouttes d’eau à un épicier retiré. »
Il passait ses dimanches chez son oncle, où il lisait le Musée des Familles et jouait au loto.
La mère d’un de ses camarades l’avait pris en amitié. « Je crois, dit-il, qu’au fond elle éprouve un certain plaisir à se charger de mon éducation et qu’elle voudrait, comme on dit, me former. Elle ne me voit pas sans me demander si je me débarbouille toujours à rebrousse-poils ; elle a remarqué que mes sourcils allaient sans cesse en sens contraire et ne me donne pas de cesse que je ne les aie remis en place. »
Dans l’été de 1849, il fit un voyage en Bretagne, où pour la première fois il vit la mer. À cet effet il fit mettre un cordon à son chapeau de feutre pour le nouer sous le menton. La mer lui parut « un beau, très beau spectacle ». Mais il ne voulut pas « beurrer une tartine poétique sur cette immense étendue d’eau où l’œil se perd ». Il préféra se familiariser avec la mer, selon sa coutume. « Nous nous sommes assis sur la falaise ; nous sommes restés près d’une heure sans parler, sans penser même, les yeux attachés sur les flots : nous étions heureux. M. Caboche me racontait qu’aux Pyrénées il y a des hommes qui montent le matin sur une roche et qui y demeurent jusqu’au soir à regarder les vagues, dans une muette et béate contemplation. Je comprends cette vie-là. C’est en grand, mais en très grand, le plaisir du badaud qui, du haut du pont des Arts, regarde l’eau couler ».
Ils débarquèrent à Cherbourg « comme deux ours dans une cage de serins ». Voyageant à pied, ils s’aperçurent « que la marche forcée est un mauvais digestif, que lorsqu’ils déjeunaient bien, ils dînaient assez mal ».
À Auray, leurs pantalons se déchirèrent ; leur cravates étaient « sales à faire peur » ; ils n’avaient plus ni chapeaux ni souliers. Notre Maître, qui a toujours eu l’âme tendre, s’apitoyait sur ses souliers. « Pauvres souliers ! ils n’avaient plus à eux deux qu’une semelle entière… Il est vrai que j’ai un cuir naturel qui s’est durci depuis le commencement du voyage. »
Et il ajoute, avec la grande pudeur qu’il observa toujours : « Je ne parle que de l’extérieur, mais si l’on pouvait pénétrer nos misères intimes ce serait bien pis. Depuis Fécamp nous courons après un bain d’eau chaude, car, pour les bains de mer, ils ne nous ont pas manqué… Par malheur l’eau de mer salit plus qu’elle ne lave, et il ferait bon, après un bain de mer, en prendre un autre pour se nettoyer. »
À la rentrée, après avoir pris un bain, Notre Maître se fit initier à la coquetterie, craignant de devenir « mâchoire ». Il acheta un lorgnon pour remplacer les lunettes — « pas un de ces petits lorgnons qu’on se fourre dans le coin de l’œil et qui vous donnent l’air ou d’un sot ou d’un fat ; c’est un lorgnon comme j’en ai eu autrefois, qui s’ouvre en poussant un ressort ». Il prit des leçons de danse et se fit par sa mère « ouvrir un crédit quelque part pour s’acheter des souliers vernis ». On lui prêta pour se promener « un bâton qui réveilla en lui mille souvenirs ». Enfin il se fit couper la barbe « non pas précisément toute la barbe, mais les deux grosses touffes qui lui hérissaient le menton ». Ses camarades d’École jugèrent « qu’il avait l’air d’un garçon perruquier » et par 14 voix contre 4 votèrent qu’il la laisserait repousser.
Il alla au bal chez M. Papillon, mais n’osa point y danser ni même y consommer : à l’heure où il partit, on ne donnait « encore que des sorbets et des glaces, et encore en très petite quantité ». Il alla donc avec Jules à l’office ce où tout cela se préparait » ; il y prit une glace et y vit des apprêts qui lui « causèrent un certain regret ».
Comme il rentrait, il entendit dire d’une façon « tout à fait désintéressée » qu’il « était très bien maintenant, et avait des yeux superbes ». M. Papillon avait prévenu deux ou trois jeunes filles : mais l’ordre de M. Dubois était que Notre Maître rentrât à l’école sur le coup de minuit. « Ç’a été un deuil général. »
Retourné aux vieux auteurs, après ces exercices, Notre Maître « s’attaqua à un grand sujet : le De re rustica comparé aux Économiques », et souleva le problème de savoir « s’il est légitime à l’homme de manger la chair des animaux ».
Il aborda ensuite la philosophie et admira Jules Simon comme un « blaguologue très distingué ». Il aima moins M. Gérusez qui lui avait apporté « un roman écrit dans un vieux français que personne de nous n’entend… il lit une heure durant cet inintelligible patois du quatorzième siècle ».
Le 29 mai 1850, Lamm proposa « d’immoler Notre Maître, comme le plus gras », sur le tombeau de Voltaire au Panthéon. La proposition ne paraît pas avoir été adoptée : car le 17 juillet, Notre Maître « mit un peu le nez » dans la « Correspondance » du célèbre écrivain.
Le 7 août de la même année, il prit du goût à la lecture des journaux, qu’on « dévorait ». « Nous nous pâmons de rire, » dit-il.
En sa troisième année d’École, son mépris pour l’érudition se fait enfin jour. « Lamm, écrit-il, fouille les vieux bouquins avec autant de persévérance que son nez. » À la Sorbonne M. Patin lui semble « un robinet d’eau tiède » et choque la délicatesse de son ouïe : on le croirait déjà critique dramatique. « Je ne sais de quelle province il arrive, mais il prononce esspression, vôter et estropie les trois quarts des mots. On a l’oreille au martyre. » Au Collège de France, M. Doissonnade, « le premier helléniste d’Europe, radote un peu, mais radote avec beaucoup de grâce ».
Pendant cette troisième année la pensée de Notre Maître mûrit, et il exprima ses premiers jugements sur les hommes. « Ce monde est plein de punaises, plus puantes les unes que les autres. » — « Dire qu’il y a des bêtes brutes qui possèdent des cent mille livres de rente et n’en usent que pour coucher avec des filles d’opéra ! »
Au concours d’agrégation, il faillit éreinter Horatius Flaccus sous le nom de Valerius Flaccus. Comme il était encore jeune, un scrupule lui vint. « Ah ça mais, dit-il à son voisin, est-ce que tu connais cet homme-là, toi ? » Il ne sut pas réparer cette innocente erreur, et fut refusé. Son échec « lui coûta près de quarante sous ».
On le nomma professeur à Chaumont, où il eut un livre de blanchisseuse, apprit à allumer son feu et sa lampe et à coudre ses boutons. Après beaucoup d’efforts il apprit aussi à faire un nœud de cravate. Une dame avait ce bien passé deux heures à « lui seriner son nœud ». La vie était « bonne dans ce pays, mais moins bonne qu’il ne l’avait cru ». Il devait interrompre sa correspondance « pour aller faire un tour à la cuisine ». Il logeait chez M. Brocard, charcutier. « Si ma lettre, dit-il, sent la vieille viande, ce n’est pas moi, c’est mon propriétaire qui en a toujours les doigts pleins. » Il passait presque tout son temps à « bayer aux grues ».
En 1851, prenant part au Plébiscite, il mit « dans l’urne, qui est une belle boîte en sapin, le non le mieux articulé qui se puisse voir ». On lui ferma, pour le punir, « un innocent bouchon où il allait dans les beaux jours d’hiver prendre un verre de rhum. » Car il n’aimait ni le tabac ni la bière. Au bal du préfet trois demoiselles lui refusèrent deux polkas et une valse, et il dut « passer son temps au buffet ».
Aux vacances de 1852, il vient à Paris à l’hôtel Corneille ; il «s’en allait prendre un bouillon le matin, chez un crémier de la rue Racine », et déjeunait « pour ses quatre sous ». Retourné à Chaumont, il quitta le charcutier, et loua chez la veuve Richoux. Cette année-là il écrivit sa fameuse supplique au ministre pour qu’on lui laissât pousser la barbe.
Il fut envoyé en Bretagne, près de la ville de Landerneau, « un gros bourg où on fait un gros commerce ». Il alla loger au-dessus d’un café. Le principal du collège lui ayant demandé une pièce pour la faire jouer par ses élèves, il chercha dans ses souvenirs et se rappela que le Secrétaire et le Cuisinier de Scribe n’a qu’un petit rôle de femme facile à supprimer.
L’an 1853 il fut nommé à Rodez, où il vécut « comme un anachorète : du bouilli et des œufs le matin, du pain et du fromage le soir ». Il eût donné « tout au monde pour une côtelette de mouton » ; mais on ne mangeait en cette ville que de l’agneau, du chevreau et « du veau qui se déchiquette et tombe en morceaux quand on y touche ».
Pour tromper sa faim, il « dévorait les journaux » ; les Débats « qui lui coûtaient dix sous par mois » ; il « trouvait le Siècle chez un collègue et suivait assez exactement le Charivari » ; c’était le journal « qui exprimait le mieux ses convictions politiques ». À table, il « remaniait la carte d’Europe entre la pomme et le fromage. Le fromage était excellent ; c’était du roquefort. »
En 1854 il fut « déshonoré » pour avoir mis au bal des « gants de couleur au lieu des gants blancs qu’il avait préparés ». Tous les regards des dames se fixèrent sur ses mains : « il en eut une sueur froide dans le dos ».
Sa disgrâce devint complète pour être allé voir l’inspecteur général « avec une cravate verte et une chemise rayée », et il fut exilé à Grenoble.
La ville lui plut d’abord. Il y trouva des rues « pavées de cette pierre plate chère aux Parisiens », des trottoirs et « la nuit des becs de gaz ». Il y voyait passer « de jolies filles ; et cela lui réjouissait les yeux. »
Notre Maître se logea chez le père Bouchard, un « fier lapin » et la « crème des hommes », qui prenait le matin « son café au lait dans une vieille soupière ébréchée », avait « vu de la très haute société à Paris » mais avait fini par « s’enfermer dans un petit cercle de vieilles culottes de peau ».
À Grenoble, il s’adonna au théâtre, et joua, pendant le carême, une « grande pantomime en quatre actes » où il représentait Cassandre dans un costume « ébouriffant ». Le « scénario était bête comme chou, mais assez plaisant ».
Enfin dans cette même ville se décida sa vocation « d’Oncle traditionnel, le coffre-fort donné par la nature », et il écrivit chez Bouchard sa première œuvre :
Ayant ainsi pris goût à « dévorer » les journaux, pénétré des opinions du Charivari, charmé par l’ombre de Cassandre et l’idéal d’un Oncle d’opérette, Notre Maître crut à bon droit son éducation achevée.
Le Maître du journalisme débuta le 1er novembre 1857 ; c’était « la première fois qu’il touchait une plume » et il déclarait « n’entendre rien à cet art ». Dès lors sa réputation était consacrée sous le nom de Satané Binet.
Depuis, le monde sait trop ce qu’il fut. Sa vie a été simple comme celle de la matrone antique :
Tel fut Notre Maître. Qui l’aime le suive !
- ↑ Journal de jeunesse de F. Sarcey
